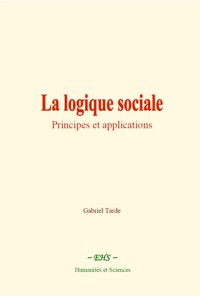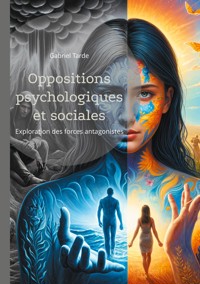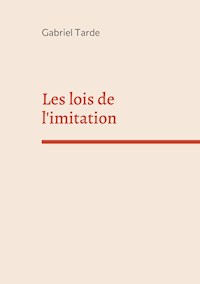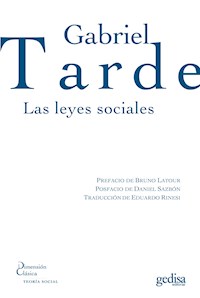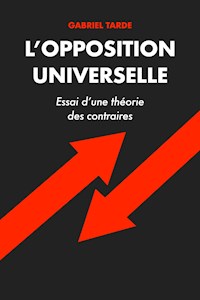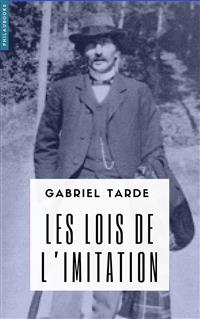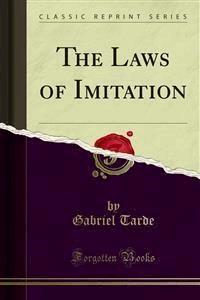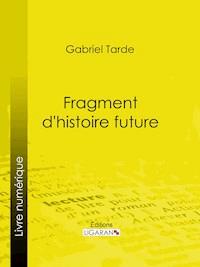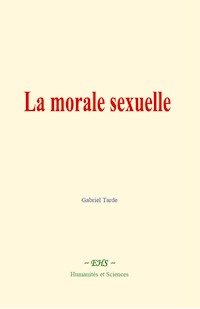
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Dans notre étude sur les transformations morales en général, nous n’avons pu suivre séparément les transformations opérées ou à opérer dans chacune des branches principales de la morale. Le temps nous manque pour entreprendre toutes ces monographies. Mais il en est une qui peut être abordée pendant le peu de temps qui nous reste, et qui, par sa nature, est facile à détacher : c’est l’examen des variations de la morale sexuelle.
Je m’attache à cette catégorie de devoirs parce qu’il n’en est pas qui soit plus propre à réfuter certaines erreurs accréditées et à mettre sur la voie des véritables principes explicatifs de notre sujet. Aux partisans, si nombreux, d’un évolutionnisme unilinéaire qui prétendrait assujettir la morale à traverser une série unique et réglée de phases successives, il suffit d’objecter la diversité si grande des points de départ de l’évolution de la morale sexuelle dans les diverses sociétés, souvent même les plus rapprochées, la diversité non moins grande du cours capricieux et zigzagant de cette évolution, et la différence profonde aussi de son aboutissement, autant qu’il est possible d’en juger, et bien qu’on puisse démêler à certains égards, à travers tant de dissemblances, une certaine tendance générale peut-être.
Il y a quelques années, sous l’influence de quelques auteurs tels que Bachofen, Mac Lennan, Sir John Lubbock, Morgan, etc., on inclinait à penser que la promiscuité au sein du clan ou de la tribu avait été le point de départ primitif et universel de l’évolution des rapports sexuels. Cette hypothèse a été battue en brèche par Westermarck, entre autres écrivains, avec une si grande vigueur qu’il n’en reste rien. Ce que l’on considérait à tort comme la règle est devenu l’exception infime et même contestable. Beaucoup de peuples, par exemple les Fuégiens, qu’on avait signalés comme livrés à la promiscuité la plus bestiale, professent au contraire de l’aversion pour l’adultère et le libertinage ; et, si chez d’autres peuples on voit une licence de mœurs qui s’approche de la promiscuité, ce n’est nullement chez les peuples les plus inférieurs. Les Veddahs, le plus infime peut-être des peuples connus, pratiquent la monogamie indissoluble. — Les tribus les plus immorales sont celles qui ont été corrompues par le contact des Européens...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 64
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La morale sexuelle.
La morale sexuelle
La morale sexuelle{*}
Dans notre étude sur les transformations morales en général, nous n’avons pu suivre séparément les transformations opérées ou à opérer dans chacune des branches principales de la morale. Le temps nous manque pour entreprendre toutes ces monographies. Mais il en est une qui peut être abordée pendant le peu de temps qui nous reste, et qui, par sa nature, est facile à détacher : c’est l’examen des variations de la morale sexuelle.
Je m’attache à cette catégorie de devoirs parce qu’il n’en est pas qui soit plus propre à réfuter certaines erreurs accréditées et à mettre sur la voie des véritables principes explicatifs de notre sujet. Aux partisans, si nombreux, d’un évolutionnisme unilinéaire qui prétendrait assujettir la morale à traverser une série unique et réglée de phases successives, il suffit d’objecter la diversité si grande des points de départ de l’évolution de la morale sexuelle dans les diverses sociétés, souvent même les plus rapprochées, la diversité non moins grande du cours capricieux et zigzagant de cette évolution, et la différence profonde aussi de son aboutissement, autant qu’il est possible d’en juger, et bien qu’on puisse démêler à certains égards, à travers tant de dissemblances, une certaine tendance générale peut-être.
Il y a quelques années, sous l’influence de quelques auteurs tels que Bachofen, Mac Lennan, Sir John Lubbock, Morgan, etc., on inclinait à penser que la promiscuité au sein du clan ou de la tribu avait été le point de départ primitif et universel de l’évolution des rapports sexuels. Cette hypothèse a été battue en brèche par Westermarck, entre autres écrivains, avec une si grande vigueur qu’il n’en reste rien. Ce que l’on considérait à tort comme la règle est devenu l’exception infime et même contestable. Beaucoup de peuples, par exemple les Fuégiens, qu’on avait signalés comme livrés à la promiscuité la plus bestiale, professent au contraire de l’aversion pour l’adultère et le libertinage ; et, si chez d’autres peuples on voit une licence de mœurs qui s’approche de la promiscuité, ce n’est nullement chez les peuples les plus inférieurs. Les Veddahs, le plus infime peut-être des peuples connus, pratiquent la monogamie indissoluble. — Les tribus les plus immorales sont celles qui ont été corrompues par le contact des Européens...
Ce qui résulte de plus net des recherches les plus approfondies sur les relations sexuelles dans le passé, c’est l’extrême diversité du point de départ de leur transformation jusqu'à nous. « Parmi les indigènes de l’archipel Indien, le professeur Wilken affirme que, à côté de peuples livrés à une licence extrême, il y en a d’autres qui sont remarquablement chastes. Ainsi chez les Nias, la grossesse d’une jeune fille est punie de mort, non seulement pour elle mais pour son séducteur... » (Westermarck). Chez les Tasmaniens, la moralité des jeunes gens a frappé les voyageurs.
On a voulu ériger en phase universelle et nécessaire de l’évolution de la famille ce que l’on a appelé le matriarcat, et qui se réduit, en somme, à ce que, dans beaucoup de tribus, la parenté par les femmes est seule reconnue. Or, « bien que le nombre des peuples chez qui la descendance et les héritages ne suivent que le côté de la mère soit très considérable, il n’y en a guère moins chez qui la descendance masculine soit reconnue, même sans compter les nations civilisées... » (Westermarck). Et, parmi ces derniers, parmi ceux qui font valoir la parenté par les hommes, se trouvent « beaucoup des races les plus grossières du monde, les indigènes du Brésil, les Fuégiens, les Hottentots, les Boschimans, et plusieurs tribus très inférieures de l’Australie et de l’Inde... ». En quoi ces grossiers sauvages se rencontrent avec les plus grandes races de l’humanité, lesquelles, comme le remarque Sir Henry Maine, dès le moment où elles nous apparaissent dans l’histoire, se montrent toutes à l’état patriarcal sans nulle trace nette de matriarcat antérieur.
Et il y aurait bien des subdivisions à établir : « Chez les Caraïbes, par exemple, la parenté était comptée dans la ligne féminine, mais l’autorité des chefs était héréditaire dans la ligne masculine seule, les enfants des sœurs étant exclus de la succession » (Westermarck).
C’est une erreur de croire que, à l’origine, les femmes sont partout regardées comme la propriété de l’homme et vendues par le père au mari, à moins qu’elles ne soient ravies de force. Chez beaucoup de peuples très sauvages, elles ne sont mariées que de leur consentement. « Heckewelder cite des exemples d’indiens qui se sont suicidés parce qu’ils ont eu des déceptions dans leurs amours, les filles qu’ils avaient choisies et à qui ils étaient fiancés ayant changé d’idée et épousé d’autres amoureux... » On se persuaderait donc à tort que les suicides d’amour sont le monopole de la civilisation. — Marier une fille contre son gré, sans nul égard à son inclination, est un fait qui n’a rien de primitif ; c’est seulement quand un certain niveau économique a été atteint, permettant la vente et l’achat, qu’un père a pu avoir l’idée de vendre sa fille, et, dès lors, de ne tenir aucun compte de ses désirs. Mais, en remontant plus haut, nul despotisme de ce genre n’est concevable et n’est observé. Nous ne pouvons pas croire la femme primitive inférieure à la femelle animale, qui, presque toujours, a une certaine liberté de choix entre ceux qui la courtisent.
Ce serait une erreur de croire que, depuis que le monde est monde, les changements qui se sont opérés dans la famille ont eu pour effet de diminuer l’inégalité soi-disant primitive entre l’homme et la femme, d'affranchir par degré la femme et de l'égaler à l’homme. En Égypte, c’est le changement inverse qui s’est opéré des Pharaons aux Ptolémées. Dans les plus anciennes époques, nous voyons l'épouse égyptienne tout à fait l'égale de son mari ; après la conquête grecque et romaine, la situation au logis a subi une sorte de diminution juridique.
La passion de généraliser mal à propos, suscitée par le parti pris de tout soumettre à des formules d’évolution rigides et uniformes, avait conduit Mac Lennan à conjecturer que, à une certaine phase de l’évolution de la famille, l’infanticide des filles avait été universellement pratiqué, ce qui, d’après lui, était l’explication de l’exogamie des clans... Mais Spencer et des ethnologues distingués ont démoli cette hypothèse (qui, du reste, eût-elle été admise, n’eût en rien expliqué l’exogamie des clans). « Chez beaucoup de peuples sauvages actuels, dit Westermarck, on n’en entend jamais parler — comme, par exemple, chez les Tuskis, les Ahts, les Esquimaux occidentaux, les Botocudos, et dans certaines tribus de la Californie... » ; « M. Fison, qui a vécu pendant beaucoup d’années parmi des races non civilisées, pense qu’on trouve l’infanticide féminin bien moins commun chez les sauvages inférieurs que parmi les tribus les plus avancées. » Ce qui est contraire à l’hypothèse.
Une des généralisations les plus excusables est celle qui consiste à universaliser l’exogamie des clans. Mais cette assertion elle-même est démentie par beaucoup de faits. Tous les clans ne sont pas exogames, il en est d’endogames. Rien de plus variable, d’après les peuples, que l’étendue des deux cercles concentriques, dont l’un comprend les personnes avec lesquelles on ne peut pas se marier, et l’autre, plus large, les personnes en dehors desquelles on ne doit pas se marier.
On a voulu généraliser aussi le mariage par enlèvement et par capture. Mais quel est donc ce cauchemar archéologique, de se représenter les tribus primitives comme toutes en guerre les unes avec les autres ! Partout où l’on voit des guerres, on voit aussi des alliances entre les tribus ; et partout des mariages, qui n’ont rien du rapt, sont le gage le plus sûr d’une alliance fidèle et durable entre deux peuples. C’est donc une grossière erreur de supposer que, à aucune époque de l’humanité, tous les mariages aient été opérés par capture violente.
Peut-on admettre que la polygamie