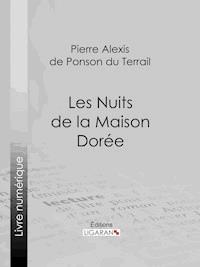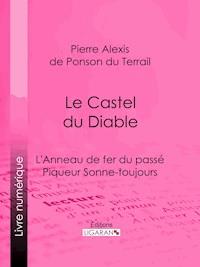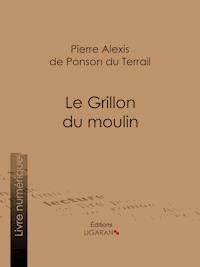Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Il est un personnage de cette histoire que nous avons un peu perdue de vue. C'est une jolie actrice des théâtres de genre, appelée Pauline Régis, qui avait tant aimé le malheureux Manuel de Maugeville. Pauline ne savait absolument rien de tout ce qui s'était passé depuis un mois. Paris est la grande ville où viennent se confondre et mourir tous les bruits. A peine si quelquefois un journal répète, en manière défaits-divers, un crime, un enlèvement commis en..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Il est un personnage de cette histoire que nous avons un peu perdue de vue.
C’est une jolie actrice des théâtres de genre, appelée Pauline Régis, qui avait tant aimé le malheureux Manuel de Maugeville.
Pauline ne savait absolument rien de tout ce qui s’était passé depuis un mois.
Paris est la grande ville où viennent se confondre et mourir tous les bruits.
À peine si quelquefois un journal répète, en manière de faits-divers, un crime, un enlèvement commis en province, en empruntant ce récit à une feuille départementale.
Puis, le lendemain, il n’en est plus question.
Pauline vivait dans la retraite la plus absolue depuis un mois.
Elle ne lisait pas de journaux ; elle ne jouait pas, ne répétait pas, et par conséquent n’allait pas au théâtre.
Son appartement était clos aux visiteurs, et la consigne était rigoureusement observée.
La jeune femme s’était dit :
– J’ai le cœur malade, et mon mal n’a d’autre remède que le temps. Je ne veux parler à personne et je ne veux pas qu’on m’en parle. Si je me guéris jamais, je reparaîtrai dans ce monde qui oublie si vite, et qui m’a déjà presque oubliée.
On se souvient que Corinne, quelques jours avant son départ pour Roche-pinte, était parvenue à forcer la consigne et à pénétrer chez Pauline.
On se souvient encore que, tandis que les deux amies déjeunaient, une fenêtre s’était ouverte au troisième étage de la maison voisine, de l’autre côté de la rue, et que tout à coup Corinne, ébahie, avait aperçu M. de Villenave hébété, stupide à cette fenêtre.
On sait ce qui était advenu, mais Pauline ne le savait pas.
Depuis ce jour-là, elle n’avait pas revu Corinne, et Corinne ne lui avait point écrit.
Tout en ayant rompu avec la plupart de ses relations et ne se montrant plus ni au bois, ni aux courses, ni aux premières, Pauline ne s’était pourtant pas condamnée à une réclusion perpétuelle.
Quelquefois, le soir, un voile-masque sur le visage, elle montait dans une voiture de place et allait respirer le grand air.
Quelquefois aussi elle sortait de très bonne heure, s’en allait à pied jusqu’au manège de la rue Duphot, qui est à deux pas de la rue Caumartin, demandait un cheval et poussait jusqu’au rond-point du Cèdre ou à la grille de Boulogne.
C’étaient là ses seules distractions.
Le reste du temps, elle demeurait chez elle et travaillait.
Or, un matin, comme elle traversait au galop la grande avenue de Longchamp pour gagner une de ces petites allées si nombreuses et si fraîches qu’on réserve aux cavaliers, et qui sont si peu fréquentées cependant, elle entendit prononcer son nom.
– Pauline ! disait une voix de femme.
Pauline s’arrêta et aperçut dans une allée perpendiculaire à celle qu’elle suivait une amazone qui arrivait sur elle.
Elle s’arrêta et reconnut ce que, en style de coulisse, on appelle une camarade.
C’était une ancienne ingénue des Variétés, qui n’avait pas de talent, et qui, après avoir longtemps cherché sa mesure, comme on dit s’était aperçue qu’au lieu de figurer sur une scène de genre, elle ferait une fort belle écuyère du Cirque.
Florina, c’était son nom, était restée à l’Hippodrome, où elle conduisait des chars, traversait des cerceaux en papier, représentait les dames du Camp du drap d’or, et sautait d’un cheval sur l’autre.
Le matin, elle se promenait pour son plaisir. Florina était lancée ; elle avait, en dehors de son métier, chevaux et voitures, un riche appartement, et pour ami une manière de gros banquier hollandais qui se ruinait pour elle, sous le prétexte qu’il aimait les belles femmes, et que Florina était une majestueuse créature.
Cette grosse femme qu’au théâtre on appelait jadis une grue et qui s’était fait siffler chaque fois qu’elle avait voulu aborder un rôle de cinquante lignes, – cette femme, disons-nous, était cependant pleine d’esprit.
Son humeur légèrement égrillarde, sa gaieté inaltérable lui valaient ses grandes et ses petites entrées dans ce qu’on appelle le monde des viveurs.
Florina allait partout, était au courant de tout, avait tout vu, tout entendu.
Pauline n’était pas liée avec elle ; mais, lorsqu’elles se rencontraient, elles se disaient volontiers bonjour.
– Pauline ! répéta Florina.
Elle poussa son cheval et vint le ranger côte à côte de celui de Pauline. Celle-ci lui tendit la main.
– Comment vas-tu ? dit l’écuyère qui tutoyait tout le monde.
– Assez bien, et vous ?
– Moi, tu le vois, j’engraisse toujours.
Et Florina se mit à rire.
– Mais, reprit-elle, que deviens-tu donc, ma petite ? On ne te voit plus.
– J’arrive de voyage.
– Es-tu par hasard allée enterrer cette pauvre Corinne ?
Florina faisait cette question de son air jovial et bon enfant.
On eût dit qu’elle demandait des nouvelles d’un terrier-bull ou d’un perroquet.
Mais Pauline, stupéfaite, s’écria :
– Corinne ? quelle Corinne ?
– Eh bien ! la tienne, la mienne, la nôtre donc, Corinne Destremont !
– Corinne… balbutia encore Pauline Régis. Eh bien ?
– Eh bien ! elle est morte.
– Morte !
Et Pauline éprouva une telle émotion qu’elle vacilla sur sa selle.
– Comment ! tu n’en savais rien ?
Cette fois, Florina cessa de rire, car elle vit Pauline si pâle, qu’il lui sembla qu’elle allait se trouver mal.
En effet, Pauline avait comme un étourdissement ; elle se laissa glisser de sa selle et s’assit, anéantie, sur le gazon de la contre-allée.
Florina était bonne fille :
– Mon Dieu ! dit-elle, et moi qui ne pensais plus que vous étiez amies, et qui parle de ça comme du Grand Turc !
Elle appela son groom, qui la suivait à distance sur un robuste poney d’Irlande, lui donna sa jument à tenir et, relevant la jupe de son amazone, sauta lestement à terre.
Pauline avait éprouvé une telle émotion qu’elle était là muette, les yeux axes, tout le corps agité d’un tremblement nerveux.
– Heureusement, reprit Florina, que nous sommes à deux pas d’Armenonville, et elle dit à son groom :
– Emmène les chevaux au pavillon et ramène-nous une voiture.
Dix minutes après, Pauline et l’écuyère étaient enfermées dans un des petits salons du pavillon, et Pauline commençait à se remettre de la violente émotion qu’elle venait d’éprouver.
– Comment ! disait alors Florina, tu n’en savais rien ?
– Non. Mais quand est-elle morte ?
– Il y a huit jours. Cela nous a fait une jolie émotion quand le petit baron Hounot est venu nous raconter ça sans crier gare.
Figure-toi que nous soupions chez Brébant. Tu sais : maintenant, on ne soupe plus que là, quand on se respecte un peu. Mon imbécile de Hollandais était gris et disait des bêtises. Le petit baron arrive et nous dit : « Qui va à l’enterrement de Corinne ? »
– Quelle Corinne ?
– Corinne Destremont.
Les femmes se mettent à crier, les hommes se regardent.
– Elle est donc morte ? dit mon Hollandais.
– Mais, brute que tu es, lui dis-je, on n’enterre que les gens qui sont morts.
Alors le petit baron nous tira un journal de sa poche, et nous dit :
– Lisez ! ceux qui veulent aller à l’enterrement peuvent prendre le train d’Auxerre. Le marquis de B… l’a fait embaumer. On a sursis aux funérailles. Toujours excentrique, le marquis ! Il conduira le deuil, comme si c’était celui de sa femme. Si jamais il se marie en province, celui-là, ça sera drôle !…
Pauline Régis écoutait Florina d’un air hébété.
– Mais enfin, dit-elle, où est-elle morte ?
– En Bourgogne.
– De quoi ?
– Elle s’est tuée, donc !
– Corinne s’est tuée !…
Et Pauline se demandait si elle n’était pas le jouet de quelque rêve épouvantable.
– Suis-je bête ? reprit Florina ; je te dis bien que Corinne est morte, qu’elle s’est tuée… mais je ne te dis pas comment.
Et Florina alla secouer un gland de sonnette pour appeler le garçon, ajoutant :
– C’est tout au long dans la Gazette des Tribunaux. Ma foi ! j’ai déjà raconté cette histoire tant de fois que j’aime autant que tu la lises, ma petite.
Le garçon entra.
– Est-ce que vous avez la Gazette des Tribunaux de mardi dernier ? demanda Florina… Oui, c’est bien mardi soir que nous soupions chez Brébant.
– Nous devons l’avoir, dit le garçon ; on en fait collection.
Et il sortit.
En effet, quelques minutes après, il revint, apportant la Gazette, que Florina mit complaisamment sous les yeux de Pauline.
Pauline, que son tremblement nerveux avait reprise, eut cependant le courage de lire, sous la rubrique : DÉPARTEMENTS : Accidents. – Sinistres :
« Nous empruntons au journal l’Yonne les lignes suivantes :
Décidément notre arrondissement, ordinairement si paisible, est voué cette année aux grandes catastrophes.
Un malheur épouvantable, un nouveau malheur, est venu jeter la consternation dans le canton de Coulanges-sur-Yonne.
Tout le monde connaît le marquis de B…, ce jeune et excentrique gentilhomme qui a fait tant de folies l’an dernier à notre fête des lanternes.
Le marquis est riche, spirituel, de vieille maison, complètement indépendant, et, à ces titres divers, il saute un peu à pieds joints sur les austères habitudes de la vie de province.
Le marquis s’ennuyait dans son château de Roche-pinte ; il a voulu peupler sa solitude.
Un matin, les paysans, les fermiers, les nombreux tenanciers de l’opulent marquis ont trouvé installée au château une fort belle personne que les domestiques appelaient madame et le marquis Bichette.
Cette beauté de premier ordre appartenait, paraît-il, à ce qu’à Paris on appelle le demi-monde.
La province a crié au scandale.
Le marquis a trouvé plaisant de donner une fête et d’y convier la noblesse bourguignonne.
Tous les jeunes gens y sont allés.
La dame a fait les honneurs du château avec un tact exquis.
On prétend qu’elle était fabuleusement riche, et qu’elle portait ce jour-là une rivière de diamants évaluée deux cent mille francs.
Mais le marquis de B… se lasse facilement.
La fête passée, ses convives partis, il a donné congé à Bichette.
Bichette est donc partie un soir, dans ce fameux mail-coach dont on a tant parlé à Auxerre, et qui brûle la poussière des grandes routes attelé de quatre trotteurs irlandais.
À minuit, le cocher et le valet de chambre qui accompagnait mademoiselle Corinne Destremont, c’est le nom de la dame, se sont arrêtés un moment dans un cabaret de Coulanges, chez le père Coquille.
Celui-ci a remarqué que le cocher était déjà un peu gris.
Le mail est reparti un quart d’heure après.
Qu’est-il arrivé depuis ?
Voilà ce qui sera peut-être un éternel mystère.
La route de Coulanges à Auxerre, par Courson, traverse un pays désert.
À droite la forêt, à gauche un ravin profond de près de cent mètres, au bord duquel la route court sur une pente inclinée.
Au bout de la pente un tournant fort raide contre lequel on a réclamé souvent, et que les ponts et chaussées ont négligé jusqu’à présent d’adoucir.
Par suite de quel évènement les chevaux se sont-ils emportés en cet endroit ?
C’est ce qu’on ignore.
Mais la voiture, lancée à toute vitesse sur cette pente, est arrivée au tournant et a sauté la rampe.
Voyageuse, cocher, valet de chambre et chevaux ont roulé dans le ravin, où ils se sont tués.
On a retrouvé, le lendemain, la voiture en mille pièces, les bagages épars alentour, le cocher et le valet de chambre morts sur le coup. La malheureuse Corinne, qui avait survécu quelques heures sans doute, à en juger par une traînée de sang qu’elle avait laissée après elle, était horriblement défigurée.
Enfin, sur la route on a trouvé une véritable mare de sang qui laisserait supposer que cette catastrophe n’est pas seulement le résultat d’un accident.
La justice informe, et nous devons nous abstenir de tout commentaire.
Il paraît, du reste, que les diamants de madame Destremont ont disparu.
Le marquis, toujours excentrique, a fait rapporter chez lui les restes de la malheureuse voyageuse.
Les docteurs P… et M…, d’Auxerre, mandés en toute hâte, ont été chargés de l’embaumement.
Enfin, tous les domestiques du château ont pris le deuil, et le marquis, tout de noir vêtu, se propose de faire à sa maîtresse de splendides funérailles… »
Pauline avait lu ces détails avec une émotion croissante ; mais tout à coup elle jeta un cri d’angoisse, un cri de douleur suprême, laissa échapper le journal et glissa évanouie dans les bras de Florina consternée.
Après avoir raconté la catastrophe du ravin de l’Homme mort, la Gazette des Tribunaux ajoutait, toujours d’après le journal l’Yonne : « Voici le troisième drame qui vient jeter la stupeur dans l’arrondissement de Coulanges, depuis un mois. M. de Maugeville assassiné, le bohémien Munito tué par M. de Villenave, enfin la maîtresse du marquis de B… finissant d’une manière aussi tragique : tel est le bilan du mois, dans ce pays ordinairement tranquille et ne s’occupant que d’engranger ses récoltes et de cuver son vin. »
C’étaient ces mots : « M. de Maugeville assassiné » qui, se détachant tout à coup en caractères de feu, avaient brûlé les yeux de Pauline Régis.
Et Pauline s’était évanouie.
Florina éperdue appela au secours. Tous les gens du pavillon accoururent.
Pendant quelques heures, Pauline fut comme morte et les soins d’un médecin qu’on alla chercher en toute hâte à Neuilly parvinrent seuls à la ranimer.
Mais elle avait une fièvre ardente, mêlée de délire, et elle ne reconnut point Florina.
Celle-ci la fit transporter dans une voiture et la reconduisit chez elle, où elle la fit mettre au lit.
Puis elle s’installa à son chevet, disant naïvement :
– Je n’aurais jamais cru que Pauline aimât profondément Corinne Destremont.
[…]
Pauline passa quarante-huit heures en proie à une fièvre brûlante.
Au bout de ce temps elle revint complètement à elle.
Florina était toujours là.
– Ma bonne petite, dit l’écuyère, je crois maintenant que tu es hors de danger et que je puis m’en aller. Mais, franchement, tu t’es fait trop de chagrin de la mort de cette pauvre Corinne, que tu ne connaissais pas comme moi, sois-en bien sûre.
Ce n’est pas elle qui se serait mise dans un pareil état, si tu étais morte !
Pauline ne répondit pas.
Mais ses yeux, rouges et secs jusque-là, s’emplirent tout à coup de larmes, et un nom monta de son âme brisée à ses lèvres :
– Manuel !
Les natures frêles et délicates sont souvent les plus énergiques.
Pauline eut la fièvre et le délire deux jours ; au bout de ce temps, sa raison lui revint complètement.
Le désespoir était dans son cœur ; mais les douleurs sans consolation retrempent l’âme quelquefois.
Pauline se dit :
– Manuel est mort. Comment et pourquoi il est mort, je le sais, moi.
Elle se souvenait de tout ce que Corinne, lui avait dit touchant M. de Villenave.
Elle se souvenait encore mieux du rôle odieux que ce dernier et Corinne avaient voulu lui faire jouer.
Enfin, ce qu’elle ne pouvait oublier, c’était la joie manifestée par Corinne, le jour où elle avait aperçu M. de Villenave à la fenêtre de la bohémienne Dolorès.
La rue Caumartin, nous l’avons dit, surtout dans son extrémité nord, est un peu une rue de province.
Les domestiques causent entre eux.
Or, la femme de chambre de Pauline Régis ; discrète pour ses propres affaires et les affaires de sa maîtresse, était curieuse de ce qui concernait les autres.
Elle avait assisté à la scène de reconnaissance.
Puis elle avait vu Corinne partir comme une folle en disant :
– Il me faut Villenave.
À partir de ce moment, la soubrette, qui se nommait Jenny et était une fine mouche, s’était mise en campagne à la seule fin de savoir pourquoi M. de Villenave, qu’on avait cherché partout, se trouvait dans la maison d’en face.
Ce que les maîtres n’obtiennent pas toujours à prix d’argent, les domestiques l’ont pour rien.
Le portier de la maison habitée par Dolorès, sollicité par un valet de chambre amoureux de Jenny, avoua tout.
Ce fut ainsi que Jenny apprit l’enlèvement de M. de Villenave devenu idiot, par Corinne qui le fit transporter chez elle et l’y garda huit grands jours.
Pauline avait témoigné à cette époque quelque inquiétude, car elle redoutait plus encore M. de Villenave pour son cher Manuel, que Corinne et toutes ses combinaisons savantes.
Mais Jenny l’avait rassurée en lui disant :
– M. de Villenave est chez Corinne et s’il recouvre la raison, ce ne sera pas de sitôt.
Pauline s’était donc un peu endormie jusqu’au jour où elle avait appris, de la bouche de Florina l’écuyère, la mort sinistre de Corinne et, par le journal, la fin tragique de M. de Maugeville.
Pauline revenait donc à sa raison, le cœur brisé, mais l’âme forte.
Et songeant à Maugeville, elle se dit :
– Je le vengerai !
Il était évident pour elle que M. de Villenave avait été le complice de Munito avant d’être son meurtrier.
Il était évident encore que M. de Villenave ne pouvait être étranger à la mort de Corinne.
Et ce misérable allait triompher !
Il épouserait certainement madame de Planche-Mibray.
– Oh ! cela ne sera pas, se dit Pauline ; cela ne peut pas être.
Comme il lui était impossible de supposer que Munito eût tué M. de Maugeville pour toute autre chose que de l’argent, il était clair à ses yeux que cet argent avait été promis par Corinne et M. de Villenave.
Ce dernier s’était donc débarrassé de ses deux complices, et il allait maintenant recueillir le fruit de tous ses crimes.
– Non, se disait Pauline, je ne suis qu’une pauvre pécheresse, et madame de Planche-Mibray est une femme du monde ; mais je lui parlerai avec tant de franchise et de conviction, qu’elle me croira.
Son parti fut bientôt pris.
– Jenny, dit-elle, tu vas faire à la hâte quelques préparatifs ; nous partons demain matin.
– Mais, madame, dit la soubrette, vous êtes bien faible encore…
– Qu’importe !
– Si vous alliez retomber malade…
– Oh ! non ! j’aurai la force d’arriver… tu verras !…
Et Pauline, essuyant ses larmes, dit encore :
– Tu sais si j’aimais M. de Maugeville !
– Oh ! oui, je le sais ! dit la soubrette émue.
– Eh bien ! il est mort, et il faut que je le venge, dit Pauline.
Jenny ne répliqua pas et se disposa à obéir.
Pauline sortit ce jour-là ; elle qu’on ne voyait plus nulle part se montra un peu partout.
Elle fit le tour du lac, sûre d’y rencontrer dix personnes peut-être qui lui parleraient de M. de Maugeville.
En effet, tandis que sa Victoria passait au pas à travers les voitures qui se croisent pendant deux heures sur la rive gauche, entre les deux chalets, elle aperçut le baron Charles Hounot, cet étourdi qui avait annoncé la mort de Corinne.
Le baron la salua, et comme elle lui faisait un signe, il s’approcha.
Pauline était pâle, mais elle ne pleurait plus, et avait même la force de sourire.
– Mon cher, dit-elle au baron en lui tendant la main, je vais à Madrid ; allez-y. Donnez votre cheval à tenir, et vous viendrez à ma rencontre. J’ai besoin de causer avec vous.
Le baron ne se le fit pas répéter ; il mit son cheval au galop, tandis que Pauline faisait signe à son cocher de tourner bride, et il arriva à Madrid en quelques minutes, puis il revint à la rencontre de Pauline qui allait au pas, et monta à côté d’elle.
– Mon ami, lui dit alors la jeune femme, vous savez que j’étais liée avec Corinne Destremont ?
– Oui.
– J’ai été absente de Paris, je n’ai rien su que ce que les journaux ont raconté, et je m’imagine que vous savez une foule de choses qu’ils n’ont pas dites.
– Je suis d’autant mieux renseigné, ma chère Pauline, répondit le baron, que j’arrive de Bourgogne.
– Ah !
– Le baron de B… m’avait invité à l’enterrement de Corinne. J’y suis allé.
– Alors, dites-moi tout.
Le baron ne se fit pas prier, il raconta tout ce que nous savons déjà, ajoutant que l’on était maintenant convaincu que les diamants avaient été volés par des gens mal famés appelés les Balthasar.
Ces gens-là avaient disparu. Leur signalement avait été envoyé à toutes les brigades de gendarmerie, mais jusqu’à présent les recherches étaient demeurées sans résultat.
– Mais enfin, dit Pauline, comment Corinne était-elle chez le marquis, avec qui elle avait rompu depuis longtemps ?
– C’est ce que j’ignore.
– Êtes-vous resté longtemps, là-bas ?
– Deux jours.
– Avez-vous rencontré un autre ami de Corinne, Villenave ?
– Parbleu !
– Ah ! vous l’avez vu… Il va se marier, dit-on ?
– Ma belle amie, dit le baron, si vous voulez dîner en tête-à-tête avec moi, je vous raconterai l’histoire du prochain mariage de Villenave. C’est tout un roman.
– En vérité ?
Et Pauline eut la force de prendre un air étonné et naïf.
Ils entrèrent à Madrid et s’enfermèrent dans un cabinet.
Alors M. Hounot ne se fit pas prier pour narrer dans tous ses détails le drame que nous avons déjà raconté et que le marquis lui avait confié tout au long.
Madame de Planche-Mibray était bohémienne d’origine. À ce titre elle avait inspiré une passion frénétique à un bohémien appelé Munito.
Ce bohémien avait assassiné M. de Maugeville, le fiancé de la baronne, ou du moins on le présumait, car jamais on n’avait retrouvé le corps de ce dernier.
Ces paroles firent tressaillir Pauline jusqu’au fond de l’âme.
– Vrai ! dit-elle, on n’a pas la preuve de la mort de M. de Maugeville ?
– Non.
– Pourtant, il a été tué ?
– C’est ce que semblent indiquer d’abord la mare de sang trouvée sur la route, ensuite les précautions prises par Munito, qui s’est longtemps dérobé aux recherches les plus actives.
– Oh ! mon Dieu ! pensait Pauline, s’il n’était pas mort !
Et, dans son cœur, qu’elle croyait mort, tremblota une lueur indécise qui était peut-être bien un rayon d’espérance.
– Mais enfin, dit-elle, on a fini par arrêter ce bohémien ?
– Pas le moins du monde. C’est Villenave qui l’a tué.
– Comment ?
– Cet homme s’était introduit jusque dans la chambre de la baronne, et il allait en abuser quand Villenave est survenu et lui a cassé la tête d’un coup de pistolet.
– Ce qui fait que Villenave est devenu le sauveur de sa tante ?
– Oui.
– Et que sa reconnaissance lie cette dernière ?
– Comme bien vous pensez.
– Je vous remercie, dit froidement Pauline. Vous êtes renseigné comme une gazette.
Elle dîna du bout des dents, pour abréger le tête-à-tête, et, à huit heures et demie, elle demanda sa voiture pour rentrer à Paris.
Sa femme de chambre l’attendait avec une vive impatience.
– Qu’y a-t-il donc encore ? demanda Pauline en la voyant très émue.
– Madame, répondit Jenny, l’Espagnole est partie.
– Quelle Espagnole ?
– La femme d’en face, la bohémienne.
– Eh bien ?
– Je ne sais pas où elle est allée, mais bien sûr, il y a un nouveau malheur sous roche.
Pauline tressaillit.
– Voyons, dit-elle, explique-toi ?…
– Madame, reprit Jenny, il y a dans la maison en face un valet de chambre qui me courtise.
– Bon !
– Par lui, j’ai su toute l’histoire de l’enlèvement de M. de Villenave.
– Après ?
– Ce valet de chambre, qu’on appelle Victor, est venu ici tout à l’heure, et il m’a dit :
« – Votre maîtresse connaît M. de Villenave ?
– Sans doute, ai-je répondu.
– Eh bien ! venez avec moi… vous allez en entendre de belles. »
Je l’ai suivi, et il m’a conduit dans cet appartement, qui est celui de son maître, lequel est encore en voyage, et qui communique avec l’appartement de la bohémienne Dolorès.
– Ah ! fit Pauline.
– Il a ouvert l’armoire à porte-manteau qui masque la porte, et j’ai vu un trou par lequel passait un filet de clarté.
Il était alors presque nuit. Nous étions dans l’ombre, et la chambre qui se trouvait de l’autre côté de la porte était éclairée.
J’ai collé mon œil au trou, et j’ai regardé.
La bohémienne n’était pas seule : elle était avec son Espagnol.
Celui-ci était couché sur le divan et fumait fort tranquillement sa cigarette.
Quant à la bohémienne, elle se promenait de long en large. L’œil en feu, les cheveux en désordre, elle avait l’air d’une bête fauve prise au piège. Je me suis mise à écouter.
– Quand tu te démèneras ainsi, disait l’Espagnol avec flegme, tu ne ressusciteras pas Munito.
– Je le vengerai.
L’Espagnol haussa les épaules et reprit :
– À ta place, je ne me dérangerais pas pour si peu. C’est un fier débarras et tu l’avais sur les bras tous les jours.
– C’était mon frère.
– Soit. Mais ce n’est pas une raison…
– Je le vengerai, te dis-je.
– Mais comment ?
– D’abord, je tuerai son meurtrier.
– Villenave ?
– Oui.
Et elle prit un poignard sur la cheminée et se mit à le brandir.
– Ma chère, dit froidement l’Espagnol, si tu assassines M. de Villenave, on te prendra, on te jugera, et tu seras guillotinée.
– Que m’importe ?
L’Espagnol haussa de nouveau les épaules et ne répondit pas.
Dolorès reprit avec une exaltation et une fureur croissantes :
– Et puis, c’est cette femme qui est cause de sa mort, que je veux tuer :
– Corinne ?
– Non, la baronne… Fille de Bohême comme nous, elle nous a reniés ; elle a méconnu l’amour de Munito…
– Voilà une chose que je comprends, dit l’Espagnol en souriant.
– Elle mourra !
Et Dolorès serrait le manche de son poignard dans ses doigts crispés.
– Ma chère, dit alors l’Espagnol, veux-tu un conseil ?
– Je veux venger Munito.
– Soit ; mais veux-tu un conseil ?
– Parle.
– Tu es bohémienne. Les bohémiens jouent du poison aussi bien que du couteau.
– C’est vrai.
– Sers-toi du poison : c’est plus sûr, et puis la justice peut y perdre son latin.
– Tu as raison, dit Dolorès, je verrai…
Et, tout en parlant, elle faisait ses préparatifs de départ.
C’est ainsi qu’elle a pris un manteau de voyage, serré dans un sac un petit flacon que je soupçonne contenir quelque drogue malfaisante et qu’elle a envoyé le nègre lui chercher une voiture de place.
L’Espagnol et elle se sont quittés assez froidement, et celui-ci en l’embrassant lui a dit :
– Je te donne quinze jours. Si dans quinze jours tu n’es pas revenue, je retourne à Madrid.
– Je reviendrai quand ils seront morts tous deux, a-t-elle répondu.
Alors, madame, acheva Jenny, j’ai quitté mon poste d’observation et je suis allée m’abriter derrière les persiennes de la fenêtre.
J’ai vu Dolorès monter en voiture.
Où est-elle allée ? Voilà ce que je ne sais pas… Mais je peux vous affirmer que M. de Villenave et madame de Planche-Mibray sont sérieusement en danger de mort.
Pauline ne répondit pas.
Elle s’enferma dans son cabinet de toilette et y changea de vêtements.
Jenny, étonnée, la vit ressortir, un quart d’heure après, en habits de voyage.
– Comment, madame, dit-elle, ce n’est donc plus demain que vous partez ?
– Non, c’est ce soir, répondit Pauline. Il n’y a pas une minute à perdre. Il faut que je sauve madame de Planche-Mibray.
Mais quelque diligence qu’elle fît, Pauline n’arriva à la gare de Lyon qu’à six heures du soir.
Le train d’Auxerre était parti.
Il fallait attendre au lendemain matin. Cependant l’employé auquel elle s’adressa lui dit :
– Il y a un train à onze heures. Ce train, qui est omnibus, s’arrête à la Roche à cinq heures du matin, mais il n’y a pas de correspondance pour Auxerre. Seulement la distance n’est pas grande ; vous trouverez certainement à la Roche une voiture qui vous conduira.
Pauline attendit.
Elle partit à onze heures, passa six mortelles heures dans le train-omnibus et arriva à la Roche.
Là, elle perdit deux grandes heures à faire chercher un cabriolet.
Enfin elle en trouva un dont le maître s’engagea à la conduire à Auxerre moyennant la bagatelle de trente francs.
Pauline se remit en route.
Comme elle sortait du petit village de Moniteau, une heure après, elle aperçut une mendiante sur la route.
Cette mendiante se retourna et jeta un regard farouche sur le cabriolet dans lequel Pauline était assise à côté de son conducteur.
Mais elle ne tendit pas la main.
Pauline tressaillit.
Cette femme en haillons était jeune encore, elle était belle et avait le type bohème.
Pauline ne l’entrevit qu’une minute, car le cabriolet allait bon train ; mais un frisson lui parcourut tout le corps.
Il lui semblait que cette femme ressemblait à la bohémienne Dolorès…
Cependant, la réflexion aidant, cette supposition lui parut absurde.
Dolorès était partie de Paris la veille au soir, il est vrai ; mais elle était partie comme une femme qui mène la vie à grandes guides.
Comment croire qu’en route elle s’était tout à coup métamorphosée en vagabonde de grand chemin ?
– Je suis folle ! se dit Pauline Régis, qui, une heure après, descendait à l’hôtel du Léopard et s’informait de la route à suivre pour se rendre à Coulanges-sur-Yonne, au château de Planche-Mibray.
Pauline Régis prit à peine le temps de se reposer quelques heures à Auxerre.
Puis elle demanda comment on se rendait à Planche-Mibray.
Elle avait un air si décent, un si joli visage, une toilette de voyage de si bon goût, que toute la province assemblée aurait juré qu’elle n’appartenait pas au théâtre.
On la prit pour une femme du vrai monde.
Les voitures publiques qui vont d’Auxerre à Clamecy et passent par Coulanges partent le matin à sept heures et le soir à six heures.
Celle du matin était partie.
Pauline ne voulait pas attendre celle du soir.
Bonnard, l’excellent homme qui tient le sceptre directorial de l’hôtel du Léopard, dit à la jeune femme :
– Madame, quiconque se présente ici en prononçant le nom de Planche-Mibray à droit à tous nos égards. Vous paraissez pressée d’arriver, je vais vous faire conduire dans mon char-à-bancs.
Le char-à-bancs du Léopard est une petite voiture assez élégante sur laquelle on dresse une tente en guise de capote, qui roule bien et que le gros percheron gris de l’hôtel traîne comme une plume.
Il y a deux bancs, et quatre personnes s’y trouvent à l’aise.
Pauline accepta l’offre qui lui était faite.
– Auguste ! cria le maître d’hôtel, donne l’avoine a Coco !
Pauline voyageait avec une caisse unique.
Tandis que le cheval mangeait l’avoine, elle s’assit sur cette caisse et se prit à songer.
En quittant Paris, le but de son voyage lui paraissait facile.
Quoi de plus simple, en effet, à première vue, que d’arriver à Planche-Mibray et de dire à la baronne : « Madame, vous courez un double danger : le premier, que je considère comme le moindre, est un danger de mort ; le second, et à mes yeux c’est le plus terrible, est d’épouser un misérable qui n’est certainement pas étranger à la mort de M. de Maugeville et qui, pour obtenir votre main et votre fortune, a ourdi les plus viles intrigues » ?
Pauline était partie en se traçant ce programme.
Mais, à mesure qu’elle approchait du terme de son voyage, l’exécution lui paraissait plus difficile.
D’abord la baronne ne la connaissait pas, n’avait peut-être même jamais entendu parler d’elle. Ensuite, M. de Villenave était au château certainement, et qui donc, de la femme de théâtre ou de l’homme à qui elle allait unir sa destinée, la baronne croirait-elle le plus facilement ?
– Cependant, se disait Pauline, il faudra bien que la baronne me croie ! D’ailleurs, j’ai une preuve matérielle à mettre sous ses yeux.
C’est le billet écrit à Corinne par Villenave et qui fait foi de sa trahison envers M. de Maugeville.
En effet, Pauline avait conservé précieusement ce billet.
Tandis qu’elle rêvait au moyen de parvenir jusqu’à madame de Planche-Mibray sans rencontrer M. de Villenave et sans qu’il fût prévenu de son arrivée, une vieille femme qui portait un panier au bras entra dans la cour du Léopard.
– Tiens ! dit le valet d’écurie qui jetait quelques seaux d’eau sur les roues du char-à-bancs pour les laver, voilà la maman Bréhaigne.
– Bonjour, mon garçon, répondit la vieille.
C’était en effet la Bréhaigne, notre vieille connaissance.
Elle venait souvent à Auxerre, et elle n’y venait jamais sans entrer au Léopard, où tout le monde, depuis les maîtres jusqu’aux valets et aux servantes, lui faisait des amitiés.
On lui donnait généralement un verre de vin, un morceau de pain et de fromage, souvent une assiettée de soupe.
Le valet d’écurie lui dit :
– Entrez donc à la cuisine, maman Bréhaigne : on vous donnera à boire et à manger.
– Venez donc, la mère, dit en même temps le bon Bonnard, qui se trouvait sur le seuil de la cuisine.