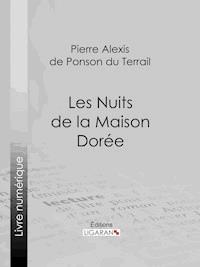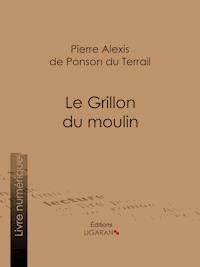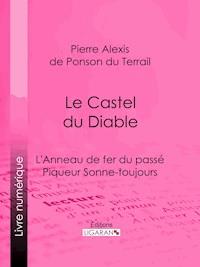
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait: "– Quel dommage, Monsieur le comte, de voyager ainsi depuis quinze jours au milieu d'un si beau pays de chasse, sans avoir pu seulement découpler et faire le bois une fois. – Mon vieux Bouquin, la guerre a des exigences impérieuses ; quand nous aurons battu les Impériaux assez vertement pour leur dicter, un traité de paix, nous demanderons un congé et nous reviendrons à Pouzauges..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
– Quel dommage, Monsieur le comte, de voyager ainsi depuis quinze jours au milieu d’un si beau pays de chasse, sans avoir pu seulement découpler et faire le bois une fois.
– Mon vieux Bouquin, la guerre a des exigences impérieuses ; quand nous aurons battu les Impériaux assez vertement pour leur dicter, un traité de paix, nous demanderons un congé et nous reviendrons à Pouzauges, où le cerf et le sanglier abondent assez dans nos environs pour tenir nos équipages en haleine toute l’année.
– Ceci est fort bien dit et bien pensé, Monsieur le comte, répondit Bouquin d’un ton grondeur ; mais ce n’était vraiment pas la peine de faire faire à vos chiens huit cents lieues, pour les traîner jour et nuit couplés et la queue basse, à la suite d’un fourgon de campagne. Depuis mon arrivée, nous n’avons fait que cela. À chaque instant nous entrons sous le couvert, nous traversons un taillis, nous débouchons dans une plaine de dix lieues où la bête serait en vue tout le temps, partout nous apercevons, ici une défense de ragot, là un bois de dix-cors, plus loin une queue de bouquetin – les chiens hurlent, ma trompe danse toute seule sur mon épaule, j’ai des fanfares, et des lancers, et des bien-aller, et des hallali dans les oreilles… rien ! nous continuons à marcher à la tête de ces dragons stupides qui haussent les épaules, les ignorants et les profanes ! à la vue de nos meilleurs chiens de Vendée et de nos plus beaux céris de Saintonge !
Et Bouquin, qui, nos lecteurs l’ont deviné, était un vieux piqueur plein de feu et de courage cynégétique, malgré ses soixante hivers révolus depuis la dernière fête du grand saint Hubert, Bouquin, cette tirade débitée sur un ton de mauvaise humeur, rentra dans son majestueux silence et jeta un regard pétri d’un dédain suprême à la compagnie de dragons qui chevauchait derrière son chef, le comte de Main-Hardye, capitaine de dragons et commandant une arrière-garde de cavalerie qui s’en allait rejoindre, à travers les steppes et les forêts immenses de la Bohême, un corps d’armée française sous les ordres du maréchal de Belle-Isle, lequel était campé devant Prague. Le comte était un jeune homme de vingt-huit à trente ans, beau garçon, léger, brave jusqu’à la témérité, aventureux jusqu’à la folie, et doué, au degré suprême, de cette noble passion de la chasse qui déjà bien qu’on ne fût alors qu’en 1750, commençait à s’éteindre chez beaucoup de gentilshommes, admirablement située cependant, mais que la guerre et le plus souvent encore les intrigues de cour, éloignaient presque toute l’année de leurs terres. Le comte chassait régulièrement tous les jours pendant les six mois de congé annuels qu’il demandait au roi, et durant les six autres, il trouvait le moyen encore de courre une ou deux fois par semaine, soit à Saint-Germain et à Compiègne, aux grandes chasses de sa majesté ; soit à Chantilly, chez le prince de Condé, ou à Sceaux, chez M. le duc.
Il y avait trois mois qu’un ordre du roi lui était arrivé au milieu d’un grand laisser-courre de gentilshommes du Bocage, et cet ordre était de rejoindre son régiment, faisant partie d’un corps d’armée qui opérait en Bohême, de concert avec la Prusse, contre l’Autriche et la Russie réunies. En vrai gentilhomme qu’il était, le comte avait mis bas sur-le-champ sa veste de chasse pour endosser son uniforme, remplacé son couteau par son épée, et accroché au-dessus de la cheminée de son salon, son cor et son esturgeon, les condamnant, non sans regrets, à un repos dont il ne pouvait prévoir le terme.
– Bouquin, avait-il dit en mettant, le pied à l’étrier, à son vieux piqueur qui, l’oreille basse et l’œil morne, se demandait combien de temps le Bocage allait demeurer silencieux et veuf des magnifiques voix de basse de ses grands chiens blancs et feu brûlé, Bouquin, mon ami, il est possible que je ne revienne pas avant un an, mais il est possible aussi que je sois de retour dans un mois. Tu prendras un soin scrupuleux de mes équipages, tu découpleras dans le bois de Jarry tous les dimanches et dans les taillis de Pouzauges tous les mercredis, tu tirailleras avec mes bassets les lapereaux du parc de Bienvenue, et tu auras bien soin de ne jamais forcer de dix-cors. En outre, je te recommande, sur la santé de tes deux oreilles, que mon couteau de chasse doit respecter à tout prix, de ne permettre à mes voisins que de rares campagnes sur mes terres. Je ne veux pas qu’on dépeuple. Et, ces recommandations faites, le comte était parti pour son régiment.
Il était arrivé la veille d’une bataille et l’avant-veille d’un siège, puis la bataille gagnée et la ville assiégée prise d’assaut, il avait été laissé en garnison dans un petit village frontière de la Prusse orientale, village sans importance par lui-même, mais dont l’ennemi aurait pu, s’en emparant, tirer un excellent parti. Le maréchal de Belle-Isle lui en avait confié la défense et était reparti pour mettre le siège devant Prague.
Pendant huit jours, le comte de Main-Hardye se tint sur ses gardes, faisant observer à ses soldats une discipline sévère, les consignant, et s’attendant d’un moment à l’autre à être attaqué par un corps d’infanterie impériale qui tenait la campagne à dix lieues de là ; mais sur un ordre supérieur, le corps s’éloigna de dix lieues encore, et alors, une idée poussa tout à coup dans le cerveau du comte : – Si je chassais ! pensa-t-il.
Le village et le pays environnant étaient admirablement situés. Bois touffus, jeunes taillis, vallons sonores, plaines caillouteuses et unies, étangs nombreux, mares et ruisseaux où les chiens pouvaient boire… rien ne manquait. Les bêtes abondaient. Les chevreuils et les biches étaient le simple fretin, – car, outre le cerf et le sanglier, il y avait encore du loup, de l’élan et de l’ours à foison. Ce luxe de gibier provenait de deux causes : d’abord la position excellente du pays, ensuite l’absence totale de veneurs dans les environs. Cet avantage avait son inconvénient, par cette raison toute simple que chaque médaille possède son revers : l’absence complète de veneurs impliquait naturellement la disette totale de chiens. Sans meute, comment chasser ?
Le comte était en veine d’idées ; il en avait trouvé une première, il pouvait fort bien en trouver une seconde ; aussi la trouva-t-il : Si je faisais venir mes chiens, se dit-il. La trotte est longue, mais on peut la faire, avec quelques marches forcées, en dix-huit jours. Il peut fort bien arriver que je passe l’hiver ici, et, dans ce cas, le service du roi me sera facile. Si, au contraire, je change de garnison, je jouerai de malheur si je ne tombe pas sur un pays de chasse. En Bohême, on chasse partout.
Là-dessus, M. de Main-Hardye appela son valet de chambre et lui dicta la lettre suivante :
Mon cher Bouquin, au reçu de ma lettre, tu te procureras une carriole grande comme une rue, tu y feras monter quinze de mes meilleurs chiens de Vendée et vingt-cinq de mes plus grands chiens céris, puis mon valet de chiens Letaillis, et tu l’attelleras de deux bons chevaux limousins. Après quoi tu t’installeras toi-même sur le siège avec mon valet de chambre qui te porte cette lettre, et tu prendras la route d’Allemagne. Quand tes chevaux seront las tu les renouvelleras. Si mon intendant manque d’argent, vends tout de suite une centaine d’hectares de terre. Pourvu que les bois nous restent, c’est tout ce qu’il faut. Apporte-moi ma trompe et mon couteau de chasse.
Cette lettre écrite et le valet de chambre parti à franc étrier, le comte s’était dit :
– En attendant Bouquin, je me procurerai un chien d’arrêt et je secouerai les lièvres et les compagnies de perdreaux qui m’avoisinent. Il avait commencé dès le lendemain. Malgré tous ses efforts, il n’avait pu trouver de chien d’arrêt ; mais il y avait suppléé par un énorme mâtin de troupeaux, ayant un nez et un jarret d’enfer, tenace, intelligent, poursuivant et pointant. Dès le premier jour, le mâtin lui fit tuer un lièvre au gîte. Le soir il donna trois coups de voix dans un fourré ; le comte crut à un second lièvre et vit débucher un daim auquel il campa une balle qui le tua raide.
Le lendemain, le mâtin relança un élan qui eut le même sort. Le comte prit goût à ce genre de chasse et pensa que lorsque sa meute serait arrivée, il deviendrait l’officier le plus heureux de France et d’Allemagne.
La meute arrive enfin, Bouquin, transporté d’aise, avait fait une diligence incroyable et laissé sur sa route la valeur représentative du château de Bienvenue en chevaux crevés. Mais, hélas ! heur et malheur se suivent d’ordinaire. Bouquin était arrivé le soir, et dès le matin suivant le comte avait le pied à l’étrier pour chasser, lorsqu’une estafette du maréchal de Belle-Isle arriva avec un ordre ainsi conçu :
« Au reçu du pli suivant, montez à cheval et, accourez à marches forcées. Service du roi. »
– Bouquin, dit tristement le comte, couple les chiens et passe à l’ambulance. Nous chasserons un autre jour. Puis il se tourna vers son lieutenant qui devait chasser avec lui :
– Faites sonner le boute-selle pour la compagnie, et à cheval !
Ce qui fit qu’au lieu de chasser, le comte partit avec ses hommes et marcha quinze jours traînant à sa suite Bouquin et sa meute.
C’était à la fin de la quinzième journée que maître Bouquin se hasarda à entamer avec son maître le dialogue par lequel nous venons de commencer notre récit. Le comte eut un mouvement de mauvaise humeur en écoutant Bouquin, dont l’abrupte éloquence réveillait si bien tous ses appétits de veneur émérite ; mais comme, avant d’être veneur, il était gentilhomme et loyal serviteur du roi, il étouffa ses instincts égoïstes et s’efforça de prendre une physionomie insouciante. Aussi ne répondit-il point à Bouquin, se contentant de jeter un heu ! philosophique que la brise emporta, mais que Bouquin surprit au passage et qui lui arracha la réflexion mentale suivante : – Les veneurs s’en vont ! où allons-nous ?
Quatre heures après, le comte et ses hommes arrivaient au camp du maréchal. M. de Belle-Isle attendait le comte avec impatience.
– Enfin ! dit-il en le voyant.
Le comte ne commandait qu’une faible troupe. Ses hommes ne pouvaient donc être qu’un secours très mince en cas d’assaut pour le lendemain, et il fut étonné du soupir de soulagement qui échappa au maréchal lorsqu’il entra dans sa tente.
– Monsieur le comte, lui dit le maréchal après avoir renvoyé ses aides-de-camp et s’être assuré qu’ils étaient parfaitement seuls ; je vous sais aussi brave que Bayard et le plus aventureux gentilhomme de France.
– Votre seigneurie est trop bonne.
– J’ai à vous proposer une mission presque impossible, vous y jouez votre vie, et je la regarde, moi, comme à peu près perdue.
– Diable ! fit le comte en souriant.
– Il s’agit de passer sur le corps, vous tout seul, de trente mille Russes, de deux cent mille Autrichiens, et de porter des lettres du roi de France au sultan.
– Donnez-moi les lettres, dit simplement le comte.
– Je vous préviens que vous courez mille dangers dont le moindre est d’avoir la tête coupée.
– Monseigneur, fit M. de Main-Hardye avec un sang-froid superbe, si vous ajoutez un mot, tout éreinté que je suis et affamé comme Ugolin, il faudra, pour mon honneur, que je me dispense de secouer la poussière de mes bottes et que je remonte à cheval sans avaler une seule bouchée.
Le maréchal sourit, d’un sourire qui valait un éloge de roi.
– Ces lettres sont-elles fort importantes ? demanda le comte.
– Tellement, répondit le maréchal que si vous n’arrivez pas, nous y perdrons une ou deux provinces.
– Alors il faut que j’arrive à tout prix… j’arriverai !
– En êtes-vous sûr ?
– Je le crois. Vous allez me signer un congé d’un mois.
– Pourquoi faire ?
– Attendez. Ensuite, mettre à ma disposition trois prisonniers autrichiens qui porteront trois lettres ; l’une à Goritz, l’autre aux environs de Vienne, la troisième à Pesth, en Hongrie. La première est pour le baron de Hollingen, colonel de la garnison de Goritz ; la seconde pour le comte de Hochœnbrun, courtisan en grande faveur à la cour de Vienne ; la troisième pour le ban Rodstock, comté hongrois.
Je les ai connus tous trois à Paris, et j’en ai emmené deux en Vendée, chez-moi, où ils ont chassé tout un automne. Ce sont trois veneurs émérites, passionnés, et qui iraient prendre un lièvre sur un clocher, si la chose était nécessaire.
– Où voulez-vous en venir ? demanda le maréchal.
– À ceci ; vous me donnez un congé, j’en profite pour aller chasser chez ces Messieurs. Arrivé à Pesth, je n’ai plus que cinquante lieues à faire pour toucher aux possessions ottomanes. Je les ferai, soyez tranquille. Sur ma route, personne ne m’arrêtera. Je me rends, en chassant, chez un officier supérieur de l’armée impériale, je suis seul avec mon piqueur et mon valet de chiens… je n’inspire aucune défiance…
– Ainsi, fit le maréchal stupéfait, vous irez à Constantinople…
– En chasseur, M. le maréchal.
– C’est prodigieux ! fit M. de Belle-Isle ; reste à vous procurer, sur-le-champ, chiens et piqueurs.
– J’ai tout cela, M. le maréchal.
– Et d’où l’avez-vous tiré ?
– De mon château de Vendée. J’ai fait venir mon piqueur et ma meute.
Le maréchal demeura stupéfait. M. de Main-Hardye se contenta de sourire avec l’orgueilleuse modestie de l’homme supérieur qui trouve l’admiration qu’il excite toute naturelle, puis il demanda quelle était l’heure du départ.
– Demain matin, répondit le maréchal.
Le comte retourna, son congé à la main, auprès de Bouquin, et lui dit :
– Nous chassons demain, prends la route de Goritz sur-le-champ, et va me détourner un cerf à dix lieues d’ici. Un Autrichien, que l’on délivre tout exprès pour la circonstance, te servira de guide.
Bouquin faillit mourir de joie. Le comte écrivit alors la circulaire suivante à ses trois anciens amis, ne changeant à chaque exemplaire, que le titre du destinataire et l’adresse :
Mon cher…… Le roi de France, daignant prendre en considération que je me suis privé de chasser depuis trois mois, uniquement pour son service, daigne m’accorder un mois de congé. Je ne suis donc plus capitaine de dragons, mais un simple disciple de Saint-Hubert, qui vous demande, à cor et à cris, un sauf-conduit pour arriver jusqu’à vous, et courre en paix vos sangliers et vos élans jusqu’à ce que son congé expire. À vous, comte de Main-Hardye.
P.-S. Je me mets en route sur-le-champ, j’espère rencontrer votre sauf-conduit à mi-chemin.
Le lendemain, dès le point du jour, le comte était à cheval. Les chiens de Bouquin étaient partis durant la nuit, ainsi que les messagers. Le comte, qui avait fait coudre, entre sa veste de chasse et la doublure, les lettres du roi, partit à son tour, escorté seulement par son valet de chambre. Les troupes françaises tenaient la campagne sur la route de Goritz, dans un rayon de vingt lieues environ. M. de Main-Hardye n’avait donc point à se préoccuper les deux premières journées. Il arriva au rendez-vous de chasse à dix heures, trouva Bouquin qui lui donna à choisir entre un cerf et un élan, opta pour l’élan et fit découpler. Les chiens, oisifs depuis longtemps, donnèrent avec une ardeur sans pareille. À 5 heures du soir, l’élan était forcé sans qu’il y eût à relever un seul défaut. Le comte fit la curée, avisa un village voisin et dit à Bouquin :
– Pour aujourd’hui, nous coucherons ici, tu partiras à deux heures et demie du matin, et tu iras faire le bois à cinq lieues plus loin. Bouquin s’inclina sans répondre. Le comte, son piqueur, son valet de chambre et son valet de chiens soupèrent à la même table dans une misérable auberge, puis couchèrent dans un grenier à foin.
Le lendemain, M. de Main-Hardye força un sanglier et fit cinq lieues de plus.
– Où ferai-je le bois demain ? demanda Bouquin.
– À dix lieues plus loin.
– Hum ! fit le piqueur avec admiration, irons-nous bien loin et bien longtemps comme ça ?
– D’abord, nous irons à Goritz.
– Et ensuite ?
– Ensuite à Vienne.
– Et après ?
– Après, à Pesth.
– Et puis nous continuerons jusqu’à Constantinople.
Bouquin, qui se levait de table, s’appuya à son siège pour ne point tomber à la renverse :
– Monsieur le comte est fou ! murmura-t-il avec commisération.
– Non pas, répondit le comte. Mais j’ai toujours eu envie de savoir par moi-même si les Turcs étaient des veneurs passables.
Bouquin haussa les épaules :
– Puisque Monsieur le comte est en route, dit-il avec une sorte d’humeur railleuse, pourquoi n’irions-nous pas jusqu’en Chine ?
– Il se pourrait que je m’y décidasse, répondit flegmatiquement le comte, je réfléchirai à ta proposition, Bouquin.
– Monsieur le comte, poursuivit Bouquin avec une humilité goguenarde, trouvera, sans doute, des relais de chiens sur sa route.
– N’avons-nous pas les nôtres ?
– S’ils chassent ainsi longtemps, il faudra les mettre en voiture sous peu.
– Nous nous reposerons un jour sur quatre.
– Ils ne tiendront pas à pareil jeu…
– Si cela arrive, dit froidement le comte, on dira que Main-Hardye a de pauvres chiens et un pauvre piqueur.
Bouquin se mordit les lèvres de colère :
– Ils arriveront, dit-il, dussé-je les porter.
Le troisième jour, M. de Main-Hardye avait couru un cerf et fait trente lieues. Le quatrième, il fit halte et la meute se reposa. Mais comme il voulait mettre à profit son congé, il prit son fusil et alla coucher trois lieues plus loin que ses gens en tirant des perdrix et des bécassines en chemin. Cela arriva d’autant plus à point, que son gîte fut une hutte de bûcherons où il n’eût trouvé, sans son gibier, que de la choucroute rancie. Le cinquième jour, tandis qu’il était sur la voie d’un élan, il tomba dans un avant-poste autrichien. On voulut l’arrêter d’abord ; il montra son congé, nomma le baron de Hollingen, chez lequel il se rendait, et fut relâché par l’officier qui commandait le détachement d’avant-garde. Ce soir-là, M. de Main-Hardye jugea prudent de gagner une petite ville pour chercher gîte, se défiant des bûcherons et des paysans qui jusque-là avait été ses hôtes.
Le comte se trouvait enfin sur les limites de la Bohême montagneuse ; jusqu’alors il n’avait traversé que plaines, forêts et coteaux imperceptibles : maintenant, il était face à face avec une chaîne de hautes et sombres montagnes, boisées de la base au faîte, percées de vallées étroites, profondes, de cavernes nombreuses où les ours et les voleurs logeaient pêle-mêle.
Un gentilhomme moins brave que M. de Main-Hardye, au tableau qui lui fut fait du pays qu’il allait parcourir, dans la dernière ville où il gîta, se fût, sinon effrayé, du moins mis à réfléchir sur les moyens convenables d’éviter toute mauvaise rencontre. Il y avait alors, par monts et par vaux, assez de ces soldats irréguliers et vagabonds, connus sous la dénomination de Znapans, et dont nous peindrons facilement l’honnête moralité si nous ajoutons que le mot français chenapan dérive directement de leur nom ; il y avait, disons-nous, assez de Znapans en campagne pour qu’il fut aisé, avec un millier de florins, d’en acquérir deux cents pour escorte. Mais M. de Main-Hardye ne s’effrayait jamais, et il se contenta de dire à Bouquin :
– Puisque nous entrons sur les terres des ours, je ne veux plus chasser que des ours. Seulement, comme je ne veux pas qu’il te puisse arriver malheur, je ferai le bois avec toi.
À trois heures du matin, le comte se remit en route et entra dans une vallée dominée de toutes parts par de hautes montagnes. Cette vallée, connue dans le pays sous le nom de Vallée-Rouge, avait sa petite légende fantastique, comme tous les coins de la bonne et naïve Germanie. Sa légende, comme toutes les autres, avait le diable pour éternel pivot, et datait du Moyen Âge. La voici en deux lignes : Satan, qui a toujours aimé ses aises, convoitait, depuis fort longtemps, les domaines et le château d’un châtelain qui, aux croisades, pris du désir de revoir son castel, avait vendu son âme à l’enfer pour satisfaire ce désir. Satan l’avait transporté chez lui en moins d’une nuit, et s’était engagé à le laisser vivre longtemps encore. Mais le châtelain sembla abuser singulièrement de la latitude, car il dépassa cent vingt ans. Tous les ans le diable apparaissait et lui disait :
– Comment te portes-tu ?
– Hum ! hum ! répondait le rusé seigneur en toussant, crachant comme un moribond, vous n’aurez plus à attendre longtemps, majesté, je me traîne…
Le diable s’en allait, revenait au bout d’un an, et trouvait son châtelain en aussi bonne santé que douze mois auparavant.
Satan fut patient jusqu’à quatre-vingt-dix ans, on vivait si vieux en ce temps-là ; à cent ans, il s’impatienta ; à cent dix, il entra en fureur, et quand la cent vingtième sonna, il n’y tint plus ! Il se présenta le soir chez le châtelain. Le châtelain était dans son lit, un flambeau sur son guéridon et une Bible à la main. Satan frémit :
– Que lis-tu là ? demanda-t-il.
– La Bible, sire. J’ai eu une visite ce matin.
– Ah ! et laquelle ?
– Celle de saint Pierre, qui m’a dit : Si tu peux vivre un an encore et apprendre par cœur cent vingt et une pages de la Bible, tu te présenteras à la porte du paradis, aussitôt mort, tu m’appelleras à voix basse et me réciteras tes cent vingt et une pages. Si tu ne fais pas une seule faute, je te tirerai le cordon à la sourdine, et le diable sera volé !
– Ah ! fit Satan pâle de colère.
– Vous le voyez, sire, dit le châtelain humblement, j’étudie, je sais déjà assez bien les soixante premières. Voulez-vous me faire répéter ?
Et il tendit la Bible à Satan. Mais Satan le repoussa, et furieux, prit le flambeau et l’approcha des draperies du lit. Le lit s’enflamma, le diable s’enfuit, et le châtelain, qui était trop cassé pour être leste, brûla lui et sa Bible. Son âme s’enfuit toute effarée vers l’enfer, mais une voix l’appela en route. L’âme se retourna et vit le grand apôtre, le concierge éternel du paradis :
– Viens, lui dit-il, récite-moi les soixante pages que tu sais. Je te fais grâce du reste.
Le châtelain fit deux ou trois fautes légères ; mais l’indulgent apôtre toussa à propos et feignit de ne les point remarquer. Le châtelain entra dans le paradis.
– Je m’en moque pas mal, dit Satan ; ce que je voulais, c’était le château. Je l’ai éteint à propos, il m’appartient et j’y veux résider quelques fois.
Depuis, les bûcherons prétendirent qu’à minuit, le samedi, on voyait au travers des clairières, flamboyer les murs lézardés du castel, qui prit le nom de Château rouge, des ombres lascives passaient et repassaient enlacées derrière les vitraux, on entendait des éclats de rire stridents et les notes éparses d’un orchestre infernal. Le château était hanté. Nul ne s’en approcha désormais, le bûcheron se signa à sa vue, le pâtre frémit en apercevant, au-dessus des sapins, les flèches pointues de ses tours ; la vallée fut maudite et abandonnée aux ours…
Ce fut précisément dans cette vallée, qu’après huit heures démarche, le comte de Main-Hardye fut assailli par un violent orage et séparé de la chasse, c’est-à-dire de ses trois serviteurs et de ses chiens, au sortir d’un épais fourré. Le bruit de la foudre avait éteint le son du cor et la voix rauque des chiens. Le comte se mit sous un arbre, s’y abrita de son mieux, lui et son cheval, et attendit que l’orage fût passé, sonnant du cor de quart d’heure en quart d’heure pour rallier la chasse. Aucune trompe ne répondit à la sienne, et l’orage dura jusqu’au soir. Le comte, impatienté, se remit en route avec la dernière ondée et s’enfonça de plus en plus dans la Vallée Rouge, dont l’aspect sauvage devenait sinistre la nuit. M. de Main-Hardye avait faim, il était mouillé jusqu’aux os. Il chemina plusieurs heures au milieu des ténèbres, des bois, espérant toujours rencontrer une hutte de bûcheron et ne l’apercevant jamais.
– Morbleu ! jura-t-il exaspéré, puisque je suis dans la vallée du diable, le diable pourrait bien être courtois, et m’offrir l’hospitalité !
Il achevait à peine, qu’en tournant un coude de la vallée, il aperçut dans le lointain une masse imposante et sombre tigrée de points lumineux… et il reconnut le Castel du Diable, illuminé des combles aux cuisines.
C’était précisément le samedi et minuit approchait.
– Oh ! oh ! dit le comte, il y a sabbat aujourd’hui et je trouverai nombreuse compagnie.
Et, sans plus manifester d’étonnement, il poussa son cheval qui reprit courage et le déposa, vingt minutes après à la grille du castel. Le compte sonna une fanfare : le pont-levis s’abaissa. Il entra dans la cour et ne vit personne. Il marcha vers le perron, le gravit, arriva dans le vestibule : vestibule et perron étaient déserts ! il monta le grand escalier en marbre rouge, entra dans une vaste salle tendue de rouge, puis dans une autre, et encore une autre… Tout était rouge, tout était illuminé, comme pour une fête, et nul ne paraissait.
Le comte trouva dans la dernière salle où il pénétra, une table servie avec deux couverts :
– Ma foi ! dit-il, je meurs de faim, et le maître de la maison ne m’en voudra pas de ne point l’attendre. Je vais attaquer ce pâté de venaison et ce jambon d’ours.
Et le comte se mit bravement à table. Le comte avait faim, disons-nous ; de plus, il était un de ces rares esprits forts qui ne se donnent point la peine d’approfondir un mystère quand il y a mieux à faire d’abord. Il avait faim… le pâté de venaison disparut presque tout entier. Puis, au pâté succédèrent sans interruption un salmis de bécasses, une bisque de perdreaux, quelques menues salaisons, un demi pot de confitures d’Orient et des pâtisseries hongroises. Le tout fut arrosé par du joannisberg d’une assez belle date, un cru de muscat rouge dont le comte ne put déterminer l’origine, et quelques gouttes de vin d’Aï, attention minutieuse et délicate de l’hôte inconnu qui servait des vins de son pays à un exilé.
– Pardieu ! s’écria le comte en riant, ceci ressemble fort à l’histoire de feu M. Perrault, « la Belle et la Bête, » le logis et la table sont splendides, l’hôte demeure invisible, et il ne se montrera, je gage, qu’au fond des jardins, sous la forme d’un monstre femelle que je n’aurai qu’à épouser pour le convertir en une séduisante princesse cousue de soie et doublée de cachemire !
Nous n’oserions affirmer que cette phrase du comte ne ressemblât point à un défi, et qu’il n’ait pas eu l’intention de provoquer l’apparition de son hôte, mais ses peines en tout cas, se trouvèrent perdues, car l’hôte ne se montra point.
Quand il eût achevé son souper, le comte se renversa philosophiquement dans son fauteuil et se dit à mi-voix :
– Il ne manque plus qu’une larme de café.
– Si Monsieur le comte veut passer au salon, il y trouvera du café et des pipes d’Orient ! répondit une voix.
Le comte leva vivement la tête, regarda autour de lui, chercha des yeux le propriétaire de la voix qu’il venait d’entendre, et ne vit personne. Seulement, dans le fond de la salle à manger, une porte venait de s’ouvrir à deux battants, et laissait voir un salon splendidement décoré, avec un feu clair et pétillant, auprès duquel on avait entassé une pile de coussins et dressé un guéridon sur lequel se trouvait le moka brûlant et une chibouque à tuyau d’ambre, toute chargée de latakié. Le comte s’accroupit, sans trop de roideur, sur les coussins, alluma la chibouque et se prit à philosopher sur les bizarreries de la vie en général et de l’existence de ce château en particulier. Ce château-là, surtout, qu’il trouvait si confortable en tous points et cependant désert au moins en apparence, lui semblait curieux à examiner.
Quand il eut dégusté le café et jeté aux cendres du foyer la cendre éteinte de sa chibouque, le comte se leva, prit un flambeau et se dit :
– Puisqu’il ne se trouve personne ici qui me puisse montrer le château en détail et me servir de cicérone, je vais me le montrer moi-même et m’orienter de mon mieux.
Et, là-dessus, il se leva et commença son inspection par le salon où il se trouvait. C’était une vaste pièce, tendue en damas vert foncé, avec des baguettes d’or aux plafonds, des arabesques et des moulures d’un bon style. Un ameublement Louis XV, soie et or, étalait alentour des murs ses dormeuses et ses fauteuils à dossiers ronds. Quelques tableaux de prix, quelques bronzes des maîtres, une miniature et un pastel étaient placés çà et là : deux tritons de cuivre doré supportaient les lisons du foyer ; sur un guéridon dressé au milieu, étaient étalés pêle-mêle des livres, des albums et des gazettes, les contes moraux de M. de Marmontel, et le dernier numéro du Mercure de France.
– Il paraît, pensa le comte, que mon hôte est ami des arts et des lettres.
Le salon examiné dans tous ses détails, le comte poussa une porte et se trouva dans un charmant boudoir bleu et blanc, encombré de laques et de potiches, de fleurs rares et d’arbustes poussés à grands frais, de délicieuses bagatelles traînant çà et là sur les dressoirs et les consoles ; en un mot, de ces mille riens ruineux dont une femme aime à s’entourer.
– Je suis assurément chez une fée, se dit le comte.
Et il passa dans une autre pièce. Celle-là différait complètement de la précédente. C’était un cabinet d’histoire naturelle, un arsenal, un musée cynégétique, tout ce qu’on voudra. Deux loups, merveilleusement empaillés et préparés, étaient assis sur leur arrière-train aux deux côtés de la porte, et semblaient fixer avec leurs yeux d’émail le visiteur nocturne qui pénétrait chez eux. Un élan, un cerf, plusieurs biches, un ours noir et une variété infinie de coqs de bruyère, de faisans, de perdrix, encombraient cette salle.
Les murs étaient tendus de fourrures : à ces fourrures s’adaptaient merveilleusement de curieuses panoplies rangées par dates historiques. Ici, c’était l’arc et le carquois des anciens, au-dessous, l’épieu Moyen Âge ; un peu plus bas, l’arquebuse à mèche, le fusil à rouet, le mousquet à silex, le fusil à deux coups dans l’origine. Plus loin, les armes orientales, les damas merveilleux, les pistolets incrustés de nacre, les couteaux de chasse à fourreau ciselé. Plus loin encore, une collection complète de cors, de clairons, de trompes de chasse, de cornes suisses ; tout cela supporté par des bois de cerf, d’élan et de cornes de buffle. Sur une table étaient empilés plusieurs ouvrages de vénerie, presque tous excessivement rares et fort curieux.
– Bon, pensa le comte, il paraît que la fée a un mari veneur ; s’il se veut bien montrer nous chasserons ensemble.
– Demain, répondit une voix.
Le comte tressaillit, promena un regard autour de lui et ne vit rien. Il retourna rapide dans le boudoir, il passa dans une autre salle qui était une bibliothèque et n’aperçut aucun être vivant.
– Attendons demain, se dit-il.
Le comte avait le suprême bonheur de ne pas faire de livres, ce qui eût pu faire supposer qu’à la rigueur il les aimait quelque peu. Il n’en était rien, cependant ; car il ne daigna pas jeter un seul coup d’œil aux rayons poudreux sur lesquels une main de bibliophile avait patiemment classé deux ou trois mille volumes grecs, latins, hébreux, syriaques et français. Il passa outre et se trouva dans une vaste galerie de marbre noir et blanc, dont la voûte était supportée par des colonnettes de marbre jaune. Des fenêtres à vitraux gothiques étaient destinées sans doute à l’éclairer pendant le jour : mais, à cette heure, elle se trouvait illuminée par des torches de résine tenues par des mains de bronze qui sortaient des murs. Ces murs étaient couverts de portraits de famille.
– De quelle famille ? se demanda le comte. Elle devait être illustre et bien apparentée, dans tous les cas ; car ce n’étaient que seigneurs en galant costume, dames en robes de cour, prélats mitres, cardinaux en simarre rouge, chevaliers en habits de Malte, et commandeurs de tous les ordres du monde chrétien. – À la bonne heure ! murmura le comte, je suis chez des gens de bonne compagnie, reste à savoir si les écuries et le chenil sont aussi convenables que tout ce que je viens de voir. Descendons.
Le comte s’orienta sans trop de peine, retrouva le grand escalier au bout de la galerie, gagna le rez-de-chaussée, la cour et les communs, et finit par trouver les écuries. Les écuries étaient tenues avec un luxe fabuleux : quarante chevaux mangeaient côte à côte à un râtelier de bois d’aloès dans une crèche de sandal ; la plus fine paille de riz était étendue en litière sur le sol dallé en marbre, les longes étaient, non en cuir vulgaire, mais en superbe chagrin d’Abyssinie. La beauté des nobles animaux émerveilla le comte ; toutes les races de coureurs célèbres y étaient dignement représentées, depuis l’étalon arabe et andalous jusqu’à la pouliche tartare. La même voix qui déjà avait vibré aux oreilles du comte à deux reprises différentes, se fit entendre de nouveau et cria :
– Monsieur le comte peut choisir celui qu’il montera demain.
– Très bien, dit le comte.
Et, après avoir hésité quelques minutes, il se décida pour un étalon arabe noir d’ébène, avec la crinière et la queue gris du fer.
Des écuries, le baron passa aux chenils. Il y avait environ trois cents chiens, c’est-à-dire un équipage pour chaque bête de chasse, depuis l’ours, auquel étaient réservés d’énorme mâtins de Norvège, jusqu’au lièvre, pour lequel le châtelain inconnu avait fait venir une meute suisse de petits chiens orangers et blancs, rapides comme l’éclair, avec une superbe voix de basse-taille qui devait résonner à ravir dans les bruyères et les bas taillis.
– Quelle bête monsieur le comte désire-t-il courir demain ? demanda la voix.
– Un élan, répondit le comte.
– C’est bien ; on va faire le bois sur-le-champ.
En ce moment, une horloge invisible et dont le veneur ne put préciser la situation topographique, sonna minuit.
– Tiens, murmura le comte, si j’allais me coucher ?
– L’appartement de monsieur le comte est prêt, fit la voix.
Le comte quitta le chenil, remonta les degrés du grand escalier, et ne sachant trop où était sa chambre à coucher, prit le parti de passer par le salon où il avait soupe. La nappe, les mets, tout ce qui restait de son repas avait disparu. Le thé était servi sur la table, accompagné de confitures d’Orient, de sorbets et de liqueurs. Un narguileh était auprès, bourré d’un tabac levantin jaune comme de l’or.
– Décidément, se dit le comte avec un rire un peu gaillard, la fée du logis est une femme charmante.
– Vous trouvez ! dit une voix douce et harmonieuse, une voix de femme qui ne ressemblait en rien à celle que le comte avait entendue déjà.
Le comte chercha de nouveau autour de lui, le salon était désert.
– Cordieu ! s’écria-t-il, je la trouve adorable ; mais je voudrais bien la voir.
– Voulez-vous lui permettre de prendre le thé avec vous ?
– Ah ! madame, s’écria le comte, lui permettre, mais c’est à elle d’ordonner ?
– Eh bien ! tournez-vous.
Le comte se tourna, espérant voir enfin sa mystérieuse hôtesse derrière lui. Il n’en était rien, et il chercha vainement ; mais en reprenant sa position première, il se trouva face à face avec un être si singulièrement beau, qu’il en jeta un cri d’admiration. C’était une femme de vingt-deux à vingt-trois ans, d’une blancheur éblouissante de mains et de visage, avec des cheveux noirs de jais et cet œil profond et velouté, cet œil de gazelle des femmes du Levant. Elle portait un costume oriental d’une merveilleuse richesse, un pantalon de soie blanc serré au-dessus de la cheville par un anneau d’or, une basquine de velours noir broché et soutaché enfermait sa taille élancée et souple comme celle d’une panthère. Les nattes de ses longs cheveux bouclés s’échappaient à profusion d’une petite toque rouge, et des bracelets de rubis et d’émeraudes étincelaient à ses bras arrondis et blancs comme ceux d’une statue. Elle regardait le comte avec un charmant sourire, arquant à demi sa lèvre rouge et voluptueuse, et le comte la regardait, lui, avec un étonnement naïf qui tenait presque de la stupeur. Et comme il semblait avoir la langue collée au palais et ne pouvoir prononcer un mot, elle prit la parole la première, et lui dit :
– Avez-vous été content de votre souper, comte ?
Cette phrase, simple et presque vulgaire, fit tressaillir le comte et lui rendit un peu son sang-froid.
– Oui, madame, balbutia-t-il.
Elle s’aperçut de son embarras et continua :
– Vous pouvez vous regarder ici comme chez vous, monsieur, et je suis trop heureuse de vous recevoir.
Elle s’exprimait en français avec un léger accent traînant qui seyait à ravir à sa voix veloutée et fraîche. Le comte parvint enfin à maîtriser son émotion ; il reprit même cette assurance spirituelle des gentilshommes galants de son époque, et répondit :