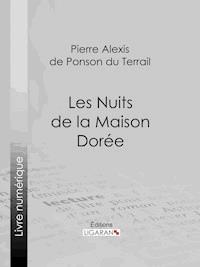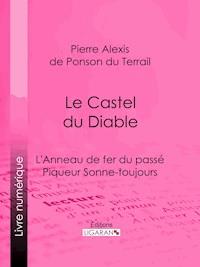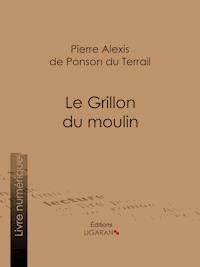Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Paris est tout petit depuis qu'il est devenu si grand. Jadis, il y a une dizaine d'années, quand on partait du boulevard Montmartre pour aller à Auteuil, on ne faisait peut-être pas son testament, mais on prenait ses précautions. Le rentier s'armait d'un parapluie, au mois de juin, le peintre emportait son caoutchouc. Aujourd'hui, un demi-cigare vous sépare du parc des Princes."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335102345
©Ligaran 2015
Paris est tout petit depuis qu’il est devenu si grand.
Jadis, il y a une dizaine d’années, quand on partait du boulevard Montmartre pour aller à Auteuil, on ne faisait peut-être pas son testament, mais on prenait ses précautions.
Le rentier s’armait d’un parapluie, au mois de juin, le peintre emportait son caoutchouc.
Aujourd’hui, un demi-cigare vous sépare du parc des Princes.
Or donc, un matin du mois de juin d’il y a deux ans, comme six heures sonnaient à Saint-Philippe-du-Roule, un jeune homme trottait d’un pas alerte dans le bout de la rue de Morny où on trouve des maisons, c’est-à-dire entre le faubourg Saint-Honoré et les Champs-Élysées.
Lorsqu’il voulut traverser cette dernière voie qui, Dieu merci, n’est pas encombrée à cette heure matinale, il s’arrêta néanmoins, et parut inquiet comme un provincial égaré en plein carrefour Drouot.
La raison de cette inquiétude était peut-être dans l’arrivée d’une de ces voitures qu’on nomme squelettes, et auxquelles les marchands de chevaux attellent auprès d’un maître d’école le cheval neuf qu’ils veulent dresser.
L’attelage était conduit par un jeune homme tout vêtu de blanc et coiffé d’un chapeau de panama. Derrière le siège, debout sur les palettes, deux autres jeunes gens paraissaient suivre avec attention la marche des chevaux, qui étaient de superbes steppeurs sous poil alezan brûlé.
Le piéton qui arrivait à l’angle de la rue de Morny eut beau s’effacer ; il fut aperçu par les trois jeunes gens qui ne purent retenir un cri de surprise, tandis que celui qui conduisait arrêtait les chevaux.
– Bonjour, baron, lui crièrent-ils.
Se voyant reconnu, le piéton s’avança.
– Bonjour, mes très chers, répondit-il.
– Mais que faites-vous donc à pied dans les Champs-Élysées à six heures du matin ? dit en riant celui qui tenait les guides.
– Je prends l’air.
– Vous rentrez ?
– Non, je sors.
– Et à pied ? Vous habitez cependant rue du Helder ?
– J’ai pris le boulevard Haussmann tout du long jusqu’à la rue de la Pépinière.
– Baron, mon ami, dit un des deux autres jeunes gens, aussi vrai que je m’appelle Léon de Courtenay, tu es mystérieux comme un héros de roman.
– Héros, non ; mystérieux, peut-être, dit le jeune homme en riant. Donnez-moi donc du feu, Arthur, j’ai laissé éteindre mon cigare.
– Mon cher, dit le personnage vêtu de blanc en lui tendant son cabanas, vous êtes amoureux, n’est-ce pas ?
– Peut-être…
– Et vous allez soupirer sous un balcon ?
– Peut-être encore. Au revoir, messieurs et merci.
Ce disant, M. le baron de Morgan salua, traversa les Champs-Élysées et poursuivit son chemin vers le Trocadéro.
C’était un homme de vingt-huit à trente ans, de taille moyenne, blond, mince, joli garçon, excessivement distingué et tel qu’une femme romanesque n’en saurait rêver de plus accompli.
Il cheminait d’un pas leste, le regard perdu dans cet horizon de brume bleuâtre qui inonde Paris le matin en été, et paraissait cependant peu pressé d’arriver à son but.
Les trois jeunes gens du squelette s’étaient arrêtés avec curiosité, et celui qu’il avait appelé Arthur murmura :
– Dieu me damne si je sais où il peut aller !
– Je le saurai, moi, dit M. Léon de Courtenay.
Un pli de terrain déroba bientôt le baron à leurs regards, et le squelette reprit sa course vers l’arc de triomphe.
Le baron cheminait toujours.
Quand il fut au Trocadéro, récemment transformé, au lieu de prendre le quai, il remonta vers Passy, longea la grande rue, passa devant la station du chemin de fer, suivit le boulevard Beauséjour et ne s’arrêta qu’à l’angle de la rue de l’Assomption.
Là, il jeta son cigare et s’enfonça dans une petite ruelle bordée de haies et de clôtures en planches qui est bien, en plein Paris, le coin le plus retiré du monde.
Auteuil a ses mystères de feuillage et de fleurs, ses nids de verdure que seuls les initiés connaissent.
Entre la rue de l’Assomption et la rue de la Source, il y a une centaine d’arpents coupés de chemins creux, couverts de grands arbres, semés de jolies et blanches maisons qui rappellent les cottages de Montmorency et du lac d’Enghien.
Ce fut dans ce dédale fleuri que le baron s’engagea.
Quelle était donc la femme, ange ou fée, pour laquelle il mouillait si gaiement ses pieds dans la rosée du matin ?
Un peu au-dessus de la rue de la Source, il prit un petit sentier à l’entrée duquel se trouvait l’écriteau traditionnel : Terrains à vendre, se glissa le long d’une haie jusqu’à une belle grille seigneuriale qui portait une autre enseigne : Il y a des pièges à loups dans le parc, et s’arrêta de nouveau.
Il était bien, en effet, arrivé à la grille d’un parc, si on peut donner ce nom toutefois à un beau jardin planté de grands arbres, couvert de fleurs, et au milieu duquel se dressait une coquette maison brique et pierre, avec terrasse à l’italienne, dont toutes les persiennes étaient closes, preuve évidente que les maîtres de cette jolie demeure dormaient encore d’un profond sommeil.
Alors notre jeune homme s’assit sur le mur d’appui de la grille et se mit à couver d’un amoureux regard la blanche villa.
Sous son toit sans doute sommeillait la fée.
Il consulta sa montre, il était sept heures.
On eût pu conclure d’un léger froncement de sourcils qu’il ne put réprimer que le baron trouvait la fée plus paresseuse qu’à l’ordinaire.
– Elle sera allée au bal de charité qu’on a donné hier, pensa-t-il.
Et il eut un de ces bons gros soupirs qui soulèvent la poitrine des amoureux convaincus.
Et, comme il s’obstinait à fixer les yeux sur ces jalousies immobiles, une voix retentit tout à coup à dix pas de lui.
Une voix sonore, un peu moqueuse en sa franchise, qui disait :
– Mon cher baron, vous n’avez donc pas lu qu’il y a des pièges à loups dans le parc ?
Le baron se retourna, pâle, muet, le rouge au front.
Un homme en jaquette de coutil rayé, en souliers blancs, une casquette de velours sur la tête, venait de se montrer entre deux touffes d’ébéniers de l’autre côté de la grille.
– Monsieur de Valserres ! balbutia le baron.
– Un père qui veille sur sa fille comme un dragon sur un trésor, mon cher baron, répondit en souriant le nouveau venu qui était un homme d’à peine quarante-trois ou quarante-quatre ans.
Et comme le baron se montrait de plus en plus confus, il ajouta, riant toujours :
– Suivez donc la grille jusque là-bas à cette petite porte, que je vais vous ouvrir ; nous causerons un brin, monsieur le lovelace.
Et, en effet, le baron ayant suivi la grille, vit la petite porte s’ouvrir, et M. de Valserres le prenant par le bras, lui dit :
– Entrez donc, il y a des pièges à loups, mais je les connais et vous les indiquerai assez à temps pour que vous ne tombiez pas dedans.
Pour les voleurs de votre espèce, mon cher baron, il faut des pièges plus sérieux.
Il l’entraîna, raillant ainsi, jusque sous une tonnelle de verdure, l’y fit asseoir sur un banc rustique, auprès d’une table qui supportait des journaux et une boîte de cigares ; et il lui dit alors :
– Prenez un puros et causons, baron. Vous êtes donc amoureux de ma fille ?
– À ce point, mon cher hôte, répondit le baron, qu’il est probable que je me brûlerai la cervelle en rentrant chez moi, car maintenant il faut que je vous demande la main de Mlle de Valserres, que vous en userez, j’en suis certain.
– Pourquoi donc, baron ?
– Oh ! mon Dieu, pour une raison toute simple et pleine de sens. Je suis ruiné, et on ne fait pas figure dans le monde avec les cent mille livres de rente qu’on a éparpillées un peu partout et dont il ne reste plus rien.
Néanmoins, poursuivit le baron avec une gaieté mélancolique, je dois vous faire ma demande en règle.
– Voyons, dit M. de Valserres, et si je ne vous accorde pas la main de Pauline, il est probable que je vous trouverai d’excellentes raisons pour que vous laissiez vos pistolets tranquilles.
Diantre ! monsieur, je suis un homme d’argent, un banquier âpre au gain ; mais je suis bon diable au demeurant, et ne veux avoir sur la conscience la mort de personne, pas même celle d’un mauvais sujet comme vous. Donc, parlez, je vous écoute.
Et M. de Valserres laissa monter en spirale vers le bleu du ciel la fumée grise de son cigare.
Le baron avait pris le cigare que lui offrait M. de Valserres.
– Donnez-moi un peu de feu, dit-il. Bon ! maintenant, je suis à vous.
– J’écoute, dit le banquier.
– Mon cher hôte, je commence par vous dire que c’est par erreur qu’on m’appelle M. de Morgan.
Je m’appelle Morgan tout court. Cependant je suis baron. Mon grand-père était fournisseur des armées au commencement de ce siècle, et l’Empereur le fit baron.
Mais je n’ai pas dans les veines la plus petite goutte de sang des croisés et mon blason ne figure nullement à Versailles, en dépit du cachet historique de ce nom de Morgan.
Mon grand-père était un aventurier méridional, et ni mon père, ni mon oncle, ni moi n’avons jamais su son histoire.
Il évitait soigneusement de parler de sa jeunesse, et dans le pays où il est mort propriétaire du vieux château de Crisenon, on n’a jamais su où il était né.
Je ne l’ai pas connu. Il est mort une dizaine d’années avant ma naissance, laissant sept ou huit millions de fortune, que mon père et mon oncle se sont partagés.
– Ah ! vous avez un oncle ? dit M. de Valserres.
– Riche, vieux, sans enfants, et dont je suis l’unique héritier. Mais le bonhomme est vert, et il pourrait bien mourir centenaire.
Vous voyez donc, mon cher hôte, que je ne puis pas, raisonnablement, mettre cet oncle-là en ligne de compte.
Parlons donc de moi seul.
J’ai mangé tout mon bien, et de la façon la plus naturelle, comme vous le pensez.
J’ai joué, j’ai brocanté des chevaux, acheté des rivières de diamants pour tout le corps de ballet de l’Opéra, et je me suis éveillé un matin avec six mille livres de rente à peine, un peu blasé, un peu vieilli, et bien décidé à me brûler honorablement la cervelle après avoir changé le dernier louis de mes cent vingt mille francs, lorsque je me suis aperçu que j’avais dans le cœur un amour vrai, profond, incommensurable ; qu’après avoir aimé le vice j’adorais la vertu, et cette découverte a été mon premier remords.
Vous devinez, n’est-ce pas ?
– Parfaitement, dit froidement le banquier, vous aimez ma fille.
Le baron fit un signe de tête affirmatif et continua :
– Depuis ce jour j’ai rompu avec mon passé ; on ne m’a plus vu au club, on ne m’a plus rencontré aux courses ; j’ai vendu mes chevaux, je me suis défait de quelques bibelots de prix, et au lieu de me dire : À cinquante mille francs par an, j’en ai encore pour vingt-six mois, je me suis dit : J’ai six mille livres de rente et je pourrai vivre et adorer mon idole dans l’ombre. Car vous pensez bien que l’idée de vous demander la main de Mlle de Valserres ne m’était même pas venue.
Depuis trois mois voici comme j’ai arrangé ma vie.
Chaque matin, je viens me blottir là derrière cette grille, et j’attends que votre fille ouvre sa fenêtre et me montre son visage d’ange.
Alors je m’en vais, et j’ai du bonheur pour ma journée.
Maintenant, ce bonheur est fini, puisque vous savez mon secret, et j’ai l’honneur de vous demander la main de Mlle Pauline de Valserres, en vous conseillant fort de me la refuser, car je ne suis pas digne d’elle.
Le baron avait dit tout cela simplement, sans emphase, comme il eût raconté une histoire ; mais on devinait son émotion et sa souffrance à un léger pli formé sur son front entre les deux sourcils, et à un petit geste fiévreux et saccadé qui accompagnait chacune de ses paroles.
M. de Valserres était demeuré impassible.
– Histoire pour histoire, dit-il ; nous parlerons ensuite de ma fille.
Vos confidences provoquent les miennes, et je vous vais esquisser en quelques mots ma biographie.
Mais, si vous le voulez bien, nous allons nous promener un peu : j’ai besoin de marcher.
– Soit, dit le baron.
Le banquier le prit par le bras, et ils se mirent à arpenter une allée sablée plantée de marronniers.
– Je me suis marié à vingt et un ans, dit M. de Valserres, et j’en ai quarante-trois.
Veuf au bout de deux ans, j’ai vécu pour ma fille, et je l’ai élevée en père jaloux.
Vous savez le bruit qu’elle fait dans le monde avec son esprit, sa beauté, sa voix de diva. Elle est capricieuse ; elle est excentrique et presque élevée à l’anglaise. Je l’ai voulu ainsi, et peut-être ai-je eu tort, mais qu’y faire à présent ?
Et le banquier soupira.
– J’ai une fortune considérable, poursuivit-il, mais j’ai eu le tort d’engager des capitaux importants dans de grandes affaires, dont quelques-unes sont aléatoires.
Riche aujourd’hui, je puis être ruiné demain.
– J’aimerais assez cela, dit le baron Morgan en souriant.
– Je vous comprends, dit le banquier, mais permettez-moi de ne point partager votre désir. Donc, je n’ai qu’un amour au monde, une adoration plutôt. Lorsque, dans un bal, je vois une demi-douzaine de petits messieurs à moustaches se presser autour d’elle et se disputer la faveur d’une contredanse ou d’une valse, je suis toujours tenté de leur couper les oreilles.
– Je comprends cela, dit à son tour le baron Morgan.
M. de Valserres reprit :
– Jadis, un banquier ne se livrait qu’à des opérations classiques ; il faisait sa fortune lentement, petit à petit ; aujourd’hui, on veut aller vite. La vie est devenue une bataille dont le million est l’arme de guerre ; et puisque tout le monde se bat, je fais comme tout le monde.
Pauline aura donc une grosse dot, une dot princière, si je la marie vite.
Mais je dois vous dire que l’idée ne m’en vient que pour soulever des tempêtes de colère dans mon cœur : je suis jaloux, jaloux de ma fille.
Elle s’y prête admirablement du reste, car elle a refusé l’hiver dernier une douzaine et demie de prétendants, tous plus accomplis les uns que les autres.
Le baron Morgan eut un soupir de soulagement.
– Cependant, poursuivit M. de Valserres, si j’étais sage, je commencerais par lui chercher un mari riche, qui eût une fortune bien solide, en belles maisons ou en bonnes terres ; je mettrais deux millions dans la corbeille et je dirais à mon gendre :
– Prenez toujours cela, et ne me le rendez sous aucun prétexte.
Je joue ce jeu d’enfer qu’on nomme le jeu des millions.
Ou je vous laisserai de quoi acheter un trône à votre femme, ou vous serez forcé de me donner du pain pour mes vieux jours.
Donc, acheva le banquier, si j’étais sage, je ferais cela.
– Mais vous n’êtes pas sage, dit le baron en souriant.
– Non, et voici pourquoi.
Il s’arrêta un moment et regarda le jeune homme en souriant.
– Je me suis juré, reprit-il, de laisser Pauline libre ; elle prendra celui qu’elle aimera… et je crois bien, ajouta-t-il, que vous ne vous brûlerez pas la cervelle, car Pauline vous aime…
Le baron jeta un cri de joie et voulut tomber aux genoux du banquier.
Mais celui-ci était devenu pâle tout à coup et il recula de quelques pas, comme si une hideuse apparition eût soudain surgi devant lui.
Sa main s’allongeait fiévreuse vers la grille du jardin, et il murmurait d’une voix étranglée :
– Lui ! lui ! encore lui !…
Alors le baron Morgan, stupéfait, suivit du regard cette main étendue, et il aperçut collée aux barreaux de la grille, entre deux buissons fleuris, une tête pâle, grimaçante, moqueuse, couverte de rares cheveux grisonnants, animée de lèvres minces et ironiques, éclairée par deux petits yeux caves et flamboyants, et il entendit en même temps une voix grêle, mordante, timbrée, d’une raillerie haineuse, qui disait :
– Oui ! oui ! tu peux y compter, tu te ruineras !…
M. de Valserres eut alors un accès de rage, et, s’armant d’un bâton qui servait de tuteur à une plante, il marcha vers la grille en le brandissant.
Mais la tête hideuse disparut et la voix s’éloigna en répétant :
– Oui, oui, tu te ruineras !…
Si M. de Valserres avait éprouvé une émotion pleine de colère à la vue de cette tête grimaçante qui le défiait, le baron Morgan, lui, était demeuré stupéfait.
M. de Valserres s’était avancé jusqu’à la grille en brandissant son bâton.
Mais le mystificateur s’était enfui et le banquier n’avait nulle envie de le poursuivre, car il revint à son hôte et lui dit :
– Je vous demande mille pardons, mais j’ai un peu perdu la tête à la vue de cet insolent.
Il essayait de sourire, mais son visage crispé et sa pâleur protestaient contre ce ton d’indifférence affectée.
– Mais quel est donc cet homme dont la vue produit sur vous une impression aussi désagréable ? demanda le baron Morgan.
– Mon cher ami, répondit le banquier, je vais regretter amèrement de vous avoir donné ma parole.
– Hein ? fit le jeune homme.
– Le jettator m’est apparu, et très certainement un malheur nous menace, ou vous, ou moi, ou ma fille, et peut-être même tous les trois.
– Mais, mon cher hôte, dit le baron en souriant, avez-vous réfléchi que nous vivons en 1866, qu’il est sept heures du matin, que nous sommes à Auteuil, banlieue annexée, et par conséquent à Paris ?
– Baron, répondit le banquier ému, quand je vous aurai raconté l’histoire de cet homme, vous accueillerez moins légèrement mes terreurs.
Le baron lorgnait toujours les persiennes closes de la villa.
– Nous avons le temps, ajouta M. de Valserres ; nous avons eu du monde hier, Pauline s’est couchée tard et elle sera paresseuse.
– Je suis tout oreilles, monsieur.
– Figurez-vous, continua le banquier, que je connais cet homme depuis ma jeunesse ; nous nous sommes trouvés côte à côte sur les bancs du collège.
C’était un esprit chagrin, un caractère taquin et méchant, une de ces natures aigries par la pauvreté et le malheur héréditaires ; ces hommes-là n’ont pas souffert encore, mais leurs pères ont souffert pour eux et leur ont légué comme le reflet de leurs douleurs.
On l’appelait Simon.
Était-ce un prénom ou un nom ? Je ne l’ai jamais su.
Il n’avait pas d’amis, on ne lui connaissait pas de parents.
Quand les vacances nous ouvraient les portes du collège, il y demeurait, lui, et personne ne venait le chercher.
Il avait bien quatre ou cinq ans de plus que moi, mais il était si malingre, si chétif, que le plus jeune de nous le rossait à coups de poing.
Du reste, il nous détestait tous. Mélange de haine et d’orgueil, ce petit être semblait avoir pris à partie, dans ses camarades, la société tout entière.
Il nous espionnait et rapportait, comme on dit au collège, et nous avions fini par le haïr presque autant qu’il nous haïssait.
À quinze ans, je le perdis de vue, mais il me resta de lui un souvenir détestable.
Il avait quitté le collège avant moi, et il était peu probable que, lui pauvre et moi riche, nous nous rencontrerions désormais.
Cela devait être cependant.
De seize à vingt ans je voyageai.
La mort de mon père, banquier comme moi, me rappela à Paris.
La première figure que j’aperçus dans mes bureaux, car je me trouvais banquier à mon tour, fut celle de Simon.
Le pauvre diable était employé à dix-huit cents francs.
Je commis alors une mauvaise action.
Sous l’influence de mes souvenirs de collège, je sentis ma haine pour lui se réveiller, et je le congédiai.
Je n’oublierai jamais le regard qu’il me lança quand mon chef de contentieux lui eut signifié ma volonté.
Il osa me tutoyer comme au collège :
– Tu m’ôtes mon pain, me dit-il, mais je porte malheur, et je me vengerai.
On le mit à la porte et je n’y pensais plus.
J’étais fiancé depuis longtemps à une jeune créole de la Martinique élevée en France, et j’attendais l’expiration de mon deuil pour l’épouser.
– C’était la mère de Pauline ? demanda le baron.
– Non, dit le banquier, il y avait un an que mon père était mort, et mon mariage était fixé à la semaine suivante.
Tout était prêt, le contrat, la corbeille.
Chaque jour j’allais passer la soirée auprès de ma fiancée, qui habitait le rond-point des Champs-Élysées, et quelquefois nous sortions en voiture avec sa mère.
Ce soir-là, comme je traversais la place de la Concorde, mon cocher faillit renverser un homme mal vêtu, portant des bottes percées et un chapeau rougi et sans bords.
Le pauvre hère n’eut que le temps de se ranger pour n’être point écrasé.
Mais en se rangeant il me regarda, et je reconnus Simon. Il me menaça du poing et se mit à rire d’un rire de malheur.
Hélas ! la vengeance commençait.
J’avais laissé, la veille, ma fiancée joyeuse et pleine de santé ; je la trouvai souffrante, alitée, en proie aux premières atteintes d’un mal épouvantable, la petite vérole. Trois semaines après elle était morte.
– Mais, mon cher hôte, dit le baron, je ne vois là qu’une coïncidence, et vraiment…
– Attendez encore, reprit le banquier. Tout passe en ce monde, surtout la douleur. Après le désespoir, vint une simple tristesse, et un an après j’avais oublié ma pauvre créole et j’épousais la mère de Pauline.
Mes affaires prospéraient ; ma fortune s’était triplée en deux ou trois ans ; Pauline venait de naître, et j’étais l’homme le plus heureux du monde.
Une nuit, en sortant du club, je rencontrai un mendiant qui me tendit la main.
Je lui donnai cent sous ; mais, comme il allait les prendre, la clarté d’un bec de gaz inonda mon visage.
Alors le mendiant eut un éclat de rire et repoussa mon aumône.
– Je ne veux pas de ton argent, me dit-il.
J’avais reconnu Simon.
Huit jours après, il y avait des courses à la Croix-de-Berny, et j’étais engagé dans un pari considérable. Le cheval que je faisais courir gagna, et je m’en revenais tout joyeux, en demi-daumont, ayant Mme de Valserres à ma droite, lorsque, entrés dans Paris par la barrière d’Enfer, les chevaux rencontrèrent un régiment, musique en tête, et s’emportèrent.
La voiture versa, le postillon fut tué, et ma femme, qui relevait de couches, éprouva une telle émotion qu’elle se mit au lit et mourut quinze jours après.
– Et vous croyez… dit encore le baron.
– Je crois à ce que j’ai vu, dit M. de Valserres avec émotion. Au moment où l’on parvenait à arrêter les chevaux, tandis qu’on relevait mon postillon et que je donnais des soins à Mme de Valserres évanouie, un mendiant passa auprès de moi et me regarda en riant.
– C’était encore Simon ?
– Oui, fit le banquier d’une voix sourde.
– Et vous ne l’avez plus revu depuis ?
– Si, une fois, il y a dix ans. J’étais engagé dans une très grosse affaire d’emprunt étranger. La Bourse était folle. Comme j’entrais dans le temple de ce dieu moderne que nous appelons l’argent, un homme appuyé à la balustrade se retourna et me regarda, c’était encore lui.
L’épouvante me prit. Je montai à la corbeille, et je fis vendre pour trois millions de rente.
L’opération fut désastreuse, et il me fallut quatre ou cinq ans pour boucher cette brèche faite à ma fortune.
Depuis lors je n’avais plus revu cet homme.
Comment est-il venu ici ? d’où vient-il ? Je l’ignore, mais c’est un malheur qu’il nous annonce.
– Heureusement que je ne suis pas superstitieux, dit le baron.
Et comme le jeune homme parlait ainsi, une des fenêtres du premier étage s’ouvrit, et une femme en peignoir blanc s’y montra, ses beaux cheveux noirs flottant sur ses épaules.
Elle aperçut le baron causant avec M. de Valserres et eut un petit cri d’étonnement et de joie.
– Pauline ! dit le banquier.
Le baron était en extase devant cette éblouissante apparition.
La jeune fille sourit après avoir rougi, et son sourire, dont le baron s’enivra, fut comme un baume consolateur qui se répandit sur le cœur troublé de M. de Valserres, qui oublia un moment la sinistre et moqueuse figure de Simon le mendiant.
Ce fut une journée délicieuse que celle que le baron Paul Morgan passa dans la villa d’Auteuil.
Le matin, il était à peu près désespéré ; le soir, le paradis était dans son cœur.
M. de Valserres avait dit vrai, – Pauline l’aimait.
Pourtant, aux yeux du monde, les deux jeunes gens se connaissaient à peine.
Jamais ils ne s’étaient vus en dehors de ces fêtes qui réunissent là tout Paris ; jamais un mot ne leur était échappé comme un aveu ; mais quand ils se rencontraient, un tressaillement mutuel leur disait qu’ils étaient l’un à l’autre.
Ce fut donc une vraie journée de fiançailles que celle qui s’écoula.
Le baron déjeuna à Auteuil, et comme le banquier était un homme qui allait vite en besogne, il leur dit :
– Mes enfants, je ne sais rien de plus désagréable, dans la vie, que les horribles préliminaires du mariage qui tuent quelquefois l’amour avant sa naissance. Si vous ne vous aimiez pas, on laisserait les choses suivre leur cours, mais vous vous aimez, et c’est bien différent. Si vous m’en croyez, nous ne ferons pas le moindre bruit. Nous sommes en été, il n’y a personne à Paris ; nous n’enverrons que des lettres de faire-part et pas d’invitations.
Vous vous marierez dans trois semaines à l’église et à la mairie d’Auteuil, puis vous vous envolerez en Suisse ou en Allemagne ; et quand vous reviendrez, en octobre, on n’aura pas eu le temps de jaser, de faire mille commentaires ; d’établir que vous, baron, vous êtes ruiné, et que Pauline aurait pu trouver un mari qui ait moins fait parler de lui.
M. de Valseras avait donc ainsi réglé les choses : on rachèterait deux bans à l’église, on ferait les publications, et dans trois semaines au plus Pauline serait la baronne Morgan.
Lorsque, à dix heures du soir, le baron songea à retourner à Paris, il n’était pas bien sûr d’être éveillé.
– Tout cela, pensait-il, me semble impossible ! Hier, je n’espérais rien ; aujourd’hui, tout m’est promis. C’est à n’y pas croire… Je rêve bien certainement. Si je rencontrais un ami, je le prierais de me pincer le bras.
Et il s’en allait, devisant ainsi avec lui-même, par le chemin qu’il avait suivi le matin.
M. de Valserres, en lui serrant la main, lui avait dit :
– Vous pouvez prendre une voiture pour vous en aller ; la dot de votre femme fera face à cette prodigalité. Mais Paul Morgan avait répondu en souriant :
– J’ai besoin d’être seul avec moi-même et de me faire à mon bonheur.
Cependant, comme il avait franchi cette porte ménagée dans la grille que M. de Valserres lui avait ouverte le matin, un souvenir avait traversé son esprit. Ce souvenir était celui de la figure hideuse et grimaçante entrevue l’espace d’une minute, et qui avait si fort épouvanté M. de Valserres.
Paul Morgan avait toujours été un sceptique, et les superstitions modernes telles que la jettature n’avaient jamais eu de prise sur lui.
Il n’avait jamais touché un bossu avant d’entreprendre une affaire importante, ni consulté des somnambules pour savoir s’il était aimé.
Eh bien, ce soir-là, son cœur, qui débordait d’ivresse, se serra tout à coup ; une vague inquiétude s’en empara et il se souvint des paroles de M. de Valserres, le matin :
– Il nous arrivera certainement un malheur, à vous, à ma fille ou à moi, ou peut-être même à tous les trois.
Paul Morgan hâta le pas, comme s’il eût eu peur de rencontrer une seconde fois cet homme qui paraissait avoir eu une influence funeste sur la vie tout entière de son beau-père futur.
Nous l’avons dit, il suivait le chemin qu’il avait pris le matin pour venir, ou plutôt il croyait le suivre.
C’est-à-dire qu’il était parvenu à un endroit où le sentier bordé de haies coupait un autre sentier.
La nuit aidant, car il avait toujours fait cette route en plein jour jusque-là, il s’était trompé, avait pris à droite au lieu de prendre à gauche, et tantôt rêvant avec délices à Pauline de Valserres, tantôt tressaillant au souvenir du prétendu jettator, le baron avait tourné deux ou trois fois sur lui-même sans s’en douter, descendant vers la rue de la Croix au lieu de remonter vers celle de l’Ascension.
Tout à coup il s’arrêta et se dit :
– Ou je me suis égaré, ou le chemin s’allonge pendant la nuit.
Cette partie d’Auteuil, qui est encore à l’état rustique, n’a ni becs de gaz, ni noms de rues, et la nuit, étoilée, il est vrai, était privée de lune.
M. Paul Morgan eut bien vite constaté qu’il s’était trompé de sentier ; mais Auteuil n’est pas si grand qu’on ne finisse par s’y reconnaître ; et il continua gaiement à marcher droit devant lui, se répétant le proverbe que tout chemin mène à Rome et par conséquent à Paris.
Mais celui qu’il suivait et qui décrivait mille courbes originales, courant tantôt entre deux buissons, tantôt à travers des clôtures en planches bordant des jardins déserts et des terrains en friche, paraissait ne pas devoir finir. Çà et là, cependant, au-dessus des haies, quand il se dressait sur la plante des pieds, il apercevait une maisonnette, mais une maisonnette silencieuse et plongée dans les ténèbres.
Enfin, à force de marcher, le baron arriva à un endroit où le chemin profondément encaissé formait un coude assez brusque, et ce coude franchi, il fut frappé au visage par un rayon de lumière.
À cent pas environ devant lui, une petite maison, une hutte plutôt, inclinait sur le chemin, par-dessus la haie, son pignon déjeté.
La lumière était celle d’une chandelle qu’on apercevait auprès d’une fenêtre.
– C’est la demeure de quelque jardinier, pensa le baron, et il me remettra dans mon chemin.
Il hâta un peu le pas et marcha droit sur la maisonnette.
Mais, à une certaine distance, il s’arrêta.
Un bruit avait frappé son oreille, et il ne pouvait s’y tromper, dans cette maison il y avait un malade ou un mort, car il entendait sangloter.
Alors il s’approcha avec précaution, étouffant le bruit de ses pas, cheminant sur les côtés qui étaient couverts d’herbe, et il arriva ainsi presque auprès de la haie qui séparait la maisonnette du chemin.
C’était une pauvre cabane en terre et en pans de bois, qui s’élevait au milieu d’un terrain inculte et planté de vieux arbres.
Elle n’avait qu’un rez-de-chaussée percé d’une fenêtre unique sur le côté.
Cette fenêtre était ouverte, et, caché derrière la haie, le baron Morgan put jeter un curieux regard à l’intérieur. Il vit alors une jeune fille pâle, amaigrie, qu’on eût volontiers prise pour un fantôme, et qui était couchée sur un misérable grabat.
Un homme, tournant le dos à la fenêtre, mais dont les cheveux étaient blancs, agenouillé devant le lit, pleurait bruyamment, en tenant dans ses mains la main diaphane de la malade.
Celle-ci disait :
– Ne pleure pas, père ; j’ai tant souffert déjà, va !… La mort est une délivrance, et la délivrance approche… Ne pleure pas, cher père… Dieu est bon, il prendra soin de toi…
– Ma fille ! ma fille ! disait le vieillard d’une voix pleine de sanglots.
Et tout à coup il se leva, et la lumière inonda son visage, et le baron Morgan recula frappé de stupeur : ce visage baigné de larmes, il l’avait reconnu !
Ce père qui pleurait sur sa fille agonisante dans ce réduit misérable, qui sans doute avait vu bien des jours sans pain, c’était le même homme qui le matin avait crié à M. de Valserres ces mots sinistres : « Tu te ruineras ! »
Cet homme enfin, c’était Simon le mendiant, Simon que le banquier avait chassé de ses bureaux vingt ans auparavant.
Et le baron Paul Morgan, qui d’abord avait songé à entrer dans cette maison et à y offrir de l’argent et des consolations, se sentit pris d’une indicible épouvante, et il s’enfuit…
Après avoir couru tout droit devant lui pendant un quart d’heure environ, le baron Morgan s’arrêta tout à coup.
D’abord il avait entendu tout près de lui le sifflet du train du chemin de fer de ceinture ; ensuite il s’était reconnu. À force de tourner et de retourner dans ce labyrinthe de chemins creux et de sentiers, il se retrouvait presque à son point de départ, c’est-à-dire au bout du chemin des Fontis, à quelques pas de la rue de l’Assomption.
Il se mit alors à rire.
– On n’est pas plus fou que moi, se dit-il. Si mes anciens amis du club m’avaient vu tout à l’heure me sauvant à toutes jambes, ils se seraient joliment moqués de moi.
Un bec de gaz lui indiquait maintenant son chemin, et le roulement du train sur la voie ferrée lui rappelait que l’âge des fantômes, des revenants et des gens à mauvais œil était passé.
– Ce pauvre M. de Valserres, se dit-il en se remettant en marche, je ne l’aurais jamais cru superstitieux à ce point.
Croire qu’un homme lui porte malheur parce qu’il a eu tort avec cet homme, parce qu’il l’a privé de son pain autrefois, ne s’explique, en définitive, que par le remords.
M. de Valserres a été dur pour le pauvre diable, et le pauvre diable se venge à sa manière, c’est-à-dire qu’il l’injurie quand il le rencontre.
Le train venait de passer.
Paul Morgan calcula qu’il aurait le temps de prendre le suivant à la station de Passy, et il se mit à longer le boulevard Montmorency, causant toujours avec lui-même.
– La preuve que cet homme n’est et ne saurait être un jettator, poursuivit-il, c’est que ceux qui croient à la jettature n’ont jamais douté de ceci : que celui qui porte malheur aux autres se porte bonheur à lui-même.
Or, je viens de voir le pauvre diable à genoux près du lit de sa fille agonisante et fondant en larmes, et j’ai été assez niais pour prendre la fuite, alors que j’eusse si bien fait d’entrer et de vider ma bourse dans cette maison où il n’y a peut-être pas de pain.
Et comme le baron Morgan avait obtenu la permission de revenir le lendemain à la villa, mais un peu moins matin qu’à l’ordinaire, c’est-à-dire au temps où il devait, en cachette, contempler son idole, il prit une belle résolution, celle de rechercher cette maisonnette où Simon vivait auprès de sa fille, de lui amener un médecin et de venir à l’aide de cette détresse suprême à l’insu de M. de Valserres et de Pauline elle-même.
C’était un garçon de cœur que le baron Paul Morgan ; il n’y a guère, du reste, que ceux-là qui se ruinent. Et quand il eut arrêté le projet de secourir mystérieusement la victime de son beau-père futur, il se sentit réconcilié avec lui-même à un haut degré et ne songea plus qu’à son bonheur.
La salle d’attente de la station de Passy était à peu près déserte. Cependant le baron fronça le sourcil en y entrant.
Il venait d’apercevoir, humant son cigare, un des trois jeunes gens qu’il avait rencontrés le matin, M. Léon de Courtenay.
Le premier mouvement des gens heureux est de se replier en eux-mêmes pour connaître leur bonheur.
Le besoin d’expansion ne vient qu’après.
M. Paul Morgan eut donc tout d’abord l’intention de battre en retraite et de continuer son chemin à pied.
Mais M. de Courtenay l’avait aperçu et le salua de la main.
Paul rendit le salut, et comme il avait été fort lié avec lui au temps de son opulence, il alla lui tendre la main.
M. de Courtenay le prit par le bras.
– Descendons sur la voie, dit-il ; nous respirerons plus à l’aise et nous causerons ; nous avons près de dix minutes à attendre.
– Est-ce que tu habites Passy l’été ? demanda le baron.
– Je n’y viens pas une fois par an.
– Alors voici un heureux hasard…
Un sourire un peu railleur glissait sur les lèvres de M. de Courtenay.
C’était un garçon de trente ans qui méritait à tous égards le nom de viveur endurci. Il était riche ; après avoir croqué son héritage paternel et maternel, il avait enterré une demi-douzaine d’oncles et de tantes qui lui avaient tout légué.
Fort de son expérience chèrement acquise, M. de Courtenay vivait maintenant en homme qui ne croit à rien, ne s’afflige ou ne se réjouit de rien, marchande le superflu comme d’autres le nécessaire, et est toujours tenté de répondre à ceux qui essayent de parler à son cœur : Je la connais celle-là ! on ne me la fait plus !
Donc M. Léon, vicomte de Courtenay, souriait en regardant le baron.
– Mon cher Paul, lui dit-il, tu ne te doutes guère que tu m’as fait gagner cent louis.
– Moi ! fit le baron.
– Mon Dieu, oui ; j’ai fait ce matin un pari te concernant et je l’ai gagné.
M. Paul Morgan tressaillit et une légère rougeur colora même son front.
– Mon bon ami, poursuivi Léon de Courtenay, il est tout naturel qu’un homme élégant comme toi, qui traverse à pied les Champs-Élysées à six heures du matin, intrigue au plus haut point ses anciens amis qui le rencontrent, surtout quand depuis plusieurs mois il s’est tenu tout à fait à l’écart.
– Ah ! je vous ai intrigués ? dit le baron s’efforçant de sourire.
– Oui. Arthur prétendait que tu allais voir une grisette de Passy ou d’Auteuil.
– En vérité ?
– Moi, j’ai affirmé que tu avais un but plus sérieux ; et comme je sais un tas de choses, j’ai même avancé que tu étais amoureux de la belle mademoiselle de Valserres.
– Vraiment ! fit le baron.
– Et j’ai parié cent louis que je ne me trompais pas.
– Qui sait ? dit M. Paul Morgan. Je ne vois pas encore comment tu prouveras que ton pari est gagné.