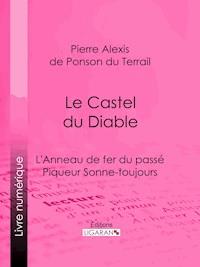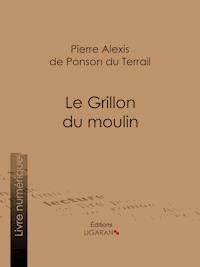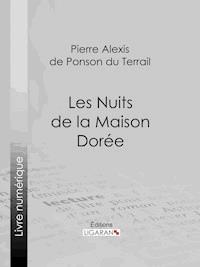
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Il pleuvait... Le boulevard était désert, les boutiques fermées. Minuit sonnait à la pendule d'un cabinet de la Maison-d'Or, où deux hommes étaient assis en face l'un de l'autre. Ils étaient jeunes tous deux, élégants dans leur mise, distingués dans leurs manières. Tous deux résumaient à ravir le prototype dû fils de famille. L'un s'appelait Raymond, l'autre se nommait Maxime. Raymond était grand, il avait l'œil bleu, les cheveux blonds, le pied petit, la main..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À M. Léo Lespès
Mon cher ami.
Je voulais publier mon livre sous les auspices du meilleur camarade que je connaisse dans le monde littéraire et d’un homme de vrai talent.
En écrivant votre nom en tête de ces quelques lignes, je ne pouvais faire mieux.
Vte PONSON DU TERRAIL.
Il pleuvait…
Le boulevard était désert, les boutiques fermées.
Minuit sonnait à la pendule d’un cabinet de la Maison-d’Or, où deux hommes étaient assis en face l’un de l’autre. Ils étaient jeunes tous deux, élégants dans leur mise, distingués dans leurs manières.
Tous deux résumaient à ravir le prototype dû fils de famille. L’un s’appelait Raymond, l’autre se nommait Maxime.
Raymond était grand, il avait l’œil bleu, les cheveux blonds, le pied petit, la main allongée et fine.
Maxime était brun, de taille moyenne, svelte comme un créole de Bourbon, blanc et pâle comme un Moscovite.
Ils étaient l’un et l’autre assis devant une table garnie de trois couverts.
Les crevettes rouges et le buisson d’écrevisses étaient intacts, le vieux médoc n’avait point été débouché, le champagne attendait dans un seau d’eau frappée.
Maxime et Raymond ne voulaient point, sans doute, toucher à leur fourchette avant l’arrivée du troisième convive.
Raymond se levait de temps à autre, allait ouvrir la fenêtre et se penchait au dehors, sans nul souci de la pluie fine et pénétrante qui mouillait l’asphalte des trottoirs.
– Rien ! rien ! murmurait-il, hormis mon cocher qui dort sur son siège et le tien qui lit un journal du soir à la lueur d’un réverbère. Antonia ne viendra pas !…
Puis il revenait s’asseoir en face de Maxime et rallumait son cigare à l’une des bougies placées sur la table.
– Ah ça ! mon cher, dit Maxime, comme Raymond répétait pour la troisième fois : « Antonia ne viendra pas ! » es-tu fou ce soir ?
– Moi, fou ?
– Sans doute.
– Pourquoi cette question ?
– Tu es jeune et beau, tu as cinquante mille livres de rente, tu passes pour un des hommes à la mode, et tu veux qu’Antonia ne vienne pas !
– Peut-être ne m’aime-t-elle plus ?
– Ô cœur naïf ! murmura Maxime. L’homme qui a cinquante mille livres de rente est toujours aimé.
– Tu crois ?
Et Raymond eut un sourire triste.
– Mais, reprit Maxime, quelle singulière idée as-tu donc eue de nous inviter ce soir, moi ton vieil ami, elle la femme que tu aimes, à venir souper ici, en partie fine, comme des étudiants qui ont reçu leur pension mensuelle et veulent éblouir des grisettes ?
Raymond continua à sourire et se tut.
Maxime poursuivit :
– N’as-tu pas, tout en haut du faubourg Saint-Honoré, un petit hôtel charmant ? Et ta salle à manger tendue de cuir, meublée en vieux chêne, jonchée d’un tapis d’Orient, ne nous a-t-elle point réunis assez souvent pour que l’idée de nous conduire au cabaret n’ait pu te venir ?
Car, sais-tu, mon bon ami ! je n’attaque ni la cuisine du lieu où nous sommes, – elle est bonne ! – ni le velours de ses divans, ni l’éclat de ses bougies ; – mais quand on est, comme nous, du jockey, lorsqu’on a chevaux de sang et maîtresses de choix, on n’imite point les clercs d’avoués qui s’en vont, avec des drôlesses, souper, la nuit, sur le boulevard !…
– Halte ! dit Raymond ; j’accepte tes reproches ; mais, que veux-tu ? j’ai vendu mon hôtel ce matin.
– Tu rêves !…
– Non, j’ai fait une excellente affaire. Tu sais que la fureur est aux spéculations sur les terrains.
– C’est vrai. Alors, pourquoi ne point souper chez Antonia ? Elle a un joli chalet au bois.
– C’est vrai ; mais…
Le roulement d’une voiture qui se fit entendre interrompit Raymond. Il se leva précipitamment et, pour la quatrième fois, il courut à la fenêtre.
Un coupé bas venait de s’arrêter à l’entrée de la rue Laffitte, en face de la petite porte du restaurant, et une femme s’était élancée d’un bond sur le seuil.
– C’est elle ! dit Raymond.
Et son visage s’illumina.
Une minute après, en effet, la porte du cabinet s’ouvrit et une femme apparut aux yeux des deux jeunes gens.
Elle pouvait avoir vingt-trois ans, elle était belle comme une héroïne de roman, elle avait la grâce d’une châtelaine de Walter-Scott.
Brune comme une fille d’Andalousie, blanche comme une Anglaise, svelte et souple comme une Indienne, Antonia était une de ces femmes dont le regard exercé un charme fatal, dont l’amour bouleverse toute la vie d’un homme, comme un orage remue et fourrage un champ de blé à la veille de la moisson.
– Ah ! chère Antonia ! murmura Raymond en lui prenant les mains, je craignais que vous ne vinssiez pas !
Elle le regarda avec un sourire à demi railleur :
– Mais, sultan de mon cœur, lui dit-elle, savez-vous bien que je ne vous ai jamais fait attendre ?
– C’est vrai ; mais…
– Il pleuvait, n’est-ce pas ?
– Justement. Et puis… et puis…
– Tu es un niais !… lui dit-elle.
Et elle lui jeta autour du cou ses deux bras blancs comme l’albâtre, et elle effleura son front de ses lèvres plus rouges que les cerises de juin.
– Allons ! dit-elle, à table ! Bonjour, Maxime ; mettez-vous auprès de moi ; là, à ma droite… J’ai faim…
Et elle s’assit.
Raymond souriait toujours, mais il était triste, un nuage planait sur son front.
– Oh ! ce Raymond ! s’écria Antonia en attaquant avec ses doigts roses le buisson d’écrevisses, il sera toute sa vie le plus original des hommes !
– Vous trouvez ? fit Maxime.
– Ma foi ! ce souper en est une preuve.
– C’était ce que je lui disais tout à l’heure.
– Ah ! ah !
– Chut ! mes amis, dit Raymond ; ce souper a un but mystérieux.
Allons donc !
– Un but philosophique, même.
– Tais-toi donc, Raymond ! s’écria Antonia ; le mot de philosophie me fait froid dans le dos.
– Pourquoi donc, chère ?
– Parce que j’avais une amie jadis qui était dans une misère complète, une misère de roi détrôné ou de poète, et qui disait à chaque instant : Bah ! je suis philosophe !…
– Eh bien ! je ne me servirai plus du mot. Seulement…
– Seulement, dit Maxime, tu vas nous expliquer pourquoi nous soupons ici.
Parce que j’ai une confidence à vous faire, à toi mon ami, à elle la femme que j’aime.
– Bon ! fit Antonia qui montra ses dents blanches en un sourire ; voilà que Raymond va tomber dans le sentiment.
Et elle se versa un verre de champagne.
– Peut-être ; mais, dans tous les cas, avant ma confidence, dit Raymond, je vous ferai une question à chacun.
– Voyons ! fit Maxime.
– Soit ! je vais commencer par toi. Qu’est-ce que l’amitié, cher ?
– C’est être deux, n’avoir qu’une bourse, qu’une épée et qu’une plume, et aimer deux femmes, c’est-à-dire ne jamais chasser l’un chez l’autre.
– Ta définition me plaît, Maxime. À toi, Antonia…
– Que veux-tu savoir ?
– Qu’est-ce que l’amour ?
– C’est avoir deux bouches qui s’unissent en un baiser, deux cœurs qui n’ont qu’un seul battement, deux haleines qui se confondent, deux âmes que le bonheur abrutit et qui ne sont plus qu’un instinct.
Raymond eut un cri de joie et tendit ses deux mains, l’une à Maxime, l’autre à Antonia.
– Pardonnez-moi d’avoir douté de vous ? dit-il.
– Tu as douté…
– Oui, de toi, mon cher Maxime, qui, après avoir été mon copin de collège, es devenu mon ami dans le monde ; de toi, ma bonne Antonia, aux genoux de qui j’ai vécu si heureux pendant trois années.
– Je t’aime ! murmura-t-elle.
– Je suis ton frère, ajouta Maxime.
– Alors, amis, dit Raymond, écoutez ma confidence.
– Voyons ! firent-ils étonnés.
Raymond redevint tout à coup mélancolique.
– Savez-vous bien, dit-il, que je ne sais ni mon nom, ni mon origine ?
– Bah !
– Je me nomme Raymond, Raymond tout court.
– Qu’importe ! fit Antonia, je n’ai pas de préjugés aristocratiques.
– Soit, reprit Raymond. Je suis né je ne sais où, mes souvenirs d’enfance se perdent dans un vieux château où m’élevait une femme encore jeune et toujours belle, que j’appelais ma mère et dont je n’ai jamais su le nom. Un jour je fus séparé d’elle brusquement et placé dans cette pension de la rue de Clichy où tu m’as connu, Maxime.
– Et tu n’as pas revu ta mère ?
– Jamais !
– Cependant…
– Une main mystérieuse faisait payer ma pension et mes maîtres d’agrément. J’ai été élevé comme un fils de roi. Escrime, équitation, peinture, musique, j’ai tout appris.
À vingt ans, j’étais reçu avocat. Ce fut alors que le directeur de ce pensionnat dans lequel j’avais passé mes jeunes années et qui avait toujours été l’intermédiaire entre mes protecteurs inconnus et moi, me dit :
– Raymond, mon ami, vous êtes homme et l’avenir est à vous. Peut-être ignorerez-vous toujours votre origine ; mais la fortune console de bien des maux quand elle vient à l’appui d’une bonne éducation et d’un noble cœur. Vous avez tout cela, mon enfant, vous êtes instruit, vous avez l’âme bien placée et vous allez entrer dans la vie avec cinquante mille livres de rente. Tous les six mois, vous recevrez une lettre chargée qui contiendra vingt-cinq mille francs. Allez, et soyez homme !
Je voulus en vain le questionner.
– Mon ami, me dit-il, je suis le dépositaire d’un secret qui mourra avec moi…
Raymond soupira.
– Cet homme est mort, ajouta-t-il, et je ne saurai jamais…
Maxime et Antonia se regardèrent silencieusement.
– Te souviens-tu, Antonia, poursuivit Raymond, de Trim, mon cheval alezan brûlé ?
– Oh ! certes ! dit la jeune femme, M. de B… te l’a payé quinze mille francs, et j’ai trouvé même que tu avais eu tort de le vendre, bien qu’il toussât légèrement.
– Il ne toussait pas, ma chère.
– Alors pourquoi l’as-tu vendu ?
– Parce que j’avais besoin de quinze mille francs. Ne m’avais-tu pas demandé ce joli chalet que tu as à Saint-James ? Il me fallait cette somme pour en parfaire le prix.
– Mais, mon ami…
– Ce matin, continua Raymond, j’ai vendu mon hôtel.
– Impossible !
– J’avais quelques dettes, il faut les payer.
– Mais…
– Voici tout à l’heure deux ans, acheva le jeune homme, que la source mystérieuse de ma fortune s’est tarie. Mon protecteur inconnu est mort sans doute, et il n’aura pas eu le temps de songer à moi.
Tandis que Raymond parlait ainsi, il regardait Antonia.
Antonia baissait les yeux sur son assiette et roulait une boulette de mie de pain dans ses doigts.
– En sorte, dit Maxime, que tu es ruiné ?
– Il me reste environ mille écus, de quoi vivre un an.
– Et… après ?
– Oh ! dit Raymond, je suis jeune, instruit, je parle plusieurs langues, j’ai du courage et je saurai bien gagner ma vie.
Antonia se taisait toujours.
– Ma foi ! dit Maxime d’un ton un peu sec, à ta place, j’irais chercher fortune en Amérique.
Raymond tressaillit, il eut froid au cœur.
– Car, mon bon ami, poursuivit le créole, là-bas, vois-tu, on peut faire tous les métiers saris déroger. On était riche, on ne l’est plus, vite on travaille pour redevenir riche, et quand on l’est redevenu, on retrouve son monde d’autrefois, ses amis, ses relations…
– C’est-à-dire, murmura Raymond avec amertume, que, pendant cette pauvreté momentanée, on les a perdus.
– Non, pas précisément ; seulement, tu comprends bien, cher ami, que les relations deviennent plus difficiles. Ainsi, suppose que tu restes à Paris : te voilà logé au sixième, allant à pied, te crottant ; tu ne peux plus te montrer au bois, aller au club, vivre dans notre monde. Nous resterons amis, mais nous ne pourrons plus nous voir et nous rencontrer comme par le passé.
Maxime disait tout cela froidement, avec une parfaite indifférence, comme s’il eût parlé d’un étranger.
Raymond soupira et se retourna vers Antonia :
– Maxime a raison, dit-il, c’est en Amérique que les fortunes se font vite. Viendras-tu avec moi, chère âme, toi qui savais si bien définir l’amour tout à l’heure ? Va, si je te sens auprès de moi, mon courage doublera, mon intelligence deviendra supérieure, et je me hâterai de faire fortune pour te rendre ton opulence passée.
Et Raymond tendait les mains vers la jeune femme, il l’enveloppait d’un regard humide, et semblait attendre qu’elle se jetât dans ses bras et lui dît : Partons !
Mais Antonia se taisait toujours.
– Tu ne m’aimes donc plus ? demanda Raymond d’une voix tremblante.
Alors elle leva les yeux sur lui :
– Tu sais bien le contraire, dit-elle. Mais tu es fou, mon pauvre ami, de vouloir t’expatrier d’abord, et tu es bien plus fou encore de songer à m’emmener.
– Pourquoi ?
– Eh ! le sais-je ? dit-elle en haussant les épaules. Que veux-tu que j’aille faire en Amérique, à mon âge ? J’ai vingt-trois ans, je suis une vieille femme, cher. J’ai des habitudes prises, des habitudes de paresse et de luxe qui s’accommoderaient mal de la vie errante que tu me proposes. Je n’aime pas aller à pied, j’ai horreur du travail, j’adore le baccarat, je suis à la mode… Veux-tu donc que je renonce à tout cela ?
Et Antonia s’exprimait avec une nonchalante froideur, en traçant de la pointe de son couteau des arabesques sur la table.
Raymond étouffa un cri, regarda tour à tour cet homme qui s’était dit son ami, cette femme qui avait protesté de son amour, et il mit ses deux mains sur son front et s’affaissa sur lui-même en murmurant :
– Oh ! tout ce que j’aimais !…
Raymond s’était évanoui. Mais son évanouissement fut court.
Lorsqu’il rouvrit les yeux, sous l’impression d’une sensation glacée, il vit devant lui un inconnu qui, après lui avoir fait respirer des sels, lui jetait de l’eau frappée au visage.
C’était un homme d’environ trente-six ans, de tournure distinguée, de mise irréprochable, et dont la boutonnière était ornée d’une décoration allemande.
– Monsieur, dit-il à Raymond, pardonnez-moi. J’étais dans le cabinet voisin, j’ai entendu la chute d’un corps et je suis accouru.
Raymond regarda autour de lui et se souvint :
– Où donc est Antonia ? murmura-t-il.
L’inconnu eut un sourire méphistophélique.
– Elle est partie au bras de Maxime, répondit-il. Et comme Raymond pâlissait :
– Tenez, monsieur, reprit-il, permettez-moi de souper avec vous ; je suis homme de bon conseil, au besoin. Nous allons causer et, sans doute, j’aurai le pouvoir de vous consoler de la perte de votre ami et de l’abandon de votre maîtresse.
Maxime regarda l’inconnu avec une sorte de stupeur.
– Vous avez donc entendu ? balbutia-t-il.
– Tout.
– Vous savez…
– Les cloisons sont minces, on est indiscret sans le vouloir. Mais rassurez-vous, monsieur, si j’ai tout entendu, je n’ai rien appris.
Ces mots étonnèrent Raymond, mais l’inconnu les lui expliqua sur-le-champ.
– Je savais votre histoire, dit-il, je la savais même beaucoup mieux que vous.
Raymond s’était levé, il avait fait un pas en arrière et regardait l’inconnu avec étonnement.
Celui-ci ajouta :
– Je sais ce que vous ne savez pas, – votre nom.
– Vous savez… mon nom ? s’écria le jeune homme qui oublia, en ce moment, l’abandon de son ami et de sa maîtresse.
– C’est-à-dire, reprit l’inconnu, que ce protecteur mystérieux qui a veillé sur vous…
– Eh bien ?
– Je l’ai connu. C’était votre père.
– Ah ! monsieur, monsieur, murmura Raymond étranglé par l’émotion, vous allez me dire son nom, n’est-ce pas ? vous allez me dire s’il vit encore… L’inconnu secoua la tête.
– Il est mort, dit-il.
– Mort ! fit Raymond en couvrant de nouveau son front de ses deux mains.
– Mort en laissant une fortune de trois cent mille livres de rente, acheva l’inconnu ; et cette fortune, je puis vous la donner, moi…
Raymond laissa retomber ses mains et attacha sur cet homme un œil fiévreux.
– Qui donc êtes-vous ? lui dit-il.
L’inconnu s’était assis en face de Raymond, qui le considérait avec un étonnement mêlé de stupeur.
Nous l’avons dit, il était de haute taille ; sa mise et ses manières annonçaient un homme distingue.
Mais il y avait dans toute sa personne quelque chose d’étrange, de railleur, et pour ainsi dire d’infernal.
Un moment de silence suivit ses dernières paroles.
– Qui donc êtes-vous, lui dit enfin Raymond, vous qui savez le nom de mon père et qui me proposez de me rendre sa fortune ?…
– Oh ! dit l’inconnu, mon nom ne vous apprendra pas grand-chose, monsieur ; je me nomme le major Samuel, j’ai été longtemps au service de la Prusse ; depuis dix années j’habite la France.
– Mais enfin, monsieur, dit Raymond, comment savez-vous ?…
– Ah ! permettez, dit le major, laissez-moi vous dire d’abord ce que je sais, vous proposer ensuite un petit marché, et puis quand vous l’aurez accepté…
– J’écoute, dit Raymond.
Notre héros était ruiné ; de plus, son seul ami et sa maîtresse venaient de l’abandonner… C’en était assez pour qu’il prêtât l’oreille à cet inconnu qui lui proposait une fortune, c’est-à-dire le moyen de reconquérir sa maîtresse et de retrouver son ami.
Le major se versa un verre de vieux médoc, et, avant de le boire, il le fit briller entré son œil et la flamme d’une bougie.
– Monsieur, dit-il alors, votre père était duc et pair.
Raymond tressaillit.
– Vous êtes son fils presque légitime.
– Pourquoi presque ?
– Parce que le duc votre père allait épouser votre mère lorsqu’une catastrophe les sépara.
– Expliquez-vous, monsieur…
– Oh ! pas avant que vous n’ayez appris ce que j’attends de vous.
– Eh bien ! parlez…
– Le duc votre père a laissé trois cent mille livres de rente.
– Vous me l’avez dit.
– Avez-vous jamais rêvé ce chiffre de fortune ?
– Jamais !
– C’est-à-dire que vous vous contenteriez de la moitié, n’est-ce pas ?
– Ah ! certes…
– Allons ! dit l’inconnu, je le vois, nous sommes tout près de nous entendre.
– Que voulez-vous de moi ?
Le major déboutonna son habit bleu, tira un portefeuille de sa poche, et de ce portefeuille un carré de papier timbré rempli, qu’il mit sous les yeux de Raymond.
Celui-ci lut :
À présentation, je paierai à l’ordre du major Samuel la somme de deux millions cinq cent mille francs.
RAYMOND DE…
duc de… »
– Vous le voyez, dit l’inconnu, le nom de famille est en blanc ; je l’ajouterai sur ce papier le jour où il vous aura été révélé, c’est-à-dire lorsque vous aurez été mis en possession de l’héritage de votre père.
Vous n’avez qu’à signer de votre prénom de Raymond.
– Et si je signe ?…
– Je vous demanderai un délai de six semaines, et je mettrai ce soir même cinquante mille francs à votre disposition.
Le major rouvrit négligemment son portefeuille et montra à Raymond qu’il était gonflé de billets de banque.
Cependant le jeune homme ne sourcilla point.
– Pardon, monsieur, dit-il, permettez-moi une question.
– Faites, monsieur.
– Mon père n’a point épousé ma mère.
– Non.
– S’est-il marié ?
– Oui.
– A-t-il eu des enfants ?
– Non.
Raymond respira.
– Alors je suis son seul héritier ?…
– C’est-à-dire, répondit le major, qu’il a laissé sa fortune à sa nièce, car j’oubliais un détail : le duc votre père est mort d’un coup de sang, et il n’a pas eu le temps de faire un testament.
– Bien, dit froidement Raymond. Mais pensez-vous que, s’il eût fait ce testament, il l’eût fait entièrement en ma faveur ?
– Non ; seulement…
– Alors, interrompit Raymond, vous n’avez aucun moyen, ce me semble, de me faire avoir une fortune qui ne m’était point destinée.
– Pardon, j’en ai un.
– Lequel ?
– Je supprimerai la nièce du duc votre père, et je mettrai au jour des documents qui établiront votre naissance.
Le major s’était expliqué froidement, en homme qui ne doute pas un seul instant que ses propositions ne soient acceptées.
Mais Raymond, qui l’avait écouté jusqu’au bout, se leva, et, le regardant en face :
– Encore une question, monsieur ? dit-il.
– J’écoute, monsieur.
– Mon père était-il réellement gentilhomme, c’est-à-dire aussi noble de cœur que de nom ?
– Je le crois, dit le major.
– Et moi, j’en suis sûr, s’écria Raymond dont la voix éclata comme un tonnerre, car bon sang ne saurait mentir !
Le major tressaillit.
– Que voulez-vous dire ? fit-il.
– Je veux dire que l’âme loyale de ce père, dont j’ignore le nom, a dû passer dans mon âme, monsieur ; car je m’étonne que vous ayez eu l’audace de me proposer un crime ! Vous êtes un misérable !
– Monsieur !…
Raymond étendit la main vers la porte.
– Sortez ! dit-il.
Le major fit un pas en arrière ; ses lèvres blanchirent, son œil eut un éclair de colère, sa main chercha à son côté une épée absente.
Mais ce fut l’histoire d’une seconde ; son rire méphistophélique se fit entendre de nouveau :
– Bah ! dit-il, les querelles gâtent les affaires ; je vous donne rendez-vous ici dans huit jours, monsieur. Vous aurez réfléchi d’ici là…
Et il sortit.
L’inconnu qui prenait le nom de major Samuel descendit, s’arrêta une minute sur le seuil de la porte extérieure de la Maison-Dorée, et parut hésiter.
Mais son parti fut bientôt pris, et, malgré la pluie qui redoublait, il s’élança au-dehors et descendit la rue Laffitte d’un pas rapide.
Lorsqu’il fut arrivé à l’angle de la rue de Provence, il croisa une voiture qui passait à vide.
– Holà ! cocher, cria-t-il.
La voiture s’arrêta, et le major dit au cocher en y montant :
– Marche rondement ; je paie bien.
– Où faut-il vous conduire, bourgeois ?
– Rue de la Pépinière.
– Quel numéro ?
– Tu m’arrêteras devant le passage du Soleil.
Le cocher fouetta son cheval qui partit au grand trot.
– M. Raymond, murmura le major durant le trajet, vous êtes un niais ! Vous laissez échapper votre fortune ; tant pis pour vous !… Je ne la laisserai point échapper, moi.
Et le major eut un sourire sinistre !
Le fiacre atteignit, en dix-minutes, le passage du Soleil.
Le major descendit, donna cent sous au cocher et le renvoya.
Le cocher tourna bride et s’en alla, se disant :
– C’est quelque amoureux qui vient flâner sous les fenêtres d’une dame.
Le major fit quelques pas du côté de la caserne ; puis, lorsque le fiacre eut disparu, il rebroussa chemin et revint jusqu’à la jonction de la rue du Rocher et de celle de la Pépinière, faisant à mi-voix cette réflexion :
– Décidément, tous ces gens-là me seraient inutiles. Je n’ai besoin que du petit baron, et je vais dissoudre l’association.
Cette résolution prise, le major gravit la rue du Rocher, dépassa la place de Laborde, et s’arrêta devant une maison élevée de deux étages seulement, qui n’avait sur la rue qu’une porte bâtarde.
Au lieu de frapper, le major tira une clef de sa poche et l’introduisit dans la serrure.
La porte s’ouvrit, tourna sans bruit et se referma sur le major, qui se trouva dans une obscurité complète, à l’entrée d’un corridor étroit et humide. Mais sans doute ce chemin lui était dès longtemps familier, car il s’avança d’un pas assuré et atteignit la rampe de l’escalier.
Cet escalier, qui montait aux étages supérieurs, descendait en même temps au-dessous du rez-de-chaussée.
Ce fut sous ce dernier chemin que le major, qui marchait à tâtons, s’engagea.
Il descendit une trentaine de marches environ, puis il se trouva devant une nouvelle porte qu’il ouvrit comme la première.
Cette porte ouverte, le mystérieux personnage se trouva sur le seuil d’un réduit assez bizarre.
C’était une sorte de cave, mal éclairée par la lueur d’une lampe à abat-jour. Au milieu se trouvait une table sur laquelle étaient étalés différents papiers.
Autour de cette table étaient rangées six personnes qui paraissaient attendre l’arrivée du major.
Ces hommes semblaient, par leur mise, appartenir à la classe élevée de la société, et leur réunion dans cette cave eût paru bizarre, si la scène qui suivit ne l’eût expliquée.
– Voilà le président ! dirent-ils tous à la fois.
– Et ils se levèrent et se découvrirent avec un certain respect.
Le major rendit les saluts.
– Pardon, messieurs, dit-il, mille pardons de vous avoir fait attendre. Nous devrions être en séance depuis minuit, et voilà qu’il est trois heures du matin.
– Heureusement, dit un jeune homme qui s’était placé à la droite du major, que les nuits sont longues en décembre.
– C’est vrai. Mais cela nous est bien égal cette fois, répondit le major, et la séance sera bientôt levée.
Ces mots excitèrent une surprise générale.
Alors le major se plaça devant la table, ce qui était un indice de sa présidence, et il se couvrit.
– La séance est ouverte, dit-il.
Les six personnes s’assirent, et l’une d’elles, le jeune homme qui avait émis cette observation que les nuits étaient longues en décembre, étala devant le président les papiers qui couvraient la table.
Le président les repoussa du doigt :
– Toutes ces paperasses sont inutiles, dit-il.
– Inutiles ! fit-on avec un redoublement de curiosité et d’étonnement.
Le président agita la sonnette, emblème de son pouvoir.
– Écoutez, messieurs, dit-il. Notre association, que nous avions appelée l’Assurance des héritages, a fonctionné pendant deux années. Nous sommes tous gens du meilleur monde, et le sort, qui nous a ruinés individuellement, est le seul coupable.
Pendant deux années nous avons fonctionné régulièrement ; nous avons eu de bonnes et de mauvaises fortunes, nous avons traversé des heures critiques et couru de grands risques. Moi, personnellement, j’ai joué ma tête ; vous, comte, vous avez frisé le bagne ; tous, nous avons fourni un steeple-chase sur la grande piste de la police correctionnelle.
Nous sommes-nous enrichis ?
Non.
Eh bien ! messieurs, aujourd’hui, la situation est devenue plus terrible que jamais. Quelqu’un de nous aura commis une imprudence ou une simple indiscrétion… La police est à nos trousses !…
Il y eut comme un frisson d’épouvante parmi les six personnages.
Le président poursuivit :
– Car il faut bien vous l’avouer, messieurs : nous avons eu quelques affaires déplorables, surtout la dernière qui a fait quelque bruit.
– C’est vrai, murmurèrent quelques voix.
– À l’heure où je vous parle, tenez, je ne suis point persuadé que dans la rue un agent quelconque ne nous épie.
Il se fit un mouvement dans l’assemblée.
– Je crois donc prudent, Messieurs, de vous engager à vous séparer.
– Mais, dit une voix, l’association est donc dissoute ?
– Provisoirement.
– Ah !
– Dans deux mois, peut-être avant, j’aurai trouvé le moyen de nous reconstituer. Messieurs, la séance est levée !
Le mot de police avait jeté parmi les mystérieux associés du major Samuel une telle perturbation, qu’aucun d’eux ne réclama contre la dissolution de la société.
Chacun tournait des regards inquiets vers la porte et eût voulu être bien loin.
– Allons, messieurs ! reprit le major, du sang froid, s’il vous plaît. Nous allons sortir d’ici les uns après les autres.
Et comme deux des associés faisaient vers la porte deux pas égaux, il ajouta :
– Procédons par ordre et sagement. Nous sommes sept ici : le plus jeune sortira le premier, et moi, en ma qualité de président, je fermerai la marche. Je suis comme le capitaine d’un vaisseau naufragé, je quitte mon bord le dernier. À vous, baron.
Et le président regardait le jeune homme qui s’était placé à sa gauche lorsqu’il avait occupé le fauteuil.
– Baron, lui dit-il, vous allez sortir le premier, et vous rentrerez chez vous par la place de Laborde. Dans cinq minutes, monsieur vous suivra et regagnera pareillement son domicile ; puis les autres, un à un, car un homme isolé qui sort d’une maison n’éveille l’attention de personne.
Tout en parlant, le major avait une plume à la main, et il s’amusait à tracer des hiéroglyphes sur la table.
Celui des associés qu’il avait appelé le petit baron, suivait la plume de l’œil, et chacun de ses traits avait un sens pour lui, dont la réunion signifiait :
« Je serai chez toi dans une heure. »
Le jeune homme sortit en saluant.
Cinq minutes après, un autre le suivit ; puis, de cinq minutes en cinq minutes, chacun des associés s’en alla.
Demeuré le dernier, le major Samuel se mit à rire :
– Les imbéciles ! dit-il…
Quelques instants après, le jeune homme à qui le major Samuel avait donné le titre de baron suivait la rue Taitbout dans son prolongement entre la rue de Provence et la rue Saint-Lazare. Quand il fut arrivé devant le n° 71, il s’arrêta et sonna.
La porte s’ouvrit, le jeune homme entra dans un vestibule spacieux, encore éclairé, jeta son nom au concierge, qui avait tiré son carreau, et monta lestement au premier étage, où il trouva une porte à deux battants dans la serrure de laquelle il introduisit une clef.
Le petit baron, comme disait le major, était chez lui.
– Un valet de chambre qui dormait tout vêtu sur une banquette s’éveilla au bruit des pas de son maître.
– Je gage, François, dit celui-ci, que tu as laissé éteindre mon feu.
– Monsieur le baron peut se tranquilliser, répondit le valet de chambre. Il y a du feu dans le fumoir et dans la chambre à coucher.
– C’est bien, dit le jeune homme.
Et il traversa successivement une jolie salle à manger, un salon meublé avec goût, une chambre à coucher de petite maîtresse et pénétra dans le fumoir.
Le fumoir était en même temps un cabinet de travail.
Il était meublé en vieux chêne, les murs étaient tendus de cuir repoussé, le sol était jonché d’un tapis mauresque.
Le petit baron, comme l’avait appelé le major Samuel, s’assit au coin du feu et attendit, un cigare aux lèvres.
Une demi-heure s’écoula, puis la sonnette de l’appartement rendit un tintement discret.
– François, dit le petit baron, tu vas introduire le major et tu iras te coucher ensuite. Je n’ai plus besoin de toi.
C’était, en effet, le major Samuel.
Il entra, tendit au jeune homme le bout des doigts, se débarrassa de son paletot, et se laissa tomber négligemment dans un fauteuil que lui avançait son hôte.
– Bonsoir, cher, lui dit-il.
– Bonsoir, mon ex-président, répondit le petit baron.
– Mais ! dit le major, est-ce que tu as pu croire, un seul instant, que l’association était dissoute ?
– Dame !
– Tu es fou ! L’association existe.
– Ah !
– Seulement…
– Oh ! fit le petit baron, je savais bien qu’il y avait une restriction.
– La voici : l’association existe toujours, seulement elle n’a plus que deux membres, toi et moi.
– C’est différent.
– Tu es le bras qui agit, je suis la tête qui conseille.
– Bon ! mais où est la besogne ?
Le major regarda fixement son hôte :
– Tu as vingt-neuf ans, dit-il, tu es bien tourné, assez joli garçon, et on peut faire quelque chose de toi.
– Vous croyez ?
– Le titre de baron est devenu vulgaire, mon bon ami.
– Merci !
– Il y a des barons par centaines.
– Est-ce que vous me voulez faire marquis ?
– Non, duc.
Le petit baron se leva vivement.
– Vous rêvez ! dit-il.
– Il y a mieux, poursuivit flegmatiquement le baron, je te veux faire épouser une jolie fille.
– Ah !
– Laquelle t’apportera cent mille livres de rentes.
Et le major murmura à part lui :
– Il m’en faut deux cents pour moi ; je veux la part du lion !
Le petit baron regarda fixement le major Samuel :
– Pardon, dit-il, mais je ne comprends tout à fait les choses que lorsqu’elles me sont expliquées.
Le major sourit :
– Tu t’appelles, dit-il, le baron de Vaufreland ?
– Oui.
– Du moins, c’est le nom que tu t’es donné…
Le baron fit la grimace.
– Par conséquent, poursuivit le major avec un flegme imperturbable, peu t’importe d’en changer ?
– C’est selon les avantages que m’offrira cette substitution.
– D’abord une jolie fille.
– Comment est-elle ?
– Blonde.
– Les yeux bleus ou noirs ?
– Bleus.
– Grande ?
– Non.
– Ah ! tant mieux !
– Pourquoi ?
– Mais, parce qu’une femme grande n’est pas une femme.
– Bah ! qu’est-ce donc !
– Un camarade, répondit le baron.
Le major se mit à rire.
– Après ? fit son hôte.
– Le second avantage est une belle fortune.
– Ceci est plus sérieux. Passons…
– Enfin, tu seras duc.
– Authentique ?
– Mais… sans doute…
– Et je m’appellerai ?
– Le duc Raymond de…
– Voyons ! achevez…
– Oh ! dit froidement le major, c’est inutile pour le moment ; tu t’appelleras RAYMOND, voilà tout !
– Voilà, dit le petit baron, un singulier nom pour un duc.
Le major haussa les épaules.
– Écoute donc, fit-il, et souviens-toi bien de mes paroles.
– Voyons ?
– À partir d’aujourd’hui, tu t’appelles donc Raymond.
– Soit.
– Tes souvenirs d’enfance les plus lointains te reportent dans un vieux château de Bretagne, où tu vivais avec une femme encore jeune et belle, ta mère.
– Est-elle morte ?
– Non. Tu verras plus tard. À dix ans, on t’a séparé d’elle et on t’a placé dans un pensionnat.
– Très bien.
– Tu es devenu homme et on t’a fait tenir mystérieusement tous les ans une pension de cinquante mille francs.
– Et puis ?
– Et puis, c’est tout.
– Comment donc ?
– C’est tout ce que tu dois savoir pour le moment.
– Mon cher major, dit alors le baron de Vaufreland, il faudrait vous expliquer plus clairement.
– C’est inutile.
– Pourquoi ?
Le major prit une attitude hautaine :
– Ah çà ! mon cher, dit-il, si ce que je vous propose ne vous convient pas, vous ferez bien de le dire tout de suite. Je vous répète qu’il est inutile que vous sachiez autre chose pour le moment. Est-ce clair ?
Le petit baron courba la tête et balbutia :
– Je ferai ce que vous voudrez, monsieur.
– À la bonne heure ! dit le major.
Puis, regardant fixement le jeune homme :
– Mon cher Raymond, dit-il, j’aurai l’honneur de vous présenter à votre mère.
– Quand ?
– Ce soir peut-être. Je dis ce soir, car voilà le jour, ce me semble.
Et le major indiquait du doigt les persiennes, au travers desquelles glissait le premier rayon de l’aube.
– Mais, mon cher major, dit le baron, un mot encore.
– Parlez…
–Ma mère me reconnaîtra-t-elle ?
Le major sourit.
– D’abord, dit-il, vous n’aviez que dix ans quand vous l’avez quittée. La voix d’un enfant et la voix d’un homme ne se ressemblent plus.
– Oui, mais les traits de l’homme gardent souvent une grande ressemblance avec ceux de l’enfant.
– Votre mère est aveugle, dit froidement le major.
– Ah ! c’est différent.
Et le baron alluma un nouveau cigare.
Le major prit son chapeau et sa canne.
– Je vous engage à vous coucher, mon cher enfant, dit-il, et à dormir de votre mieux jusqu’à midi, tandis que je m’occuperai de justifier pour vous le proverbe : Le bien vient à ceux qui dorment.
– Quand vous reverrai-je ?
– Je déjeunerai chez Verdier entre midi et une heure. Venez m’y rejoindre.
– J’y serai. Au revoir, major.
Le major Samuel s’en alla, et lorsqu’il fut dans l’escalier, il se fit cette réflexion à mi-voix :
– Le vrai Raymond est un niais, un vrai niais, car le petit baron a le même son de voix que lui, et il est assez joli garçon pour tourner la tête à sa prétendue cousine.
Quand il fut dans la rue, le major consulta sa montre.
– Il est cinq heures et demie, se dit-il, trop tard pour que je me couche, trop tôt pour que j’aille voir Jeanne l’aveugle. Je vais prendre un bain russe, et puis j’irai faire ma toilette.
Et le mystérieux personnage gagna à pied le boulevard et la rue Vivienne, ajoutant à mi-voix :
– Cette pauvre Jeanne sera bien surprise et bien émue quand je lui raconterai l’histoire des masques noirs.
Trois heures après environ, c’est-à-dire un peu avant neuf heures, une voiture descendait au grand trot de son cheval de louage l’avenue de Neuilly et s’arrêtait, un peu avant le pont, à la grille d’une petite maison bâtie entre cour et jardin.
Au bruit de la sonnette que le cocher fit vibrer avec le manche de son fouet, une fenêtre du rez-de-chaussée s’ouvrit et encadra le visage rougeaud d’une servante encapuchonnée dans une coiffe bretonne.
Cette femme, qui pouvait bien avoir quarante ans, se prit à considérer avec un étonnement profond et la voiture et le personnage qui en descendait.
Ce personnage, on l’a deviné peut-être, n’était autre que le major Samuel.
Le major renvoya sa voiture et pénétra dans la cour de la maison, dont la servante vint ouvrir la grille, en disant :
– Que désire monsieur ?
– C’est bien ici que demeure une dame aveugle, madame Blanchet ?
– Oui, monsieur.
– C’est à elle que je désire parler.
– Mais, monsieur, dit la servante qui semblait hésiter, madame ne reçoit jamais de visites.
– Elle recevra la mienne quand elle saura pourquoi je viens.
– Monsieur veut-il me dire son nom ?
– C’est inutile. Dites simplement à votre maîtresse que c’est un monsieur qui était au bal masqué de l’hôtel de ville de Bordeaux.
Ces paroles n’avaient pour la servante aucune signification. Aussi regarda-t-elle le visiteur avec une curiosité croissante. Mais il eut un geste tellement impérieux qu’elle n’osa lui désobéir, et elle l’introduisit dans un petit vestibule en lui disant :
– Veuillez m’attendre un moment.
Elle poussa une porte au fond du vestibule et disparut.
Quelques minutes s’écoulèrent, puis la servante revint.
– Monsieur, dit-elle avec une certaine émotion, qui sans doute était le reflet de celle que venait d’éprouver sa maîtresse, madame est souffrante, et elle vous demande la permission de vous recevoir sans cérémonie.
La maison était d’une simplicité extrême. On y respirait une aisance médiocre, et, bien certainement, celle qui l’habitait était loin d’être riche.
Le major fut introduit dans un petit salon au rez-de-chaussée, dont l’ameublement n’offrait rien de remarquable, à l’exception, toutefois, d’un grand portrait d’homme placé au-dessus du canapé et dont la peinture vigoureuse attirait tout d’abord l’attention.
C’était une œuvre de maître, à coup sûr, représentant un homme encore jeune, revêtu d’un brillant uniforme de hussards.
Si le portrait était ressemblant, l’homme dont il rappelait les traits avait dû être bien certainement un des plus nobles et des plus beaux types rêvés par l’art.
Nez fièrement busqué, lèvre autrichienne, teint blanc et mat, grands yeux bleus, moustaches blondes, taille svelte et haute, – c’était un portrait en pied ; – rien n’y manquait, pas même un calme et fier sourire qui arrondissait les coins de la bouche.
Le major, en franchissant le seuil du salon, regarda tout d’abord ce portrait et murmura :
– Oh ! la chaude peinture ! Oh ! le fringant cavalier !
Mais, presque au même instant, une porte s’ouvrit dans le fond du petit salon et le major entendit des pas légers.
Il se retourna. Une femme venait d’entrer à pas lents, les mains étendues devant elle.
Cette femme touchait-elle aux limites de la jeunesse ? avait-elle déjà franchi l’âge mûr ?
C’était là un problème des plus difficiles à résoudre.
À voir son front blanc, ses beaux cheveux noirs roulés et relevés sur ses tempes, ses lèvres rouges sur lesquelles glissait un sourire un peu triste, on eût pu croire qu’elle touchait à peine à la trentième année.
Mais quelques rides au bas du visage, quelques plis aux tempes, et puis, un je ne sais quoi plein de lassitude dans sa démarche et toute sa personne donnaient à cette présomption un formel démenti.