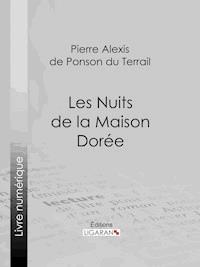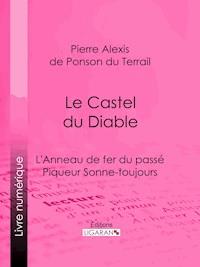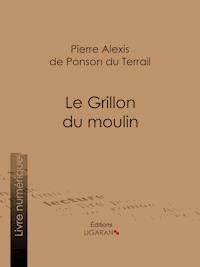
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait: "Ce Grillon était une jeune fille. Et cette jeune fille trottinait, les pieds dans la rosée, un peu avant le lever du soleil, dans le sentier qui traverse les prés et va du moulin au village. Jamais peut-être on ne verra plus joli sentier, et prés plus verts, et moulin plus babillard, et village plus rustique, et jeune fille plus fraîche, plus pimpante, plus adorablement jolie que le Grillon."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À Monsieur Edmond Pointel
Directeur du Monde Illustre
Mon cher Directeur,
Je ne sais pas si j’ai fait un bon livre, mais j’ai la conviction d’avoir écrit une histoire honnête et simple, et je crois lui porter bonheur en vous la dédiant.
Votre dévoué,
PONSON DU TERRAIL
Mai 1868
Ce Grillon était une jeune fille.
Et cette jeune fille trottinait, les pieds dans la rosée, un peu avant le lever du soleil, dans le sentier qui traverse les prés et va du moulin au village.
Jamais peut-être on ne verra plus joli sentier, et prés plus verts, et moulin plus babillard, et village plus rustique, et jeune fille plus fraîche, plus pimpante, plus adorablement jolie que le Grillon.
Le moulin était dans le pli d’un vallon, à un quart de lieue de la Loire, tout auprès du village qu’on appelle Férolles-les-Prés.
Et on a bien raison de lui donner ce nom, car vous chercheriez en vain du regard un labourage ou un vignoble. Il est entouré d’une ceinture de prairies vertes que bordent de grands peupliers mélancoliques.
Le moulin est tout au fond, derrière le clocher, au pied du premier coteau qui ferme le val. Le cours d’eau qui le fait tourner n’a pas de nom sur les cartes, même sur la carte du département. C’est un ruisseau tapageur qui sort des sables de Sologne, dont l’eau a légèrement le goût de la poix résine, mais qui est néanmoins claire, limpide, et étincelle comme du cristal quand un rayon de soleil parvient à se glisser au travers des saules qui croissent sur ses deux berges.
Le moulin a un nom : on l’appelle Brin-d’Amour. – Pourquoi ? – Le magister, qui croit être savant, et le curé, qui l’est un peu, ne vous le diraient pas plus que moi. Les anciens du pays sont aussi ignorants que le magister. Le moulin s’appelle Brin-d’Amour, parce qu’il n’a pas d’autre nom.
Or, en ce temps-là, mettez que c’était il y a huit ou neuf ans, car cette histoire est toute fraîche, la meunière de Brin-d’Amour était une fort belle femme qui n’avait pas tout à fait quarante ans, et aurait bien pu n’en avouer que trente si on ne lui avait pas connu de par le monde un grand fils qui avait déjà tiré à la conscription il y avait beau jour.
Mame Suzon, comme on l’appelait, s’était mariée à quinze ans et elle avait été veuve à dix-neuf. Jamais elle ne s’était remariée.
Et, certes, les amoureux et les prétendants n’avaient pas manqué pourtant, et si on les eût mis à la file les uns des autres, ils auraient fait une jolie procession qui aurait pu aller de Férolles à Châteauneuf en se donnant la main.
D’abord mame Suzon était plus jolie, plus fraîche encore, plus blanche que les plus belles dames de la ville.
Elle avait des yeux bleus qui paraissaient bruns, des cheveux d’un noir de jais, un petit nez retroussé plein de malice et de bonté à la fois, des dents bien blanches et bien rangées, et lorsqu’elle riait, ce qui lui arrivait souvent, on aurait dit que le bon Dieu ouvrait un coin de son paradis et que les anges y jouaient à cache-cache.
Elle avait bien la taille un peu épaisse, mais où est le mal ? Les tailles de guêpe ne se trouvent pas aux champs et ne font pas toujours le bonheur des villes.
Et puis, mame Suzon était quasiment une dame sous le rapport de la fortune.
Il y avait quarante arpents de bonnes terres qui ne devaient pas un liard aux hypothèques tout à l’entour du moulin, et le moulin était le premier, comme il était le plus joli de la contrée.
Au bord de la Loire, quand vous demandez à voir un moulin, on vous montre une poivrière en bois qui tourne sur un pivot et que le vent fait marcher. Quand il ne vente pas, il n’y a pas de farine, et sans farine comment faire du pain ?
Ce diable de fleuve qu’on nomme la Loire, il ne donne de l’eau que lorsqu’il déborde : ou il vous laisse mourir de soif, ou il vous noie.
Brin-d’Amour était donc une exception.
Brin-d’Amour était un moulin à eau que le petit ruisseau faisait tourner en tout temps ; un moulin modèle, qui faisait tic-tac nuit et jour, et broyait plus de grain à lui tout seul que toutes les vilaines baraques perchées sur des fourmilières, et qui ne parviennent pas à égayer le triste paysage qu’elles dominent.
Comment, avec une pareille dot, mame Suzon ne se serait-elle pas remariée, haut la main, si elle en eût eu fantaisie ?
On disait même qu’un noble ruiné l’avait demandée.
Mais on dit tant de choses !
Ce qu’il y avait de certain, c’est que mame Suzon était restée veuve, concentrant toutes ses affections sur son fils Laurent et sur sa nièce Noémi.
Noémi avait quatorze ans lorsque Laurent tira au sort.
Laurent était un beau garçon, leste, bien découplé, travailleur et bon enfant.
Il avait les petits pieds, les petites mains, l’œil bleu et les cheveux noirs de sa mère.
Avec un brin de toilette, le dimanche, il était si faraud qu’il eût pu jouer le rôle de coq du village.
Noémi était une petite blonde piquante, alerte, rieuse comme sa tante, si mignonne qu’on eût dit une fée des bois, et en élevant l’orpheline, mame Suzon souriait et se disait :
– Quelle jolie bru j’aurai là quelque jour !
Mais, hélas ! mère propose et fils dispose.
Un soir du mois de mars de l’année 185. ., Laurent arriva au moulin avec une gerbe de rubans multicolores à son chapeau.
C’était le soir du tirage au sort.
Mame Suzon se mit à rire, et Noémi, l’espiègle petite fille rit plus fort encore, car toutes deux s’imaginèrent que Laurent leur faisait une farce.
En effet, le matin même, il avait amené un bon numéro.
Pourquoi donc jouait-il au conscrit ?
Mais après avoir ri, les deux femmes se mirent tout à coup à pleurer.
Laurent était réellement conscrit ; il voulait partir à la place d’un autre.
Cet autre était son frère de lait, un assez mauvais garnement dont les parents ne valaient pas cher.
Mais la mère de ce dernier avait nourri Laurent ; Laurent aimait son frère de lait, et quand il avait vu le jeune homme tomber au sort, il avait consenti à partir à sa place.
Le mal n’était pourtant pas sans remède, attendu qu’il y avait de beaux écus au moulin, et que mame Suzon ne se ruinerait pas à remplacer son étourdi de fils.
Mais Laurent voulait partir.
Il sauta au cou de sa mère, qu’il prit à part, et lui dit :
– Laisse-moi aller. D’abord, je verrai du pays… Si je m’ennuie loin de toi, je vous l’écrirai, tu me remplaceras. Ensuite, vois-tu, je suis amoureux fou de Noémi, et elle n’a que quatorze ans, et avant deux ans il ne faut pas y penser.
Et, malgré tout, Laurent partit.
Et il y avait déjà deux ans qu’il était sous les drapeaux, ce qui fait que Noémi avait seize ans le jour où commence notre récit.
Et maintenant que vous savez le nom du moulin, celui de la meunière, et l’histoire de son fils, suivons, si vous le voulez bien, le Grillon, c’est-à-dire Noémi, qui s’en allait d’un pas léger à Férolles-les-Prés, un matin de septembre, comme sonnait l’Angelus, et peu soucieuse de mouiller ses petits pieds dans la luzerne qui avait envahi le sentier.
Mais d’abord, pourquoi l’appelait-on le Grillon ?
Elle avait environ cinq ans lorsque sa mère mourut.
Sa mère était la sœur de mame Suzon.
La pauvre femme était morte de chagrin, car elle avait épousé un mauvais sujet qui, après avoir tout mangé, était allé se noyer dans la Loire.
Donc, mame Suzon avait recueilli l’enfant et lui avait servi de mère.
La petite Noémi était alors toute malingre, toute chétive, noire comme un pruneau en dépit de ses cheveux blonds, et, quand elle fut installée au moulin, elle choisit pour sa place favorite le coin de la cheminée.
Tout le jour, et bien avant dans la soirée, elle était là, se roulant dans les cendres et écoutant chanter la marmite ou le chaudron sur le feu de bourrées et de javelles, et chantant pareillement des lambeaux de chansons, des fragments de cantiques, tout ce qu’elle entendait, et qu’elle retenait sans peine.
Quand elle prit sa nièce avec elle, mame Suzon était veuve aussi, et elle pleurait encore son homme. Les chansons naïves de la petite lui tombèrent sur le cœur comme un baume.
Pour la première fois peut-être, depuis bien longtemps, la veuve ne pleura plus chaque fois après souper.
Il y avait eu sécheresse, et pendant tout un long été le ruisseau tari n’avait pu faire tourner le moulin.
Du jour où la petite fut au moulin, on vit le ruisseau couler à flots.
Enfin, un vieil oncle du défunt meunier mourut et laissa un beau bien de près de vingt mille écus à son jeune neveu et à sa nièce par alliance.
Or il est une superstition populaire qui est commune à toute la France, c’est que cet insecte presque imperceptible qu’on nomme un grillon, qui s’établit dans les briques d’une cheminée derrière la plaque du foyer, qu’on voit rarement et qu’on entend chanter toujours, est une sorte de dieu lare, de génie familier et protecteur de la maison.
La chaumière qui possède un grillon est bénie de Dieu.
La petite Noémi ne quittait pas le coin du feu ; de plus, elle chantait toujours.
En outre, depuis qu’elle était au moulin, le moulin tournait, les pratiques arrivaient, et avec eux les beaux écus, et en plus de tout cela l’héritage de l’oncle.
Pour sûr, Noémi portait bonheur.
Vous comprenez maintenant pourquoi on l’avait appelée le Grillon.
Quand elle fut grande, cependant, elle quitta le coin du feu, renonça à son rôle de Cendrillon et s’en alla comme les autres, à l’école d’abord, puis aux champs.
Mais comme elle chantait toujours et que d’ailleurs le bonheur était toujours à la maison, le nom de Grillon lui resta.
Donc, le Grillon s’en allait à l’aube, par le sentier qui descendait du moulin au bourg.
Un bourg de soixante feux, dans lequel il n’y avait qu’un bourgeois qui était un ancien cuisinier de Paris, et qu’on appelait le père Franval, ni gendarmerie, ni pompiers, ni aucun corps constitué, et qui n’avait jamais fait parler de lui d’aucune manière.
Le maire habitait un château à deux lieues de là.
L’autorité n’était donc représentée à Férolles que par l’adjoint, un bon paysan, le curé, un brave prêtre qui observait, en donnant tout aux pauvres, le vœu de pauvreté qu’il avait fait, et le maître d’école, qui était un vieux brave homme plus versé dans l’arpentage que dans la grammaire, et qui donnait vacance à ses écoliers chaque fois qu’il était en retard pour engranger sa récolte.
Du reste, l’adjoint, le curé et le maître d’école étaient unis comme les doigts de la main, se réunissaient l’hiver au presbytère et jouaient à la bête ombrée, un jeu inoffensif qui a quelque succès aux bords de la Loire.
Les élections n’avaient jamais divisé personne à Férolles-les-Prés. Le conseil municipal ignorait les orages, et quand le feu prenait quelque part tout le monde y courait.
Enfin, la femme de l’instituteur apprenait à lire aux petites filles, et jamais on n’avait eu de dissensions relatives à l’enseignement.
On dit même, mais nous n’oserions l’affirmer, que le préfet passant par là, avait donné à Férolles le nom de Commune-Modèle.
Le facteur qui venait de Jargeau ne passait que tous les deux jours ; et encore passait-il de grand matin, ayant rarement une lettre à distribuer, et plus rarement encore une autre lettre à prendre dans la boîte vermoulue qui se trouvait auprès de l’église, tout à côté du maréchal.
En revanche, il portait une demi-douzaine de journaux politiques pour M. le maire, et de journaux de mode pour Mme la mairesse, lesquels étaient dans leur château, à deux lieues de Férolles, au haut du coteau qui ferme le Val, et par conséquent en Sologne.
Or, au château, le comte de S… – car le maire était comte, et son château était un vrai château, ce qui est rare dans le pays environnant – au château, disons-nous, une bouchée de pain, un morceau de fromage et un bon verre de vin attendaient ce modeste fonctionnaire auquel les paysans ont naïvement donné le nom de postillon. Ce qui faisait qu’il s’arrêtait à peine à Férolles, et y passait habituellement le matin, tant le verre de vin lui allongeait le cœur et les jambes.
Quand je vous aurai dit que, dans la poche de son tablier, le Grillon avait une lettre, vous comprendrez pourquoi elle marchait si lestement avant le lever du soleil. Elle voulait arriver à Férolles avant le facteur. Cette lettre portait cette suscription :
À monsieur Laurent Tiercelin,
caporal au 4e bataillon de chasseurs à pied,
à Lyon.
Donc le Grillon arriva à Férolles.
Les quelques maisons qui bordent l’unique rue commençaient à s’ouvrir.
Les hommes outillaient leurs charrues et garnissaient leurs chevaux ; les femmes peignaient et décrassaient leurs marmots ; le maître d’école battait un brin d’avoine dans sa grange, en attendant l’heure de la classe, et le bon curé sortait de son presbytère pour entrer à l’église et dire sa messe.
– Bonjour, Noémi, dirent les uns en la saluant.
– Bonjour, mamzelle, dirent les autres en souriant.
– Bonjour, Grillonnet, fit le maréchal qui allumait le feu de sa forge.
Le Grillon rendit saluts et sourires, entra dans la forge et dit à Mathurin Baudry, – c’était le nom du maréchal, – en le regardant de son petit air malin :
– On a beau se lever matin, on arrive toujours pour se chauffer chez vous.
– C’est à toi qu’il faut dire ça, ma petite, répondit le forgeron. Pourquoi te lèves-tu de si bonne heure ?
– J’apporte une lettre pour le facteur. C’est bien son jour, n’est-ce pas ?
– Oui, les mardis, jeudis et vendredis. Tiens, justement, le voici, ma mignonne, là-bas, au bout du grand chemin, auprès de la grange au père Siffet.
– Eh bien, dit la jeune fille, je vais à sa rencontre. Qui sait ! il a peut-être aussi des lettres pour nous.
– C’est une lettre pour Laurent, ça, n’est-ce pas ?
– Oui-da, et une longue encore… et quand il l’aura lue…
– Eh bien ? fit le maréchal en clignant de l’œil.
– Eh bien, je crois qu’il se laissera remplacer et qu’il nous reviendra.
– Petite coquine, dit le forgeron, tu veux donc devenir Mme Laurent au plus vite ?
Elle rougit et baissa sa jolie tête.
Le forgeron ajouta :
– Du reste, vous avez raison, ta tante et toi. On dit que nous allons avoir la guerre…
– La guerre ! dit la jeune fille avec effroi.
– Je connais ça, moi qui ai été soldat… un malheur est vite arrivé… et quand on a du bien et un joli moulin au soleil, ma mignonne, c’est pas la peine de se rafraîchir la tête d’une prune sans eau-de-vie.
Le Grillon joignit les mains :
– La guerre ! dit-elle, la guerre ! mais vous me faites une peur affreuse, Mathurin !
Le facteur, apercevant la jeune fille, avait doublé le pas, de telle façon que le Grillon, tout ému du reste des paroles du forgeron, n’eut pas besoin d’aller à sa rencontre.
– Eh ! mamzelle Noémi, j’ai une lettre pour vous.
– Pour moi ou pour ma tante ?
– Pour vous.
Et le facteur tendit la lettre.
– Ah ! dit le Grillon en s’en emparant, c’est une lettre de Laurent. Quelque chose me disait en chemin qu’elle arriverait aujourd’hui.
– Ça va m’épargner une jolie trotte, fit le facteur.
Le Grillon décacheta la lettre avec une fiévreuse impatience ; mais, dès les premières lignes, elle pâlit, ses yeux s’emplirent de larmes, et elle se laissa tomber presque sans connaissance dans les bras du forgeron et du facteur abasourdi.
Avant de dire ce que contenait cette lettre qui venait de produire une si vive émotion sur le Grillon, disons ce que renfermait celle que la jeune fille portait à la poste.
Elle était de mame Suzon à son fils.
La meunière écrivait :
Mon cher enfant,
Voici deux années que tu es parti.
Tout le monde me dit que je suis toujours jeune ; mais moi je sens bien que j’ai vieilli de dix ans depuis ton départ.
Il faut donc que tu reviennes.
D’abord j’ai besoin de toi. À la vente du pauvre père Bictaud, qui est mort cet hiver, j’ai acheté la petite ferme des Genetières. C’est trente arpents de plus à cultiver. Ensuite le moulin n’a jamais tant tourné, et nous ne pouvons plus suffire.
J’aurais comme une idée d’en construire un second, un peu plus haut.
Il y a bien de l’eau pour deux moulins dans le ruisseau.
Tu t’établirais et tu prendrais celui-là.
Voici que Grillonnet a seize ans ; elle s’est faite belle fille et forte. Vous pouvez vous marier, mes enfants, M. le curé et M. le maire vous donneront la permission.
Par conséquent, reviens, mon bon petit homme, les yeux me tombent de te voir.
Je suis allée hier à Orléans et j’ai porté deux beaux sacs de mille francs à l’intendance pour ton remplacement.
En outre, dans cette lettre, je t’envoie cent francs pour ton voyage.
Mais si tu avais des dettes, et si ça ne suffisait pas, écris-nous poste pour poste, on te renverra ce que tu demanderas.
Hier, on disait que nous allions avoir la guerre. Ça me fait peur et j’en ai froid dans tout le corps. Vilain enfant que tu es ! Avais-tu donc besoin de te faire soldat, et surtout de partir à la place de ce garnement de Michel qui est bien le plus mauvais sujet de tout le pays !
Ah ! si je n’avais pas été si malade quand tu es né, ce n’est pas ces gens-là qui t’auraient nourri.
Il faut que tu sois bon comme le bon pain, mon enfant, pour n’avoir pas sucé de la méchantise avec un pareil lait.
Il n’y a pas dans tout le pays des brigands pareils à ces Brûlart ; le fils ne vaut pas mieux que le père. C’est misérable, mais ça n’a que ce que ça mérite ; ça vit de rapine et de braconnage, et ils m’en ont tant fait, tant fait, que je leur ai fermé la porte du moulin.
Faut même que je te donne une nouvelle qui te saignera un peu le cœur, car tu es bon, mon pauvre enfant. Ta nourrice, la mère Brûlart, est morte cet hiver. Nous n’avons pas voulu te l’écrire ; mais puisque tu vas revenir, autant vaut que tu le saches tout de suite.
Elle est morte après avoir traîné deux mois, elle s’est confessée, ce qui a étonné tout le monde, car jamais elle n’allait à l’église et jurait comme une païenne. Je ne sais pas ce qu’elle a dit au curé, mais il est sorti de chez eux tout bouleversé, et même quand il m’a vue le lendemain à l’enterrement, il n’était pas encore remis.
On dit même qu’il a écrit une lettre sous sa dictée, et que cette lettre qui est adressée on ne sait à qui, a été déposée chez un notaire de Jargeau.
Quand la mère Brûlart a été morte, le père et le fils ont recommencé leur vie de vagabondage et de vol. Ça ne m’étonnerait pas qu’au premier jour ils fussent mis en prison ; et c’est un bien mauvais service que tu as rendu à Michel de le remplacer. Le régiment l’aurait peut-être rendu meilleur et remis dans le bon chemin.
Enfin, mon enfant, reviens, reviens vite ; Grillonnet n’ose trop rien dire, mais quand on parle de toi, sa petite poitrine se soulève, et en place de chanter, elle soupire, que ça m’en rend le cœur gros.
Nous vous marierons tout de suite, et crois bien, quoiqu’on dise que je suis toujours jolie, que je n’ai pas peur de devenir grand-mère.
Je t’embrasse mille fois et Noémi aussi.
Ta mère qui t’adore,
SUZANNE TIERCELIN.
Cette lettre avait été écrite la veille au soir, entre la tante et la nièce, la tante souriant, la nièce soupirant de plus belle. Aussi, le lendemain matin, personne n’était encore levé au moulin que le Grillon était en route pour Férolles-les-Prés.
Voyons maintenant ce que contenait cette lettre apportée par le facteur et qui avait si vivement impressionné la jeune fille.
Elle était de Laurent.
Mais elle n’était pas timbrée de Lyon et portait, au contraire, la date de Chambéry.
Elle était adressée à Noémi et ainsi conçue :
Comme tu es une brave et courageuse petite femme, mon cher Grillon adoré, c’est à toi que j’écris de préférence à ma mère, qui ne manquera pas de pleurer quand tu lui diras la nouvelle.
Nous sommes partis de Lyon à marche forcée, voici trois jours, et nous ne nous sommes arrêtés qu’ici, où, dit-on, nous nous reposerons une nuit.
Comme je pensais à toi, à notre bonne mère, et que j’allais me décider à revenir au pays et à me laisser remplacer, voici que le bruit que nous avons la guerre se répand dans le bataillon ; on nous consigne à la caserne, et, quelques heures après, on nous dit que nous allons en Italie.
Pense donc ce qu’auraient dit les camarades si j’avais parlé de me faire remplacer.
On n’aurait pas manqué de prétendre que j’avais peur, et il n’y fallait pas songer.
Mais on dit que la guerre ne sera pas longue, que c’est l’affaire de deux ou trois batailles, et que dans six mois nous serons de retour.
Tu penses bien qu’alors, les camarades dont j’aurai partagé les dangers, les privations et les fatigues, ne pourront plus dire que je suis un poltron, lorsque je leur annoncerai que je retourne au pays pour faire ma petite femme de mon cher Grillonnet que j’aime de tout mon cœur.
Console bien notre mère, dis-lui combien je vous aime toutes deux, et puis n’allez pas vous imaginer qu’il peut m’arriver malheur.
J’ai toujours au cou les deux médailles que vous m’avez données quand je suis parti, et j’ai idée qu’elles me protégeront. Je t’écris sur mon genou. Nous sommes campés hors la ville, et nous sommes si las que la terre sur laquelle nous couchons me rappelle nos bons matelas de plume d’oie du pays.
Adieu, mon cher Grillonnet, au revoir plutôt, car je reviendrai, et bien vite, je te le promets. Tâche que notre mère ne pleure pas trop, et aime bien celui qui se dit pour la vie,
Ton petit mari.
LAURENT.
P.S. Écrivez-moi : À M. Laurent Tiercelin, caporal au 4e chasseurs à pied. Faire suivre en Europe. Si d’ici là j’ai attrapé les galons de sergent, elle m’arrivera tout de même.
C’est de votre lettre que je parle.
– Pauvre mamzelle ! murmura le facteur en regardant Noémi qui fondait en larmes.
– Qu’est-ce qui arrive donc ? demanda le forgeron qui fit sa grosse voix pour ne pas paraître ému.
Le Grillon lui tendit la lettre et continua à pleurer.
– Bah ! dit l’ancien soldat, c’est pas une affaire après tout. J’en ai vu bien d’autres, moi, est-ce que je ne suis pas revenu ?
Et comme il disait cela, un nouveau personnage entra dans la forge et dit :
– Qu’est-ce qu’elle a donc à pleurer comme ça le Grillon ?
Ce nouveau personnage n’était autre que Michel Brûlart, le frère de lait de Laurent, celui-là même dont la meunière avait tracé un si triste portrait dans la lettre qu’elle écrivait à son fils.
Qu’on nous permette une rapide silhouette de Michel, le frère de lait de Laurent, qui venait d’entrer dans la forge de Mathurin Baudry.
Michel était du même âge que Laurent, puisqu’il était son frère de lait, et il était par conséquent sur ses vingt-quatre ans.
C’était un grand garçon maigre et sec, aux cheveux jaunes, à l’œil gris, à la figure longue éclairée par de petits yeux gris sans chaleur, aux lèvres minces recouvrant de vilaines dents longues et déchaussées.
Son père et lui jouissaient d’une assez mauvaise réputation dans la contrée environnante, et les gens de Férolles s’applaudissaient de ce qu’ils n’étaient pas sur la commune, leur chaumière s’élevant à bord de bois, sur le territoire de Souvigny.
Cultivateurs, ils ne cultivaient rien du tout, pas même les deux arpents de mauvaise terre qu’ils possédaient à l’entour de leur maison.
Les fermiers du voisinage les employaient quand ils ne pouvaient faire mieux, au temps de la moisson.
Les marchands de bois d’Orléans qui achetaient une coupe leur donnaient des bourrées à l’entreprise.
Ce dernier travail leur plaisait plus que tout autre, et la raison en était bien simple.
Tout en cordant du bois, le père et le fils étaient aux écoutes.
Si une meute chassait un lièvre, ils prenaient lestement leur fusil caché sous un fagot, couraient attendre la bête au passage, la tuaient et l’emportaient bien avant l’arrivée des chiens et du chasseur.
Le poulailler de Châteauneuf leur payait le lièvre trois francs, et leur journée était bonne.
En hiver, ils tendaient des pièges à bécasses.
En été, ils prenaient de jeunes perdreaux au filet.
En toute saison, le bien d’autrui leur payait une dîme.
Arbres à fruits, graines, fourrages, pommes de terre, tout leur était bon.
Mais on les craignait, parce qu’on les savait capables de tout.
Le voyant entrer chez lui, le maréchal le regarda de travers.
– Qu’est-ce que tu veux ? lui dit-il.
– Du feu pour allumer ma pipe, répondit le garnement.
Et il tira de sa poche un brûle-gueule tout bourré et se dirigea vers le fourneau, en disant :
– Qu’est-ce qu’elle a donc, le Grillon ?
Noémi pleurait à chaudes larmes et n’avait pas même fait attention à lui.
– Ce qu’elle a ? fit le forgeron d’un ton bourru, tu ne devrais pas le demander… car si elle pleure, c’est toi qui en es cause.
– Oh ! c’te farce !
– À preuve, c’est que Laurent est parti à ta place…
– Ça, c’est vrai.
– Et que s’il lui arrive malheur…
À ces paroles, les larmes de Noémi redoublèrent, et elle leva les yeux sur le frère de lait de Laurent.
Noémi n’aimait certes pas Michel ; elle avait même toujours éprouvé pour lui une aversion instinctive.
Néanmoins, en ce moment, elle obéit à un sentiment qui est assez fréquent et qui pousse les gens affligés à rechercher des gens qui partagent leur douleur.
Elle prit la lettre de Laurent et la tendit à Michel.
Michel savait un peu lire, à la condition de lire à mi-voix et même parfois d’épeler un mot.
– Eh bien, mamzelle, dit le facteur, me donnez-vous votre lettre ?
– Non… c’est inutile, maintenant… répondit Noémi qui se mit à pleurer de plus belle.
Le facteur partit et les deux jeunes gens restèrent seuls avec le forgeron.
Michel s’était mis à lire la lettre de Laurent à mi-voix. Eut-il une émotion réelle, ou bien sut-il jouer habilement la comédie ? C’est ce qu’il eût été difficile de préciser. Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’à mesure qu’il lisait, sa voix devenait sourde et que, lorsqu’il eut fini, le forgeron lui vit de grosses larmes dans les yeux.
– Eh bien, ma foi, dit-il, tu es meilleur que je ne croyais.
Et il lui tendit la main.
– Ah ! il t’aimait bien, va, Michel, dit le Grillon, que les larmes feintes ou vraies du garnement touchaient pareillement.
Et comme le forgeron, elle lui tendit la main.
– Si j’avais su cela, dit Michel, jamais je n’aurais voulu qu’il partît à ma place.
– Puisque tu n’es pas aussi mauvais qu’on le dit, fit Mathurin Baudry, tu ne vas pas laisser cette jeunesse s’en retourner seule au moulin, n’est-ce pas ? Vois comme elle est pâle et toute tremblante.
– Grillonnet, dit Michel toujours ému, venez avec moi, je vas vous reconduire… Pauvre Laurent… Oh ! j’ai envie de partir à mon tour…
Et il prit le Grillon par la main et lui dit :
– Venez avec moi… nous ne serons pas trop de deux pour donner cette mauvaise nouvelle à maman Suzon.
Le Grillon avait si grand besoin d’épancher sa douleur, qu’elle accepta ce qu’elle eût refusé en toute autre circonstance. Elle consentit à s’appuyer sur le bras de Michel.
On la vit retraverser l’unique rue du village, non plus rieuse et légère, mais pleurant comme une Madeleine, et sa douleur parut si vive que personne n’osa la questionner.
Seulement, quand elle fut passée, quelques voisins coururent à la forge et trouvèrent Mathurin Baudry tout soucieux ; il raconta de quoi il retournait, et on l’écouta en hochant la tête.
Bien qu’elle fût riche, mame Suzon était aimée de tout le monde.
– Pauvre femme, disait-on, pourvu qu’il ne lui arrive pas malheur !
– Moi, disait le forgeron, je ne sais pas pourquoi, mais j’ai de mauvaises idées.
Et tandis que les commentaires allaient leur train à Férolles, Noémi retournait au moulin, soutenue par Michel qui jouait de mieux en mieux son rôle d’homme désolé.
À mesure qu’ils approchaient, les deux jeunes gens ralentissaient le pas.
À la douleur première de la jeune fille s’ajoutait maintenant une vague épouvante.
Comment annoncerait-elle à mame Suzon la terrible nouvelle ?
Quand tous deux furent dans le sentier qui traversait le jardin potager planté au midi du moulin, le Grillon s’arrêta :
– J’ai peur, dit-elle.
– Moi aussi, murmura Michel.
Et comme ils faisaient cette réflexion, ils virent un homme à cheval qui s’en venait du moulin, un sac de farine devant lui.
– Ah ! mon Dieu, dit Michel, c’est Nicolas Maurey, le charretier de Grangetaine ; pourvu qu’il n’ait pas rencontré le facteur tout à l’heure, et que celui-ci ne lui ait pas parlé de la chose.
– Eh bien ? fit le Grillon étonnée.
– Il est si bête, Nicolas, qu’il aura appris cela sans ménagement à mame Suzon.
Le Grillon se prit à frissonner et doubla le pas.
Michel Brûlart avait deviné la vérité.
Ce Nicolas Maurey était le type le plus pur du charretier abruti et bestial qui ne sait que deux choses, faire claquer son fouet et maltraiter ses chevaux.
Pas méchant, mais brutal et têtu, et entrant en fureur si on lui disait qu’il ne ménageait pas son attelage.
Trop souvent le charretier croit qu’un cheval lui appartient et qu’il a le droit de l’accabler de coups les plus violents si la pauvre bête n’a pas la force de sortir d’une ornière ou de monter une côte.
Nicolas Maurey était bien cet être à demi sauvage, moitié homme et moitié brute.
Il allait chercher du sable à une marnière qui était au-dessus du moulin et appartenait à mame Suzon.
Celle-ci avait cédé au fermier de Grangetaine l’exploitation de ladite marnière.
Pour s’y rendre, il fallait croiser d’abord le raccourci qui conduisait de Férolles au plateau de Sologne, sur lequel était situé le château du maire, et passer ensuite dans la cour même du moulin.
Les choses étaient donc arrivées à peu près comme l’avait prévu Michel.
Le facteur avait rejoint Nicolas qui pestait, jurait et sacrait après ses chevaux, bien qu’ils ne fussent pas chargés et ne fissent aucun effort impuissant.
Mais l’habitude est une seconde nature, et le charretier ne pouvait faire deux pas sans injurier les bêtes, le bon Dieu, le paradis et les saints.
– Eh ! lui cria le facteur, en passant, t’as pas l’air commode, aujourd’hui.
Nicolas remit son fouet sur son cou et regarda le facteur de son gros œil rond stupide.
– Qu’est-ce que ça vous fait ? dit-il.
– À moi, rien, dit le facteur, c’était une manière de te dire bonjour.
– Oh ! hue ! oh ! dia ! oh ! hue ! sacré nom ! hurla le charretier.
– Puis, il fit claquer son fouet quatre ou cinq fois, et s’étant ainsi calmé, il regarda le facteur une seconde fois et lui dit :
– Qu’est-ce qu’il y a donc de neuf à Jargeau ? On dit que l’avoine est à douze francs l’hectolitre.
– Je ne sais pas, dit le facteur ; mais si tu veux du nouveau, je vas t’en apprendre.
– C’est-y que le foin serait r’augmenté ? Oh ! dia ! oh ! hue ! sacré nom !
Et il y eut un nouveau claquement de fouet.
– Il y a que nous avons la guerre, dit le facteur.
– La guerre ! Oh ! c’te farce ! Avec ça que les chevaux ne sont déjà pas assez chers comme ça…
– Nous avons la guerre, répéta le facteur.
– C’est-y sur le Journal du Loiret ? Faut pas s’y fier, parce qu’il dit un tas de choses qui ne sont pas exactes, ajouta le charretier, à preuve que l’autre jour il a marqué la paille à quarante-neuf francs et qu’elle n’était qu’à quarante-sept. Mais tous ces gribouille-papier, acheva le charretier, ça ne sait seulement pas comment le blé pousse.
– Ce n’est pas sur le journal, dit le facteur.
– Alors, c’est que c’est peut-être vrai…
– C’est Laurent Tiercelin, le fils à mame Suzon, qui vient de l’écrire, à preuve qu’il part de Lyon, où il était en garnison.
– Oh ! hu ! oh ! dia ! répéta le charretier, qui était arrivé à la croisière du chemin. Pourvu que le foin ne l’augmente pas encore, ça m’est égal. Bonsoir, postillon !
Le facteur prit le sentier qui montait au plateau, et Nicolas Maurey continua à injurier ses bêtes et à faire claquer son fouet jusque dans la cour du moulin.
Mame Suzon était sur la porte.
– Eh ! Nicolas ? dit-elle.
Le rustre ôta son bon net de coton rayé blanc et bleu et dit :
– Qu’est-ce qu’il y a, bourgeoise ?
– Avez-vous encore beaucoup de sable dans la marnière ?
– Une trentaine de tombereaux.
– Tu diras à Jean Fessu, ton maître, que j’en reprendrai une dizaine, moi.
– Qu’est-ce que vous en voulez faire, bourgeoise ?
– C’est pour mettre ici.
Et la meunière montrait la cour du moulin qui était devenue inégale et défoncée, çà et là, pendant la mauvaise saison.
– Vous voulez faire toilette ? dit le rustre avec un gros rire.
Pourquoi donc pas ? dit mame Suzon. On peut être de noce au premier jour et danser un brin ici.
– Qui donc que vous voulez marier ?
– Peut-être bien ma nièce.
– Le Grillonnet ?
– Oui-da, mon garçon.
– Et avec qui ?
Mame Suzon se prit à sourire.
– Tu ne le devines donc pas, gros rustaud ?
– Est-ce qu’on peut savoir ?
– Et avec qui donc veux-tu que je marie ma nièce, si ça n’est pas avec mon fils ? dit mame Suzon.
– Ah ! oui ; parlons-en, dit le charretier ; voilà qu’il est parti pour l’armée de la guerre.
– Il est à l’armée, c’est vrai, dit mame Suzon, mais il va revenir.
– C’est pas ce que dit le facteur.
Mame Suzon tressaillit.
– Qu’est-ce qu’il dit donc le facteur ? fit-elle.
– Qu’on a la guerre, qu’on va se battre, et que Laurent est parti… à preuve qu’il l’a écrit… Oh ! hue ! oh ! dia ! Bonsoir, bourgeoise.
Et Nicolas fit claquer son fouet.
Mame Suzon, toute bouleversée, s’était assise sur le seuil de sa porte.
Elle avait des bourdonnements dans les oreilles et des titillements dans les yeux.
Que venait donc de lui dire cet homme ?
Qu’était-ce que cette lettre dont il parlait ?
À qui donc Laurent avait-il écrit ?
Il est de certaines émotions qui ne se traduisent ni par des cris, ni par des larmes, mais par une prostration complète.
Les deux garçons meuniers étaient à leur besogne ; les gens de la ferme étaient aux champs.
Une servante qui, à l’intérieur, vaquait aux soins du ménage, ne soupçonna même pas ce qui s’était passé.
Mame Suzon, affolée, stupide, les yeux fixés sur le chemin de Férolles, venait d’apercevoir le Grillon qui cheminait lentement en compagnie de Michel, le triste garnement, et son cœur de mère devina sur-le-champ la sinistre vérité.
Quand le Grillon et Michel arrivèrent, mame Suzon, affaissée sur le seuil, était comme morte.
Huit jours s’étaient écoulés.
La résignation aux maux sans remède est le propre des gens de la campagne.
Nature patiente et calme, douée d’une âpre énergie, le paysan, habitué à lutter contre les caprices de la température, l’ingratitude du sol, les inondations et les incendies ; le paysan, disons-nous, se soumet assez vite aux volontés d’en haut, si dures soient-elles.
Le rêve de bonheur de mame Suzon et celui de sa nièce Noémi se trouvaient maintenant indéfiniment ajournés et reculés.
Quand reviendrait Laurent ?
Et Laurent reviendrait-il ?
Telles étaient les deux questions solennelles et terribles que les pauvres femmes se posaient chaque matin et chaque soir.
Elles s’en allaient tous les jours, à six heures, entendre la messe à Férolles, priaient pour le pauvre soldat, et s’en revenaient ensuite au moulin.
Plus de chansons et plus de rires, mais pas de larmes non plus.
Les deux femmes avaient une de ces douleurs calmes et silencieuses qui sont les plus poignantes.
Un nouvel hôte s’était installé au moulin.
Cet hôte, c’était Michel Brûlart.
Le mauvais garnement, le braconnier, le vagabond, avait paru s’amender tout à coup.
Mame Suzon lui avait vu verser d’abondantes larmes, qui paraissaient sincères.
Comme, pendant plusieurs heures, la pauvre meunière avait été dans un état alarmant, Michel était resté auprès d’elle.
Le soir était venu : il avait soupé et couché au moulin.
Le lendemain, il s’était offert à aller à Orléans pour avoir des nouvelles positives de la guerre.
Il y était allé en effet et en était revenu avec cette vague espérance qu’on ne se battrait peut-être pas.
C’était du moins ce qu’on lui avait dit à l’intendance.
Cette bonne nouvelle avait fait bien venir le messager.
Il était demeuré au moulin le lendemain encore.
Un des garçons meuniers s’étant pris la main dans un engrenage, s’était trouvé dans l’impossibilité de travailler.
Michel s’était offert à sa place.
– Tu as l’air de vouloir te ranger, lui avait dit mame Suzon. Reste donc, et conduis-toi bien ici, tandis que mon pauvre enfant se bat à ta place.
Deux jours après, on reçut la nouvelle d’un premier engagement entre les troupes franco-italiennes et l’armée autrichienne.
Ce premier engagement était une victoire, et la préfecture fit afficher un supplément au Moniteur des communes à la porte de toutes les mairies.
Le lendemain il arriva une lettre de Laurent. Le jeune homme écrivait du camp de San-Martino. Il avait pris part à la première bataille, il s’était bien conduit, et il était porté pour le grade de sergent. Sa lettre était toute pleine de cette humeur belliqueuse qui fait le fond de notre caractère national et transforme un paysan en héros en moins de huit jours.
Les deux femmes allèrent porter un cierge à l’autel de la Vierge, et, au retour, mame Suzon fit faire une distribution de pain aux habitants les plus nécessiteux du pays.
Michel travaillait avec ardeur, ne quittait plus mame Suzon ni le Grillon, et allait chaque matin au-devant du facteur avec l’espérance d’avoir une nouvelle lettre de Laurent.
Les gens de Férolles eux-mêmes s’étaient émus de cette transformation subite.
Les uns disaient :
– Jamais nous n’aurions cru que Michel fût capable d’un bon sentiment.
Les autres corrigeaient cette opinion par celle-ci :
– Si le père et la mère n’avaient pas été des mauvais sujets et qu’ils l’eussent élevé autrement, cet enfant n’aurait pas mal tourné.
Quant au père Brûlart, depuis que son fils travaillait, il se montrait de temps en temps au cabaret de Férolles et haussait les épaules quand on lui parlait de Michel.
– Puisqu’il est au moulin, disait-il, qu’il y reste ! c’est un fier débarras pour moi.
On l’avait même entendu formuler des menaces contre son fils ; et le bruit en était venu aux oreilles de mame Suzon qui lui avait dit :
– Travaille, mon enfant, et je prendrai soin de ton avenir. Ne t’inquiète pas de ce que dit ton père. Si tu deviens un brave garçon et un bon ouvrier, quand mon Laurent sera revenu, il ne regardera pas à te donner quelques milliers de francs pour t’établir.
Il y avait donc déjà huit jours que Michel était au moulin.
Au lieu de coucher dans le corps de logis principal, et par conséquent sous la même clef que mame Suzon et sa nièce, il s’était modestement installé dans la chambrette attenante à l’écurie et qui était destinée au charretier, en temps ordinaire.
Mais comme le charretier qu’on avait alors était marié avec la servante, il n’occupait pas la chambrette, et Michel s’en était accommodé.
Or donc, ce soir-là, après souper, après une prière faite en commun pour le soldat, Michel souhaita la bonne nuit à la meunière et au Grillon et s’alla coucher.
La nuit était si noire que, pour traverser la cour, il fut obligé de prendre une lanterne, de peur de se jeter dans le trou au fumier qu’on venait de vider.
Seulement, une fois dans son réduit, au lieu de se déshabiller, il se glissa tout vêtu sous ses couvertures, après avoir éteint la lanterne.
Puis il attendit.
Avait-il donc quelque expédition de braconnage en tête, et sa conversion n’était-elle pas complète ?
Il attendit environ une heure.
Comme on était dans la belle saison, on pouvait coucher les fenêtres ouvertes.
Michel avait donc laissé la sienne entrebâillée, et il prêtait l’oreille à ces moindres bruits lointains de la nuit qu’un braconnier distingue si merveilleusement.
Les grenouilles coassaient au bord de l’écluse.
Le moulin tournait ; au loin, dans les champs, on entendait le houhoulement monotone d’un hibou.
Puis il vint un moment où le houhoulement parut se dédoubler.
Au lieu d’un hibou, Michel en entendit deux.
– Eh ! se dit-il, je crois que v’là le moment.
Et il sortit lestement du lit, prit ses sabots à la main, se glissa hors de la chambrette, traversa l’écurie, monta l’échelle du grenier à foin et sortit par la porte de ce dernier endroit.
On entendait toujours chanter deux hiboux.
Michel, toujours nu-pieds, se mit à courir à travers champs.