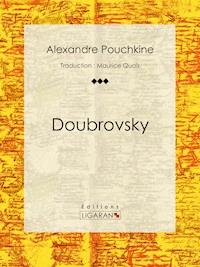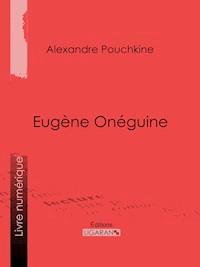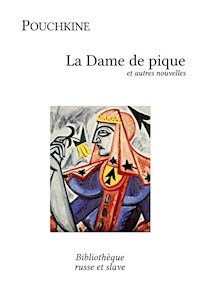
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliothèque russe et slave
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Les nouvelles les plus célèbres du grand Pouchkine, le fondateur de la littérature russe moderne.
La Dame de pique est ici suivie des
Récits de feu Ivan Pétrovitch Bielkine, tous dans la fameuse traduction d'André Gide et de Jacques Schiffrin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliothèque russe et slave
— Collection dirigée par Xavier Mottez —
Chez le même éditeur — Littérature russe
1. GOGOLLes Âmes mortes. Traduction d’Henri Mongault
2. TOURGUENIEVMémoires d’un chasseur. Traduction d’Henri Mongault
3. TOLSTOÏLes Récits de Sébastopol. Traduction de Louis Jousserandot
4. DOSTOÏEVSKIUn joueur. Traduction d’Henri Mongault
5. TOLSTOÏAnna Karénine. Traduction d’Henri Mongault
6. MEREJKOVSKILa Mort des dieux. Julien l’Apostat. Traduction d’Henri Mongault
7. BABELCavalerie rouge. Traduction de Maurice Parijanine
8. KOROLENKOLe Musicien aveugle. Traduction de Zinovy Lvovsky
9. KOUPRINELe Duel. Traduction d’Henri Mongault
10. GOGOLLe Révizor — Le Mariage. Traduction de Marc Semenoff
11. DOSTOÏEVSKIStépantchikovo et ses habitants. Traduction d’Henri Mongault
12. Les Bylines russes — La Geste du Prince Igor. Traductions de Louis Jousserandot et d’Henri Grégoire
13. PISSEMSKIMille âmes. Traduction de Victor Derély
14. RECHETNIKOVCeux de Podlipnaïa. Traduction de Charles Neyroud
15. TOURGUENIEVPoèmes en prose. Traduction de Charles Salomon
16. GONTCHAROVOblomov. Traduction de Jean Leclère
17. GOGOLVeillées d’Ukraine. Traduction d’Eugénie Tchernosvitow
18. DOSTOÏEVSKIMémoires écrits dans un souterrain. Traduction d’Henri Mongault
19. KOUPRINELe Bracelet de grenats — Olessia. Traduction d’Henri Mongault
20. GOGOLTarass Boulba. Traduction de Marc Semenoff
21. LESKOVGens d’Église. Traduction d’Henri Mongault
22. POUCHKINELa Fille du capitaine. Traduction d’Eugène Séménoff
23. LOUGOVOÏPollice Verso. Traduction d’Ely Halpérine-Kaminsky
24. CHMELIOVLe Soleil des morts. Traduction de Denis Roche
25. CHMELIOVGarçon !Traduction d’Henri Mongault
26. GOGOLNouvelles de Pétersbourg. Traductions de Michel-Rostislav Hofmann et Tatiana Rouvenne
27. ILF ET PETROVLes Douze Chaises. Traduction d’Alain Préchac
28. POUCHKINERécits de Belkine. Traduction de Pierre Skorov
29. LESKOVLady Macbeth du district de Mzensk et autres nouvelles. Traductions de Jean Leclère et d’Irène Tateossov
30. TOURGUENIEVPères et fils. Traduction de Marc Semenoff
31. ILF ET PETROVLe Veau d’or. Traduction d’Alain Préchac
32. PILNIAKRiazan-la-pomme. Traduction de Maurice Parijanine, révisée par Michel Niqueux
33. PILNIAKL’Année nue. Traduction de L. Desormonts et L. Bernstein, révisée par Dany Savelli
34. TOLSTOÏLe Faux Coupon. Traduction de Pierre Skorov
35. DOSTOÏEVSKISouvenirs de la maison des morts. Traduction d’Henri Mongault
36. POUCHKINELa Dame de pique — Le Nègre de Pierre le Grand. Traduction de Michel Niqueux
37. LESKOVLe Pèlerin enchanté — Aux confins du monde. Traductions d’Alice Orane et d’Hélène Iswolsky
38. ARSENIEVDersou Ouzala. Traduction de Pierre P. Wolkonsky
39. BOUNINELe Village. Traduction de Maurice Parijanine
40. BOUNINESoukhodol et autres nouvelles. Traduction de Maurice Parijanine
41. ILF ET PETROVKolokolamsk et autres nouvelles fantastiques. Traduction d’Alain Préchac
42. TOURGUENIEVFumée. Traduction de Génia Pavloutzky
43. BOUNINELe Monsieur de San Francisco et autres nouvelles. Traduction de Maurice Parijanine
44. BOULGAKOVCœur de chien. Traduction d’Alexandre Karvovski (Petite Bibliothèque slave)
45. LESKOVLe Gaucher. Traduction de Paul Lequesne (Petite Bibliothèque slave)
46. TOURGUENIEVMoumou. Traduction d’Henri Mongault. Préface de Dominique Fernandez (Petite Bibliothèque slave)
47. BOUNINETrois roubles. Traduction d’Anne Flipo Masurel. Préface d’Andreï Makine (Petite Bibliothèque slave)
Alexandre Pouchkine
Пушкин Александр Сергеевич
1799 – 1837
LA DAME DE PIQUE
suivie des
RÉCITS DE FEU IVAN PÉTROVITCH BIELKINE
Traduit du russe par André Gide et Jacques Schiffrin
© Bibliothèque russe et slave, 2022
LA DAME DE PIQUE
Пиковая дама
« Dame de pique signifie malveillance secrète. »Le Cartomancien moderne.
I
Quand dehors la grisaille
Brouillait les vitres,
Ils se retrouvaient.
Il fallait les voir, Dieu ait leur âme !
S’acharnant sur leurs mises,
Les doubler.
Et gagner,
Et marquer le coup
À la craie.
Ainsi, par les temps sombres,
Les voyait-on s’absorber
En de sérieuses affaires.
On jouait chez Naroumov, officier aux gardes à cheval. La longue nuit d’hiver s’écoula sans qu’on s’en aperçût. On se mit à souper vers cinq heures du matin. Les gagnants mangeaient de grand appétit ; les autres regardaient distraitement leurs couverts vides. Mais la conversation s’anima grâce au champagne, et bientôt tout le monde y prit part.
— Qu’as-tu fait aujourd’hui, Sourine ? demanda le maître de la maison.
— J’ai perdu, comme d’habitude. Vraiment, je n’ai pas de veine. Je ne double jamais ma mise. Rien ne me démonte. Pourtant je perds toujours.
— Eh quoi ! pas une seule fois tu n’as cherché à profiter de la série ? Pas une seule fois tu n’as été tenté d’essayer ? Ta constance me confond.
— Et que diriez-vous de Hermann ? s’écria l’un des convives en désignant un jeune officier du génie. De sa vie ce garçon n’a fait un paroli, ni même touché une carte ; mais il reste avec nous jusqu’à cinq heures du matin, à nous regarder jouer.
— Le jeu m’intéresse beaucoup, dit Hermann, mais, dans l’espoir du superflu, je ne puis risquer le nécessaire.
— Hermann est allemand : il est économe, voilà tout, remarqua Tomski. Mais s’il est quelqu’un que je ne comprenne pas, c’est ma grand-mère, la comtesse Anna Fédotovna.
— Comment ? Pourquoi ? s’écrièrent les convives.
— Je ne puis concevoir, reprit Tomski, les raisons qui la retiennent de jouer.
— Voyons ! dit Naroumov, qu’y a-t-il d’étonnant à ce qu’une femme de quatre-vingts ans ne ponte pas ?
— N’avez-vous rien entendu dire ?
— Rien, vraiment.
— Or donc, écoutez. Mais sachez d’abord que ma grand-mère, il y a quelque soixante ans, vint à Paris, où elle fit fureur. On la suivait en foule ; on voulait voir la Vénus moscovite*1. Richelieu, qui lui fit la cour, faillit se brûler la cervelle, affirme-t-elle, désespéré par ses rigueurs. En ce temps, les dames jouaient au pharaon. Un soir, à la cour, ma grand-mère, jouant contre le duc d’Orléans, perdit sur parole une somme considérable. Rentrée chez elle, tout en décollant ses mouches et en dégrafant ses paniers, ma grand-mère avoua sa dette à mon grand-père et lui enjoignit de payer. Feu mon grand-père, autant qu’il m’en souvient, lui servait d’intendant en quelque sorte. Il la craignait comme le feu ; cependant l’aveu d’une perte aussi effroyable le jeta hors de ses gonds. Il fit des comptes, remontra à ma grand-mère qu’en six mois ils avaient dépensé un demi-million ; qu’ils n’avaient point en France leurs villages de Moscou et de Saratov ; bref, il refusa de payer. Grand-mère alors le gifla, et, pour consommer la disgrâce, fit, cette nuit-là, chambre à part.
Le lendemain elle le convoqua ; elle escomptait le bon effet de ce châtiment matrimonial. Pour la première fois de sa vie, elle condescendit à des raisonnements, à des explications. Rien n’y fit… En vain s’efforça-t-elle de lui expliquer qu’il y a dette et dette, et qu’on n’en peut user avec un prince ainsi qu’avec un carrossier. Grand-père s’entêtait et refusait de rien entendre. "Non et non." C’était tout. Grand-mère ne savait plus que devenir. Elle connaissait intimement un homme fort remarquable. Vous avez entendu parler du comte de Saint-Germain, dont on raconte tant de merveilles. Vous savez qu’il se faisait passer pour le Juif errant, pour l’inventeur de l’élixir de vie, de la pierre philosophale. Certains riaient de lui comme d’un charlatan, et Casanova, dans ses Mémoires, dit que c’était un espion. Quoi qu’il en soit, et malgré le mystère dont il s’entourait, Saint-Germain gardait un aspect fort respectable et se montrait très aimable en société. Ma grand-mère, qui l’aime encore à la folie, ne supporte pas d’entendre parler de lui sans respect. Elle savait que le comte de Saint-Germain pouvait disposer de sommes énormes, et décida de s’adresser à lui. Elle lui écrivit donc un billet, le priant de passer au plus tôt chez elle. Le vieil original accourut, et la trouva tout accablée de désespoir. Elle lui dépeignit sous les couleurs les plus sombres la conduite barbare de son mari, et dit en terminant qu’elle reportait sur son amitié et son obligeance tous ses espoirs. Saint-Germain se mit à réfléchir :
— Je vous avancerais bien cette somme, dit-il, mais je sais que vous n’auriez de repos qu’après me l’avoir rendue, et je n’aurais donc pas levé vos ennuis. Je propose un autre moyen : regagner l’argent.
— Mais, mon cher comte, répondit ma grand-mère, je vous l’ai dit, nous n’avons plus d’argent du tout !
— Il n’en est point besoin, répliqua Saint-Germain ; daignez seulement m’écouter…
Et il lui révéla un secret que chacun de nous paierait cher…
Les jeunes joueurs redoublèrent d’attention. Tomski alluma sa pipe, en tira une bouffée et continua :
Le soir même, ma grand-mère parut à Versailles au jeu de la reine*. Le duc d’Orléans tenait la banque. Ma grand-mère s’excusa négligemment de ne s’acquitter pas aussitôt, débita pour se justifier je ne sais quelle petite histoire, et se mit incontinent à ponter. Elle choisit trois cartes, les joua l’une après l’autre en doublant à chaque fois sa mise. Les trois cartes gagnèrent, et ma grand-mère put s’acquitter glorieusement.
— Pur hasard ! s’écria l’un des convives.
— Quel conte ! protesta Hermann.
— Les cartes étaient peut-être truquées, reprit un troisième.
— Je ne le crois pas, répliqua gravement Tomski.
— Comment, dit Naroumov, tu as une grand-mère qui devine trois cartes gagnantes successives, et tu n’as pas encore su t’emparer de ce secret cabalistique ?
— C’est bien là le diable ! répondit Tomski. Elle avait quatre fils, dont mon père. Tous les quatre, joueurs enragés ; elle ne révéla son secret à aucun d’eux, bien que cela leur eût été fort utile, ainsi qu’à moi. Mais voici ce que m’a raconté mon oncle, le comte Ivan Ilitch, et ce dont son honneur se fait garant : feu Tchaplitzki — celui-là même qui est mort dans la misère après avoir gaspillé des millions —, dans sa jeunesse, un jour qu’il jouait contre Zoritch, s’il m’en souvient, perdit près de trois cent mille roubles. Il était au désespoir. Ma grand-mère, qui se montrait toujours très sévère pour les étourderies des jeunes gens, eut, je ne sais pourquoi, pitié de Tchaplitzki. Elle lui désigna trois cartes ; il aurait à les jouer l’une après l’autre ; mais il lui donnait sa parole de ne jouer ensuite plus jamais. Tchaplitzki se rendit chez son vainqueur. Ils jouèrent. Tchaplitzki mit cinquante mille roubles sur la première carte, et gagna. Il doubla son enjeu, et gagna encore ; gagna de même avec la troisième carte. En fin de compte il put s’acquitter et se trouver encore en gain…
— Mais voilà bientôt six heures ; il est temps d’aller se coucher.
En effet, le jour commençait à poindre. Les jeunes gens vidèrent leurs verres et l’on se sépara.
II
— Il paraît que Monsieur est décidément pour les suivantes.
— Que voulez-vous, Madame ? Elles sont plus fraîches*.
Conversation mondaine.
La vieille comtesse*** était dans sa chambre de toilette, assise devant un miroir. Trois suivantes l’entouraient. L’une tenait un pot de rouge, l’autre une boîte d’épingles à cheveux, la troisième un haut bonnet orné de rubans couleur feu. La comtesse n’avait plus la moindre prétention à la beauté, la sienne était flétrie depuis longtemps ; mais elle conservait toutes les habitudes de sa jeunesse, suivait rigoureusement les modes du siècle passé, et mettait à sa toilette tout autant de soin et de temps que soixante ans auparavant. Une jeune fille, sa pupille, faisait de la broderie dans l’embrasure de la fenêtre.
— Bonjour, grand-maman*, dit en entrant un jeune officier. Bonjour, mademoiselle Lise. Grand-maman*, j’ai une demande à vous adresser.
— Qu’est-ce que c’est, Paul ?
— Permettez-moi de vous présenter un de mes amis et de l’amener vendredi à votre bal.
— Amène-le directement au bal, où tu me le présenteras. As-tu été hier chez*** ?
— Certainement ! C’était très gai. On a dansé jusqu’à cinq heures. Eletzkaïa était à ravir.
— Eh, mon cher ! Que lui trouve-t-on de si beau ? Peut-on la comparer à la princesse Daria Pétrovna, sa grand-mère ! À propos : je suppose qu’elle doit être bien vieillie, la princesse Daria Pétrovna ?
— Vieillie ! Eh quoi ! répondit étourdiment Tomski, il y a bien sept ans déjà qu’elle est morte.
La jeune fille leva la tête et fit signe au jeune officier. Il se souvint alors qu’on cachait à la vieille comtesse la mort des personnes de son âge. Il se mordit les lèvres. Mais la comtesse accueillit cette nouvelle, qu’elle entendait pour la première fois, avec une parfaite indifférence.
— Morte ! dit-elle ; tiens, je ne le savais même pas. Nous avons été nommées ensemble demoiselles d’honneur, et lorsque nous fûmes présentées à l’Impératrice…
Et la comtesse raconta pour la centième fois son anecdote.
— Allons, Paul ! dit-elle ensuite ; aide-moi à me lever. Lisanka, où est ma tabatière ?
Et la comtesse, accompagnée de ses trois suivantes, se retira derrière le paravent pour achever sa toilette.
Tomski resta seul avec la jeune fille.
— Qui donc voulez-vous présenter à la comtesse ? demanda à voix basse Lisavéta Ivanovna.
— Naroumov. Vous le connaissez ?
— Non. Est-ce un militaire ?
— Oui.
— Dans le génie ?
— Non, dans la cavalerie. Qu’est-ce qui vous faisait penser qu’il est dans le génie ?
La jeune fille se mit à rire et ne répondit rien.
— Paul ! cria la comtesse derrière le paravent. Envoie-moi un nouveau roman ; n’importe lequel, pourvu qu’il ne soit pas dans le goût du jour.
— Qu’entendez-vous par là, grand-maman* ?
— Je veux dire un roman où le héros n’étrangle ni son père, ni sa mère, et où il n’y ait pas de noyés. J’ai une peur atroce des noyés.
— Oh ! des romans de ce genre, on n’en fait plus ! Ne voudriez-vous pas un roman russe ?
— Tiens ! est-ce qu’il y a des romans russes ? Envoie-m’en un, mon cher, envoie-m’en un, je t’en prie.
— Au revoir, grand-maman*, je suis pressé. Au revoir, Lisavéta Ivanovna. Pourquoi donc vouliez-vous que Naroumov fût dans le génie ?
Et Tomski sortit de la chambre de toilette.
Restée seule, Lisavéta Ivanovna laissa son ouvrage et se mit à regarder par la fenêtre. Bientôt, de l’autre côté de la rue, à l’angle de la maison du coin, parut un jeune officier.
Lisavéta Ivanovna rougit ; elle reprit son ouvrage et baissa la tête sur le canevas. En ce moment la comtesse rentra, complètement habillée.
Lisanka, dit-elle, fais atteler. Nous irons faire une promenade.
Lisanka se leva et se mit à ranger sa tapisserie.
— Eh bien, qu’as-tu donc, petite mère ? Es-tu sourde ? cria la comtesse ; fais vite atteler le carrosse.
— J’y vais, répondit la jeune fille, et elle courut vers l’antichambre.
Un domestique entra et remit à la comtesse quelques livres de la part du prince Paul Alexandrovitch.
— C’est bien ! Faites-le remercier. Lisanka, où donc cours-tu ?
— Je vais m’habiller.
— Tu as le temps, petite mère. Assieds-toi là : ouvre le premier volume et fais-moi la lecture.
La jeune fille prit le livre et lut quelques lignes.
— Plus haut ! dit la comtesse. Qu’as-tu donc, petite mère ? Serais-tu enrouée ? Attends. Approche-moi le petit tabouret. Plus près… Eh bien !…
Lisavéta Ivanovna lut encore deux pages. La comtesse bâilla.
— Jette ce livre, dit-elle. Quelles fadaises ! Renvoie tout cela au prince Paul, et fais-le remercier… Et le carrosse ? Que devient le carrosse ?
— Il est prêt, dit Lisavéta Ivanovna, en regardant par la fenêtre.
— Pourquoi n’es-tu pas habillée ? Toujours il faut t’attendre. C’est insupportable, ma chère !
Lisa courut à sa chambre. Elle n’y était pas depuis deux minutes, que la comtesse sonnait de toutes ses forces.
Trois suivantes accoururent par une porte, un valet par une autre.
— On a beau appeler, personne ne vous entend ! s’écria la comtesse. Qu’on aille presser Lisavéta Ivanovna. Je l’attends.
La jeune fille entra en manteau et en chapeau.
— Enfin, te voilà ! dit la comtesse. Mais quel est cet accoutrement ! À quoi songes-tu ? Qui prétends-tu séduire ?… Quel temps fait-il ? Du vent, n’est-ce pas ?
— Non, Excellence, dit le valet de chambre, il fait très doux.
— Vous répondez toujours au hasard. Ouvrez le vasistas. Je le disais bien ! Il fait du vent ; un vent très froid. Qu’on dételle ! Lisanka, nous ne sortons pas. C’était bien la peine de t’attifer ainsi !
Et voilà ma vie ! songea Lisavéta Ivanovna.
En vérité, Lisavéta Ivanovna était une bien malheureuse créature. « Il est amer, le pain d’autrui, dit Dante, et les marches du seuil d’autrui sont pénibles à gravir. » Et qui donc aurait pu mieux connaître l’amertume de la sujétion, que la pauvre pupille d’une vieille femme de qualité ? La comtesse n’était assurément pas méchante, mais elle avait tous les caprices d’une femme gâtée par le succès mondain. Elle était avare et se complaisait dans un froid égoïsme, comme les vieilles gens qui ont cessé d’aimer et qui sont hostiles au présent. Elle prenait part à toutes les frivoles distractions de la vie mondaine, elle se traînait à toutes les fêtes, et là, fardée et parée à la mode ancienne, se tenait assise dans son coin, ornement hideux et obligatoire des salles de bal. Les invités en entrant s’approchaient d’elle avec de profonds saluts, comme on accomplirait un rite. Puis personne ne s’en occupait plus. Chez elle, où était reçue toute la ville, elle observait une étiquette rigoureuse et ne reconnaissait jamais aucun de ses visiteurs. Ses nombreux domestiques, engraissés et vieillis dans ses antichambres, en prenaient à leur aise avec la vieille moribonde, que chacun plumait à l’envi. Dans cette maison, Lisavéta Ivanovna menait une vie de martyre. Servait-elle le thé, c’étaient aussitôt des reproches à propos du sucre gaspillé. Lisait-elle à voix haute quelque roman, la comtesse la faisait responsable de tous les défauts de l’auteur. Accompagnait-elle la comtesse dans une promenade, c’est à elle qu’on s’en prenait du mauvais temps et des mauvais pavés. Les appointements fixés ne lui étaient jamais intégralement payés ; cependant on exigeait d’elle qu’elle fût habillée comme tout le monde, c’est-à-dire comme fort peu de gens. Dans la société, son rôle était des plus misérables. Chacun la connaissait, mais elle n’était remarquée par personne. Au bal, elle ne dansait que lorsqu’on manquait de vis-à-vis, et les dames la prenaient par le bras chaque fois qu’il leur fallait quitter le salon pour réparer quelque désordre de leur toilette. Elle avait de l’amour-propre, sentait vivement l’infortune de sa situation, et jetait autour d’elle des regards impatients dans l’attente d’un libérateur. Mais les jeunes gens, prudents dans leur étourderie vaniteuse, ne l’honoraient d’aucun regard, bien que Lisavéta Ivanovna fût cent fois plus charmante que les jeunes beautés froides et hautaines autour desquelles ils faisaient les jolis cœurs. Que de fois, quittant les riches et fastidieux salons, elle s’en était allée pleurer dans sa petite chambre que meublaient une commode, un lit en bois peint, un paravent de papier, un petit miroir, et où une chandelle dans un chandelier de cuivre répandait une morne lueur.
Un jour — cela se passait le surlendemain de la soirée décrite au début de cette histoire, et une semaine avant la scène que nous venons de conter —, un jour, Lisavéta Ivanovna était assise près de la fenêtre, devant son métier ; regardant distraitement dans la rue, elle aperçut un jeune officier du génie, immobile, les yeux fixés sur sa fenêtre. Elle baissa la tête et reprit son travail. Au bout de cinq minutes, elle regarda de nouveau ; le jeune officier était à la même place. N’ayant pas l’habitude de faire la coquette avec les officiers qui passaient sous ses fenêtres, elle se remit à travailler et demeura près de deux heures sans plus lever les yeux de son métier. On servit le dîner. Elle se leva, s’occupa de ranger son ouvrage et, ayant involontairement regardé dans la rue, elle y vit encore l’officier. Cela lui parut assez étrange. Après le dîner, elle s’approcha de la fenêtre avec une certaine inquiétude, mais l’officier n’était plus là. Elle cessa de penser à lui.
Mais deux jours après, sortant avec la comtesse, comme elle allait monter en voiture, elle le revit. Il se tenait près du perron, le visage enfoui dans un col de castor ; ses yeux noirs étincelaient sous les bords de son tricorne. Lisavéta Ivanovna eut peur sans trop savoir pourquoi, et s’installa dans la voiture, saisie d’un trouble étrange.
De retour à la maison, elle courut à la fenêtre ; l’officier était à son poste, fixant sur elle son regard. Elle recula, brûlant de curiosité et agitée par un sentiment tout nouveau pour elle.
Depuis lors, il ne se passa pas de jour que le jeune homme ne parût, à l’heure habituelle, sous les fenêtres de la maison. Des rapports muets s’établirent entre eux. Assise à sa place et travaillant, elle pressentait son approche, relevait la tête et le regardait chaque jour plus longuement. Le jeune homme paraissait lui en être reconnaissant : elle distinguait, avec ce regard aigu de la jeunesse, qu’une vive rougeur couvrait les joues pâles de l’officier chaque fois que leurs yeux se rencontraient. Au bout d’une semaine, elle lui sourit.
Lorsque Tomski demanda à la comtesse la permission de lui présenter un ami, le cœur de la pauvre fille battit bien fort. Mais en apprenant que Naroumov faisait son service aux gardes à cheval, et non point dans le génie, elle s’en voulut d’avoir laissé paraître son secret devant un écervelé.