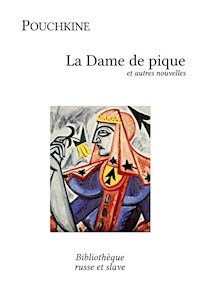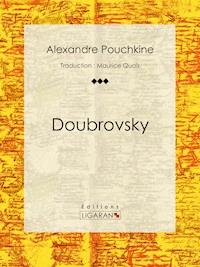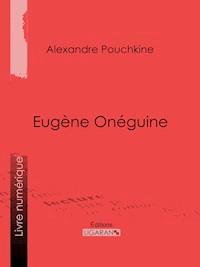Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliothèque russe et slave
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
« Sommet de l’art fantastique » selon Dostoïevski,
La Dame de pique, histoire d’un désir utopique (le viol de la réalité ou du destin) qui finit en folie, est le récit de Pouchkine qui a suscité le plus d’interprétations, fondées sur l’histoire, le symbolisme, la mythologie, la psychanalyse, etc., et qui, pour la première fois, sont exposées dans des notes. Par ailleurs, les recherches en stylistique et en narratologie ont attiré l’attention sur des particularités significatives de la prose précise et concise de Pouchkine, dont cette nouvelle traduction tient compte. Le volontarisme du héros napoléonien, Hermann, peut être rapproché de celui de Pierre le Grand, que Pouchkine mit en scène dans un roman historique inachevé, avec son ancêtre africain. Celui-ci quitte les délices du Paris de la Régence pour participer à l’œuvre civilisatrice de Pierre le Grand, et se heurte au conservatisme des boyards. Pouchkine mêle la fiction à l’histoire et à l’autobiographie pour peindre, avec des couleurs vives, le douloureux mariage du nouveau et de l’ancien.
Traduction, notes et dossiers de Michel Niqueux, 2000.
EXTRAIT DE
LA DAME DE PIQUE
Une fois, on jouait aux cartes chez le garde à cheval Naroumov. La longue nuit d’hiver s’était écoulée insensiblement ; on s’était mis à souper après quatre heures du matin. Ceux qui avaient gagné mangeaient avec grand appétit ; les autres restaient l’air absent devant leurs assiettes vides. Mais le champagne apparut, la conversation s’anima, et tous y prirent part.
— Qu’as-tu fait, Sourine ? demanda le maître de maison.
— J’ai perdu, comme d’habitude. Il faut reconnaître que je n’ai pas de chance : je joue la mirandole, je ne m’emporte jamais, rien ne peut me démonter, et je perds toujours !
— Et tu ne t’es jamais laissé tenter ? Tu n’as jamais misé sur le routé ?. Ta fermeté me confond.
— Et que dire d’Hermann ! dit l’un des convives en désignant un jeune ingénieur. De sa vie, il n’a touché une carte, il n’a jamais fait de paroli de sa vie, et pourtant il reste avec nous jusqu’à cinq heures du matin à nous regarder jouer !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Alexandre Sergueïevitch Pouchkine est un poète, dramaturge et romancier russe né à Moscou le 26 mai 1799 et mort à Saint-Pétersbourg le 29 janvier 1837.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE
— LITTÉRATURE RUSSE —
Alexandre Pouchkine
Пушкин Александр Сергеевич
1799 – 1837
LA DAME DE PIQUELE NÈGRE DE PIERRE LE GRAND
Пиковая дамаАрап Петра Великого
1834 — 1837
Traduction et commentaires de Michel Niqueux, 2000.
© La Bibliothèque russe et slave, 2016
© Michel Niqueux, 2000, 2016
La Dame de pique
La dame de pique12 signifie une secrète malveillance.
Nouveau manuel de divination13
I
Les jours de mauvais temps,
Ils se retrouvaient souvent
Chez eux.
Ils jouaient en doublant
La mise de cinquante à cent,
Mon Dieu !
Ils avaient l’heur de gagner
Et ils marquaient à la craie14
Les coups.
Ainsi, par les temps mauvais,
Étaient-ils tous occupés
Beaucoup.15
UNE FOIS16, on jouait aux cartes chez le garde à cheval17 Naroumov. La longue nuit d’hiver s’était écoulée insensiblement18 ; on s’était mis à souper après quatre heures du matin. Ceux qui avaient gagné mangeaient avec grand appétit19 ; les autres restaient l’air absent devant leurs assiettes vides. Mais le champagne apparut, la conversation s’anima, et tous y prirent part20.
— Qu’as-tu fait21, Sourine ? demanda le maître de maison.
— J’ai perdu, comme d’habitude. Il faut reconnaître que je n’ai pas de chance : je joue la mirandole22, je ne m’emporte jamais, rien ne peut me démonter, et je perds toujours !
— Et tu ne t’es jamais laissé tenter ? Tu n’as jamais misé sur le routé ?23. Ta fermeté me confond.
— Et que dire d’Hermann !24 dit l’un des convives en désignant un jeune ingénieur25. De sa vie, il n’a touché une carte, il n’a jamais fait de paroli26 de sa vie, et pourtant il reste avec nous jusqu’à cinq heures du matin à nous regarder jouer !
— Le jeu m’intéresse fortement, dit Hermann, mais je ne suis pas en état de sacrifier le nécessaire dans l’espoir d’acquérir le superflu27.
— Hermann est un Allemand : il est économe28, voilà tout ! fit observer Tomski29. Mais s’il est quelqu’un qui dépasse mon entendement, c’est bien ma grand-mère, la comtesse Anna Fédotovona.
— Comment ? Quoi ? s’écrièrent les convives.
— Je ne puis concevoir, reprit Tomski, pourquoi ma grand-mère ne ponte jamais !
— Qu’y a-t-il d’étonnant, dit Naroumov, à ce qu’une vieille octogénaire ne ponte pas ?
— Vous ne connaissez donc pas son histoire ?
— Non, vraiment, pas du tout !
— Alors, écoutez.
Il faut savoir qu’il y a quelque soixante ans, ma grand-mère alla à Paris, et y fut très à la mode30. On courait après elle en foule pour voir la Vénus moscovite31 ; Richelieu32 lui-même lui fit la cour, et ma grand-mère affirme qu’il faillit se brûler la cervelle à cause de ses rigueurs.
En ces temps-là, les dames jouaient au pharaon. Un jour33, à la cour, ma grand-mère perdit sur parole contre le duc d’Orléans34 une très grosse somme. Rentrée chez elle, ma grand-mère, tout en décollant les mouches de son visage et en délaçant ses paniers, annonça cette perte à mon grand-père et lui enjoignit de payer.
Feu mon grand-père, autant qu’il m’en souvienne, était comme qui dirait l’intendant de ma grand-mère. Il la craignait comme le feu35 ; cependant, la nouvelle d’une perte aussi effroyable le mit hors de lui : il apporta ses comptes, démontra à ma grand-mère qu’en six mois ils avaient dépensé un demi-million, qu’ils n’avaient point près de Paris leurs campagnes des environs de Moscou ou de Saratov, et il refusa net de payer. Ma grand-mère lui donna un soufflet et en signe de disgrâce fit chambre à part.
Le lendemain, elle fit appeler son époux, en espérant que ce châtiment privé avait produit son effet, mais elle le trouva inébranlable. Pour la première fois de sa vie, elle en vint à délibérer et à s’expliquer avec lui ; elle pensait lui faire honte en lui démontrant avec condescendance qu’il y a dette et dette, et qu’il existe une différence entre un prince et un carrossier. Bernique ! Grand-père regimbait. Non, un point c’est tout ! Grand-mère ne savait que faire.
Elle avait pour connaissance intime un homme fort remarquable. Vous avez entendu parler du comte de Saint-Germain36, au sujet duquel on dit tant de merveilles. Vous savez qu’il se faisait passer pour le Juif errant37, pour l’inventeur de l’élixir de longue vie, de la pierre philosophale38, etc. On riait de lui comme d’un charlatan, et dans ses Mémoires, Casanova dit même que c’était un espion39 ; au demeurant, malgré ses airs mystérieux, Saint-Germain était d’une figure fort estimable et se montrait très aimable en société. Ma grand-mère l’aime encore éperdument et se fâche quand on n’en parle pas avec respect. Elle savait que Saint-Germain pouvait disposer de grosses sommes. Elle se détermina à recourir à lui. Elle lui écrivit un billet pour le prier de passer au plus vite chez elle.
Le vieil original apparut tout de suite et la trouva plongée dans une douleur terrible. Elle lui dépeignit sous les couleurs les plus noires la barbarie de son mari, et lui dit à la fin qu’elle plaçait tous ses espoirs dans son amitié et son obligeance.
Saint-Germain se mit à réfléchir.
« Je puis vous avancer cette somme, dit-il, mais je sais que vous n’aurez de repos tant que vous ne me l’aurez rendue, et je ne voudrais pas vous jeter dans de nouveaux embarras. Il y a un autre moyen : vous pouvez vous racquitter. » — « Mais, mon cher comte, répondit ma grand-mère, je vous dis que nous n’avons plus d’argent du tout. » — « Il n’en est point besoin, répliqua Saint-Germain : veuillez seulement m’écouter. » Là-dessus, il lui révéla un secret pour lequel chacun de nous eût donné cher40...
Les joueurs redoublèrent d’attention. Tomski alluma sa pipe, tira une bouffée et continua41.
Le soir même, ma grand-mère parut à Versailles, au jeu de la Reine. Le duc d’Orléans tenait la banque ; ma grand-mère lui fit quelques excuses pour ne pas avoir apporté sa dette, débita pour se justifier une petite histoire, et se mit à ponter contre lui. Elle choisit trois cartes et les joua l’une après l’autre : toutes les trois gagnèrent sonica42, et ma grand-mère regagna entièrement ce qu’elle avait perdu.
— Le hasard ! dit l’un des convives.
— Un conte !43 fit Hermann.
— Des cartes truquées, peut-être ? ajouta un troisième44.
— Je ne le pense pas, répondit gravement Tomski.
— Comment ! dit Naroumov, tu as une grand-mère qui devine trois cartes qui gagnent l’une après l’autre, et tu ne t’es pas encore approprié ce secret cabalistique45 ?
— Ah c’est bien le diable ! répondit Tomski. Elle avait quatre fils, dont mon père, — tous les quatre joueur acharnés, et elle n’a révélé son secret à aucun d’eux, bien que cela n’eût pas été mauvais pour eux, ni pour moi non plus. Mais voici ce que m’a raconté mon oncle, le comte Ivan Ilyitch, en me le garantissant sur son honneur. Feu Tchaplitski, celui-là même qui est mort dans la misère après avoir mangé des millions, avait dans sa jeunesse perdu un jour près de trois cent mille roubles en jouant, s’il m’en souvient bien, contre Zoritch46. Il était au désespoir. Ma grand-mère, qui était toujours très sévère envers les frasques des jeunes gens, eut je ne sais pourquoi pitié de Tchaplitski. Elle lui désigna trois cartes, à jouer l’une après l’autre, et lui fit donner sa parole d’honneur de ne plus jamais jouer à l’avenir. Tchaplitski se présenta chez son vainqueur. Ils se mirent à jouer. Tchaplitski misa cinquante mille roubles sur la première carte et gagna du premier coup ; il fit paroli puis paroli-paix47, et se racquitta en se trouvant même encore en gain...
Mais il est temps d’aller se coucher : il est déjà six heures moins le quart48.
En effet, le jour commençait à poindre : les jeunes gens vidèrent leurs verres et se séparèrent49.
II
— Il paraît que monsieur est décidément pour les suivantes.
— Que voulez-vous, madame ? Elles sont plus fraîches.
Conversation mondaine50
LA VIEILLE COMTESSE *** était assise devant une glace dans sa chambre de toilette. Trois filles de chambre l’entouraient. L’une tenait un pot de fard, l’autre une boîte d’épingles à cheveux, la troisième un haut bonnet à rubans couleur de feu51. La comtesse n’avait plus la moindre prétention à une beauté depuis longtemps fanée, mais elle avait conservé toutes les habitudes de sa jeunesse, suivait rigoureusement les modes des années soixante-dix et mettait à sa toilette autant de temps et de soin que soixante ans auparavant. Auprès de la fenêtre, une jeune fille, sa pupille52, était assise devant un métier un broder53.
— Bonjour, grand’maman, dit en entrant un jeune officier. Bonjour, mademoiselle Lise. Grand’maman, j’ai une demande à vous faire.
— Qu’y a-t-il, Paul ?
— Permettez-moi de vous présenter un de mes amis et de l’amener vendredi à votre bal.
— Amène-le directement au bal et tu me l’y présenteras. As-tu été tantôt chez *** ?
— Comment donc ! Ce fut très gai ; on a dansé jusqu’à cinq heures. Eletskaïa54 était à ravir.
— Fi donc, mon cher ! Qu’y a-t-il de beau chez elle ? Ce n’est pas comme sa grand-mère, la princesse Daria Petrovna !... À propos, je suppose qu’elle doit être bien vieille, la princesse Daria Petrovna ?
— Comment, vieille ? répondit étourdiment Tomski, il y a bien sept ans qu’elle est morte.
La jeune fille leva la tête et fit un signe55 au jeune homme. Il se souvint qu’on cachait à la vieille comtesse la mort des personnes de son âge et se mordit la lèvre. Mais la comtesse accueillit cette nouvelle avec une grande indifférence.
— Morte ! dit-elle, et moi qui ne le savais pas ! Nous avons été nommées ensemble demoiselles d’honneur, et lorsque nous nous présentâmes, l’Impératrice...56
Et pour la centième fois, la comtesse raconta l’anecdote à son petit-fils.
— Allons, Paul, dit-elle ensuite, aide-moi à me lever. Lison57, où est ma tabatière ?
Et58 la comtesse, accompagnée de ses chambrières, passa derrière un paravent pour achever sa toilette. Tomski resta avec la jeune fille.
— Qui donc voulez-vous présenter à la comtesse ? demanda à voix basse Lizavéta Ivanovna.
— Naroumov. Vous le connaissez ?
— Non ! C’est un militaire ou un civil ?
— Un militaire.
— Du génie ?
— Non ! de la cavalerie. Pourquoi pensiez-vous qu’il fût du génie ?
La jeune fille se mit à rire et ne répondit mot.
— Paul ! cria la comtesse de derrière le paravent, fais-moi porter quelque nouveau roman, mais je t’en prie, surtout pas des romans modernes.
— Qu’entendez-vous par là, grand’maman ?
— Je veux dire des romans où le héros n’étrangle ni son père ni sa mère, où il n’y ait pas de noyés. J’ai affreusement peur des noyés ! 59
— À présent, il n’y a pas de romans de ce genre. Ne voudriez pas des romans russes ?
— Y aurait-il des romans russes ? 60 Envoie-m’en, mon cher, envoie-m’en, je t’en prie.
— Adieu, grand’maman, je suis pressé... Adieu, Lizavéta Ivanovna. Pourquoi donc pensiez-vous que Naroumov fût dans le génie ?
Et Tomski quitta la chambre de toilette.
Lizavéta Ivanovna demeura seule : elle abandonna son ouvrage et se mit à regarder par la fenêtre. Bientôt, d’un côté de la rue, un jeune homme apparut devant la maison qui faisait l’angle. Une rougeur couvrit les joues de Lizavéta Ivanovna, qui se remit à son ouvrage et baissa la tête sur son canevas. À ce moment, la comtesse entra, toute habillée.
— Fais atteler la voiture, Lison, dit-elle, nous allons en promenade.
Lison se leva de derrière son métier et se mit à ranger son ouvrage.
— Que fais-tu, ma bonne61 ! Tu es sourde, quoi, cria la comtesse. Fais vite atteler la voiture.
— Tout de suite, répondit doucement la jeune fille, et elle courut à l’antichambre.
Un domestique entra et remit à la comtesse des livres de la part du prince Paul Alexandrovitch62.
— C’est bien. Qu’on le remercie, dit la comtesse. Lison, Lison ! mais où donc cours-tu ?
— M’habiller.
— Tu as le temps, ma bonne. Reste ici. Ouvre le premier volume, fais-moi la lecture...
La jeune fille prit le livre et lut quelques lignes.
— Plus fort ! dit la comtesse. Qu’as-tu, ma bonne ? Tu n’as plus de voix ? Attends : approche-moi le tabouret, plus près, allons !
Lizavéta Ivanovna lut encore deux pages. La comtesse eut un bâillement.
— Laisse ce livre, dit-elle, balivernes que cela ! Renvoie ces livres au prince Paul avec mes remerciements... Mais que devient la voiture ?
— Elle est prête, dit Lizavéta Ivanovna après avoir jeté un coup d’œil dans la rue.
— Mais pourquoi n’es-tu pas habillée ? dit la comtesse. Il faut toujours t’attendre ! Cela est insupportable, ma bonne !
Lisa courut à sa chambre. Deux minutes ne s’étaient pas écoulées que la comtesse se mit à sonner de toutes ses forces. Les trois filles de chambre accoururent par une porte, le valet par une autre.
— Il n’y a donc pas moyen de se faire entendre, leur dit la comtesse. Qu’on aille dire à Lizavéta Ivanovna que je l’attends.
Lizavéta Ivanovna entra en manteau et en chapeau.
— Enfin, ma fille ! dit la comtesse. Mais quelle toilette ! À quoi bon ? Qui veux-tu séduire ? Mais quel temps fait-il ? Du vent, semble-t-il ?
— Non, Excellence ! dit le valet de chambre. Le temps est très calme.
— Vous parlez toujours au hasard ! Ouvre le vasistas. C’est bien ça : du vent ! Et glacial ! Qu’on dételle ! Lison, nous ne sortons pas : c’était bien la peine de t’attifer ainsi !
« Et voilà mon existence ! » songea Lizavéta Ivanovna63.
En effet, Lizavéta Ivanovna était une créature fort malheureuse64. Amer est le pain d’autrui, dit Dante, et pénibles les marches du perron d’autrui65, et qui pouvait mieux connaître l’amertume de la dépendance, sinon la pauvre pupille66 d’une vieille douairière ? La comtesse *** n’avait pas certes mauvais cœur, mais elle était capricieuse comme une femme gâtée par le monde, elle était avare et plongée dans un froid égoïsme, comme toutes les vieilles gens qui ont passé le temps d’aimer et qui sont étrangères au siècle présent. Elle prenait part à toutes les mondanités, hantait les bals où elle restait assise dans un coin, fardée et vêtue à l’ancienne mode, comme un hideux et indispensable ornement de salle de bal ; à leur arrivée, les invités allaient s’incliner profondément devant elle, comme pour suivre un rite établi, puis personne ne s’en occupait plus67. Chez elle, elle recevait toute la ville, en observant une stricte étiquette et68 sans reconnaître les visages. Ses nombreux domestiques, qui avaient engraissé et blanchi sous le harnois dans les communs, agissaient à leur guise et volaient à qui mieux mieux la vieille moribonde. Lizavéta Ivanovna était le souffre-douleur de la maison. Servait-elle le thé, elle était réprimandée pour avoir dépensé trop de sucre ; faisait-elle la lecture de romans, elle était coupable de tous les péchés de l’auteur ; accompagnait-elle la comtesse dans ses promenades, c’est elle qui répondait du temps et de l’état du pavé. On lui avait fixé des appointements qui ne lui étaient jamais versés en totalité, alors que l’on exigeait d’elle qu’elle fût habillée comme tout le monde, c’est-à-dire comme fort peu de gens. Dans la société, elle jouait un rôle des plus pitoyables. Chacun la connaissait, mais personne ne la remarquait ; au bal, elle ne dansait que lorsqu’il manquait un vis-à-vis, et les dames lui prenaient le bras chaque fois qu’il leur fallait se rendre à la chambre de toilette pour arranger quelque chose à leur parure. Elle avait de l’amour-propre, elle ressentait vivement sa situation et regardait autour d’elle dans l’attente impatiente d’un libérateur69 ; mais les jeunes gens, calculateurs dans leur vaine gloire volage, ne l’honoraient pas de leur attention, bien que Lizavéta Ivanovna fût cent fois plus charmante que les arrogantes et froides jeunes filles à marier autour desquelles ils papillonnaient. Que de fois, quittant sans bruit le salon fastueux et ennuyeux, elle s’en était allée pleurer dans sa pauvre chambre, meublée d’un paravent tendu de papier peint, d’une commode, d’un petit miroir et d’un lit peint, faiblement éclairée par une bougie de suif dans un chandelier de cuivre ! 70
Un jour, — cela s’était passé deux jours après la soirée décrite au début de ce récit, et une semaine avant la scène à laquelle nous venons de nous arrêter71, un jour, Lizavéta Ivanovna, assise près de la fenêtre à son métier à broder, avait jeté par hasard un coup d’œil dans la rue et aperçu un jeune officier du génie qui se tenait immobile, le regard dirigé vers sa fenêtre. Elle avait baissé la tête et s’était remise à son ouvrage ; au bout de cinq minutes, elle jeta un nouveau regard,— le jeune officier était toujours à la même place. N’ayant pas l’habitude de faire la coquette avec les officiers qui passaient, elle cessa de regarder dans la rue et resta près de deux heures à broder sans relever la tête. On servit le dîner. Elle se leva, se mit à ranger son métier et ayant involontairement jeté un regard dans la rue, elle y vit encore l’officier. Cela lui parut assez étrange. Après le dîner, elle s’approcha de la fenêtre avec une certaine inquiétude, mais l’officier n’y était plus, et elle l’oublia...
Deux ou trois jours plus tard72, sortant avec la comtesse pour monter en voiture, elle le revit. Il se tenait tout près du perron, le visage caché par un col de castor ; ses yeux noirs étincelaient sous son chapeau. Lizavéta Ivanovna eut peur sans savoir elle-même de quoi, et monta dans la voiture avec un frémissement73 indéfinissable.
De retour à la maison, elle courut à la fenêtre : l’officier se tenait à la même place, les yeux dirigés74 sur elle : elle recula, torturée par la curiosité et troublée par un sentiment tout nouveau pour elle.
Depuis lors, il ne se passa pas de jour sans que le jeune officier ne parût sous les fenêtres de l’hôtel à heure fixe. Des rapports tacites s’établirent entre elle et lui. Assise à sa place à travailler, elle sentait qu’il approchait, elle levait la tête et le regardait chaque jour un peu plus longuement. Le jeune homme semblait lui en être reconnaissant : elle voyait avec le regard aigu de la jeunesse une vive rougeur monter à ses joues pâles chaque fois que leurs regards se rencontraient. Au bout d’une semaine, elle lui sourit...
Lorsque Tomski avait demandé à la comtesse la permission de lui présenter son camarade, le cœur de la pauvre jeune fille s’était mis à battre bien fort. Mais en apprenant que Naroumov n’était pas du génie, que c’était un garde à cheval, elle avait regretté par cette question indiscrète d’avoir dévoilé son secret à cet étourdi de Tomski75.