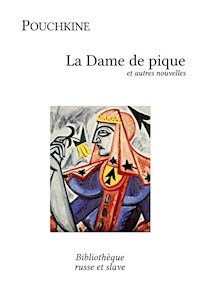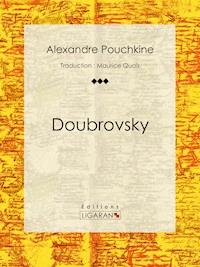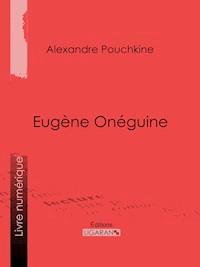Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
La Fille du capitaine ( Kapitanskaïa dotchka) est un roman publié par Alexandre Pouchkine en 1836. Se déroulant au XVIIIe siècle, principalement dans les steppes situées au sud de l'Oural, il a pour thème les aventures et les amours de deux jeunes gens pris dans la tourmente de la révolte d'Emelian Pougatchev. La Fille du capitaine est considéré comme l'un des premiers chefs d'oeuvre de la littérature russe1.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Fille du Capitaine
Pages de titreCHAPITRE II – LE GUIDECHAPITRE III – LA FORTERESSECHAPITRE IV – LE DUELCHAPITRE V – LA CONVALESCENCECHAPITRE VI – POUGATCHEFFCHAPITRE VII – L’ASSAUTCHAPITRE IX – LA SÉPARATIONCHAPITRE X – LE SIÈGECHAPITRE XII – L’ORPHELINECHAPITRE XIII – L’ARRESTATIONCHAPITRE XIV – LE JUGEMENTPage de copyright1
La Fille du Capitaine
Alexandre Pouchkine
2
CHAPITRE I – LE SERGENT AUX GARDES
Mon père, André Pétrovitch Grineff, après avoir servi dans sa
jeunesse sous le comte Munich, avait quitté l’état militaire en 17…
avec le grade de premier major. Depuis ce temps, il avait
constamment habité sa terre du gouvernement de Simbirsk, où il
épousa Mlle Avdotia, 1ere fille d’un pauvre gentilhomme du
voisinage. Des neuf enfants issus de cette union, je survécus seul ;
tous mes frères et sœurs moururent en bas âge. J’avais été inscrit
comme sergent dans le régiment Séménofski par la faveur du major
de la garde, le prince B…, notre proche parent. Je fus censé être en
congé jusqu’à la fin de mon éducation. Alors on nous élevait
autrement qu’aujourd’hui. Dès l’âge de cinq ans je fus confié au
piqueur Savéliitch, que sa sobriété avait rendu digne de devenir mon
menin. Grâce à ses soins, vers l’âge de douze ans je savais lire et
écrire, et pouvais apprécier avec certitude les qualités d’un lévrier de
chasse. À cette époque, pour achever de m’instruire, mon père prit à
gages un Français, M. Beaupré, qu’on fit venir de Moscou avec la
provision annuelle de vin et d’huile de Provence. Son arrivée déplut
fort à Savéliitch. « Il semble, grâce à Dieu, murmurait-il, que l’enfant
était lavé, peigné et nourri. Où avait-on besoin de dépenser de
l’argent et de louer un moussié, comme s’il n’y avait pas assez de
domestiques dans la maison ? »
Beaupré, dans sa patrie, avait été coiffeur, puis soldat en Prusse,
puis il était venu en Russie pour être outchitel, sans trop savoir la
signification de ce mot. C’était un bon garçon, mais étonnamment
distrait et étourdi. Il n’était pas, suivant son expression, ennemi de la
bouteille, c’est-à-dire, pour parler à la russe, qu’il aimait à boire.
3
Mais, comme on ne présentait chez nous le vin qu’à table, et
encore par petits verres, et que, de plus, dans ces occasions, on
passait l’outchitel, mon Beaupré s’habitua bien vite à l’eau-de-vie
russe, et finit même par la préférer à tous les vins de son pays,
comme bien plus stomachique. Nous devînmes de grands amis, et
quoique, d’après le contrat, il se fût engagé à m’apprendre le
français, l’allemand et toutes les sciences, il aima mieux apprendre
de moi à babiller le russe tant bien que mal. Chacun de nous
s’occupait de ses affaires ; notre amitié était inaltérable, et je ne
désirais pas d’autre mentor. Mais le destin nous sépara bientôt, et ce
fut à la suite d’un événement que je vais raconter.
Quelqu’un raconta en riant à ma mère que Beaupré s’enivrait
constamment. Ma mère n’aimait pas à plaisanter sur ce chapitre ; elle
se plaignit à son tour à mon père, lequel, en homme expéditif, manda
aussitôt cette canaille de Français. On lui répondit humblement que
le moussié me donnait une leçon. Mon père accourut dans ma
chambre. Beaupré dormait sur son lit du sommeil de l’innocence. De
mon côté, j’étais livré à une occupation très intéressante. On m’avait
fait venir de Moscou une carte de géographie, qui pendait contre le
mur sans qu’on s’en servît, et qui me tentait depuis longtemps par la
largeur et la solidité de son papier. J’avais décidé d’en faire un cerf-
volant, et, profitant du sommeil de Beaupré, je m’étais mis à
l’ouvrage. Mon père entra dans l’instant même où j’attachais une
queue au cap de Bonne-Espérance. À la vue de mes travaux
géographiques, il me secoua rudement par l’oreille, s’élança près du
lit de Beaupré, et, réveillant sans précaution, il commença à
l’accabler de reproches.
Dans son trouble, Beaupré voulut vainement se lever ; le pauvre
outchitel était ivre mort. Mon père le souleva par le collet de son
habit, le jeta hors de la chambre et le chassa le même jour, à la joie
inexprimable de Savéliitch. C’est ainsi que se termina mon
éducation.
Je vivais en fils de famille (nédorossl), m’amusant à faire
tourbillonner les pigeons sur les toits et jouant au cheval fondu avec
les jeunes garçons de la cour. J’arrivai ainsi jusqu’au-delà de seize
ans. Mais à cet âge ma vie subit un grand changement.
4
Un jour d’automne, ma mère préparait dans son salon des
confitures au miel, et moi, tout en me léchant les lèvres, je regardais
le bouillonnement de la liqueur. Mon père, assis pris de la fenêtre,
venait d’ouvrir l’Almanach de la cour, qu’il recevait chaque année.
Ce livre exerçait sur lui une grande influence ; il ne le lisait qu’avec
une extrême attention, et cette lecture avait le don de lui remuer
prodigieusement la bile. Ma mère, Qui savait par cœur ses habitudes
et ses bizarreries, tâchait de cacher si bien le malheureux livre, que
des mois entiers se passaient sans que l’Almanach de la cour lui
tombât sous les yeux. En revanche, quand il lui arrivait de le trouver,
il ne le lâchait plus durant des heures entières. Ainsi donc mon père
lisait l’Almanach de la cour en haussant fréquemment les épaules et
en murmurant à demi-voix : « Général !… il a été sergent dans ma
compagnie. Chevalier des ordres de la Russie !… y a-t-il si
longtemps que nous… ? » Finalement mon père lança l’Almanach
loin de lui sur le sofa et resta plongé dans une méditation profonde,
ce qui ne présageait jamais rien de bon.
« Avdotia Vassiliéva, dit-il brusquement en s’adressant à ma mère,
quel âge a Pétroucha ?
— Sa dix-septième petite année vient de commencer, répondit ma
mère.
Pétroucha est né la même année que notre tante Nastasia
Garasimovna a perdu un œil, et que…
— Bien, bien, reprit mon père ; il est temps de le mettre au
service. »
La pensée d’une séparation prochaine fit sur ma mère une telle
impression qu’elle laissa tomber sa cuiller dans sa casserole, et des
larmes coulèrent de ses yeux. Quant à moi, il est difficile d’exprimer
la joie qui me saisit. L’idée du service se confondait dans ma tête
avec celle de la liberté et des plaisirs qu’offre la ville de Saint-
Pétersbourg. Je me voyais déjà officier de la garde, ce qui, dans mon
opinion, était le comble de la félicité humaine.
Mon père n’aimait ni à changer ses plans, ni à en remettre
l’exécution. Le jour de mon départ fut à l’instant fixé. La veille, mon
père m’annonça qu’il allait me donner une lettre pour non chef futur,
et me demanda du papier et des plumes.
5
« N’oublie pas, André Pétrovitch, dit ma mère, de saluer de ma
part le prince B… ; dis-lui que j’espère qu’il ne refusera pas ses
grâces à mon Pétroucha.
— Quelle bêtise ! s’écria mon père en fronçant le sourcil ;
pourquoi veux-tu que j’écrive au prince B… ?
— Mais tu viens d’annoncer que tu daignes écrire au chef de
Pétroucha.
— Eh bien ! quoi ?
— Mais le chef de Pétroucha est le prince B… Tu sais bien qu’il
est inscrit au régiment Séménofski.
— Inscrit ! qu’est-ce que cela me fait qu’il soit inscrit ou non ?
Pétroucha n’ira pas à Pétersbourg. Qu’y apprendrait-il ? à dépenser
de l’argent et à faire des folies.
Non, qu’il serve à l’armée, qu’il flaire la poudre, qu’il devienne
un soldat et non pas un fainéant de la garde, qu’il use les courroies de
son sac. Où est son brevet ? donne-le-moi. »
Ma mère alla prendre mon brevet, qu’elle gardait dans une
cassette avec la chemise que j’avais portée à mon baptême, et le
présenta à mon père d’une main tremblante. Mon père le lut avec
attention, le posa devant lui sur la table et commença sa lettre.
La curiosité me talonnait. « Où m’envoie-t-on, pensais-je, si ce
n’est pas à Pétersbourg ? » Je ne quittai pas des yeux la plume de
mon père, qui cheminait lentement sur le papier. Il termina enfin sa
lettre, la mit avec mon brevet sous le même couvert, ôta ses lunettes,
n’appela et me dit : « Cette lettre est adressée à André Kinlovitch
R…, mon vieux camarade et ami. Tu vas à Orenbourg pour servir
sous ses ordres. »
Toutes mes brillantes espérances étaient donc évanouies. Au lieu
de la vie gaie et animée de Pétersbourg, c’était l’ennui qui
m’attendait dans une contrée lointaine et sauvage. Le service
militaire, auquel, un instant plus tôt, je pensais avec délices, me
semblait une calamité. Mais il n’y avait qu’à se soumettre. Le
lendemain matin, une kibitka de voyage fut amenée devant le perron.
On y plaça une malle, une cassette avec un service à thé et des
serviettes nouées pleines de petits pains et de petits pâtés, derniers
restes des dorloteries de la maison paternelle. Mes parents me
6
donnèrent leur bénédiction, et mon père me dit : « Adieu, Pierre ;
sers avec fidélité celui à qui tu as prêté serment ; obéis à tes chefs ;
ne recherche pas trop leurs caresses ; ne sollicite pas trop le service,
mais ne le refuse pas non plus, et rappelle-toi le proverbe : Prends
soin de ton habit pendant qu’il est neuf, et de ton honneur pendant
qu’il est jeune. »
Ma mère, tout en larmes, me recommanda de veiller à ma santé, et
à Savéliitch d’avoir bien soin du petit enfant. On me mit sur le corps
un court touloup de peau de lièvre, et, par-dessus, une grande pelisse
en peau de renard. Je m’assis dans la kibitka avec Savéliitch, et partis
-pour ma destination en pleurant amèrement.
J’arrivai dans la nuit à Sirabirsk, où je devais rester vingt-quatre
heures pour diverses emplettes confiées à Savéliitch. Je m’étais arrêté
dans une auberge, tandis que, dès le matin, Savéliitch avait été courir
les boutiques. Ennuyé de regarder par les fenêtres sur une ruelle sale,
je me mis à errer par les chambres de l’auberge. J’entrai dans la pièce
du billard et j’y trouvai un grand monsieur d’une quarantaine
d’années, portant de longues moustaches noires, en robe de chambre,
une queue à la main et une pipe à la bouche. Il jouait avec le
marqueur, qui buvait un verre d’eau-de-vie s’il gagnait, et, s’il
perdait, devait passer sous le billard à quatre pattes. Je me mis à les
regarder jouer ; plus leurs parties se prolongeaient, et plus les
promenades à quatre pattes devenaient fréquentes, si bien qu’enfin le
marqueur resta sous le billard. Le monsieur prononça sur lui
quelques expressions énergiques, en guise d’oraison funèbre, et me
proposa de jouer une partie avec lui. Je répondis que je ne savais pas
jouer au billard. Cela lui parut sans doute fort étrange. Il me regarda
avec une sorte de commisération. Cependant l’entretien s’établit.
J’appris qu’il se nommait Ivan Ivanovitch Zourine, qu’il était chef
d’escadron dans les hussards ***, qu’il se trouvait alors à Simbirsk
pour recevoir des recrues, et qu’il avait pris son gîte à la même
auberge que moi. Zourine m’invita à dîner avec lui, à la soldat, et,
comme on dit, de ce que Dieu nous envoie.
J’acceptai avec plaisir ; nous nous mîmes à table ; Zourine buvait
beaucoup et m’invitait à boire, en me disant qu’il fallait m’habituer
au service. Il me racontait des anecdotes de garnison qui me faisaient
7
rire à me tenir les côtes, et nous nous levâmes de table devenus amis
intimes. Alors il me proposa de m’apprendre à jouer au billard.
« C’est, dit-il, indispensable pour des soldats comme nous. Je
suppose, par exemple, qu’on arrive dans une petite bourgade ; que
veux-tu qu’on y fasse ? On ne peut pas toujours rosser les juifs. Il
faut bien, en définitive, aller à l’auberge et jouer au billard, et pour
jouer il faut savoir jouer. » Ces raisons me convainquirent
complètement, et je me mis à prendre ma leçon avec beaucoup
d’ardeur. Zourine m’encourageait à haute voix ; il s’étonnait de mes
progrès rapides, et, après quelques leçons, il me proposa de jouer de
l’argent, ne fût-ce qu’une groch (2 kopeks), non pour le gain, mais
pour ne pas jouer pour rien, ce qui était, d’après lui, une fort
mauvaise habitude. J’y consentis, et Zourine fit apporter du punch ;
puis il me conseilla d’en goûter, répétant toujours qu’il fallait
m’habituer au service. « Car, ajouta-t-il, quel service est-ce qu’un
service sans punch ? » Je suivis son conseil. Nous continuâmes à
jouer, et plus je goûtais de mon verre, plus je devenais hardi. Je
faisais voler les billes par-dessus les bandes, je me fâchais, je disais
des impertinences au marqueur qui comptait les points, Dieu sait
comment ; j’élevais l’enjeu, enfin je me conduisais comme un petit
garçon qui vient de prendre la clef des champs. De cette façon, le
temps passa très vite. Enfin Zourine jeta un regard sur l’horloge, posa
sa queue et me déclara que j’avais perdu cent roubles. Cela me rendit
fort confus ; mon argent se trouvait dans les mains de Savéliitch.
Je commençais à marmotter des excuses quand Zourine me dit
« Mais, mon Dieu, ne t’inquiète pas ; je puis attendre ».
Nous soupâmes. Zourine ne cessait de me verser à boire, disant
toujours qu’il fallait m’habituer au service. En me levant de table, je
me tenais à peine sur mes jambes. Zourine me conduisit à ma
chambre.
Savéliitch arriva sur ces entrefaites. Il poussa un cri quand il
aperçut les indices irrécusables de mon zèle pour le service.
« Que t’est-il arrivé ? me dit-il d’une voix lamentable. Où t’es-tu
rempli comme un sac ? Ô mon Dieu ! jamais un pareil malheur
n’était encore arrivé.
— Tais-toi, vieux hibou, lui répondis-je en bégayant ; je suis sûr
8
que tu es ivre. Va dormir, … mais, avant, couche-moi. »
Le lendemain, je m’éveillai avec un grand mal de tète. Je me
rappelais confusément les événements de la veille. Mes méditations
furent interrompues par Savéliitch, qui entrait dans ma chambre avec
une tasse de thé. « Tu commences de bonne heure à t’en donner,
Piôtr Andréitch, me dit-il en branlant la tête. Eh ! de qui tiens-tu ? Il
me semble que ni ton père ni ton grand-père n’étaient des ivrognes. Il
n’y a pas à parler de ta mère, elle n’a rien daigné prendre dans sa
bouche depuis sa naissance, excepté du kvass. À qui donc la faute ?
au maudit moussié : il t’a appris de belles choses, ce fils de chien, et
c’était bien la peine de faire d’un païen ton menin, comme si notre
seigneur n’avait pas eu assez de ses propres gens ! » J’avais honte ; je
me retournai et lui dis : « Va-t’en, Savéliitch, je ne veux pas de thé ».
Mais il était difficile de calmer Savéliitch une fois qu’il s’était mis en
train de sermonner.
« Vois-tu, vois-tu, Piôtr Andréitch, ce que c’est que de faire des
folies ? Tu as mal à la tête, tu ne veux rien prendre. Un homme qui
s’enivre n’est bon à rien. Bois un peu de saumure de concombres
avec du miel, ou bien un demi-verre d’eau-de-vie, pour te dégriser.
Qu’en dis-tu ? »
Dans ce moment entra un petit garçon qui m’apportait un billet de
la part de Zourine. Je le dépliai et lus ce qui suit :
« Cher Piôtr Andréitch, fais-moi le plaisir de m’envoyer, par mon
garçon, les cent roubles que tu as perdus hier. J’ai horriblement
besoin d’argent.
Ton dévoué,
« Ivan Zourine »
Il n’y avait rien à faire. Je donnai à mon visage une expression
d’indifférence, et, m’adressant à Savéliitch, je lui commandai de
remettre cent roubles au petit garçon.
« Comment ? pourquoi ? me demanda-t-il tout surpris.
— Je les lui dois, répondis-je aussi froidement que possible.
— Tu les lui dois ? repartit Savéliitch, dont l’étonnement
redoublait. Quand donc as-tu eu le temps de contracter une pareille
dette ? C’est impossible. Fais ce que tu veux, seigneur, mais je ne
donnerai pas cet argent. »
9
Je me dis alors que si, dans ce moment décisif, je ne forçais pas ce
vieillard obstiné à m’obéir, il me serait difficile dans la suite
d’échapper à sa tutelle. Lui jetant un regard hautain, je lui dis : « Je
suis ton maître, tu es mon domestique. L’argent est à moi ; je l’ai
perdu parce que j’ai voulu le perdre. Je te conseille, de ne pas faire
l’esprit fort et d’obéir quand on te commande. »
Mes paroles firent une impression si profonde sur Savéliitch, qu’il
frappa des mains, et resta muet, immobile. « Que fais-tu là comme un
pieu ? » m’écriai-je avec colère. Savéliitch se mit à pleurer. « Ô mon
père Piôtr Andréitch, balbutia-t-il d’une voix tremblante, ne me fais
pas mourir de douleur. Ô ma lumière, écoute-moi, moi vieillard ;
écris à ce brigand que tu n’as fait que plaisanter, que nous n’avons
jamais eu tant d’argent. Cent roubles ! Dieu de bonté !… Dis-lui que
tes parents t’ont sévèrement défendu de jouer autre chose que des
noisettes.
— Te tairas-tu ? lui dis-je en l’interrompant avec sévérité ; donne
l’argent ou je te chasse d’ici à coups de poing. » Savéliitch me
regarda avec une profonds expression de douleur, et alla chercher
mon argent. J’avais pitié du pauvre vieillard ; mais je voulais
m’émanciper et prouver que je n’étais pas un enfant. Zourine eut ses
cent roubles. Savéliitch s’empressa de me faire quitter la maudite
auberge ; il entra en m’annonçant que les chevaux étaient attelés. Je
partis de Simbirsk avec une conscience inquiète et des remords
silencieux, sans prendre congé de mon maître et sans penser que je
dusse le revoir jamais.
10
CHAPITRE II – LE GUIDE
Mes réflexions pendant le voyage n’étaient pas très agréables.
D’après la valeur de l’argent à cette époque, ma perte était de
quelque importance. Je ne pouvais m’empêcher de convenir avec
moi-même que ma conduite à l’auberge de Simbirsk avait été des
plus sottes, et je me sentais coupable envers Savéliitch. Tout cela me
tourmentait. Le vieillard se tenait assis, dans un silence morne, sur le
devant du traîneau, en détournant la tête et en faisant entendre de loin
en loin une toux de mauvaise humeur. J’avais fermement résolu de
faire ma paix avec lui ; mais je ne savais par où commencer. Enfin je
lui dis : « Voyons, voyons, Savéliitch, finissons-en, faisons la paix. Je
reconnais moi-même que je suis fautif. J’ai fait hier des bêtises et je
t’ai offensé sans raison. Je te promets d’être plus sage à l’avenir et de
le mieux écouter. Voyons, ne te fâche plus, faisons la paix.
— Ah ! mon père Piotr Andréitch, me répondit-il avec un profond
soupir, je suis fâché contre moi-même, c’est moi qui ai tort par tous
les bouts. Comment ai-je pu te laisser seul dans l’auberge ? Mais que
faire ? Le diable s’en est mêlé. L’idée m’est venue d’aller voir la
femme du diacre qui est ma commère, et voilà, comme dit le
proverbe : j’ai quitté la maison et suis tombé dans la prison. Quel
malheur ! quel malheur ! Comment reparaître aux yeux de mes
maîtres ? Que diront-ils quand ils sauront que leur enfant est buveur
et joueur ? »
Pour consoler le pauvre Savéliitch, je lui donnai ma parole qu’à
l’avenir je ne disposerais pas d’un seul kopek sans son consentement.
Il se calma peu à peu, ce qui ne l’empêcha point cependant de
grommeler encore de temps en temps en branlant la tête : « Cent
11
roubles ! c’est facile à dire ».
J’approchais du lieu de ma destination.
Autour de moi s’étendait un désert triste et sauvage, entrecoupé de
petites collines et de ravins profonds. Tout était couvert de neige. Le
soleil se couchait. Ma kibitka suivait l’étroit chemin, ou plutôt la
trace qu’avaient laissée les traîneaux de paysans. Tout à coup mon
cocher jeta les yeux de côté, et s’adressant à moi : « Seigneur, dit-il
en ôtant son bonnet, n’ordonnes-tu pas de retourner en arrière ?
— Pourquoi cela ?
— Le temps n’est pas sûr. Il fait déjà un petit vent. Vois-tu comme
il roule la neige du dessus ?
— Eh bien ! qu’est-ce que cela fait ?
— Et vois-tu ce qu’il y a là-bas ? (Le cocher montrait avec son
fouet le côté de l’orient.)
— Je ne vois rien de plus que la steppe blanche et le ciel serein.
— Là, là, regarde… ce petit nuage. »
J’aperçus, en effet, sur l’horizon un petit nuage blanc que j’avais
pris d’abord pour une colline éloignée. Mon cocher m’expliqua que
ce petit nuage présageait un bourane.
J’avais ouï parler des chasse-neige de ces contrées, et je savais
qu’ils engloutissent quelquefois des caravanes entières. Savéliitch,
d’accord avec le cocher, me conseillait de revenir sur nos pas. Mais
le vent ne me parut pas fort ; j’avais l’espérance d’arriver à temps au
prochain relais : j’ordonnai donc de redoubler de vitesse.
Le cocher mit ses chevaux au galop ; mais il regardait sans cesse
du côté de l’orient. Cependant le vent soufflait de plus en plus fort.
Le petit nuage devint bientôt une grande nuée blanche qui s’élevait
lourdement, croissait, s’étendait, et qui finit par envahir le ciel tout
entier.
Une neige fine commença à tomber et tout à coup se précipita à
gros flocons. Le vont se mit à siffler, à hurler. C’était un chasse-
neige. En un instant le ciel sombre se confondit avec la mer de neige
que le vent soulevait de terre. Tout disparut. « Malheur à nous,
seigneur ! s’écria le cocher ; c’est un bourane. »
Je passai la tête hors de la kibitka ; tout était obscurité et
tourbillon. Le vent soufflait avec une expression tellement féroce,
12
qu’il semblait en être animé. La neige s’amoncelait sur nous et nous
couvrait. Les chevaux allaient au pas, et ils s’arrêtèrent bientôt.
« Pourquoi n’avances-tu pas ? dis-je au cocher avec impatience.
— Mais où avancer ? répondit-il en descendant du traîneau. Dieu
seul sait où nous sommes maintenant. Il n’y a plus de chemin et tout
est sombre. »
Je me mis à le gronder, mais Savéliitch prit sa défense.
« Pourquoi ne l’avoir pas écouté ? me dit-il avec colère. Tu serais
retourné au relais ; tu aurais pris du thé ; tu aurais dormi jusqu’au
matin ; l’orage se serait calmé et nous serions partis. Et pourquoi tant
de hâte ? Si c’était pour aller se marier, passe. »
Savéliitch avait raison. Qu’y avait-il à faire ? La neige continuait
de tomber ; un amas se formait autour de la kibitka. Les chevaux se
tenaient immobiles, la tête baissée, et tressaillaient de temps en
temps. Le cocher marchait autour d’eux, rajustant leur harnais,
comme s’il n’eût eu autre chose à faire. Savéliitch grondait. Je
regardais de tous côtés, dans l’espérance d’apercevoir quelque indice
d’habitation ou de chemin ; mais je ne pouvais voir que le
tourbillonnement confus du chasse-neige… Tout à coup je crus
distinguer quelque chose de noir.
« Holà ! cocher, m’écriai-je, qu’y a-t-il de noir là-bas ? »
Le cocher se mit à regarder attentivement du côté que j’indiquais.
« Dieu le sait, seigneur, me répondit-il en reprenant son siège ; ce
n’est pas un arbre, et il me semble que cela se meut. Ce doit être un
loup ou un homme. »
Je lui donnai l’ordre de se diriger sur l’objet inconnu, qui vint