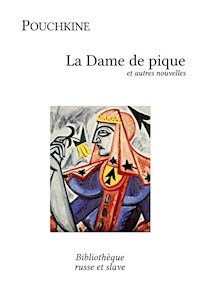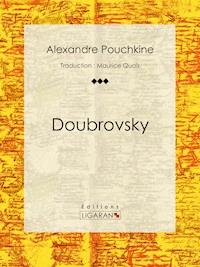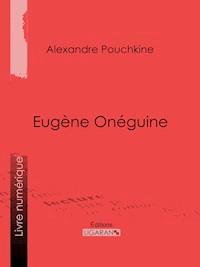Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliothèque russe et slave
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Poète de génie, Alexandre Pouchkine prétendait pourtant que la poésie est une bagatelle, et attachait une importance première à la prose.
Les Récits de Bielkine furent écrits - en même temps que
Les Petites Tragédies,
La fin d'Eugène Oniéguine et de nombreux poèmes - lors d'une période créatrice extraordinairement fertile, durant l'automne de 1830, « l'automne de Boldino ». Ces nouvelles constituent selon Vladimir Nabokov « les premières nouvelles en langue russe d'une valeur esthétique permanente ». Étalon d'une prose limpide, mélodieuse et captivante, elles sont aussi d'une extrême densité poétique. Chacune peut-être lue au premier degré, comme un drame miniature achevé ; chacune s'inscrit aussi dans un ensemble ironique aux significations multiples, un jeu avec les conventions, les genres et les clichés littéraires. L'alliance paradoxale d'une rigueur classique et d'une polysémie presque post-moderne rend cette œuvre impérissable. Cette nouvelle traduction rend accessible au lecteur français l'harmonie formelle de cette prose autant que la diversité des échos et des références qui s'y enchevêtrent.
Traduction intégrale des cinq
Récits (
Le coup de feu,
La tempête de neige,
Le marchand de cercueils,
Le maître de poste,
La demoiselle-paysanne) par Pierre Skorov, 2009.
EXTRAIT
Nous avions nos quartiers dans la bourgade de ***. On sait ce qu’est la vie d’un officier de garnison. Le matin : exercice, manège ; repas chez le commandant du régiment ou dans une auberge juive ; le soir : punch et cartes. À ***, il n’y avait pas une maison où l’on tînt salon, pas une jeune fille à marier. Nous nous réunissions les uns chez les autres, et nous n’y voyions rien que nos uniformes.
Un homme seulement appartenait à notre société sans être militaire. Il avait près de trente-cinq ans, ce qui en faisait à nos yeux un vieillard. L’expérience lui donnait sur nous maints avantages ; du reste son air habituellement taciturne, son caractère rude et sa mauvaise langue influençaient fortement nos jeunes esprits. Une sorte de mystère entourait son destin ; il paraissait Russe, mais portait un nom étranger.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Alexandre Sergueïevitch Pouchkine est un poète, dramaturge et romancier russe né à Moscou le 26 mai 1799 et mort à Saint-Pétersbourg le 29 janvier 1837
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE
— LITTÉRATURE RUSSE —
Alexandre Pouchkine
Пушкин Александр Сергеевич
1799 – 1837
RÉCITS DE FEU IVAN PÉTROVITCH BELKINE
Повести покойного Ивана Петровича Белкина
1831
Traduction de Pierre Skorov, 2009.
© La Bibliothèque russe et slave, 2015
© Pierre Skorov, 2009 [Temps et Périodes], 2015
Couverture : Pavel FEDOTOV, La Fiancée capricieuse (1847)
Mme Prostakova :
Eh, mon bon ami, dites-vous bien qu’il
est amateur d’histoires depuis qu’il est tout petit.
Skotinine :
Mitrophane tient de moi.
FONVIZINE, Le Nigaud
Avertissement de l’Éditeur
par Alexandre Pouchkine*
Ayant entrepris de mener à bien la publication des Récits d’I. P. Belkine, que nous proposons aujourd’hui à l’attention du public, nous eussions aimé accompagner ces dernières ne fût-ce que d’une brève biographie du défunt auteur, afin de satisfaire au moins en partie à la légitime curiosité des amateurs de nos belles-lettres. Pour ce faire, nous nous sommes adressés à Maria Alexeïévna Trafilina, la parente la plus proche et l’héritière d’Ivan Pétrovitch Belkine ; mais il lui fut malheureusement impossible de nous informer en rien au sujet du défunt, puisque ce dernier lui était parfaitement inconnu. Elle nous conseilla à cette fin de solliciter un certain homme de mérite, ancien ami d’Ivan Pétrovitch. Nous suivîmes ce conseil et reçûmes à notre requête la réponse souhaitée, ci-dessous reproduite. Nous la citons sans aucune modification ni commentaire, comme un précieux témoignage de nobles opinions et d’une amitié émouvante, et d’autre part, comme une information biographique fort satisfaisante.
Monsieur *** !
Votre bien aimable lettre datée du 15 de ce mois, le 23 du même mois j’ai eu l’avantage de recevoir, dans laquelle vous me faites part de votre désir d’être complètement renseigné au sujet de la date de naissance et de mort, du service, des affaires familiales, ainsi que des occupations et du caractère du défunt Ivan Pétrovitch Belkine, mon feu sincère ami et voisin. C’est avec une grande joie que je satisfais à votre désir et vous communique, monsieur, tout ce que de ses conversations, ainsi que de mes propres observations me rappeler je puis. Ivan Pétrovitch Belkine naquit à une noble et honnête famille en l’an 1798 dans le village de Gorioukhino. Feu son père, le commandant Piotr Ivanovitch Belkine, avait pris pour femme la demoiselle Pélaguéia Gavrilovna, de la lignée des Trafiline. Il n’était pas un homme de grande fortune, mais de besoins modérés, et fort habile pour la chose domestique. Leur fils reçut sa première éducation du sacristain du village. C’est à cet honorable homme qu’il devait, semble-t-il, son inclination à la lecture et aux occupations relatives aux belles-lettres russes. En l’an 1815, il prit du service dans un régiment de chasseurs (dont je ne puis me rappeler le numéro) dans lequel il demeura jusques en l’an 1823. La mort de ses parents, survenue presque en même temps, le contraignit à démissionner et à revenir dans le village de Gorioukhino, son patrimoine.
Ayant pris en main l’administration de ses terres, Ivan Pétrovitch, du fait de son inexpérience et de sa nature miséricordieuse, eut tôt fait de compromettre ses affaires et de gâter l’ordre strict établi par feu son père. Ayant congédié le staroste, qui était consciencieux et adroit et dont les paysans (comme à leur habitude) se plaignaient, il remit la gérance de sa terre à sa vieille ménagère, qui avait gagné sa confiance par son art de conter des histoires. Ladite vieille, qui était sotte, ne sut jamais distinguer un assignat de vingt-cinq roubles d’un assignat de cinquante ; les serfs, dont elle était à tous la marraine, ne la craignaient point ; le staroste qu’ils élurent, lui-même un fripon, leur manifestait une telle indulgence qu’Ivan Pétrovitch se vit obligé d’abolir la corvée et d’établir une taille fort modérée ; mais là encore, profitant de sa faiblesse, les paysans le convainquirent de leur accorder une exemption considérable pour la première année, et les années suivantes payèrent plus des deux tiers de leur redevance en noix, airelles, etc. Même alors, il restait des arrérages.
En qualité d’ami de feu le père d’Ivan Pétrovitch, j’estimai de mon devoir d’offrir également mes conseils à son fils et de me mettre à sa disposition pour rétablir l’ordre précédent, par lui négligé. Pour ce faire, lors d’une visite à lui rendue, j’exigeai les livres de comptes, fis comparaître ce fripon de staroste et, en la présence d’Ivan Pétrovitch, m’attelai à l’étude desdits livres. Le jeune propriétaire me prêta d’abord toute l’attention et toute l’application possible. Mais comme il apparaissait, d’après les comptes, que durant les deux dernières années le nombre de serfs avait augmenté, alors que la quantité de volaille et de bétail avait ostensiblement décru, Ivan Pétrovitch se satisfit de cette première information et ne m’écouta plus. Et au moment même où, par mes investigations et mon sévère interrogatoire, j’avais réussi à confondre tout à fait ce fripon de staroste et à le réduire au silence complet, j’entendis à mon plus grand dépit Ivan Pétrovitch ronfler à grand bruit sur sa chaise. Je cessai dès lors de me mêler de la gérance de sa propriété et — tout comme lui — je remis ses affaires à la bonne grâce du Très-Haut.
Ceci n’altéra nullement, du reste, notre amicale relation, puisque compatissant à sa faiblesse et à la funeste incurie qu’il partageait avec les autres jeunes gens de notre noblesse, je n’en aimais pas moins sincèrement Ivan Pétrovitch. Il était d’ailleurs bien impossible de ne pas avoir d’affection pour un jeune homme si doux et si honnête. Ivan Pétrovitch, de son côté, témoignait de la considération pour mon âge et m’était cordialement dévoué. Jusques à son décès, il continua de me voir presque chaque jour, appréciant l’occasion de discourir simplement avec moi, bien que par nos habitudes, nos opinions et nos caractères, nous divergeassions grandement l’un de l’autre.
Ivan Pétrovitch avait un mode de vie des plus modérés et évitait tous excès ; jamais il ne m’advint de le voir éméché (ce qui dans notre contrée passe légitimement pour un miracle inouï). Pour la gent féminine, il avait une inclination notoire, mais possédait une pudeur véritablement virginale1.
Outre les récits que vous avez bien voulu mentionner dans votre lettre, Ivan Pétrovitch a laissé quantité de manuscrits, dont une partie se trouve en ma possession, et une autre partie a été employée par la ménagère à divers usages domestiques. Ainsi l’hiver dernier, toutes les fenêtres de sa maison furent calfeutrées avec la première partie d’un roman inachevé. Les récits ci-dessus mentionnés furent, semble-t-il, son premier essai. Ils sont, comme avait coutume de dire Ivan Pétrovitch, véridiques pour la plupart et recueillis par lui auprès de diverses personnes2. Toutefois, les noms propres y sont presque tous de sa propre invention, tandis que les noms des hameaux et villages sont pour la plupart empruntés à notre terroir, pour laquelle raison mon village s’y trouve également quelque part mentionné. La cause n’en était point quelque malicieuse pensée, mais uniquement un manque d’imagination.
Ivan Pétrovitch, à l’automne de l’an 1828, prit un coup de froid qui se transforma en fièvre chaude, et mourut en dépit des efforts inlassables de notre médecin de campagne, homme fort adroit, surtout quant au traitement de maladies invétérées comme les cors aux pieds et d’autres maux de ce genre. Il mourut dans mes bras dans sa trentième année, et fut enseveli à l’église du village de Gorioukhino, auprès de feu ses parents.
Ivan Pétrovitch était de taille moyenne, avait les yeux gris, les cheveux blonds, le nez droit ; il avait le visage maigre et le teint blanc.
Voici, très cher monsieur, tout ce dont j’ai pu me souvenir concernant le mode de vie, les occupations, le caractère et l’apparence de feu mon voisin et ami. Cependant, dussiez-vous trouver opportun de faire de cette lettre quelque usage, je vous prie fort humblement de ne point mentionner mon nom ; car bien qu’ayant une grande considération et une grande affection pour les littérateurs, j’estime inutile et inconvenant à mon âge de m’affubler de ce titre. Avec ma plus parfaite considération, etc.
Au village de Nénaradovo, ce 16 novembre 1830.
Estimant de notre devoir de respecter la volonté de l’honorable ami de notre auteur, nous lui exprimons ici notre plus profonde gratitude pour les informations qu’il a bien voulu nous apprendre et espérons que le public en appréciera la sincérité et la candeur.
*. Cette “Note de l’Éditeur” est une parodie des faux lettrés. Pouchkine, avec sa facétie habituelle, y prend pour cible les littérateurs précieux de son époque et fait un pastiche de leur style ampoulé, prétentieux et truffé de lieux communs. La lourdeur de cette préface est en outre destinée à trancher avec l’élégante clarté des “Récits” proprement dits, et souligner par ce contraste que ce prétendu “éditeur” n’a, comme il dit, rien à voir avec ce « Monsieur Belkine », prétendu auteur des récits qui suivent. (N.d.T.)
1. Suit une anecdote que nous omettons, la considérant comme superflue. Du reste, nous pouvons assurer le lecteur qu’elle ne contient rien de répréhensible pour la mémoire d’Ivan Pétrovitch.
2. De fait, le manuscrit de M. Belkine comporte, en tête de chaque récit, une mention faite de la main de l’auteur, de la nature suivante : « Raconté par telle personne » (rang ou poste, suivi des initiales du prénom et du nom). Nous les rapportons à l’intention des exégètes curieux : « Le Maître » fut raconté par le conseiller titulaire A.G.N., « Le coup de feu» par le lieutenant-colonel I.P.L., « Le marchand de cercueils » par le commis B.V., « La tempête de neige» et « La demoiselle » par Mlle K.I.T.
Le coup de feu
Nous nous battîmes.
BARATYNSKII
Je jurai de l’abattre selon les lois du duel (il me devait encore mon coup).
Un soir au bivouac
I
Nous avions nos quartiers dans la bourgade de ***. On sait ce qu’est la vie d’un officier de garnison. Le matin : exercice, manège ; repas chez le commandant du régiment ou dans une auberge juive ; le soir : punch et cartes. À ***, il n’y avait pas une maison où l’on tînt salon, pas une jeune fille à marier. Nous nous réunissions les uns chez les autres, et nous n’y voyions rien que nos uniformes.
Un homme seulement appartenait à notre société sans être militaire. Il avait près de trente-cinq ans, ce qui en faisait à nos yeux un vieillard. L’expérience lui donnait sur nous maints avantages ; du reste son air habituellement taciturne, son caractère rude et sa mauvaise langue influençaient fortement nos jeunes esprits. Une sorte de mystère entourait son destin ; il paraissait Russe, mais portait un nom étranger. Il avait jadis servi dans les hussards, et non sans succès ; nul ne savait ce qui l’avait poussé à démissionner et à s’installer dans cette triste bourgade où il menait un train de vie à la fois frugal et prodigue. Il allait toujours à pied, vêtu d’une redingote noire usée, mais tenait table ouverte pour tous les officiers de notre régiment. À vrai dire, son dîner consistait en deux ou trois plats préparés par un soldat à la retraite, mais le champagne y coulait à flots. Personne ne connaissait l’étendue de sa fortune ni de ses rentes, et personne n’osait lui en poser la question. On trouvait chez lui des livres, surtout des traités militaires et des romans. Il les prêtait volontiers sans jamais les réclamer ; en revanche, il ne rendait jamais à son propriétaire un livre emprunté. Son exercice favori était le tir au pistolet. Les murs de sa chambre étaient rongés par les balles, aussi pleins d’alvéoles que les rayons d’une ruche. Une riche collection de pistolets était le seul luxe de la pauvre masure qu’il habitait. Il était parvenu à une adresse incroyable et, s’il s’était proposé d’abattre une poire posée sur la casquette de quelqu’un, nul dans notre régiment n’eût craint d’y risquer sa tête. Notre conversation avait souvent trait au duel ; Silvio (je l’appellerai ainsi) n’y prenait alors jamais part. Il répondait sèchement à nos questions, qu’il lui était arrivé de se battre, mais ne rentrait point dans les détails, et l’on voyait que de telles questions lui étaient désagréables. Nous supposions qu’il avait sur la conscience quelque malheureuse victime de sa terrible adresse. D’ailleurs, nous ne songions pas même à soupçonner en lui fût-ce un semblant de poltronnerie. Il existe des gens dont le seul aspect écarte de tels soupçons. Un incident imprévu nous stupéfia tous.
Un jour, une dizaine de nos officiers dînaient chez Silvio. Nous buvions comme à l’ordinaire, c’est-à-dire beaucoup. Après le repas, nous insistâmes pour que l’hôte nous tînt une banque. Il refusa longtemps, ne jouant presque jamais ; enfin, il ordonna d’apporter les cartes, jeta sur la table une cinquantaine de pièces d’or et commença de tailler. Nous l’entourâmes et le jeu s’engagea. Silvio avait l’habitude de garder, durant le jeu, un silence absolu, ne discutait pas et ne s’expliquait pas. S’il arrivait à un ponteur de se tromper, il payait aussitôt ce qui manquait ou inscrivait l’excédent. Nous le savions bien, et nous laissions Silvio faire à sa manière ; mais nous avions parmi nous un officier muté depuis peu dans notre régiment. Il jouait avec nous et fit par distraction un paroli de trop. Silvio prit la craie et rétablit le compte selon son habitude. L’officier, pensant qu’il s’était trompé, se lança dans des explications. Silvio continua de tailler sans rien dire. L’officier perdit patience, se saisit de la brosse et effaça ce qu’il croyait inscrit à tort. Silvio prit la craie et l’inscrivit de nouveau. L’officier à qui le vin, le jeu et le rire de ses camarades avaient échauffé l’esprit, se sentit cruellement offensé. Pris de rage, il saisit un chandelier de cuivre sur la table et le lança sur Silvio qui l’esquiva de justesse. Nous étions tous fort embarrassés. Silvio se leva, blême de colère, et dit avec un regard étincelant : « Monsieur, veuillez sortir et remerciez Dieu que cela soit arrivé dans ma maison. »
Nous ne doutions pas des conséquences et considérions notre nouveau camarade comme mort. L’officier sortit en disant qu’il était prêt à répondre de son offense à la convenance de monsieur le banquier. La partie se prolongea encore quelques minutes, mais, sentant que notre hôte n’avait pas l’esprit à jouer, nous quittâmes le jeu un à un et rejoignîmes nos logis, en discutant de l’imminente vacance au régiment.
Le lendemain au manège, nous nous enquérions déjà de savoir si le pauvre lieutenant était toujours en vie, quand il apparut parmi nous en personne ; nous lui posâmes la même question. Il répondit qu’il n’avait eu nulle nouvelle de Silvio. Cela nous étonna. Nous allâmes chez Silvio et nous le trouvâmes dans sa cour, logeant balle sur balle dans l’as collé sur la porte cochère. Il nous reçut comme à son habitude, sans rien dire de l’incident de la veille. Trois jours s’écoulèrent, et le lieutenant était encore en vie. Nous nous demandions avec étonnement : Silvio ne se battra-t-il pas ? Silvio ne se battit pas. Il se satisfit d’une explication superficielle et se réconcilia avec l’offenseur.
Ceci faillit lui nuire considérablement aux yeux des jeunes officiers. Les jeunes gens pardonnent moins que tout le manque de bravoure, car ils y voient d’habitude le sommet du mérite humain et l’excuse à toute sorte de vices. Pourtant, petit à petit tout s’oublia et Silvio retrouva son influence première.