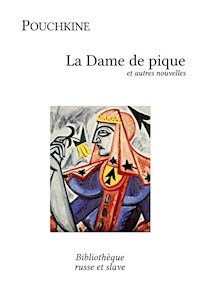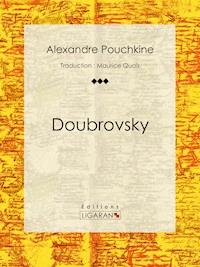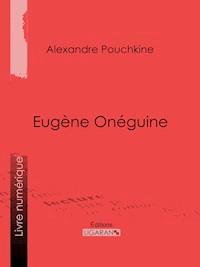Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliothèque russe et slave
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
À dix-sept ans, le jeune Pierre Grineff est envoyé par son père servir dans une forteresse aux confins de l'Oural. Il tombe amoureux de la belle Macha, la fille du capitaine de la garnison, mais à ce moment éclate l'insurrection de l'usurpateur Pougatcheff, qui soulève les paysans et les peuplades des environs contre l'autorité de Catherine II. Roman d'aventures, roman historique,
la Fille du capitaine est le classique des classiques russes par excellence.
Traduction intégrale d'Eugène Séménoff, 1932.
EXTRAIT
Mon père, André Pétrovitch Grineff, avait servi sous les ordres du comte Minich et pris sa retraite en 17.. comme major de première classe. Depuis, il habitait ses terres du gouvernement de Simbirsk. Il avait épousé la fille d’un pauvre gentilhomme, Avdotia Vassilievna J. Nous étions dix enfants. Tous mes frères et sœurs moururent en bas âge. Ma mère me portait encore dans son sein quand je fus inscrit en qualité de sergent au régiment de la garde Séménovsky, grâce au major de la garde, le prince B..., notre proche parent. Si ma mère avait mis au monde une fille, mon père eût déclaré la mort du sergent et l’affaire aurait été liquidée. Je passai pour être en congé jusqu’à la fin de mes études.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Alexandre Sergueïevitch Pouchkine est un poète, dramaturge et romancier russe né à Moscou le 26 mai 1799 et mort à Saint-Pétersbourg le 29 janvier 1837
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE
— LITTÉRATURE RUSSE —
Alexandre Pouchkine
Пушкин Александр Сергеевич
1799 – 1837
LA FILLE DU CAPITAINE
Капитанская дочка
1836
Traduction d’Eugène Séménoff, 1932.
© La Bibliothèque russe et slave, 2015
© Eugène Séménoff, 1932
Couverture : John Everett Millais MILLAIS, The Black Brunswicker (1860)
Chez le même éditeur — Littérature russe
1. GOGOLLes Âmes mortes. Traduction d’Henri Mongault
2. TOURGUENIEVMémoires d’un chasseur. Traduction d’Henri Mongault
3. TOLSTOÏLes Récits de Sébastopol. Traduction de Louis Jousserandot
4. DOSTOÏEVSKIUn joueur. Traduction d’Henri Mongault
5. TOLSTOÏAnna Karénine. Traduction d’Henri Mongault
6. MEREJKOVSKILa Mort des dieux. Julien l’Apostat. Traduction d’Henri Mongault
7. BABELCavalerie rouge. Traduction de Maurice Parijanine
8. KOROLENKOLe Musicien aveugle. Traduction de Zinovy Lvovsky
9. KOUPRINELe Duel. Traduction d’Henri Mongault
10. GOGOLLe Révizor — Le Mariage. Traduction de Marc Semenoff
11. DOSTOÏEVSKIStépantchikovo et ses habitants. Traduction d’Henri Mongault
12. Les Bylines russes — La Geste du Prince Igor. Traductions de Louis Jousserandot et d’Henri Grégoire
13. PISSEMSKIMille âmes. Traduction de Victor Derély
14. RECHETNIKOVCeux de Podlipnaïa. Traduction de Charles Neyroud
15. TOURGUENIEVPoèmes en prose. Traduction de Charles Salomon
16. GONTCHAROVOblomov. Traduction de Jean Leclère
17. GOGOLVeillées d’Ukraine. Traduction d’Eugénie Tchernosvitow
18. DOSTOÏEVSKIMémoires écrits dans un souterrain. Traduction d’Henri Mongault
19. KOUPRINELe Bracelet de grenats — Olessia. Traduction d’Henri Mongault
20. GOGOLTarass Boulba. Traduction de Marc Semenoff
21. LESKOVGens d’Église. Traduction d’Henri Mongault
22. POUCHKINELa Fille du capitaine. Traduction d’Eugène Séménoff
LA FILLE DU CAPITAINE
Veille à l’honneur dès ton jeune âge. (Proverbe.)
CHAPITRE PREMIER
SERGENT DE LA GARDE
Il eût été demain capitaine de la garde.
Non. Qu’il serve comme fantassin...
Fort bien. Il y fera connaissance avec la misère.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mais qui donc est son père ?
KNIAJNINE*.
MON père, André Pétrovitch Grineff, avait servi sous les ordres du comte Minich et pris sa retraite en 17.. comme major de première classe. Depuis, il habitait ses terres du gouvernement de Simbirsk. Il avait épousé la fille d’un pauvre gentilhomme, Avdotia Vassilievna J. Nous étions dix enfants. Tous mes frères et sœurs moururent en bas âge. Ma mère me portait encore dans son sein quand je fus inscrit en qualité de sergent au régiment de la garde Séménovsky, grâce au major de la garde, le prince B..., notre proche parent. Si ma mère avait mis au monde une fille, mon père eût déclaré la mort du sergent et l’affaire aurait été liquidée. Je passai pour être en congé jusqu’à la fin de mes études.
À cette époque, les enfants n’étaient pas élevés comme aujourd’hui. Dès l’âge de cinq ans, je fus confié au palefrenier Savélytch qui, à cause de sa bonne conduite, avait été choisi pour être mon diadka1. Sous sa direction, j’appris à lire et à écrire, ainsi qu’à connaître les lévriers et leurs qualités.
Mon père engagea un second éducateur. C’était un Français. Il s’appelait M. Beaupré. On le fit venir de Moscou en même temps que la commande annuelle de vin et d’huile d’olive. Cette arrivée déplut fort à Savélytch.
« Dieu merci, bougonnait-il, l’enfant — ce me semble — est lavé, peigné, nourri. Pourquoi jeter de l’argent par les fenêtres en s’attachant un moussiou ? »
Beaupré, coiffeur dans son pays, puis soldat en Prusse, était venu en Russie pour y être outchitel2, sans trop savoir ce que ce mot voulait dire.
C’était un brave garçon, mais léger et débauché à l’extrême. Sa plus grande faiblesse résidait dans sa passion pour le beau sexe. Et, souvent, il lui arrivait d’être payé de ses tendresses par des coups qui le faisaient gémir des journées entières. Il n’était pas non plus ennemi de la bouteille, ce qui, en bon russe, signifie qu’il lui arrivait maintes fois de boire bien plus qu’il n’aurait convenu. On ne prenait du vin qu’au dîner et seulement un petit verre qu’on oubliait fréquemment d’offrir au professeur. Alors Beaupré s’accoutuma bien vite au vodka et le préféra même aux vins de sa patrie, comme incomparablement plus sain pour l’estomac. Nous liâmes amitié sur-le-champ. Selon ses engagements, il devait m’enseigner le français, l’allemand et toutes les sciences, mais il aima mieux apprendre, grâce à moi, à baragouiner le russe. Bientôt, chacun de nous ne s’occupa plus que de ses propres affaires.
Nous nous entendions parfaitement. Je ne désirais nullement changer de mentor. Mais le destin nous sépara très vite, et voici comment. La lingère Palachka, grosse fille au visage marqué de variole, et la vachère borgne Akoulka se jetèrent un jour en pleurant aux pieds de ma mère pour avouer leur criminelle faiblesse et porter plainte contre le moussiou qui avait abusé de leur « ingénuité ». Maman ne plaisantait pas sur ce chapitre ; elle en référa à mon père qui, dans ces cas, opérait à la minute et sans pitié.
Il manda immédiatement le coupable. Moussiou me donnait sa « leçon ».
Mon père se rendit alors dans ma chambre. Beaupré dormait d’un sommeil d’innocent. Pour moi, j’étais très affairé. Quelques semaines auparavant, on avait fait venir, de Moscou une carte de géographie. Elle ne m’intéressait que par sa grandeur et la qualité de son papier. Aussi décidai-je de la transformer en cerf-volant ; et, profitant du sommeil de Beaupré, je me mis au travail. Mon père entra juste au moment où j’étais en train d’ajuster une queue de taille au cap de Bonne-Espérance. Devant cet exercice géographique, papa me tira les oreilles, puis courut à Beaupré, le réveilla non sans brusquerie et l’accabla de sanglants reproches. Moussiou, hébété, essaya de se lever, mais ne put y parvenir : le malheureux était ivre-mort. À sept malheurs une seule réponse, dit un vieux proverbe russe. Mon père le saisit par le col et le jeta dehors séance tenante, à l’indescriptible joie de Savélytch.
Mon éducation en resta là. Je vécus en petit sauvage, chassant les pigeons et jouant avec les enfants des serfs à saute-mouton. Mais le moment vint où ma vie changea.
Un jour d’automne, je regardais maman faire de la confiture de miel. L’eau m’en venait à la bouche. Papa lisait près de la fenêtre le Calendrier de la Cour, qui paraît chaque année. Ce livre produisait toujours sur lui la plus désagréable impression. Il ne le parcourait jamais sans s’irriter devant les nouvelles qu’il y apprenait. Cela le rendait aigri, fielleux. Maman, qui connaissait bien ses habitudes, tâchait de cacher le malheureux ouvrage. Mais quand papa le retrouvait, il le lisait des heures entières. Il avait donc le Calendrier de la Cour entre les mains ; il ne cessait de gronder et haussait souvent les épaules : « Lieutenant général !... Il n’était que sergent dans ma compagnie... Décoré des deux ordres russes !... Mais il n’y a pas longtemps que nous... » Mon père jetait enfin le Calendrier sur le canapé et demeurait plongé dans d’amères réflexions. Ce jour-là, brusquement, il dit à maman :
« Avdotia Vassilievna, quel âge a Pétroucha3 ?
— Mais il est dans sa dix-septième année. Pétroucha est né l’année même où tante Anastasie Guérassimovna est devenue borgne, alors que...
— Alors, il est temps qu’il fasse son service. »
La pensée d’une séparation prochaine émut si fort maman qu’elle laissa tomber la cuiller dans la casserole et fondit en larmes. Moi, par contre, je fus ravi. L’idée de service se confondit avec celle de liberté et celle des plaisirs de la vie pétersbourgeoise. Je me voyais déjà officier de la garde, ce qui représentait pour moi le summum du bonheur humain.
Mon père n’aimait pas à revenir sur ses intentions ni en différer la réalisation. Le jour de mon départ fut fixé. La veille, mon père déclara qu’il voulait écrire à mon futur chef et demanda du papier et une plume.
« N’oublie pas, André Pétrovitch, dit ma mère, de saluer de ma part le prince B... et ajoute que j’espère fermement qu’il comblera Pétroucha de ses faveurs.
— Quelle sottise ! répondit mon père en fronçant les sourcils, et pour quel motif écrirais-je au prince B... ?
— Mais, tu viens de dire que tu vas faire une lettre au chef de Pétroucha.
— Alors ?... Ensuite ?...
— Le prince B... n’est-il pas le chef de Pétroucha, puisque tu as inscrit l’enfant au régiment Séménovsky ?
— Inscrit ! Que m’importe qu’il y soit inscrit ! Il n’ira pas à Pétersbourg où il ne pourrait que dépenser de l’argent et faire l’écervelé sans apprendre ce qu’est le service. Non, qu’il soit soldat dans l’armée, qu’on le contraigne à trimer, qu’il fasse connaissance avec la poudre ! Je le veux un soldat et non un chamaton4... Inscrit dans la garde !... Où est son passeport ? donne-le-moi. »
Maman alla le chercher. Elle le gardait dans un petit coffre avec la chemise de mon baptême. D’une main tremblante, elle le remit à mon père. Papa le lut attentivement, le posa devant lui sur la table et se mit à écrire la lettre. La curiosité me torturait. Où serais-je expédié, puisque ce n’était pas à Pétersbourg ? Mes yeux restaient fixés sur la plume de mon père, qui écrivait lentement. Il acheva enfin la lettre, la cacheta après avoir mis le passeport dans l’enveloppe, ôta ses lunettes, puis, m’ayant fait signe d’approcher, dit :
« Voici la lettre pour André Karlovitch R..., mon vieux camarade et ami. Tu iras à Orenbourg et serviras sous ses ordres. »
Ainsi s’évanouirent mes espérances. Au lieu d’une joyeuse vie à Pétersbourg, le destin me réservait un mortel ennui dans un pays triste et lointain. Et le service, que je regardais quelques instants auparavant comme devant me procurer beaucoup de joies, me parut une véritable catastrophe.
Mais il n’y avait pas à discuter.
Dès le lendemain matin, une kibitka5 fut avancée devant le perron. On y avait mis ma grosse valise, une petite cave avec un service à thé et quelques gâteries.
Mes parents me bénirent, et mon père prononça ces paroles :
« Adieu, Piotr. Fais ton service avec toute la fidélité qui est due à ceux auxquels tu auras prêté serment. Obéis à tes chefs, ne recherche point leurs faveurs ; ne montre pas trop de zèle au service, mais sache ne pas éviter les corvées nécessaires, et rappelle-toi le proverbe : « Garde ton vêtement aussi longtemps qu’il peut servir, et veille à l’honneur dès ton jeune âge. »
Maman, tout en larmes, me recommanda de bien faire attention à ma santé, et, à Savélytch, de prendre grand soin de son enfant. On me fit endosser une pelisse en peau de lièvre, puis, par-dessus, une fourrure de renard.
Je montai dans la kibitka avec Savélytch et partis sans pouvoir retenir mes pleurs.
La même nuit, j’atteignis Simbirsk où je devais passer une journée pour faire quelques emplettes indispensables. Je descendis dans une auberge, et Savélytch ne tarda pas à me quitter afin d’acheter ce qui nous manquait. Las de regarder par la fenêtre de ma chambre, et d’où je ne voyais qu’une ruelle assez sale, je me promenai à travers l’auberge. Dans la salle de billard, je vis un homme de grande taille, âgé de trente-cinq ans environ, portant de longues moustaches noires, vêtu d’une robe de chambre, une queue de billard entre les mains et la pipe à la bouche. Il jouait avec le marqueur, lequel, s’il gagnait, recevait un petit verre de vodka ; s’il perdait, marchait à quatre pattes sous le billard. Je les regardai jouer. La promenade à quatre pattes devenait de plus en plus fréquente, si bien que le marqueur finit par rester sous le billard. En guise d’oraison funèbre, son partenaire proféra quelques injures plus fortes les unes que les autres, puis me proposa de faire une partie. Je refusai, alléguant l’ignorance. La raison lui parut bizarre. Il me sembla qu’il me fixait avec pitié. Cependant, nous nous mîmes à causer.
J’appris qu’il se nommait Ivan Ivanovitch Zourine, était capitaine du régiment de hussards N. et se trouvait de passage à Simbirsk, chargé du recrutement. Descendu, lui aussi, à l’auberge, il m’invita à dîner, au hasard de la fourchette, en soldat. Je m’empressai d’accepter. Zourine buvait sec et me forçait à faire de même, disant qu’il fallait « s’habituer au service ». Il me contait des anecdotes militaires extrêmement amusantes. Nous nous levâmes de table tout à fait grands amis. Il s’offrit alors à me donner une leçon de billard.
« Cela est nécessaire, me dit-il, pour nous autres militaires. Ainsi, quand en campagne on arrive dans un village perdu, comment occuper ses loisirs si ce n’est en les passant au café et en jouant au billard ! Il est donc indispensable de connaître ce jeu. »
Je fus si convaincu de la vérité du raisonnement que j’acceptai avec empressement la leçon qu’il voulait bien me donner. La partie commença. Zourine m’encourageait, admirait mon adresse et s’étonnait de mes succès rapides ; puis, après un moment, me proposa de jouer de l’argent :
« Ce sera, me dit-il, un denier la partie, non pour gagner, mais simplement afin de ne pas pousser les billes pour rien, ce qui est, à mon avis, une très mauvaise habitude. »
J’acceptai encore.
Zourine commanda du punch et me persuada d’en prendre, reparlant de la nécessité de « se faire au service » et affirmant que « pas de punch, pas de service ».
Je suivis son conseil.
Cependant, notre jeu continuait. À mesure que je vidais mon verre, je m’excitais davantage. Les billes volaient à tout moment par-dessus bord. Je m’échauffais, m’emportais contre le marqueur qui — Dieu sait comment — comptait les coups ; j’augmentais d’heure en heure l’enjeu. Bref, je me conduisis comme un gamin en liberté pour la première fois. Les heures s’écoulaient sans que j’y prisse garde. Zourine regarda enfin la pendule, posa la queue de billard, et m’annonça que j’avais perdu cent roubles. Je me sentis quelque peu troublé. Savélytch détenait mon argent. Je voulus m’excuser, mais Zourine m’interrompit :
« C’est sans importance. Ne t’inquiète pas. Je sais patienter. En attendant, allons chez Arinouchka6. »
Comment pourrais-je le celer ! J’achevai la journée aussi follement que je l’avais commencée. Nous soupâmes chez Arinouchka. Zourine me versait à boire sans discontinuer : « Il faut s’habituer au service, » ne cessait-il de répéter. Je titubais en me levant de table. À minuit, Zourine me reconduisit à l’auberge. Savélytch nous attendait sur le perron. Il fut stupéfié à la vue des preuves indéniables de mon zèle pour le service.
« Qu’as-tu donc ? me demanda-t-il d’un ton de profond reproche. Où as-tu pu te mettre dans un état pareil ? Mon Dieu ! Jamais de ma vie je n’ai vu une telle abomination.
— Tais-toi, barbon ! articulai-je avec difficulté. Il me semble que tu es ivre ; va te coucher et couche-moi. »
Le lendemain, je me réveillai avec un fort mal de tête. Je tâchais de me rappeler les événements de la veille quand Savélytch entra, m’apportant une tasse de thé.
« Tu commences trop tôt, bien trop tôt à t’amuser, Piotr Andréitch7, me reprocha-t-il en hochant la tête. À qui ressembles-tu donc ? Jamais ton père ni ton grand-père ne se sont enivrés. Quant à ta mère, la question ne se pose même pas : de sa vie, elle n’a pris que du kvass8. Et à qui la faute de ce qui vient d’arriver ? À ce maudit moussiou... Le voilà qui court chez Antipovna : « Madame, je vous prie, « vodka. » Je t’en donnerai du « je vous prie ». C’est bien ça... Ah ! il t’a appris de belles choses, ce fils de chien... Fallait-il vraiment engager comme professeur cet étranger, ce mécréant, comme si le barine9 manquait de gens ! »
J’avais honte. Aussi je lui dis en détournant la tête :
« Va t’en, Savélytch, je ne veux pas de thé. »
Mais il n’était pas facile de faire taire Savélytch quand il avait entamé un sermon.
« Vois-tu, Piotr Andréitch, ce que c’est que la noce ?... Ta tête est lourde ; tu n’as pas d’appétit... Homme qui boit devient une chiffe... Prends donc de la saumure de concombre avec du miel, ou, ce qui serait encore mieux, avale la moitié d’un petit verre d’eau-de-vie. En veux-tu ? »
En ce moment, un jeune chasseur entra et me remit une lettre de J.-J. Zourine. Je la décachetai et lus :
« Cher Piotr Andréiévitch, je te prie de me faire tenir par mon domestique les cent roubles que tu as perdus. J’en ai un besoin urgent. À te servir. J. Zourine. »
Il n’y avait pas à reculer. Aussi, de l’air le plus indifférent, je demandai à Savélytch — qui avait la garde de mon argent comme du linge et de toutes mes affaires — de remettre cent roubles au chasseur.
« Comment ! Pourquoi ? interrogea Savélytch étonné.
— Je les dois, répondis-je aussi froidement que possible.
— Tu les dois ! s’exclama Savélytch encore plus surpris. Mais, depuis quand ? L’affaire me semble bien louche... Tout ce que tu voudras, mais... je ne donnerai pas un kopeck. »
Je compris que si, à cet instant décisif, je ne prenais pas le dessus sur ce vieil obstiné, il me serait bien difficile de m’affranchir jamais de sa tutelle. Je le regardai alors droit dans les yeux et lui dis sèchement :
« Je suis ton maître et toi tu es mon serviteur. L’argent m’appartient. Hier, j’ai perdu cent roubles parce que tel fut mon plaisir, et je te donne le conseil de m’obéir sans discuter. »
Mes paroles produisirent sur Savélytch un effet tel qu’il demeura comme pétrifié.
« Eh bien ! qu’attends-tu ? » criai-je avec colère. Savélytch fondit en larmes.
« Mon petit père Piotr Andréitch, commença-t-il d’une voix tremblante, je mourrai de douleur. Mon petit soleil aimé, écoute-moi. Écris à ce brigand que tu as plaisanté, que nous ne possédons pas une telle somme. Cent roubles, Seigneur miséricordieux ! Tu expliqueras que tes parents t’avaient très sévèrement interdit de jouer à quelque jeu que ce soit, sauf au jeu de noix10...
— Assez de radotages, proférai-je d’un ton dur. Remets l’argent ou je te chasse sur-le-champ. »
Savélytch me regarda avec une profonde tristesse et sortit pour chercher l’argent. J’avais pitié du malheureux. Mais je tenais à montrer mon indépendance et à prouver que je n’étais plus un enfant. Les cent roubles furent comptés.
Savélytch voulut m’éloigner le plus vite possible de cette auberge maudite. Il se hâta de faire atteler les chevaux, et, la conscience troublée, plein d’un repentir muet, je quittai Simbirsk sans prendre congé de mon professeur de billard ni penser que je pourrais le revoir un jour.
*. Auteur dramatique et poète du XVIIIe siècle.
1. Gouverneur.
2. Professeur.
3. Diminutif de Pierre (Piotr).
4. Oisif.
5. Voiture couverte pour les longs voyages.
6. Diminutif d’Hélène.
7. Dans l’intimité, les Russes appellent leur interlocuteur par son prénom et son nom patronymique : Pierre (Piotr) Andréitch (ou Andréiévitch) signifie : Pierre, fils d’André.
8. Boisson nationale non alcoolisée.
9. Seigneur, maître.
10. Jeu populaire russe qui ressemble au jeu de quilles.
CHAPITRE II
LE GUIDE
Mon pays, mon petit coin,
Parages inconnus
Que moi-même ne fréquente plus
Où ma belle monture ne me conduit point,
Mais où ma jeunesse et ma force
Et la griserie des tavernes
Me mènent, moi, brave cœur !...
Vieille chanson.
AU long du chemin, mes méditations, à la vérité, manquaient de gaieté. Ma perte au jeu était assez importante. Et je me trouvais dans l’impossibilité de ne pas m’avouer en mon for intérieur que ma conduite à l’auberge de Simbirsk avait été stupide. De plus, je me sentais coupable envers Savélytch — toutes choses qui me causaient un vif ennui. Le pauvre vieux était assis, morne, sur le bord de la kibitka ; ses yeux se détournaient de moi ; il gardait un silence, coupé de temps en temps par des gémissements. Je tenais absolument à faire la paix avec lui et ne savais comment entamer la conversation. Enfin, je parlai :
« Eh bien ! Savélytch ! Ne boude plus ; réconcilions-nous. Je reconnais ma faute. Je suis coupable sur tous les points, je le comprends. J’ai commis hier des sottises ; je t’ai offensé pour rien. Je te promets de me conduire dorénavant avec plus de sagesse et de t’écouter. Alors, ne sois plus fâché et faisons la paix.
— Ah, petit père Piotr Andréitch ! répondit-il avec un profond soupir, je suis furieux contre moi-même. C’est moi qui suis coupable. Comment ai-je pu te laisser seul à l’auberge ! Que faire ? J’ai commis un péché. J’ai voulu rendre visite à la femme du diacre et voir une vieille amie. Le dicton est bien juste : « Qui entre dans une maison, échoue dans une prison. » C’est un malheur. Comment pourrai-je paraître maintenant devant mes seigneurs ? Que diront-ils en apprenant que l’enfant boit et joue ? »
Pour consoler mon pauvre Savélytch, je lui donnai ma parole qu’à l’avenir je ne disposerais plus d’un seul kopeck sans son consentement. Il se calma peu à peu, mais, par moments, il grommelait : « Cent roubles ! pensez-vous ! »
Nous approchions de la ville où j’allais être soldat. Alentour, s’étendaient de tristes solitudes, coupées de collines et de ravins. Tout était couvert de neige.
Le soleil baissait. La kibitka suivait une route étroite ou plutôt une piste tracée par des traîneaux de paysans. Tout à coup, le iamchtchik11 se mit à observer attentivement un point du ciel ; puis, il ôta son bonnet et, se tournant vers moi, demanda :
« Barine, veux-tu que nous rebroussions chemin ?
— Pourquoi ?
— Le temps n’est pas sûr du tout : le vent se lève ; vois, il commence de balayer la neige.
— Quel obstacle y aurait-il ?
— Regarde là-bas. »
Le iamchtchik dirigea son fouet vers l’Est.
« Je ne vois rien que la steppe blanche et le ciel pur.
— Mais plus loin..., là... ce petit nuage. »
J’aperçus, en effet, à l’extrême horizon, comme une petite vapeur blanche que j’avais prise d’abord pour une colline très lointaine.
Le iamchtchik m’expliqua que le nuage annonçait le bourane12.
J’avais entendu parler des bouranes dans ces steppes et je savais que des caravanes entières de chariots avaient été ensevelies sous la neige. Savélytch, comme le iamchtchik, conseilla de revenir sur nos pas. Il me semblait cependant que le vent ne soufflait pas très fort. J’espérai atteindre avant la bourrasque le relais suivant et donnai l’ordre d’aller plus vite.
Le iamchtchik lança les chevaux bride abattue, tout en continuant de fixer l’Est avec inquiétude. Le vent devenait de plus en plus violent. Le petit nuage se métamorphosait en nuée blanche qui grandissait, grandissait et allait s’étendant sur tout le ciel. Une neige très fine se mit à tomber, qui, presque aussitôt, se changea en gros flocons. Le vent siffla. L’ouragan se déchaîna. En un clin d’œil, le ciel se confondit avec l’immense mer de neige. Toutes choses s’estompèrent et, brusquement, disparurent.
« Ah, barine ! cria le iamchtchik, c’est le bourane. »
Nous étions au milieu de ténèbres où se mouvaient des montagnes de neige. Le vent hurlait avec une rage si grande qu’il semblait animé. Nous étions tout couverts de flocons amoncelés. Les chevaux n’avançaient plus qu’avec une peine à chaque pas plus grande ; bientôt, ils s’arrêtèrent.
« Pourquoi n’essaies-tu pas d’aller plus loin ? criai-je avec impatience au iamchtchik.
— Où irais-je ? répondit-il en descendant de son siège. Il n’est plus possible de se reconnaître ; la route a disparu et la nuit complète nous enveloppe. » Je m’emportai contre lui. Savélytch prit sa défense.
« Quelle mauvaise inspiration de n’avoir pas suivi son conseil ! fit-il d’un ton irrité. Il fallait retourner à l’auberge prendre du thé et y passer la nuit. La tempête aurait pris fin et nous serions repartis. Et, à cette heure, nous sommes dehors, comme des fous ! Si nous allions encore à un mariage !... » Savélytch avait raison. Mais que faire ! La neige continuait de tomber... Les chevaux demeuraient immobiles, la tête baissée, frissonnants.
Le iamchtchik tournait autour de la voiture et s’occupait à vérifier l’attelage. Savélytch grognait contre le temps. Je regardais de tous côtés, espérant apercevoir une ombre d’habitation ou de piste, mais je ne voyais que les tourbillons déments de la tempête. Soudain, il me sembla distinguer au loin une vague silhouette noire.
« Eh ! iamchtchik, quelle est cette tache sombre, là-bas ? »
Il fixa l’horizon.
« Dieu sait, barine, dit-il en remontant sur son siège. Ce n’est pas un chariot... pas un arbre non plus... cela remue, cependant. Ça doit être un loup ou un homme. »
Je lui demandai d’aller vers cet être inconnu, lequel, voyant cela, se dirigea sans hésiter de notre côté. Au bout d’un instant, nous avions un homme devant nous.