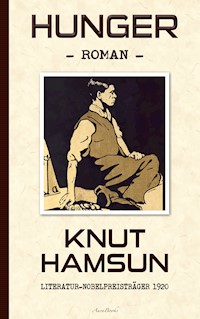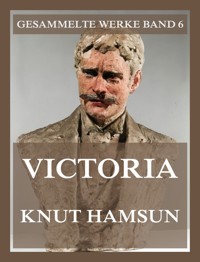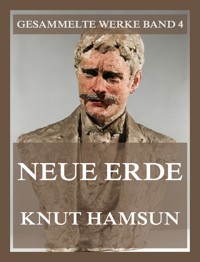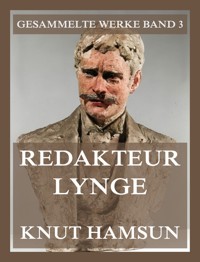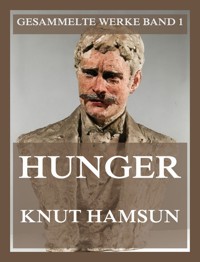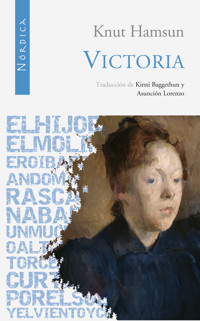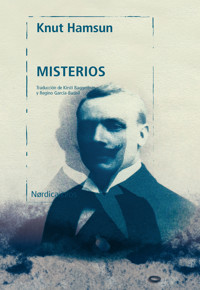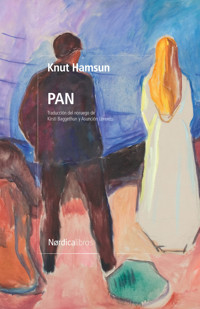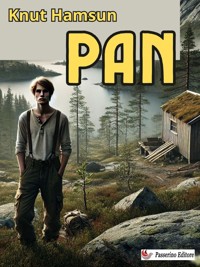0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Passerino
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Faim (en norvégien Sult) est un roman de l'écrivain norvégien
Knut Hamsun, publié dans sa version définitive en 1890, après une parution partielle dans le magazine danois Ny Jord en 1888. Ce roman de la solitude, inspiré de l'expérience de l'auteur avant qu'il ne rencontre le succès, relate à la première personne la vie d'un écrivain qui erre dans les rues de Christiania, tenaillé par la faim qu'il recherche autant qu'il la fuit, et la déchéance physique et mentale qu'il subit en conséquence.
Knud Pedersen, plus connu sous son nom de plume
Knut Hamsun (Knut Hamsund avant 1885), né le 4 août 1859 à Vågå, en Norvège, et mort le 19 février 1952 à Nørholm (en), près de Grimstad, est un écrivain norvégien, lauréat du prix Nobel de littérature en 1920.
Son œuvre, rapprochée de la littérature moderniste, s'oppose au naturalisme pour reconstituer les mécanismes de la pensée. Elle dresse l'éloge d'une nature humaine libérée des contraintes sociales.
Traduit du norvégien par
Georges Sautreau.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Knut Hamsun
La faim
The sky is the limit
table des matières
Introduction
Préface
Première partie
Deuxième partie
Troisième partie
Quatrième partie
Introduction
Je voudrais parler aujourd’hui d’un homme singulièrement doué, d’un personnage original et puissant qui mérite, à tous égards, l’attention des lettrés et des curieux d’âmes peu banales. Il s’appelle Knut Hamsun, et l’éditeur Albert Langen vient de nous révéler une œuvre extraordinaire de ce Norvégien : La Faim.
Extraordinaire, vraiment, et qui ne ressemble à aucune œuvre connue. N’allez pas vous imaginer que ce titre cache un livre de révolte sociale, des prêches ardents, des anathèmes et des revendications. Nullement, La Faim est le roman d’un jeune homme qui a faim, voilà tout, qui passe des jours et des jours sans manger, et qui n’a pas une plainte, et qui n’a pas une haine...
Nul autre drame, nulle autre action, dans ce livre, que la faim. Et, dans ce sujet poignant mais qu’on pourrait croire à la longue monotone, c’est une diversité d’impressions, d’épisodes renouvelés de rencontres dans la rue, de paysages nocturnes, un défilé curieux de figures imprévues, étrangement bizarres, qui font de ce livre une œuvre unique, de premier ordre et qui passionne.
Autobiographie, sûrement.
J’ai là, sous les yeux, la photographie de Knut Hamsun. C’est un homme de forte carrure, de membres vigoureux et souples. Sous des cheveux rudes, impeignés, son front est modelé en coups de pouce énergiques et nets. Son regard est étrange. Dans l’enfoncement de l’orbite, il a des lueurs profondes et sourdes. On sent qu’il a dû connaître bien des spectacles exceptionnels : il a quelque chose de lointain, de voyageur, de nostalgique, comme le regard des marins. La moustache se retrousse, courte et mangée aux bords, sur une lèvre pleine de bonté. Physionomie d’expression double, énergique et tendre, ardente et contenue, pénétrante et voilée, fière et triste et, marquée çà et là aux joues creuses, aux narines pincées et reniflantes, des signes de la souffrance, elle impressionne et retient longtemps l’esprit.
Knut Hamsun n’a que trente-quatre ans, et je crois bien qu’aucune vie ne fut plus aventureuse que la sienne. De bonne heure, elle fut trempée au malheur.
À vingt-deux ans, il quitta la Norvège, chassé par la misère et la faim. Las de lutter, avec un incroyable courage, contre les fatalités qui ne cessaient de l’accabler, désespérant de gagner par le travail un morceau de pain, préservé d’ailleurs par une nature strictement loyale et une indomptable fierté contre les tentations mauvaises, il s’embarqua un beau jour sur un navire qui s’en allait pêcher la morue sur les bancs de Terre-Neuve. Lui-même, dans d’étonnantes pages publiées, il y a un an, par La Revue blanche, il a raconté son existence là-bas...
Il faudrait lire en entier ces courtes et impressionnantes pages, qui ont un autre accent d’humanité frénétique et bestiale que celui de Pêcheurs d’Islande. L’apparition soudaine des grands steamers dans la brume, les hallucinations qu’elle provoque dans la nuit, sont rendues par Knut Hamsun avec une force, une terreur, une grandeur d’expression inconnues de Pierre Loti.
... Après trois ans de cette existence, Knut Hamsun partit pour l’Amérique où, sans ressources, sans appui, sans relations, il se fit ouvrier. Durant trois ans encore, il travailla la terre, gagnant à peine sa vie, réduit aux privations mais n’en souffrant pas, car il avait acquis une force d’endurance extraordinaire. Alors, il rêva de retourner en Norvège. Mais comment faire ? Il n’avait pas d’économies, pas d’argent pour payer son voyage et il était trop fier pour solliciter son rapatriement. D’ailleurs, il n’y songea pas, sans doute. Il put, enfin, se faire accepter comme conducteur de sleeping-car, sur une des grandes lignes d’Amérique. Nourri, logé, suffisamment payé, il put, au bout de quatre ans, réunir des économies assez notables pour entreprendre son voyage de retour et se mettre au travail littéraire dont il avait toujours, en soi, gardé la passion.
Mais quelque temps après son arrivée en Norvège, il fut obligé, je ne sais pour quelle raison, de s’expatrier de nouveau. Et il se réfugia à Paris où, seul, pauvre, ignoré de tous, il poursuivit avec acharnement une des plus belles œuvres de ce temps.
Il faut aimer cet homme ; il faut suivre, avec passion, cet admirable et rare artiste, à la simple image de qui j’ai vu briller la flamme du génie.
O CTAVE M IRBEAU.
Mars 1895.
Préface
On tourne les feuillets de ce livre étrange. Au bout de peu de temps on a des larmes et du sang plein les doigts, plein le cœur. Dans son édition d’avant guerre, je crois que j’avais été l’un des premiers à le lire ; puis aussitôt à le faire admirer autour de moi. L’attention du public à son égard ne commença pourtant de s’éveiller que lorsque Jean-Louis Barrault s’avisa de porter ce vaste soliloque sur la scène ; c’était, si je ne fais erreur, concurremment avec le Hamlet de Laforgue. Je n’étais pas en France à ce moment et garde le très vif regret de n’avoir pu voir notre grand mime assumer paradoxalement un rôle, tout inventé par lui, où il sut, me dit-on ensuite, se montrer admirable. « Inventé » ? Non précisément. Knut Hamsun lui-même n’a rien inventé du tout. C’est là le propre de ce chef-d’œuvre de s’imposer par le seul fait de sa réalité. Aucune histoire, aucune intrigue : au cours du livre rien d’autre ne nous est offert que le lamentable spectacle d’un homme sans cesse sur le point de mourir de faim. La faim est le sujet même du livre avec tous les troubles intellectuels et les déformations morales qu’entraîne une inanition prolongée. C’est moins un héros de roman qu’un cas de clinique. Vais-je oser dire que ceci me gêne un peu ; que cet homme, dès le début, ne soit pas normal ?
Knut Hamsun est parfaitement dans son droit de nous présenter un être bizarre, dont le comportement, même s’il est repu, nous désoriente ; mais alors nous changeons de sujet ; ou, plus précisément, le sujet bifurque : il y a ce qui est dû à la faim et ce qui est dû à un état pathologique, fort intéressant par lui-même, mais qui ne dépend plus de la faim. Sans doute cet effroyable orgueil qui l’entraîne en dépit de tout vers la souffrance, vers l’abnégation gratuite et parfaitement inutile, sans doute tous ces sursauts absurdes de fierté sont-ils de naturelles réactions d’une nature très particulière : ou faut-il admettre que son être même, comme son estomac, reste à ce point façonné par le jeûne, qu’il ne peut rien garder. La réserve physiologique, intellectuelle ou morale, lui est (devenue ?) intolérable. Tout ce qu’il prend ou qu’on lui donne, il le vomit presque aussitôt. De sorte que son amour-propre malade est, de beaucoup, ce qui lui coûte le plus cher à nourrir. Il ne se fait aucun scrupule de profiter de la double sortie d’un immeuble pour ne point payer un fiacre dans lequel il est monté sans raison ; mais prend un macératoire plaisir à jeter à la tête de quelqu’un, à qui il ne doit rien, quantité de couronnes qu’il vient inespérément de recevoir et qui suffiraient à le tirer d’affaire, du moins pour un temps, à lui permettre de travailler en paix. Avons-nous affaire à un fou ? Non ; pas précisément comme dans l’ Inferno de Strindberg ; mais du moins à quelqu’un qu’attire l’abîme et qui reste sans cesse sur le point de s’y précipiter à cœur perdu.
Ah ! combien toute notre littérature paraît, auprès d’un tel livre, raisonnable. Quels gouffres nous environnent de toutes parts, dont nous commençons seulement à entrevoir les profondeurs ! Notre culture méditerranéenne a dressé dans notre esprit des garde-fous, dont nous avons le plus grand mal à secouer enfin les barrières ; et c’est là ce qui permettait à La Bruyère d’écrire, il y a déjà deux siècles de cela : « Tout est dit ». Tandis que devant La Faim on est presque en droit de penser que, jusqu’à présent, presque rien n’est dit, au contraire, et que l’Homme reste à découvrir.
Façon de parler, il va sans dire, et sans doute serait-il bien de préciser : ce qui se déplace lentement ce n’est point tant la limite des connaissances, l’étendue des terræ incognitæ, mais bien plutôt celle de l’ostracisme ; j’allais dire : de la pudeur – ou, si l’on préfère, regardant de l’autre côté de la barrière : de l’obscénité. Il y a des régions humaines qu’il n’est pas décent d’exposer sur la scène ; mais qui n’en existent pas moins. Ces régions « tabou » varient d’époque en époque ; et, durant un long temps, notre littérature, par exemple, se montra beaucoup plus soucieuse d’approfondir que d’élargir notre champ d’investigation. Mais celui-ci varie plus encore de pays à pays. Le Français se montre aujourd’hui beaucoup plus soucieux qu’il n’était au temps de ma jeunesse de porter les yeux non plus constamment sur soi-même : il jette des regards de côté et découvre, parfois avec une surprise un peu naïve, que bien des comportements ne cessent pas d’être humains, pour cesser, en apparence du moins, d’être spécifiquement français ; qu’ils pourraient bien devenir intéressants du jour où lui, Français, commencerait à s’y intéresser. C’est une remarque que je faisais il y a déjà quelque cinquante ans ; de nos jours elle a presque perdu sa raison d’être. La Faim de Knut Hamsun m’invite à y revenir.
A NDRÉ G IDE.
Première partie
C’était au temps où j’errais, la faim au ventre, dans Christiana, cette ville singulière que nul ne quitte avant qu’elle lui ait imprimé sa marque...
Je suis couché dans ma mansarde, éveillé, et j’entends au-dessous de moi une pendule sonner six heures. Il faisait déjà grand jour et les gens commençaient à circuler dans l’escalier. Là-bas, près de la porte, ma chambre était tapissée avec de vieux numéros du Morgenbladet. Je pouvais y voir distinctement un AVIS du directeur des Phares et, un peu à gauche, grasse et rebondie, une annonce de pain frais, de Fabian Olsen, boulanger.
Aussitôt j’ouvris les yeux tout grands et, suivant une vieille habitude, je me mis à réfléchir, cherchant si j’avais aujourd’hui quelque sujet de me réjouir. J’avais été un peu serré dans les derniers temps ; l’un après l’autre, mes effets avaient pris le chemin de « Ma tante », j’étais devenu nerveux et susceptible ; à deux ou trois reprises aussi j’étais resté au lit toute la journée, à cause de vertiges. De temps en temps, quand la chance me souriait, je pouvais à la rigueur toucher cinq couronnes pour un feuilleton dans un journal ou l’autre.
Le jour grandissait et je me mis à lire les annonces là-bas, près de la porte ; je pouvais distinguer jusqu’aux maigres caractères grimaçants de : Suaires, chez Demoiselle Andersen, à droite sous la porte cochère. Cela m’occupa un long moment ; j’entendis la pendule au-dessous sonner huit heures avant de me lever pour m’habiller.
J’ouvris la fenêtre et regardai dehors. D’où j’étais, j’avais vue sur une corde à linge et un terrain vague ; tout au bout, il restait, de l’incendie d’une forge, un foyer éteint que quelques ouvriers étaient en train de déblayer. Je m’accoudai à la fenêtre, et examinai le ciel. Il allait certainement faire une belle journée. L’automne était venu, la saison délicate et fraîche où toutes choses changent de couleur et passent de vie à trépas. Dans les rues le vacarme avait déjà commencé et ce bruit m’attirait dehors. Cette chambre vide dont le plancher ondulait à chaque pas que j’y faisais était pareille à un lugubre cercueil disjoint. Il n’y avait pas de serrure convenable à la porte et pas de poêle dans la chambre ; j’avais coutume de coucher la nuit sur mes chaussettes pour les avoir à peu près sèches le lendemain matin. Le seul objet avec lequel je pusse me distraire était un petit fauteuil rouge, à bascule, où je m’asseyais le soir pour y somnoler en songeant à maintes et maintes choses. Quand le vent soufflait fort et que les portes, au-dessous, étaient ouvertes, toutes sortes de sifflements bizarres se faisaient entendre à travers le plancher et les cloisons. Et là-bas, près de ma porte, des fissures, longues d’une main, s’ouvraient dans le Morgenbladet.
Je me redressai, allai dans le coin du lit inspecter un paquet, à la recherche d’un peu de nourriture pour déjeuner, mais je ne trouvai rien et revins à la fenêtre.
Dieu sait, pensais-je, si jamais cela me servira à quelque chose de chercher une situation ! Ces multiples refus, ces demi promesses, ces « non » tout secs, ces espoirs tour à tour nourris et déçus, ces nouvelles tentatives qui à chaque fois tournaient à rien, avaient eu raison de mon courage. En dernier lieu j’avais sollicité une place de garçon de caisse, mais j’étais arrivé trop tard ; au surplus je ne pouvais fournir caution pour cinquante couronnes. Toujours il se trouvait un obstacle ou un autre. Je m’étais aussi présenté au corps des sapeurs-pompiers. Nous étions une cinquantaine d’hommes dans le préau, bombant la poitrine pour donner une impression de force et de grande hardiesse. Un inspecteur faisait la ronde et examinait ces postulants, leur tâtait les bras et leur posait des questions. Devant moi il passa tout droit et se contenta de secouer la tête en disant que j’étais refusé à cause de mes lunettes. Je me présentai une seconde fois, sans lunettes ; je me tenais les sourcils froncés, les yeux aigus comme des couteaux, et de nouveau l’homme passa tout droit devant en souriant... il avait dû me reconnaître. Le pire de tout, c’était que mes vêtements avaient commencé à devenir si minables que je ne pouvais plus me présenter dans une place en homme convenable.
Avec quelle régularité, quel mouvement uniforme j’avais descendu la pente, constamment ! J’avais fini par être si singulièrement dénué de tout qu’il ne me restait pas même un peigne, pas même un livre à lire quand la vie me devenait par trop triste. Tout l’été durant j’avais rôdé dans les cimetières ou dans le parc du Château où je m’asseyais et composais des articles pour les journaux, colonne après colonne, sur les choses les plus diverses : inventions bizarres, lubies, fantaisies de mon cerveau agité. Dans mon désespoir je choisissais souvent les sujets les plus inactuels, qui me coûtaient de longues heures d’efforts et n’étaient jamais acceptés. Quand un morceau était fini, je m’attaquais à un nouveau et me laissais rarement décourager par le « non » des rédacteurs en chef : je me disais sans cesse qu’un jour cela finirait bien par réussir. Et, en effet, quand j’avais la veine et que mon article était assez bien tourné, je pouvais parfois toucher cinq couronnes pour le travail d’un après-midi.
De nouveau, je me redressai, quittai la fenêtre, allai vers la chaise qui me servait de toilette. J’humectai avec un peu d’eau les genoux luisants de mon pantalon pour les noircir et leur donner l’air plus neuf. Cela fait, je mis, comme à l’ordinaire, du papier et un crayon dans ma poche et je sortis. Je me glissai en grand silence en bas de l’escalier pour ne pas éveiller l’attention de mon hôtesse ; quelques jours étaient passés depuis l’échéance de mon terme et il ne me restait plus de quoi le payer.
Il était neuf heures. Le bruit des voitures et des voix emplissait l’air : immense chœur matinal où se fondaient les pas des piétons et les claquements de fouet des cochers. Ce bruyant trafic de toutes parts me redonna aussitôt de l’énergie et je commençais à me sentir de plus en plus content. Rien n’était plus loin de ma pensée qu’une simple promenade dans l’air frais du matin. Qu’importait l’air à mes poumons ? J’étais fort comme un géant et j’aurais pu arrêter une voiture avec mon épaule. Un sentiment étrange et délicat s’était emparé de moi, le sentiment de toute cette joyeuse insouciance. Je me mis à observer les gens que je croisais ou dépassais, et j’allais, lisant les affiches sur les murs, cueillant l’impression d’un regard qu’on me lançait d’un tram en marche, laissant entrer en moi les moindres bagatelles, toutes les menues contingences qui croisaient ma route et disparaissaient.
Si seulement on avait un peu à manger par une si belle journée ! L’impression de ce gai matin me subjuguait, j’étais incapable de refréner ma joie et je me mis à fredonner de contentement, sans motif précis. Devant une boucherie, une bonne femme, le panier au bras, était arrêtée et méditait sur des saucisses pour son déjeuner ; quand je passai près d’elle, elle me regarda. Elle n’avait plus qu’une dent de devant. Nerveux et facilement impressionnable comme je l’étais devenu ces derniers jours, le visage de la femme me causa soudain une sensation de dégoût. Sa longue dent jaune avait l’air d’un petit doigt qui lui sortait de la mâchoire, et son regard était encore tout chargé de saucisses quand elle le tourna vers moi. Du coup je perdis l’appétit et le cœur me leva. En arrivant à la halle aux viandes, j’allai à la fontaine et bus un peu d’eau ; je levai les yeux... il était dix heures au clocher de Notre-Sauveur.
Je continuai à marcher par les rues, flânant sans me soucier de rien, m’arrêtai à un coin sans nécessité, changeai de direction et pris une rue latérale où je n’avais aucune affaire. Je laissais aller les choses, errant dans le matin joyeux, berçant mon insouciance de-ci, de-là parmi les autres heureux mortels. L’air était vide et clair et il n’y avait pas une ombre sur mon âme.
Depuis dix minutes j’avais eu constamment devant moi un vieil homme boiteux. Il portait un paquet d’une main et marchait avec tout son corps, travaillant de toutes ses forces pour prendre de la vitesse. Je l’entendais souffler de fatigue et l’idée me vint que je pourrais porter son paquet ; toutefois je ne cherchai pas à le rattraper. En haut de la rue Grænsen je rencontrai Hans Pauli, qui salua et passa très vite. Pourquoi était-il pressé ? Je n’avais pas la moindre intention de lui demander une couronne, je voulais même, au tout premier jour, lui renvoyer une couverture que je lui avais empruntée quelques semaines plus tôt. Aussitôt que je serais un peu remonté je ne voulais plus devoir de couverture à personne. Peut-être commencerais-je dès aujourd’hui un article sur « Les Crimes de l’Avenir » ou « Le Libre-arbitre », n’importe quoi, quelque chose d’intéressant qui me rapporterait dix couronnes au moins... Et, à la pensée de cet article, je me sentis tout à coup traversé d’un besoin impérieux de m’y mettre tout de suite pour épancher la plénitude de mon cerveau. J’allais me chercher un endroit convenable dans le parc du Château pour ne pas me reposer avant d’avoir fini.
Mais devant moi, dans la rue, le vieil estropié continuait à faire les mêmes mouvements clopinants. À la fin, cela commençait à m’irriter d’avoir tout le temps cet invalide devant moi. Son voyage semblait ne jamais devoir prendre fin. Peut-être s’était-il fixé précisément le même but que moi et tout le long du chemin il me faudrait l’avoir sous les yeux. Dans mon exaspération il me sembla qu’à chaque croisement de rue il ralentissait un brin, comme s’il m’attendait, pour voir quelle direction j’allais prendre. Sur quoi il se remettait à balancer son paquet dans les airs et repartait de toutes ses forces pour prendre de l’avance. Plus je vais et plus je regarde cet être obsédant, plus je me sens rempli d’irritation contre lui. J’avais le sentiment que petit à petit il me gâtait ma belle humeur et du même coup entraînait avec soi dans la laideur cette pure, belle matinée. Il avait l’air d’un gros insecte boitillant qui voulait à toute force se faire une place dans le monde et garder le trottoir pour soi tout seul. Comme nous arrivions au sommet de la côte, je me rebiffai ; je ne voulais pas me laisser faire plus longtemps. Je me tournai vers la vitrine d’une boutique et m’arrêtai pour donner à l’homme l’occasion de passer son chemin. Après quelques minutes, quand je me remis à marcher, il était de nouveau devant moi ; lui aussi s’était arrêté sur place. Sans réfléchir, je fis trois ou quatre pas en avant, furieusement, rattrapai l’homme et le frappai sur l’épaule.
Il s’arrêta net. Nous nous mîmes à nous dévisager mutuellement.
« Un petit sou pour acheter du lait ! dit-il enfin, en penchant la tête de côté.
– Allons, bon, me voilà bien ! »
Je fouillai dans mes poches et dis :
« Pour acheter du lait, oui... Hem... L’argent est rare par le temps qui court, et je ne sais pas jusqu’à quel point vous êtes vraiment dans le besoin.
– Je n’ai pas mangé depuis hier à Drammen, dit l’homme ; je n’ai pas un sou vaillant et je n’ai pas encore trouvé de travail.
– Vous êtes ouvrier ?
– Oui, je suis piqueur de bottines.
– Quoi ?
– Piqueur de bottines. Du reste je sais aussi faire des souliers.
– Ça change la thèse, dis-je. Attendez-moi ici quelques minutes, je vais aller chercher un peu d’argent pour vous, quelques öre. »
En toute hâte je descendis la rue des Saules où je connaissais un prêteur sur gages, au premier étage ; du reste je n’avais encore jamais été chez lui. En entrant sous la porte cochère, j’enlevai vivement mon gilet, le roulai et le mis sous mon bras ; puis je montai l’escalier et frappai à l’échoppe. Je m’inclinai et jetai le gilet sur le comptoir.
« Une couronne et demie, dit l’homme.
– Bien, merci, répondis-je. N’était qu’il commençait à devenir trop étroit, je ne m’en serais pas séparé. »
Je ramassai la monnaie et la reconnaissance et me retirai. Au fond, c’était une vraie trouvaille, ce gilet ; j’aurais encore de l’argent pour un copieux déjeuner et, avant ce soir, mon article sur « Les Crimes de l’Avenir » serait sur pied. Sur-le-champ, je commençai à trouver l’existence plus douce, et me hâtai de retourner vers l’homme pour me débarrasser de lui.
« S’il vous plaît ! lui dis-je. Je suis heureux que vous vous soyez adressé à moi de prime abord. »
L’homme prit l’argent et se mit à m’examiner. Qu’est-ce qu’il regardait de tous ses yeux ? J’eus l’impression qu’il concentrait son attention sur mes genoux de pantalon et je me lassai de cette impertinence. Le drôle croyait-il que j’étais vraiment aussi pauvre que j’en avais l’air ? N’avais-je pas autant dire commencé un article de dix couronnes ? Au surplus, je n’avais aucune crainte pour l’avenir, j’avais beaucoup de fers au feu. Alors, est-ce que ça regardait cet inconnu si je faisais largesse d’un menu pourboire par une si belle journée ? Le regard de l’homme m’irritait et je résolus de lui donner une leçon avant de le quitter. Je haussai les épaules et dis :
« Mon brave homme, c’est une vilaine habitude que vous avez prise de manger des yeux les genoux d’un homme quand il vous donne une couronne. »
Il renversa la tête en arrière contre le mur et ouvrit la bouche. Un travail se faisait derrière son front de gueux ; il pensait sans doute que je voulais le narguer d’une manière ou de l’autre, et il me tendit l’argent.
Je frappai du pied et jurai qu’il le garderait. Se figurait-il que je voudrais m’être donné pour rien toute cette peine ! Tout bien considéré, je lui devais peut-être cette couronne, j’avais comme le souvenir d’une vieille dette, il avait devant lui un homme intègre, honnête jusqu’au bout des ongles. Bref, l’argent était à lui... Oh ! pas la peine de me remercier, ç’avait été une joie pour moi. Adieu.
Je m’en allai. Enfin, j’étais débarrassé de cet invalide persécuteur et je pouvais retrouver mon calme. Je redescendis la rue des Saules et m’arrêtai devant un magasin de comestibles. La vitrine était remplie de victuailles et je me décidai à entrer acheter quelque chose pour manger en chemin.
« Un morceau de fromage et un petit pain ! dis-je en jetant ma demi-couronne sur le comptoir.
– Du fromage et du pain pour toute la somme ? demanda ironiquement la femme, sans me regarder.
– Pour les cinquante öre », répondis-je, impassible.
Je ramassai mes emplettes, dis bonjour à la grosse vieille femme avec une politesse extrême et à toute allure je gagnai le parc par la rampe du Château. J’y cherchai un banc où je serais seul et me mis à ronger gloutonnement mes provisions. Cela me fit du bien, il y avait longtemps que je n’avais pris un repas aussi abondant et peu à peu je me sentais envahir par ce calme repu qu’on éprouve après une longue crise de larmes. Un grand courage montait en moi. Il ne me suffisait plus d’écrire un article sur un sujet aussi simple et aussi banal que « Les Crimes de l’Avenir ». Du reste, c’était à la portée de n’importe qui : il n’y avait qu’à inventer ou même à tout bonnement lire l’histoire. Je me sentais capable de plus grands efforts, j’étais en humeur de vaincre des difficultés et je me décidai pour un traité en trois parties sur « La Connaissance philosophique ». Naturellement j’y trouverais l’occasion de mettre à mal quelques-uns des sophismes de Kant...
Quand je voulus prendre ce qu’il me fallait pour écrire, avant de commencer mon travail, je découvris que je n’avais plus de crayon sur moi, je l’avais oublié dans l’échoppe du prêteur : mon crayon était resté dans la poche du gilet.
Grand Dieu ! comme tout prenait plaisir à marcher à rebours ! Je proférai quelques jurons, me levai de mon banc et fis les cent pas dans les allées. Partout un grand calme ; tout là-bas, vers le pavillon de la Reine, quelques bonnes d’enfants trimbalaient leurs voitures ; à part elles, on ne voyait personne nulle part. J’étais horriblement irrité et je croisais rageusement devant mon banc. Est-ce que tout ne tournait pas remarquablement mal ? Et de tous les côtés ! Un article en trois parties allait échouer pour le simple motif que je n’avais pas dans ma poche un bout de crayon de dix öre ! Si je redescendais rue des Saules pour me faire rendre mon crayon ? Il me resterait encore le temps d’achever un bon morceau avant que le parc fût rempli de promeneurs. Et puis tant de choses dépendaient de ce Traité de la Connaissance philosophique, peut-être le bonheur de plusieurs hommes, on ne sait jamais. Je me dis à moi-même qu’il serait peut-être d’un grand secours à bien des jeunes gens. Réflexion faite, je ne m’attaquerais pas à Kant ; je pouvais fort bien l’éviter, il me suffisait de dévier imperceptiblement quand j’arriverais à la question du Temps et de l’Espace ; mais pour Renan, je ne répondais de rien, ce vieux curé de Renan... En tout état de cause il s’agissait de faire un article de tant et tant de colonnes. Mon terme impayé, les longs regards de l’hôtesse quand je la rencontre le matin dans l’escalier, me tourmentaient toute la journée et resurgissaient même aux moments heureux où, à part cela, je n’avais pas une pensée sombre. Il fallait en finir. Je sortis rapidement du parc pour aller chercher mon crayon chez le prêteur.
En descendant la rampe du Château, je rattrapai deux dames et les dépassai. Je frôlai la manche de l’une d’elles au passage. Je levai les yeux. Elle avait un visage plein, un peu pâle. Soudain elle rougit et devint étrangement belle. Je ne sais ce qui la fit rougir, peut-être un mot entendu d’un passant, peut-être simplement une silencieuse pensée intérieure. Ou bien était-ce parce que j’avais touché son bras ? Sa poitrine haute eut quelques violentes ondulations, sa main se crispa rudement sur le manche de son ombrelle. Que se passait-il en elle ?
Je m’arrêtai et me laissai dépasser de nouveau, incapable pour le moment d’aller plus loin, tant cela me paraissait bizarre. J’étais d’une humeur irritable, mécontent de moi-même à cause de l’aventure du crayon, et grandement excité par toute cette nourriture que j’avais absorbée, le ventre vide. Tout à coup, sous une fantastique inspiration, ma pensée prend une direction singulière. Je me sens possédé d’une étrange envie de faire peur à cette dame, de la suivre et de la contrarier d’une manière ou de l’autre. De nouveau je la rattrape et la dépasse, me retourne brusquement pour me trouver face à face avec elle et la dévisager. Arrêté, je la regarde droit dans les yeux et j’invente séance tenante un nom que je n’ai jamais entendu, un nom d’une consonance fluide et nerveuse : Ylajali. Quand elle fut assez près de moi, je me dressai de toute ma hauteur et lui dit d’un ton pressant :
« Vous perdez votre livre, mademoiselle. »
J’entendais le battement de mon cœur dans ma poitrine, en prononçant ces paroles.
« Mon livre ? » demande-t-elle à sa compagne. Et elle continue son chemin.
Ma méchanceté croissante me fit suivre la dame. Instantanément j’eus pleine conscience de commettre une sottise, sans toutefois pouvoir m’en empêcher. Mon trouble était tel qu’il échappait à mon contrôle ; il m’inspirait les plus folles suggestions, et je leur obéissais à tour de rôle. J’avais beau me dire que je me conduisais comme un idiot, cela ne servait à rien. Je faisais les plus absurdes grimaces derrière le dos de la dame, et je toussai furieusement plusieurs fois en la dépassant. Je marchais tous doucement devant elle, avec quelques pas d’avance. Je sentais ses yeux dans mon dos, et involontairement je me courbais sous la honte de l’avoir ainsi tourmentée. Petit à petit il me vint une impression singulière, l’impression d’être très loin, tout autre part, j’avais le sentiment mal défini que ce n’était pas moi qui marchais là, sur les dalles du trottoir, en courbant le dos.
Quelques minutes après, la dame arriva à la librairie Pascha. J’étais déjà arrêté devant la première vitrine et, quand elle passa près de moi, je m’avançai et répétai :
« Vous perdez votre livre, mademoiselle.
– Mais quel livre ? dit-elle d’une voix angoissante. Tu comprends de quel livre il parle ? »
Et elle s’arrête. Je me délecte cruellement de son trouble ; la perplexité que je lis dans ses yeux me ravit. Sa pensée est incapable de concevoir cette apostrophe insensée. Elle n’a pas de livre sur soi, pas trace, pas le moindre feuillet d’un livre. Et pourtant elle cherche dans ses poches ; à plusieurs reprises elle ouvre les mains et les regarde ; elle tourne la tête et examine la rue derrière elle ; elle surmène son petit cerveau fragile jusqu’à la plus extrême contention, pour trouver de quel livre je parle. Son visage change de couleur, prend tantôt une expression, tantôt une autre et j’entends sa respiration oppressée ; les boutons de sa robe eux-mêmes ont l’air de me fixer comme une rangée d’yeux pétrifiés.
« Ne fais donc pas attention à lui, dit sa compagne en la tirant par le bras ; il est tout bonnement ivre ; ne vois-tu pas que le type est ivre ! »
Si étranger que je fusse à moi-même en ce moment, et entièrement en proie à des influences invisibles, je remarquais pourtant tout ce qui se passait autour de moi. Un grand chien brun traversa la rue en courant, aux environs du square du Lund, et descendit vers Tivoli ; il portait un étroit collier de métal blanc. Plus haut dans la rue, une fenêtre s’ouvrit au premier étage ; une bonne s’y pencha, les manches retroussées, et se mit en devoir de nettoyer les vitres à l’extérieur. Rien n’échappait à mon attention, j’avais toute ma clarté et ma présence d’esprit, le flot des choses me pénétrait avec une netteté étincelante comme si une lumière intense s’était faite subitement autour de moi. Les dames devant moi avaient toutes deux une aile d’oiseau bleu sur leur chapeau et un ruban de soie écossais autour du cou. L’idée me vint qu’elles étaient sœurs.
Elles obliquèrent, s’arrêtèrent devant le magasin de musique de Cisler et se mirent à causer. Je m’arrêtai aussi. Toutes deux revinrent sur leurs pas, reprirent le chemin par lequel elles étaient venues, passèrent de nouveau près de moi, tournèrent le coin de la rue de l’Université et montèrent jusqu’à la place Saint-Olaf. J’étais tout le temps sur leurs talons, aussi près que je l’osais. Une fois elles se retournèrent et me jetèrent un regard mi-effrayé, mi-curieux. Je ne vis dans leurs mines aucune indignation, pas un froncement de sourcils. Cette patience devant mon importunité me remplit de honte et je baissai les yeux. Je ne voulais plus les contrarier, je voulais seulement, par pure gratitude, les suivre du regard, ne pas les perdre de vue, jusqu’au moment où elles entreraient n’importe où et disparaîtraient.