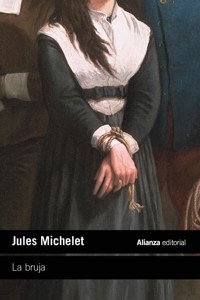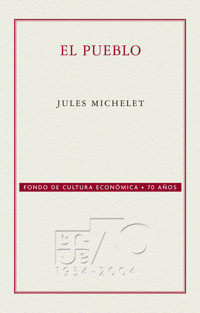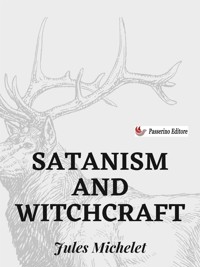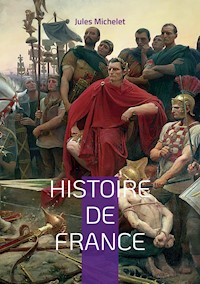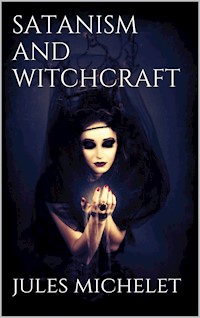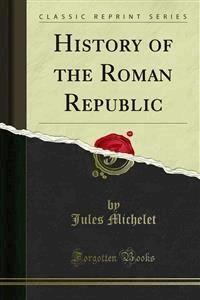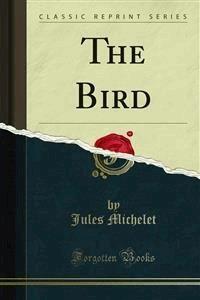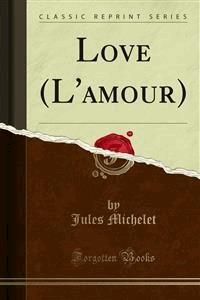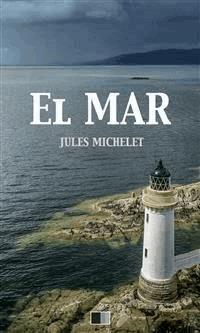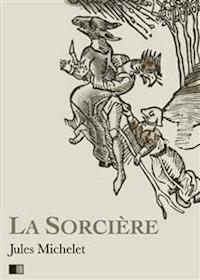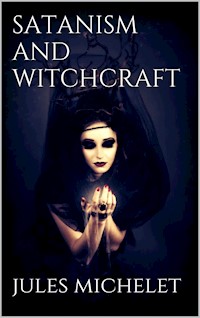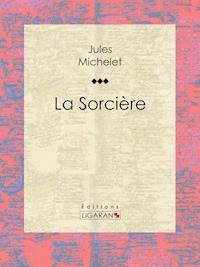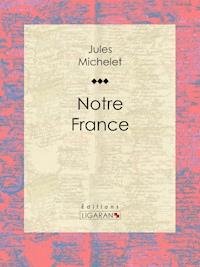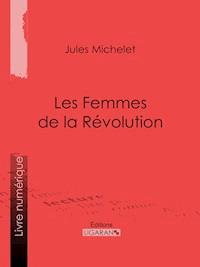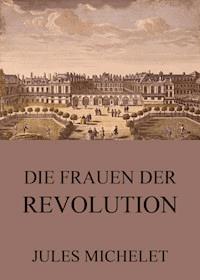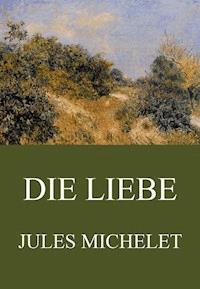Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Il n'est personne qui ne voie le fait capital du temps. Par un concours singulier de circonstances sociales, religieuses, économiques, l'homme vit séparé de la femme. En cela de plus en plus. Ils ne sont pas seulement dans des voies différentes et parallèles, ils semblent deux voyageurs partis de la même station, l'un à toute vapeur, l'autre à petite vitesse, mais sur des rails différents."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Il n’est personne qui ne voie le fait capital du temps. Par un concours singulier de circonstances sociales, religieuses, économiques, l’homme vit séparé de la femme.
Et cela de plus en plus. Ils ne sont pas seulement dans des voies différentes et parallèles, ils semblent deux voyageurs partis de la même station, l’un à toute vapeur, l’autre à petite vitesse, mais sur des rails divergents.
L’homme, quelque faible qu’il puisse être moralement, n’en est pas moins dans un chemin d’idées, d’inventions et de découvertes si rapide, que le rail brûlant en lance des étincelles.
La femme, fatalement laissée en arrière, reste au sillon d’un passé qu’elle connaît peu elle-même. Elle est distancée, pour notre malheur, mais ne veut ou ne peut aller plus vite.
Le pis, c’est qu’ils ne semblent pas pressés de se rapprocher. Il semble qu’ils n’aient rien à se dire. Le foyer est froid, la table muette et le lit glacé.
On n’est pas tenu, disent-ils, de se mettre en frais pour les siens. Mais ils n’en font pas davantage dans une société étrangère où la politesse commande. Tout le monde voit chaque soir comme un salon se sépare en deux salons, un des hommes et un des femmes. Ce qu’on n’a pas assez vu, ce qu’on peut expérimenter, c’est que dans une petite réunion amicale d’une douzaine de personnes, si la maîtresse de maison exige par une douce violence que les deux cercles se fondent, que les hommes causent avec les femmes, le silence s’établit, il n’y a plus de conversation.
Il faut dire nettement la chose comme elle est. Ils n’ont plus d’idées communes, ni de langage commun, et même sur ce qui pourrait intéresser les deux parties, on ne sait comment parler. Ils se sont trop perdus de vue. Bientôt, si l’on n’y prenait garde, malgré les rencontres fortuites, ce ne serait plus deux sexes, mais deux peuples.
Rien d’étonnant si le livre qui combattait ces tendances, un petit livre de cœur, sans prétention littéraire, a été de toutes parts amèrement critiqué.
L’Amour venait naïvement se jeter dans le divorce, invoquait la bonne nature et disait : « Aimez encore. »
À ce mot, d’aigres cris s’élèvent, on avait touché la fibre malade. « Non, nous ne voulons pas aimer ! nous ne voulons pas être heureux !… Il y a là-dessous quelque chose. Sous cette forme religieuse qui divinise la femme, il a beau fortifier, émanciper son esprit ; il veut une idole esclave, et la lier sur l’autel. »
Ainsi, au mot d’union, éclata le mal du temps, division, dissolution, les tristes goûts solitaires, les besoins de la vie sauvage, qui couvent au fond de leur esprit.
Des femmes lurent et pleurèrent. Leurs directeurs (religieux ou philosophes, n’importe) dictèrent leur langage. À peine osèrent-elles faiblement défendre leur défenseur. Elles firent mieux, elles relurent, dévorèrent le coupable livre ; elles le gardent pour les heures libres et l’ont caché sous l’oreiller.
Cela le console fort, ce livre si malmené, et des injures de l’ennemi, et des censures de l’ami. Ni les hommes du Moyen Âge, ni ceux de la femme libre, n’y trouvaient leur compte. L’Amour voulait retirer la femme au foyer. Ils préfèrent pour elle le trottoir ou le couvent.
« Un livre pour le mariage, pour la famille ! Scandale ! Faites-nous plutôt, je vous prie, trente romans pour l’adultère. À force d’imagination, rendez-le un peu amusant. Vous serez bien mieux reçu. »
Pourquoi fortifier la famille ? dit un journal religieux. N’est-elle pas parfaite aujourd’hui ? Il y a bien eu autrefois ce qu’on appelait l’adultère, mais cela ne se voit plus. – Pardon, répond un grand journal politique dans un feuilleton spirituel qui a extrêmement réussi, pardon, cela se voit encore, et même on le voit partout, mais cela fait si peu de bruit, on y met si peu de passion, qu’on n’en vit pas moins doucement, c’est chose inhérente au mariage français et presque une institution. Chaque nation a ses mœurs, et nous ne sommes point Anglais.
Doucement ! oui, voilà le mal. Ni le mari ni l’amant n’en sont troublés ; elle non plus ; elle voudrait se désennuyer, voilà tout. Mais dans cette vie tiède et pâle, où l’on met si peu de cœur, où l’on dépense si peu d’art, où pas un des trois ne daigne faire effort de manière ou d’autre, tous baissent, tous bâillent, s’affadissent d’une nauséabonde douceur.
Chacun est bien averti, et personne n’a envie de ce mariage. Si nos lois de succession ne faisaient la femme riche, on ne se marierait plus, du moins dans les grandes villes.
J’entendais à la campagne un monsieur marié et père de famille, bien posé, qui endoctrinait un jeune homme de son voisinage : « Si vous devez rester ici, disait-il, il faudra bien vous marier, mais si vous vivez à Paris, cela n’en vaut pas la peine. Il est trop aisé de faire autrement. »
On sait le mot qui marqua la fin du peuple le plus spirituel de la terre, du peuple d’Athènes : « Ah ! si nous pouvions, sans femmes, avoir des enfants ! » – Ce fut bien pis dans l’Empire. Toutes les pénalités légales, ces lois Julia qui croyaient marier l’homme à coups de bâton, ne parvinrent plus à le rapprocher de la femme, et il sembla même que le désir physique, cette belle fatalité qui aiguillonne le monde et centuple ses énergies, se fût éteint ici-bas. Pour ne plus voir une femme, on fuyait jusqu’en Thébaïde.
Les motifs qui, aujourd’hui, non seulement font craindre le mariage, mais éloignent de la société des femmes, sont divers et compliqués.
Le premier, incontestablement, c’est la misère croissante des filles pauvres qui les met à discrétion, la facilité de posséder ces victimes de la faim. De là la satiété et l’énervation, de là l’inaccoutumance d’un amour plus élevé, l’ennui mortel qu’on trouverait à solliciter longuement ce que si facilement on peut avoir chaque soir.
Celui même qui aurait d’autres besoins et des goûts de fidélité, qui voudrait aimer la même, préfère infiniment une personne dépendante, douce, obéissante, qui, ne se croyant aucun droit, pouvant être quittée demain, ne s’écarte d’un pas et veut plaire.
La forte et brillante personnalité de nos demoiselles qui, trop souvent prend l’essor le lendemain du mariage, effraye le célibataire. Il n’y a pas à plaisanter, la Française est une personne. C’est la chance d’un bonheur immense, mais parfois d’un malheur aussi.
Nos excellentes lois civiles (qui sont celles de l’avenir, et vers qui gravite le monde) n’en ont pas moins ajouté à cette difficulté inhérente du caractère national. La Française hérite et le sait, elle a une dot et le sait. Ce n’est pas comme en certains pays voisins où la fille, si elle est dotée, ne l’est qu’en argent (fluide qui file aux affaires du mari). Ici elle a des immeubles, et même quand ses frères veulent lui en donner la valeur, la jurisprudence s’y oppose et la maintient riche en immeubles, garantis par le régime dotal, ou certaines stipulations. Cette fortune le plus souvent est là qui subsiste. Cette terre ne s’envole pas, cette maison ne s’écroule pas ; elles restent pour lui donner voix au chapitre, lui maintenir une personnalité que n’ont guère l’Anglaise ou l’Allemande.
Celles-ci, pour ainsi parler, s’absorbent dans leur mari ; elles s’y perdent corps et bien (si elles ont quelque bien). Aussi, elles sont, je crois, plus déracinées que les nôtres de leur famille natale, qui ne les reprendrait pas. La mariée compte comme morte pour les siens, qui se réjouissent d’avoir placé une fille dont ils n’auront jamais la charge désormais. Quoi qu’il arrive, et, quelque part que la mène son mari, elle ira et restera. À de pareilles conditions on craint moins le mariage.
Une chose curieuse en France, contradictoire en apparence et qui ne l’est pas, c’est que le mariage est très faible, et très fort l’esprit de famille. Il arrive (surtout en province, dans la bourgeoisie de campagne) que la femme, mariée quelque temps, une fois qu’elle a des enfants, fait de son âme deux parts, l’une aux enfants, l’autre aux parents, à ses premières affections qui se réveillent. – Que garde le mari ? Rien. C’est ici l’esprit de famille qui annule le mariage.
On ne peut pas se figurer comme cette femme est ennuyeuse, se renfonçant dans un passé rétrograde, se remettant au niveau d’une mère d’esprit suranné, tout imbu de vieilles choses. Le mari vit doucement, mais baisse vite, découragé, lourd, propre à rien. Il perd ce que, dans ses études, dans une jeune société, il avait gagné d’idées pour aller un peu en avant. Il est bientôt amorti par la dame propriétaire, par le pesant étouffement du vieux foyer de famille.
Avec une dot de cent mille francs on enterre ainsi un homme qui peut-être chaque année aurait gagné cent mille francs.
Le jeune homme se le dit, à l’âge du long espoir et de la confiance. D’ailleurs qu’il ait plus, qu’il ait moins ; n’importe : il veut courir sa chance, savoir de quoi il est capable ; il envoie au diable la dot. Pour peu qu’il ait quelque chose qui batte sous la mamelle gauche, il n’ira pas, pour cent mille francs, se faire le mari de la reine.
Voilà ce que m’ont dit souvent les célibataires ils m’ont encore dit ceci, un soir que j’en avais chez moi cinq ou six, et de grand mérite, et que je les tourmentais sur leur prétendu célibat.
Un d’eux, savant distingué, me dit très sérieusement ces propres paroles : « Monsieur, ne croyez nullement, quelques distractions qu’on puisse trouver au dehors, qu’on ne soit pas malheureux de n’avoir pas de foyer, je veux dire, une femme à soi, qui vraiment vous appartienne. Nous le savons, nous le sentons. Nul autre repos pour le cœur. Et ne l’avoir pas, monsieur, sachez que c’est une vie sombre, cruelle et amère. »
Amère. Sur ce mot-là, les autres insistèrent et dirent comme lui.
« Mais, dit-il en continuant, une chose nous en empêche. Tous les travailleurs sont pauvres en France. On vit de ses appointements : on vit de sa clientèle, etc. On vit juste. Moi, je gagne six mille francs, mais telle femme à laquelle je pourrais songer, dépense autant pour sa toilette. Les mères les élèvent ainsi. En supposant qu’on me la donne, cette belle, que deviendrai-je le lendemain, quand, sortie d’une maison riche, elle va me trouver si pauvre ? Si je l’aime (et j’en suis capable), imaginez les misères, les lâchetés dont je puis être tenté pour devenir un peu riche, et lui déplaire un peu moins.
Je me souviendrai toujours que me trouvant dans une petite ville du Midi, où l’on envoie les malades à la mode, je vis passer sur une place où les mulets se roulaient dans une épaisse poussière, une surprenante apparition. C’était une fort belle dame ; courtisanesquement vêtue (une dame pourtant, non une fille), vingt-cinq ans, gonflée, ballonnée, dans une fraîche et délicieuse robe de soie bleu de ciel, nuée de blanc (chef-d’œuvre de Lyon), qu’elle traînait outrageusement par les endroits les plus sales. La terre ne la portait pas. Sa tête blonde et jolie, le nez au vent, son petit chapeau d’amazone qui lui donnait l’air d’un petit page équivoque, toute sa personne disait : “Je me moque de tout. ” Je sentais que cette idole, monstrueusement amoureuse d’elle-même, avec toute sa fierté, n’appartenait pas moins d’avance à ceux qui la flatteraient, qu’on s’en jouerait avec des mots et qu’elle n’en était pas même à savoir ce que c’est qu’un scrupule. Je me souvins de Salomon : Et tergens os suum dixit : Non sum operata malum. Cette vision m’est restée. Ce n’est pas une personne, ce n’est pas un accident ; c’est la mode, ce sont les mœurs du temps que j’ai vu passer ; et j’en garderai toujours la terreur du mariage. »
« Pour moi, dit un autre plus jeune, l’obstacle, l’empêchement dirimant, ce n’est pas la crinoline, monsieur, c’est la religion. »
On rit ; mais lui, s’animant : « Oui, la religion. Les femmes sont élevées dans un dogme qui n’est point le nôtre. Les mères qui veulent tant marier leurs filles, leur donnent l’éducation propre à créer le divorce. »
Quel est le dogme de la France ? Si elle ne le sait elle-même, l’Europe le sait très bien ; sa haine le lui dit à merveille. Pour moi, c’est un ennemi, un étranger très rétrograde qui me l’a un jour formulé : « Ce qui nous rend votre France haïssable, disait-il, c’est que, sous un mouvement apparent, elle ne change pas. C’est comme un phare à éclipse, à feux tournants ; elle montre, elle cache la flamme, mais le foyer est le même. – Quel foyer ? L’esprit voltairien (bien antérieur à Voltaire) ; – en second lieu, 89, les grandes lois de la Révolution ; – troisièmement, les canons de votre pape scientifique, l’Académie des sciences. »
Je disputai. Il insista, et je vois qu’il avait raison. Oui, quelles que soient les questions nouvelles, 89 est la foi de ceux même qui ajournent 89 et le renvoient à l’avenir. C’est la foi de toute la France, c’est la raison pour laquelle l’étranger nous condamne en masse et sans distinction de partis.
Eh bien, les filles de France sont élevées justement à haïr et dédaigner ce que tout Français aime et croit. Par deux fois elles ont embrassé, lâché, tué la Révolution : premièrement au seizième siècle, quand il s’agissait de la liberté de conscience ; puis à la fin du dix-huitième, pour les libertés politiques. Elles sont vouées au passé, sans trop savoir ce que c’est. Elles écoutent volontiers ceux qui disent avec Pascal : « Rien n’est sûr ; donc, croyons l’absurde. » Les femmes sont riches en France, elles ont beaucoup d’esprit, et tous les moyens d’apprendre. Mais elles ne veulent rien apprendre, ni se créer une foi. Qu’elles rencontrent l’homme de foi sérieuse, l’homme de cœur, qui croit et aime toutes les vérités constatées, elles disent en souriant : « Ce monsieur ne croit à rien. »
Il y eut un moment de silence. Cette sortie, un peu violente, avait pourtant, je le vis, enlevé l’assentiment de tous ceux qui étaient là. Je leur dis : Si l’on admettait ce que vous venez d’avancer, je crois qu’il faudrait dire aussi qu’il en a été de même bien souvent dans d’autres âges, et qu’on se mariait pourtant. Les femmes aimaient la toilette, le luxe, étaient rétrogrades. Mais les hommes de ces temps-là sans doute étaient plus hasardeux. Ils affrontaient ces périls, espérant que leur ascendant, leur énergie, l’amour surtout, le maître, le vainqueur des vainqueurs, opéreraient en leur faveur d’heureuses métamorphoses. Intrépides Curtius, ils se lançaient hardiment dans ce gouffre d’incertitudes. Et fort heureusement pour nous. Car, messieurs, sans cette audace de nos pères, nous ne naissions pas.
Maintenant, permettez-vous à un ami plus âgé de vous parler avec franchise ?… Eh bien, j’oserai vous dire que si vous étiez vraiment seuls, si vous supportiez, sans consolations, cette vie que vous trouvez amère, vous vous presseriez d’en sortir. Vous diriez : L’amour est fort, et il peut tout ce qu’il veut. Plus grande sera la gloire de convertir à la raison ces beautés absurdes et charmantes. Avec une grande volonté, déterminée, persévérante, un milieu choisi, un entourage habilement calculé, on peut tout. Mais il faut aimer, aimer fortement et la même. Point de froideur. La femme cultivée et désirée, infailliblement appartient à l’homme. Si l’homme de ce temps-ci se plaint de n’aller pas à l’âme, c’est qu’il n’a pas ce qui la dompte, la force fixe du désir.
Maintenant, pour parler seulement du premier obstacle allégué, de l’orgueil effréné des femmes, de leur furie de toilette, etc., il me semble que ceci s’adresse surtout aux classes supérieures, aux dames riches, ou à celles qui ont occasion de se mêler au monde riche. C’est deux cent ou trois cent mille dames. Mais savez-vous combien de femmes il y a en France ? Dix-huit millions, dix-huit cent mille à marier.
Il y aurait bien de l’injustice à les accuser en masse des torts et des ridicules de la haute société. Si elles l’imitent de loin, ce n’est pas toujours librement. Les dames, par leur exemple, et souvent parleurs mépris, leurs risées, à l’étourdie, font en ce sens de grands malheurs. Elles imposent un luxe impossible à de pauvres créatures qui parfois ne l’aimeraient pas, mais qui par position, pour des intérêts sérieux, sont forcées d’être brillantes, et, pour l’être, se précipitent dans les plus tristes hasards.
Les femmes qui ont entre elles une destinée à part, et tant de secrets communs, devraient bien s’aimer un peu et se soutenir, au lieu de se faire la guerre. Elles se nuisent dans mille choses, indirectement. La dame riche, dont le luxe change la toilette des classes pauvres, fait grand tort à la jeune fille. Elle empêche son mariage ; nul ouvrier ne se soucie d’épouser une poupée si coûteuse à habiller. – Restée fille, elle est, je suppose, demoiselle de comptoir, de magasin ; mais, là même, la dame lui nuit encore. Elle aime mieux avoir affaire à un commis en habit noir, flatteur, plus femme que les femmes. Les maîtres de magasin ont été ainsi conduits à substituer à grands frais le commis à la demoiselle, qui coûtait bien moins. – Celle-ci, que deviendra-t-elle ? Si elle est jolie, à vingt ans elle sera entretenue, et passera de main en main. Flétrie bientôt avant trente, elle deviendra couseuse, et fera des confections à raison de dix sous par jour. Nul moyen de vivre sans demander chaque soir son pain à la honte. Ainsi la femme au rabais, par une terrible revanche, va rendant de plus en plus le célibat économique, le mariage inutile. Et la fille de la dame ne pourra pas se marier.
Voulez-vous, messieurs, qu’en deux mots je vous esquisse le sort de la femme en France ? Personne ne l’a fait encore avec simplicité. Ce tableau, si je ne me trompe, doit toucher votre cœur, et vous éclairer peut-être, vous empêcher de mêler des classes fort différentes dans un même anathème.
Quand les fabricants anglais, énormément enrichis par les machines récentes, vinrent se plaindre à M. Pitt et dirent : « Nous n’en pouvons plus, nous ne gagnons pas assez ! » il dit un mot effroyable qui pèse sur sa mémoire : « Prenez les enfants. »
Combien plus coupables encore ceux qui prirent les femmes, ceux qui ouvrirent à la misère de la fille des villes, à l’aveuglement de la paysanne, la ressource funeste d’un travail exterminateur et la promiscuité des manufactures ! Qui dit la femme, dit l’enfant ; en chacune d’elles qu’on détruit, une famille est détruite, plusieurs enfants, et l’espoir des générations à venir.
Barbarie de notre Occident ! la femme n’a plus été comptée pour l’amour, le bonheur de l’homme, encore moins comme maternité et comme puissance de race ;
Mais comme ouvrière !
L’ouvrière ! mot impie, sordide, qu’aucune langue n’eut jamais, qu’aucun temps n’aurait compris avant cet âge de fer, et qui balancerait à lui seul tous nos prétendus progrès.
Ici arrive la bande serrée des économistes, des docteurs du produit net. « Mais, monsieur, les hautes nécessités économiques, sociales ! L’industrie, gênée, s’arrêterait… Au nom même des classes pauvres ! etc., etc. »
La haute nécessité, c’est d’être. Et visiblement, l’on périt. La population n’augmente plus, et elle baisse en qualité. La paysanne meurt de travail, l’ouvrière de faim. Quels enfants faut-il en attendre ? Des avortons, de plus en plus.
« Mais un peuple ne périt pas ! » Plusieurs peuples, de ceux même qui figurent encore sur la carte, n’existent plus. La haute Écosse a disparu. L’Irlande n’est plus comme race. La riche, l’absorbante Angleterre, ce suceur prodigieux qui suce le globe, ne parvient pas à se refaire par la plus énorme alimentation. La race y change, y faiblit, fait appel aux alcools, et elle faiblit encore plus. Ceux qui la virent en 1815 ne la reconnurent plus en 1830. Et combien moins depuis !
Que peut l’État à cela ? Bien moins là-bas, en Angleterre, où la vie industrielle engloutit tout, la terre même n’étant plus qu’une fabrique. Mais infiniment en France, où nous comptons encore si peu d’ouvriers (relativement).
Que de choses ne se pouvaient pas, qui se sont faites pourtant ! On ne pouvait abolir la loterie ; Louis-Philippe l’a abolie. On eût juré qu’il était impossible de démolir Paris pour le refaire ; cela s’exécute aisément aujourd’hui par une petite ligne du Code. (Expropriation pour cause d’utilité publique.)
Je vois deux peuples dans nos villes :
L’un, vêtu de drap, c’est l’homme ; – l’autre, de misérable indienne. – Et cela, même l’hiver ! L’un, je parle du dernier ouvrier, du moins payé, du gâcheux, du serviteur des ouvriers ; il arrive pourtant, cet homme, à manger de la viande le matin (un cervelas sur le pain ou quelque autre chose). Le soir, il entre à la gargote et il mange un plat de viande et même boit de mauvais vin.
La femme du même étage prend un sou de lait le matin, du pain à midi et du pain le soir, à peine un sou de fromage. – Vous niez ?… Cela est certain : je le prouverai tout à l’heure. Sa journée est de dix sous, et elle ne peut être de onze, pour une raison que je dirai.
Pourquoi en est-il ainsi ? L’homme ne veut plus se marier, il ne veut plus protéger la femme. Il vit gloutonnement seul.
Est-ce à dire qu’il mène une vie abstinente ? Il ne se prive de rien. Ivre le dimanche soir, il trouvera, sans chercher, une ombre affamée, et outragera cette morte.
On rougit d’être homme.
« Je gagne trop peu, » dit-il. Quatre ou cinq fois plus que la femme, dans les métiers les plus nombreux. Lui quarante ou cinquante sous, et elle dix, comme on va le voir.
La pauvreté de l’ouvrier serait pour l’ouvrière richesse, abondance et luxe.
Le premier se plaint bien plus. Et, dès qu’il manque en effet, il manque de bien plus de choses. On peut dire d’eux ce qu’on a dit de l’Anglais et de l’Irlandais : « L’Irlandais a faim de pommes de terre. L’Anglais a faim de viande, de sucre, de thé, de bière, de spiritueux, etc., etc. »
Dans le budget de l’ouvrier nécessiteux, je passais deux choses qu’il se donne à tout prix, et auxquelles elle ne songe pas : le tabac et la barrière. Pour la plupart, ces deux articles absorbent plus qu’un ménage.
Les salaires de l’homme ont reçu, je le sais, une rude secousse, principalement par l’effet de la crise métallique qui change la valeur de l’argent. Ils remontent, mais lentement. Il faut du temps pour l’équilibre. Mais, en tenant compte de cela, la différence subsiste. La femme est encore plus frappée. C’est la viande, c’est le vin, qui sont diminués pour lui ; pour elle, c’est le pain même. Elle ne peut reculer, ni tomber davantage : un pas de plus, elle meurt.
« C’est leur faute, dit l’économiste. Pourquoi ont-elles la fureur de quitter les campagnes, de venir mourir de faim dans les villes ? Si ce n’est l’ouvrière même, c’est sa mère qui est venue, qui, de paysanne, se fit domestique. Elle ne manque pas, hors mariage, d’avoir un enfant, qui est l’ouvrière. »
Mon cher monsieur, savez-vous ce que c’est que la campagne de France ? combien le travail y est terrible, excessif et rigoureux ? Point de femmes qui cultivent en Angleterre. Elles sont bien misérables, mais enfin vivent en chapeau, gardées du vent et de la pluie. L’Allemagne, avec ses forêts, ses prairies, etc., avec un travail très lent et la douceur nationale, n’écrase pas la femme, comme on fait de celle-ci. Le durus arator du poêle n’a guère son idéal qu’ici. Pourquoi ? Il est propriétaire. Propriétaire de peu, de rien, et propriétaire obéré. Par un travail furieux, aveugle, de très mauvaise agriculture, il lutte avec le vautour. Cette terre va lui échapper. Plutôt que cela n’arrive, il s’y enterrera, s’il le faut ; mais d’abord surtout sa femme. C’est pour cela qu’il se marie, pour avoir un ouvrier. Aux Antilles, on achète un nègre ; en France, on épouse une femme.
On la prend de faible appétit, de taille mesquine et petite, dans l’idée qu’elle mangera moins (historique).
Elle a grand cœur, cette pauvre Française, fait autant et plus qu’on ne veut. Elle s’attelle avec un âne (dans les terres légères) et l’homme pousse la charrue. En tout, elle a le plus dur. Il taille la vigne à son aise. Elle, la tête en bas, gratte et pioche. Il a des répits, elle non. Il a des fêtes et des amis. Il va seul au cabaret. Elle va un moment à l’église et elle y tombe de sommeil. Le soir, s’il rentre ivre, battue ! et souvent, qui pis est, enceinte ! La voilà, pour une année, traînant sa double souffrance, au chaud, au froid, glacée du vent, recevant la pluie tout le jour.
La plupart meurent de phtisie, surtout dans le Nord (voiries statistiques). Nulle constitution ne résiste à cette vie. Pardonnons-lui à cette mère, si elle a envie que sa fille souffre moins, si elle l’envoie à la manufacture (du moins elle aura un toit sur la tête), ou bien, domestique à la ville, où elle participera aux douceurs de la vie bourgeoise. L’enfant n’y est que trop portée. Toute femme a dans l’esprit des petits besoins d’élégance, de finesse et d’aristocratie.
Elle en est tout d’abord punie. Elle ne voit plus le soleil. La bourgeoise est souvent très dure, surtout si la fille est jolie. Elle est immolée aux enfants gâtés, singes malins, cruels petits chats, qui font d’elle leur jouet. Sinon, grondée, vexée, malmenée. Alors elle voudrait mourir. Le regret du pays lui vient ; mais elle sait que son père ne voudra jamais la reprendre. Elle pâlit, elle dépérit.
Le maître seul est bon pour elle. Il la consolerait, s’il l’osait. Il voit bien qu’en cet état désolé, où la petite n’a jamais un mot de douceur, elle est d’avance à celui qui lui montrerait un peu d’amitié. L’occasion en vient bientôt, madame étant à la campagne. La résistance n’est pas grande. C’est son maître, et il est fort. La voilà enceinte. Grand orage. Le mari honteux baisse les épaules. Elle est chassée, et sans pain, sur le pavé, en attendant qu’elle puisse accoucher à l’hôpital. (Histoire presque invariable, voyez les confessions recueillies par les médecins.)
Quelle sera sa vie, grand Dieu ! que de combats ! que de peines, si elle a tant de bon cœur, de courage, qu’elle veuille élever son enfant !
Voyons la condition de la femme ainsi chargée, et encore dans des circonstances relativement favorables.
Une jeune veuve protestante, de mœurs très austères, laborieuse, économe, sobre, exemplaire en tout sens, encore agréable, malgré tout ce qu’elle a souffert, demeure derrière l’Hôtel-Dieu, dans une rue malsaine, plus bas que le quai. Elle a un enfant maladif, qui va toujours à l’école, retombe toujours au lit, et qui ne peut avancer. Son loyer, de cent vingt francs, moins enchéri que bien d’autres, est porté à cent soixante. Elle disait à deux dames excellentes : « Quand je puis aller en journée, on veut bien me donner vingt sous, même vingt-cinq ; mais cela ne me vient guère que deux ou trois fois la semaine. Si vous n’aviez eu la bonté de m’aider pour mon loyer en me donnant cinq francs par mois, il eût fallu, pour nourrir mon enfant, que je fisse comme les autres, que je descendisse le soir dans la rue. »
La pauvre femme qui descend tremblante, hélas ! pour s’offrir, est à cent lieues de l’homme grossier à qui il lui faut s’adresser. Nos ouvrières qui ont tant d’esprit, dégoût, de dextérité, sont la plupart distinguées physiquement, fines et délicates. Quelle différence entre elles et les dames des plus hautes classes ? Le pied ? Non. La taille ? Non. La main seule fait la différence, parce que la pauvre ouvrière, forcée de laver souvent, passant l’hiver sous le toit avec une simple chaufferette, a ses mains, son unique instrument de travail et de vie, gonflées douloureusement, crevées d’engelures. À cela près, la même femme, pour peu qu’on l’habille, c’est madame la comtesse, autant qu’aucune du grand faubourg. Elle n’a pas le jargon du monde. Elle est bien plus romanesque, plus vive. Qu’un éclair de bonheur lui passe, elle éclipsera tout.
On ne sait pas assez combien les femmes sont une aristocratie. Il n’y a pas de peuple chez elles.
Quand je passai le détroit, un doux visage de femme, épuisé, mais fin, joli, distingué, suivait la voiture, me parlant, inutilement, car je n’entendais pas l’anglais. Ses beaux yeux bleus, suppliants, paraissaient souffrants, profonds, sous un petit chapeau de paille.
– Monsieur, dis-je à mon voisin, qui entendait le français, pourriez-vous m’expliquer ce que me dit cette charmante personne, qui a l’air d’une duchesse, et qui, je ne sais pourquoi, s’obstine à suivre la voiture ?
– Monsieur, me dit-il poliment, je suis porté à croire que c’est une ouvrière sans ouvrage, qui se fait mendiante, au mépris des lois.
Deux évènements immenses ont changé le sort de la femme en Europe dans ces dernières années.
Elle n’a que deux grands métiers, filer et coudre.
Les autres (broderie, fleurs, etc.) méritent à peine d’être comptés. La femme est une fileuse, la femme est une couseuse. C’est son travail, en tous les temps, c’est son histoire universelle.
Eh bien, il n’en est plus ainsi. Cela vient d’être changé.
La machine à lin a d’abord supprimé la fileuse. Ce n’est pas un gain seulement, c’est tout un monde d’habitudes quia été perdu. La paysanne filait, en surveillant ses enfants, son foyer, etc. Elle filait aux veillées. Elle filait en marchant, menant sa vache ou ses moutons.
La couseuse était l’ouvrière des villes. Elle travaillait chez elle, ou continûment tout le jour, ou en coupant ce travail des soins du ménage. Pour tout labeur important, cela n’existera plus. D’abord, les couvents, les prisons, faisaient terrible concurrence à l’ouvrière isolée. Mais voici la machine à coudre qui l’anéantit.
Le progrès de deux machines, le bon marché, la perfection de leur travail, feront, malgré toute barrière, arriver partout leurs produits. Il n’y a rien à dire contre les machines, rien à faire. Ces grandes inventions sont, à la fin, au total, des bienfaits pour l’espèce humaine. Mais leurs effets sont cruels aux moments de transition.
Combien de femmes en Europe (et ailleurs) seront frappées par ces deux terribles fées, par la fileuse d’airain et la couseuse de fer ? Des millions ? Mais jamais on ne pourrait le calculer.
L’ouvrière de l’aiguille s’est trouvée, en Angleterre si subitement affamée, que nombre de sociétés d’émigration s’occupent de favoriser son passage en Australie. L’avance est de sept cent vingt francs, mais la personne émigrée peut dès la première année en rendre moitié (Blosseville). Dans ce pays où les mâles sont infiniment plus nombreux, elle se marie sans peine, fortifiant de familles nouvelles cette puissante colonie, plus solide que l’empire indien.
Les nôtres que deviennent-elles ? Elles ne font pas grand bruit. On ne les verra pas, comme l’ouvrier, coalisé et robuste, le maçon, le charpentier, faire une grève menaçante et dicter des conditions. Elles meurent de faim, et voilà tout. La grande mortalité de 1854 est surtout tombée sur elles.
Depuis ce temps cependant, leur sort s’est bien aggravé. Les bottines de femmes ont été cousues à la mécanique. Les fleuristes sont moins payées, etc.
Pour m’éclairer sur ce triste sujet, j’en parlais à plusieurs personnes, spécialement à mon vénérable ami et confrère, M. le docteur Villermé, à M. Guerry, dont les beaux travaux sont si estimés, enfin à un jeune statisticien dont j’avais fort admiré la méthode rigoureuse, M. le docteur Bertillon. Il eut l’obligeance extrême de faire, à cette occasion, un travail sérieux, où il réunit aux données que le monde ouvrier peut fournir celles que des personnes de l’administration lui communiquèrent. Je voudrais qu’il le complétât et le publiât.
Je n’en donnerai qu’une ligne : « Dans le grand métier général qui occupe toutes les femmes (moins un petit nombre), le travail de l’aiguille, elles ne peuvent gagner que dix sous. »
Pourquoi ? « Parce que la machine, qui est encore assez chère, fait le travail à dix sous. Si la femme en demandait onze, on lui préférerait la machine. »
Et comment y supplée-t-elle ? « Elle descend le soir dans la rue. »
Voilà pourquoi le nombre des filles publiques, enregistrées, numérotées, n’augmente pas à Paris, et, je crois, diminue un peu.
L’homme ne se contente pas d’inventer les machines qui suppriment les deux grands métiers de la femme, il s’empare directement des industries secondaires dont elle vivait, descend aux métiers du faible. La femme peut-elle, à volonté, monter aux métiers qui exigent de la force, prendre ceux des hommes ? Nullement.
Les dames nonchalantes et oisives, enfoncées dans leur divan, peuvent dire tant qu’elles voudront : « La femme n’est point une malade. » – Ce qui n’est rien quand on peut, deux jours, trois jours, se dorloter, est souvent accablant pour celle qui n’a point de repos. Elle devient tout à fait malade.
En réalité, la femme ne peut travailler longtemps ni debout, ni assise. Si elle est toujours assise, le sang lui remonte, la poitrine est irritée, l’estomac embarrassé, la tête injectée. Si on la tient longtemps debout, comme la repasseuse, comme celle qui compose en imprimerie, elle a d’autres accidents sanguins. Elle peut travailler beaucoup, mais en variant l’attitude, comme elle fait dans son ménage, allant et venant.
Il faut qu’elle ait un ménage, il faut qu’elle soit mariée.
La demoiselle bien élevée, comme on dit, qui peut enseigner, devenir gouvernante dans une famille, professeur de certains arts, se tire-t-elle mieux d’affaire ? Je voudrais pouvoir dire : Oui. Ces situations plus douces n’entraînent pas moins pour elle une infinité de chances scabreuses, au total une vie trouble, une destinée avortée, parfois tragique. Tout est difficulté pour la femme seule, tout impasse ou précipice.
Il y a quinze ans, je reçus la visite d’une jeune et aimable demoiselle que ses parents envoyaient de la province à Paris. On l’adressait à un ami de la famille qui pouvait l’aider à gagner sa vie en lui procurant des leçons. J’exprimai l’étonnement que me donnait leur imprudence. Alors, elle me dit tout. On l’envoyait dans ce péril pour en éviter un autre. Elle avait dans son pays un amant plein de mérite, et qui voulait l’épouser ; c’était le plus honnête homme, c’était un homme de talent. Mais, hélas ! il était pauvre. « Mes parents l’aiment, l’estiment, dit-elle, mais craignent que nous ne mourions de faim. »
Je lui dis sans hésiter : « Il vaut mieux mourir de faim que de courir le cachet sur le pavé de Paris. Je vous engage, mademoiselle, à retourner, non pas demain, mais aujourd’hui, chez vos parents. Chaque heure que vous restez ici vous fera perdre cent pour cent. Seule, inexpérimentée, que deviendrez-vous ? »
Elle suivit mon conseil. Ses parents consentirent. Elle épousa. Sa vie fut très difficile, pleine des plus dures épreuves, exemplaire et honorable. Partagée péniblement entre le soin de ses enfants et l’aide très intelligente qu’elle donnait aux travaux de son mari, je la vois encore l’hiver courant aux bibliothèques où elle faisait des recherches pour lui. Avec toutes ces misères, et la douleur qu’on avait de ne pouvoir secourir leur fière pauvreté, jamais je n’ai regretté le conseil que je lui donnai. Elle jouit beaucoup par le cœur, ne souffrit que de la fortune. Il n’y eut jamais meilleur ménage. Elle arriva à la mort aimée, pure et honorée.
La pire destinée pour la femme, c’est de vivre seule.
Seule ! le mot même est triste à dire… Et comment se fait-il sur la terre qu’il y ait une femme seule !
Eh quoi ! il n’est donc plus d’hommes ? Sommes-nous aux derniers jours du monde ? la fin, l’approche du Jugement dernier nous rend-elle si égoïstes, qu’on se resserre dans l’effroi de l’avenir et dans la honte des plaisirs solitaires ?
On reconnaît la femme seule au premier coup d’œil. Prenez-la dans son voisinage, partout où elle est regardée, elle a l’attitude dégagée, libre, élégamment légère, qui est propre aux femmes de France. Mais dans un quartier où elle se croit moins observée, elle se laisse aller ; quelle tristesse ! quel abattement visible ! J’en rencontrai l’hiver dernier, jeunes encore, mais en décadence, tombées du chapeau au bonnet, un peu maigries, un peu pâlies (d’ennui, d’anxiété ? de faible et de mauvaise nourriture ?). Pour les refaire belles et charmantes, il eût suffi de peu de chose : quelque espoir, trois mois de bonheur.
Que de gênes pour une femme seule ! Elle ne peut guère sortir le soir ; on la prendrait pour une fille. Il est mille endroits où l’on ne voit que des hommes, et si une affaire l’y mène, on s’étonne, on rit sottement. Par exemple, qu’elle se trouve attardée au bout de Paris, qu’elle ait faim, elle n’osera pas entrer chez un restaurateur. Elle y ferait évènement, elle y serait un spectacle. Elle aurait constamment tous les yeux fixés sur elle, entendrait des conjectures hasardées, désobligeantes. Il faut qu’elle retourne à une lieue, qu’arrivée tard, elle allume du feu, prépare son petit repas. Elle évite de faire du bruit, car un voisin curieux (un étourdi d’étudiant, un jeune employé, que sais-je ?) mettrait l’œil à la serrure, ou indiscrètement, pour entrer, offrirait quelque service. Les communautés gênantes, disons mieux, les servitudes de nos grandes vilaines casernes, qu’on appelle des maisons, la rendent craintive en mille choses, hésitante à chaque pas. Tout est embarras pour elle, et tout liberté pour l’homme. Combien, par exemple, elle s’enferme, si le dimanche, ses jeunes et bruyants voisins font entre eux, comme il arrive, ce qu’on appelle un repas de garçon !
Examinons cette maison.
Elle demeure au quatrième, et elle fait si peu de bruit que le locataire du troisième avait cru quelque temps n’avoir personne au-dessus de lui. Il n’est guère moins malheureux qu’elle. C’est un monsieur que sa santé délicate, et un peu d’aisance, ont dispensé de rien faire. Sans être vieux, il a déjà les habitudes prudentes d’un homme toujours occupé de se conserver lui-même. Un piano qui l’éveille un peu plus tôt qu’il ne voudrait a révélé la solitaire. Puis, une fois, il a entrevu sur l’escalier une aimable figure de femme un peu pâle, de svelte élégance, et il est devenu curieux. Rien de plus aisé. Les concierges ne sont pas muets, et sa vie est si transparente ! Moins les moments où elle donne ses leçons, elle est toujours chez elle, toujours à étudier. Elle prépare des examens, aimant mieux être gouvernante, avoir l’abri d’une famille. Enfin, on en dit tant de bien que le monsieur devient rêveur. « Ah ! si je n’étais pas pauvre ! dit-il. Il est bien agréable d’avoir la société d’une jolie femme à vous, qui comprend tout, vous dispense de traîner vos soirées au spectacle ou au café. Mais quand on n’a, comme moi, que dix mille livres de rente, on ne peut pas se marier. »
Il calcule alors, suppute son budget, mais en faisant le double compte qu’ils font en pareil cas, réunissant les dépenses probables de l’homme marié et celles du célibataire qui continuerait le café, le spectacle, etc. C’est ainsi qu’un de mes amis, un des plus spirituels journalistes de Paris, trouvait que pour vivre deux, sans domestique, dans une maisonnette de banlieue, il faut trente mille livres de rente.
Cette lamentable vie, d’honorable solitude et d’ennui désespéré, c’est celle que mènent les ombres errantes qu’on appelle en Angleterre les membres de clubs. Cela commence aussi en France. Fort bien nourris, fort bien chauffés, dans ces établissements splendides, trouvant là tous les journaux et de riches bibliothèques, vivant ensemble comme des morts bien élevés et polis, ils progressent dans le spleen et se préparent au suicide. Tout est si bien organisé que la parole est inutile ; il n’est même besoin de signes. À tels jours de l’année, le tailleur se présente et prend mesure, sans qu’on ait besoin de parler. Point de femme. Et encore moins irait-on chez une fille. Mais, une fois par semaine, une demoiselle apportera des gants, ou tel objet payé d’avance, et sortira sans bruit au bout de cinq minutes.
J’ai parfois, en omnibus, rencontré une jeune fille modestement mise, mais en chapeau toutefois, qui avait les yeux sur un livre et ne s’en détachait pas. Si près assis, sans regarder, je voyais. Le plus souvent, le livre était quelque grammaire ou un de ces manuels pour préparer les examens. Petits livres, épais et compactes, où toute science est concentrée sous forme sèche, indigeste, comme à l’état de caillou. Elle se mettait pourtant tout cela sur l’estomac, la jeune victime. Visiblement, elle s’acharnait à absorber le plus possible. Elle y employait les jours et les nuits, même les moments de repos que l’omnibus lui offrait entre ses courses et ses leçons données aux deux bouts de Paris. Cette pensée inexorable la suivait. Elle n’avait garde de lever les yeux, la terreur de l’examen pesait trop. On ne sait pas combien elles sont peureuses. J’en ai vu qui, plusieurs semaines d’avance, ne se couchaient plus, ne respiraient plus, ne faisaient plus que pleurer.
Il faut avoir compassion.
Notez que, dans l’état actuel de nos mœurs, je suis très grand partisan de ces examens qui facilitent une existence un peu plus libre, au total, honorable. Je ne demande pas qu’on les simplifie, qu’on resserre le champ des études qui sont demandées. J’y voudrais pourtant une autre méthode ; en histoire par exemple, un petit nombre de grands faits capitaux, mais circonstanciés, détaillés et non des tables de matières. Je soumets cette réflexion à mes savants collègues et amis, qui sont juges de ces examens.
Je voudrais encore qu’on ménageât davantage la timidité, que les examens fussent publics, mais pour les dames seulement, qu’on n’admit d’hommes tout au plus que les parents des demoiselles. Il est dur de leur faire subir cette épreuve devant un public curieux (comme cela arrive dans certaines villes). Il faudrait aussi laisser à chacune le choix du jour de l’examen. Pour plusieurs, l’épreuve est terrible, et, sans cette précaution, peut les mettre en danger de mort.
Eugène Sue, dans un roman faible d’exécution, mais d’observation excellente (la Gouvernante), donne le tableau très vrai de la vie d’une demoiselle transportée tout à coup dans une maison étrangère dont elle doit élever les enfants. Égale ou supérieure par l’éducation, modeste de position, le plus souvent de caractère, elle n’intéresse que trop. Le père en est fort touché, le fils se déclare amoureux ; les domestiques sont jaloux des égards dont elle est l’objet, la calomnient, etc. Mais que de choses à ajouter ? Combien, chez Sue, est incomplète la triste Iliade de ce qu’elle a à souffrir, même à craindre de dangers ? On pourrait citer des faits étonnants, incroyables. Ici c’est la passion du père portée jusqu’au crime, entreprenant d’effrayer une gouvernante vertueuse, lui coupant son linge, ses robes, même brûlant un jour ses rideaux ! Là, c’est une mère corrompue qui, voulant gagner du temps et marier son fils le plus tard possible, trouve très bon qu’en attendant il trompe une pauvre demoiselle sans conséquence, qui n’a ni parents, ni protecteur. Elle flatte, caresse la fille crédule, et, sans qu’il y paraisse, arrange des occasions, des hasards calculés. Au contraire, j’ai vu ailleurs la maîtresse de maison, si violente et si jalouse, rendant la vie si amère à la triste créature, que, par l’excès des souffrances, elle prenait justement son abri sous la protection du mari.
La tentation est naturelle pour une jeune âme, fière et pure, courageuse contre le sort, de sortir de la dépendance individuelle, et de s’adresser à tous, de prendre un seul protecteur, le public, et de croire qu’elle pourra vivre du fruit de sa pensée.
Que les femmes pourraient ici nous faire de révélations ! Une seule a conté cette histoire dans un roman très fort, dont le défaut est d’être court, de sorte que les situations n’arrivent pas à tout leur effet. Ce livre, une Fausse position, a paru il y a quinze ans et disparu aussitôt. C’est l’itinéraire exact, le livre de route d’une pauvre femme de lettres, le relevé des péages, octrois, taxes de barrières, droits d’entrée, etc., qu’on exige d’elle pour lui permettre quelques pas ; l’aigreur, l’irritation que sa résistance lui crée tout autour, de sorte que tous l’environnent d’obstacles, que dis-je ? d’obstacles meurtriers.
Avez-vous vu en Provence des enfants ameutés contre un insecte qu’ils croient dangereux ? Ils disposent autour de lui des pailles ou des brins secs, puis allument… De quelque côté que la pauvre créature s’élance, elle trouve la flamme, se brûle cruellement, retombe ; et cela plusieurs fois ; elle essaye toujours d’un courage obstiné, toujours en vain. Elle ne peut passer le cercle de feu.
C’est la même chose au théâtre. La femme énergique et belle, qui se sent de la force au cœur, se dit : « Par la littérature, il me faut subir les intermédiaires qui disposent de l’opinion. Sur la scène, je suis en personne par-devant mon juge, le public, je plaide moi-même pour moi. Je n’ai pas besoin qu’on dise : “Elle a du talent !” – Mais je dis : “Voyez !” »
Quelle erreur ! la foule décide bien moins par ce qu’elle voit que par ce qu’on lui dit être le jugement de la foule. On est touché de cette actrice, mais chacun hésite à le dire. Chacun attendra, craindra le ridicule d’un entraînement passionné. Il faudra que les censeurs autorisés, les moqueurs de profession, aient donné le signal de l’admiration. Alors le public éclate, ose admirer, dépasse même tout ce que lui aurait dicté son émotion personnelle.
Mais, seulement pour arriver à ce jour du jugement où elle aura tout à craindre, que de fâcheux préalables ! que d’hommes intéressés, suspects, indélicats, disposent souverainement de son sort !
Par quelles filières, quelles épreuves, ont réussi les débuts ? comment s’est-elle concilié ceux qui la présentent et la recommandent ? puis, le directeur auquel elle est présentée ? plus tard, l’auteur à la mode qui ferait pour elle un rôle ? les critiques en dernier lieu ? Et je ne parle pas ici des grands organes de la presse qui se respectent un peu, mais des plus obscurs, des plus inconnus. Il suffit qu’un jeune employé, qui passe sa vie dans tel ministère à tailler des plumes, ait griffonné à son bureau quelques lignes satiriques, qu’une petite feuille les reçoive, les répande dans l’entracte. Animée, encouragée des premiers applaudissements, elle rentre en scène belle d’espoir… mais ne reconnaît plus la salle. Tout est brisé, le public glacé. On se regarde en riant.
J’étais jeune quand je vis une scène bien forte, dont je suis resté indigné. J’aime à croire que de nos jours les choses ne sont plus ainsi.
Chez un de ces terribles juges que je connaissais, je vois arriver une petite personne, fort simplement mise, d’une figure douce et bonne, fatiguée déjà et un peu fanée. Elle lui dit, sans préface, qu’elle venait lui demander grâce, qu’elle le priait du moins de lui dire pourquoi il ne passait pas un jour sans la cribler, l’accabler. Il répondit hardiment, non pas qu’elle jouait mal, mais qu’elle était impolie, qu’à un premier article assez favorable elle eût dû répondre par un signe de reconnaissance, une marque solide de souvenir. « Hélas ! monsieur, je suis si pauvre ! je ne gagne presque rien, et je dois soutenir ma mère. – Peu m’importe ! ayez un amant… – Mais je ne suis pas jolie. Et d’ailleurs je suis si triste !… On n’aime que les femmes gaies… – Non, vous ne m’en ferez pas accroire. Vous êtes jolie, mademoiselle, et c’est mauvaise volonté. Vous êtes fière, cela ne vaut rien. Il faut faire comme les autres, il faut avoir un amant. » Il ne sortit pas de là.
Je n’ai jamais compris comment on avait la force de siffler une femme. Chacun d’eux est peut-être bon, et ils sont cruels en masse. Cela arrive parfois dans telle ville de province. Pour forcer le directeur à dépenser plus qu’il ne peut, et à faire venir les premiers talents, on exécute chaque soir une infortunée qui, elle-même, aurait du talent, mais qui, sous cet acharnement, ce honteux supplice, perd la tête, chancelle, bégaye, ne sait plus ce qu’elle dit. Elle pleure, reste muette, implore des yeux… On rit, on siffle. Elle s’irrite, se révolte contre une si grande barbarie. Mais alors, c’est une tempête si horrible et si féroce, qu’elle tombe, demande pardon…
Maudit qui brise une femme, qui lui ôte ce qu’elle avait de fierté, de courage, d’âme ! Dans une Fausse position, ce moment est marqué d’une manière si tragique et si vraie, qu’on sent que c’est la nature même ; cela est pris sur le vif. Camille, la femme de lettres, habilement entourée du cercle de feu, n’ayant plus d’issue, veut mourir. Elle n’en est empêchée que par un hasard imprévu, une occasion inévitable, impérieuse, de faire quelque bien encore. Attendrie par la charité, amollie, elle perd les forces que l’orgueil prêtait à son désespoir. Un sauveur lui vient, elle cède. La voilà humble, désarmée par le grand dilemme qui corrompit tant les mystiques : « Si le vice est un péché, l’orgueil est un plus grand péché. » Elle est devenue tout à coup, celle qui portait la tête si haut, bonne, docile, obéissante. Elle fait l’aveu de la femme : « J’ai besoin d’un maître. Commandez, dirigez… Je ferai ce qu’on voudra. »
Ah ! dès qu’elle est une femme, dès qu’elle est douce, pas fière, tout est ami, tout s’aplanit. Les saints lui savent gré d’être humble. Les mondains en ont bon espoir. Les portes se rouvrent devant elle, et littérature et théâtre. On travaille, on conspire pour elle. Plus elle est morte de cœur, mieux elle est posée dans la vie. Les apparences redeviennent excellentes. Tout ce qui fit guerre à l’artiste, à la femme laborieuse et indépendante, est bon pour la femme soumise (désormais entretenue).
L’auteur du roman, à la fin, torture, mais sauve l’héroïne. Il lui met un fer brûlant au cœur, celui d’un véritable amour. Elle succombe, perd l’esprit avant sa dégradation. Peu ont ce bonheur ; la plupart ont déjà trop souffert, trop baissé pour sentir si vivement ; elles subissent leur sort, sont esclaves, – esclaves grasses et florissantes.
Esclaves de qui ? direz-vous. De cet être incertain et inconnu qui d’autant moins est responsable, et d’autant plus est léger, sans égard et sans pitié. Son nom ? C’est Nemo, le nom sous lequel Ulysse s’affranchit du cyclope. Ici, c’est le cyclope même, le minotaure dévorant. C’est Personne, et c’est Tout le monde.
J’ai dit qu’elle était esclave. Plus misérablement esclave que le nègre du planteur, plus que la fille publique numérotée du ruisseau. Comment ? Parce que ces misérables, du moins, n’ont pas d’inquiétude, ne craignent pas le chômage, sont nourries par leurs tyrans. La pauvre camellia, au contraire, n’est sûre de rien. On peut la quitter tous les jours, et la laisser mourir de faim. Elle semble gaie, insouciante. Son métier est de sourire. Elle sourit, et dit cependant : « Peut-être affamée demain !… Et pour retraite, une borne ! »