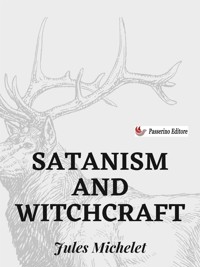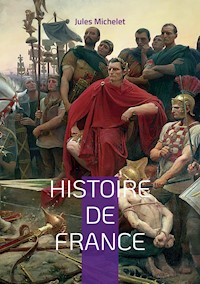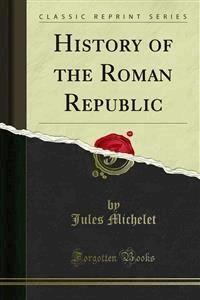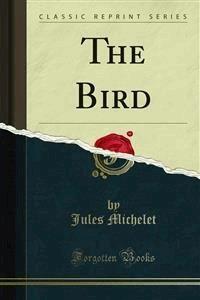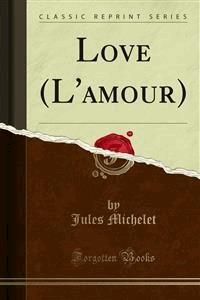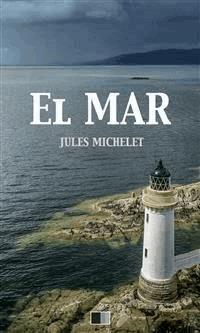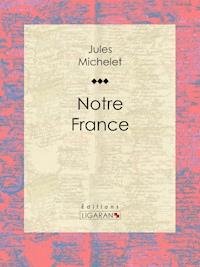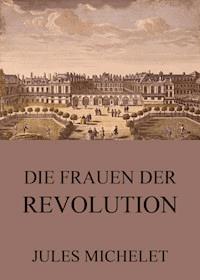Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
"La Sorcière, écrit par Jules Michelet, est un livre captivant qui plonge le lecteur au cœur de l'histoire sombre et mystérieuse des sorcières. Publié en 1862, cet ouvrage est considéré comme l'un des premiers à aborder ce sujet de manière approfondie et documentée.
Michelet, historien français renommé, nous emmène dans un voyage à travers le temps, explorant les croyances, les superstitions et les persécutions qui ont entouré les sorcières depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge. Avec une plume passionnée et érudite, il nous dévoile les différentes facettes de ces femmes accusées de pactiser avec le diable et de pratiquer la magie noire.
L'auteur nous offre une analyse psychologique des sorcières, cherchant à comprendre les raisons qui les ont poussées à embrasser cette voie dangereuse. Il explore également les liens entre la sorcellerie et la condition féminine, mettant en lumière les injustices et les discriminations dont les femmes ont été victimes à travers les siècles.
La Sorcière est un livre qui ne se contente pas de relater des faits historiques, mais qui cherche également à dénoncer les préjugés et les violences infligées aux femmes au nom de la superstition. Michelet nous invite à réfléchir sur les mécanismes de la peur et de l'intolérance, et à remettre en question les jugements hâtifs et les stéréotypes qui persistent encore de nos jours.
Ce livre, à la fois instructif et captivant, est un véritable chef-d'œuvre de l'histoire et de la littérature. La plume envoûtante de Michelet nous transporte dans un univers fascinant où se mêlent sorcellerie, magie et oppression. La Sorcière est un incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des femmes, à la sorcellerie et à la lutte contre les préjugés.
Extrait : ""La femme s'ingénie, imagine : elle enfante des songes et des dieux. Elle est voyante à certain jour ; elle a l'aile infinie du désir et du rêve. Pour mieux compter les temps, elle observe le ciel. Mais la terre n'a pas moins son cœur. Les yeux baissés sur les fleurs amoureuses, jeune et fleur elle-même, elle fait avec elles connaissance personnelle. Femme, elle leur demande de guérir ceux qu'elle aime."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335001129
Des livres que j’ai publiés, celui-ci me paraît le plus inattaquable. Il ne doit rien à la chronique légère ou passionnée. Il est sorti généralement des actes judiciaires.
Je dis ceci non seulement pour nos grands procès (de Gauffridi, de la Cadière, etc.), mais pour une foule de faits que nos savants prédécesseurs ont pris dans les archives allemandes, anglaises, etc., et que nous avons reproduits.
Les manuels d’inquisiteurs ont aussi contribué. Il faut bien les croire dans tant de choses où ils s’accusent eux-mêmes.
Quant aux commencements, aux temps qu’on peut appeler l’âge légendaire de la sorcellerie, les textes innombrables qu’ont réunis Grimm, Soldan, Wright, Maury, etc., m’ont fourni une base excellente.
Pour ce qui suit, de 1400 à 1600 et au-delà, mon livre a ses assises bien plus solides encore dans les nombreux procès jugés et publics.
J.MICHELET.
1er décembre 1862.
Sprenger dit (avant 1500) : « Il faut dire l’hérésie des sorcières, et non des sorciers ; ceux-ci sont peu de chose. » – Et un autre sous Louis XIII : « Pour un sorcier, dix mille sorcières. »
« Nature les fait sorcières. » – C’est le génie propre à la Femme et son tempérament. Elle naît Fée. Par le retour régulier de l’exaltation, elle est Sibylle. Par l’amour, elle est Magicienne. Par sa finesse, sa malice (souvent fantasque et bienfaisante), elle est Sorcière et fait le sort, du moins endort, trompe les maux.
Tout peuple primitif a même début ; nous le voyons par les Voyages. L’homme chasse et combat. La femme s’ingénie, imagine : elle enfante des songes et des dieux. Elle est voyante à certain jour ; elle a l’aile infinie du désir et du rêve. Pour mieux compter les temps, elle observe le ciel. Mais la terre n’a pas moins son cœur. Les yeux baissés sur les fleurs amoureuses, jeune et fleur elle-même, elle fait avec elles connaissance personnelle. Femme, elle leur demande de guérir ceux qu’elle aime.
Simple et touchant commencement des religions et des sciences ! Plus tard, tout se divisera ; on verra commencer l’homme spécial, jongleur, astrologue ou prophète, nécromancien, prêtre, médecin. Mais, au début, la Femme est tout.
Une religion forte et vivace, comme fut le paganisme grec, commence par la sibylle, finit par la sorcière. La première, belle vierge, en pleine lumière, le berça, lui donna le charme et l’auréole. Plus tard, déchu, malade, aux ténèbres du Moyen Âge, aux laudes et aux forêts, il fut caché par la sorcière ; sa pitié intrépide le nourrit, le fit vivre encore. Ainsi, pour les religions, la Femme est mère, tendre gardienne et nourrice fidèle. Les dieux sont comme les hommes ; ils naissent et meurent sur son sein.
Que sa fidélité lui coûte !… Reines mages de la Perse, ravissante Circé ! sublime Sibylle, hélas ! qu’êtes-vous devenues ? et quelle barbare transformation !… Celle qui, du trône d’Orient, enseigna les vertus des plantes et le voyage des étoiles, celle qui, au trépied de Delphes, rayonnante du dieu de lumière, donnait ses oracles au monde à genoux, – c’est elle, mille ans après, qu’on chasse comme une bête sauvage, qu’on poursuit aux carrefours, honnie, tiraillée, lapidée, assise sur les charbons ardents !…
Le clergé n’a pas assez de bûchers, le peuple assez d’injures, l’enfant assez de pierres, contre l’infortunée. Le poète (aussi enfant) lui lance une autre pierre, plus cruelle pour une femme. Il suppose, gratuitement, qu’elle était toujours laide et vieille. Au mot Sorcière, on voit les affreuses vieilles de Macbeth. Mais leurs cruels procès apprennent le contraire. Beaucoup périrent précisément parce qu’elles étaient jeunes et belles.
La Sibylle prédisait le sort. Et la Sorcière le fait. C’est la grande, la vraie différence. Elle évoque, elle conjure, opère la destinée. Ce n’est pas la Cassandre antique qui voyait si bien l’avenir, le déplorait, l’attendait. Celle-ci crée cet avenir. Plus que Circé, plus que Médée, elle a en main la baguette du miracle naturel, et pour aide et sœur la Nature. Elle a déjà des traits du Prométhée moderne. En elle commence l’industrie, surtout l’industrie souveraine qui guérit, refait l’homme. Au rebours de la Sibylle, qui semblait regarder l’aurore, elle regarde le couchant ; mais justement ce couchant sombre donne, longtemps avant l’aurore (comme il arrive aux pics des Alpes), une aube anticipée du jour.
Le prêtre entrevoit bien que le péril, l’ennemie, la rivalité redoutable, est dans celle qu’il fait semblant de mépriser, la prêtresse de la Nature. Des dieux anciens, elle a conçu des dieux. Auprès du Satan du passé, on voit en elle poindre un Satan de l’avenir.
L’unique médecin du peuple, pendant mille ans, fut la Sorcière. Les empereurs, les rois, les papes, les plus riches barons, avaient quelques docteurs de Salerne, des Maures, des Juifs, mais la masse de tout état, et l’on peut dire le monde, ne consultait que la Saga ou Sage-femme. Si elle ne guérissait, on l’injuriait, on l’appelait sorcière. Mais généralement par un respect mêlé de crainte, on la nommait Bonne dame, ou Belle dame (bella donna), du nom même qu’on donnait aux Fées.
Il lui advint ce qui arrive encore à sa plante favorite, la Belladonne, à d’autres poisons salutaires qu’elle employait et qui furent l’antidote des grands fléaux du Moyen Âge. L’enfant, le passant ignorant, maudit ces sombres fleurs avant de les connaître. Elles l’effrayent par leurs couleurs douteuses. Il recule, il s’éloigne. Ce sont là pourtant les Consolantes (Solanées), qui, discrètement administrées, ont guéri si souvent, endormi tant de maux.
Vous les trouvez aux plus sinistres lieux, isolés, mal famés, aux masures, aux décombres. C’est encore là une ressemblance qu’elles ont avec celle qui les employait. Où aurait-elle vécu, sinon aux landes sauvages, l’infortunée qu’on poursuivit tellement, la maudite, la proscrite, l’empoisonneuse qui guérissait, sauvait ? la fiancée du Diable et du Mal incarné, qui a fait tant de bien, au dire du grand médecin de la Renaissance. Quand Paracelse, à Bâle, en 1527, brûla toute la médecine, il déclara ne savoir rien que ce qu’il apprit des sorcières.
Cela valait une récompense. Elles l’eurent. On les paya en tortures, en bûchers. On trouva des supplices exprès ; on leur inventa des douleurs. On les jugeait en masse, on les condamnait sur un mot. Il n’y eut jamais une telle prodigalité de vies humaines. Sans parler de l’Espagne, terre classique des bûchers, où le Maure et le Juif ne vont jamais sans la sorcière, on en brûle sept mille à Trêves, et je ne sais combien à Toulouse, à Genève cinq-cents en trois mois (1513), huit-cents à Wurtzbourg, presque d’une fournée, mille cinq cents à Bamberg (deux tout petits évêchés !). Ferdinand II lui-même, le bigot, le cruel empereur de la guerre de Trente ans, fut obligé de surveiller ces bons évêques ; ils eussent brûlé tous leurs sujets. Je trouve, dans la liste de Wurtzbourg, un sorcier de onze ans, qui était à l’école, une sorcière de quinze, à Bayonne deux de dix-sept, damnablement jolies.
Notez qu’à certaines époques, par ce seul mot Sorcière, la haine tue qui elle veut. Les jalousies de femmes, les cupidités d’hommes, s’emparent d’une arme si commode. Telle est riche ?… Sorcière. – Telle est jolie ?… Sorcière. On verra la Murgui, une petite mendiante, qui, de cette pierre terrible, marque au front pour la mort, la grande dame, trop belle, la châtelaine de Lancinena.
Les accusées, si elles peuvent, préviennent la torture et se tuent. Rémy, l’excellent juge de Lorraine, qui en brûla huit cents, triomphe de cette Terreur. « Ma justice est si bonne, dit-il, que seize, qui furent arrêtées l’autre jour, n’attendirent pas, s’étranglèrent tout d’abord. »
Sur la longue voie de mon Histoire, dans les trente ans que j’y ai consacrés, cette horrible littérature de sorcellerie m’a passé, repassé fréquemment par les mains. J’ai épuisé d’abord et les manuels de l’inquisition, les âneries des dominicains (Fouets, Marteaux, Fourmilières, Fustigations, Lanternes, etc., ce sont les titres de leurs livres). Puis, j’ai lu les parlementaires, les juges lais qui succèdent à ces moines, les méprisent et ne sont guère moins idiots. J’en dis un mot ailleurs. Ici, une seule observation, c’est que, de 1300 à 1600, et au-delà, la justice est la même. Sauf un entracte dans le Parlement de Paris, c’est toujours et partout même férocité de sottise. Les talents n’y font rien. Le spirituel De Lancre, magistrat bordelais du règne d’Henri IV, fort avancé en politique, dès qu’il s’agit de sorcellerie, retombe au niveau d’un Nider, d’un Sprenger, des moines imbéciles du quinzième siècle.
On est saisi d’étonnement en voyant ces temps si divers, ces hommes de culture différente, ne pouvoir avancer d’un pas. Puis on comprend très bien que les uns et les autres furent arrêtés, disons plus, aveuglés, irrémédiablement enivrés et ensauvagés, par le poison de leur principe. Ce principe est le dogme de fondamentale injustice : « Tous perdus pour un seul, non seulement punis, mais dignes de l’être, gâtés d’avance et pervertis, morts à Dieu même avant de naître. L’enfant qui tète est un damné. »
Qui dit cela ? Tous, Bossuet même. Un docteur important de Rome, Spina, maître du Sacré Palais, formule nettement la chose : « Pourquoi Dieu permet-il la mort des innocents ? Il le fait justement. Car s’ils ne meurent à cause des péchés qu’ils ont faits, ils meurent toujours coupables pour le péché originel. » (De Strigibus, c. 9.)
De cette énormité, deux choses dérivent, et en justice et en logique. Le juge est toujours sûr de son affaire ; celui qu’on lui amène est coupable certainement, et, s’il se défend, encore plus. La justice n’a pas à suer fort, à se casser la tête, pour distinguer le vrai du faux. En tout, on part d’un parti pris. Le logicien, le scolastique n’a que faire d’analyser l’âme, et de se rendre compte des nuances par où elle passe, de sa complexité, de ses oppositions intérieures et de ses combats. Il n’a pas besoin, comme nous de s’expliquer comment cette âme, de degré en degré, peut devenir vicieuse. Ces finesses, ces tâtonnements, s’il pouvait les comprendre, oh ! comme il en rirait, hocherait la tête ! et qu’avec grâce alors oscilleraient les superbes oreilles dont son crâne vide est orné !
Quand il s’agit surtout du Pacte diabolique, du traité effroyable où pour un petit gain d’un jour, l’âme se vend aux tortures éternelles, nous chercherions nous autres à retrouver la voie maudite, l’épouvantable échelle de malheurs et de crimes qui l’auront fait descendre là. Notre homme a bien affaire de tout cela ! Pour lui l’âme et le diable étaient nés l’un pour l’autre, si bien qu’à la première tentation, pour un caprice, une envie, une idée qui passe, du premier coup l’âme se jette à cette horrible extrémité.
Je ne vois pas non plus que nos modernes se soient enquis beaucoup de la chronologie morale de la sorcellerie. Ils s’attachent trop aux rapports du Moyen Âge avec l’Antiquité. Rapports réels, mais faibles, de petite importance. Ni la vieille Magicienne, ni la Voyante celtique et germanique ne sont encore la vraie Sorcière. Les innocentes Sabasies (de Bacchus Sabasius), petit sabbat rural, qui dura dans le Moyen Âge, ne sont nullement la Messe noire du quatorzième siècle, le grand défi solennel à Jésus. Ces conceptions terribles n’arrivèrent pas par la longue filière de la tradition. Elles jaillirent de l’horreur du temps.
D’où date la Sorcière ? Je dis sans hésiter : « Des temps du désespoir. »
Du désespoir profond que fit le monde de l’Église. Je dis sans hésiter : « La Sorcière est son crime. »
Je ne m’arrête nullement à ses doucereuses explications qui font semblant d’atténuer : « Faible, légère, était la créature, molle aux tentations. Elle a été induite à mal par la concupiscence. » Hélas ! dans la misère, la famine de ces temps, ce n’est pas là ce qui pouvait troubler jusqu’à la fureur diabolique. Si la femme amoureuse, jalouse et délaissée, si l’enfant chassée par la belle-mère, si la mère battue de son fils (vieux sujets de légendes), si elles ont pu être tentées, invoquer le mauvais Esprit, tout cela n’est pas la Sorcière. De ce que ces pauvres créatures appellent Satan, il ne suit pas qu’il les accepte. Elles sont loin encore, et bien loin d’être mûres pour lui. Elles n’ont pas la haine de Dieu.
Pour comprendre un peu mieux cela, lisez les registres exécrables qui nous restent de l’Inquisition, non pas dans les extraits de Llorente, de Lamothe-Langon, etc., mais dans ce qu’on a des registres originaux de Toulouse. Lisez-les dans leur platitude, leur morne sécheresse, si effroyablement sauvage. Au bout de quelques pages, on se sent morfondu. Un froid cruel vous prend. La mort, la mort, la mort, c’est ce qu’on sent dans chaque ligne. Vous êtes déjà dans la bière, ou dans une petite loge de pierre aux murs moisis. Les plus heureux sont ceux qu’on tue. L’horreur, c’est l’in pace. C’est ce mot qui revient sans cesse, comme une cloche d’abomination qu’on sonne et qu’on résonne, mot toujours le même : Emmurés.
Épouvantable mécanique d’écrasement, d’aplatissement, cruel pressoir à briser l’âme. De tour de vis en tour de vis, ne respirant plus et craquant, elle jaillit de la machine, et tomba au monde inconnu.
À son apparition, la Sorcière n’a ni père, ni mère, ni fils, ni époux, ni famille. C’est un monstre, un aérolithe, venu on ne sait d’où. Qui oserait, grand Dieu ! en approcher ?
Où est-elle ? Aux lieux impossibles, dans la forêt des ronces, sur la lande, où l’épine, le chardon emmêlés, ne permettent pas le passage. La nuit, sous quelque vieux dolmen. Si on l’y trouve, elle est isolée par l’horreur commune ; elle a autour comme un cercle de feu.
Qui le croira pourtant ? c’est une femme encore. Même cette vie terrible presse et tend son ressort de femme, l’électricité féminine. La voilà douée de deux dons :
L’illuminisme de la folie lucide, qui, selon ses degrés, est poésie, seconde vue, pénétration perçante, la parole naïve et rusée, la faculté surtout de se croire en tous ses mensonges. Don ignoré du sorcier mâle. Avec lui, rien n’eût commencé.
De ce don un autre dérive, la sublime puissance de la conception solitaire, la parthénogenèse que nos physiologistes reconnaissent maintenant dans les femelles de nombreuses espèces pour la fécondité du corps, et qui n’est pas moins sûre pour les conceptions de l’esprit.
Seule, elle conçut et enfanta. Qui ? Une autre elle-même qui lui ressemble à s’y tromper.
Fils de haine, conçu de l’amour. Car sans l’amour, on ne crée rien. Celle-ci, tout effrayée qu’elle est de cet enfant, s’y retrouve si bien, se complaît tellement eu cette idole, qu’elle la place à l’instant sur l’autel, l’honore, s’y immole, et se donne comme victime et vivante hostie. Elle-même bien souvent le dira à son juge : « Je ne crains qu’une chose : souffrir trop peu pour lui. » (Lancre.)
Savez-vous bien le début de l’enfant ? C’est un terrible éclat de rire. N’a-t-il pas sujet d’être gai, sur sa libre prairie, loin des cachots d’Espagne et des emmurés de Toulouse. Son in pace n’est pas moins que le monde. Il va, vient, se promène. À lui la forêt sans limite ! à lui la lande des lointains horizons ! à lui toute la terre dans la rondeur de sa riche ceinture ! La sorcière lui dit tendrement : « Mon Robin » du nom de ce vaillant proscrit, le joyeux Robin Hood, qui vit sous la verte fouillée. Elle aime aussi à le nommer du petit nom de Verdelet, Joli-bois, Vertbois. Ce sont les lieux favoris de l’espiègle. À peine eut-il vu un buisson, qu’il fit l’école buissonnière.
Ce qui étonne, c’est que du premier coup la Sorcière vraiment fit un être. Il a tous les semblants de la réalité. On l’a vu, entendu. Chacun peut le décrire.
Les saints, ces bien-aimés, les fils de la maison, se remuent peu, contemplent, rêvent ; ils attendent en attendant, sûrs qu’ils auront leur part d’Élus. Le peu qu’ils ont d’actif se concentre dans le cercle resserré de l’Imitation (ce mot est tout le Moyen Âge). – Lui, le bâtard maudit, dont la part n’est rien que le fouet, il n’a garde d’attendre. Il va cherchant et jamais ne repose. Il s’agite, de la terre au ciel. Il est fort curieux, fouille, entre, sonde, et met le nez partout. Du Consummatum est il se rit, il se moque. Il dit toujours : « Plus loin ! » – et « En avant ! »
Du reste, il n’est pas difficile. Il prend tous les rebuts ; ce que le ciel jette, il ramasse. Par exemple, l’Église a jeté la Nature, comme impure et suspecte. Satan s’en saisit, s’en décore. Bien plus, il l’exploite et s’en sert, en fait jaillir des arts, acceptant le grand nom dont on veut le flétrir, celui de Prince du monde.
On avait dit imprudemment : « Malheur à ceux qui rient ! » C’était donner d’avance à Satan une trop belle part, le monopole du rire et le proclamer amusant. Disons plus : nécessaire. Car le rire est une fonction essentielle de notre nature. Comment porter la vie, si nous ne pouvons rire, tout au moins parmi nos douleurs ?
L’Église, qui ne voit dans la vie qu’une épreuve, se garde de la prolonger. Sa médecine est la résignation, l’attente et l’espoir de la mort. – Vaste champ pour Satan. Le voilà médecin, guérisseur des vivants. – Bien plus, consolateur : il a la complaisance de nous montrer nos morts, d’évoquer les ombres aimées.
Autre petite chose rejetée de l’Église, la Logique, la libre Raison. C’est là la grande friandise dont l’autre avidement se saisit.
L’Église avait bâti à chaux et à ciment un petit in pace, étroit, à voûte basse, éclairé d’un jour borgne, d’une certaine fente. Cela s’appelait l’École. On y lâchait quelques tondus, et on leur disait : « Soyez libres. » Tous y devenaient culs-de-jatte. Trois cents, quatre cents ans confirment la paralysie. Et le point d’Abailard est justement celui d’Occam !
Il est plaisant qu’on aille chercher là l’origine de la Renaissance. Elle eut lieu, mais comment ? par la satanique entreprise des gens qui ont percé la voûte, par l’effort de damnés qui voulaient voir le ciel. Et elle eut lieu bien plus encore, loin de l’École et des lettrés, dans l’École buissonnière, où Satan fit la classe à la sorcière et au berger.
Enseignement hasardeux, s’il en fut, mais dont les hasards même exaltaient l’amour curieux, le désir effréné de voir et de savoir. – Là commencèrent les mauvaises sciences, la pharmacie défendue des poisons, et l’exécrable anatomie. – Le berger, espion des étoiles, avec l’observation du ciel, apportait là ses coupables recettes, ses essais sur les animaux. – La sorcière apportait du cimetière voisin un corps volé ; et pour la première fois (au risque du bûcher) on pouvait contempler ce miracle de Dieu « qu’on cache sottement, au lieu de le comprendre » (comme a dit si bien M. Serres).
Le seul docteur admis là par Satan, Paracelse y a vu un tiers, qui parfois se glissait dans l’assemblée sinistre, y apportait la chirurgie. – C’était le chirurgien de ces temps de bonté, le bourreau, l’homme à la main hardie, qui jouait à propos du fer, cassait les os et savait les remettre, qui tuait et parfois sauvait, pendait jusqu’à un certain point.
L’université criminelle de la sorcière, du berger, du bourreau, dans ses essais qui furent des sacrilèges, enhardit l’autre, força sa concurrente d’étudier. Car chacun voulait vivre. Tout eût été à la sorcière ; on aurait pour jamais tourné le dos au médecin. – Il fallut bien que l’Église subît, permît ces crimes. Elle avoua qu’il est de bons poisons (Grillandus). Elle laissa, contrainte et forcée, disséquer publiquement. En 1306, l’italien Mondino ouvre et dissèque une femme ; une en 1315. – Révélation sacrée, Découverte d’un monde (c’est bien plus que Christophe Colomb). Les sots frémirent, hurlèrent. Et les sages tombèrent à genoux.
Avec de telles victoires, Satan était bien sûr de vivre. Jamais l’Église seule n’aurait pu le détruire. Les bûchers n’y firent rien, mais bien certaine politique.
On divisa habilement le royaume de Satan. Contre sa fille, son épouse, la Sorcière, on arma son fils, le Médecin.
L’Église, qui, profondément, de tout son cœur, haïssait celui-ci, ne lui fonda pas moins son monopole, pour l’extinction de la Sorcière. Elle déclare, au quatorzième siècle, que si la femme ose guérir sans avoir étudié, elle est sorcière et meurt.
Mais comment étudierait-elle publiquement ? Imaginez la scène risible, horrible, qui eût eu lieu, si la pauvre sauvage eût risqué d’entrer aux Écoles ! Quelle fête et quelle gaieté ! Aux feux de la Saint-Jean, on brûlait des chats enchaînés. Mais la sorcière liée à cet enfer miaulant, la sorcière hurlante et rôtie, quelle joie pour l’aimable jeunesse des moinillons et des cappets !
On verra tout au long la décadence de Satan. Lamentable récit. On le verra pacifié, devenu un bon vieux. On le vole, on le pille, au point que des deux masques qu’il avait au Sabbat, le plus sale est pris par Tartuffe.
Son esprit est partout. Mais lui-même, de sa personne, en perdant la Sorcière, il perdait tout. – Les sorciers furent des ennuyeux.
Maintenant qu’on l’a précipité tellement vers son déclin, sait-on bien ce qu’on a fait là ? – N’était-il pas un acteur nécessaire, une pièce indispensable de la grande machine religieuse, un peu détraquée aujourd’hui ? – Tout organisme qui fonctionne bien est double, a deux côtés. La vie ne va guère autrement. C’est un certain balancement de deux forces, opposées, symétriques, mais inégales ; l’inférieure fait contrepoids, répond à l’autre. La supérieure s’impatiente, et veut la supprimer. – À tort.
Lorsque Colbert (1672) destitua Satan avec peu de façon en défendant aux juges de recevoir les procès de sorcellerie, le tenace Parlement normand, dans sa bonne logique normande, montra la portée dangereuse d’une telle décision. Le diable n’est pas moins qu’un dogme, qui tient à tous les autres. Toucher à l’éternel vaincu, n’est-ce pas toucher au vainqueur ? Douter des actes du premier, cela mène à douter des actes du second, des miracles qu’il fit précisément pour combattre le Diable. Les colonnes du ciel ont leur pied dans l’abîme. L’étourdi qui remue cette base infernale, peut lézarder le paradis.
Colbert n’écouta pas. Il avait tant d’autres affaires. – Mais le diable peut-être entendit. Et cela le console fort. Dans les petits métiers où il gagne sa vie (spiritisme ou tables tournantes), il se résigne, et croit que du moins il ne meurt pas seul.
Certains auteurs nous assurent que, peu de temps avant la victoire du christianisme, une voix mystérieuse courait sur les rives de la mer Égée, disant : « Le grand Pan est mort. »
L’antique dieu universel de la Nature était fini. Grande joie. On se figurait que, la Nature étant morte, morte était la tentation. Troublée si longtemps de l’orage, l’âme humaine va donc reposer.
S’agissait-il simplement de la fin de l’ancien culte, de sa défaite, de l’éclipse des vieilles formes religieuses ? Point du tout. En consultant les premiers monuments chrétiens, on trouve à chaque ligne l’espoir que la Nature va disparaître, la vie s’éteindre, qu’enfin on touche à la fin du monde. C’en est fait des dieux de la vie, qui en ont si longtemps prolongé l’illusion. Tout tombe, s’écroule, s’abîme. Le Tout devient le Néant : « Le grand Pan est mort ! »
Ce n’était pas une nouvelle que les dieux dussent mourir. Nombre de cultes anciens sont fondés précisément sur l’idée de la mort des dieux. Osiris meurt, Adonis meurt, il est vrai, pour ressusciter. Eschyle, sur le théâtre même, dans ces drames qu’on ne jouait que pour les fêtes des dieux, leur dénonce expressément, par la voix de Prométhée, qu’un jour ils doivent mourir. Mais comment ? vaincus, et soumis aux Titans, aux puissances antiques de la Nature.
Ici, c’est bien autre chose. Les premiers chrétiens, dans l’ensemble et dans le détail, dans le passé, dans l’avenir, maudissent la Nature elle-même. Ils la condamnent tout entière, jusqu’à voir le mal incarné, le démon dans une fleur. Viennent donc, plus tôt que plus tard, les anges qui jadis abîmèrent les villes de la mer Morte. Qu’ils emportent, plient comme un voile la vaine figure du monde, qu’ils délivrent enfin les saints de cette longue tentation.
L’Évangile dit : « Le jour approche. » Les Pères disent : « Tout à l’heure. » L’écroulement de l’Empire et l’invasion des Barbares donnent espoir à saint Augustin qu’il ne subsistera de cité bientôt que la cité de Dieu.
Qu’il est pourtant dur à mourir, ce monde, et obstiné à vivre ! Il demande, comme Ézéchias, un répit, un tour de cadran. Eh bien, soit, jusqu’à l’an Mille. Mais après, pas un jour de plus.
Est-il bien sûr, comme on l’a tant répété, que les anciens dieux fussent finis, eux-mêmes ennuyés, las de vivre ! qu’ils aient, de découragement, donné presque leur démission ? que le christianisme n’ait eu qu’à souffler sur ces vaines ombres ?
On montre ces dieux dans Rome, on les montre dans le Capitole, où ils n’ont été admis que par une mort préalable, je veux dire en abdiquant ce qu’ils avaient de sève locale, en reniant leur patrie, en cessant d’être les génies représentant les nations. Pour les recevoir, il est vrai, Rome avait pratiqué sur eux une sévère opération, les avait énervés, pâlis. Ces grands dieux centralisés étaient devenus, dans leur vie officielle, de tristes fonctionnaires de l’empire romain. Mais cette aristocratie de l’Olympe, en sa décadence, n’avait nullement entraîné la foule des dieux indigènes, la populace des dieux encore en possession de l’immensité des campagnes, des bois, des monts, des fontaines, confondus intimement avec la vie de la contrée. Ces dieux logés au cœur des chênes, dans les eaux fuyantes et profondes, ne pouvaient en être expulsés.
Et qui dit cela ? c’est l’Église. Elle se contredit rudement. Quand elle a proclamé leur mort, elle s’indigne de leur vie de siècle en siècle, par la voix menaçante de ses conciles, elle leur intime de mourir… Eh quoi ! ils sont donc vivants ?
« Ils sont des démons… » – Donc, ils vivent. Ne pouvant en venir à bout, on laisse le peuple innocent les habiller, les déguiser. Par la légende, il les baptise, les impose à l’Église même. Mais, du moins, sont-ils convertis ? Pas encore. On les surprend qui sournoisement subsistent en leur propre nature païenne.
Où sont-ils ? Dans le désert, sur la lande, dans la forêt ? Oui, mais surtout dans la maison. Ils se maintiennent au plus intime des habitudes domestiques. La femme les garde et les cache au ménage et au lit même. Ils ont là le meilleur du monde (mieux que le temple), le foyer.
Il n’y eut jamais de révolution si violente que celle de Théodose. Nulle trace dans l’Antiquité d’une telle proscription d’aucun culte. Le Perse adorateur du feu, dans sa pureté héroïque, peut outrager les dieux visibles, mais il les laissa subsister. Il fut très favorable aux Juifs, les protégea, les employa. La Grèce, fille de la lumière, se moqua des dieux ténébreux, des Cabires ventrus, et elle les toléra pourtant, les adopta comme ouvriers, si bien qu’elle en fit son Vulcain. Rome, dans sa majesté, accueillit, non seulement l’Étrurie, mais les dieux rustiques du vieux laboureur italien. Elle ne poursuivit les druides que comme une dangereuse résistance nationale.
Le christianisme vainqueur voulut, crut tuer l’ennemi. Il rasa l’École, par la proscription de la logique, et par l’extermination des philosophes, qui furent massacrés sous Valens. Il rasa ou vida le Temple, brisa les symboles. La légende nouvelle aurait pu être favorable à la famille, si le père n’y eût été annulé dans saint Joseph, si la mère avait été relevée comme éducatrice, comme ayant moralement enfanté Jésus. Voie féconde qui fut tout d’abord délaissée par l’ambition d’une haute pureté stérile.
Donc le christianisme entra au chemin solitaire où le monde allait de lui-même, le célibat, combattu en vain par les lois des Empereurs. Il se précipita sur cette pente par le monachisme.
Mais l’homme au désert fut-il seul ? Le démon lui tint compagnie, avec toutes les tentations. Il eut beau faire, il lui fallut recréer des sociétés, des cités de solitaires. On sait ces noires villes de moines qui se formèrent en Thébaïde. On sait quel esprit turbulent, sauvage, les anima, leurs descentes meurtrières dans Alexandrie. Ils se disaient troublés, poussés du démon, et ne mentaient pas.
Un vide énorme s’était fait dans le monde. Qui le remplissait ? Les chrétiens le disent, le démon, partout le démon : Ubique dæmon.
La Grèce, comme tous les peuples, avait eu ses énergumènes, troublés, possédés des esprits. C’est un rapport tout extérieur, une ressemblance apparente qui ne ressemble nullement. Ici, ce ne sont pas des esprits quelconques. Ce sont les noirs fils de l’abîme, idéal de perversité. On voit partout dès lors errer ces pauvres mélancoliques qui se haïssent, ont horreur d’eux-mêmes. Jugez, en effet, ce que c’est, de se sentir double, d’avoir foi en cet autre, cet hôte cruel qui va, vient, se promène en vous, vous fait errer où il veut, aux déserts, aux précipices. Maigreur, faiblesse croissantes. Et plus ce corps misérable est faible, plus le démon l’agite. La femme surtout est habitée, gonflée, soufflée de ces tyrans. Ils l’emplissent d’aura infernale, y font l’orage et la tempête, s’en jouent, au gré de leur caprice, la font pécher, la désespèrent.
Ce n’est pas nous seulement, hélas ! c’est toute la nature qui devient démoniaque. Si le diable est dans une fleur, combien plus dans la forêt sombre ! La lumière qu’on croyait si pure est pleine des enfants de la nuit. Le ciel plein d’enfer ! quel blasphème ! L’étoile divine du matin, dont la scintillation sublime a plus d’une fois éclairé Socrate, Archimède ou Platon, qu’est-elle devenue ? Un diable, le grand diable Lucifer. Le soir, c’est le diable Vénus, qui m’induit en tentation dans ses molles et douces clartés.
Je ne m’étonne pas si cette société devient terrible et furieuse. Indignée de se sentir si faible contre les démons, elle les poursuit partout, dans les temples, les autels de l’ancien culte d’abord, puis dans les martyrs païens. Plus de festins ; ils peuvent être des réunions idolâtriques. Suspecte est la famille même ; car l’habitude pourrait la réunir autour des lares antiques. Et pourquoi une famille ? L’Empire est un empire de moines.
Mais l’individu lui-même, l’homme isolé et muet, regarde le ciel encore, et dans les astres retrouve et honore ses anciens dieux. « C’est ce qui fait les famines, dit l’empereur Théodose, et tous les fléaux de l’empire. » Parole terrible qui lâche sur le païen inoffensif l’aveugle rage populaire. La loi déchaîne à l’aveugle toutes les fureurs contre la loi.
Dieux anciens, entrez au sépulcre. Dieux de l’amour, de la vie, de la lumière, éteignez-vous ! Prenez la capuche du moine. Vierges, soyez religieuses. Épouses, délaissez vos époux ; ou, si vous gardez la maison, restez pour eux de froides sœurs.
Mais tout cela, est-ce possible ? qui aura le souffle assez fort pour éteindre d’un seul coup la lampe ardente de Dieu ? Cette tentative téméraire de piété impie pourra faire des miracles étranges, monstrueux… Coupables, tremblez !
Plusieurs fois, dans le Moyen Âge, reviendra la sombre histoire de la Fiancée de Corinthe. Racontée de si bonne heure par Phlégon, l’affranchi d’Adrien, on la retrouve au douzième siècle, on la retrouve au seizième, comme le reproche profond, l’indomptable réclamation de la Nature.
« Un jeune homme d’Athènes va à Corinthe, chez celui qui lui promit sa fille. Il est resté païen, et ne sait pas que la famille où il croyait entrer vient de se faire chrétienne. Il arrive fort tard. Tout est couché, hors la mère, qui lui sert le repas de l’hospitalité, et le laisse dormir. Il tombe de fatigue. À peine il sommeillait, une figure entre dans la chambre : c’est une fille, vêtue, voilée de blanc ; elle a au front un bandeau noir et or. Elle le voit. Surprise, levant sa blanche main : « Suis-je donc déjà si étrangère dans la maison ?… Hélas ! pauvre recluse… Mais, j’ai honte, et je sors. Repose. – Demeure, belle jeune fille, voici Cérès, Bacchus, et, avec toi, l’Amour ! N’aie pas peur, ne sois pas si pâle ! – Ah ! loin de moi, jeune homme ! Je n’appartiens plus à la joie. Par un vœu de ma mère malade, la jeunesse et la vie sont liées pour toujours. Les dieux ont fui. Et les seuls sacrifices sont des victimes humaines. – Eh quoi ! ce serait toi ? toi, ma chère fiancée, qui me fus donnée dès l’enfance ? Le serment de nos pères nous lia pour toujours sous la bénédiction du ciel. Ô vierge ! sois à moi ! – Non, ami, non, pas moi. Tu auras ma jeune sœur. Si je gémis dans ma froide prison, toi, dans ses bras, pense à moi, à moi qui me consume et ne pense qu’à toi, et que la terre va recouvrir. – Non, j’en atteste cette flamme ; c’est le flambeau d’hymen. Tu viendras avec moi chez mon père. Reste, ma bien-aimée. » – Pour don de noces, il offre une coupe d’or. Elle lui donne sa chaîne, mais préfère à la coupe une boucle de ses cheveux.
C’est l’heure des esprits ; elle boit, de sa lèvre pâle, le sombre vin couleur de sang. Il boit avidement après elle. Il invoque l’Amour. Elle, son pauvre cœur s’en mourait, et elle résistait pourtant. Mais il se désespère, et tombe en pleurant sur le lit. – Alors, se jetant près de lui : « Ah ! que la douleur me fait mal ! Mais, si tu me touchais, quel effroi ! Blanche comme la neige, froide comme la glace, hélas ! telle est ta fiancée. – Je te réchaufferai ; viens à moi ! quand tu sortirais du tombeau… » Soupirs, baisers, s’échangent. « Ne sens-tu pas comme je brûle ? » – L’amour les étreint et les lie. Les larmes se mêlent au plaisir. Elle boit, altérée, le feu de sa bouche ; le sang figé s’embrase de la rage amoureuse, mais le cœur ne bat pas au sein.
Cependant la mère était là, écoutait. Doux serments, cris de plainte et de volupté. – « Chut ! c’est le chant du coq ! À demain, dans la nuit ! » Puis, adieu, baisers sur baisers !
La mère entre indignée. Que voit-elle ? Sa fille. Il la cachait, l’enveloppait. Mais elle se dégage, et grandit du lit à la voûte : « Ô mère ! mère ! vous m’enviez donc ma belle nuit, vous me chassez de ce lieu tiède. N’était-ce pas assez de m’avoir roulée dans le linceul, et sitôt portée au tombeau ? Mais une force a levé la pierre. Vos prêtres eurent beau bourdonner sur la fosse. Que font le sel et l’eau, où brûle la jeunesse ? La terre ne glace pas l’amour !… Vous promîtes ; je viens redemander mon bien…
Las ! ami, il faut que tu meures. Tu languirais, tu sécherais ici. J’ai tes cheveux ; ils seront blancs demain… Mère, une dernière prière ! Ouvrez mon noir cachot, élevez un bûcher, et que l’amante ait le repos des flammes. Jaillisse l’étincelle et rougisse la cendre ! Nous irons à nos anciens dieux. »
« Soyez des enfants nouveau-nés (quasi modo geniti infantes) ; soyez tout petits, tout jeunes par l’innocence du cœur, par la paix, l’oubli des disputes, sereins, sous la main de Jésus. »
C’est l’aimable conseil que donne l’Église à ce monde si orageux, le lendemain de la grande chute. Autrement dit : « Volcans, débris, cendres, lave verdissez. Champs brûlés, couvrez-vous de fleurs. » Une chose promettait, il est vrai, la paix qui renouvelle : toutes les écoles étaient finies, la voie logique abandonnée.
Une méthode infiniment simple dispensait du raisonnement, donnait à tous la pente aisée qu’il ne fallait plus que descendre. Si le credo était obscur, la vie était toute tracée dans le sentier de la légende. Le premier mot, le dernier fut le même : Imitation.
« Imitez, tout ira bien. Répétez et copiez. » Mais est-ce bien là le chemin de la véritable enfance, qui vivifie le cœur de l’homme, qui lui fait retrouver les sources fraîches et fécondes ? Je ne vois d’abord dans ce monde, qui fait le jeune et l’enfant, que des attributs de vieillesse, subtilité, servilité, impuissance. Qu’est-ce que cette littérature devant les monuments sublimes des Grecs et des Juifs ? même devant le génie romain ? C’est précisément la chute littéraire qui eut lieu dans l’Inde, du brahmanisme au bouddhisme ; un verbiage bavard après la haute inspiration. Les livres copient les livres, les églises copient les églises, et ne peuvent plus même copier. Elles se volent les unes les autres. Des marbres arrachés de Ravenne, on orne Aix-la-Chapelle. Telle est toute cette société. L’évêque roi d’une cité, le barbare roi d’une tribu, copient les magistrats romains. Nos moines, qu’on croit originaux, ne font dans leur monastère que renouveler la villa (dit très bien Chateaubriand). Ils n’ont nulle idée de faire une société nouvelle, ni de féconder l’ancienne. Copistes des moines d’Orient, ils voudraient d’abord que leurs serviteurs fussent eux-mêmes de petits moines laboureurs, un peuple stérile. C’est malgré eux que la famille se refait, refait le monde.
Quand on voit que ces vieillards vont si vite vieillissant, quand, en un siècle, l’on tombe du sage moine saint Benoît au pédantesque Benoît d’Aniane, on sent bien que ces gens-là furent parfaitement innocents de la grande création populaire qui fleurit sur les ruines : je parle des Vies des saints. Les moines les écrivirent, mais le peuple les faisait. Cette jeune végétation peut jeter des feuilles et des fleurs par les lézardes de la vieille masure romaine convertie en monastère, mais elle n’en vient pas à coup sûr. Elle a sa racine profonde dans le sol ; le peuple l’y sème, et la famille l’y cultive, et tous y mettent la main, les hommes, les femmes et les enfants. La vie précaire, inquiète, de ces temps de violence, rendait ces pauvres tribus imaginatives, crédules pour leurs propres rêves, qui les rassuraient, Rêves étranges, riches de miracles, de folies absurdes et charmantes.
Ces familles, isolées dans la forêt, dans la montagne (comme on vit encore au Tyrol, aux Hautes-Alpes), descendant un jour par semaine, ne manquaient pas au désert d’hallucinations. Un enfant avait vu ceci, une femme avait rêvé cela. Un saint tout nouveau surgissait. L’histoire courait dans la campagne, comme en complainte, rimée grossièrement. On la chantait et la dansait le soir au chêne de la fontaine. Le prêtre qui, le dimanche, venait officier dans la chapelle des bois trouvait ce chant légendaire déjà dans toutes les bouches. Il se disait : « Après tout, l’histoire est belle, édifiante… Elle fait honneur à l’Église. Vox populi, vox Dei !…. Mais comment l’ont-ils trouvée ? » On lui montrait des témoins véridiques, irrécusables, l’arbre, la pierre, qui ont vu l’apparition, le miracle. Que dire à cela ?
Rapportée à l’abbaye, la légende trouvera un moine, propre à rien, qui ne sait qu’écrire, qui est curieux, qui croit tout, toutes les choses merveilleuses. Il écrit celle-ci, la brode de sa plate rhétorique, gâte un peu. Mais la voici consignée et consacrée, qui se lit au réfectoire, bientôt à l’église. Copiée, chargée, surchargée d’ornements souvent grotesques, elle ira de siècle en siècle, jusqu’à ce que honorablement elle prenne rang à la fin dans la Légende dorée.
Lorsqu’on lit encore aujourd’hui ces belles histoires, quand on entend les simples, naïves et graves mélodies où ces populations rurales ont mis tout leur jeune cœur, on ne peut y méconnaître un grand souffle, et l’on s’attendrit en songeant quel fut leur sort.
Ils avaient pris à la lettre le conseil touchant de l’Église : « Soyez des enfants nouveau-nés. » Mais ils en firent l’application à laquelle on songeait le moins dans la pensée primitive. Autant le christianisme avait craint, haï la Nature, autant ceux-ci l’aimèrent, la crurent innocente, la sanctifièrent, même en la mêlant à la légende.
Les animaux que la Bible si durement nomme les velus, dont le moine se défie, craignant d’y trouver des démons, ils entrent dans ces belles histoires de la manière la plus touchante (exemple, la biche qui réchauffe, console Geneviève de Brabant).
Même hors de la vie légendaire, dans l’existence commune, les humbles amis du foyer, les aides courageux du travail, remontent dans l’estime de l’homme. Ils ont leur droit. Ils ont leurs fêtes. Si, dans l’immense bonté de Dieu, il y a place pour les plus petits, s’il semble avoir pour eux une préférence de pitié, « pourquoi, dit le peuple des champs, pourquoi mon âne n’aurait-il pas entrée à l’église ? Il a des défauts, sans doute, et ne me ressemble que plus. Il est rude travailleur, mais il a la tête dure ; il est indocile, obstiné, entêté, enfin, c’est tout comme moi. »
De là les fêtes admirables, les plus belles du Moyen Âge, des Innocents, des Fous, de l’Âne. C’est le peuple même d’alors, qui, dans l’âne, traîne son image, se présente devant l’autel, laid, risible, humilié ! Touchant spectacle ! Amené par Balaam, il entre solennellement entre la Sibylle et Virgile, il entre pour témoigner. S’il regimba jadis contre Balaam, c’est qu’il voyait devant lui le glaive de l’ancienne loi. Mais ici la Loi est finie, et le monde de la Grâce semble s’ouvrir à deux battants pour les moindres, pour les simples. Le peuple innocemment le croit. De là la chanson sublime où il disait à l’âne, comme il se fût dit à lui-même :
Rude audace ! Est-ce bien là ce qu’on vous demandait, enfants emportés, indociles, quand on vous disait d’être enfants ? On offrait le lait. Vous buvez le vin. On vous conduisait doucement bride en main sur l’étroit sentier. Doux, timides, vous hésitiez d’avancer. Et tout à coup la bride est cassée… La carrière, vous la franchissez d’un seul bond.
Oh ! quelle imprudence ce fut de vous laisser faire vos saints, dresser l’autel, le parer, le charger, l’enterrer de fleurs ! Voilà qu’on le distingue à peine. Et ce qu’on voit, c’est l’hérésie antique condamnée de l’Église, l’innocence de la nature ; que dis-je ! une hérésie nouvelle qui ne finira pas demain : l’indépendance de l’homme.
Écoutez et obéissez :
Défense d’inventer, de créer. Plus de légendes, plus de nouveaux saints. On en a assez. Défense d’innover dans le culte par de nouveaux chants ; l’inspiration est interdite. Les martyrs qu’on découvrirait doivent se tenir dans le tombeau, modestement, et attendre qu’ils soient reconnus de l’Église. Défense au clergé, aux moines, de donner aux colons, aux serfs, la tonsure qui les affranchit. – Voilà l’esprit étroit, tremblant de l’Église carolingienne. Elle se dédit, se dément, elle dit aux enfants : « Soyez vieux ! »
Quelle chute ! Mais est-ce sérieux ? On nous avait dit d’être jeunes. – Oh ! le prêtre n’est plus le peuple. Un divorce infini commence, un abîme de séparation. Le prêtre, seigneur et prince, chantera sous une chape d’or, dans la langue souveraine du grand empire qui n’est plus. Nous, triste troupeau, ayant perdu la langue de l’homme, la seule que veuille entendre Dieu, que nous reste-t-il, sinon de mugir et de bêler, avec l’innocent compagnon qui ne nous dédaigne pas, qui l’hiver nous réchauffe à l’étable et nous couvre de sa toison ? Nous vivrons avec les muets et serons muets nous-mêmes.
En vérité, l’on a moins le besoin d’aller à l’église. Mais elle ne nous tient pas quittes. Elle exige que l’on revienne écouter ce qu’on n’entend plus.
Dès lors un immense brouillard, un pesant brouillard gris de plomb, a enveloppé ce monde. Pour combien de temps, s’il vous plaît ? Dans une effroyable durée de mille ans ! Pendant dix siècles entiers, une langueur inconnue à tous les âges antérieurs a tenu le Moyen Âge, même en partie les derniers temps, dans un état mitoyen entre la veille et le sommeil, sous l’empire d’un phénomène désolant, intolérable, la convulsion d’ennui qu’on appelle : le bâillement.
Que l’infatigable cloche sonne aux heures accoutumées, l’on bâille ; qu’un chant nasillard continue dans le vieux latin, l’on bâille. Tout est prévu ; on n’espère rien de ce monde. Les choses reviendront les mêmes. L’ennui certain de demain fait bâiller dès aujourd’hui, et la perspective des jours, des années d’ennui qui suivront, pèse d’avance, dégoûte de vivre. Du cerveau à l’estomac, de l’estomac à la bouche, l’automatique et fatale convulsion va distendant les mâchoires sans fin ni remède. Véritable maladie que la dévote Bretagne avoue, l’imputant, il est vrai, à la malice du diable. Il se tient tupi dans les bois, disent les paysans bretons ; à celui qui passe et garde les bêtes il chante vêpres et tous les offices, et le fait bâiller à mort.
Être vieux, c’est être faible. Quand les Sarrasins, les Northmans, nous menacent, que deviendrons-nous si le peuple reste vieux ? Charlemagne pleure, l’Église pleure. Elle avoue que les reliques contre ces démons barbares ne protègent plus l’autel. Ne faudrait-il pas appeler le bras de l’enfant indocile qu’on allait lier, le bras du jeune géant qu’on voulait paralyser ? Mouvement contradictoire qui remplit le neuvième siècle. On relie le peuple, on le lance. On le craint et on l’appelle. Avec lui, par lui, à la hâte, on fait des barrières, des abris qui arrêteront les barbares, couvriront les prêtres et les saints, échappés de leurs églises.
Malgré le Chauve empereur, qui défend que l’on bâtisse, sur la montagne s’élève une tour. Le fugitif y arrive. « Recevez-moi au nom de Dieu, au moins ma femme et mes enfants. Je camperai avec mes bêtes dans votre enceinte extérieure. » La tour lui rend confiance et il sent qu’il est un homme. Elle l’ombrage. Il la défend, protège son protecteur.
Les petits jadis, par famine, se donnaient aux grands comme serfs. Mais ici, grande différence. Il se donne comme vassal, qui veut dire brave et vaillant.
Il se donne et il se garde, se réserve de renoncer. « J’irai plus loin. La terre est grande. Moi aussi, tout comme un autre, je puis là-bas dresser ma tour… Si j’ai défendu le dehors, je saurai me garder dedans. »
C’est la grande, la noble origine du monde féodal. L’homme de la tour recevait des vassaux, mais en leur disant : « Tu t’en iras quand tu voudras, et je t’y aiderai, s’il le faut ; à ce point que, si tu t’embourbes, moi je descendrai de cheval. » C’est exactement la formule antique.
Mais, un matin, qu’ai-je vu ? Est-ce que j’ai la vue trouble ? Le seigneur de la vallée fait sa chevauchée autour, pose les bornes infranchissables, et même d’invisibles limites. « Qu’est cela ?… Je ne comprends point. » – Cela dit que la seigneurie est fermée. « Le seigneur, sous porte et gonds, la tient close, du ciel à la terre. »
Horreur ! En vertu de quel droit ce vassus (c’est-à-dire vaillant) est-il désormais retenu ? – On soutiendra que vassus peut aussi vouloir dire esclave.
De même le mot servus, qui se dit pour serviteur (souvent très haut serviteur, un comte ou prince d’Empire), signifiera pour le faible un serf, un misérable dont la vie vaut un denier.
Par cet exécrable filet, ils sont pris. Là-bas cependant, il y a dans sa terre un homme qui soutient que sa terre est libre, un aleu, un fief du soleil. Il s’assoit sur une borne, il enfonce son chapeau, regarde passer le seigneur, regarde passer l’Empereur. « Va ton chemin, passe, Empereur… Tu es ferme sur ton cheval, et moi sur ma borne encore plus. Tu passes, et je ne passe pas… Car je suis la Liberté. »
Mais je n’ai pas le courage de dire ce que devient cet homme. L’air s’épaissit autour de lui, et il respire de moins en moins. Il semble qu’il soit enchante. Il ne peut plus se mouvoir. Il est comme paralysé. Ses bêtes aussi maigrissent, comme si un sort était jeté. Ses serviteurs meurent de faim. Sa terre ne produit plus rien. Des esprits la rasent la nuit.
Il persiste cependant : « Povre homme en sa maison roy est. »
Mais on ne le laisse pas là. Il est cité, et il doit répondre en cour impériale. Il va, spectre du vieux, monde, que personne ne connaît plus. « Qu’est-ce que c’est ? disent les jeunes. Quoi ! il n’est seigneur, ni serf ! Mais alors il n’est donc rien ? »
« Qui suis-je ?… Je suis celui qui bâtit la première tour, celui qui vous défendit, celui qui, laissant la tour, alla bravement au pont attendre les païens Northmans… Bien plus, je barrai la rivière, je cultivai l’alluvion, j’ai créé la terre elle-même, comme Dieu qui la tira des eaux… Cette terre, qui m’en chassera ?
« Non, mon ami, dit le voisin, on ne te chassera pas. Tu la cultiveras, cette terre… mais autrement que tu ne crois… Rappelle-toi, mon bonhomme, qu’étourdiment, jeune encore (il y a cinquante ans de cela), tu épousas Jacqueline, petite serve de mon père… Rappelle-toi la maxime : « Qui monte ma poule est mon coq. » – Tu es de mon poulailler. Déceins-toi, jette l’épée… Dès ce jour, tu es mon serf. »
Ici, rien n’est d’invention. Cette épouvantable histoire revient sans cesse au Moyen Âge. Oh ! de quel glaive il fut percé ! J’ai abrégé, j’ai supprimé, car chaque fois qu’on s’y reporte, le même acier, la même pointe aiguë traverse le cœur.