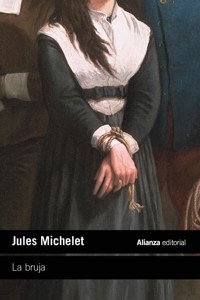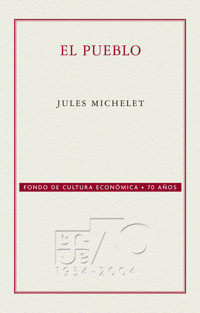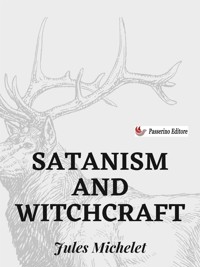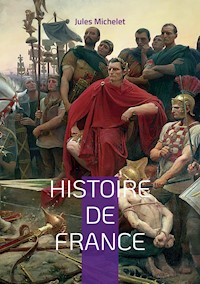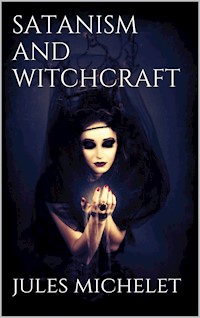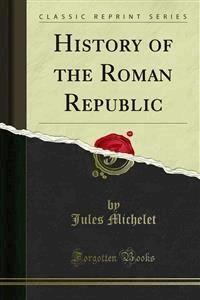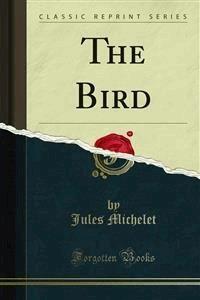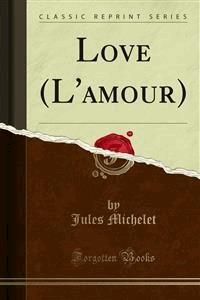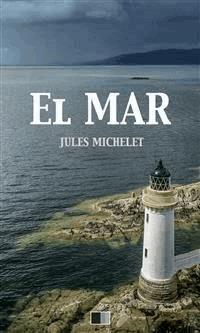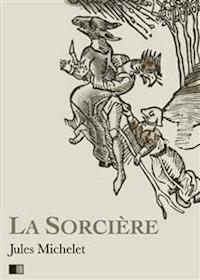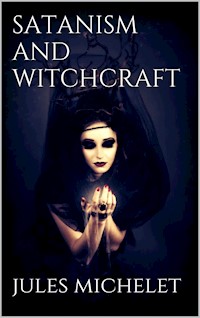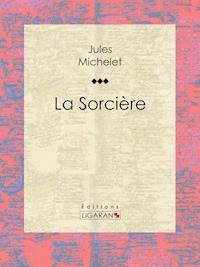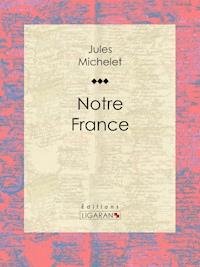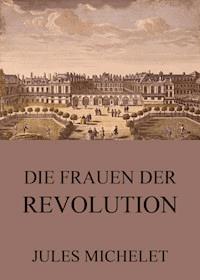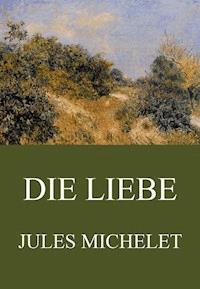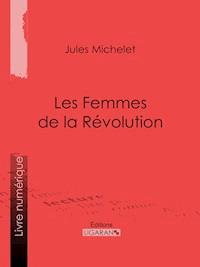
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
"Les Femmes de la Révolution, écrit par Jules Michelet, est un ouvrage captivant qui met en lumière le rôle essentiel des femmes pendant la période tumultueuse de la Révolution française.
Dans cet ouvrage, Michelet nous plonge au cœur de cette époque charnière de l'histoire de la France, où les femmes ont joué un rôle souvent méconnu mais pourtant crucial. L'auteur met en avant des figures emblématiques telles que Marie-Antoinette, Charlotte Corday, Olympe de Gouges et bien d'autres, qui ont marqué cette période de leur empreinte.
À travers une plume vive et passionnée, Michelet nous dévoile les différentes facettes de la vie des femmes pendant la Révolution. Il explore leurs luttes, leurs espoirs, leurs sacrifices et leurs aspirations, tout en soulignant leur contribution à la construction d'une nouvelle société.
L'auteur ne se contente pas de dresser un simple portrait des femmes de cette époque, mais il nous offre également une analyse profonde de leur place dans la société et de leur influence sur les événements politiques et sociaux de l'époque. Il met en évidence leur rôle dans les clubs politiques, leur participation active aux débats intellectuels et leur engagement dans les mouvements révolutionnaires.
Les Femmes de la Révolution est un livre incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Révolution française et à la place des femmes dans cette période cruciale. Michelet nous offre un regard neuf et éclairant sur ces femmes souvent oubliées, mais dont l'impact sur l'histoire de la France est indéniable.
En somme, Les Femmes de la Révolution est un ouvrage passionnant qui rend hommage à ces femmes courageuses et déterminées qui ont contribué à façonner le destin de la France. À travers la plume talentueuse de Jules Michelet, nous découvrons leur histoire, leurs combats et leur héritage, et nous sommes invités à réévaluer leur place dans l'histoire de notre pays.
Extrait : ""Au moment d'apporter notre existence entière, nos fortunes et nos vies à cette grande circonstance, la plus grave qui fut jamais, chacun doit serrer sa ceinture, bien ramasser sa force, regarder dans son âme, dans sa maison, s'il est sûr d'y trouver l'unité qui fait la victoire…"""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’espèce de galerie ou musée biographique que le lecteur va parcourir se compose principalement des portraits de femmes que M. Michelet a tracés dans son Histoire de la Révolution.
Quelques-uns étaient incomplets, l’historien n’ayant dû, dans cette histoire générale, les esquisser que de profil. Il y a suppléé d’après les meilleures sources biographiques.
Plusieurs articles sont neufs, comme on le verra ; d’autres ont été refondus ou considérablement développés.
(1er mars 1854.)
Ce livre paraît le jour où l’on ferme les livres, où les évènements prennent la parole, où recommence la guerre européenne, interrompue quarante années.
Et comment liriez-vous ? vous regardez là-bas où vont vos fils, vos frères ! – ou plus près, sur la ligne où vos époux peut-être iront demain ! Votre âme est aux nouvelles, votre oreille au canon lointain ; vous écoutez inquiètes son premier coup, solennel et profond, qui tonne pour la grande guerre religieuse de l’Orient et de l’Occident.
Grande guerre, en vérité, et qu’on ne limitera pas. Pour le lieu, pour le temps, et pour le caractère, elle ira grandissant. C’est la guerre de deux dogmes, ô femmes ! de deux symboles et de deux fois, la nôtre et celle du passé. Ce caractère définitif, obscur encore dans les tâtonnements, les balbutiements de la politique, se révélera de plus en plus.
Oui, quelles que soient les formes équivoques et bâtardes, hésitantes, sous lesquelles se produit ce terrible nouveau-né du temps, dont le nom sonne la mort de tant de cent mille hommes, – la guerre, – c’est la guerre du christianisme barbare de l’Orient contre la jeune foi sociale de l’Occident civilisé. Lui-même, l’ennemi, l’a dit sans détour du Kremlin. Et la lutte nouvelle offre l’aspect sinistre de Moloch défendant Jésus.
Au moment d’apporter notre existence entière, nos fortunes et nos vies à cette grande circonstance, la plus grave qui fut jamais, chacun doit serrer sa ceinture, bien ramasser sa force, regarder dans son âme, dans sa maison, s’il est sûr d’y trouver l’unité qui fait la victoire.
Que serait-ce, dans cette guerre extérieure, si l’homme encore avait la guerre chez lui, une sourde et énervante guerre de larmes ou de muets soupirs, de douloureux silences ? si la foi du passé, assise à son foyer, l’enveloppant de résistances, de ces pleurs caressants qui brisent le cœur, lui tenait le bras gauche, quand il doit frapper des deux mains… ?
« Dis-moi donc, femme aimée ! puisque nous sommes encore à cette table de famille où je ne serai pas toujours, dis-moi, avant ce sauvage duel, quelque part qu’il me mène, seras-tu de cœur avec moi ?… Tu t’étonnes, tu jures en pleurant… Ne jure pas, je crois tout. Mais je connais ta discorde intérieure. Que feras-tu dans ces extrémités où la lutte actuelle nous conduira demain ?
À cette table où nous sommes deux aujourd’hui et où tu seras seule, élève et fortifie ton cœur. Mets devant toi l’histoire héroïque de nos mères, lis ce qu’elles ont fait et voulu, leurs dévouements suprêmes, leur glorieuse foi de 89, qui, dans une si profonde union, dressa l’autel de l’avenir.
Âge heureux d’actes forts, de grandes souffrances, mais associées, d’union dans la lutte, de communauté dans la mort !… âge où les cœurs battirent dans une telle unité d’idée, que l’Amour ne se distingua plus de la Patrie !
Plus grande aujourd’hui est la lutte, elle embrasse toute nation, – plus profonde, elle atteindra demain la plus intime fibre morale. Ce jour-là, que feras-tu pour moi ? Demande à l’histoire de nos mères, à ton cœur, à la foi nouvelle, pour qui celui que tu aimes veut combattre, vivre et mourir.
Qu’elle soit ferme en moi ! et que Dieu dispose… Sa cause est avec moi… La fortune y sera aussi et la félicité, quoi qu’il arrive, si toi, uniquement aimée, tu me restes entière, et si, unie dans mon effort et ne faisant qu’un cœur, tu traverses héroïque cette crise suprême d’où va surgir un monde. »
Tout le monde a remarqué la fécondité singulière des années 1768, 1769 et 1770, si riches en enfants de génie, ces années qui produisent les Bonaparte, les Fourier, les Saint-Simon, les Chateaubriand, les de Maistre, les Walter Scott, les Cuvier, les Geoffroy Saint-Hilaire, les Bichat, les Ampère, un incroyable flot d’inventeurs dans les sciences.
Une autre époque, antérieure de dix ans (vers 1760), n’est pas moins étonnante. C’est celle qui donna la génération héroïque qui féconda de son sang le premier sillon de la liberté, celle qui, de ce sang fécond, a fait et doué la Patrie ; c’est la Gironde et la Montagne, les Roland et les Robespierre, les Vergniaud et les Danton, les Camille Desmoulins ; c’est la génération pure, héroïque et sacrifiée qui forma les armées invincibles de la République, les Kléber et tant d’autres.
La richesse de ces deux moments, ce luxe singulier de forces qui surgissent tout à coup, est-ce un hasard ? Selon nous, il n’y a nul hasard en ce monde.
Non, la cause naturelle et très simple du phénomène, c’est la sève exubérante dont ce moment déborda.
La première date (1760 environ), c’est l’aube de Rousseau, le commencement de son influence, au premier et puissant effet du livre d’Émile, la vive émotion des mères qui veulent allaiter et se serrent au berceau de leur enfant.
La seconde date est le triomphe des idées du siècle, non seulement par la connaissance universelle de Rousseau, mais par la victoire prévue de ses idées dans les lois, par les grands procès de Voltaire, par ses sublimes défenses de Sirven, Calas et la Barre. Les femmes se turent, se recueillirent sous ces émotions puissantes, elles couvèrent le salut à venir. Les enfants à cette heure portent tous un signe au front.
Puissantes générations sorties des hautes pensées d’un amour agrandi, conçues de la flamme du ciel, nées du moment sacré, trop court, où la femme, à travers la passion, entrevit, adora l’idée.
Le commencement fut beau. Elles entrèrent dans les pensées nouvelles par celle de l’éducation, par les espérances, les vœux de la maternité, par toutes les questions que l’enfant soulève dès sa naissance en un cœur de femme, que dis-je ? dans un cœur de fille, bien longtemps avant l’enfant : « Ah ! qu’il soit heureux, cet enfant ! qu’il soit bon et grand ! qu’il soit libre !… Sainte liberté antique, qui fis les héros, mon fils vivra-t-il dans ton ombre ?… » Voilà les pensées des femmes, et voilà pourquoi dans ces places, dans ces jardins où l’enfant joue sous les yeux de sa mère ou de sa sœur, vous les voyez rêver et lire… Quel est ce livre que la jeune fille, à votre approche, a si vite caché dans son sein ? Quelque roman ? l’Héloïse ? Non, plutôt les Vies de Plutarque, ou le Contrat social.
La puissance des salons, le charme de la conversation, furent alors, quoi qu’on ait dit, secondaires dans l’influence des femmes. Elles avaient eu ces moyens au siècle de Louis XIV. Ce qu’elles eurent de plus au dix-huitième, et qui les rendit invincibles, fut l’amour enthousiaste, la rêverie solitaire des grandes idées, et la volonté d’être mères, dans toute l’extension et la gravité de ce mot.
Les spirituels commérages de madame Geoffrin, les monologues éloquents de madame de Staël, le charme de la société d’Auteuil, de madame Helvétius ou de madame Récamier, n’auraient pas changé le monde, encore moins les femmes scribes, la plume infatigable de madame de Genlis.
Ce qui, dès le milieu du siècle, changea toute la situation, c’est qu’en ces premières lueurs de l’aurore d’une nouvelle foi, au cœur des femmes, au sein des mères, se rencontrèrent deux étincelles : humanité, maternité.
Et de ces deux étincelles, ne nous en étonnons pas, sortit un flot brûlant d’amour et de féconde passion, une maternité surhumaine.
La première apparition des femmes dans la carrière de l’héroïsme (hors de la sphère de la famille) eut lieu, on devait s’y attendre, par un élan de pitié.
Cela se fût vu en tout temps, mais, ce qui est vraiment du grand siècle d’humanité, ce qui est nouveau et original, c’est une persistance étonnante dans une œuvre infiniment dangereuse, difficile et improbable, une humanité intrépide qui brava le péril, surmonta tout obstacle et dompta le temps.
Et tout cela, pour un être qui peut-être à d’autres époques n’eût intéressé personne, qui n’avait guère pour lui que d’être homme et très malheureux !
Nulle légende plus tragique que celle du prisonnier Latude ; nulle plus sublime que celle de sa libératrice, madame Legros.
Nous ne conterons pas l’histoire de la Bastille, ni celle de Latude, si connue. Il suffit de dire que, pendant que toutes les prisons s’étaient adoucies, celle-ci s’était endurcie. Chaque année on aggravait, on bouchait les fenêtres, on ajoutait des grilles.
Il se trouva qu’en ce Latude, la vieille tyrannie imbécile avait enfermé l’homme le plus propre à la dénoncer, un homme ardent et terrible, que rien ne pouvait dompter, dont la voix ébranlait les murs, dont l’esprit, l’audace, étaient invincibles… Corps de fer indestructible qui devait user toutes les prisons, et la Bastille, et Vincennes, et Charenton, enfin l’horreur de Bicêtre, où tout autre aurait péri.
Ce qui rend l’accusation lourde, accablante, sans appel, c’est que cet homme, tel quel, échappé deux fois, se livra deux fois lui-même. Une fois, de sa retraite, il écrit à madame de Pompadour, et elle le fait reprendre ! La seconde fois, il va à Versailles, veut parler au roi, arrive à son antichambre, et elle le fait reprendre… Quoi ! l’appartement du roi n’est donc pas un lieu sacré !…
Je suis malheureusement obligé de dire que dans cette société molle, faible, caduque, il y eut force philanthropes, ministres, magistrats, grands seigneurs, pour pleurer sur l’aventure ; pas un ne fit rien. Malesherbes pleura, et Lamoignon, et Rohan, tous pleuraient à chaudes larmes.
Il était sur son fumier à Bicêtre, mangé des poux à la lettre, logé sous terre, et souvent hurlant de faim. Il avait encore adressé un mémoire à je ne sais quel philanthrope, par un porte-clef ivre. Celui-ci heureusement le perd, une femme le ramasse. Elle le lit, elle frémit, elle ne pleure pas, celle-ci, mais elle agit à l’instant.
Madame Legros était une pauvre petite mercière qui vivait de son travail, en cousant dans sa boutique ; son mari, coureur de cachets, répétiteur de latin. Elle ne craignit pas de s’embarquer dans cette terrible affaire. Elle vit, avec un ferme bon sens, ce que les autres ne voyaient pas, ou bien voulaient ne pas voir : que le malheureux n’était pas fou, mais victime d’une nécessité affreuse de ce gouvernement, obligé de cacher, de continuer l’infamie de ses vieilles fautes. Elle le vit, et elle ne fut point découragée, effrayée. Nul héroïsme plus complet : elle eut l’audace d’entreprendre, la force de persévérer, l’obstination du sacrifice de chaque jour et de chaque heure, le courage de mépriser les menaces, la sagacité et toutes les saintes ruses, pour écarter, déjouer les calomnies des tyrans.
Trois ans de suite, elle suivit son but avec une opiniâtreté inouïe dans le bien, mettant à poursuivre le droit, la justice, cette âpreté singulière du chasseur ou du joueur, que nous ne mettons guère que dans nos mauvaises passions.
Tous les malheurs sur la route, et elle ne lâche pas prise. Son père meurt, sa mère meurt ; elle perd son petit commerce ; elle est blâmée de ses parents, vilainement soupçonnée. On lui demande si elle est la maîtresse de ce prisonnier auquel elle s’intéresse tant. La maîtresse de cette ombre, de ce cadavre dévoré par la gale et la vermine !
La tentation des tentations, le sommet, la pointe aiguë du Calvaire, ce sont les plaintes, les injustices, les défiances de celui pour qui elle s’use et se sacrifie !
Grand spectacle de voir cette femme pauvre, mal vêtue, qui s’en va de porte en porte, faisant la cour aux valets pour entrer dans les hôtels, plaider sa cause devant les grands, leur demander leur appui.
La police frémit, s’indigne. Madame Legros peut être enlevée d’un moment à l’autre, enfermée, perdue pour toujours ; tout le monde l’en avertit. Le lieutenant de police la fait venir, la menace. Il la trouve immuable, ferme ; c’est elle qui le fait trembler.
Par bonheur, on lui ménage l’appui de madame Duchesne, femme de chambre de Mesdames. Elle part pour Versailles, à pied, en plein hiver ; elle était grosse de sept mois… La protectrice est absente ; elle court après, gagne une entorse, et elle n’en court pas moins. Madame Duchesne pleure beaucoup, mais hélas ! que peut-elle faire ? Une femme de chambre contre deux ou trois ministres, la partie est forte ! Elle tenait en main la supplique ; un abbé de cour, qui se trouve là, la lui arrache des mains, lui dit qu’il s’agit d’un enragé, d’un misérable, qu’il ne faut pas s’en mêler.
Il suffit d’un mot pareil pour glacer Marie-Antoinette, à qui l’on en avait parlé. Elle avait la larme à l’œil. On plaisanta. Tout finit.
Il n’y avait guère en France d’homme meilleur que le roi. On finit par aller à lui. Le cardinal de Rohan (un polisson, mais, après tout, charitable) parla trois fois à Louis XVI, qui par trois fois refusa. Louis XVI était trop bon pour ne pas en croire M. de Sartines, l’ancien lieutenant de police. Il n’était plus en place, mais ce n’était pas une raison pour le déshonorer, le livrer à ses ennemis. Sartines à part, il faut le dire, Louis XVI aimait la Bastille, il ne voulait pas lui faire tort, la perdre de réputation.
Le roi était très humain. Il avait supprimé les bas cachots du Châtelet, supprimé Vincennes, créé la Force pour y mettre les prisonniers pour dettes les séparer des voleurs.
Mais la Bastille ! la Bastille ! c’était un vieux serviteur que ne pouvait maltraiter à la légère la vieille monarchie. C’était un mystère de terreur, c’était, comme dit Tacite, –instrumentum regni.
Quand le comte d’Artois et la reine, voulant faire jouer Figaro, le lui lurent, il dit seulement, comme objection sans réponse : « Il faudrait donc alors que l’on supprimât la Bastille ? »
Quand la révolution de Paris eut lieu, en juillet 89, le roi, assez insouciant, parut prendre son parti. Mais, quand on lui dit que la municipalité parisienne avait ordonné la démolition de la Bastille, ce fut pour lui comme un coup à la poitrine : « Ah ! dit-il, voici qui est fort ! »
Il ne pouvait pas bien recevoir, en 1781 une requête qui compromettait la Bastille. Il repoussa celle que Rohan lui présentait pour Latude. Des femmes de haut rang insistèrent. Il fit alors consciencieusement une étude de l’affaire, lut tous les papiers ; il n’y en avait guère d’autres que ceux de la police, ceux des gens intéressés à garder la victime en prison jusqu’à la mort. Il répondit définitivement que c’était un homme dangereux ; qu’il ne pouvait lui rendre la liberté jamais.
Jamais ! tout autre en fût resté là. Eh bien, ce qui ne se fait pas par le roi se fera malgré le roi. Madame Legros persiste. Elle est accueillie des Condé, toujours mécontents et grondeurs ; accueillie du jeune duc d’Orléans, de sa sensible épouse, la fille du bon Penthièvre ; accueillie des philosophes, de M. le marquis de Condorcet, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, de Dupaty, de Villette, quasi-gendre de Voltaire, etc., etc.
L’opinion va grondant ; le flot, le flot va montant. Necker avait chassé Sartines ; son ami et successeur Lenoir était tombé à son tour… La persévérance sera couronnée tout à l’heure. Latude s’obstine à vivre, et madame Legros s’obstine à délivrer Latude.
L’homme de la reine, Breteuil, arrive en 83, qui voudrait la faire adorer. Il permet à l’Académie de donner le prix de vertu à madame Legros, de la couronner… à la condition singulière qu’on ne motive pas la couronne.
Puis, 1784, on arrache à Louis XVI la délivrance de Latude. Et, quelques semaines après, étrange et bizarre ordonnance qui prescrit aux intendants de n’enfermer plus personne, à la requête des familles, que sur raison bien motivée, d’indiquer le temps précis de la détention demandée, etc. C’est-à-dire qu’on dévoilait la profondeur du monstrueux abîme d’arbitraire où l’on avait tenu la France. Elle en savait déjà beaucoup, mais le gouvernement en avouait davantage.
Madame Legros ne vit pas la destruction de la Bastille. Elle mourut peu avant. Mais ce n’en est pas moins elle qui eut la gloire de la détruire. C’est elle qui saisit l’imagination populaire de haine et d’horreur pour la prison du bon plaisir qui avait enfermé tant de martyrs de la foi ou de la pensée. La faible main d’une pauvre femme isolée brisa, en réalité, la hautaine forteresse, en arracha les fortes pierres, les massives grilles de fer, en rasa les tours.
Le caractère de ce moment unique, c’est que les partis y deviennent des religions. Deux religions se posent en face, l’idolâtrie dévote et royaliste, l’idéalité républicaine. Dans l’une, l’âme, irritée par le sentiment de la pitié même, rejetée violemment vers le passé qu’on lui dispute, s’acharne aux idoles de chair, aux dieux matériels qu’elle avait presque oubliés. Dans l’autre, l’âme se dresse et s’exalte au culte de l’idée pure ; plus d’idoles, nul autre objet de religion que l’idéal, la patrie, la liberté.
Les femmes, moins gâtées que nous par les habitudes sophistiques et scolastiques, marchent bien loin devant les hommes dans ces deux religions. C’est une chose noble et touchante, de voir parmi elles, non seulement les pures, les irréprochables, mais les moins dignes même, suivre un noble élan vers le beau désintéressé, prendre la patrie pour amie de cœur, pour amant le droit éternel.
Les mœurs changent-elles alors ? non, mais l’amour a pris son vol vers les plus hautes pensées . La patrie, la liberté, le bonheur du genre humain, ont envahi les cœurs des femmes. La vertu des temps romains, si elle n’est dans les mœurs, est dans l’imagination, dans l’âme, dans les nobles désirs. Elles regardent autour d’elles où sont les héros de Plutarque ; elles les veulent, elles les feront. Il ne suffit pas, pour leur plaire, de parler Rousseau et Mably. Vives et sincères, prenant les idées au sérieux, elles veulent que les paroles deviennent des actes. Toujours elles ont aimé la force. Elles comparent l’homme moderne à l’idéal de force antique qu’elles ont devant l’esprit. Rien peut-être n’a plus contribué que cette comparaison, cette exigence des femmes, à précipiter les hommes, à hâter le cours rapide de notre révolution.
Cette société était ardente ! Il nous semble, en y entrant, sentir une brûlante haleine.
Nous avons vu, de nos jours, des actes extraordinaires, d’admirables sacrifices, des foules d’hommes qui donnaient leurs vies ; et pourtant, toutes les fois que je me retire du présent, que je retourne au passé, à l’histoire de la Révolution, j’y trouve bien plus de chaleur ; la température est tout autre. Quoi ! le globe aurait-il donc refroidi depuis ce temps ?
Des hommes de ce temps-là m’avaient dit la différence, et je n’avais pas compris. À la longue, à mesure que j’entrais dans le détail, n’étudiant pas seulement la mécanique législative, mais le mouvement des partis, non seulement les partis, mais les hommes, les personnes, les biographies individuelles, j’ai bien senti alors la parole des vieillards.
La différence des deux temps se résume d’un mot : On aimait.
L’intérêt, l’ambition, les passions éternelles de l’homme, étaient en jeu, comme aujourd’hui ; mais la part la plus forte encore était celle de l’amour. Prenez ce mot dans tous les sens, l’amour de l’idée, l’amour de la femme, l’amour de la patrie et du genre humain. Ils aimèrent et le beau qui passe, et le beau qui ne passe point ; deux sentiments mêlés alors, comme l’or et le bronze, fondus dans l’airain de Corinthe.
Les femmes règnent alors par le sentiment, par la passion, par la supériorité aussi, il faut le dire, de leur initiative. Jamais, ni avant ni après, elles n’eurent tant d’influence. Au dix-huitième siècle, sous les encyclopédistes, l’esprit a dominé dans la société ; plus tard, ce sera l’action, l’action meurtrière et terrible. En 91, le sentiment domine, et par conséquent, la femme.
Le cœur de la France bat fort à cette époque. L’émotion, depuis Rousseau, a été croissant. Sentimentale d’abord, rêveuse, époque d’attente inquiète, comme une heure avant l’orage, comme dans un jeune cœur l’amour vague avant l’amant. Souffle immense, en 89, et tout cœur palpite !… Puis 90, la Fédération, la fraternité, les larmes… En 91, la crise, le débat, la discussion passionnée. – Mais partout les femmes, partout la passion individuelle dans la passion publique ; le drame privé, le drame social, vont se mêlant, s’enchevêtrant ; les deux fils se tissent ensemble ; hélas ! bien souvent, tout à l’heure, ensemble ils seront tranchés !
Une légende anglaise circulait, qui avait donné à nos Françaises une grande émulation. Mistress Macaulay, l’éminent historien des Stuarts, avait inspiré au vieux ministre Williams tant d’admiration pour son génie et sa vertu, que, dans une église même, il avait consacré sa statue de marbre comme déesse de la Liberté.
Peu de femmes de lettres alors qui ne rêvent d’être la Macaulay de la France. La déesse inspiratrice se retrouve dans chaque salon. Elles dictent, corrigent, refont les discours qui, le lendemain, seront prononcés aux clubs, à l’Assemblée nationale. Elles les suivent, ces discours, vont les entendre aux tribunes ; elles siègent, juges passionnées, elles soutiennent de leur présence l’orateur faible ou timide. Qu’il se relève et regarde… N’est-ce pas là le fin sourire de madame de Genlis, entre ses séduisantes filles, la princesse et Paméla ? Et cet œil noir, ardent de vie, n’est-ce pas madame de Staël ? Comment faiblirait l’éloquence ?… Et le courage manquera-t-il devant madame Roland ?
Les hommes ont fait le 14 juillet, les femmes le 6 octobre. Les hommes ont pris la Bastille royale, et les femmes ont pris la royauté elle-même, l’ont mise aux mains de Paris, c’est-à-dire de la Révolution.
L’occasion fut la famine. Des bruits terribles circulaient sur la guerre prochaine, sur la ligue de la reine et des princes avec les princes allemands, sur les uniformes étrangers, verts et rouges, que l’on voyait dans Paris, sur les farines de Corbeil qui ne venaient plus que de deux jours l’un, sur la disette qui ne pouvait qu’augmenter, sur l’approche d’un rude hiver… Il n’y a pas de temps à perdre, disait-on ; si l’on veut prévenir la guerre et la faim, il faut amener le roi ici ; sinon, ils vont l’enlever.
Personne ne sentait tout cela plus vivement que les femmes. Les souffrances, devenues extrêmes, avaient cruellement atteint la famille et le foyer. Une dame donna l’alarme, le samedi 3, au soir ; voyant que son mari n’était pas assez écouté, elle courut au café de Foy, y dénonça les cocardes antinationales, montra le danger public. Le lundi, aux halles, une jeune fille prit un tambour, battit la générale, entraîna toutes les femmes du quartier.
Ces choses ne se voient qu’en France ; nos femmes font des braves et le sont. Le pays de Jeanne d’Arc, et de Jeanne de Montfort, et de Jeanne Hachette, peut citer cent héroïnes. Il y en eut une à la Bastille, qui, plus tard, partit pour la guerre, fut capitaine d’artillerie ; son mari était soldat. Au 18 juillet, quand le Roi vint à Paris, beaucoup de femmes étaient armées. Les femmes furent à l’avant-garde de notre Révolution. Il ne faut pas s’en étonner, elles souffraient davantage.
Les grandes misères sont féroces, elles frappent plutôt les faibles, elles maltraitent les enfants, les femmes bien plus que les hommes. Ceux-ci vont, viennent, cherchent hardiment, s’ingénient, finissent par trouver, au moins pour le jour. Les femmes, les pauvres femmes, vivent, pour la plupart, renfermées, assises, elles filent, elles cousent ; elles ne sont guère en état, le jour où tout manque, de chercher leur vie. Chose douloureuse à penser, la femme, l’être relatif qui ne peut vivre qu’à deux, est plus souvent seule que l’homme. Lui, il trouve partout la société, se crée des rapports nouveaux. Elle, elle n’est rien sans la famille. Et la famille l’accable ; tout le poids porte sur elle. Elle reste au froid logis, démeublé et dénué, avec des enfants qui pleurent, ou malades, mourants, et qui ne pleurent plus… Une chose peu remarquée, la plus déchirante peut-être au cœur maternel, c’est que l’enfant est injuste. Habitué à trouver dans la mère une providence universelle qui suffit à tout, il s’en prend à elle, durement, cruellement, de tout ce qui manque, crie, s’emporte, ajoute à la douleur une douleur plus poignante.
Voilà la mère. Comptons aussi beaucoup de filles seules, tristes créatures sans famille, sans soutien, qui, trop laides, ou vertueuses, n’ont ni ami, ni amant, ne connaissent aucune des joies de la vie. Que leur petit métier ne puisse plus les nourrir, elles ne savent point y suppléer : elles remontent au grenier, attendent ; parfois on les trouve mortes, la voisine s’en aperçoit par hasard.
Ces infortunées n’ont pas même assez d’énergie pour se plaindre, faire connaître leur situation, protester contre le sort. Celles qui agissent et remuent, au temps des grandes détresses, ce sont les fortes, les moins épuisées par la misère, pauvres plutôt qu’indigentes. Le plus souvent, les intrépides qui se jettent alors en avant sont des femmes d’un grand cœur, qui souffrent peu pour elles-mêmes, beaucoup pour les autres ; la pitié, inerte, passive chez les hommes, plus résignés aux maux d’autrui, est chez les femmes un sentiment très actif, très violent, qui devient parfois héroïque, et les pousse impérieusement aux actes les plus hardis.
Il y avait, au 5 octobre, une foule de malheureuses créatures qui n’avaient pas mangé depuis trente heures. Ce spectacle douloureux brisait les cœurs, et personne n’y faisait rien ; chacun se renfermait en déplorant la dureté des temps. Le dimanche 4, au soir, une femme courageuse, qui ne pouvait voir cela plus longtemps, court du quartier Saint-Denis au Palais-Royal, elle se fait jour dans la foule bruyante qui pérorait, elle se fait écouter ; c’était une femme de trente-six ans, bien mise, honnête, mais forte et hardie. Elle veut qu’on aille à Versailles, elle marchera à la tête. On plaisante, elle applique un soufflet à l’un des plaisants. Le lendemain, elle partit des premières, le sabre à la main, prit un canon à la Ville, se mit à cheval dessus, et le mena à Versailles, la mèche allumée.
Parmi les métiers perdus qui semblaient périr avec l’ancien régime, se trouvait celui de sculpteur en bois. On travaillait beaucoup en ce genre, et pour les églises, et pour les appartements. Beaucoup de femmes sculptaient. L’une d’elles, Madeleine Chabry, ne faisant plus rien, s’était établie bouquetière au quartier du Palais-Royal, sous le nom de Louison ; c’était une fille de dix-sept ans, jolie et spirituelle. On peut parier hardiment que ce ne fut pas la faim qui mena celle-ci à Versailles. Elle suivit l’entraînement général, son bon cœur et son courage. Les femmes la mirent à la tête, et la firent leur orateur.
Il y en avait bien d’autres que la faim ne menait point. Il y avait des marchandes, des portières, des filles publiques, compatissantes et charitables, comme elles le sont souvent. Il y avait un nombre considérable de femmes de la halle ; celles-ci fort royalistes, mais elles désiraient d’autant plus avoir le roi à Paris. Elles avaient été le voir quelque temps avant cette époque, je ne sais à quelle occasion ; elles lui avaient parlé avec beaucoup de cœur, une familiarité qui fit rire, mais touchante, et qui révélait un sens parfait de la situation : « Pauvre homme ! disaient-elles en regardant le roi, cher homme ! bon papa ! » – Et plus sérieusement à la reine : « Madame, madame, ouvrez vos entrailles !… ouvrons-nous ! » Ne cachons rien, disons bien franchement ce que nous avons à dire.
Ces femmes des marchés ne sont pas celles qui souffrent beaucoup de la misère ; leur commerce, portant sur les objets nécessaires à la vie, a moins de variations. Mais elles voient la misère mieux que personne, et la ressentent ; vivant toujours sur la place, elles n’échappent pas, comme nous, au spectacle des souffrances. Personne n’y compatit davantage, n’est meilleur pour les malheureux. Avec des formes grossières, des paroles rudes et violentes, elles ont souvent un cœur royal, infini de bonté. Nous avons vu nos Picardes, les femmes du marché d’Amiens, pauvres vendeuses de légumes, sauver le père de quatre enfants qu’on allait guillotiner ; c’était le moment du sacre de Charles X ; elles laissèrent leur commerce, leur famille, s’en allèrent à Reims, elles firent pleurer le roi, arrachèrent la grâce, et, au retour, faisant entre elles une collecte abondante, elles renvoyèrent sauvés, comblés, le père, la femme et les enfants.
Le 5 octobre, à sept heures, elles entendirent battre la caisse, et elles ne résistèrent pas. Une petite fille avait pris un tambour au corps de garde, et battait la générale. C’était lundi ; les halles furent désertées, toutes partirent : « Nous ramènerons, disent-elles, le boulanger, la boulangère… Et nous aurons l’agrément d’entendre notre petite mère Mirabeau. »
Les halles marchent, et, d’autre part, marchait le faubourg Saint-Antoine. Sur la route, les femmes entraînaient toutes celles qu’elles pouvaient rencontrer, menaçant celles qui ne viendraient pas de leur couper les cheveux. D’abord, elles vont à la Ville. On venait d’y amener un boulanger qui, sur un pain de deux livres, donnait sept onces de moins. La lanterne était descendue. Quoique l’homme fût coupable, de son propre aveu, la garde nationale le fit échapper. Elle présenta la baïonnette aux quatre ou cinq cents femmes déjà rassemblées. D’autre part, au fond de la place, se tenait la cavalerie de la garde nationale. Les femmes ne s’étonnèrent point. Elles chargèrent la cavalerie, l’infanterie, à coups de pierres ; on ne put se décider à tirer sur elles ; elles forcèrent l’Hôtel de Ville, entrèrent dans tous les bureaux. Beaucoup étaient assez bien mises, elles avaient pris une robe blanche pour ce grand jour. Elles demandaient curieusement à quoi servait chaque salle, et priaient les représentants des districts de bien recevoir celles qu’elles avaient amenées de force, dont plusieurs étaient enceintes, et malades peut-être de peur. D’autres femmes, affamées, sauvages, criaient : Du pain et des armes ! Les hommes étaient des lâches, elles voulaient leur montrer ce que c’était que le courage… Tous les gens de l’Hôtel de Ville étaient bons à pendre, il fallait brûler leurs écritures, leurs paperasses… Et elles allaient le faire, brûler le bâtiment peut-être… Un homme les arrêta, un homme de taille très haute, en habit noir, d’une figure sérieuse et plus triste que l’habit. Elles voulaient le tuer d’abord, croyant qu’il était de la Ville, disant qu’il était un traître… Il répondit qu’il n’était pas traître, mais huissier de son métier, l’un des vainqueurs de la Bastille. C’était Stanislas Maillard.
Dès le matin, il avait utilement travaillé dans le faubourg Saint-Antoine. Les volontaires de la Bastille, sous le commandement d’Hullin, étaient sur la place en armes ; les ouvriers, qui démolissaient la forteresse, crurent qu’on les envoyait contre eux. Maillard s’interposa, prévint la collision. À la Ville, il fut assez heureux pour empêcher l’incendie. Les femmes promettaient même de ne point laisser entrer d’hommes ; elles avaient mis leurs sentinelles armées à la grande porte. À onze heures, les hommes attaquent la petite porte qui donnait sous l’arcade Saint-Jean. Armés de leviers, de marteaux, de haches et de piques, ils forcent la porte, forcent les magasins d’armes. Parmi eux, se trouvait un garde française, qui le matin avait voulu sonner le tocsin, qu’on avait pris sur le fait ; il avait, disait-il, échappé par miracle ; les modérés, aussi furieux que les autres, l’auraient pendu sans les femmes, il montrait son cou sans cravate, d’où elles avaient ôté la corde… Par représailles, on prit un homme de la Ville pour le pendre ; c’était le brave Lefebvre, le distributeur des poudres au 14 juillet ; des femmes ou des hommes déguisés en femmes, le pendirent effectivement au petit clocher ; l’une ou l’un d’eux coupa la corde, il tomba, étourdi seulement, dans une salle, vingt-cinq pieds plus bas.
Ni Bailly ni la Fayette n’étaient arrivés. Maillard va trouver l’aide-major général, et lui dit qu’il n’y a qu’un moyen de finir tout, c’est que lui, Maillard, mène les femmes à Versailles. Ce voyage donnera le temps d’assembler des forces. Il descend, bat le tambour, se fait écouter. La figure froidement tragique du grand homme noir fit bon effet dans la Grève ; il parut homme prudent, propre à mener la chose à bien. Les femmes, qui déjà partaient avec les canons de la Ville, le proclament leur capitaine. Il se met en tête avec huit ou dix tambours ; sept ou huit mille femmes suivaient, quelques centaines d’hommes armés, et enfin, pour arrière-garde, une compagnie des volontaires de la Bastille.
Arrivés aux Tuileries, Maillard voulait suivre le quai, les femmes voulaient passer triomphalement sous l’horloge, par le palais et le jardin. Maillard, observateur des formes, leur dit de bien remarquer que c’était la maison du roi, le jardin du roi ; les traverser sans permission, c’était insulter le roi. Il s’approcha poliment du suisse, et lui dit que ces dames voulaient passer seulement, sans faire le moindre dégât. Le suisse tira l’épée, courut sur Maillard, qui tira la sienne… Une portière heureusement frappe à propos d’un bâton, le suisse tombe, un homme lui met la baïonnette à la poitrine. Maillard l’arrête, désarme froidement les deux hommes, emporte la baïonnette et les épées.
La matinée avançait, la faim augmentait. À Chaillot, à Auteuil, à Sèvres, il était bien difficile d’empêcher les pauvres affamées de voler des aliments. Maillard ne le souffrit pas. La troupe n’en pouvait plus à Sèvres ; il n’y avait rien, même à acheter ; toutes les portes étaient fermées, sauf une, celle d’un malade qui était resté ; Maillard se fit donner par lui, en payant, quelques brocs de vin. Puis il désigna sept hommes, et les chargea d’amener les boulangers de Sèvres, avec tout ce qu’ils auraient. Il y avait huit pains en tout, trente-deux livres pour huit mille personnes… On les partagea, et l’on se traîna plus loin. La fatigue décida la plupart des femmes à jeter leurs armes. Maillard leur fit sentir d’ailleurs que, voulant faire visite au roi, à l’Assemblée, les toucher, les attendrir, il ne fallait pas arriver dans cet équipage guerrier. Les canons furent mis à la queue, et cachés en quelque sorte. Le sage huissier voulait un amener sans scandale, pour dire comme le palais. À l’entrée de Versailles, pour bien constater l’intention pacifique, il donna le signal aux femmes de chanter l’air d’Henri IV.
Les gens de Versailles étaient ravis, criaient : Vivent nos Parisiennes ! Les spectateurs étrangers ne voyaient rien que d’innocent dans cette foule qui venait demander secours au roi. Un homme, peu favorable à la Révolution, le Genévois Dumont, qui dînait au palais des Petites-Écuries, et regardait d’une fenêtre, dit lui-même : « Tout ce peuple ne demandait que du pain. »
L’Assemblée avait été, ce jour-là, fort orageuse. Le roi, ne voulant sanctionner ni la Déclaration des droits, ni les arrêtés du 4 août, répondait qu’on ne pouvait juger des lois constitutives que dans leur ensemble, qu’il y accédait néanmoins, en considération des circonstances alarmantes, et à la condition expresse que le pouvoir exécutif reprendrait toute sa force.
« Si vous acceptez la lettre du roi, dit Robespierre, il n’y a plus de constitution, aucun droit d’en avoir une. » Duport, Grégoire, d’autres députés, parlent dans le même sens. Pétion rappelle, accuse l’orgie des gardes du corps. Un député, qui lui-même avait servi parmi eux, demande, pour leur honneur, qu’on formule la dénonciation, et que les coupables soient poursuivis. « Je dénoncerai, dit Mirabeau, et je signerai, si l’Assemblée déclare que la personne du roi est la seule inviolable. » C’était désigner la reine. L’Assemblée entière recula : la motion fut retirée ; dans un pareil jour, elle eût provoqué un meurtre.
Mirabeau lui-même n’était pas sans inquiétude pour ses tergiversations. Il s’approche du président, et lui dit à demi-voix : « Mounier, Paris marche sur nous… croyez-moi, ne me croyez pas, quarante mille hommes marchent sur nous… Trouvez-vous mal, montez au château, et donnez-leur cet avis, il n’y a pas une minute à perdre… – Paris marche ? dit sèchement Mounier (il croyait Mirabeau un des auteurs du mouvement) ; eh bien, tant mieux ! nous en serons plus tôt république. »
L’Assemblée décide qu’on enverra vers le roi, pour demander l’acceptation pure et simple de la Déclaration des droits. À trois heures, Target annonce qu’une foule se présente aux portes sur l’avenue de Paris.