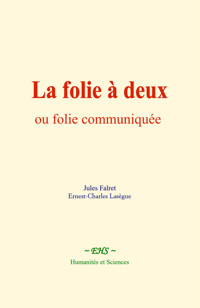
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Französisch
Il est de principe que l’aliéné, quelle que soit la forme de sa maladie, résiste avec une obstination vraiment maladive à tous les arguments qu’on peut faire valoir à l’encontre de son délire. La contradiction l’arrête ou le laisse indifférent, mais elle ne change rien au fond de ses idées. Intimidé ou déjà sur la voie de la guérison, il consent tout au plus à se taire, mais son intelligence ne bénéficie pas de ces réticences calculées. Il est, sous ce rapport, comparable, à quelque degré, aux enfants qui renoncent devant la menace à l’expression de leur sentiment, tout en s’ingéniant à montrer qu’ils ne s’engagent pas au delà d’une concession apparente. Si la folie n’excluait pas la persuasion, elle ne serait qu’une erreur au lieu d’être une maladie…
Dans le délire à deux, l’aliéné, l’agent provocateur, répond, en effet, au type dont nous venons d’esquisser les principaux traits. Son associé est plus délicat à définir, mais avec une recherche persévérante, on arrive à saisir les lois auxquelles obéit ce second facteur de la folie communiquée.
La première condition est qu’il soit d’une intelligence faible, mieux disposée à la docilité passive qu’à l’émancipation ; la seconde qu’il vive en relation constante avec le malade ; la troisième qu’il soit engagé par l’appât d’un intérêt personnel. On ne succombe à l’escroquerie que par la séduction d’un lucre, quel qu’il soit ; on ne cède à la pression de la folie que si elle vous fait entrevoir la réalisation d’un rêve caressé.
Nous envisagerons successivement chacune de ces données d’après les renseignements que fournit l’observation.
À PROPOS DES AUTEURS
Jules Falret, né le 17 avril 1824 à Vanves et mort le 28 mai 1902 dans la même ville, est un médecin aliéniste français
Ernest-Charles Lasègue, né le 5 septembre 1816 à Paris et mort le 20 mars 1883 dans le 1er arrondissement de Paris1, est un médecin français. Médecin des Hôpitaux de Paris, il a marqué la psychiatrie française du xixe siècle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
La folie à deux ou folie communiquée
La folie à deux
ou folie communiquée
Il est de principe que l’aliéné, quelle que soit la forme de sa maladie, résiste avec une obstination vraiment maladive à tous les arguments qu’on peut faire valoir à l’encontre de son délire. La contradiction l’arrête ou le laisse indifférent, mais elle ne change rien au fond de ses idées. Intimidé ou déjà sur la voie de la guérison, il consent tout au plus à se taire, mais son intelligence ne bénéficie pas de ces réticences calculées. Il est, sous ce rapport, comparable, à quelque degré, aux enfants qui renoncent devant la menace à l’expression de leur sentiment, tout en s’ingéniant à montrer qu’ils ne s’engagent pas au delà d’une concession apparente. Si la folie n’excluait pas la persuasion, elle ne serait qu’une erreur au lieu d’être une maladie.
Par compensation l’aliéné n’agit pas plus sur les gens sains d’esprit, que ceux-ci n’agissent sur lui. On a dit que l’aliénation était contagieuse, et que la fréquentation des malades ne devait pas être considérée comme exempte de danger pour ceux qui vivent en contact avec eux. La chose peut être vraie pour les prédisposés, en quête d’une occasion ; elle est absolument fausse pour l’immense majorité des hommes raisonnables. Les infirmiers des asiles ne sont pas plus exposés que ceux des hôpitaux, et la cohabitation avec les malades n’entraîne pas, pour la famille, plus de danger. De même qu’on ne réussit pas à les convaincre, de même les fous ne parviennent pas à persuader ; pour qu’il en fût ainsi, il faudrait qu’ils eussent à leur service des ressources morales et intellectuelles incompatibles avec leur état pathologique ; le prosélytisme, quand il s’agit d’idées étranges auxquelles répugne la raison, n’est pas une œuvre facile, et elle n’aurait de chances de succès qu’en se dépensant dans une lutte infatigable. Or, l’aliéné vit étranger à l’opinion des autres ; il se suffit à lui-même et peu lui importe, tant sa croyance s’impose avec une autorité irrésistible, qu’on veuille ou non le suivre sur le terrain dont on ne le dépossédera pas.
Il s’établit ainsi une ligne de démarcation absolue qui n’admet pas de compromis.
Si la vie commune avec les aliénés est nuisible, et elle l’est souvent, ce n’est pas en vertu d’une contagion du délire. L’assistant ne se résigne pas d’emblée à subir le fait accompli ; il espère qu’une éclaircie permettra à la raison de ressaisir son pouvoir, et, fort de cette confiance, il entame l’éducation du malade. L’insuccès l’irrite ou le décourage ; il surmène sa force de résistance et l’épuise. Quand cette série de tentatives se prolonge avec les perplexités qu’elle entraîne, les caractères fortement trempés sont les seuls qui n’en subissent pas la fâcheuse influence. Plus les liens qui attachaient l’assistant à l’aliéné sont étroits, plus le zèle est ardent et la fatigue considérable. En revanche, les indifférents échappent à la fois à ce travail inutilement douloureux et à ses conséquences.
Les choses se passent ainsi dans la supposition d’un délire absolu en regard d’une intelligence correcte. C’est heureusement la condition la plus fréquente, mais il existe des cas où la scission entre l’aliéné et ceux qui vivent dans sa familiarité n’est pas aussi formelle, et c’est à ces faits exceptionnels qu’est consacrée cette étude.
Le problème comprend alors deux termes entre lesquels il s’agit d’établir une équation : d’une part, le malade actif ; de l’autre, l’individu réceptif qui subit, sous des formes et à des degrés divers, son influence.
Seul, livré à ses instincts pathologiques, l’aliéné est relativement facile à examiner ; il a le goût, l’appétit même d’énoncer les idées qui l’obsèdent, ou il se résout à un mutisme systématique qui n’est pas moins significatif. Une fois qu’on a pénétré dans la place, elle est d’autant plus aisée à explorer qu’elle est moins ouverte au monde extérieur.




























