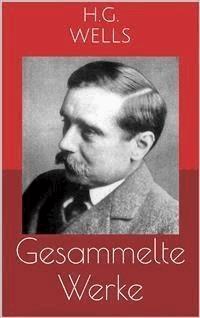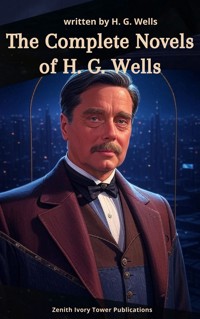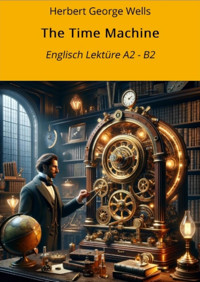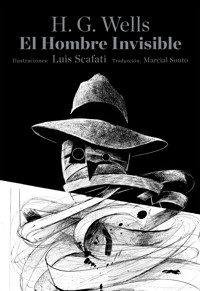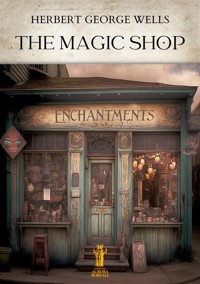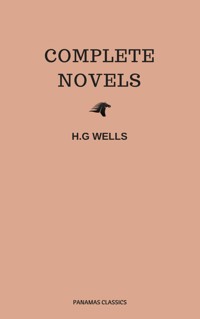2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
Bert Smallways n'est pas un héros. Ce serait plutôt Candide propulsé dans la guerre mondiale, une guerre conçue à l'échelle planétaire, en 1908, par un stratège de génie, H.G. Wells, qui invente l'arme absolue : les dirigeables géants, véritables porte-avions, d'où prennent leur vol les « Drachenflieger » de bombardement. Ainsi, l'Allemagne attaque directement les Etats-Unis et, sur la route de New York, coule la flotte U.S. ; Pearl Harbor, une trentaine d'années après, ne sera qu'un pâle reflet de cet engagement aéronaval. A leur tour, les Japonais ouvrent les hostilités et inventent les kamikazes. De nouvelles armes naissent, tel le canon à éclairs, ancêtre direct du rayon laser, le fameux rayon de la mort. Une saga extraordinaire et méconnue qui se déploie sur plusieurs continents sur un rythme cinématographique.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
La Guerre dans les Airs
Pages de titreCHAPITRE PREMIER123456CHAPITRE II1 - 12 - 13 - 14 - 15 - 1CHAPITRE III LE BALLON1 - 22 - 23 - 24 - 25 - 2CHAPITRE IV1 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 1789CHAPITRE V1 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 27 - 1CHAPITRE VI1 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 3CHAPITRE VII1 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 4CHAPITRE VIII1 - 72 - 73 - 74 - 75 - 7CHAPITRE IX1 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 57 - 29 - 110CHAPITRE X1 - 92 - 93 - 94 - 9CHAPITRE XI L’EFFONDREMENT1 - 102 - 103 - 104 - 105 - 9ÉPILOGUEPage de copyrightHerbert George Wells
LA GUERRE DANS LES AIRS
CHAPITRE PREMIER
OÙ IL EST QUESTION DU PROGRÈS ET DE LA FAMILLE SMALLWAYS
1
– Leur Progrès, comme ils disent, ça marche, – déclara M. Tom Smallways, – ça marche, et l’on se demande comment ça peut toujours marcher.
M. Smallways faisait cette remarque longtemps avant le début de la guerre dans les airs, accoté contre la palissade, au bout de son jardin, et, d’un regard qui n’exprimait ni louange ni blâme, il contemplait la vaste usine à gaz de Bun Hill. Au-dessus des gazomètres pressés les uns contre les autres, trois formes étranges apparurent, grandes vessies flasques qui se balançaient lourdement, devenaient plus rondes et plus énormes – des ballons que l’on gonflait pour les ascensions hebdomadaires de l’Aéro-Club.
– C’est comme ça tous les samedis, – précisa le voisin M. Stringer, le laitier. – Pas plus tard qu’hier, tout le monde se serait précipité pour voir un ballon partir, et maintenant il n’y a pas un trou à la campagne qui n’ait son départ de ballon tous les dimanches… Heureusement pour les compagnies du gaz !
– Samedi dernier, – répliqua M. Smallways, – j’ai été obligé de ramasser trois brouettées de gravier dans mes pommes de terre… trois brouettées de lest qu’ils nous ont versées sur la tête. Ils m’ont écrasé les touffes qui n’étaient pas enterrées.
– Il y a des dames, parait-il, qui montent là-dedans…
– Si on peut appeler ça des dames… En tout cas, ce n’est pas l’idée que je me fais d’une dame… Grimper en l’air et jeter des tas de sable sur le monde, ce n’est pas cela qu’on m’a enseigné à considérer comme une occupation pour des dames.
M. Stringer approuva de la tête, et les deux voisins continuèrent à surveiller les masses boursouflées, avec une expression qui avait passé de l’indifférence à la désapprobation.
M. Tom Smallways était fruitier de son état et jardinier par vocation, et Jessica, sa modeste épouse, vaquait aux soins de la boutique. Le ciel avait destiné M. Smallways à vivre dans un monde paisible, mais il avait oublié de créer un monde paisible pour M. Smallways. Le pauvre homme vivotait dans un chaos d’innovations continuelles et acharnées, en un endroit précisément ou ces innovations s’effectuaient ostensiblement et impitoyablement. Les vicissitudes, eût-on pu dire, croissaient sur le sol même qu’il labourait ; son jardin, loué à l’année, était ombragé d’une immense palissade de planches, qui proclamait que ce lopin de terre constituait un très enviable site pour des constructions. À l’ombre de cette menace perpétuelle de congé, M. Smallways se livrait à l’horticulture, sur ce dernier bout de terrain investi de jour en jour plus étroitement par les accaparements urbains. Il s’en consolait de son mieux en s’imaginant que ça ne pouvait pas durer.
– Faudra bien que ça s’arrête ! – répétait-il.
Son vieux père se souvenait du Bun Hill comme d’un idyllique village. Jusqu’à cinquante ans, le vieillard avait conduit les chevaux de Sir Peter Bone ; puis, comme il s’était mis à boire, on lui avait confié l’omnibus de la gare, ce qui le mena jusqu’à soixante-dix-huit ans, âge auquel il prit sa retraite. Tout le jour, rabougri, bourré de réminiscences qu’il déchargeait, dès la première approche, sur l’imprudent qui s’aventurait dans son voisinage, il demeurait assis près de l’âtre. Il vous décrivait le domaine de Sir Peter Bone, qu’on avait morcelé par lotissements ; il vous disait comment le noble seigneur régentait le pays quand il y avait encore des bois et des champs, des chasses à tir et à courre, quand les pataches et les diligences parcouraient la grand’route, quand des terrains de jeux s’étendaient à l’endroit qu’occupe l’usine à gaz, et qu’on bâtissait le Palais de Cristal. Puis ç’avait été le chemin de fer, des villas et encore des villas, les usines à gaz, et les réservoirs de la Compagnie des Eaux, au milieu d’un océan hideux de logements ouvriers ; ensuite, la captation des sources et l’assèchement de la petite rivière dont le lit n’était plus qu’une rigole fétide ; et enfin une seconde ligne de chemin de fer et une seconde station, et des maisons, encore des maisons et des boutiques, une concurrence insoutenable, des magasins à grandes vitrines, des écoles, des impôts nouveaux, des omnibus, des tramways à traction mécanique, qui allaient jusqu’au cœur de Londres, des bicyclettes, des automobiles en nombre toujours croissant, une bibliothèque publique payée par M. Carnegie…
– Faudra bien que ça s’arrête ! répétait M. Tom Smallways, dont les jours s’écoulaient au milieu de ces merveilles.
Mais ça ne s’arrêtait pas. La fruiterie, située dans une des plus petites et des plus vieilles maisons du village, sur la Grand’Rue, avait un air submergé, l’air de se cacher de quelque ennemi qui serait à sa recherche. Quand on refit la chaussée, on la surhaussa à ce point, pour la niveler, qu’il fallait maintenant descendre trois marches pour entrer dans la boutique. Tom s’efforçait de vendre uniquement la récolte de son jardin, produits excellents assurément, mais de variété limitée. Et le Progrès vint, qui l’obligea à mettre dans son étalage des artichauts et des aubergines de France, des pommes étrangères, des pommes de l’État de New York, de Californie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, – « des fruits qui ont un bel aspect, mais qui ne valent pas nos bonnes pommes d’Angleterre » – des bananes, des noix aux formes insolites, des « grappes fruits » et des mangues…
Les automobiles qui montaient ou descendaient la Grand’Rue devenaient de plus en plus énormes et puissantes, passaient en ronflant à des vitesses toujours plus grandes et répandaient des odeurs toujours plus infectes. On vit même de gros camions assourdissants, qui remplaçaient les voitures de livraisons pour la distribution des sacs de charbon, caisses, ballots, paquets, colis de tous genres. Des omnibus automobiles détrônèrent les omnibus à chevaux, et les fraises du Kent elles-mêmes adoptèrent la traction mécanique pour se rendre à Londres, la nuit, et ajoutèrent à leur saveur naturelle les parfums du Progrès.
Enfin, le jeune Bert Smallways acheta une motocyclette.
2
Bert, il est nécessaire de l’expliquer, était un Smallways à idées progressives.
Rien n’exprime avec plus d’éloquence l’impitoyable acharnement du Progrès, que le fait qu’il s’inocula dans le sang même des Smallways. Déjà alors qu’il était bambin en culottes courtes, le jeune Smallways avait en lui quelque chose d’avancé et d’entreprenant. À l’âge de cinq ans, il disparut pendant une journée entière, et, au cours de sa septième année, il manqua de se noyer dans le réservoir de la Compagnie des Eaux. À dix ans, il se fit confisquer un vrai revolver par un vrai sergent de ville. Il apprit à fumer, non pas avec de vieilles pipes bourrées de papier gris et de rognures de roseau, comme Tom l’avait fait jadis, mais avec de véritables cigarettes achetées sou par sou chez un marchand de véritable tabac. Il n’avait pas douze ans que son langage imagé ahurissait son père. Vers cet âge, il se faisait par semaine trois shillings et plus en portant les bagages des voyageurs à la station et en vendant la gazette hebdomadaire de la localité. Il dépensait cet argent en achats de journaux comiques illustrés, de cigarettes et de tout ce qui est indispensable à une vie adonnée au plaisir et à la culture intellectuelle : tout cela ne l’empêcha pas de terminer ses études classiques à un âge exceptionnellement précoce.
Nantis de ces détails, vous voilà fixés à présent sur le genre de personnage qu’était Bert Smallways, de six ans le cadet de Tom. Pendant un temps, on avait essayé de l’employer dans la fruiterie, – lorsque Tom, à vingt et un ans, avait épousé Jessica qui en avait trente et qui lui apportait ses économies de domestique. Mais ce n’était pas la vocation de Bert d’être employé. Il éprouvait une particulière aversion pour la bêche, et, quand on le chargeait de livrer un panier de légumes, un instinct nomade s’éveillait irrésistible en lui ; désormais le panier lui appartenait : il ne se souciait ni du poids ni de la destination des légumes, aussi longtemps que rien ne l’obligeait à les porter à leur adresse. Pour lui, un charme magique imprégnait l’univers, et il se lançait à la poursuite de ce charme, oubliant panier et le reste. Aussi, Tom se décida-t-il à s’occuper lui-même de ses livraisons et à se mettre en quête, pour Bert, de patrons qui ignoreraient le penchant poétique de son frère. Bert effleura successivement un bon nombre de métiers : il fut groom dans un magasin de nouveautés et chez un médecin, garçon de pharmacie, apprenti plombier, griffonneur d’adresses, garçon laitier, « golf caddie », et enfin aide-mécanicien chez un loueur et réparateur de bicyclettes. En ce dernier avatar, il trouva apparemment les débouchés que sa nature progressive exigeait. Son patron, dénommé Grubb, était un jeune homme à l’âme de pirate et à la figure noire, qui passait ses soirées au café-concert et rêvait d’inventer une mirifique chaîne de transmission. Bert voyait en lui le modèle du parfait gentleman. Grubb donnait en location les bicyclettes les plus sales et les plus dangereuses de tout le sud de l’Angleterre, et il conduisait, avec une verve déconcertante, les discussions qui s’ensuivaient. Bert et lui s’entendirent à merveille. Bert devint presque un cycliste acrobate, capable de franchir de nombreux kilomètres sur des machines qui se seraient immédiatement démolies sous vous ou moi ; il prit l’habitude de se débarbouiller après le travail et parfois même de laver son cou. Avec le surplus de ses gains, il achetait des cigarettes, des cols et des cravates sensationnels, et se payait des cours de sténographie à l’Institut Philotechnique de Bun Hill.
De temps à autre, il entrait chez son frère : alors Tom, qui avait un penchant naturel à témoigner du respect à n’importe qui et à n’importe quoi, s’émerveillait de son élégance et de sa conversation.
– C’est un garçon qui va de l’avant, ce Bert – disait-il. – Il sait pas mal de choses.
– Espérons qu’il n’en sait pas trop, – répondait Jessica – qui avait le sens de la mesure.
– À notre époque, il faut aller de l’avant – affirmait Tom. – Les pommes de terre nouvelles, et bien anglaises, nous les aurons en mars, si ça continue de ce train-là. Je n’ai jamais vu une époque pareille… As-tu remarqué sa cravate, hier soir ?
– Elle ne lui allait pas, Tom. C’est une cravate de beau monsieur, mal assortie avec le reste… Ça ne lui va pas, ce genre-là.
Bientôt, Bert fit l’emplette d’un complet de cycliste, avec la casquette, l’insigne et tous les accessoires. Et à le voir, le dos arrondi, la tête baissée sur le guidon très bas, pédaler en compagnie de Grubb, jusqu’à Brighton, on avait la révélation miraculeuse de ce que promettait la race des Smallways.
On va de l’avant à notre époque !
Le vieux Smallways, assis au coin du feu, bredouillant entre ses dents, célébrait la grandeur des temps passés : il parlait du vieux sir Peter qui menait lui-même son « coach » à Brighton – aller et retour en vingt-huit heures, – des chapeaux hauts de forme blancs du vieux sir Peter, de lady Bone qui ne mit jamais le pied à terre sinon pour se promener dans son jardin, et des grands combats de boxe à Crawley. Il parlait de culottes de peau couleur saumon, de chasses au renard à Ring’s Bottom, où s’élève maintenant un asile d’aliénés pour les indigents de Londres, des robes de soie et des crinolines de lady Bone… Mais personne ne l’écoutait. Le monde avait impatronisé un type de gentleman absolument nouveau, dont l’énergie et l’activité n’avaient rien de celle du gentleman d’autrefois, un personnage enveloppé d’imperméables poudreux, le visage caché sous des lunettes monstrueuses, et surmonté d’une coiffure baroque, un gentleman fabricant de puanteurs nauséabondes, et qui, à toute vitesse, sur les routes, fuyait devant la poussière et devant les fumées infectes qu’il dégageait. Sa compagne, d’après ce qu’on en pouvait voir des fenêtres de la Grand’Rue de Bun Hill, était une déesse du plein air et du plein vent, aussi affranchie des soucis du confort qu’une bohémienne de grands chemins, et moins habillée qu’empaquetée pour se faire transporter à destination à une allure vertigineuse.
Bert grandit ainsi avec un idéal de mobilité et de vastes entreprises. Il devint, autant du moins qu’il pouvait devenir quelque chose, un mécanicien cycliste du genre écorneur d’émail et forceur d’écrous. Sa bicyclette de course, qui développait au moins neuf mètres de multiplication, n’arrivait pas à le satisfaire, et longtemps il s’acharna à pédaler à une vitesse de trente kilomètres à l’heure sur des routes sans cesse plus poussiéreuses qu’encombrait une circulation de véhicules mécaniques toujours plus nombreux. Mais enfin ses économies accumulées lui offrirent la chance impatiemment attendue. Le système d’achat par paiements mensuels lui permit d’obvier à l’insuffisance de ses ressources et, par une matinée de dimanche, mémorable et ensoleillée, il sortit de la boutique sa nouvelle acquisition. Avec l’aide et les conseils de Grubb, il se mit en selle, et, dans les détonations assourdissantes du moteur, il se lança à travers l’épais brouillard poussiéreux de la grand’route, pour s’ajouter volontairement, comme un danger public de plus, aux charmes champêtres de l’Angleterre méridionale.
– Parti pour Brighton ! – bredouilla le vieux Smallways qui observait son fils avec un sentiment mêlé d’orgueil et de réprobation. Et il ajouta : – À son âge, je n’avais jamais été à Londres… jamais été nulle part où mes jambes ne pouvaient me porter. Et tout le monde en était là… à moins qu’on ne fût de la haute… Maintenant tout un chacun s’en va partout. C’est à se demander comment ils reviennent. Parti pour Brighton, ah ! oui… qui est-ce qui voudrait acheter des chevaux, à présent ?
– Vous ne pouvez pas dire que je sois allé à Brighton, moi, – fit remarquer Tom.
– Ni qu’il ait même envie d’y aller pour perdre son temps et dépenser son argent – insista sèchement Jessica.
3
Pendant toute une période, la motocyclette accapara à tel point l’esprit de Bert qu’il resta indifférent au nouveau genre d’exercice et de délassement que recherchait l’impatience humaine.
Il ne s’aperçut pas que le type de l’automobile, comme celui de la bicyclette, se fixait, en perdant ses caractéristiques aventureuses. À vrai dire, – fait exact autant qu’inattendu, – ce fut Tom qui constata le premier la manifestation nouvelle de l’esprit inquiet de l’homme. Les soins de son jardin le rendaient attentif à surveiller le ciel ; la proximité de l’usine à gaz et du Palais de Cristal, où avaient lieu de continuelles ascensions, et aussi les avalanches de lest dans ses carrés de pommes de terre, conspirèrent pour révéler à son esprit récalcitrant que la Déesse de l’Innovation tournait vers les cieux sa fantaisie perturbatrice. L’engouement pour l’aéronautique commençait.
Grubb et Bert en entendirent parler d’abord dans un music-hall ; puis le cinématographe confirma la rumeur ; enfin l’imagination de Bert fut stimulée par la lecture d’une édition populaire des Pirates aériens. Au début, la preuve la plus ostensible de cette nouvelle vogue fut la multiplication des ballons. Le ciel, au-dessus de Bun Hill, en fut véritablement infesté. Pendant les après-midi du mercredi et du samedi, en particulier, on ne pouvait lever les yeux sans à tout moment apercevoir un ballon. Un beau jour, Bert, qui roulait vers Croydon, fut arrêté par la soudaine apparition, au-dessus du parc du Palais de Cristal, d’un monstre énorme en forme de traversin. Il freina, coupa l’allumage, mit pied à terre et regarda. C’était un traversin au nez cassé, pour ainsi dire, avec, au-dessous, et relativement exiguë, une carcasse rigide portant un homme et un moteur ; à l’avant, une hélice tournait en ronflant, et une sorte de gouvernail en toile s’agitait à l’arrière. La nacelle avait l’air de traîner le cylindre récalcitrant, à la façon dont un vaillant petit terrier remorquerait un timide éléphant. À n’en pas douter, ce couple monstrueux gouvernait à son gré tous ses mouvements. Il s’éleva à la hauteur de plus de trois cents mètres, mit le cap vers le sud, disparut derrière les collines, reparut très loin dans l’est, comme une petite silhouette bleue, poussée à toute vitesse par une brise du sud-ouest, revint au-dessus des tours du Palais de Cristal, décrivit quelques cercles, choisit un lieu propice pour descendre et sombra hors de vue.
Bert soupira profondément, et enfourcha sa motocyclette.
Ce ne fut que le commencement d’une succession d’étranges phénomènes dans le ciel : cylindres, cônes, monstres en forme de poire, et même à la fin un appareil en aluminium qui scintillait d’éblouissante façon, et que Grubb, par une analogie avec les armures du moyen âge inclinait à prendre pour une machine de guerre. Et bientôt, on parvint réellement à voler.
Cependant, rien de ces expériences n’était visible de Bun Hill. Elles se poursuivaient dans des enclos réservés et sous des conditions spéciales, de sorte que Grubb et Bert Smallways ne furent renseignés que par la page illustrée de leur journal à un sou, et par le cinématographe. De tous côtés, ils en entendaient parler, et chaque fois que, dans un lieu public, quelqu’un déclarait à haute voix, d’un ton assuré et confiant : « C’est forcé qu’ils y arrivent ! » il y avait dix chances contre une qu’il s’agit de vol aérien. Un beau jour, Bert transforma un couvercle de caisse en un écriteau que Grubb accrocha à la devanture, avec cette inscription :
« Construction et Réparation d’Aéroplanes. »
Tom en fut bouleversé ; il lui sembla que c’était un manque de respect, mais la plupart des voisins et tous ceux qu’intéressait le sport approuvèrent cette idée, qu’ils jugeaient excellente.
On ne parlait que de s’élancer dans les airs et tout le monde affirmait : « C’est forcé qu’on y vienne ! » mais on n’y venait pas sans anicroches. On volait certes, et dans des machines plus lourdes que l’air, mais il y avait aussi les chutes où parfois le moteur se brisait et parfois l’aéronaute, souvent les deux à la fois. Les appareils s’élevaient assez bien et volaient pendant quelques kilomètres, mais ils reprenaient rarement terre sans qu’une partie quelconque se disloquât. Il ne semblait guère possible de s’y fier entièrement. Un vent trop fort ou un tourbillon près du sol risquait de tout culbuter, quand ce n’était pas une seconde de distraction de la part de l’aviateur. Et les engins chaviraient aussi, tout simplement, sans raison apparente.
– C’est du côté de la stabilité que ça pèche ! – certifiait Grubb, répétant son journal. – Ils piquent du nez jusqu’à ce qu’ils se le cassent.
Les expériences se poursuivaient avec des alternatives de triomphe et de désastre. Après chaque insuccès, le public et les journaux se lassaient des coûteuses reproductions photographiques et des rapports exagérément optimistes. On se désintéressa quelque peu de l’aviation et l’on pratiqua moins les ascensions en sphériques. Pourtant ce sport n’était pas complètement délaissé et on continuait à emporter des provisions de sable pour les déverser sur les pelouses et les plates-bandes des paisibles citoyens. Tom se rassura tout au moins en ce qui concernait l’aéroplane. Il est vrai qu’à ce moment les applications du monorail se multipliaient, et l’anxiété de Tom n’était détournée des hauteurs de l’empyrée que par des menaces plus immédiates et des symptômes d’innovations plus rapprochées du sol.
Depuis plusieurs années, il avait beaucoup été question du monorail. Mais le mal commença vraiment lorsque Brennan présenta aux divers corps savants d’Europe son monorail à wagon gyroscopique. Ce fut la grande vogue de 1907, et la salle de démonstration de la Société Royale fut trop petite pour le nombre des curieux. Des soldats glorieux, des sionistes fameux, des romanciers illustres, et de fort nobles dames, s’étouffaient dans l’étroit couloir, enfonçaient des coudes distingués dans des côtes que l’univers eût été désolé de savoir broyées ; et tout ce monde s’estimait favorisé s’il apercevait « juste un petit bout de rail ». D’une voix imperceptible, mais persuasive, le grand inventeur exposait sa découverte, et il lançait son obéissant modèle réduit des trains de l’avenir sur des rampes, des courbes, et des affaissements arqués. Le wagon, simple et pratique, courait sur son unique rail ; il s’arrêtait, faisait marche arrière, restait sur place, avec un équilibre parfait et stupéfiant, qu’il conservait au milieu d’un tonnerre d’applaudissements. La foule se dispersait enfin, chacun discutant jusqu’à quel point on aimerait traverser un abîme sur un câble d’acier.
– Supposez que le gyroscope s’arrête !
Bien peu soupçonnaient ce que le monorail de Brennan allait faire pour la sécurité des transports et jusqu’à quel point il allait métamorphoser la face du monde.
Quelques années plus tard, on fut à même de mieux s’en rendre compte. Bientôt, personne ne s’effraya plus de traverser un abîme sur un câble ; le monorail remplaça les lignes de tramways ou de chemins de fer et toutes les formes de voies pour locomotion mécanique. Quand le prix du terrain le permettait, on posait le rail sur le sol, autrement on l’élevait sur des armatures de fer ; les wagons, rapides et commodes, sillonnaient le pays en tous sens et rendaient les mêmes services que les moyens de transport de jadis.
Quand le vieux Smallways mourut, Tom ne trouva rien de plus caractéristique, en guise d’oraison funèbre, que ces mots :
– Au temps où il était enfant, rien ne dépassait la hauteur de nos cheminées ; on ne voyait ni un rail ni un câble dans le ciel !
Le vieux Smallways roula jusqu’à sa dernière demeure sous un réseau complexe de fils et de câbles, car Bun Hill à présent était non seulement un centre de distribution d’énergie motrice, – avec une station génératrice et des transformateurs tout auprès de l’ancienne usine à gaz, – mais aussi un important point de jonction du réseau monorail suburbain. En outre, le téléphone était installé chez tous les commerçants et même dans presque toutes les maisons.
Les hautes armatures des câbles du monorail devinrent un des traits caractéristiques du paysage urbain. Ces puissantes constructions de fer, peintes en vert bleuté brillant, ressemblaient à d’immenses tréteaux effilés en pyramide. L’un de ces tréteaux enjambait la maison de Tom, et, sous cette immensité, elle prenait un air encore plus humble et penaud ; un autre géant se dressait dans un coin du jardin, sur lequel n’existait jusqu’à présent aucune bâtisse, et ou rien n’était changé, sinon qu’on avait ajouté deux écriteaux réclames, dont l’un recommandait une montre à 3, 95 F et l’autre un tonique pour le système nerveux. Ces deux écriteaux étaient placés sur un plan horizontal, de façon à frapper la vue des voyageurs du monorail aérien, et ils servaient de toit pour un hangar à outils et pour une serre à champignons. Jour et nuit, sur les lignes de Brighton et de Hastings, passaient en bourdonnant des wagons longs, larges, confortables, éclairés brillamment dès le coucher du soleil. De la rue, en bas, avec leurs fugaces clartés et leurs grondements, on eût dit un orage d’été accompagné d’éclairs et de coups de tonnerre incessants.
Bientôt, un pont fut jeté sur le Pas-de-Calais, composé d’une série de piliers semblables à autant de tours Eiffel et supportant des câbles de monorails à cent cinquante pieds au-dessus de l’eau ; vers le milieu, ils s’élevaient plus haut encore, pour permettre le passage des grands navires de Londres et d’Anvers et des transatlantiques de Brême et de Hambourg.
Puis, les lourdes automobiles se mirent à rouler sur une couple de roues placées l’une derrière l’autre. Quand il eut vu filer devant sa boutique le premier véhicule de ce genre, Tom en fut si terriblement bouleversé qu’il en demeura sombre et taciturne pendant plusieurs jours.
Toutes ces applications du gyroscope et du monorail absorbaient naturellement l’attention publique. À ce moment, toutefois, une énorme surexcitation se produisit. Une prospectrice sous-marine, Miss Patricia Giddy, qui avait pris ses diplômes de sciences naturelles à l’Université de Londres, découvrit des gisements d’or au large d’Anglesea. Après de brèves vacances consacrées à la propagande en faveur du suffrage des femmes, elle travaillait sur les rocs aurifères du Pays de Galles, et l’idée la frappa que ces bancs de roches pouvaient bien reparaître plus loin sous les flots. Elle décida de vérifier cette hypothèse au moyen de la drague inventée par le docteur Alberto Cassini. Grâce à l’heureuse combinaison du raisonnement et de l’intuition particulière à son sexe, elle trouva de l’or à sa première descente, et, après trois heures de recherches, elle émergea avec une centaine de kilos d’un minerai qui contenait de l’or dans la proportion inouïe de dix-sept onces à la tonne. Mais si passionnante que soit l’histoire de cette prospection sous-marine, on la relatera une autre fois. Il suffira de noter ici que le renouveau d’intérêt pour l’aéronautique eut lieu au moment où, en conséquence de la découverte de miss Giddy, une surélévation des prix s’était produite, en même temps qu’une augmentation de la confiance générale et de l’esprit d’entreprise.
4
Tout à coup, on ne s’occupa plus que d’aérostation, de vol plané, du plus lourd que l’air ! Ce fut comme une brise qui se lève par un jour calme : rien ne la fait présager, elle survient et passe. On se mit à parler d’aéronautique, comme si jamais on n’avait abandonné un seul instant ce sujet. Les journaux reproduisirent des types de machines et des portraits d’aviateurs en plein essor ; les articles et les allusions au vol dans les airs se multiplièrent dans les graves revues. Dans les trains monorails, on se demandait : « Va-t-on bientôt voler ? » En une nuit ou deux, comme des champignons, on vit surgir une multitude d’inventeurs. L’Aéro-Club lança le projet d’une vaste Exposition sur un emplacement rendu utilisable par la démolition de tout un coin immonde de Whitechapel.
La vague montante eut tôt fait de provoquer une ondulation sympathique jusque dans la boutique de Bun Hill. Grubb exhuma son vieux modèle de machine volante, l’essaya dans la courette, réussit par miracle à en obtenir une envolée, et l’appareil alla choir dans un jardin proche, sur une serre où il brisa dix-sept vitres et neuf pots de fleurs.
Alors, jaillissant on ne sait d’où, soutenue on ne sait comment, la rumeur persistante et troublante se répandit que le problème était résolu, que le secret était connu. Bert en entendit parler un après-midi, alors qu’il se rafraîchissait dans une auberge près de Nutfield où sa moto l’avait emmené. Là, un personnage vêtu d’un uniforme kaki, un soldat du génie, fumait méditativement ; il témoigna soudain d’un certain intérêt pour la machine de Bert : c’était un solide morceau de machine âgée de huit ans, qui avait acquis déjà une sorte de valeur documentaire à notre époque de perfectionnements ultra-rapides. Ses qualités dûment discutées, le soldat aborda un nouveau sujet en remarquant :
– Ma prochaine machine, autant que je puisse le prévoir, sera un aéroplane. J’en ai assez de rouler sur les routes.
– On en parle, – répliqua Bert.
– On en parle et on le fait… ça vient !
– Ça y met le temps ; je le croirai quand je le verrai. Ce ne sera pas long.
La conversation dégénérait en un duel aimable de contestations.
– Je vous dis que maintenant on vole… Je l’ai vu moi-même, – insistait le soldat.
– Bah ! nous l’avons tous vu.
– Je ne parle pas des essais d’une envolée avec une chute au bout, et l’appareil endommagé… On vole dans les airs, je vous le répète, un vol réel, sans danger régulier, contrôlé, contre le vent favorable ou non.
– Vous n’avez pas vu ça !
– Je l’ai vu ! Au camp d’Aldershot. Ils gardent la chose secrète. Et ils ont raison, c’est un succès… Vous pensez bien que notre administration n’a pas envie qu’on se paye encore sa tête.
L’incrédulité de Bert était ébranlée. Il posait des questions, et le soldat y répondait complaisamment.
– Je vous dis qu’ils ont enclos un espace de plus de quinze cents mètres de côté, avec des ronces artificielles et des fils de fer barbelés, jusqu’à trois mètres de hauteur… Mais nous, dans le camp, on jette de temps en temps un coup d’œil… Et ce n’est pas seulement nous autres, les Anglais, qui sommes sur la piste : Il y a les Japonais, et ceux-là pas de doute… ils ont mis la main dessus… Et les Allemands !… Et les Français, qui ne sont jamais restés en arrière dans ce genre d’inventions… ce n’est pas leur habitude. Ils ont été les premiers à faire des cuirassés, des sous-marins, des ballons dirigeables, et il est probable qu’ils ne seront pas les derniers cette fois-ci non plus.
Planté sur ses jambes écartées, le soldat bourrait pensivement une seconde pipe. Bert était assis sur le parapet, contre lequel il avait appuyé sa moto.
– Ce sera drôle, la guerre avec ça, – assura-t-il.
– On se lancera à travers les airs un de ces quatre matins, – reprit le soldat. – Quand on y sera, quand le rideau se lèvera, je vous promets que vous trouverez tout le monde en scène, et à la besogne… Vous ne lisez pas ce qu’on dit dans les journaux, là-dessus ?
– Mais si, un peu.
– Eh ! bien, avez-vous fait cette surprenante observation qu’on escamote les inventeurs ? Un inventeur arrive avec tout le tam-tam de la publicité, il opère quelques expériences qui réussissent et puis… pft !… ni vu, ni connu.
– Je n’ai pas remarqué ça.
– Eh ! bien, je l’ai remarqué, moi. Surveillez le premier quidam qui fait un joli coup dans ce genre-là, et je vous promets que vous ne tarderez pas à le perdre de vue… Il disparaît tout tranquillement, sans tambour ni trompette, et vous n’entendez plus jamais parler de lui. Vous comprenez ?… Il s’éclipse. Parti, sans adresse… Au début… c’est déjà de l’histoire ancienne… il y avait les frères Wright… qui volaient pendant des heures… et puis, crac, bonsoir, les voilà filés. Ça devait être en dix-neuf cent et quelques… Après eux, il y eut ces aviateurs, vous savez bien, en Irlande… Ma foi, j’ai oublié leur nom. Ils volaient eux aussi, à ce qu’on prétend, et ils ont plié bagage. On n’a pas annoncé leur mort, que je sache, mais, s’ils sont vivants, on ne s’occupe guère d’eux. Ensuite il y eut celui qui fit le tour de Paris avec son appareil et qui chavira dans la Seine. Ça, c’était voler pour de bon, malgré la culbute ; mais où est-il maintenant ? Il ne s’était pas blessé dans l’accident. Et cependant, c’est comme s’il était tombé dans le troisième dessous.
L’orateur se disposa à allumer sa pipe.
– On dirait qu’une société secrète les subtilise les uns après les autres, – opina Bert.
– Une société secrète ! Ah ! bien ! – l’allumette craqua et le fumeur tira quelques bouffées. – Une société secrète ! – répéta-t-il, la pipe entre les dents et l’allumette flambant toujours. – L’Administration de la guerre, c’est tout aussi secret ! – Il jeta l’allumette et fit quelques pas. – C’est comme je vous le dis, – certifia-t-il, – il n’y a pas une puissance importante en Europe, ou en Asie, ou en Amérique, ou en Afrique, qui n’ait au moins deux ou trois machines volantes dans son sac, à l’heure actuelle, de vraies machines volantes bien maniables… Et l’espionnage et les ruses pour surprendre ce que les autres ont trouvé ! Voyez-vous, pas un étranger, pas même un de nos compatriotes, s’il n’est accrédité, ne peut approcher à plus de cinq kilomètres des terrains d’expérience.
– Pourtant – fit Bert – j’aimerais bien en voir un… rien que pour pouvoir y croire quand je l’aurais vu.
– Vous le verrez avant qu’il soit longtemps, promit le soldat, qui prit sa motocyclette et la poussa sur la route.
Bert resta assis sur son parapet, grave et pensif, la casquette rejetée en arrière et une cigarette à demi éteinte au coin de la bouche.
– Si ce qu’il dit est vrai – marmonna-t-il – moi et Grubb nous sommes en train de perdre notre temps… sans parler de ce que va coûter la réparation de la serre.
5
Pendant que sa mystérieuse conversation avec le soldat tourmentait l’imagination de Bert Smallways, se produisit le fait le plus stupéfiant de tout le chapitre dramatique de l’histoire humaine qui relate la rapide conquête de l’air. On parle volontiers d’événements qui font époque, – celui-là en fut un : l’envolée inattendue de M. Alfred Butteridge, qui, partant du Palais de Cristal, fit le trajet Glasgow, et retour ; dans un petit appareil plus lourd que l’air, d’aspect fort pratique, une machine parfaitement maniable et dirigeable, qui volait aussi bien qu’un pigeon.
On avait l’impression très nette que ce n’était pas seulement un pas en avant vers la conquête définitive de l’air, une enjambée de géant, un bond colossal. M. Butteridge navigua dans les airs pendant neuf heures et, durant ce temps, il évolua avec l’aisance et l’assurance d’un oiseau. Sa machine, cependant, n’avait l’aspect ni d’un oiseau, ni d’un papillon, non plus que l’extension latérale de l’aéroplane ordinaire. Elle suggérait plutôt à l’observateur l’idée d’une abeille ou d’une guêpe. Certaines parties tournaient avec une vitesse extrême et produisaient l’effet d’ailes transparentes, et d’autres parties, y compris deux élytres d’une courbe particulière, restaient tendues et immobiles. Au milieu se trouvait un corps de forme arrondie et allongée, comme le corps d’une phalène, sur lequel M. Butteridge se tenait installé à califourchon. L’analogie augmentait de ce fait que l’appareil volait avec un bourdonnement sourd, comme celui d’une guêpe contre une fenêtre.
M. Butteridge prit le monde par surprise. C’était un de ces inconnus que le Destin réussit à produire encore pour stimuler l’humanité. Il venait, affirmait-on avec une égale assurance, d’Australie, d’Amérique, de Gascogne. On prétendait, sans la moindre trace de vérité, qu’il était fils d’un industriel qui avait amassé une fortune considérable à fabriquer des becs de plume en or et les stylographes Butteridge. En réalité, il n’y avait aucune parenté entre les deux Butteridge. Depuis quelques années, en dépit de sa voix tonitruante, de sa vaste corpulence et de ses airs importants, agressifs et féroces, le nôtre n’était qu’un membre insignifiant de la plupart des sociétés aéronautiques existantes alors. Un jour, il adressa une lettre circulaire à toute la presse londonienne pour annoncer qu’il avait organisé, au Palais de Cristal, une expérience probante, au cours de laquelle une machine volante s’enlèverait et démontrerait péremptoirement que les difficultés qui avaient entravé jusqu’alors le vol mécanique dans les airs étaient définitivement vaincues. Rares furent les journaux qui insérèrent sa lettre, et plus rares encore les lecteurs qui ajoutèrent la moindre créance à son information. Personne même ne se tourmenta, lorsque, à la suite d’une querelle pour des motifs personnels, il cravacha la figure d’un célèbre virtuose allemand sur le perron d’un grand hôtel de Piccadilly. Sa tentative fut retardée par cette altercation qu’on rapporta très inexactement en orthographiant son nom Betteridge et Betridge. Jusqu’à sa première envolée, il n’avait su, par aucun moyen, s’imposer à l’attention publique. Une trentaine de curieux à peine, en dépit de sa réclame, étaient présents, quand, vers six heures, par un beau matin d’été, il ouvrit les portes du vaste hangar dans lequel il avait procédé au montage de son appareil et que son insecte géant se mit à bourdonner aux oreilles d’un monde insouciant et incrédule.
Mais, avant qu’il eût tourné deux fois au-dessus du Palais de Cristal, la Renommée avait embouché sa trompette, et elle en tirait déjà de longs appels quand les vagabonds endormis sur les bancs de Trafalgar Square, éveillés en sursaut, aperçurent Butteridge virant autour de la colonne de Nelson. Vers dix heures et demie, comme il passait au-dessus de Birmingham, la Renommée continuait à faire retentir les échos britanniques de son assourdissante fanfare. L’exploit dont on désespérait était accompli ! Un homme voyageait dans les airs, à son gré et en toute sécurité !
L’Écosse l’attendait bouche bée. Il arriva à Glasgow vers une heure, et l’on raconte que le travail ne fut pas repris avant deux heures et demie dans les docks et les manufactures de cette ruche industrielle. L’imagination publique était juste assez instruite des choses de l’aviation pour apprécier M. Butteridge à sa réelle valeur. Il contourna les bâtiments de l’Université et piqua vers une moindre altitude, pour être à portée de voix de la foule assemblée dans le West End Park et sur la pente de Gilmour Hill. L’appareil décrivait, à une vitesse de cinq kilomètres à l’heure, un large cercle, avec un bourdonnement sourd qui aurait complètement dominé la voix claironnante de M. Butteridge, s’il n’avait eu la précaution de se munir d’un mégaphone. Avec une aisance parfaite, l’aviateur évitait les clochers, les tourelles, les câbles du monorail, tout en riant à tue-tête :
– Mon nom est Butteridge ! – Et il épelait : – B-UT-T-E-R-I-D-G-E. Vous y êtes ? Ma mère était écossaise !
S’étant assuré qu’on l’avait compris, il s’éleva à nouveau au milieu des hourras, des cris et des acclamations patriotiques, et il s’élança à toute vitesse et comme en se jouant vers le sud-est, montant et descendant, glissant en longues ondulations, d’une manière qui ressemblait extraordinairement au vol de la guêpe.
En route, il alla évoluer au-dessus de Liverpool, de Manchester et d’Oxford, épelant son nom dans chaque ville, et son retour à Londres provoqua une surexcitation sans précédent. Tout le monde levait la tête vers le ciel. En ce seul jour, le nombre des gens écrasés dans la rue fut plus élevé qu’au cours des trois derniers mois, et un bateau à vapeur du service municipal de la Tamise heurta si violemment le ponton de Westminster qu’il n’échappa au naufrage qu’en allant s’enliser sur la rive opposée, dans la vase découverte par la marée basse.
Butteridge revint au Palais de Cristal, point de départ classique des aventures aéronautiques, à l’heure où le soleil se couchait, et il réintégra sans encombre son hangar, dont il fit immédiatement fermer les portes au nez des photographes et des journalistes.
– Dites donc, vous autres, – les apostropha-t-il, pendant que son aide poussait les portes, – je meurs de fatigue, et je ne me tiens plus sur les jambes d’avoir été si longtemps en selle. Impossible de vous accorder une seule seconde d’entretien, je suis fourbu, esquinté. Mon nom est Butteridge. B-U-T-T-E-R-I-D-G-E. Compris ? Je suis citoyen de l’Empire britannique. Pour le reste, à demain.
De confus instantanés ont survécu pour rappeler cet incident. L’aide tient tête à un flot envahissant de jeunes gens résolus, en chapeaux melons et cravates conquérantes, qui brandissent des carnets de notes ou soulèvent des appareils photographiques. L’aviateur, dans l’embrasure des portes, les domine de sa haute taille ; sa bouche, éloquente cavité sous une grosse moustache noire, est distendue par les vociférations qu’il s’époumone à lancer vers ces intrépides serviteurs de la Renommée. Il est là, dressé de toute sa taille, l’homme le plus fameux du moment. Symboliquement presque, il gesticule avec son mégaphone qu’il tient dans la main gauche.
6
Tom et Bert Smallways assistèrent tous deux à ce retour, de la crête de Bun Hill, d’où ils avaient si souvent contemplé les feux d’artifice du Palais de Cristal. Bert était surexcité, Tom restait calme et inerte, mais ni l’un ni l’autre ne se rendaient compte du bouleversement qu’allaient apporter à leurs existences les conséquences de ce début.
– Peut-être que Grubb s’occupera davantage de sa boutique, à présent, – observa Tom, – et qu’il jettera au feu son satané modèle. Non pas que ça puisse nous tirer d’affaire, tant que ne sera pas réglé le compte en retard avec Steinhart…
Bert était suffisamment clairvoyant et assez au courant des problèmes de l’aéronautique pour comprendre que cette gigantesque imitation d’une abeille allait, pour employer son expression, « flanquer des convulsions aux journaux ». Il fut évident le lendemain que, conformément aux prévisions de Bert, l’accès avait été sérieux : en des pages noircies de clichés hâtifs, la prose des comptes rendus trépidait, et le haut des colonnes écumait de titres délirants. Le surlendemain, ce fut pire, et, avant la fin de la semaine, les journaux ne furent pas tant mis en vente que jetés à travers les rues, avec des vociférations. Dans ce tumulte, dominait seule l’exceptionnelle personnalité de M. Butteridge, avec les conditions extraordinaires qu’il exigeait pour livrer le secret de son invention.
Car c’était un secret, qu’il gardait impénétrable par les moyens les plus astucieux. Dans la tranquille retraite des grands hangars du Palais de Cristal, il avait construit son appareil avec le concours d’ouvriers indifférents et inattentifs. Le lendemain de son voyage dans les airs, il démonta tout seul la machine, et fit empaqueter certaines parties par des aides trop bornés pour être capables de le trahir ; lui-même se chargea d’emballer avec un soin particulier le moteur et les autres pièces mécaniques. Les caisses dûment scellées furent expédiées dans toutes les directions à divers garde-meubles. Il devint évident que ces précautions n’avaient rien d’excessif, quand on vit M. Butteridge violemment assailli de demandes de photographies et de renseignements au sujet de sa machine. Mais, satisfait d’avoir une fois mené à bien sa démonstration, l’aviateur prétendait garder son secret contre tout danger de fuite. Il faisait face au public, à présent, avec cette unique question : voulait-on, oui ou non, ce secret ? Citoyen de l’Empire britannique, répétait-il à satiété, son premier et son dernier désir était de voir son invention devenir le privilège et le monopole de l’Empire ; cependant…
C’est là que commençait la difficulté.
On ne pouvait en douter, M. Butteridge était un homme singulièrement affranchi de toute fausse modestie, et même, à vrai dire, de toute modestie, quel qu’en fût le genre. Il accueillait volontiers les interviewers, répondait à leurs questions sur tous les sujets autres que l’aéronautique, prodiguait les opinions, les critiques, les détails biographiques, distribuait les portraits et documents iconographiques concernant son individu, et usait de tous les moyens pour projeter sa personnalité sur l’horizon terrestre. Les effigies qu’on publia de lui soulignaient d’abord une immense moustache noire et, en second lieu, derrière la moustache, un air farouchement irascible. Pourtant, dans le public, on avait l’impression que Butteridge était un homme de peu de poids. Personne de vraiment grand, sentait-on, n’aurait eu une expression si virulente et si agressive, bien qu’en réalité Butteridge eût une taille de six pieds deux pouces (1, 88 m) et un poids exactement proportionnel. En outre, il était engagé dans une histoire d’amour de dimensions extravagantes et inaccoutumées et de conditions irrégulières, et le public britannique, encore fort attaché au souci du décorum, apprit avec alarme et répugnance que l’inventeur imposait comme une condition sine qua non à l’acquisition exclusive de l’inestimable secret de la stabilité aérienne, une intervention officielle en faveur de la solution de cette affaire.
Les détails précis relatifs à cette liaison ne furent jamais révélés au grand jour ; on sut que la dame, apparemment par une magnanime inadvertance, avait perpétré la cérémonie du mariage avec « un putois abject », pour citer une expression inédite de M. Butteridge, et cette aberration zoologique avait d’une manière vexatoire et légale ruiné ses chances sociales de bonheur. M. Butteridge s’obstinait à pérorer sur ce sujet, et, à la clarté de telles complications, à dépeindre les splendeurs morales et physiques de la dame. Quel embarras, pour une presse qui a toujours possédé un penchant considérable à la réticence et qui tenait, bien entendu, selon les usages modernes, à obtenir le plus possible de détails, à condition qu’ils ne fussent pas immodérément personnels ! Quel embarras, certes, de se heurter inexorablement au vaste cœur de M. Butteridge, de le voir ouvert grâce à cette impitoyable autovivisection, et d’apercevoir ses fragments tressautants, ornés d’étiquettes emphatiques comme des oriflammes.
On s’y heurtait, et il n’y avait pas moyen d’éviter l’obstacle. M. Butteridge faisait battre et palpiter son terrifiant viscère devant les journalistes épouvantés. Jamais aucun oncle n’astreignit aussi implacablement ses petits-neveux à écouter le tic-tac de sa grosse montre. Il triomphait de toutes leurs échappatoires et « se glorifiait de son amour », affirmait-il, en les obligeant à le noter dans leurs carnets.
– Il s’agit là d’une affaire privée, monsieur Butteridge, – objectaient-ils.
– Mais l’injustice, monsieur, est publique. Peu m’importe de m’attaquer à des institutions ou à des individus, de m’en prendre même à tout l’univers ! Je plaide la cause d’une femme, d’une femme que j’aime, monsieur… une noble femme incomprise et outragée ! Je la défends, monsieur, et je la vengerai, contre les quatre vents du ciel ! – menaçait-il avec véhémence.
D’autres fois, il clamait à pleine voix : – J’aime l’Angleterre, mais le puritanisme, voyez-vous, je l’abhorre, il me donne la nausée, il me soulève le cœur. Prenez mon cas, par exemple…
Il se remettait à étaler impitoyablement son cœur, et cela jusque sur les secondes épreuves de ses interviews. Si les rédacteurs n’avaient pas suffisamment noté ses beuglements et ses gesticulations, il les insérait en marge, de sa grosse écriture écrasée, et en ajoutait beaucoup plus qu’ils n’en avaient omis.
La chose devenait étrangement délicate pour un journaliste britannique. Jamais il n’y eut problème à la fois aussi notoire et aussi dénué d’intérêt. Jamais le monde n’avait écouté avec moins d’appétit et de sympathie l’histoire d’un amour malheureux. D’autre part, la curiosité était extrême concernant l’invention de M. Butteridge. Mais quand on pouvait faire dévier un instant l’aviateur de la cause féminine dont il s’instituait le champion, il discourait le plus souvent avec des sanglots de tendresse dans la voix, sur sa mère et sur son enfance ; – sa mère qui couronnait une encyclopédie complète de vertus par cette particularité d’avoir été « en grande partie écossaise » ; elle n’était pas de race pure, mais presque.
– Tout ce qui est en moi, je le dois à ma mère, tout ! – proclamait-il. – Demandez-le à tous ceux qui ont accompli quelque chose, vous entendrez la même antienne tout ce que nous possédons, nous le devons à la femme. C’est elle qui est la race, monsieur ! L’homme, peuh !… un rêve, une illusion. Il arrive et il passe ! C’est l’âme de la femme qui nous entraîne toujours plus loin et toujours plus haut !
Et il phrasait sans cesse sur ce ton-là.
On ne savait guère ce qu’il demandait au gouvernement pour son secret, ni ce qu’en dehors d’un paiement en argent il pensait obtenir d’un État moderne pour son affaire de cœur. Les observateurs judicieux en concluaient qu’il ne proposait aucun marché, mais qu’il profitait d’une occasion sans précédent pour brailler et parader devant un public attentif. Des rumeurs coururent à propos de son passé. On raconta qu’il avait tenu une sorte d’hôtel borgne à Cape Town, où il avait eu pour locataire un inventeur nommé Palliser, jeune homme fort timide et sans amis. Il avait assisté aux expériences de cet ingénieur qui, venu d’Angleterre dans un état avancé de tuberculose, mourut bientôt, fournissant ainsi l’occasion à l’hôtelier de s’approprier les papiers et les plans que personne ne réclamait. Ce fut là, tout au moins, l’allégation émise par les journaux américains les plus audacieux ; mais le public ne vit paraître à ce sujet ni preuve ni réfutation.
En outre, M. Butteridge s’engagea avec ardeur dans un enchevêtrement de réclamations concernant un grand nombre de prix en argent. Ces prix, dont quelques-uns remontaient à 1906, avaient été offerts pour récompenser les succès du vol mécanique. À l’époque où M. Butteridge allait accomplir son exploit, quantité de journaux, voyant le peu de risque couru par leurs confrères qui déjà s’étaient aventurés dans ces promesses, avaient offert de payer en certains cas des sommes absolument ruineuses ; par exemple, au premier aviateur qui irait de Manchester à Glasgow, ou de Londres à Manchester, au premier qui franchirait en Angleterre une distance de cent ou de deux cents milles, etc. La plupart avaient hérissé leur donation de conditions ambiguës, et à présent ils cherchaient à biaiser et refusaient de s’exécuter. Un ou deux seulement payèrent sans discussion et appelèrent avec frénésie l’attention publique sur leur générosité. M. Butteridge se lança dans des polémiques et des litiges avec les récalcitrants, tout en entretenant une vigoureuse agitation et d’actifs pourparlers, afin de décider le Gouvernement à lui acheter son invention.
Pendant que tout ce bruit s’amplifiait, un fait, toutefois, demeurait fixe derrière les absurdes amours de Butteridge, derrière ses opinions politiques, sa personnalité, ses clameurs et ses vantardises, et ce fait, c’est que, pour la masse du public, il restait l’unique possesseur du secret qui permettrait de construire l’aéroplane pratique, et probablement donnerait à son acquéreur l’empire du monde. Bientôt, à la vive consternation de la multitude, y compris entre autres M. Bert Smallways, il devint apparent que, de quelque façon qu’eussent été entamées les négociations pour l’acquisition de ce précieux secret par le gouvernement anglais, il y avait des chances pour qu’elles n’aboutissent jamais. Un grand quotidien de Londres jeta l’alarme en publiant une interview sous ce titre terrifiant : « M. Butteridge dit ce qu’il pense ! » À la suite de quoi l’inventeur, ou le prétendu tel, déversait sa rancœur.
– Je suis venu du bout de la terre (ce qui semblait confirmer l’histoire de l’hôtel mal famé de Cape-Town) pour apporter à ma patrie le secret qui lui assurera la suprématie universelle. Et qu’est-ce que j’obtiens en retour ? – une pause. – Je suis bafoué par de vieux bonzes, par des mandarins périmés !… Et la femme que j’aime est traitée comme une pestiférée !… Je suis citoyen de l’Empire Britannique ! – poursuivait-il en un splendide transport, rétabli de sa main sur l’épreuve de l’article. – Mais la patience humaine a des limites. Il y a des nations plus jeunes, des nations vivantes, des nations qui ne se contentent pas de ronfler et de glousser apathiquement, en des paroxysmes de pléthore, sur des lits de formalités et de bureaucratie. Il y a des nations où les gens ne seront pas assez présomptueux pour dédaigner l’empire du monde, dans le seul but de berner un inconnu et d’insulter une noble femme dont ils ne sont pas dignes de délacer les souliers. Il y a des nations qui ne restent pas aveugles devant la science, qui ne sont pas livrées pieds et poings liés à une snobocratie efféminée et à des décadents dégénérés ! Bref, notez bien mes paroles : il y a d’autres nations !
C’est ce discours qui avait particulièrement impressionné Bert Smallways.
– Si les Allemands ou les Américains mettent le grappin là-dessus, – déclara-t-il d’un ton pénétré à son frère – l’Angleterre est fichue ! C’est réglé ! Le pavillon de l’empire des mers ne sera plus qu’une loque, une chiffe inutile !
– Pourriez-vous nous donner un coup de main, ce matin ? – s’enquit Jessica pendant le silence solennel qui suivit. – On dirait que tout le monde, à Bun Hill, a besoin de pommes de terre nouvelles en même temps. Tom ne pourra pas faire la moitié des livraisons.
– Nous vivons sur un volcan ! – reprit Bert, sans paraître avoir entendu. – À tout moment, la guerre peut éclater…, et quelle guerre !
Il hocha la tête avec une moue de mauvais augure.
– Il vaudrait mieux aller porter ce paquet-ci d’abord, Tom, – indiqua Jessica. Puis, se tournant résolument vers Bert : – Vous nous donnerez votre matinée, n’est-ce pas ?
– Rien ne m’en empêche, – convint Bert – Ça va tout doucement à la boutique, ces jours-ci. Pourtant, tous ces dangers qui menacent l’Empire me tourmentent d’une manière effrayante !
– Ça se dissipera en travaillant, – fit Jessica.
Bientôt, Bert, ployé sous le fardeau des pommes de terre et des périls de l’Empire, se promena par un monde de changements et de merveilles, et son malaise se transforma rapidement en une irritation très nette contre le poids et l’inélégance du sac de pommes de terre, et en une conception fort précise du caractère de sa belle-sœur, qu’il jugeait parfaitement détestable.
CHAPITRE II
OÙ BERT SMALLWAYS EST ASSAILLI DE DIFFICULTÉS
1
Il ne vint à l’idée ni de Tom ni de Bert Smallways que le remarquable exploit aérien de M. Butteridge pût en aucune manière affecter leur existence, ni qu’il en résultât pour eux d’être distingués parmi les millions d’individus qui les entouraient. Quand, du haut de Bun Hill, ils eurent vu la guêpe mécanique, avec ses plans rotateurs dorés par le couchant, rejoindre en bourdonnant l’abri du hangar, ils reprirent le chemin de la fruiterie, en contrebas sous le grand pilier de fer de la ligne du monorail allant de Londres à Brighton, et aussitôt ils recommencèrent la discussion qu’ils avaient entamée avant que le miraculeux Butteridge eût surgi des brumes londoniennes.
C’était une discussion difficile et sans issue. Ils se criaient les phrases dans l’oreille, à cause du mugissement et du ronflement des wagons gyroscopiques qui traversaient la Grand’Rue. Le sujet du débat était litigieux et confidentiel. Les affaires de Grubb paraissaient en fâcheuse posture. Or dans un moment d’enthousiasme financier, il avait associé Bert pour moitié à son entreprise, ce qui le dispensait de lui payer aucun salaire.
Bert s’efforçait de faire entrer dans la tête de Tom que la nouvelle firme « Grubb et Smallways » offrait des avantages sans précédents et sans comparaison pour le petit capitaliste possédant des fonds disponibles. Et Bert en arrivait à constater, comme si c’eût été un fait extraordinaire, que Tom restait absolument bouché à toute idée. À la fin, il laissa de côté les considérations financières, et, faisant exclusivement appel à l’affection fraternelle, il réussit à emprunter à Tom un souverain, en échange de sa parole d’honneur comme garantie du remboursement.
La firme « Grubb et Smallways », anciennement « Grubb », avait en réalité joué de malheur depuis quelque temps. Au cours des dernières années, les affaires avaient marché cahin-caha, avec une prédisposition romanesque à l’insécurité, dans une petite échoppe délabrée ouvrant sur la Grand’Rue. Les murs du magasin étaient ornés d’affiches brillamment coloriées, envoyées par des fabriques de cycles, et de tout un assortiment de grelots et de timbres, de pinces à pantalon, de burettes à huile, de valves, de clefs anglaises, de sacoches, et autres accessoires. Des écriteaux et des pancartes annonçaient « Bicyclettes à louer », « Réparations », « Gonflement gratuit de pneus », « Huiles et essences » et toutes attractions similaires. La firme représentait diverses marques obscures de bicyclettes, deux machines neuves constituant le fonds en magasin. À l’occasion, une vente s’opérait, mais le plus clair des bénéfices des deux associés, quand la chance, qui n’était pas toujours de leur côté, les favorisait, provenait de menus travaux nécessités par des crevaisons de pneus et par d’autres accidents. Ils plaçaient aussi des phonographes à bon marché et tiraient quelques profits de la vente des boîtes à musique. Leur activité se donnait surtout libre cours dans la location des bicyclettes. C’était là un singulier commerce que ne régissait aucun principe commercial ou économique connu, que ne régissait, à vrai dire, aucun principe. Le stock de location consistait en une quantité de bicyclettes d’hommes et de dames, dans un état de dislocation qui défiait toute description et toute tentative de réparation. Ces instruments étaient loués à des individus téméraires et peu exigeants, inexperts aux choses de ce monde. Le tarif nominal s’élevait à un shilling pour la première heure et à six pence pour les heures suivantes. Mais, en réalité, il n’existait aucun prix fixe, et d’avisés gamins, en insistant assez, pouvaient s’offrir une course à bicyclette et le frisson du danger pour le prix réduit de trois pence à l’heure, s’ils prouvaient que c’était là toute leur fortune. Pour les transactions régulières, on exigeait des arrhes, excepté avec les clients habituels la selle et le guidon rapidement mis à hauteur convenable, les engrenages et les moyeux huilés, l’aventureux cycliste se lançait dans la carrière. Il finissait presque toujours par revenir, mais parfois, en cas d’accident sérieux, Bert ou Grubb devaient aller rechercher la machine. La location comptait jusqu’au moment du retour à la boutique, et le prix en était déduit du montant des arrhes. Rarement une machine sortait de leurs mains en état de rouler sans accrocs. Les plus fantaisistes possibilités de pannes se nichaient dans tous les organes : dans le pas de vis usé de l’écrou qui maintenait la selle, dans les pédales branlantes, dans la chaîne détendue, dans le guidon vacillant, et surtout dans les freins et les pneus. Des clappements, des crissements et d’étranges grincements rythmiques s’éveillaient, aussitôt que l’intrépide pédaleur avait fait quelques tours de roue. Ensuite, il arrivait que le ressort du timbre ou du frein refusait de fonctionner devant un obstacle ; la douille du tube droit d’arrière se desserrait et la selle s’enfonçait brusquement avec un rebondissement déconcertant ; la chaîne cliquetante sautait soudain hors des dents d’un des pignons, au milieu d’une descente, bloquant la machine et l’obligeant à une halte aussi brusque que désastreuse, mais sans arrêter en même temps l’élan acquis du cycliste ; ou bien enfin un pneu éclatait ou soupirait silencieusement, abandonnait la lutte, et s’affalait dans la poussière.
Quand le cycliste revenait, pédestrement, haletant et fourbu, Grubb n’écoutait aucune récrimination. Il examinait gravement la machine :
– Vous l’avez rudement malmenée, cette bécane, – commençait-il, invariablement.
Et il devenait sur-le-champ la calme incarnation de l’esprit de controverse.
– Vous ne voulez pourtant pas que la bicyclette vous prenne dans ses bras et vous porte, – argumentait-il. – C’est à vous de faire preuve d’intelligence. Après tout, ça n’est qu’une machine.
Parfois la liquidation des comptes frisait les moyens violents. C’était toujours un démêlé fort prolixe et souvent pénible, mais à notre époque de progrès on ne gagne pas sa vie sans batailler. Malgré tous ces soucis, la location demeura une source assez régulière de bénéfices jusqu’au jour où toutes les vitres de la devanture furent brisées, et le stock de la vitrine grandement endommagé, par deux clients grincheux qui ne témoignaient d’aucun goût pour la controverse illogique. C’étaient deux vigoureux et grossiers chauffeurs employés aux usines de Gravesend ; l’un manifestait son mécontentement parce que sa pédale gauche s’était détachée et l’autre parce que son pneumatique s’était dégonflé – menus accidents, négligeables, d’après la coutume acceptée à Bun Hill, et dus certainement à un usage par trop brutal de ces délicates machines : mais cette méthode d’argumentation ne parvint pas à persuader aux deux clients qu’ils avaient tort. Toutefois, c’est un fâcheux moyen de démontrer à un homme qu’il vous a loué des machines défectueuses que de lancer sa pompe à pied au milieu de la boutique et de sortir son assortiment de trompes pour les faire rentrer à travers la vitrine. Le procédé ne réussit à convaincre ni l’un ni l’autre des deux associés, mais les vexa seulement et les irrita. Une querelle en engendre une autre et ce désagrément amena entre Grubb et son propriétaire une violente dispute sur les garanties morales et les responsabilités légales impliquées dans le remplacement des vitres. Le conflit atteignit son maximum à la veille des vacances de la Pentecôte.
Finalement, Grubb et Smallways n’eurent d’autre ressource que la stratégie d’un déménagement nocturne.
Ils guignaient depuis longtemps, pour leur nouvelle installation, au brusque tournant de la route, dans le bas de Bun Hill, une petite boutique, en forme de hangar, avec une vitrine d’une seule glace et une unique pièce sur le derrière. C’est là qu’ils soutinrent bravement le combat pour l’existence, en dépit des importunités persistantes de leur ancien propriétaire, avec l’espoir de certaines éventualités que semblait promettre la situation particulière de leur magasin. Mais là aussi ils étaient condamnés à la déconvenue.
La route de Londres à Brighton, qui traverse Bun Hill, ressemblait à l’Empire britannique et à la Constitution anglaise, en ce sens qu’elle avait acquis peu à peu son actuelle importance. À l’encontre des autres routes d’Europe, celles du Royaume Uni n’avaient jamais été soumises à aucun essai organisé de redressement et d’aplanissement, et c’est à cela sans doute qu’il faut attribuer leur caractère pittoresque. L’antique Grand’Rue de Bun Hill dégringole, au bout de l’agglomération des maisons, pendant huit ou neuf cents pieds, à une inclinaison de dix pour cent, puis elle tourne à angle droit sur la gauche, décrit une courbe d’une trentaine de mètres jusqu’à un pont de briques franchissant un ravin desséché qui fut autrefois le lit de l’Otterbourne, – et enfin elle fait un coude brusque autour d’un épais taillis d’arbres, avant de continuer à courir droite, simple, paisible. Il y avait eu là plusieurs accidents de voitures et de bicyclettes, avant que fût construite la boutique qu’occupaient Grubb et Smallways, et, à parler franchement, la possibilité de nouveaux accidents les avait surtout attirés.
Cette perspective s’était offerte à eux sous un jour humoristique.