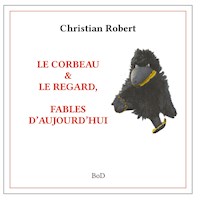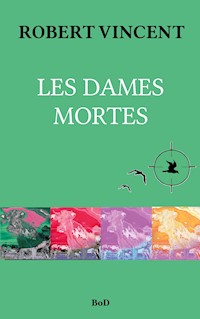Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
De nos jours, à Bolbec, dans le Pays de Caux, en Normandie, un obus allemand oublié éclate dans la cour du couple Bouju. Une main noire de fioul est projetée dans la chambre d'une voisine, la jeune chanteuse, Luna de Bourdon-Buchy. Après analyse, il apparaît que cette main reposait dans le pétrole depuis des décennies. Le reste du corps? Introuvable. La découverte du membre amputé met tout le commissariat de Bolbec en émoi, à commencer par le commandant Georges Faidherbe pour qui jeux de mains rime forcément avec jeux de vilains. LA MAIN NOIRE relate la septième enquête, sous la plume de ROBERT VINCENT, de ce policier havrais, temporairement détaché sur place dans un polar d'humour noir, poétique et cruel, qui transforme le roman policier en tragédie musicale.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Avertissement
Les personnages et les évènements de ce récit sont issus de la fantaisie de l’auteur, comme dans les autres titres précédemment publiés. Ces êtres de fiction sont plus proches de Tintin ou de Barbarella que de quiconque de réel : vous, nous ou le voisin de palier. Leur vérité et leur humanité sont toutes romanesques.
Des tristesses surannées Des malheurs qu’on oublie Des ongles un peu noircis Des ongles un peu noircis.(Joseph d’Anvers / Arman Méliès / Alain Bashung, « Tant de nuits », album Bleu pétrole)
Table des chapitres
Pays de Caux, août 1944 : le choc
Paint it black
Tout sur la fille
Vous avez dit Jacques ?
Un peu de lumière dans le noir
Parfum de fleurs et âme de fer
Quelque chose sur le fils
Viva Luna
!
La main dans le sac et sur la cuisse
Démarrage au
terminus
C’est du lourd
L’arbre du pardon
Pays de Caux, août 44 : le soupçon
Le coup de patte de l’artiste
Le fort dévale
Une langue morte
Bolbec, Août 44 : le marché
Les Terrier sortent de l’ombre
La petite fluette et le grand muet
Une méridienne à la bonne heure
L’amant au noir désir
Bolbec
brown baby
Araignée du matin, fais pas le malin
Farce et attrape-Riton
Bolbec, juin 1974 : le crime
L’assaut scie celui qui fait feu
Bolbec, juillet 1994: fouille au corps
Un baiser de fuel
Les silences de l’amer
Épilogue sur une méridienne mélancolique
Bonus :
La main noire
(chanson)
1
Pays de Caux, août 1944 : le choc
— Frappez, monsieur Hergot. Frappez donc. Frappez fort. Vite !
La cime des arbres commençait à se distinguer sur un ciel vide de nuages. Une légère pâleur montait de l’est. Bientôt, ce serait l’aube d’un nouveau jour du mois d’août 1944.
Dans une pente, en contrebas d’une route de campagne où les taillis venaient d’être fauchés par un accident, un civil entre deux âges tenait dans ses mains le pare-chocs arraché d’une Opel Super Six de l’armée allemande. La pièce de métal était trop lourde pour lui. Mais c’était surtout son hésitation qui rendait son geste maladroit. Un pan de sa veste soulevé par l’extrémité du pare-chocs battait lentement au rythme de sa respiration et du mouvement léger d’oscillation de son corps.
En face de lui, le jeune capitaine Heiner Obendorf s’impatientait. Il parlait avec ce léger accent et ce rythme que la fille d’Hergot, Josiane, trouvait si charmant.
Le civil, Étienne Hergot, ne l’entendait plus. Le malheureux avait l’impression d’être la vedette agitée d’un film muet. Il voulait vite sortir de ce cauchemar éveillé. Alors, il frappa. Du mieux qu’il pouvait. Ni par haine ni à cause des humiliations accumulées pendant quatre ans d’occupation. Comme sa fille, il avait encore de la sympathie pour le jeune officier allemand.
Ses coups firent écho à une batterie antiaérienne en pleine action. Sous le premier, l’Allemand s’agenouilla. Le second, lancé d’un grand balancement du pare-chocs, atteignit le visage, et fit s’effondrer le jeune officier, qui roula dans les feuilles mortes et les ronces hachées.
Sidéré, le Français accomplit mécaniquement l’autre geste prévu : la lanterne électrique à la main, il jeta son arme improvisée de l’autre côté de la voiture accidentée.
Étienne Hergot passa ensuite devant le poste de conduite, qu’il balaya de sa lumière. Il aperçut le buste du chauffeur. Le visage était découpé en éventail par les lames de verre du pare-brise éclaté sous le choc. Le Français fut pris de malaise. Il tituba comme un homme soûl vers l’avant défoncé de l’Opel.
Il fallait se reprendre pourtant, et bien exécuter le reste. Hergot retourna le corps allongé à terre. Il chercha le poignet, le pouls. Il ne sentit rien dans la nervosité de l’instant. Alors il s’agenouilla et écouta le cœur. A travers la vareuse, le son ne passait pas. Le canon de 88 tonnant contre une escadrille de bombardiers alliés revenus de leur mission nocturne gênait aussi le Français. À chaque salve d’artillerie, il enfonçait la tête dans ses épaules, paralysé, redoutant d’entendre aussi le sifflement des bombes qui tombent comme dans cet après-midi du 1er août où le mont de Bolbec et la gare avaient été ravagés. Vingt et un morts dont six femmes. Tués par les Alliés. Il prit enfin sur lui et remonta vers le visage tourné contre le sol. Il n’y toucherait pas, surtout pas après le choc terrible et destructeur qu’il avait asséné. Il écouta seulement. Un gargouillis le rassura. Du sang, des humeurs bouillonnaient sous l’effet d’une respiration lente et tranquille.
Le jeune Hauptmann Heiner Obendorf avait été assommé à sa demande expresse. Il était dans le coma peut-être mais vivant et sans doute serait-il satisfait plus tard. Étienne Hergot essuya d’un grand mouchoir à carreaux son visage en sueur malgré la fraîcheur du petit matin. Il tremblait encore, pourtant il réussit à rassembler ses pensées.
Il allait passer chez Ernest Aubourg. Le laitier devait être déjà levé et se préparait pour sa tournée. Hergot lui demanderait de promener par ici sa carriole, de ramasser le blessé et de porter l’alarme au PC des Schleus, la Kommandantur, installée au premier étage de la mairie de Bolbec. Il fallait improviser. Rien de tout ça n’était prévu quand Hergot s’était couché la veille au soir après avoir embrassé Josiane. Sa fille, installée dans le salon, finissait une traduction pour les Allemands. Plus tard, en pleine nuit, le jeune capitaine Obendorf était apparu devant la porte de sa chambre, fébrile, décidé, l’uniforme déchiré et souillé. Il avait persuadé Étienne Hergot, pour ne pas dire forcé, de le suivre dans la nuit. Comment était-il entré dans la maison fermée à clef ? Mystère. En hâte, les deux hommes avaient quitté la maison puis la ville silencieusement.
Hergot ramassa la serviette de cuir qu’Obendorf avait tirée des buissons pour la lui donner. C’est pour ça aussi que le Hauptmann l’avait fait cavaler jusque-là : deux cent mille francs en billets de mille avec leur bel Hermès et leur Déméter aux yeux d’aveugle. Une somme. On manquait de tout. Il n’y avait plus rien à acheter. Mais la guerre ne durerait plus longtemps, ni les restrictions. Deux cent mille francs, quatre ou cinq ans de revenu, ne seraient pas négligeables après.
Il était prêt à détaler quand une vague inquiétude, le sentiment d’avoir oublié quelque chose d’essentiel, fit retourner Hergot à l’Opel. Bon Dieu, la portière arrière était fermée ! Comment les Frisés pourraient-ils croire que le capitaine avait été éjecté sous le choc de l’accident ? Le Français ouvrit grand la portière. Sous l’effet de son propre poids et de la pente, elle se referma aussitôt avec un bruit sec comme un coup de fusil qui le fit sursauter. Il faudrait expliquer ça à Aubourg au cas où les Boches le cuisineraient. Hergot eut le temps d’apercevoir le troisième homme, un civil, dans la berline. Une impulsion lui fit rouvrir la porte et braquer sa lampe à l’intérieur. Il n’aurait pas dû. Il eut un haut-le-cœur, retint difficilement une envie de vomir. Le type avait la moitié de la tête arrachée. Sa calotte crânienne reposait dans une mare de sang, sur la banquette, découpée par la rafale d’un Hawker Tempest britannique. C’était le même spectacle horrible qu’en mars, le mercredi où il rentrait du Havre en autocar. Aux Trois-Pierres, vers 18 heures, des avions alliés les avaient mitraillés. Son voisin de banquette, un client, Théophraste Geoffrey, avait eu le cou sectionné. Il y avait eu d’autres morts et des blessés, du sang partout, même sur lui, le miraculé indemne.
Dans l’Opel, le rescapé cette fois-ci avait été le jeune Heiner Obendorf. Il escortait alors un ponte de la collaboration industrielle travaillant pour l’organisation Todd chargée de superviser la construction du Mur de l’Atlantique et de la Manche. Le miracle lui avait ouvert les yeux sur sa débâcle personnelle. Mieux valait se faire rapatrier sanitaire, la gueule cassée, que crever dans une guerre perdue désormais bien que les rapports officiels fussent toujours fanfarons. « Des avions de guerre allemands rapides ont attaqué des objectifs dans le sud et l’est de l’Angleterre »1. Ces avions rapides, le capitaine teuton eût préféré les voir en action au-dessus de lui, ce soir-là.
La victime à l’arrière de l’Opel était une huile : ses habits et ses chaussures étaient neufs et de très bonne qualité, élégants, luxueux même, une rareté après cinq ans de guerre. Étienne Hergot savait de quoi il retournait : il était tailleur. Par terre, à côté du pied gauche du mort, un petit objet luisait. Hergot tendit la main et le mit dans sa poche.
La Flak se tut. C’était la trêve de l’aube. La canonnade allait reprendre bientôt son balayage aérien. Pendant cette accalmie, une grive musicienne lança un trille. En s’aidant de ses mains tellement la pente était forte sur les derniers mètres, Hergot remonta sur le bas-côté de la route et resta là, à quatre pattes, quelques longues minutes, à respirer l’air du matin. Si Mathilde le voyait ? Elle l’apercevait peut-être de là-haut. En se relevant, Etienne Hergot se mit à sangloter. Mathilde, son épouse, n’avait pas survécu à trois semaines d’exode exténuantes, le laissant seul avec leur fille, Josiane. Il pleurait encore sur la route qui le menait chez Ernest Aubourg dans le faubourg de Bolbec. Il marchait tenant à la main la serviette en cuir que le jeune Allemand était allé chercher dans les buissons avant de la lui tendre.
Etienne Hergot allait mettre à l’abri deux cent mille francs.
Les tirs avaient repris, il baissa la tête comme pour se protéger d’un ciel griffé d’éclairs. C’est à cet instant qu’une fusée traversa son champ de vision. Elle sifflait terriblement au sortir d’un bosquet à l’horizon, volant bas, d’une façon irrégulière. C’était fréquent. Dans leur débâcle, les Boches tiraient des obus mal emboutis, fabriqués à la va-vite dans des usines d’armement bombardées jours et nuits. M. Hergot se frotta les yeux, suivit le projectile. Il crut un instant à une de leurs nouvelles bombes volantes qui rataient le décollage une fois sur deux.
C’était plutôt un petit engin, avec ses neuf kilos volant en vrille vers Bolbec. M. Hergot ferma les yeux dans l’attente de la déflagration. Rien ne se produisit. Au sifflement de l’engin succéda celui des oiseaux. Hergot se demanda où avait atterri ce foutu obus. Non, décidément, leur matériel ne valait plus rien. Les Boches, cette fois, étaient bien kaputt.
1Rapport de la Wehrmacht, QG du Führer, 21 juillet 44.
2
Paint it black
L’explosion de cet obus secoue la vallée de Bolbec soixante-et-un an plus tard, le 25 août 2006, à 8 heures 02 précisément.
Impossible de situer l’origine de la déflagration quand on habite cette ville tapie dans le fond d’une cuvette, confluence de vallées qui s’étoilent en pattes d’araignée. L’onde rebondit par échos dans toutes les directions. Puis une sirène retentit des hauteurs, en haut du parc municipal. En bas, celle d’un camion de pompiers lui fait écho. Il parcourt l’artère principale et passe en bas de la rue piétonne, veine blanche de la petite ville brune et grise et file vers le sinistre signalé par un filet noirâtre sur les hauteurs.
Des habitants se mettent aux fenêtres, des consommateurs aux cafés sortent sur les trottoirs, le verre matinal à la main. Ils s’interrogent :
— C’est-i’ une usine qu’a pété ? demande le charcutier, surgi en trombe de son laboratoire dans la rue.
— Oui, semblent répondre des hochements de tête entendus et résignés.
— Ça devait arriver un jour, commente le même, en allumant une Gitane sans filtre. J’l’ai toujours dit : la zone industrielle de Port-Jérôme, elle est trop près.
On ne l’écoute pas. Lui, c’est un militant écologiste. Il ne perd pas une occasion pour faire sa propagande, vouant aux gémonies les industries pétrolières installées en bord de Seine de Petit-Couronne, près de Rouen, à Gonfreville-l’Orcher en amont du Havre, en passant par Port-Jérôme au débouché de la vallée du Commerce où une rivière, la Bolbec, vient alimenter le fleuve en face de Quillebeuf-sur-Seine. On cherche plutôt à deviner ce qui se passe. Les plus méfiants claquent immédiatement leurs volets, ferment en tremblant leurs fenêtres qu’ils calfeutrent. C’est peut-être déjà trop tard. Il ne fallait pas mettre le nez dehors, il fallait renfoncer la tête dans ses épaules, écouter France Bleu en attendant que les usines tombent en pluie pétrochimique sur la ville.
Sur le plateau, au-dessus de la place de la mairie, s’élève la maison des Bourdon-Buchy. Au rez-de-chaussée de cette maison bourgeoise sans âge, cube grisâtre, décrépit et aveugle côté ville, l’explosion du 25 août est d’abord ressentie avec un certain soulagement. La comtesse de Bourdon-Buchy se dit qu’elle arrive enfin au bout de la traversée de la vie, passée pour moitié sur une méridienne bancale au tissu crevé dont les ressorts commencent à méchamment lui vriller le popotin.
La maison a été secouée, elle vacille sur ses fondations et ses miettes d’ardoises se dispersent maintenant sur la ville, en confettis bleutés. La bombe a explosé à deux pas, sur le plateau, et son souffle pourrait avoir ébranlé ce qui reste de la construction pour la faire s’effondrer dans la fosse du centre ville. Alors que les murs semblent encore trembler, que la peinture écaillée du plafond tombe en pluie blanchâtre dans son salon, la comtesse de Bourdon-Buchy révise son jugement. Tout sauf tomber dans la cuvette urbaine. Disparaître corps et biens, dignement pulvérisée, soit. Et qu’on n’en parle plus. Mais débouler lamentablement la pente en dispersant les restes du patrimoine sur un ciment sale parsemé d’herbes folles et de cadavres de bouteilles, non. Les manants du bas seraient trop heureux d’aller piller les débris de l’aristo, chercher quelque relique d’argenterie à barboter.
Soudain elle se souvient de sa fille, à l’étage.
La sirène du parc municipal s’est tue. Silence pesant post-catastrophe. Quelques toux résonnent chez des voisins du quartier de l’Électricité. Des chiens hurlent à la mort de l’autre côté de la vallée. Une télévision s’est rallumée, quelque part. La vie reprend.
Au premier étage de la maison des aristocrates, c’est Luna de Bourdon-Buchy que la bombe a surprise dans l’élan joyeux de son insouciante jeunesse. Luna a vingt-sept ans, elle en fait dix de moins, c’est une chanteuse dont la carrière peine à décoller. Elle habite encore chez sa mère et se présente systématiquement aux concours de chansons régionaux où elle remporte régulièrement quelques prix. On la trouve bizarre. Commune à la ville, elle est belle en scène. Elle se déchaîne et en trouble plus d’un.
Juste avant la déflagration, la jeune femme répétait à sa fenêtre, profitant du fait qu’une mini-pelleteuse avait entrepris de creuser à un mètre d’une vieille cuve à mazout une tranchée dans la propriété voisine. La chanteuse semi-professionnelle aime répéter dans le bruit. Un fond sonore, de préférence industriel, lui convient parfaitement : cette technique fait tomber toute inhibition et lui offre un accompagnement inouï et gratuit. Petite, elle allait couiner sous les murs de la fonderie de Bolbec, son conservatoire à elle.
Ce 25 août donc, à 8h 01 et 59 secondes, Luna chante le deuxième couplet de Consuélate como yo, une rumba inoffensive, quand l’explosion a lieu. Emportée par le souffle, elle traverse en volant les trois mètres de large de sa chambre pour heurter le mur et retomber sur son lit, sonnée. Sur le mur repeint en un noir goudronneux, sa silhouette se découpe au pochoir, couettes comprises. Luna, retombée comme une poupée de chiffon sur son matelas, le menton sur la poitrine et la langue pendante, a les bras en croix et les jambes écartées. Dans une semi-conscience, elle se voit le tronc attaché dans cette position outrageante à la roue du moulin de la ruelle Papavoine, s’apprêtant à basculer dans la rivière noire de Bolbec. Elle lutte de toutes ses forces pour ne pas sombrer définitivement dans l’inconscience. Elle est détrempée, grasse, meurtrie de partout. Ses tympans sont douloureux, son ouïe assourdie. En plus, elle voit mal. Les verres de ses lunettes sont souillés par une substance liquide et puante. Du fioul : un fond de cuve domestique vieilli depuis des décennies dans la propriété voisine.
Luna ôte ses grandes lunettes rectangulaires en écailles, distingue avec peine sa fenêtre dont la découpe n’a plus la régularité d’un rectangle parfait. Elle est myope et astigmate mais n’avait jamais vu, sans ses lunettes, sa fenêtre à ce point déformée : un immense œil-de-bœuf, un œil gigantesque qui la regarde bizarrement de sa pupille noire. Cette pupille, c’est le nuage de fumée tout rond qui stagne au-dessus du cratère et s’évapore doucement. Le bourdonnement dans ses oreilles s’atténue un peu. Derrière l’acouphène, Luna distingue même un lointain tambour. Elle tourne avec peine la tête sur sa droite. On doit frapper à la porte. Où est la porte, d’ailleurs ? Elle essuie ses verres sur une partie propre de ses draps. Le mur où la porte s’ouvre d’habitude est lacéré de larges bandes noires aux reflets rougeoyants tracés en étoile sur tous les murs, à partir de l’œil-de-bœuf géant. L’emplacement de la porte, ce doit être à peu près là, au milieu de ce mur sur sa droite, où une araignée monstrueuse tremblote au rythme des coups portés sur le bois, dans le couloir. L’araignée glisse lentement laissant au-dessus d’elle sa trace, cinq lignes aux reflets rougeâtres.
Une araignée si énorme, c’est déjà peu commun en Normandie, pense Luna, mais à cinq pattes, ça n’existe pas. Elle a eu le temps de l’apprendre à l’école, même si elle n’a pas fait de longues études : une araignée, ça a toujours huit pattes. Et ça court et ça monte. Alors, si ce n’est pas une araignée… Sa réflexion est interrompue par l’autrice de ses jours qui semble l’appeler de très loin derrière la cloison, mais dont elle reconnaît l’inflexion noble et inimitable, le timbre rocailleux de grande fumeuse et les mots si affectueux :
— Luna ! Ouvrez-moi, bon Dieu… ma pauvre enfant… mais qu’est-ce que vous avez encore fait comme connerie ?
— Je chantais, ne vous déplaise maman, répond mécaniquement la jeune femme avant de pousser un hurlement.
Ce n’est pas une araignée. Seule une main peut avoir cinq doigts et une pareille taille. Une main noire tranchée, toute juteuse d’un liquide visqueux. Comme sous l’effet du choc, cette main se recroqueville. Le majeur et l’annulaire se sont pliés vers la paume et le pouce leur est passé dessus. L’index et l’auriculaire, eux, sont restés tout raides. Elle devient inerte. Terminado.
Luna regarde ses propres mains. Les deux sont là, noires aussi et dégoulinantes du même liquide, mais encore bien attachées au bout de ses bras tremblants, avec tous leurs doigts. Alors ?..
3
Tout sur la fille
On a mis Luna dans l’ancienne chambre de l’aïeule d’origine espagnole, née Cajamar y Mondragon, dont la piété farouche aurait forcé l’admiration du Grand Inquisiteur Torquemada lui-même. Les murs sont couverts d’une tapisserie rouge sang de bœuf sur laquelle la vieille a fait accrocher sa collection de bénitiers en faïence en provenance de toute l’Europe et même des Amériques. La pièce, jamais chauffée, sent le moisi et la poussière que les décennies écoulées depuis la mort de l’ancêtre ont accumulée dans les bénitiers. Un lit d’une personne et demie, en bois sombre, trop haut et trop court –on doit y dormir assis– occupe la pièce au-dessous d’un crucifix énorme qui touche la tête de lit et atteint presque le plafond pourtant élevé. C’est là qu’est allongée Luna. Ses lunettes et sa montre sont posées sur la table de nuit, à sa droite.
— Elle est choquée, il faut l’hospitaliser, madame la comtesse, recommande le médecin de famille, accouru au plus vite. Vous devriez toutes les deux quitter les lieux.
Josépha de Bourdon-Buchy a déjà résisté victorieusement aux pompiers. Elle n’a pas voulu laisser la maison dont quelques ardoises ont été soufflées. Elle se redresse, bombe fièrement les deux obus intimidants de sa poitrine et darde vers le médecin un regard de feu, chargé de « bravitude ». Les nerfs lâchent, elle éclate :
— Choquée ? Et moi, donc, je ne suis pas choquée ? J’étais pourtant là aussi quand l’explosion s’est produite ! Et n’ai-je pas été choquée quand Gorgon a fait faillite et s’est suicidé ? Et n’ai-je pas été choquée de mettre au monde dans des douleurs atroces –car vous savez que j’ai le bassin étroit, docteur– une fille alors que toute la famille attendait un garçon ? Et ne suis-je pas tous les jours choquée de l’indifférence, de la malveillance, de la grossièreté et de la vulgarité du monde contemporain ? Est-ce que je quitte le navire, est-ce que j’abandonne ma place dans la vie, est-ce que je déserte ? Choquée ou pas choquée, Luna restera chez nous.
Pour ponctuer la fermeté de sa décision, la comtesse cambre les reins dans une pose piou-piesque, posture conquérante qu’un poilu de 14 n’aurait pas reniée.
Voilà pourquoi sa fille se retrouve dans la chambre rouge, dont le nom même la terrorisait enfant. Le médecin sort. Il connaît la comtesse. Rien à faire, personne ne quittera jamais cette maison.
Luna reprend doucement ses esprits. En face d’elle, se dresse une silhouette masculine immense. Un homme dans sa chambre ! Elle le voit flou. Son handicap visuel exagère sans doute la taille du personnage, cependant il doit être grand et, autant qu’elle peut en juger quand il s’approche d’elle, a des cheveux frisés aux reflets fauves.
— Bonjour, mademoiselle, commandant de police Georges Faidherbe, mais vous pouvez m’appeler commissaire. Vous sentez-vous suffisamment forte pour échanger quelques mots avec moi ?
« Sentez » est bien le mot : vous sentez fort bon, mademoiselle, pense Faidherbe, homme à l’odorat hypersensible. Derrière l’odeur persistante de pétrole imprégnant encore la chevelure de la jeune femme, il perçoit des effluves capiteux de figue qui émanent de son corps.
Malgré l’assourdissement dû à l’explosion, Luna a entendu les paroles qui lui sont parvenues étouffées. La jeune femme ressent un deuxième choc, intérieur cette fois. Après le tonnerre de l’explosion, c’est le coup de foudre auditif. Elle fond pour une voix, un timbre exceptionnel qu’elle a reconnu aux premières notes. Elle entend au pied de son lit la voix idéale. Elle voudrait dire « Oui, avec joie, autant de mots que vous voulez, soufflez-les sur mon corps pour éteindre mes douleurs. » Aucun son ne peut sortir de sa gorge. Elle hoche bêtement la tête. C’est l’amour sans phrase.
Faidherbe s’est assis sur le rebord du lit. Il regarde la jeune femme avec une certaine gêne. Il ne peut pas manquer d’admirer sa chevelure, tresses dénouées, longue, épaisse et brune, ses sourcils marqués, ses yeux noirs, son visage ovale aux joues légèrement rebondies, ses autres rondeurs aussi. Sa mère l’a déshabillée, débarbouillée et fourrée au lit complètement sonné dans une nuisette à elle, trop grande et semi-transparente. Luna est myope mais elle est assez fine pour comprendre le silence qui s’est établi, à peine troublé par la respiration encore essoufflée de l’homme qui a monté l’escalier jusqu’à son lit. Elle rougit et remonte le drap sur elle pour cacher sa poitrine généreuse, pas trop vite cependant.
— Excusez-moi, bafouille le commandant, je ne voulais pas…
Puis, il se reprend, avec une respiration plus régulière :
— Je suis venu vous demander de me raconter ce qui s’est passé.
Il faut commencer en douceur par du déjà connu ; ensuite il compte faire remonter le temps à la jeune femme.
En bas, une ambulance a déjà évacué le conducteur de la pelleteuse. L’ouvrier est vivant. Traumatisme crânien, tympans éclatés, des ecchymoses et des coupures dues aux vitres de la mini pelleteuse Pel Job 22.4 : elles se sont fragmentées sous l’explosion et l’ont criblé. Le bras de l’engin a détourné un éclat de métal qui aurait pu le couper en deux. Un miracle. L’homme a gardé ses deux mains et ses deux pieds. Et l’on sauvera ses yeux.
La police scientifique a déjà ratissé le terrain et emporté l’organe mutilé qui avait atterri sur la porte de chambre de la jeune femme. À l’heure présente, le médecin légiste Foutel a abandonné la réparation des meubles antiques, sa marotte, pour la décortiquer et en tirer le plus d’informations possible.
C’est muet, une main, mais lui saura la faire parler si elle a quelque chose à dire. L’ennuyeux, c’est qu’elle est imbibée de mazout comme une tomate confite d’huile. Il ne faut pas être grand clerc pour deviner qu’elle a baigné longtemps dans la cuve avant de reprendre l’air et voler jusqu’au mur de chambre de Luna, propulsée par l’explosion. Or jamais personne n’a fait de déclaration de perte de main dans la zone que couvre la brigade criminelle du Havre. Personne. Le lieutenant Fésol le jure. Bien qu’il soit catalan, Fésol semble avoir eu pour berceau un tiroir de son bureau du Havre : il est la mémoire de la brigade. Pourtant, le propriétaire de la main est quelque part. Faidherbe est prêt à parier qu’il est aussi en morceaux. Son petit doigt, dont il a perdu une phalange à Étretat2, le lui a dit.
Une voix désarticulée sort de la bouche de Luna :
— La main noire a sauté sur moi…
Luna ne maîtrise plus ni aigus ni graves. Sans savoir précisément ce qui cloche, elle sent bien que sa voix a pris des inflexions dissonantes. Elle se recroqueville sur elle-même, ramenant ses genoux contre sa poitrine.
— Vous étiez en train de chanter ? La fenêtre était ouverte ? Vous chantez toujours la fenêtre ouverte ? demande doucement le policier.
La jeune femme hoche la tête, puis corrige :
— Seulement après la fête de la musique, il fait plus chaud.
— Mais toujours devant la fenêtre ? insiste Faidherbe.
La jeune femme déplie un bras vers la table de nuit, lentement, comme si elle craignait encore de provoquer une catastrophe. Elle se saisit de ses lunettes et les porte à son visage sans cesser de fixer son interlocuteur. Le mazout a déposé une pellicule grasse sur les verres. Sa mère a oublié de les nettoyer. Faidherbe lui apparaît comme à travers des vitraux opaques. Elle réfléchit et quand elle a trouvé ce qu’il attend, elle glisse de sa voix désaccordée :
— Je n’ai jamais vu personne toucher à cette cuve. Je n’y faisais pas spécialement attention, elle a toujours été là. Je croyais même qu’elle était vide et qu’elle ne servait plus.
Soudain, la conscience de ce qui arrive à ses cordes vocales la frappe. Elle se met à sangloter :
— Dites, vous croyez que ma voix reviendra ?
Comme s’il était laryngologiste ! Mais Georges Faidherbe est ému de son désarroi. Il s’approche et lui caresse la joue.
— Bien sûr, quand vous entendrez mieux. C’est une question de jours.
À travers ses lunettes brouillées, elle essaie de jauger ce grand type, de deviner cet homme qui voudrait la consoler et qui ne se rend pas compte qu’elle est en train de tomber sous son charme. En plissant les yeux, elle démasque sa cinquantaine, un début d’estomac. Mince, un vieux.
Elle ne veut pas y croire. La voix est plus jeune. Il doit être plus jeune avec cette voix merveilleuse, mais il ne comprend rien. C’est un imbécile. Un de plus. Elle cache son visage dans ses genoux.
Le commandant recule doucement et quitte la pièce. Il y a l’enquête et tant à faire. Pourtant il est troublé. Il se dégageait de la jeune femme autre chose qu’une odeur de fioul, un parfum puissant qui l’a frappé au cœur. C’est l’inconvénient quand on a beaucoup de flair, on devient trop sensible.