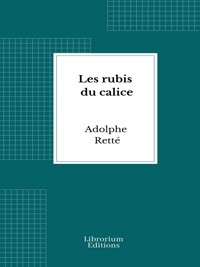1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Dans un temps aussi troublé que le nôtre, les principes de la Révolution, la démocratie, le régime parlementaire, — qui ne valurent jamais grand’chose — se prouvent tout à fait impuissants à vivifier la France après l’effroyable saignée qu’elle vient de subir.
C’est donc un devoir, pour quiconque aime son pays, de le servir en lui montrant, selon des expériences personnelles, les causes des maux dont il souffre et les remèdes propres à le guérir.
J’essaie de contribuer à ce labeur patriotique dans les pages suivantes. On y trouvera le témoignage d’un homme, âgé aujourd’hui de soixante ans, qui, jusqu’à la quarantaine, connut les pires aberrations de l’individualisme aussi bien sur le plan philosophique et social que dans le domaine de la littérature. Sa formation romantique, l’esprit de révolte qui s’ensuivit l’obligèrent de les appliquer tant que la grâce de Dieu ne l’eut pas amené à l’Église.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
ADOLPHE RETTÉ
LA MAISON EN ORDRE
COMMENT UN RÉVOLUTIONNAIRE DEVINT ROYALISTE
© 2024 Librorium Editions
ISBN : 9782385746018
LA MAISON EN ORDRE
PRÉFACE
CHAPITRE PREMIER IMPRESSIONS D’ENFANCE
CHAPITRE II LA GUERRE DE 1870
CHAPITRE III AU COLLÈGE
CHAPITRE IV TEMPS PERDU
CHAPITRE V AU RÉGIMENT
CHAPITRE VI LE SYMBOLISME
CHAPITRE VII L’ANARCHIE
CHAPITRE VIII CHEZ CLEMENCEAU
CHAPITRE IX LE SILLON
CHAPITRE X LES LIBÉRAUX
CHAPITRE XI CHARLES MAURRAS
CHAPITRE XII DIEU ET LE ROI
AAUGUSTE SIDEL ALSACIENDÉPORTÉ PAR LES ALLEMANDS EN SILÉSIE DE 1915 A 1918
PRÉFACE
Au milieu des factions de toute espèce, nous n’appartenons qu’à l’Église et à la Patrie.
Louis VEUILLOT.
Dans un temps aussi troublé que le nôtre, les principes de la Révolution, la démocratie, le régime parlementaire, — qui ne valurent jamais grand’chose — se prouvent tout à fait impuissants à vivifier la France après l’effroyable saignée qu’elle vient de subir.
C’est donc un devoir, pour quiconque aime son pays, de le servir en lui montrant, selon des expériences personnelles, les causes des maux dont il souffre et les remèdes propres à le guérir.
J’essaie de contribuer à ce labeur patriotique dans les pages suivantes. On y trouvera le témoignage d’un homme, âgé aujourd’hui de soixante ans, qui, jusqu’à la quarantaine, connut les pires aberrations de l’individualisme aussi bien sur le plan philosophique et social que dans le domaine de la littérature. Sa formation romantique, l’esprit de révolte qui s’ensuivit l’obligèrent de les appliquer tant que la grâce de Dieu ne l’eut pas amené à l’Église.
Je l’ai dit ailleurs : « Une conversion, c’est une rentrée dans l’ordre. » Et, c’est, en effet, par la Vérité catholique que j’ai acquis le sens de la règle, de la discipline, de la hiérarchie et le goût de la stabilité dans la tradition. Ensuite, ayant beaucoup souffert et beaucoup vu, ayant peut-être passablement retenu, j’ai compris que notre patrie ne pouvait redevenir forte et prospère que par un régime qui prendrait le contre-pied de la doctrine et des institutions dont nous sommes affligés depuis 1789.
Ce régime, c’est la monarchie.
Comme on le verra plus loin, je conçus les bienfaits de la monarchie, j’admis sa nécessité, d’abord par désillusion. Observant les partis en leurs querelles pour s’assurer les faveurs de la femme sans tête qui a nom République, je fus dégoûté par la bassesse de leurs ambitions et l’ignominie de leurs convoitises. Je saisis combien il était absurde que les intérêts les plus essentiels de la France dépendissent des fluctuations d’assemblées soi-disant représentatives où pullulaient les illettrés et les incapables, où dominaient quelques intrigants, captifs eux-mêmes de financiers louches. Je constatai l’évidence, c’est-à-dire que les changements perpétuels de ministères empêchaient toute continuité dans les desseins et dans les actes. Je vis la discorde entretenue dans les provinces par les politiciens subalternes qui mènent aux fondrières cet aveugle : le suffrage universel. Je vis enfin d’honnêtes gens, pleins de bonne volonté, voués à l’impuissance, malgré leurs efforts, parce qu’ils ne réussissaient pas à se libérer de l’erreur démocratique. Et je conclus que si une réaction salutaire ne ramenait pas le Roi pour rétablir l’ordre dans la maison, nous pourrions peut-être bientôt écrire en pleurant sur la porte : Finis Galliae ! Que Dieu détourne le présage !… Arrivé à ce point, il y a une douzaine d’années, je m’informai des doctrines de l’Action française. Je lus surtout Maurras, non plus en dilettante, comme naguère, mais afin de vérifier, par les faits, si le régime qu’il proposait pour le salut de la France était conforme à la vérité politique. La réponse fut totalement affirmative.
C’est le récit de mon évolution que l’on va lire. On m’excusera si j’ai donné à cet essai la forme de mémoires. Elle m’a paru la moins aride et la plus capable de persuader le lecteur. Je l’avais déjà employée lorsque j’écrivis Du diable à Dieu, où j’ai rapporté comment j’avais été conduit de l’ignorance religieuse à la foi. L’indulgence avec laquelle fut accueilli ce petit livre m’a décidé à user d’une forme à peu près analogue pour exposer comment je fus amené de la frénésie révolutionnaire à l’indifférence politique, puis à la doctrine royaliste.
Est-il besoin d’ajouter que je n’ai été déterminé, en entreprenant ce travail, par aucune ambition autre que celle de servir la France dans la mesure de mes moyens ? Depuis des années, je vis à l’écart, soit au cœur de la forêt, soit dans des monastères, soit au village. Je ne veux rien être. Je ne fréquente ni les milieux politiques ni les cénacles littéraires, ni les salons — non par dédain, certes, mais par un penchant inné à la solitude et au silence. Il se peut que cette habitude de vie présente quelques inconvénients. Mais elle possède un grand avantage : elle me permet de juger les vicissitudes de la politique avec un entier détachement.
Au surplus, j’aime à travailler dans mon petit coin pour le public, composé de catholiques fervents, chérissant la France parce que catholiques, qui veut bien me suivre depuis 1906.
Je leur offre donc ce livre qui, vu la maladie chronique et sans cesse aggravée dont je souffre, en me soumettant à la volonté de Dieu, sera peut-être le dernier que j’écrirai. Je souhaite de leur faire partager ma conviction, qui se résume en ceci : ayant contracté un mariage d’amour avec l’Église et un mariage de raison avec la Monarchie, j’estime que cette bigamie louable est nécessaire à tous ceux qui prient, pâtissent et combattent pour le salut de notre France bien-aimée, royaume de Marie par le vœu de Louis XIII et Fille aînée du Saint-Siège par la miséricorde de la Providence.
CHAPITRE PREMIER IMPRESSIONS D’ENFANCE
C’est en 1869. J’ai six ans, et je me prélasse en un petit fauteuil à bras, dans un cabinet de travail tout tapissé de livres depuis le plancher jusqu’au plafond. Assis à son bureau qu’encombrent des dossiers et des brochures, mon grand-père penche sa tête aux cheveux argentés sur un manuscrit du Moyen Age qu’il scrute avec une loupe et dont l’aspect fripé, les teintes jaunâtres et l’odeur rance me causent une sorte de répulsion. Une lampe à huile nous éclaire. Parfois elle charbonne et fait entendre par des bruits singuliers qu’elle a besoin qu’on la remonte.
Mon grand-père est un érudit dont l’ex-libris porte cette phrase de Montaigne : « Les historiens sont le vrai gibier de mon étude. »
Sur mes genoux je tiens un volume in-8o, dont la reliure en maroquin rouge est si fanée qu’elle a pris la nuance de la gelée de groseilles. C’est l’Histoire de Napoléon, publiée par le baron de Norvins en 1827 et illustrée par Raffet.
Ce Norvins avait rempli diverses fonctions administratives sous l’Empire. Mis à la retraite par le gouvernement de la Restauration, plein de rancune et enthousiaste de l’Empereur, il ne montrait aucun esprit critique. Son histoire, c’était une apologie à outrance de son héros et une espèce de pamphlet plein d’allusions malveillantes aux Bourbons. Cela, je l’ai constaté plus tard ; mais alors je ne puis m’en rendre compte et je m’enivre de cette lecture comme d’un vin capiteux qui m’emplit la tête de fanfares, de canonnades et d’un cliquetis d’armes entrechoquées.
Un silence studieux règne sur nous, rendu plus sensible par les crépitements du feu de coke qui s’effrite dans la cheminée, par le grignotis de la plume lorsque mon grand-père prend une note et par les houlements plaintifs du vent d’hiver qui jette des poignées de grésil contre les volets bien clos.
Comme il y a plusieurs soirs que je lis Norvins, j’en suis à la campagne de Marengo. Elle me conquiert, mais, en même temps que je la dévore, je revois Toulon, Rivoli, les Pyramides, Brumaire. Toute cette épopée me possède au point qu’il m’est impossible de continuer à suivre le texte. Le front brûlant, les yeux dans le vague, je vois flotter devant moi de grandes images — mille fois plus belles que les dessins de Raffet. La figure de Napoléon s’en détache comme un soleil parmi des nuages empourprés. Il me semble que son regard fulgurant me prédit un avenir de gloire belliqueuse. Je crois entendre sa voix brève me dicter des plans de batailles…
Cette hallucination me tient si fort que quand ma bonne grand’mère entre dans la chambre pour nous demander si nous oublions qu’il est l’heure du souper, je reste immobile, sans l’entendre, tant j’ai perdu le sentiment des choses extérieures.
Mon grand-père repousse son fauteuil, se lève et, me voyant tout rouge, les paupières papillotantes, m’interroge :
— Est-ce que tu dormais, mon petit ?
— Oh non, grand-papa, je voyais Napoléon !
Ma grand’mère s’inquiète :
— Tu as tort, dit-elle à son mari, de laisser cet enfant lire si longtemps près du feu…
Mais grand-père ne l’écoute pas. Pensif, il m’examine puis pose sa main sur ma tête :
— Il n’est pas malade, dit-il, mais il a de l’imagination. Ce n’est pas la première fois que je remarque combien cette lecture le passionne… Après tout, j’aime mieux qu’il s’enflamme pour Bonaparte que pour des contes de fées. Qu’il apprenne l’histoire. Quand il sera plus grand, nous verrons à rectifier les notions plus ou moins exactes que Norvins lui inculque en ce moment…
Nous passons dans la salle à manger. D’habitude je jase volontiers pendant les repas et mon babil amuse mes grands-parents. Mais, ce soir-là, je mange mon œuf à la coque comme en rêve et je demeure silencieux.
— Décidément, tu tombes de sommeil, dit ma grand’mère, je vais te mettre au lit tout de suite après souper.
Je ne proteste pas. Je n’ai nullement envie de dormir, mais je me dis que dans la solitude de ma petite chambre je pourrai repasser à loisir les événements prodigieux dont je viens de lire le récit sans être dérangé par personne, pas même par ces excellents vieillards que j’aime de tout mon cœur. Et qui sait, peut-être que je reverrai Napoléon dans un songe !… Disons tout de suite que mon grand-père, — nullement bonapartiste — ne rectifia rien des notions fournies par Norvins. D’abord ses travaux l’absorbaient beaucoup. Puis il estimait superflu de me fatiguer l’esprit par des considérations de politique abstraite auxquelles, selon toute vraisemblance, lui-même croyait peu. Enfin, comme pas mal d’hommes de sa génération, il s’était imbu des idées de Rousseau et il avait coutume de dire : — Laissons les enfants se développer selon leur nature.
C’est d’après un principe analogue qu’il me permettait de butiner, à tort et à travers, dans sa bibliothèque. Méthode d’éducation périlleuse et contre laquelle, à mon détriment, toute l’affection qu’il me portait ne sut pas le mettre en garde.
Autant que je puis me le représenter maintenant, en philosophie il professait le scepticisme. La politique lui apparaissait comme une arène nauséabonde où révolutionnaires et conservateurs échangeaient de burlesques gourmades pour le triomphe de la sottise humaine. Sur toutes choses, il émettait des jugements où l’ironie se tempérait d’une certaine pitié. Car il était bon, charitable aux malheureux et déplorait seulement que ses contemporains n’eussent pas découvert, dans la loi naturelle, une doctrine qui les fît vivre en paix les uns avec les autres. Si quelque politicien de sa connaissance l’adjurait de prendre parti, c’était avec le plus goguenard des sourires qu’il répondait, en mémoire de Candide : — Je cultive mon jardin.
Rien de plus exact. — Car s’il prenait de l’intérêt à déchiffrer les palimpsestes et à cataloguer les incunables, il se plaisait encore davantage à biner une planche de carottes, arroser ses salades et greffer des roses sur les églantiers dont il plantait ses parterres.
Il n’aurait pas fait de mal à une mouche. Je ne lui ai connu que deux haines : contre le socialisme et contre l’Église. Je me rappelle ses invectives quand on parlait devant lui de l’Internationale alors à ses débuts. Quant à l’Église, on eût dit qu’il nourrissait à son égard des motifs de rancune personnels. Il ne cessait de bafouer le clergé que pour railler les dogmes. Aussi multiplia-t-il les précautions pour que je ne reçusse aucun enseignement religieux.
En ce temps lointain, un jour par semaine, le curé venait faire à l’école un cours de catéchisme et l’on récitait un Pater et un Ave au commencement et à la fin de chaque classe. Mais l’aversion de mon grand-père pour le catholicisme allait si loin que, lorsqu’il me conduisit pour la première fois au pédagogue, il stipula, de la façon la plus formelle, que je n’assisterais pas aux prières et que je n’aurais aucun contact avec le prêtre.
Ma grand’mère était pieuse et pratiquait régulièrement. Or, il n’entravait point ses dévotions, tolérait un crucifix au mur de leur chambre à coucher, acceptait qu’elle servît du maigre le vendredi et s’abstenait même de blasphémer en sa présence. Elle aurait bien voulu m’emmener à la messe le dimanche. Mais, sur ce point, il se montra irréductible. Non seulement il exigea d’elle la promesse de ne me faire assister à aucune cérémonie du culte, mais encore il lui interdit de me parler de Dieu.
Ma grand’mère obéissait en soupirant. Toutefois, je me souviens que, le soir et le matin, avant de me border dans mon lit ou de présider à mes ablutions, elle traçait à la dérobée un signe de croix sur mon front et sur ma poitrine. Ce geste m’intriguait. Il m’arriva de lui demander ce qu’il signifiait.
Elle me répondit : — Tu l’apprendras quand tu seras grand…
Et comme j’insistais, elle se contenta d’ajouter : — Cela te portera bonheur.
C’est trente-six ans plus tard que ce signe m’a, en effet, porté bonheur…
Je me suis souvent demandé si, féru de Rousseau et, je crois, en particulier, de ce recueil de balivernes emphatiques : l’Émile, mon grand-père, m’appliquant son système de « bride sur le cou » aggravé d’ignorance religieuse, ne voulait pas tenter une expérience. En tout cas, il ne put la mener à terminaison, car il mourut en 1872, après avoir, à maintes reprises, formulé sa volonté que ses obsèques fussent civiles. Ce qu’il confirma par son testament. Elles eurent donc lieu au grand chagrin de ma pauvre grand’mère et au scandale du village dont la majeure partie pratiquait. N’oubliez pas qu’à cette époque un enterrement sans Dieu était chose fort rare et considérée par presque tout le monde comme une monstruosité. Il n’y avait guère que quelques disciples de Proudhon pour se livrer à des manifestations de cet acabit. Si l’on avait fait remarquer à mon grand-père qu’il imitait ainsi ceux qu’il tenait pour de dangereux utopistes, il eût probablement essayé de se justifier par des distinguo non moins subtils que les ergoteries de certains scolastiques. Et pourtant, quel illogisme chez cet homme d’une évidente bonne foi, mais qui prétendait maintenir debout l’édifice social en lui retirant son appui le plus indispensable : la religion ! Il possédait une vaste intelligence ; malheureusement, comme à beaucoup de savants du XIXe siècle, les préjugés anticléricaux lui bouchaient l’horizon spirituel.
C’est à la campagne, où nous vivions les trois quarts de l’année, que je fus élevé de la sorte. J’étais un enfant rêveur, très impressionnable, avide de lectures, et déjà si amoureux de la solitude qu’en dehors des heures de classe je fuyais mes camarades de l’école. Cela, non par sotte vanité, mais parce que l’obligation d’échanger des propos quelconques avec autrui m’était souvent pénible. Je préférais contempler, loin de tous, les images féeriques dont se peuplait avec surabondance mon univers intérieur et me forger des aventures merveilleuses où la réalité morose n’avait aucune part. Il me semble que telle est restée la dominante de mon caractère. Aujourd’hui que l’âge me mène par le sentier qui décline vers la tombe, je récapitule les phases très diverses d’une existence qui, contre mon gré, fut parfois si mêlée aux agitations humaines. Et je m’aperçois que mes jours les plus heureux, je les ai vécus auprès de bûcherons taciturnes, dans un village ignoré, à la lisière de la forêt de Fontainebleau ou chez des moines cisterciens voués au silence perpétuel.
Dès le temps de mon enfance, je souffrais lorsqu’il me fallait aller à la ville. Le cœur serré, j’y respirais mal. J’avais envie de faire la grimace à tous les passants et de tirer la langue aux statues ridicules des carrefours. Je haïssais le tumulte des voitures, les pavés grisâtres, les hautes maisons à façade revêche, l’atmosphère enfumée. Au retour, dans le calme de notre campagne, comme je me dilatais à l’aise !
Le domaine n’était pas très étendu, mais d’aspect très varié. Il s’adossait à une colline toute chevelue de taillis serrés où les chênes rugueux alternaient avec mes frères de prédilection : les bouleaux, toujours frémissants, et dont le feuillage chuchote, pour ceux qui savent les entendre, d’incomparables poèmes. Au commencement de juin, pour la joie de mes yeux, les genêts couvraient le sous-bois d’une royale toison d’or.
Il y avait un potager dont les choux bien alignés, les bordures de thym odorant et les ruches bruissantes d’abeilles me ravissaient. Il y avait une sapinaie pleine d’ombres mystérieuses où le vent imitait tour à tour le murmure des vagues marines et le chant grave de l’orgue. Il y avait un verger, à l’herbe drue, semé tantôt de marguerites, tantôt de scabieuses. De vieux pommiers trapus y portaient des barbes de lichen et de mousses. Longeant la propriété d’un bout à l’autre, une rivière, qui était mon amie la plus intime. Je passais de longues heures sur le bord à mirer les papillotis de la lumière et le reflet vagabond des nuages sur les ondes couleur d’ardoise bleutée et d’émeraude. Ah ! celui qui n’aime pas à regarder indéfiniment l’eau qui coule et à y faire cingler vers des régions fabuleuses les escadrilles de ses rêves ne connaîtra jamais une des plus grandes joies que la vie puisse nous offrir.
Enfin il y avait, devant la maison, une profusion de rosiers, greffés, comme je l’ai dit, par mon grand-père, et des roses de toute espèce et de toutes nuances, depuis le blanc safrané jusqu’au rouge-ponceau, presque noir — des roses, des roses, partout des roses dont je respirais avec volupté les parfums, dont j’admirais éperdument les teintes. Là aussi, en cette campagne si douce, j’ai connu le bonheur. Je me trouvais tellement bien, près de mes grands-parents, que, pénétrée de leur chaude tendresse, mon âme s’épanouissait comme un glaïeul au soleil.
Lorsque je m’étais concentré des journées entières sur moi-même, parmi les fleurs et les arbres, j’éprouvais, par foucades, un besoin irrésistible d’épancher au dehors les lyrismes exubérants qui me mettaient l’esprit en fête. Alors je narrais aux bons vieux, avec un violent coloris d’expression et avec mille détails imprévus, les histoires délicieusement chimériques que j’avais inventées et dont j’alimentais mon imagination sans aboutir à la satiété.
— Où va-t-il chercher tout ce qu’il raconte ? s’écriait ma grand’mère ébahie et charmée.
Et mon grand-père, riant sous cape, prophétisait : — Si celui-là ne devient pas un poète, je veux moi-même devenir… tout ce qu’on voudra !
On devine quel brandon la légende de l’Empereur vint ajouter à ce foyer imaginatif déjà si effervescent. A la lettre, j’idolâtrais Napoléon et je rendais une sorte de culte à une gravure d’après David, suspendue à l’un des murs du salon et qui le représentait, rigide et fier sur un cheval cabré, indiquant d’un geste impérieux le sommet du mont Saint-Bernard. Cette image théâtrale me comblait d’admiration.
Bientôt, à la lecture assidue de Norvins, je joignis celle d’une publication en je ne sais combien de volumes intitulée : Victoires et Conquêtes des Français. Alors je ne rêvai plus que batailles. Dès que, revenu de l’école, j’avais bâclé mes devoirs à la va-vite, je m’élançais dehors pour y reproduire les luttes épiques dont, servi par une mémoire extraordinaire, j’avais retenu toutes les péripéties.
Armé d’une latte, en guise de sabre, je lâchais dans le verger les volailles de la basse-cour. Elles me représentaient les Prussiens à Iéna, les Russes à Friedland, les Espagnols à Somo-Sierra. Coqs, poules, dindons, canards, je les pourchassais sans pitié, je les traquais dans les buissons où elles cherchaient un refuge. A leurs caquets, à leurs gloussements éperdus, à leurs coins-coins désespérés je répondais par le cri de : « Vive l’Empereur ! » Et je ne cessais de les affoler que quand, hors d’haleine, je me laissais tomber dans l’herbe pour y apaiser les battements désordonnés de mon cœur.
Or, des pattes démises et des ailes cassées résultèrent de ces glorieux combats. Des poussins tombés à l’eau s’y noyèrent. La servante chargée du poulailler se plaignit hautement. Ma grand’mère, malgré son penchant à excuser mes incartades, trouva que, cette fois, j’allais un peu loin. On soumit le cas à mon grand-père. Je lui expliquai que, malmenant la volaille, je faisais la conquête de l’Europe à la suite de l’Empereur. Il rit beaucoup. Cependant il m’interdit de poursuivre mes exploits.
J’obéis à regret et, pour donner une autre issue à mon humeur guerrière, je m’attaquai à une chèvre qu’on laissait paître en liberté dans tout le domaine. Une phrase de Victoires et Conquêtes m’excitait d’une façon prodigieuse. Je me la rappelle comme si je l’avais lue hier ; la voici : « Nos bataillons attaquèrent vigoureusement et culbutèrent les Autrichiens. »
Du coup, je vis les vaincus de Ratisbonne et de Wagram s’écrouler, cul par-dessus tête, sous le choc de nos baïonnettes. Et aussitôt je prétendis faire subir à la chèvre un sort identique. Mais la maligne bête était d’un caractère beaucoup moins endurant que mes victimes habituelles. Elle me laissa foncer, se déroba au moment où j’allais l’atteindre puis, revenant sur moi et, me chargeant à son tour, d’un solide coup de tête, elle m’envoya rouler dans un fossé plein d’orties qui me piquèrent outrageusement. Je me relevai, couvert d’ampoules cuisantes et je criai à la chèvre : « Tu n’es qu’un sale Kaiserlik !… » Ce qui était, à mon sens, la suprême injure. Toutefois j’avais appris que je n’étais pas invincible et, par la suite, je me gardai de renouveler mon attaque.
Lorsque le mauvais temps m’empêchait de sortir, je recommençais nos batailles avec des soldats de plomb. J’en possédais une quantité, car mes grands-parents qui me gâtaient comme je l’ai dit et qui encourageaient mon goût pour les jeux de Bellone, m’en donnaient des boîtes à toute occasion : étrennes, anniversaires, etc.
Mes lectures m’ancrèrent dans cette conviction que l’Empereur était infaillible, qu’il ne pouvait jamais avoir tort. Toute opposition à ses volontés me semblait un sacrilège. Je considérais ses adversaires comme d’ineptes croquants dont la résistance devait être punie par de formidables raclées. Aussi, quand j’en fus aux revers : la retraite de Russie, Leipsick, la première abdication, je tombai dans une désolation indicible. Quoique je n’eusse encore rien lu de Victor Hugo, comme lui « j’accusais le destin de lèse-majesté ». Autour de mon dieu, je ne distinguais plus que des traîtres et des lâches. Le retour de l’île d’Elbe me rendit quelque allégresse. Frémissant d’enthousiasme, je hurlai par les corridors cette phrase de la proclamation impériale : « L’aigle a volé de clocher en clocher jusqu’aux tours de Notre-Dame ! » Mais Waterloo me précipita de nouveau dans le désespoir. Je ne voulais pas que la bataille eût été perdue. Je lisais et relisais les pages funèbres avec le désir enragé que « l’infâme » Grouchy vînt quand même à la rescousse et que la Garde mît Blücher et Wellington en compote. Je vous certifie que j’ai pleuré quand Napoléon abdiqua pour la seconde fois. Ah ! si j’avais tenu Fouché, Lafayette et les pleutres du gouvernement provisoire, quelle bastonnade, mes amis !
L’exil à Sainte-Hélène me navra. Je haïssais les Anglais d’une haine irréductible. Je barbouillai d’encre l’effigie d’Hudson Lowe qui, à mon avis, déshonorait le volume où l’agonie de Napoléon était rapportée. Et pour atténuer mon deuil, je relus passionnément la campagne d’Austerlitz…
Si je récapitule, dans l’ensemble, ces premiers souvenirs, il m’apparaît que mon enfance annonce nettement ce que je devais être jusqu’au jour où la Grâce divine me conduisit à la foi catholique et l’expérience de la vie au royalisme. Travaillé, sans doute, d’hérédités rebelles à la règle, poussé comme une plante sauvage, à peu près sans contrôle, dénué de principes religieux, doué d’une imagination exubérante qui se portait aux aventures, à la poésie et au romantisme, surestimant, d’après l’histoire de Napoléon, la force sans contre-poids, ni entraves, me développant à une époque de mœurs plates, de démocratie pourrissante et de parlementarisme infécond — tout conspirait à ce que je devinsse un révolté.
Et c’est, en effet, ce qui arriva.
CHAPITRE II LA GUERRE DE 1870
Au mois de juillet 1870, la guerre éclata entre la France et l’Allemagne. Dès le commencement d’août, ma mère, qui habitait Paris avec mes deux sœurs, me réclama auprès d’elle et, prise de peur, nous emmena en Belgique. Elle s’installa, en une sorte de campement, à Liège où nous avions de la parenté.
Mon père, précepteur des fils du grand-duc Constantin, vivait à Saint-Pétersbourg depuis plusieurs années et ne venait nous voir que très rarement. C’est qu’hélas, la discorde régnait à notre foyer ; chacune de ses visites se marquait par des scènes pénibles où se froissaient deux caractères nullement faits l’un pour l’autre. Cette mésentente eut les conséquences les plus graves sur mon avenir. Je n’en parlerai cependant que le moins possible. Il y a là une cicatrice douloureuse que je préfère ne pas rouvrir. Paix aux morts…
Cependant, malgré ces dissensions, mon père estima qu’il était de son devoir de rejoindre les siens en détresse. Il obtint un congé, s’embarqua sur un vaisseau russe qui le conduisit à Anvers et fut à Liège environ une dizaine de jours avant le désastre de Sedan. J’avais quatre ans lorsque je l’avais vu pour la dernière fois. C’est dire que je ne gardais de lui qu’un souvenir fort confus ; mais, comme je n’en avais guère entendu parler qu’avec amertume, je redoutais son abord. Aussi fus-je agréablement surpris lorsque j’eus découvert que c’était un homme très franc, très expansif — sauf avec ma mère — et qui nous aimait beaucoup mes sœurs et moi. Je me sentais tout à fait en confiance auprès de lui. Lui-même ne pouvait pas se passer de moi. Ayant été nommé d’un comité de secours aux réfugiés besogneux, il me prenait toujours avec lui pour les courses et démarches que nécessitait sa mission charitable. Tout en cheminant, la main dans la main, nous causions et je constatai que mon culte pour Napoléon comme ma connaissance précoce de l’histoire du Premier Empire ne semblaient pas lui déplaire. C’est qu’il était très bonapartiste. Je me rappelle encore les invectives dont, après le 4 septembre, il chargea l’équipe d’avocassiers et de pamphlétaires républicains qui se jeta sur le pouvoir comme une bande de marcassins amaigris par de longs jeûnes sur un champ de pommes de terre connu pour son rapport fructueux. Ensuite, la dictature de Gambetta en province — nous ne savions presque rien de Paris assiégé — lui apparut ce qu’elle était réellement : le règne d’un braillard, aux relations fort suspectes, et qui, flanqué d’ambitieux subalternes et de bohèmes noceurs, ne réussit qu’à organiser l’écrasement final de la France par les Teutons. Cent fois, je l’ai entendu prédire que l’incapacité de ce gouvernement hasardeux, issu d’une émeute devant l’ennemi, amènerait fatalement notre défaite et la guerre civile. On voit qu’il ne manquait pas de perspicacité.
Assurément, j’étais encore trop jeune pour juger, au point de vue de la politique, les événements dont nous subissions le contre-coup. Néanmoins, je possédais déjà un certain don d’observation qui ne demandait qu’à s’exercer. C’est pourquoi quelques faits, très significatifs quant à l’état des esprits, me frappèrent d’une façon toute spéciale.
Par exemple, l’attitude des Belges à notre égard m’intriguait. Certes, ils traitaient ceux de nos soldats internés chez eux avec humanité et donnaient volontiers des soins aux malades. Pour nous autres réfugiés, ils nous accueillaient sans beaucoup d’empressement et nous témoignaient même de la froideur. Quand on apprenait les défaites réitérées de notre patrie, ils ne manifestaient point d’allégresse — du moins en notre présence — mais on sentait qu’elles ne leur étaient pas désagréables. A Liège, mes parents avaient loué le premier et le second étage d’une petite maison sise derrière le Jardin Botanique. Le propriétaire occupait le rez-de-chaussée. Souvent le soir, il montait les journaux à mon père. En les lui remettant, il lui servait invariablement cette phrase : « Eh bien monsieur, les Français sont de nouveau battus, savez-vous ?… » Puis il s’efforçait de prendre un air compatissant ; mais, à son intonation, il était facile de deviner que les victoires allemandes l’attristaient beaucoup moins qu’il n’eût voulu le faire croire. Mon père restant impassible, il attendait quelques secondes comme s’il avait désiré entamer une controverse. Voyant que rien ne venait, il se décidait à sortir de la chambre en murmurant : « C’est fâcheux !… »
Jamais il n’obtint un mot de réponse. Moi qui le guettais, il m’arriva de le suivre en tapinois sur le palier. Je voyais alors sa physionomie se transformer avec une rapidité surprenante. Elle exprimait toute autre chose que de la sympathie. Sans doute que le silence gardé par mon père le vexait passablement, car une fois, je l’entendis grommeler : « — Ces Fransquillons, on les rosse et ils font encore les fiers !… Tout de même ils sont bien rossés !… » Et il descendit l’escalier en se frottant les mains et en affichant une mine de jubilation qui m’indigna.
— Il a donc deux visages ? me dis-je. Si nos revers lui causent tant de joie, pourquoi fait-il semblant de nous plaindre ?
A sept ans on ne connaît pas la comédie humaine ; j’ignorais donc que, comme l’a dit un philosophe désabusé, — peut-être Chamfort — « la parole a été donnée à l’homme pour dissimuler sa pensée ».
Blessé dans ma droiture, je rapportai à mon père ce que je venais de voir et d’entendre. Il haussa les épaules puis, étant fort lettré, il me cita ce distique d’Ovide :
Donec eris felix, multos numerabis amicos,
Tempora si fuerint nubila, solus eris.
— Sais-tu ce que cela veut dire ?
N’ayant pas commencé le latin, je secouai négativement la tête.
— Eh bien ! cela signifie : « Tant que tu seras heureux, tu compteras beaucoup d’amis. Si le temps se gâte, tu seras seul. »
Il était bien vrai que l’Europe qui, la veille, nous faisait fête, nous tourna le dos à l’exemple de la Fortune en 70. Nul ne sembla pressentir la menace pour toutes les nations qu’impliquaient les succès de l’Allemagne sous l’hégémonie prussienne. Mais, qu’on s’en souvienne, à cette époque, l’incorrigible rêveur, imbu d’humanitairerie et de romantisme sentimental que fut Napoléon III, dirigeait la politique étrangère de la France d’une façon si incohérente que tout le monde se méfiait de lui. Sa diplomatie, nébuleuse au possible, pleine de contradictions, tantôt hésitante, tantôt tracassière, dénuée de traditions et totalement inapte à saisir le Réel sous les apparences, nous avait aliéné les puissances comme les petits peuples. De là, notre isolement.
Que Bismarck avait vu clair lorsqu’il lança cette boutade : « Napoléon III ? Une grande incapacité méconnue ! »
Et comme elle s’était révélée, cette incapacité, avant et après Sadowa ! Qu’on veuille bien se remémorer les faits. L’Autriche par terre, la Prusse triomphante, maîtresse de la Confédération germanique, Napoléon III avait laissé entendre qu’il nous fallait quelque compensation pour l’unité allemande réalisée. Naïvement, il fit valoir son inertie pendant la campagne de Bohême. Bismarck, prodige d’astuce, équivoqua tant que la déconfiture de l’Autriche ne fut pas certaine. Dès qu’il tint la victoire, il se montra irréductible. Napoléon III demandait Mayence. Il lui déclara nettement que cette cession était impossible parce que l’Allemagne unifiée n’admettrait pas qu’on lui enlevât la plus petite parcelle de son territoire — fût-ce à l’amiable. L’empereur n’insista pas. Mais, talonné par l’opinion, il suggéra qu’il se contenterait de Luxembourg. Le roi de Hollande consentait à l’annexion et il semble que les Luxembourgeois ne s’y montraient pas très opposés. Bismarck, alors, déchaîna sa presse qui poussa les hauts cris, dénonçant à l’Europe les convoitises françaises et déclarant que Luxembourg qui, en ces temps-là, faisait partie de la Confédération, ne pouvait en être détaché sous aucun prétexte. Les rapports entre la France et l’Allemagne s’aigrirent de plus en plus et un conflit faillit éclater dès 1867. Grâce à l’intervention de l’Angleterre, les choses s’étaient arrangées tant bien que mal.