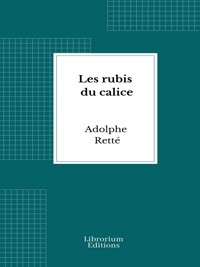1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Quelques années avant la guerre, au milieu de septembre, je fis une excursion en auto avec un ami âgé de trente-cinq ans environ. Je l’avais rencontré à l’hôtellerie d’une communauté de Bénédictins exilée en Belgique depuis l’époque où l’athéisme officiel baptisa défense laïque une crise de rage antireligieuse.
Aux offices, nous nous trouvions côte à côte ainsi qu’au réfectoire. Comme nous étions les seuls retraitants, il arriva que, pendant les récréations nous échangeâmes des propos qui me prouvèrent qu’il possédait une forte culture littéraire. D’ailleurs il gardait toujours, sous son bras ou dans la poche de son veston, un exemplaire de la Divine Comédie. Je remarquai que ce poème constituait sa lecture unique à l’exclusion de tout livre de piété. Il le feuilletait à la chapelle où il me parut qu’il ne priait pas. Il l’annotait dans sa cellule tandis que le missel dont le Père hôtelier l’avait muni, comme moi, demeurait immuablement fermé.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
ADOLPHE RETTÉ
LETTRES A UN INDIFFÉRENT
© 2024 Librorium Editions
ISBN : 9782385746025
LETTRES A UN INDIFFÉRENT
LETTRE I LA PRIVATION DE DIEU
LETTRE II D’APRÈS L’IMITATION
LETTRE IV LA CONFESSION
LETTRE V UNE AME DU PURGATOIRE
LETTRE VI LA VIERGE AU JARDIN
LETTRE VII LE PRINCE DE L’USURE
LETTRE VIII UNE DAME MÉTALLIQUE
LETTRE IX[11] LECTURES (poésie).
LETTRE X LECTURES (prose).
LETTRE XII BEATA SOLITUDO
A GASTON RAISQUI N’EST PAS UN INDIFFÉRENT
PRÉFACE
Quelques années avant la guerre, au milieu de septembre, je fis une excursion en auto avec un ami âgé de trente-cinq ans environ. Je l’avais rencontré à l’hôtellerie d’une communauté de Bénédictins exilée en Belgique depuis l’époque où l’athéisme officiel baptisa défense laïque une crise de rage antireligieuse.
Aux offices, nous nous trouvions côte à côte ainsi qu’au réfectoire. Comme nous étions les seuls retraitants, il arriva que, pendant les récréations nous échangeâmes des propos qui me prouvèrent qu’il possédait une forte culture littéraire. D’ailleurs il gardait toujours, sous son bras ou dans la poche de son veston, un exemplaire de la Divine Comédie. Je remarquai que ce poème constituait sa lecture unique à l’exclusion de tout livre de piété. Il le feuilletait à la chapelle où il me parut qu’il ne priait pas. Il l’annotait dans sa cellule tandis que le missel dont le Père hôtelier l’avait muni, comme moi, demeurait immuablement fermé.
Nous n’étions pas encore assez liés pour que je lui demandasse le motif d’une préférence aussi exclusive. Au surplus, très courtois mais distant, il se livrait peu. Il parlait assez volontiers de Dante pour louer la splendeur farouche ou la suavité insinuante des images dont le grand Florentin illustra ses vers ; il analysait, de façon perspicace, son symbolisme. Si l’entretien amenait le nom de quelque auteur contemporain, les jugements qu’il formulait témoignaient de son sens critique et de son bon goût. Mais, quant à tout autre sujet, il se tenait sur une grande réserve — au point que, parfois, s’il entamait une phrase qui aurait pu ouvrir un jour sur son être intime, il s’interrompait net et laissait tomber la conversation. On eût dit alors qu’il fermait une porte à triples verrous pour empêcher son interlocuteur de pénétrer dans son âme.
Je crus m’apercevoir, tout d’abord, qu’il y avait là non de la méfiance à mon égard, mais plutôt un sentiment de crainte tel que celui qu’on éprouverait à peser sur une plaie mal guérie et d’où le sang ne demande qu’à jaillir. Néanmoins, je me sentais intrigué car il est rare que deux hommes sympathiques l’un à l’autre — c’était notre cas — vivent, pendant une quinzaine, dans un tête-à-tête journalier sans en venir aux confidences personnelles.
— Après tout, me dis-je, cela ne me regarde pas. Si ce garçon aime à garnir de palissades les entours de son âme, je ne vois pas pourquoi je tenterais de forcer la clôture. Il apprécie ainsi qu’il sied Dante et l’art en général ; ce n’est déjà pas si commun. Profitons de son intelligence et gardons-nous d’entreprendre le cambriolage de sa personnalité.
Cependant, la seconde semaine de mon séjour s’achevait et je dus songer à boucler ma valise pour le départ. J’en parlai au Père hôtelier devant Maurice — c’est le nom que je donnerai à mon nouvel ami. — De plus, je manifestai le regret de n’avoir pas visité la célèbre abbaye de Maredsous qui s’élève à une vingtaine de kilomètres du château isolé que nos cénobites avaient adapté, tant bien que mal, aux règles et aux coutumes de la discipline monastique.
— Je puis vous conduire à Maredsous, intervint Maurice, j’ai mon auto. En moins d’une heure, nous serons là-bas. Après, je vous mènerai à la gare de Namur où vous prendrez le train pour Paris.
Tandis qu’il me faisait cette proposition, je le regardais et il me sembla que ce n’était pas une politesse banale qui l’avait inspirée. D’ordinaire impassible, la physionomie de Maurice laissait percer le désir que j’acceptasse.
Je ne saurais expliquer comment j’eus l’intuition que ma société lui était bonne. Ce fut une sorte d’avertissement qui se formula d’une façon assez précise en moi. J’acquiesçai donc sans hésiter.
Nous gagnons l’abbaye ; nous la parcourons rapidement, pilotés par un frère convers. Comme, remontés sur la machine, je m’inquiétais de l’heure approchante du train, Maurice me demanda tout à coup :
— Êtes-vous très pressé de retourner chez vous ?
— Pressé ?… Mon Dieu non : en ce moment je m’octroie des vacances et je n’ai pas d’autre projet que celui d’être à Fontainebleau pour la fin du mois. C’est le moment où ma chère forêt commence à se dorer d’automne.
— En ce cas, reprit-il, pourquoi ne resteriez-vous pas encore avec moi ? Il m’est venu l’idée de battre un peu le pays en votre compagnie. Je le connais passablement et j’y sais des coins attrayants. Nous garderons l’auto : nous irons à droite, à gauche, sans itinéraire fixé d’avance ; nous rencontrerons de vieilles églises d’architecture savoureuse et des paysages bons à se fixer dans la mémoire. Ce ne sera pas du temps perdu pour vous… Pour moi, non plus.
L’invite me séduisit et je n’eus pas grand’peine à consentir. La vie ressemble si souvent à un sentier grisâtre et rectiligne entre deux talus monotones qu’il faut s’empresser de saisir, avec gratitude, les occasions de sauter par-dessus le remblai pour flâner parmi les plaines — peut-être féeriques — qui s’élargissent là-bas et vont se perdre dans la brume empourprée où se transfigurent des horizons mystérieux.
En outre, je sentais de plus en plus que Maurice avait besoin de ma présence…
Ce récit n’ayant pas pour objet de développer des impressions de voyage, je mentionnerai seulement que nous avons parcouru en tous sens les Ardennes belges, poussé une petite pointe en Allemagne, une autre en Hollande. Bien entendu, nul chauffeur mercenaire ne nous soumettait à sa tyrannie. Maurice tenait le volant. Aux étapes, je lui donnais un coup de main pour nettoyer et graisser la machine, changer les pneus, déjouer l’astuce des aubergistes. Quant aux sensations d’art et de belle nature, la récolte fut abondante… Je passe rapidement sur tout cela pour en venir à l’épisode qui me révéla enfin mon compagnon de route.
Une seule fois, au cours de notre randonnée, Maurice eut la velléité de s’ouvrir davantage. Nous visitions l’église d’une bourgade dont le nom m’échappe. Nous y fûmes retenus par un retable du quatorzième siècle représentant une Mise au tombeau. J’en admirai l’art naïf et pathétique. Puis un enchaînement d’idées me fit rappeler la mort pour notre salut du Rédempteur. Maurice m’écoutait sans émettre une syllabe ; comme à l’habitude, ses traits demeuraient rigides. Pourtant, lorsque j’ajoutai que ce divin holocauste nous valait de sentir le Christ vivre en nous, sa physionomie s’anima soudain ; ses joues pâles se colorèrent ; une flamme, aussi vite éteinte qu’allumée, passa dans ses prunelles ; et il dit d’une voix sourde :
— Jésus est mort en moi ; il ne ressuscitera pas…
Surpris, j’attendais avec quelque anxiété qu’il poursuivît. Mais, fâché sans doute d’avoir rompu la consigne de silence sur soi-même qu’il s’imposait, il se maîtrisa. Son visage redevint morne. Une minute après, il se mit à détailler, du ton le plus froid et à un point de vue purement technique, le travail de l’artiste qui avait sculpté le retable.
Je craignis de le désobliger en contrariant son parti-pris et ne relevai point le propos. Il me suffisait, quant à présent, d’être assuré que la réserve insolite dont il se masquait l’âme, lui servait à refréner des orages. — Sous cette glace où il fige l’expression de ses sentiments, pensai-je, se creuse, sans doute, un cratère en éruption ; il m’a envoyé un jet de lave… Attendons la suite.
Elle ne tarda pas.
Le lendemain, nous passons la nuit dans un hameau perché sur une colline, à peu de distance de Liége. Au réveil, je m’aperçois que c’est dimanche et, naturellement, je demande à la patronne de l’auberge s’il y a une église où entendre la messe.
— Pas ici, me répondit-elle, la paroisse est à une bonne lieue. Mais vous trouverez, au bas de la côte, un couvent de religieuses du Sacré-Cœur où la messe se dit à sept heures. La chapelle est ouverte au public.
— Cela vous convient-il ? dis-je à Maurice.
D’ordinaire, étant l’urbanité même, et aussi, tenant, je crois, beaucoup à m’être serviable, il adhérait gracieusement à tout ce que je lui proposais. Je fus donc fort étonné de le voir froncer le sourcil, pincer les lèvres et secouer la tête. Pour la première fois, il montrait de la mauvaise humeur.
— Réellement, dit-il, est-ce que vous tenez à ne pas manquer la messe ?
— Mais oui, j’y tiens… D’ailleurs, c’est dimanche.
— Je le sais bien que c’est dimanche… Seulement, j’avais combiné notre itinéraire du jour de façon à visiter deux ou trois sites assez éloignés d’ici… Si nous allons à la messe, nous perdrons du temps.
Je repris :
— Une messe basse dure vingt minutes. Et puis, en ce qui me concerne, je n’estime pas que ce soit du temps perdu… S’il vous déplaît d’y assister, rien ne vous oblige de m’accompagner.
Il me regarda longuement, l’air indécis. Je dois avouer que j’avais parlé d’une manière assez sèche. Le fait est que je me sentais dérouté car si jusqu’alors j’avais eu lieu de soupçonner chez Maurice une sorte d’inertie, quant à la foi, j’avais pu également constater qu’au monastère comme ailleurs, il s’était conformé aux rites et aux préceptes sans effort apparent ni répugnance marquée. Or, aujourd’hui, quelque chose me disait que Maurice cherchait à se dérober et que cette mauvaise raison d’une journée de voyage fort chargée ne constituait qu’un prétexte.
Cependant, comme je ne voulais à aucun prix me donner, vis-à-vis de lui, le rôle d’un censeur importun, je conclus en souriant :
— Eh bien, je file à la messe. Si vous n’y venez pas, j’en serai quitte pour prier en double : un introït pour vous, puis un pour moi et le reste de même…
Ma plaisanterie ne le dérida pas. Il demeurait contracté. Mais, comme je passais le seuil en disant : A tout à l’heure, il me rejoignit, murmurant :
— Je vais avec vous. — Puis il ne desserra plus les dents jusqu’à la chapelle.
De mon côté, je réfléchissais. J’étais assez perplexe. Pourquoi Maurice s’insurge-t-il à propos d’une chose aussi simple que l’assistance à la messe dominicale ? S’il ne croit plus, pourquoi s’est-il astreint à une retraite chez les moines ? Pourquoi s’applique-t-il avec tant de soin à dérober les mouvements profonds de son âme ? Pourquoi, s’il nourrit de l’hostilité contre l’Église, semble-t-il prendre plaisir à ma société ? Il a pu vérifier que — bien imparfaitement, certes, mais avec bonne volonté — je m’efforce d’observer la loi catholique ; donc, s’il en est devenu l’adversaire, il aurait dû m’éviter, ne pouvant tabler sur mon approbation…
Tout cela, et d’autres remarques analogues que j’avais faites à son sujet, formaient un problème tramé d’éléments contradictoires.
Pour le moment, je n’étais pas à même de le résoudre. Je ne pus que me remémorer l’aphorisme de Tourgueneff : « L’âme d’autrui, c’est une forêt obscure. »
Mais dans cette forêt il y a parfois des vipères. Qui sait si le Vieux Serpent n’engluait pas de son venin la conscience du pauvre Maurice ?
Je conclus : En tout cas, il souffre et je voudrais essayer de lui venir en aide. Je vais prier pour lui… S’il est dans les vues de Dieu que je lui sois auxiliateur, unissant mon oraison au Saint Sacrifice, j’obtiendrai que les mérites de Notre-Seigneur suppléent à mon insuffisance.
Nous arrivons à la chapelle. Elle était de dimensions exiguës : une poignée de paysans, de tâcheronnes et de fermières, une trentaine d’enfants l’emplissaient presque jusqu’au porche, de sorte que nous eûmes quelque peine à trouver place.
La messe commença. Quoique je fisse de mon mieux pour la suivre, je dus m’apercevoir que Maurice ne priait pas. Il gardait l’attitude d’un homme bien élevé que les circonstances forcent de subir une corvée ; mais ses yeux erraient çà et là, en quête d’un incident ou d’un objet propre à fixer son attention. On eût dit qu’il cherchait à me faire entendre qu’il était venu là par condescendance mais que toute pensée religieuse lui restait étrangère.
Attristé, je m’enfonçai dans une prière aussi fervente que possible à son intention.
La sonnette tinta pour la Consécration et Jésus descendit sur l’autel. Et alors, je vis, d’un regard d’âme, le Jardin des Olives. Les disciples sommeillaient, étendus sur le sable ; — parmi eux Maurice plus assoupi que quiconque. Notre-Seigneur, le visage inondé du sang de son agonie, vint à lui et lui dit : Tu n’as pas pu veiller une heure avec moi ?… Mais Maurice ne répondit rien ; il dormait.
Cette image me fut décisive. Dieu soit loué, me dis-je, il ne livre pas le bon Maître aux juges iniques ; il ne le flagelle ni ne le couronne d’épines !… Il dort et un mauvais rêve l’obsède. Seigneur, faites que je parvienne à l’éveiller…
La messe terminée, la chapelle se vida rapidement. Dehors, les fidèles échangeaient, en patois wallon, des phrases joviales puis se séparaient pour regagner qui sa métairie, qui sa chaumine.
Je dis à Maurice : Maintenant, je suis vôtre. Embrayons le moteur et en route !…
Mais il ne paraissait plus aussi pressé de partir. Tournant le dos à l’auberge, il me fit signe de le suivre et prit un chemin étroit qui montait à notre gauche et aboutissait à une plate-forme d’où l’on dominait le pays. J’allai après lui sans l’interroger. A l’expression de sa figure, j’avais deviné que quelque chose venait de se produire en lui qui modifierait nos rapports.
Nous arrivons au sommet de la montée et nous débouchons sur la petite esplanade que Maurice m’avait indiquée. Nous y découvrons un banc de bois vermoulu. Trois tilleuls l’ombrageaient dont le feuillage odorant bruissait avec douceur au vent frais du matin. Devant nous, des prairies descendaient en une longue pente que jalonnaient des pommiers touffus où rougissaient les premières teintes de l’automne. Tout au bas, la ville de Liége se tassait, grise et confuse, à travers les fumées onduleuses qui montaient de ses toits d’ardoise. Elle emplissait la vallée d’une rumeur vague où se cadençaient les gammes joyeuses des cloches du dimanche. La Meuse décrivait une courbe au lointain et brillait, comme un large cimeterre d’or et d’acier fabuleux, sous le soleil oblique.
Je revois ce paysage ; je me rappelle, avant tout, le ciel si pur, si profond, si diaphane, qui répandait sur nos têtes sa lumière argentée.
Nous nous asseyons. Maurice, les yeux baissés, se tait assez longtemps ; et je me garde de le troubler, car je crains d’effaroucher son esprit ombrageux en manifestant trop tôt l’intérêt fraternel que je lui porte.
Enfin il relève le front, me fixe bien en face — la tristesse de son regard m’émeut — et, me serrant la main d’un geste spontané, il se met à me parler :
— Combien j’ai dû vous froisser, tout à l’heure, en montrant, d’une façon aussi malgracieuse, que la messe me déplaisait !…
— Me froisser, ce serait beaucoup dire, répondis-je, mais j’avoue que je fus quelque peu dérouté. En effet, vous reconnaîtrez que, depuis notre rencontre, rien dans vos manières d’agir ne pouvait me donner à supposer que la pratique religieuse vous fût répulsive.
— Oui, reprit-il, vous deviez croire à un caprice saugrenu de ma part. Mais mon incartade avait des causes. Si cela ne vous ennuie pas, je vais vous les exposer… Après tout, je suis las de me taire. Il y a trop de temps que le fardeau de mes pensées m’écrase. Il me soulagerait de vous en décrire la pesanteur. Si vous pouviez m’aider à le supporter, je me féliciterais du hasard qui nous lia.
— Ce n’est peut-être pas un hasard, observai-je.
— Nous verrons… Pour commencer, il importe que je vous esquisse, à grands traits, ma vie antérieure.
Il se recueillit quelques minutes. Les cloches allègres chantaient toujours ; les ramures éoliennes des tilleuls frémissaient à l’unisson ; caché à la cime, un ramier sauvage roucoulait timidement, par intervalles. Sous le soleil pacifique, toute la campagne se reposait dans le Seigneur et murmurait un hymne à sa gloire.
Cette harmonieuse sérénité me fit du bien. J’avais besoin de ce réconfort, car de tels abîmes se creusent parfois dans une âme qui s’apprête à vous livrer son secret ! Lorsqu’il plaît à Dieu de m’en ouvrir quelqu’une, je suis d’abord pris de panique : le sentiment de ma propre misère m’accable et ce n’est que par une fuite éperdue dans le Cœur de Jésus que j’obtiens le courage de revenir à elle et d’affronter les vertiges de « la forêt obscure ».
Enfin Maurice reprit la parole. Il s’exprimait avec lenteur, sans faire un geste :
— J’appartiens à une famille qui, si loin que remonte le souvenir, fut très pieuse et même rigide quant à l’observation des préceptes du catholicisme. Ma mère avait perdu ses parents lorsque je vins au monde. Veuve aussi, peu après son mariage, elle passait la plus grande partie de ses journées à l’église. Tout enfant, elle m’emmenait avec elle ; elle exigeait que je reste agenouillé à son côté et me réprimandait si je marquais de la fatigue ou de l’ennui. A la maison, c’étaient des exercices de piété interminables, des lectures à haute voix, choisies dans des traités d’ascétisme rébarbatifs qui, quoique je les comprisse mal, m’infligeaient la notion que j’étais un être abominable de naissance et qu’en moi ne cessaient de germer mille instincts pervers. Les mots d’« enfer » et de « damnation » revenaient à tous les paragraphes. Quand ma mère commentait ces textes lugubres, elle en aggravait encore la désolation ; un Dies iræ perpétuel grondait en ses discours. De sorte que je vivais dans une atmosphère de compression et d’effroi. Je concevais Dieu comme un tyran prêt à me pulvériser pour un bâillement involontaire aux offices, pour la demande d’une cuillerée de confiture en plus sur le pain de mon goûter.
Plus tard, j’ai compris que ma mère, par hérédité ou par nature, s’était imbue de jansénisme. Je sentais bien qu’elle m’aimait tout de même, mais il y avait trop de jours où elle se reprochait son affection comme une faiblesse. Alors, elle redoublait de sévérité à mon égard et, pour expier ce manquement à la règle farouche qu’elle s’était imposée, elle s’écrasait de mortifications.
Plusieurs fois, je la vis changer de confesseurs ; elle ne les trouvait jamais assez austères. Enfin elle découvrit un vieux prêtre retiré du ministère et qui professait la sombre doctrine d’épouvante et de réprobation où elle se cramponnait comme un naufragé de l’océan glacial à une banquise.
J’appris à le connaître, cet homme, car dès que j’eus sept ans, elle obtint qu’il me confessât toutes les semaines. Je me rappelle la rudesse opiniâtre qu’il mettait à fulminer l’anathème contre mes pauvres petits péchés. Il s’appliquait, avec un zèle atrabilaire, à me persuader que j’étais un composé de toutes les imperfections et que, très probablement, Dieu m’avait prédestiné aux rigueurs de sa justice.
Bien entendu, les plaisirs de mon âge m’étaient interdits ; je n’ai jamais possédé ni toupie ni soldats de plomb. On m’élevait soigneusement à l’écart des autres enfants, tenus pour des vases de perdition. En dehors de son directeur, ma mère ne recevait que trois dévotes surannées qui partageaient son égarement. Parques inflexibles, leur âme se révélait plus sèche, plus rugueuse et plus racornie que le cuir d’un dromadaire tué par la soif au centre du Sahara. Elles s’accordaient pour jeter de la cendre à la face de l’univers entier, critiquer âprement le clergé de leur paroisse, éplucher avec malveillance et assaisonner de vinaigre les faits et gestes de quiconque leur frôlait le coude. Leurs propos me transperçaient comme une bise de novembre. Mais s’il m’arrivait d’éternuer en leur présence, elles ne perdaient pas une seconde pour me prédire la carrière d’un scélérat. Dénouement du drame : des claques sur mes joues pâlotes et ma réclusion dans un cabinet noir…
Quand je me reporte aux années de ma morne enfance, je les revois pareilles à une courette obscure, humide et froide, étranglée entre quatre maisons hautes de huit étages, aux murailles verdâtres comme des linceuls moisissants, aux fenêtres closes de persiennes inexorables. Un ciel couleur de suie pèse sans cesse sur les toits. Tout au fond, grelotte un acacia malingre dont les quelques feuilles se fripent et se recroquevillent sitôt sorties du bourgeon. Et cet arbrisseau qui s’étiole, c’est moi-même…
Lorsque je fis ma première communion, l’implacable janséniste m’avait tellement imprégné du sentiment de mon indignité que je reçus l’hostie sans aucune joie. Je passai le reste du jour dans le tremblement, à me redire que je venais, presque à coup sûr, de profaner le corps du Dieu terrible dont la Majesté courroucée m’opprimait ainsi qu’un bloc de granit.
Peu après, ma mère mourut subitement. J’eus pour tuteur un parent assez éloigné qui crut assez faire en administrant, avec probité, la fortune assez considérable dont j’héritais. Pour le surplus, je fus transplanté dans un collège ecclésiastique, au loin. J’y passai même toutes mes vacances…
Vous n’avez que faire de descriptions. Je n’entrerai donc pas dans le détail de ma nouvelle existence. Ce qu’il importe d’en retenir, c’est que le milieu, si différent de celui où j’avais langui auparavant, ne réussit pas à modifier l’état de mon âme. Le contact de mes camarades de pension — d’assez gentils enfants pour la plupart — ne me dégourdit point. Je laissai tomber les avances que quelques-uns me firent. Je ne les rabrouais pas, mais je prenais un air si malheureux et si morose quand on m’invitait à une partie de barres ou de billes, qu’on finit par me considérer comme un jeune hibou qui ne saurait se plaire aux envolées pépiantes des passereaux. On me laissa dans mon coin ; et cet isolement me maintint dans la stupeur terrifiée où je me figeais depuis que j’avais reçu l’empreinte du jansénisme.
Des professeurs et des surveillants, aucun n’obtint ma confiance ni mon affection. Je ne leur reproche pas de m’avoir négligé. C’étaient de bons prêtres, attentifs à leur fonction. Mais n’étant qu’une demi-douzaine, toujours surmenés, parmi un grand nombre d’élèves, ils ne pouvaient guère se donner à l’un plus qu’à l’autre. Ils nous instruisaient et nous éduquaient à la grosse, d’après des méthodes traditionnelles, s’attachant surtout à nous canaliser dans un courant d’habitudes pieuses qui nous devinssent une routine préservatrice pour l’avenir.
Or je crois qu’à cette époque, j’aurais eu besoin d’une sollicitude particulière. J’eusse rencontré un cœur d’apôtre, comme on prétend qu’il en existe, quelqu’un de brûlant qui me témoignât de la tendresse, qui me réchauffât l’âme, peut-être serais-je sorti de l’ombre taciturne où je me confinais pour m’épanouir au grand soleil de la joie, ainsi que le faisaient mes camarades.
Ce sauveteur clairvoyant je ne le trouvai pas.
Je passai donc les jours à rêver tristement dans le vague. Pourtant, à la longue, une pensée obsédante s’empara de moi qui fixa mon esprit jusqu’alors à la dérive. La voici : je comparais, à toute heure, la religion rébarbative, que ma mère et son vieux directeur m’avaient inculquée, à la dévotion aisée que nos maîtres nous apprenaient. Je m’aperçus vite qu’elles ne coïncidaient en aucun point. Et je me demandais : Dieu est-il un despote inaccessible dont nous ne sommes jamais sûrs d’apaiser la colère ? Ou bien est-il un dominateur indulgent, que quelques exercices de piété, accomplis avec exactitude mais sans trop de réflexions, suffisent à contenter ?
J’avais beau me poser la question, je n’arrivais pas à une réponse qui me tranquillisât. Enfin, à force d’incertitudes, un scrupule me vint. Je m’imaginai que, par manque de soin dans mes examens de conscience, j’avais dissimulé des péchés dont la survivance en moi m’aveuglait quant à la façon de comprendre Dieu et de lui être agréable.
Je me crus damné sans rémission. Cette idée me fut bientôt si pénible que je résolus de la soumettre à mon confesseur. Si j’avais su m’expliquer, si surtout j’avais remonté jusqu’à la cause initiale de mon désarroi, il est à peu près certain qu’il aurait saisi la gravité du mal dont je souffrais et qu’il y aurait porté remède. Mais, par timidité et aussi par crainte d’offenser Dieu en alléguant des excuses au crime dont je m’estimais coupable, je me bornai à dire au Père que je ne pouvais plus communier parce que, malgré les absolutions antérieures, ma conscience demeurait chargée de péchés.
Je m’exprimai sans doute d’une façon très gauche car mon confesseur comprit que je lui avais caché des fautes dont j’avais eu honte de lui spécifier l’espèce. Mais il ne lui fallut pas beaucoup d’interrogations pour se rassurer à cet égard. Il en conclut que mon scrupule ne provenait que d’un défaut de confiance dans la miséricorde divine. Il me reprocha, en termes peut-être trop sommaires, un excès d’analyse sur moi-même et me prescrivit de mettre désormais plus de simplicité dans ma préparation au sacrement de pénitence. Puis, comme trente élèves attendaient leur tour, agenouillés à la file dans la chapelle, il me congédia.
Je demeurai anxieux. La question n’était pas résolue : qui avait raison des tenants du Dieu sévère ou des partisans du Dieu de mansuétude ? Les impressions reçues jadis restaient trop fortes pour que je ne penchasse pas vers les premiers. Elles l’emportèrent et il en résulta que je m’ancrai dans le désespoir avec la conviction que les maîtres, les élèves et moi-même nous étions tous des réprouvés. Par suite, nos confessions, nos communions, nos prières n’étaient que gestes et chuchotement vains dans les ténèbres… Plus rien à faire pour notre salut !
Cette crise était trop violente pour durer… Vous m’objecterez que j’aurais dû, par exemple, me confier au Supérieur. Homme d’expérience, il m’aurait, je le suppose, tiré de la cave sans soupiraux où je m’isolais de la sorte…
— Assurément, répondis-je, dans un cas pareil, se taire, c’est aggraver son mal.
— Oui, mais voilà, je ne parlai pas. Je ne sais quelle force latente me murait dans mon silence. Il semble que, rabattue sur elle-même de si bonne heure, attaquée dans sa volonté, mon âme était devenue incapable de dilatation. Lorsque le sentiment de désespoir qui l’opprimait s’atténua par l’accoutumance, je fus pris d’une sorte d’atonie religieuse. Je ne me dérobai point à la pratique ; je continuai d’obéir, sans objections, au règlement : j’allais à la messe, je me confessais, je communiais comme les autres. Mais je faisais tout cela d’une façon machinale, parce qu’il n’était pas dans mon caractère de me révolter. Une résignation passive atrophiait mes facultés. On disait de moi : « Ce n’est pas un mauvais garçon, mais il a l’air d’un somnambule… »
Et c’est ainsi que j’entrai dans l’indifférence. Que vous décrire de plus ? Mon âme gisait dans mon corps comme un cadavre dans son cercueil.
Mes années d’études finies, je passai mon baccalauréat et je retournai dans le monde. Mon tuteur, qui avait hâte de se débarrasser de moi, me fit émanciper et me rendit compte de ma fortune. A dix-neuf ans, je me trouvai mon maître, sans avoir à gagner mon pain, mais aussi sans personne qui s’intéressât à moi. Du reste, j’aurais découragé les sympathies par mon manque d’entregent.
Or, il advint qu’aussitôt libre de me conduire à ma guise, je m’éloignai de la religion. Comment cela se produisit, je ne saurais trop l’expliquer : je le constate. Du jour au lendemain, la foi se retira de moi. Je ne mis plus les pieds à l’église ; mes lèvres perdirent l’habitude de formuler la moindre prière. Je ne pensai plus à Dieu. Cette évolution se fit sans luttes ni angoisses. Simplement, toute idée religieuse me quitta comme, en octobre, l’écorce de certains platanes se détache et tombe.
Je ne m’alarmai pas de ce changement. Au contraire, je respirai plus à l’aise parce que la qualité de mon indifférence avait changé : la résignation avait disparu ; elle était remplacée par la sensation agréable d’être libéré d’un joug trop onéreux pour mes épaules. Aussi ne fis-je rien du tout pour réagir.
Cependant, il n’est pas dans la nature que l’intelligence et la sensibilité demeurent oisives. L’existence d’un mondain désœuvré ne m’intéressait pas. Le contact de ce qu’on appelle « la bonne société » m’ennuyait prodigieusement et je m’empressai de m’en tenir à distance. D’autre part, je ne me sentais de goût pour aucune profession. Je me tournai donc vers l’art, la littérature et les philosophies. Je les cultivai, non dans le dessein de créer une œuvre, mais de meubler d’objets délectables la solitude de mon esprit. En somme, je fus un dilettante, un collectionneur de belles formes et de pensées ingénieuses, nullement soucieux de les classer d’après une doctrine préconçue.
Je me disais : Si, comme l’assure Stendhal, « la beauté est une promesse de bonheur », peut-être en la cherchant un peu partout, deviendrai-je ce que je n’ai jamais été — heureux.
Tout d’abord, je lus avec avidité, sans m’imposer un choix. La substance de cent bibliothèques m’emplit le cerveau. Puis je voyageai ; je visitai des musées ; j’appris des langues, entre autres l’italien si à fond, que je pus lire Dante dans le texte. Des métaphysiques contradictoires m’occupèrent comme l’avaient fait les styles différents des écrivains et des peintres. Nulle ne me retint. Elles m’amusaient, mais pour mon jugement, elles n’avaient pas plus de consistance que ces fumées qui montent de la ville devant nous.
Au bout de quelques années de ce régime, je découvris soudain que toutes ces choses ne m’intéressaient plus. Je me trouvai, parmi leurs prestiges fragiles, comme un promeneur sous une futaie saisie par la gelée et qui se dépouille. Art, littérature, philosophies me furent des feuilles sèches qui papillonnaient autour de moi, puis descendaient s’abattre sur la terre durcie. Je les foulais d’un pied paresseux et leur bruissement monotone cessa bientôt de me divertir.
Je végétai alors quelques mois dans un état d’inertie intellectuelle et morale. Je sentais en moi un vide immense que, rien au monde, me semblait-il, n’était capable de combler. L’ennui, fils de la morne incuriosité, comme dit Baudelaire, s’installa dans mon âme. Je ne fus qu’un bâillement continuel et je regrettai de ne pouvoir user les vingt-quatre heures du jour à dormir.
A la longue, cette léthargie m’effraya comme un symptôme d’hébétude ; une réaction se fit. Voulant galvaniser l’automate ambulant que je devenais, je m’aperçus que j’avais des sens et je me dis : Mais des gens existent qui n’ont d’autre occupation que de régaler leur sensualité. Puisque les plaisirs de l’esprit m’ont déçu, pourquoi ne pas les imiter ? Après tout, gorger la brute, qui veille en nous, des jouissances qu’elle préfère, c’est peut-être le moyen d’échapper au spleen rongeur dont je suis possédé.