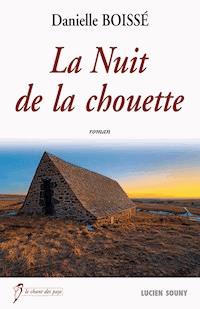
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Lucien Souny
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
En 1960, Annie est en âge de rire, de sortir et d’aimer.
Mais, à part la ferme, elle ne connaît rien de ce monde qui bouge, de ces femmes qui se maquillent, qui vont au cinéma, qui portent des talons hauts et des bas…
D’ailleurs, elle est certaine qu’elle finira vieille fille ! Un jour, de passage dans le village, elle tombe sous le charme d’un nouveau venu – un commis agricole – à l’allure flamboyante et à l’esprit badin. Si jusqu’à présent rien n’avait alimenté ses rêves, tout devient différent lorsque André l’entraîne dans le tourbillon d’un bal d’été. Elle découvre les premiers frémissements de son corps et elle est assaillie de pensées qui l’emportent loin de l’univers clos et figé de ses parents. Mais la cruelle réalité de la vie la rattrape brutalement. Dès le lendemain, le beau garçon file à Paris avec un copain pour y faire fortune. Bien vite, Annie s’aperçoit qu’elle est enceinte. Dévastée, elle craint les foudres de Dieu, la colère de son père et les calomnies de son entourage. Elle apprendra que l’effort, le travail et la solidarité humaine permettent de survivre aux épreuves et de garder sa dignité.
Fausses pistes, coups de théâtre, révélations… Un roman habilement construit, qui fait s’entremêler mystère, amour et tragédie.
EXTRAIT
Saint-Chély-d’Aubrac – 1960
Dans une cuisine modeste mais rutilante de propreté, où flottaient encore les effluves d’un copieux repas du dimanche, quatre jeunes filles se prélassaient, leurs tâches domestiques terminées. Le plancher balayé, la vaisselle lavée et rangée dans l’armoire, la longue table familiale essuyée et encore humide, elles pouvaient se permettre cette pause après l’effort, sans crainte d’être houspillées par la maîtresse de maison. Assises en rang d’oignons, Marie, Annie et Jeannine, trois amies, originaires du village, écoutaient religieusement Nicole. Cette invitée, installée en face d’elles et inconnue jusque-là, devisait sans discontinuer depuis le départ des adultes, une fois le déjeuner terminé.
La narratrice scruta son jeune public attentif.
—… J’irai encore plus loin ! Je parie qu’aucune de vous trois ne s’est jamais laissé caresser les seins, ni même embrasser longuement sur la bouche !
À dix-huit ans, la pulpeuse Nicole était sans doute experte, depuis déjà longtemps, en matière de caresses osées et de baisers goulus et pénétrants. Elle roula de gros yeux amusés en direction des trois candides adolescentes qui constituaient son auditoire captivé.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Danielle Boissé, franco-américaine, vit en France depuis trente-cinq ans. Tourangelle d’origine, mais expatriée alors qu’elle était enfant aux USA, elle est revenue dans le Quercy à l’âge de 30 ans, pour finalement s’installer dans les Pyrénées-Orientales, à Perpignan. Auteur, elle s’est d’abord fait connaître en signant des polars qui ont été traduits en catalan, puis en anglais ! Aujourd’hui, elle veut faire rêver le lecteur en imaginant des histoires remplies d’humanité, campées au cœur de ces régions de France qu’elle aime tant, qu’elle dépeint avec talent et dont elle resitue toute la finesse et l’âme.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autrefois le rat de ville
Invita le rat des champs,
D’une façon fort civile,
À des reliefs d’ortolans…
Jean de La Fontaine, Fables
À Antonio, qui, tous les jours, éclaire mon chemin.
Saint-Chély-d’Aubrac – 1960
Dans une cuisine modeste mais rutilante de propreté, où flottaient encore les effluves d’un copieux repas du dimanche, quatre jeunes filles se prélassaient, leurs tâches domestiques terminées. Le plancher balayé, la vaisselle lavée et rangée dans l’armoire, la longue table familiale essuyée et encore humide, elles pouvaient se permettre cette pause après l’effort, sans crainte d’être houspillées par la maîtresse de maison. Assises en rang d’oignons, Marie, Annie et Jeannine, trois amies, originaires du village, écoutaient religieusement Nicole. Cette invitée, installée en face d’elles et inconnue jusque-là, devisait sans discontinuer depuis le départ des adultes, une fois le déjeuner terminé.
La narratrice scruta son jeune public attentif.
—… J’irai encore plus loin ! Je parie qu’aucune de vous trois ne s’est jamais laissé caresser les seins, ni même embrasser longuement sur la bouche !
À dix-huit ans, la pulpeuse Nicole était sans doute experte, depuis déjà longtemps, en matière de caresses osées et de baisers goulus et pénétrants. Elle roula de gros yeux amusés en direction des trois candides adolescentes qui constituaient son auditoire captivé. Comme aucune affirmation ne vint contredire l’étonnante hypothèse avancée par la coquette citadine, celle-ci poursuivit sur un ton dédaigneux.
— Mes pauvres enfants ! Alors vous ne savez vraiment rien de l’amour et des hommes ? Est-ce qu’à notre époque on peut encore croire une chose pareille ?
Elle hocha la tête à plusieurs reprises et soupira, consternée par tant d’innocence.
— Ma parole, vous êtes vraiment des oies blanches ! finit-elle par jeter avec une fatuité insolente.
Marie Cayzac, d’un an sa cadette et fille unique de la maison, gigota sur sa chaise, en proie à une agitation qui en disait long sur son énervement. Piquée au vif par cette dernière réflexion si désobligeante, elle riposta, telle une insurgée, prenant ses amies à témoin.
— Non mais, dis donc, cousine ! Ne nous prends pas de si haut, tu veux ! C’est pas parce que tu arrives de la ville que tu dois te sentir supérieure et nous traiter d’oies. Pas vrai, les filles ?
Les deux autres, Jeannine Vernhes et Annie Delmas, également vexées par l’insulte à leur intelligence, opinèrent du bonnet. Nicole observa leurs sourcils rapprochés et leur front plissé de mécontentement, et elle fit la moue, songeuse. Après tout, il lui coûtait peu de se montrer conciliante avec ses nouvelles connaissances.
— Bon, bon, tu as raison. Je m’excuse. Ce n’est sans doute pas de votre faute. Mais avouez pourtant qu’à votre âge vous êtes drôlement en retard ! Les gars de ce bled ne seraient tout de même pas tous des… ? Enfin ! Disons qu’ils ne doivent pas être très… entreprenants !
L’image affligeante d’un ramassis d’hommes efféminés, émasculés ou impuissants plana au-dessus d’elles. De mal en pis !
Outrée, Jeannine, la plus jeune du groupe, prit courageusement la parole. Cette jouvencelle fluette de quinze ans, habituellement effacée et, jusque-là, silencieuse devant ses aînées, sentait qu’on insultait à présent la gent masculine de son village et qu’on mettait en doute sa virilité.
— Eh ! Dis donc ! Les garçons du pays et ceux de ta grande ville, c’est du pareil au même ! Qu’est-ce que tu crois ? C’est nous trois qui les obligeons à nous respecter ! Si on le leur permettait, ils nous embrasseraient et tenteraient même beaucoup plus que ça. D’ailleurs, on connaît certaines dévergondées qui ne leur ont pas résisté et qui pourraient en conter un brin sur eux… Y compris à toi qui, apparemment, es si savante !
Elle pencha la tête, gênée, et un frisson sensuel mais involontaire la parcourut.
— Tu comprends, sœur Catherine nous a assez rabâché qu’on ne doit jamais céder au désir bestial des hommes, ni se laisser corrompre par leurs perversions… Du moins, jusqu’à notre nuit de noces. Évidemment, à partir de ce moment-là, pour être mère comme le prévoit et l’ordonne l’Église, on sera malheureusement bien obligées de les laisser faire !
Sa dernière remarque ne laissait rien présager de bien réjouissant dans cet acte d’amour matrimonial, redouté et pourtant tant attendu. C’était une citation directe et fidèle de leur ancienne institutrice. La pudibonderie de cette observation renvoyait l’image de l’agneau innocent livré à l’abattage et elle fit pouffer malgré elles les deux autres villageoises, moins soumises et moins crédules que leur cadette. Elles se rappelaient la mine dégoûtée, aux yeux exorbités, qu’affichait la scrupuleuse religieuse lorsque celle-ci abordait, avec les plus âgées, le sujet embarrassant des péchés de la chair et celui, parfois humiliant, du devoir conjugal des femmes. Leur rire détendit l’atmosphère.
Les trois amies d’enfance s’étaient rassemblées dans la cuisine chez Marie pour y accueillir sa parente venue de la ville. Arrivée de Clermont-Ferrand le matin même, cette sensuelle et étonnante donzelle avait été expédiée dans ce village paisible par ses parents avec l’injonction formelle d’y passer l’été. Depuis qu’elles l’écoutaient relater ses expériences amoureuses, les trois adolescentes finissaient par se demander si la belle Nicole Fabre n’avait pas gravement péché et n’était pas tout simplement en exil à la campagne ! Elles grignotaient avec gourmandise les gâteaux apportés par cette invitée clermontoise et se délectaient non seulement de ces douceurs inhabituelles et raffinées, mais également des propos insolites que tenait cette jeune fille libertine au joli corps de femme.
— Tu en as donc embrassé tant que ça, toi, des garçons ? interrogea négligemment Marie, intriguée plus qu’elle ne voulait l’admettre par cette conversation si audacieuse et si singulière.
Nicole gonfla le buste, prête, de toute évidence, à raconter dans les moindres détails certaines de ses plus croustillantes aventures. Cependant, pour l’heure, les trois amies n’en apprirent pas davantage, car la mère de Marie venait d’entrer inopinément dans la cuisine. Silence radio ! D’un commun accord, rapide bien que silencieux, les quatre bavardes stoppèrent net une conversation que n’aurait pas du tout appréciée Mme Cayzac.
— Alors, la souris de ville et celles des champs, vous faites plus ample connaissance ? Vous n’allez pas rester enfermées par ce beau dimanche ! Je suis sûre que Nicole serait heureuse de découvrir notre village. Allez donc vous aérer, bande de pipelettes !
Elle les chassa gentiment à petits coups de torchon et, en ménagère économe, rangea le reste des gâteaux au fond d’un placard. Sous ses yeux bienveillants, Marie, Jeannine et Annie quittèrent la cuisine, suivies d’une Nicole peu réjouie d’aller marcher dans la campagne. Tout en haussant les épaules, soumises, elles partirent sans but précis. Du moins, elles allaient pouvoir parler sans contrainte.
En ce jour de repos du Seigneur, le soleil brillait, déjà chaud pour un mois de juin, et l’air embaumait. À l’exception du pépiement des oiseaux dans les arbres et du babil des quatre promeneuses qui, par moments, ressemblait à un gloussement de poules, la campagne était déserte et silencieuse. Les adolescentes badinaient joyeusement en marchant, surtout Nicole, finalement heureuse d’être libre et loin de la présence des adultes. Leur promenade les avait peu à peu conduites sur les hauteurs du bourg. À l’instigation de Marie, elles quittèrent la chaussée à un endroit dépourvu d’arbres et, avec précaution, s’approchèrent au bord du précipice. Depuis ce point de vue, elles jouissaient du remarquable panorama d’un village en miniature. Au loin, les maisons de poupées arboraient leurs jolis toits de lauzes fines en arrondi qui rappelaient les écailles d’un poisson. De-ci de-là, on apercevait les roses grimpantes qui couraient le long de leurs façades et semblaient monter à l’assaut des gouttières. L’église, au clocher étonnant en forme de tour, dominait le centre de la bourgade. Depuis son parvis, des rues étroites et des chemins bordés de haies partaient en zigzag et menaient au petit cimetière et vers des fermes éparpillées sur les collines environnantes. À perte de vue, les parcelles boisées, de pâturage ou laissées en jachère tapissaient les terres en damier comme un ouvrage de couture aux multiples couleurs qu’on aurait jeté au sol.
— Où sont les vaches ? demanda Nicole, apparemment peu sensible à cet admirable tableau bucolique.
Elle scruta le paysage dans sa totalité et étouffa un bâillement.
— On m’avait dit qu’il y en avait tellement par ici. J’en vois bien quelques-unes, là-bas autour des fermes, mais pas tant que ça !
Quand vient le printemps en Aubrac, vert pays d’élevage bovin, les bêtes quittent les étables et montent vers les gras pâturages des hauts plateaux. Cette bruyante et traditionnelle transhumance avait eu lieu à la fin du mois précédent et les vaches ne redescendraient que le 13 octobre pour la Saint-Géraud. Les trois amies expliquèrent à la citadine que les troupeaux des riches propriétaires étaient partis. Seuls les petits cheptels appartenant aux fermiers moins aisés restaient sur place dans leurs prés.
— Mes parents n’en ont que huit et nous les gardons sur nos terres toute l’année, lui apprit Annie.
Pas très loquace, celle-ci n’avait pas beaucoup participé à une conversation d’ailleurs dominée par Marie et Nicole. Avec Jeannine, elles se tenaient même un peu en retrait des deux cousines, sans doute intimidées par le papotage incessant de l’aînée.
Annie saisit l’opportunité, dans l’accalmie qui suivit, pour poursuivre et annoncer à Marie qu’elle devait les quitter. À la différence de ses deux camarades, elle ne vivait pas au village mais dans un hameau éloigné.
— J’en ai pour une bonne heure de marche, et, on a beau être dimanche, nos deux cochons attendent leur soupe ! Je suis partie ce matin pour aller à la messe et pour manger chez toi, mais maintenant mon travail m’attend. J’ai passé une belle journée. Merci de m’avoir invitée. Allez, à bientôt !
Elle embrassa amicalement les trois filles et, d’un pas résolu, elle se dirigea à travers champs, en direction de Régaussou, où se situait la modeste exploitation de ses parents. Sur son chemin, les fleurs sauvages de juin abondaient dans les fourrés et sur les talus, entremêlées, par endroits, avec les hautes herbes et les blés dorés. Annie respira à pleins poumons leur doux parfum. Elles se dressaient fièrement vers le soleil et n’attendaient que d’être cueillies : des pensées sauvages, chacune avec ce qui semblait être la frimousse malicieuse d’un lutin, de fragiles coquelicots écarlates et satinés, de fines centaurées d’un bleu délicat, des nuages blancs de marguerites, quelques hautes gentianes jaune citron éparpillées, çà et là… Le matin, en descendant au village, elle s’était dit qu’à son retour elle en cueillerait un gros bouquet pour sa mère. Mais les paroles de Nicole lui trottaient dans la tête et elle ne prêtait plus aucune attention à la foisonnante floraison printanière qui fourmillait à ses pieds. Tout en cheminant, elle se remémorait les rires étouffés de certaines camarades de classe pendant les cours de sœur Catherine. Malgré leur jeune âge, ces saines et robustes paysannes ne considéraient pas les ébats amoureux comme « bestiaux et dépravés », loin s’en fallait ! Par contre, ils étaient interdits et condamnés par l’Église, ça c’était certain ! De plus, si on en croyait la religieuse, ces mêmes gestes passionnés étaient également risqués, voire dangereux ! Car une fois cataloguée comme « fille facile », une adolescente en âge de se marier ne trouverait plus de mari – aucun garçon ne voulant épouser une traînée ! Annie soupira. À dix-sept ans passés depuis peu, elle avait beau être restée sage, pas un jeune homme ne se profilait à l’horizon. Il faut dire qu’elle avait très peu de voisins à Régaussou. Surtout dans la catégorie « jeune célibataire cherchant une fiancée » ! Après un haussement d’épaules résigné, elle accéléra le pas. Comme elle l’avait dit à ses amies, son travail l’attendait !
* * *
Une fois leurs tâches dominicales achevées, Annie et ses parents s’étaient retrouvés dans la cuisine, presque silencieux, bien aises de souper et de se délasser. La soirée printanière semblait s’étirer sans fin, douce et paisible. Derrière la grange, même la volaille avait cessé son bruyant caquetage et s’était installée pour la nuit sur les perchoirs du poulailler. La porte de la maison était ouverte sur la cour ; on n’avait pas allumé la lampe. Il ferait encore jour à l’heure d’aller se coucher ! La vaisselle faite et le rugueux plancher balayé, les deux femmes se remirent à table auprès du père. Après avoir consulté l’almanach, Lucien Delmas alluma sa dernière cigarette de la journée.
— Aujourd’hui, c’est la Saint-Léonce. Dans une semaine, ça sera la Saint-Jean. On est en plein dans les jours les plus longs. Avec l’arrivée des grosses chaleurs, prévues tôt cette année, on va avoir du pain sur la planche !
Les deux femmes, qui savaient lire entre les lignes, avaient vite compris qu’il songeait déjà aux corvées d’eau. Pénibles toute l’année mais davantage pendant l’été ! Les abondantes pluies hivernales ne viendraient plus remplir les barriques judicieusement placées sous les chenaux en châtaignier. Indispensable pour les arrosages quotidiens du vaste potager, pour abreuver les cochons et la volaille et pour couvrir tous les besoins de la famille, il fallait aller la chercher, cette eau tant convoitée ! À la différence des villageois établis dans la vallée, les habitants de ce hameau haut perché et isolé n’avaient toujours pas l’eau courante. Le maire avait promis qu’ils l’auraient « d’ici peu ». En bas, elle coulait déjà depuis quatre ans, fraîche et abondante, aux robinets ménagers et près des bâtiments agricoles ! Une manne providentielle, quasi miraculeuse, disaient certains anciens. Son arrivée avait changé la vie des sept cents âmes du pays. Les Delmas, par contre, tout comme leurs voisins immédiats, devaient mener boire leurs vaches à la source, deux fois par jour, toute l’année. En outre, il leur fallait ramener à la maison, plusieurs fois par semaine, un tombereau chargé de tonneaux remplis du précieux liquide. Sans parler des fréquents allers et retours d’Annie, avec un joug et des seaux. La source se trouvait à deux cents mètres. Toute une expédition ! Pareil pour l’électricité. On prévoyait de leur installer les lignes « très prochainement ». Il y avait si longtemps que le courant existait à Saint-Chély que les heureux habitants de la commune n’en faisaient même plus de cas. « Pour nous, c’est une autre paire de manches ! Loin des yeux, loin du cœur », maugréait le chef de famille, souvent découragé. Annie supposa qu’à présent son père allait sans doute lui ressortir ses recommandations habituelles : « Ne gaspille pas l’eau pour te laver si souvent les cheveux, et n’allume pas la lampe à pétrole dans ta chambre le soir pour lire tes romans-photos ! »
Il tira une dernière bouffée de sa cigarette, signe qu’il était bientôt l’heure d’aller se coucher. Elle prit une décision audacieuse, se racla la gorge et se lança.
— Je sais que vous vous êtes connus dès votre enfance, maman et toi, mais quel âge aviez-vous quand vous vous êtes embrassés la première fois pour de vrai ? Je veux dire, avec passion, en amoureux.
Ses paroles firent l’effet d’un coup de canon tiré dans la quiétude de la cuisine. Son père ouvrit de grands yeux étonnés. Surprise, sa mère la dévisagea d’un air effaré, la bouche béante.
— Ben quoi ? Je n’ai pas dit de gros mots ni de paroles scandaleuses ! C’est juste pour savoir. Vous êtes mes parents, après tout. Il n’y a pas de mal, non ?
Elle les considéra avec espoir, mais néanmoins avec une certaine appréhension. C’était la première fois qu’elle évoquait un sujet aussi sensible avec eux ! Ses mains croisées sur la table, le buste tendu en avant, elle attendait une réponse. Visiblement, cela avait de l’importance pour la gamine. Son père toussota et, la mine penaude, jeta un regard en coin à son épouse, souriant mais embarrassé. Celle-ci rougit et baissa les yeux comme une jeune fille.
— Ma parole, tu en as de drôles de questions tout à coup !
Germaine risqua un coup d’œil vers son mari et vit le regard de celui-ci, gêné, mais néanmoins amusé.
— Eh bien, j’avais ton âge, ou un peu plus, et ton père en avait dix-neuf. C’est bien ça, Lucien, non ?
Il hocha la tête. Ses yeux se plissèrent malicieusement et il observa attentivement sa surprenante progéniture. De lui voir le visage si sérieux, il eut un sourire de gamin honteux.
— À vrai dire, il y avait déjà un bail que j’en mourais d’envie ! Pourtant, avant qu’elle me laisse faire, il m’a fallu lui rappeler qu’après tout on allait se marier dans l’année !
Sa femme lui décocha une bourrade dans les côtes et il éclata de rire devant son embarras.
— Au fait, reprit-il, pourquoi cette question si indiscrète ? On n’a pas pour habitude de déballer nos petits secrets, comme ça, à table. Et surtout avec notre fille. N’oublie pas ce que disaient les anciens : « Parler d’amour en public, c’est semer des graines de coquettes… Vous récolterez des cocus ! » Alors, explique-nous ce qui se trame là-dessous. Y aurait-il un freluquet que tu envisages d’embrasser… avec passion, comme tu dis ?
— Mais pas du tout, voyons ! Qu’est-ce que tu vas imaginer ? Et qui voudrais-tu que j’embrasse ? Le taureau ? Je ne sors jamais. Il ne se passe jamais rien ici ! Je n’ai même pas de petit ami ! De toute façon, il n’y a pratiquement pas de garçons de mon âge dans ce coin perdu. Je vais probablement mourir vieille fille dans ce trou avant même d’avoir connu l’amour !
Germaine et Lucien hésitaient entre le rire et la colère. Ils lui demandèrent ce qui avait bien pu déclencher de telles réflexions déplaisantes à propos de leur foyer. Alors, pêle-mêle et d’un trait, elle leur raconta l’arrivée de Nicole et ses révélations sur la vie à la grande ville, le cinéma, les bals, le maquillage et les bas en nylon, la nouvelle musique venue des États-Unis, ses sorties avec des garçons – tout ce qu’elle-même ne connaîtrait sans doute jamais ! Peu habitués à ce genre de langage, ils se sentirent désemparés. Surtout qu’à cet instant, comme pour clore l’incident, Annie baissa la tête sur ses bras repliés et se mit à sangloter. Déconcertée devant ce chagrin inhabituel, Germaine avança la main et tapota doucement les cheveux de sa fille. Machinalement, Lucien écrasa son mégot entre ses doigts, récupérant les quelques brins de tabac qu’il remit soigneusement dans sa blague. Il haussa les épaules. Ce sujet dépassait l’entendement du brave agriculteur. Lui et sa femme étaient nés à Régaussou et ils y avaient trouvé l’amour et le bonheur. Un bonheur, certes modeste, fait de bien simples plaisirs ! Si, dans leur jeunesse, ils avaient eu parfois des états d’âme, ils n’avaient jamais pu s’en ouvrir à leurs propres parents qui, d’ailleurs, auraient été abasourdis d’être abordés de la sorte. Ils s’étaient donc contentés de leur humble existence et avaient fait avec. Lucien se dit qu’il fallait désormais vivre avec son temps : les mœurs, et apparemment les jeunes, avaient changé !
Peu après, ils partirent se coucher et, jusqu’à une heure avancée de la nuit, Annie entendit ses parents murmurer dans leur chambre. Dans les jours qui suivirent, et à plusieurs reprises, les Delmas l’envoyèrent au village, sous un prétexte ou un autre. Était-ce dû à cette soirée et aux propos désespérés qu’avait tenus leur fille ? « Descends donc m’acheter encore quelques pelotes de cette laine bleue chez Mme Brouzes. Prends aussi deux kilos de sucre à l’épicerie. Il va falloir commencer les confitures de fraises, et le caïffa* ne passera que jeudi prochain. » Un matin, chose inouïe, impensable, comme si elle venait seulement d’y songer, sa mère avait nonchalamment rajouté : « Tiens, pendant que tu es en bas, passe donc voir ton amie Marie Cayzac et sa cousine. Invite-les au café pour boire une limonade avec toi ! Cela te changera les idées ! »
Les femmes en général, et les jeunes filles en particulier, avaient peu l’habitude de fréquenter les cinq cafés du village. Pourtant, comme s’en était aperçu Lucien, les mœurs changeaient. En cette année 1960, à l’aube d’une encore timide mais inéluctable libération de la femme, il n’était plus rare de voir une volée de jeunettes s’abattre sur un des établissements, surtout pendant la période estivale. Le temps de se désaltérer d’une limonade ou d’un diabolo fraise, elles s’installaient discrètement, souvent au fond de la salle, avant de repartir en riant vers leurs occupations ménagères ou leur travail dans les champs. Généralement, les hommes, en maîtres absolus des lieux depuis des lustres, ne voyaient pas d’un bon œil cette invasion féminine. « Des donzelles dans un troquet ! On aura tout vu ! » Mais comme l’avait fait judicieusement remarquer une gamine à son bougon de grand-père : « Pépère Henri, on ne fait aucun mal, voyons ! Et, en plus, vous êtes là pour nous surveiller. » Le vieillard s’était rendu à l’évidence. Il n’y avait là, en effet, pas de quoi fouetter un chat.
Assise au bistrot avec ses nouvelles amies, à un point stratégique près de la fenêtre, Nicole s’ennuyait à mourir. Quelques regards rapides et discrets jetés autour d’elle lui avaient suffi pour évaluer la clientèle. Elle avait pris son parti : les occasions de faire d’intéressantes rencontres ici semblaient bien maigres, voire nulles. Dépitée, elle hocha la tête. Toutefois, elle redressa légèrement le torse pour mieux faire pointer sa poitrine généreuse, secoua d’un geste voluptueux son épaisse chevelure et observa à nouveau la salle à la dérobée. On ne sait jamais si un homme vous contemple ! Elle sirota son diabolo menthe avec application. Une sortie, quoique sans éclat, demeure néanmoins une sortie. C’était mieux que de traîner à la maison où elle risquait de voir sa tante lui coller une corvée sur le dos ! À travers ses longs cils baissés, elle examina les consommateurs appuyés au comptoir. À ses côtés, Marie et Annie papotaient, indifférentes à la présence masculine et au brouhaha ambiant. Nicole écouta leur conversation distraitement, néanmoins suffisamment pour saisir qu’elles parlaient chiffons, et elle reprit son étude en soupirant. Elle avait rapidement enregistré que la moyenne d’âge des personnes présentes était élevée et que celles-ci n’offraient pas un grand intérêt. Des agriculteurs pour la plupart ! Il y avait aussi deux hommes qui s’entretenaient des cours du bétail en vrais maquignons, quelques commerçants et ouvriers qui passaient se rincer le gosier avant de reprendre le travail et plusieurs vieux qui se tapaient une interminable partie de belote. Beaucoup fumaient et l’ambiance était décontractée et bruyante. Deux femmes seulement figuraient parmi les clients. Elles bavardaient, légèrement à l’écart. Ces fermières, la couperose, comme la quarantaine, bien avancée, étaient attablées devant un thé d’Aubrac. À cet âge vénérable, elles n’étaient plus des concurrentes ! Une gamine boutonneuse et aux seins plats, à la mine insignifiante, s’activait au service. Sans hésitation, Nicole décida que celle-là aussi entrait dans la catégorie « hors concours » et qu’elle ne représentait donc aucun danger, elle non plus. Un garçon, à l’allure de grand benêt, s’occupait du bar. Elle le classa au rang des « puceaux, enfants de chœur »… Une quantité négligeable, à ignorer. La patronne, vêtue de noir, assise droite comme un i sur son haut tabouret, tenait la caisse avec un œil perçant qui notait tout. Elle avait les lèvres fines et serrées, des yeux en fente de tirelire et le menton en galoche. Vu son habillement, et surtout son regard dur et sévère, la jeune fille jugea qu’il devait s’agir d’une veuve et d’une vraie bourrique. À éviter ou à surveiller de près ! Soudain, à travers l’épais voile de fumée bleue, Nicole remarqua un individu qui, faute de mieux, paraissait offrir des possibilités. Celui-ci semblait fixer leur table avec insistance. L’appréciation de la citadine fut rapide : de vingt à vingt-cinq ans, robuste, pour ne pas dire en léger surpoids, un visage commun et peu gracieux, les cheveux coupés trop courts, de taille très moyenne… En ville, elle ne l’aurait pas regardé deux fois. Cependant, dans ce village, une belle brune comme elle ne pouvait pas se permettre de faire la difficile. Pour attirer son attention, elle lui adressa un sourire charmeur et un regard plein de promesses. En sourdine, elle se pencha vers ses camarades et se renseigna.
— Qui est ce quidam, accoté au bar, qui n’arrête pas de lorgner par ici ? Ma parole, j’ai l’air de drôlement l’intéresser !
Les deux amies se retournèrent vivement et scrutèrent dans la direction indiquée.
— Celui-là ? Penses-tu ! Ce n’est que Pierre Rouillac, le fils de la patronne, expliqua Marie en pouffant. C’est un timide et en plus un taiseux. Que je sache, il n’est jamais sorti avec quelqu’un de sa vie. Remarque, à moins qu’une gazelle du désert ne l’ait dépucelé pendant son service militaire en Algérie… Il ne saurait pas quoi faire d’une fille, de toute façon ! Attends, on va rigoler !
Elle fit de grands gestes dans sa direction en s’esclaffant d’un rire chevalin et sonore. Deux anciens, penchés sur leurs cartes à la table voisine, froncèrent les sourcils, contrariés d’avoir été déconcentrés dans leur partie par ce hennissement nerveux. Depuis l’arrivée de Nicole, le vocabulaire et le comportement de Marie avaient subi des transformations. L’influence de sa cousine s’exerçait fâcheusement sur elle. Annie se fit la réflexion que les parents de son amie ne remercieraient pas leur nièce s’ils s’en apercevaient ! Voyant qu’on lui faisait signe, il n’en fallut pas plus au jeune timoré pour qu’il se décide à traverser la salle et à les aborder. Après une rapide poignée de main à Nicole et un baiser sommaire à Marie, il se détourna d’elles et les ignora. En revanche, il embrassa affectueusement Annie sur les joues et la serra dans ses bras…, un tantinet plus longuement que nécessaire, estimèrent les cousines in petto.
— Bonjour, Pierre. Tu es revenu ! Cette fois, c’est donc la quille ? s’enquit l’heureuse élue, visiblement contente de le revoir, elle aussi.
Rouge de confusion, il s’éclaircit la gorge et se frotta la tête récemment dégarnie par les bons soins d’un des « coiffeurs » sadiques de l’armée française.
— Oui, je… viens d’être démobilisé.
Marie prit les devants et l’invita à s’asseoir avec elles. Il obtempéra, les yeux rivés sur Annie. Il n’ajouta rien à la conversation qui suivit, si ce n’est pour répondre succinctement aux quelques questions aimables que celle-ci lui posa par politesse. Puis il leur offrit une deuxième consommation et s’éclipsa. Sa mère l’appelait. En la suivant, il disparut dans la cuisine derrière le bar.
Nicole se fit l’amère réflexion que, si elle-même avait envisagé de se mettre ce balourd dans la poche, elle avait inexplicablement et lamentablement échoué. Malgré sa bouche rouge et humide à souhait et ses jeux savants de sourires aguichants, entrecoupés de battements de cils papillonnants, ce grand dadais semblait lui préférer une des deux cruches qui lui servaient de repoussoir !
— Eh bien, Annie ! On peut dire que tu as un ticket ! Ce type est raide dingue de toi ! assura-t-elle avec un brin de jalousie après le départ de l’ancien soldat. On voit bien qu’il meurt d’envie de t’embrasser.
— Mais tu rigoles, non ? s’écria Marie, horrifiée. Annie et Pierre sont comme frère et sœur depuis des années. Si jamais Annie l’embrassait, ce serait un cas d’inceste. Je te jure ! En plus, elle n’en voudrait pas, de ce garçon ! Pas plus qu’aucune autre fille du village, d’ailleurs. Ce fada n’a jamais rien à dire, tu n’as pas remarqué ? Il a ce regard stupide qu’ont les moutons de mon père ! De plus, sa mère l’appelle et il accourt comme un toutou !
— Ne parle pas de Pierre comme ça ! lui intima Annie avec humeur. Il est peut-être timide, mais il est brave et pas bête du tout ! Qu’est-ce que tu veux ? Ce n’est pas sa faute si, depuis qu’elle est veuve, sa mère l’a toujours couvé. Elle a dû s’apercevoir qu’il nous parlait et cela ne lui aura pas plu. Le pauvre a beau avoir vingt-deux ans, elle lui met toujours le grappin dessus !
* * *
André Marciac, un garçon de ferme, quitta le bureau de poste sans se hâter, les mains dans les poches, la casquette crânement penchée sur un œil, et il se dirigea vers le café le plus proche. D’une des cabines des PTT, il venait de téléphoner à Espalion pour demander au vétérinaire de monter de toute urgence à l’exploitation « du Marques ». Connaissant d’expérience le comportement hautain et peu pressé de ces messieurs en costume-cravate et belles chaussures, André savait qu’il disposait largement du temps nécessaire pour aller boire un verre, voire deux. Cette heure volée à son patron ne le faisait pas culpabiliser outre mesure. C’était de bonne guerre. N’était-il pas resté dans la grange jusqu’à minuit passé, auprès de la pauvre Rousselle ? Arrivé devant la porte du bistrot, il fut hélé par une nouvelle connaissance, un ouvrier qui sortait des jardins d’en face et qui descendait la rue. Sans s’arrêter pour autant, André se retourna et lui lança un mot doublé d’un geste amical en réponse à son salut. Annie quittait le café. Elle aussi se retourna pour adresser un dernier geste d’adieu à ses amies, encore assises près de la fenêtre. Le choc frontal fut rude et inévitable. André poussa un juron, Annie cria de douleur. Ils se retrouvèrent dans les bras l’un de l’autre, déconcertés par cette entrée en matière. Devant le comique de la situation, il leur sembla qu’il valait mieux en rire. Ce qu’ils firent en se massant chacun la tête.
— Ben, dis donc, tu as la caboche dure, toi ! gémit Annie.
— Et toi…, me semble que tu as la cafetière en béton !
Comme elle descendait les quelques marches, il fit volte-face et lui emboîta le pas.
— Attends, ne te sauve pas comme ça ! Je vais peut-être avoir besoin des premiers secours. C’est que… tu m’as fait très mal !
Il exagéra sa faiblesse et fit mine de s’affaisser contre elle.
— Ma parole, tu ne manques pas de culot ! C’est plutôt à moi de me plaindre !
Ils se jaugèrent d’un regard espiègle, avec un sourire en coin, et ils s’apprécièrent mutuellement. Elle se dit qu’elle n’avait jamais vu un si beau garçon. Lui s’aperçut que cette gamine avait de magnifiques yeux brun doré, un minois rose et frais, et, surtout, qu’elle avait un corps gracile et, ma foi, bien appétissant. D’autorité, il s’empara de son panier et, tout en marchant à ses côtés, il entama un dialogue destiné à la faire rire.
— Je m’appelle André, ce qui, d’emblée, paraît un prénom bien trop ordinaire pour un gars aussi spécial que moi. Mais, au moins, il a le mérite d’être facile à retenir. Remarque, si jamais tu venais quand même à l’oublier, il existe plein de mots qui me décrivent parfaitement : élégant, intelligent, magnifique, beau comme un dieu, séduisant, splendide, intéressant… La liste est longue ! Oh ! J’oubliais : modeste, discret, humble… Tu vois ? Tu ne risques pas de m’oublier.
Comme prévu, elle éclata de rire, étonnée par ce langage inusité chez les jeunes gens qu’elle avait jusqu’alors rencontrés.
— Autant te le dire tout de suite, poursuivit-il sur un ton plus sérieux, je suis un gars de l’Assistance et j’ai déjà traîné dans pas mal d’endroits avant d’atterrir ici. Je viens de débarquer, il y a à peine un mois, ce qui explique que je ne t’avais encore jamais vue. Sinon, tu parles, je m’en serais souvenu !
Ils débouchèrent sur la place de la mairie, où jouait, en hurlant, une nuée de gamins en culottes courtes. D’un coup de pied magistral, André envoya leur ballon au loin. Les gosses coururent pour le récupérer. Le calme revenu, il demanda à Annie où elle se rendait d’un pas si déterminé.
— Je remonte chez moi, à Régaussou, pour dîner.
Du menton, elle indiqua vaguement les hauteurs, devant eux, de l’autre côté de l’église.
— C’est une ferme ? Je travaille par là aussi, à l’exploitation du Marques.
— Non, c’est un hameau reculé, à une heure d’ici.
— Ah ! mince ! Moi qui aurais aimé te raccompagner chez toi ! Malheureusement, j’attends le vétérinaire d’un moment à l’autre pour une de nos vaches et je dois rester dans les parages.
Lorsqu’ils parvinrent à un embranchement du chemin, elle reprit timidement la parole.
— Je crois que c’est ici que nos voies se séparent ! Toi, tu dois descendre par là et moi je vais prendre ce sentier qui monte vers les bois et qui me conduira vers ma maison. J’ai l’habitude de couper à travers champs au lieu de suivre la route, c’est beaucoup plus court.
Elle tendit la main vers son panier.
— Attends ! Bon sang, t’es vraiment si pressée ? Tu t’appelles comment, au fait ?
— Delmas… Annie Delmas.
— Eh bien, écoute-moi, Annie Delmas. J’aimerais te revoir. Qu’est-ce que tu fais, là-haut dans ta ferme ?
— Je m’occupe de la volaille et du potager.
— C’est tout ?
— Mais non, voyons ! Je prépare la soupe des cochons, je garde les vaches aux prés, j’aide aussi ma mère à la cuisine et au ménage, je fais des lessives et des corvées d’eau…
— Oui, bon, je vois que tu es bien occupée.
— Ma mère m’a même appris à faire le pain et à tricoter des bas !
— Mais, apparemment, tu descends bien au village de temps en temps ? Je me trompe ?
— En effet, je descends une ou deux fois par semaine. Surtout le dimanche pour aller à l’église.
— Eh bien, voilà ! On se voit dimanche prochain après la messe ? Qu’est-ce que tu en dis, toi ?
Elle rosit de plaisir et hocha la tête, sans toutefois oser répondre…, mais, pour André, son visage ébloui en disait long ! Il plissa les yeux de satisfaction et, fier comme un Gascon, il lui appliqua d’office un baiser sonore sur chaque joue. Après un dernier signe amical de la main, il s’éloigna, de la démarche assurée d’un jeune conquérant, vers la ferme de ses patrons. Quand il eut disparu au bout du chemin, Annie agrippa sa gorge d’une main tremblante et respira profondément. Elle étouffait ; l’air lui manquait ! Elle se dit qu’elle avait sans doute retenu sa respiration depuis le moment de leur rencontre ! Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine et elle fut prise de vertige. Elle s’aperçut avec étonnement que la brise lui remplissait à présent les poumons d’un nouveau et doux parfum qui la fit frémir. Les arbres, l’herbe et les roses autour d’elle se mirent à dégager une odeur cent fois plus puissante que de coutume. Le soleil de juin, haut dans le ciel mais pourtant encore timide, lui brûla subitement la peau de mille feux. Transportée par une joie indicible, elle soupira d’aise devant ces phénomènes surprenants. C’était donc cela, le fameux « coup de foudre » ?
* * *
Comme prévu par l’almanach, l’été et les chaleurs suffocantes étaient arrivés en avance et s’étaient installés au pays depuis de longues semaines. Fort heureusement, les foins fournis et odoriférants, si abondants cette année, avaient été coupés et rentrés au sec sans subir les effets dévastateurs de la grêle ou de l’orage. Quant à la précieuse moisson dorée de blé, d’avoine, de seigle ou de sarrasin, elle était amassée dans des montagnes de sacs, empilés à l’abri eux aussi. Les granges étaient pleines à craquer, jusque sous leurs toits ! Elles exhalaient une agréable odeur de miel et de fleurs séchées. Le soleil, qui s’infiltrait par les interstices de leurs murs en planches mal jointées, éclairait des millions de particules poussiéreuses en suspension qui voltigeaient dans l’air étouffant. À la vue de cette belle récolte, désormais protégée des intempéries, les agriculteurs, tributaires du climat et toujours sur le qui-vive, pouvaient respirer, rassurés. Ils tiendraient tout l’hiver ! Les quelques grains de céréales oubliés au sol dans les champs dénudés feraient le bonheur des oiseaux et des rongeurs.
Depuis peu, on avait vu apparaître, par-ci par-là, dans certaines des exploitations les plus prospères du pays, un petit nombre d’engins agricoles, venus d’outre-Atlantique pour la plupart. Comme de grands volatiles tropicaux, ces machines s’étaient posées sur les champs blonds et ambrés ; rouges, vertes ou orange, elles se distinguaient de loin par leurs vives couleurs brillantes. Ce phénomène, nouveau et inquiétant pour une partie des paysans, avait engendré de multiples polémiques dans les cafés. Était-ce le début d’une nouvelle ère moderne et florissante à l’américaine ou plutôt la fin d’une époque ancestrale ? Dans un avenir proche, les McCormick, Harvester, John Deere ou Massey Ferguson allaient-ils épargner des heures de labeur aux fermiers aveyronnais ou mettraient-ils au chômage des centaines d’ouvriers agricoles ? Forcément les deux à la fois, c’était évident ! C’est du moins ce qu’affirmait André Marciac, du haut de ses dix-sept ans. « Ces tracteurs, ces faucheuses et ces moissonneuses-batteuses motorisés, Dieu merci, ne rentrent pas facilement dans les petites parcelles entourées de haies et de murs en pierre qu’on a par ici. Mais, tôt ou tard, obligés de fournir un meilleur rendement, nos fermiers les plus modestes devront mieux s’équiper. Chez les notaires ou les banquiers, tous des rapaces, ils obtiendront de lourds emprunts et s’endetteront pour de longues années en achetant ces machines. Ils seront alors contraints de renvoyer la plupart de leurs garçons de ferme, devenus inutiles. Ceux qui ne voudront pas ou ne pourront pas s’acheter ces engins modernes, eh ben, ils seront forcés de vendre leurs terres à de riches exploitants. Oh, je ne dis pas que ça se passera demain ! Mais dans quelques années, oui. Et pas tant d’années que ça, tu verras ! Des gars comme moi, qui n’ont pas de terres et pas d’argent pour s’en acheter, ma foi, il faudra qu’ils changent de métier ! »
Lui et Annie s’étaient vus, après la messe, chaque dimanche de l’été, et, ce jour-là, comme à chaque fois, elle l’écoutait, émerveillée par ses connaissances. Comment un jeune orphelin, élevé par l’Assistance publique, avec seulement un brevet en poche, pouvait-il en savoir autant ? Elle lui posa la question.
— Comme je te l’ai dit en juin, au tout début de notre rencontre, j’ai pas mal bourlingué et discuté à droite et à gauche ! lui répondit-il avec un soupçon de suffisance.
Encouragé par le regard admiratif de la jeune fille, il lui apprit qu’il n’avait pas toujours été valet de ferme. D’abord embauché comme apprenti forgeron à Brive-la-Gaillarde, il avait quitté son patron pour entrer chez





























