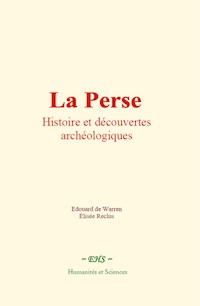
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Ce livre retrace l’histoire ancienne de la Perse et explore les informations issues des découvertes archéologiques.
La Perse proprement dite n’apparaît pas dans l’histoire en des siècles aussi reculés que les plaines arrosées par le Tigre et l’Euphrate. Mais par les conditions géographiques du milieu, la Perse est antérieure, pour ainsi dire, à la Mésopotamie ; il est donc impossible qu’elle n’ait alors fourni des hommes.
L’histoire ancienne de ce pays était encore à étudier lorsque le baron de Bode pénétra dans ces contrées négligées trop longtemps par la science, à la faveur de circonstances exceptionnelles. Dans la région montagneuse de la Perse, entre les deux chaînes neigeuses de l’Alvend et de l’Ardekan, s’étend depuis la frontière turque à l’ouest jusqu’aux limites des provinces d’Ispahan et de Fars, à l’est et au sud-est, le pays désigné sous le nom de Louristan, que les voyageurs et les savants ont laissé jusqu’à ce jour dans un oubli presque complet. Au sud de l’Ardekan, entre les premières pentes de cette chaîne et les rives septentrionales du golfe Persique, un autre pays, qui n’est guère plus connu que le premier, porte le nom de Khouzistan, ou, plus communément, d’Arabistan, parce qu’il embrasse le territoire des Arabes de la tribu Chaïb. Le livre du baron de Bode, écrit en vue d’un public restreint et tout spécial, est de ceux qui, sans attirer l’attention de la foule, prennent silencieusement leur place dans les bibliothèques scientifiques…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Perse : histoire et découvertes archéologiques.
La Perse
Histoire et découvertes archéologiques
Les terres de la Perse.{1}
La Perse proprement dite n’apparaît pas dans l’histoire en des siècles aussi reculés que les plaines arrosées par le Tigre et l’Euphrate. Mais par les conditions géographiques du milieu, la Perse est antérieure, pour ainsi dire, à la Mésopotamie ; il est donc impossible qu’elle n’ait alors fourni des hommes.
En effet, les marais fétides dans lesquels s’épanchaient les fleuves en crue et qui se desséchaient au soleil lors de la décrue furent d’abord complètement inhabitables ; la culture qui se fit par degrés, refoulant devant elle la brousse et le marécage, descendit graduellement des vallées persanes. Les colons suivant la pente du sol par les campagnes salubres qui bordent les torrents furent les premiers éléments ethniques des plaines basses ; à eux le mérite d’avoir régularisé les fleuves et les coulées, d’avoir transformé les brousses en vergers et en champs, d’avoir créé un foyer de progrès en un lieu chaotique, meurtrier pour l’homme. Peut-être est-ce à cet état de choses que fait allusion l’antique légende chaldéenne, appropriée depuis par les Hébreux : « Tout était informe et vide » ! Mais l’agent ordonnateur fut l’émigrant descendu de la montagne.
La partie occidentale du plateau d’Iranie, celle qui, dans le langage moderne, a pris le nom de Perse, est de forme plus régulière et plus « une » que la partie orientale : son histoire devait en conséquence se dérouler d’une manière plus égale et plus majestueuse. Aux époques primitives, lorsque les peuplades constituées en des milieux géographiques voisins gardaient leur existence indépendante, quelques parties du territoire iranien échappaient à cette unité historique. Mais, à ne considérer que le plateau proprement dit, on constate que, dans son ensemble, il est admirablement disposé pour former un ensemble politique très solide. Au nord-ouest, plusieurs massifs montagneux surveillent, comme autant de citadelles, les défilés, les cols et les hautes vallées par lesquels auraient pu se glisser les envahisseurs venus des régions caucasiennes. Sur toute la longueur du front occidental s’alignent, en un large rebord, les plissements des monts qui dominent les plaines de la Mésopotamie. D’autres chaînes bordières, partant de l’angle sud-oriental de la Caspienne, limitent la Perse au nord-est et la séparent des sables et des terres alluviales qu’arrose l’Oxus en un étroit, ruban de cultures. Du côté de l’est, de vastes solitudes, inhabitables dans une grande partie de leur étendue, séparent le triangle occidental de la Perse et le labyrinthe des vallées orientales que peuplent les Afghans.
Enfin, deux mers baignent les racines du plateau : au nord, le bassin profond de la Caspienne qui se prolonge vers les froidures boréales jusqu’en des espaces si lointains que jadis ils pouvaient paraître infinis ; au sud, le golfe en demi-cercle qui va rejoindre l’océan des Indes aux rivages longtemps inconnus. Très puissantes pour l’attaque, les populations qui occupaient les hautes terres de l’Iran et qui en gardaient les portes du côté de l’Euphrate avaient d’autre part l’immense avantage d’être presque inabordables sur une grande partie de leur mur d’enceinte : partout des obstacles, des parois inaccessibles, des sables brûlants, des baies entourées de roches arides. Si des pirates étrangers débarquaient en foule sur les côtes méridionales, devant eux se dressaient les escarpements des monts en étages successifs ; quand des pillards nomades pénétraient au nord par petites bandes sur les hauteurs du plateau, bientôt ils venaient se heurter contre d’épaisses masses d’hommes et reprenaient en hâte le chemin de la plaine.
Avant Alexandre, aucun conquérant venu de l’Occident n’avait réussi à s’installer en maître plus loin que le bord du plateau.
Ce rigide isolement géographique devait faire de l’Iran le siège d’empires très énergiquement constitués. C’est là que prit naissance, après bien d’autres États que ne mentionne pas l’histoire, l’empire des Elamites dominés par leurs puissants Nakhonte ; puis on y vit surgir la royauté des Mèdes, celle bien autrement grandiose de Cyrus et de ses successeurs les Akhéménides ; c’est là aussi qu’après les expéditions triomphantes d’Alexandre le Macédonien se groupèrent les Parthes en une nation très vigoureuse qui tint tête aux Romains, puis là que se forma la dynastie des Sassanides, devant lesquels vint se briser complètement la fortune de Rome. Après l’invasion des Mahométans, d’autres dynasties se fondèrent sur le plateau d’Iran, et de nos jours encore, le royaume iranien, connu du nom de Perse, d’après l’une de ses provinces, a gardé ses frontières naturelles, quoique, au temps actuel où la science militaire est si puissamment servie par les forces industrielles, les anciennes conditions du relief et du climat aient singulièrement perdu de leur importance, et que ce territoire, devenu relativement petit dans l’immense tourbillonnement de l’histoire humaine, ne soit plus qu’un simple enjeu entre l’Angleterre et la Russie.
L’Iranie fut aussi l’une des contrées où se préparèrent en partie les éléments les plus précieux de notre avoir intellectuel et nos progrès futurs. Qu’on se rappelle l’influence de la Perse dans l’évolution religieuse par la religion du feu, par celle de Zardoucht ou Zoroastre, par les Manichéens, le mahométisme chiite et les Babi ; son rôle dans le mouvement lyrique de la pensée avec les Saadi, les Hafiz, les Firduzi ; sa grande activité dans les arts, encore prépondérante dans tout l’Orient, de l’Inde à la Turquie.
Les montagnes qui se profilent en arêtes parallèles le long du rebord sud-occidental de l’Iran constituent autant de murs d’enceinte difficiles à traverser, les rivières nées dans l’intérieur du labyrinthe n’échappant à leur prison que par une série de défilés étroits, de « cluses » qui se succèdent par de brusques coupures à angle droit, inaccessibles pour la plupart ; les sentiers d’escalade passent presque tous par les brèches des hautes murailles ; pour aller d’un lieu des terres élevées vers une partie de la plaine inférieure située pourtant dans un même bassin fluvial, les bergers peuvent avoir à faire jusqu’à vingt ascensions et autant de descentes ; d’ailleurs, nuls autres que les montagnards ne pourraient se hasarder en de semblables contrées, pardessus des crêtes qui dépassent en certains endroits la hauteur de 4000 mètres. Le nom de Zagros, que l’on donne encore à ces montagnes, vient, dit-on, de l’arabe Zaghar, qui signifie « défilé étroit entre de hautes montagnes, à la frontière d’un pays ennemi ».
Il en résulte que les habitants de l’âpre région, les Bakhlyari, restèrent pratiquement indépendants pendant toute la période historique ; ils l’étaient probablement autant aux époques antérieures qu’ils le sont aujourd’hui. En cet Orient que l’on dit voué à l’esprit monarchique héréditaire, on constate l’existence de républiques fédérales se maintenant de siècle en siècle. Les annales mentionnent, il est vrai, les Lur et les Bakhlyari comme assujettis tantôt au Chaldéens, tantôt aux Assyriens, aux Elamites ou aux Perses ; mais quelques offrandes apportées en grande et respectueuse cérémonie suffisaient à la vanité des suzerains, et ceux-ci, satisfaits de l’hommage, se gardaient bien d’attaquer les Bakhlyari dans leur multiple forteresse aux cent remparts, aux défilés impraticables. Au contraire, les princes akhéménides, dans tout l’éclat de leur puissance, payaient un droit de passage aux Cosséens ou Bakhtyari quand ils voulaient se rendre d’Ecbatane à Babylone ou de Persépolis à Suse.
Ces montagnards redoutés restent d’autant plus facilement maîtres chez eux qu’ils ont gardé plus de mobilité dans leurs allures, étant successivement nomades comme pasteurs de bétail, puis résidants fixes comme agriculteurs ; ils transhument du haut en bas de la montagne, plusieurs fois par année, suivant les saisons, et peuvent, à l’occasion, se grouper en troupes considérables ou se disperser comme des chamois entre les précipices. À ce genre de vie ils ont gagné un grand esprit de liberté, un fier sentiment d’indépendance égalitaire qui les portent facilement à mépriser des voisins moins favorisés par la nature. Leur nom de peuple, qui signifie « heureux », « vaillant », « invincible », témoigne des causes qui leur ont valu la liberté et leur ont donné la belle fierté d’allure et la clarté du regard. Ils consentent parfois à servir comme volontaires dans l’armée persane, mais à condition de rester ensemble et de ne pas être distribués en divers régiments. Dès que leurs droits héréditaires sont lésés, ils se mettent en insurrection et souvent ils descendirent en vengeurs sur les cités des alentours. Ils n’accueillent aucun fonctionnaire dans leurs montagnes, mais ils sont très gracieux et prévenants pour l’étranger, et quelques Anglais, même une Anglaise, depuis 1890, ont profité de cette bonne hospitalité pour aller passer chez eux la villégiature estivale.
Quoique les Bakhtyari se ressemblent beaucoup, par suite des conditions du climat et du genre de vie imposé par la nature, quoiqu’on leur trouve « comme un air de famille », ils appartiennent à des groupes ethniques différents, et c’est encore le relief orographique de la contrée qui explique ces diversités. On trouve quatre nationalités distinctes chez les Suisses : Allemands, Français, Italiens, Romanches ; il en existe au moins autant chez les Bakhtyari. Les uns paraissent être de purs Aryens, d’autres sont incontestablement d’origine sémitique. La plupart sont considérés comme étant de sang turc ; enfin, il en est qui ont plutôt le type mongol, et de nombreuses sous-variétés indiquent le mélange en des proportions changeantes.
Mais ces peuples d’origine multiple parlent tous des dialectes à type persan, grâce au génie iranien qui les a civilisés. La grande variété des populations dans le pays des Bakhtyari s’explique par le mouvement des guerres qui se sont produites autour de leurs massifs. Suivant les vicissitudes des victoires et défaites, des tribus et des armées de nationalités très différentes ont été refoulées des avant-monts ou des plateaux et se sont cantonnées dans ces forteresses naturelles du pays d’Elam : des traditions locales racontent la venue de ces groupes originairement distincts et souvent superposés en suzerains et en vassaux suivant un mode féodal. L’induction historique rapproche maintenant les termes Bakhtyari, Bactriane et la famille des Bak pénétrant en Chine, mais les inscriptions des conquérants mentionnent rarement ces habitants des hautes cluses qui ne recherchaient pas la vie plus facile des plaines, et qu’épargnaient aussi les horreurs de la guerre. Les annales des grands empires, élamite, babylonien, assyrien, mède, perse, ignorent ces résidus humains vivant à l’abri de la gloire.
A part ces populations et quelques autres moins considérables, auxquelles le relief de la contrée permet de se maintenir dans un isolement relatif, les habitants des hautes terres iraniennes devaient, par la facilité des contacts et des croisements, s’unir sans peine en un seul corps de nation. Mais cette unité politique correspondant à l’unité géographique du plateau n’implique nullement l’unité de races parmi les éléments ethniques venus spontanément ou amenés des régions diverses du pourtour. Au contraire, ces éléments présentaient originairement de très grands contrastes, et il ne pouvait en être autrement puisque les contrées avoisinantes diffèrent beaucoup par le sol et le climat ; montagnes de l’Arménie et plaines basses de la Chaldée, vallées arides du Mekran et rivages brûlés du golfe Persique, régions sablonneuses où coule l’Oxus et steppes de la Caspienne, autant de pays à natures opposées ayant pour habitants ici des agriculteurs, là des nomades, ailleurs des pillards, gens les plus divers par le langage, les traditions et les mœurs, nègres et Sémites, Aryens et Touraniens.
Mais ces habitants de toute provenance, que les événements complexes de l’humanité ont fait se rencontrer sur le plateau de l’Iranie occidentale, y ont subi une transformation plus ou moins rapide de leur nature première, et toute la masse humaine formée de ces éléments divers a été repétrie en une pâte nouvelle. Les montagnards descendus des hautes vallées neigeuses, les riverains montés du littoral aride et brûlant se sont, les uns et les autres, mais en sens inverse, accommodés au climat, nouveau pour eux, de ces terres baignées dans un air léger.
Cascades de top-é-kazab dans les montagnes des bakhtyari.
D’après une photographie de J. de Morgan (Mission archéologique en Perse.)
En son entier, la Perse se trouve comprise dans la zone dite tempérée, quoique certaines parties de ses côtes, le long des mers indiennes, doivent une température brûlante à la direction des vents, au manque de pluies et à leur exposition aux ardeurs du midi. D’après le tracé, en très grande partie hypothétique, des lignes isothermes, la température moyenne de la Perse serait à peu près la même que celle de la France, située pourtant beaucoup plus au nord, mais ayant une moindre altitude et se trouvant bien exposée aux courants aériens et océaniques du sud-ouest. Or, cette température moyenne, avec balancement annuel de fortes oscillations saisonnières du froid au chaud, est de celles que l’expérience de l’humanité indique comme l’une des plus salubres et des plus favorables au développement intellectuel des populations. Ces conditions physiques du milieu, présidant au mélange des éléments ethniques distincts qui venaient s’entre-choquer puis s’unir sur les hautes terres d’Iran, contribuèrent à déterminer ce beau type persan, l’un de ceux qui, avec celui des Géorgiens et des Circassiens, se rapprochent le plus de la beauté telle que nous la comprenons : les mêmes causes façonnèrent aussi le génie iranien, si remarquable par la souplesse et la clarté de la compréhension. Les enfants des écoles, groupés sur les nattes, ravissent d’admiration le voyageur européen : leurs yeux brillent d’une ardeur intelligente, et ils secouent leur petite tête frisée avec des gestes les plus spirituels et les plus charmants.
L’espace trapézoïdal de la Perse, compris entre les remparts inégaux des monts, n’est pas également bien aménagé par la nature pour l’heureuse floraison de la « plante homme ». Loin de là ! Une très forte part de ces hautes terres consiste en étendues rocheuses, argileuses, sableuses ou salines complètement inhabitables. Le plateau se creuse vers son milieu d’une cuvette aux pentes douces descendant jusqu’à une altitude de 300 (140 ?) mètres seulement au-dessus du niveau de la mer. Des rivières coulaient autrefois vers cette dépression médiane ; une mer intérieure ou du moins un vaste lac emplissait la cavité ; mais la dessiccation générale du climat a vaporisé ces nappes d’eau, tari ces rivières, stérilisé ces espaces par les efflorescences salines, et la population a dû se borner à l’occupation des vallées herbeuses et des zones fertiles qui longent la base des monts. Même entre les arêtes parallèles de plusieurs des chaînes montagneuses qui se succèdent dans la partie sud-occidentale du plateau, s’étendent çà et là des espaces sans eau où l’homme n’a pu s’établir. Si le moulin à vent est d’origine persane, comme le disent les indigènes, la raison en est au souffle constant qui balaie violemment les vastes étendues désertes et les pitons isolés au milieu des anciennes mers.
En étudiant les contours de ces régions forcément stériles de l’Iran, on constate que, dans l’ensemble, elles occupent avec leurs annexes les terres les plus basses, affectant une forme à peu près triangulaire vers le centre, le sud et l’est du pays. D’autre part, les régions fertiles, invitant l’homme à la résidence et à l’agriculture, sont disposées en deux bandes se rencontrant sous un angle aigu dans la partie nord-occidentale du plateau.
Ce territoire s’enfonce sur un espace de plus de 500 kilomètres entre deux rangées de hautes montagnes ; de puissants massifs le limitent également au nord, les cônes de volcans isolés dont l’un est, à certaines saisons, complètement entouré par les eaux du lac d’Urmiah, se dressent çà et là ; un grand nombre de passages divergent de l’Azerbeïdjan vers tous les pays du pourtour, à l’est vers les côtes de la Caspienne, au nord vers la vallée de l’Araxe, à l’ouest vers le lac de Van, au sud-ouest vers le Tigre et l’Euphrate. Ainsi les pêcheurs riverains de la mer, les agriculteurs et les bergers des contrées transcaucasiennes, les montagnards karduques et arméniens des massifs occidentaux avaient de fréquentes occasions de se mêler ou de se heurter aux habitants de l’Atropatène et aux immigrants venus des contrées méridionales ou orientales de l’Iran en suivant la base des montagnes.
La juxtaposition des deux bandes de culture et de population qui se rejoignent en cette contrée ne pouvait manquer de lui donner une vitalité puissante, comparable aux flammes vives jaillissant au contact de deux braises. En outre, la diversité des éléments ethniques réunis dans l’avenue des montagnes, entre les sommets « divins », Demavend, Elvend, Savalan, Ararat, devait faciliter la naissance d’une grande civilisation. Là, dans le triangle Téhéran, Tabris, Hamadan, se trouva le centre de gravité de tout le monde médique et persan qui s’était installé sur le plateau d’Iran, et là il se trouve encore.
Grâce à ses découvertes sur l’orientation géographique des noms cités dans les Veda, Brunnhofer crut pouvoir affirmer que les Aryens qui chantèrent les anciens hymnes habitaient précisément ces régions de l’Atropatène et les contrées voisines, à l’ouest vers l’Arménie, à l’est vers le Khorassan.
Le volcan éteint que l’on appelle actuellement Savalan est le seul mont du haut duquel ou puisse apercevoir à la fois la mer — la Caspienne —, le cours du fleuve Rasa — l’Araxe — et les glorieux sommets neigeux de l’Himavat — l’Albordj ou Elburz. Le Savalan n’est autre que l’Açnavanta où se fit la révélation divine pour les fidèles de Zoroastre; ce fut une montagne plus sainte encore que le Demavend et l’Ararat, ou plutôt la sainteté, comme une flamme, voyagea de cime en cime en même temps que les porteurs de torches qui cheminaient à leurs bases.
Des deux zones iraniennes convergeant vers l’angle de l’Atropatène, l’une, celle qui, de l’est à l’ouest, suit la base méridionale du Caucase iranien et de l’Elburz, a pris dans l’histoire une importance de premier ordre, grâce aux voies naturelles qui la continuent, d’un côté jusqu’aux extrémités de l’Asie, de l’autre vers l’Europe et l’Afrique.
La zone occidentale, qui longe les montagnes bordières dans la direction du sud, doit certainement une grande valeur historique aux relations qu’elle établit entre les diverses provinces de l’Iran, surtout entre la Médie et la Perse proprement dites ; mais la route naturelle finit par se perdre à demi dans les régions presque désertes qui s’inclinent vers le golfe Persique, la mer d’Oman et l’océan Indien, et des voies latérales, descendant à angle droit à travers les montagnes du côté de la Chaldée, détournent à l’ouest le mouvement des peuples et des idées.





























