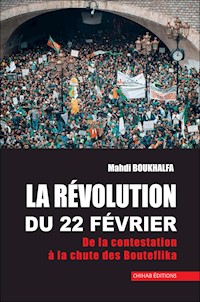
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Chihab
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Le 22 février 2019, les Algériens sont sortis à travers tout le pays dénoncer la volonté d’un président grabataire de briguer un 5e mandat, en dépit du bon sens, son âge et sa santé déclinante. Les Algériens, les partis d’opposition et la société civile sont montés à l’assaut de cette intolérable volonté du pouvoir évoluant en mode prédateur, d’imposer un président pratiquement incapable de diriger le pays. Le président Bouteflika était fini. La colère du peuple contre la nomenklatura et les oligarques qui lui sont affiliés, l’a fait dégager dans un premier temps ainsi que son « clan ». Le Hirak était né, et ces belles manifestations populaires organisées maintenant chaque vendredi depuis cet historique 22 février, montrent à quel point les Algériens ont soif de justice sociale, de démocratie, de bonne gouvernance, de respect des droits de l’homme, de toutes les libertés, qui redonnent à ce peuple sa dignité et sa fierté. Celles pour lesquelles un million et demi de martyrs ont donné leur vie pour que le pays s’affranchisse du joug colonial. Et, après, de toutes les oppressions.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Sociologue-urbaniste de formation,
Mahdi Boukhalfa a débuté en février 1983 une carrière de journaliste à l’APS. En 1990-1991, il intègre successivement les rédactions d’Horizons et El Moudjahid, où il a dirigé plusieurs rubriques. En 2003, il est nommé chef de bureau de l’APS à Rabat. Editorialiste au Quotidien d’Oran, il a été également journaliste puis rédacteur en chef de Maghrebemergent.info.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La révolution du 22 février
De la contestation à la chute des Bouteflika
Mahdi BOUKHALFA
La révolution du 22 février
De la contestation à la chute des Bouteflika
CHIHAB EDITIONS
© Éditions Chihab, 2019
www.chihab.com
Tél. : 021 97 54 53 / Fax : 021 97 51 91
ISBN : 978-9947-39-359-8
Dépôt légal : octobre 2019
Présentation
La tentation de trop, celle de vouloir briguer un 5e mandat au crépuscule de sa vie, à 82 ans, affaibli par une santé déclinante, aura mis fin dans des circonstances populaires épiques au « règne » du président Abdelaziz Bouteflika. Laissant un pays au bord de la crise politique, sociale et financière, avec le recours à la planche à billets pour compléter de maigres recettes pétrolières, le président démissionnaire a cependant réussi le miracle de ressouder le peuple et de lui donner l’envie de croire que le meilleur est à venir pour la nation. Une fraternité retrouvée. Et de se rencontrer chaque fin de semaine pour « vendredire » au pouvoir de partir, et de construire un nouveau pays, un nouvel état, démocratique, appuyé par une bonne gouvernance et géré par les représentants du peuple. Cet ouvrage n’a pas d’autre prétention que celle de rapporter le plus fidèlement possible les péripéties, les événements liés au mouvement populaire du 22 février. Tout comme les interventions des responsables de partis, de mouvements associatifs, du président de la république et du chef d’état major de l’ANP, entre le début du grand mouvement populaire dénonçant le 5e mandat, le 22 février, et la journée du 5 avril, coïncidant avec le 7e vendredi consécutif de manifestations populaires pour le départ du régime de Bouteflika. Car, si au soir du mardi 2 avril le président est parti, il a cependant laissé derrière lui toute l’architecture et les hommes qui l’ont servi, y compris les présidents des deux chambres du Parlement et celui du Conseil constitutionnel. Un espace temporel choisi pour rapporter fidèlement tous les moments et les interventions politiques relatifs au processus de « dégagisme » mené par les Algériens pour débarquer le pouvoir en place, ses symboles, ses hommes, dont le président Bouteflika. Ce présent ouvrage, qui a plus la forme d’un travail journalistique, tente d’être le plus près possible des événements qui se sont déroulés durant la période définie plus haut, consigne et tente d’expliquer ce qui s’est passé durant les grands moments du mouvement du 22 février, jusqu’à la démission du président Bouteflika, le 2 avril et au-delà, au vendredi 5 avril. La raison de la limitation temporelle de ce travail est de donner rapidement au public un premier regard sur ce qui s’est passé entre le 22 février et le 5 avril 2019, d’une part, et, d’autre part, de livrer un premier travail, un premier aperçu non exhaustif de ce qui s’est passé durant ce premier acte du mouvement populaire. Premier acte, car la démission du président Abdelaziz Bouteflika n’est pas en soi la fin de ce mouvement populaire qui ne cesse de répéter qu’il faut que tout le système parte, depuis la première sortie de manifestants à Bordj Bou Arrerdij et Jijel, avec la force de dizaines de millions de marcheurs qui égaient chaque vendredi, depuis presque quatre mois maintenant. L’objectif des Algériens est de faire partir tout le système de gouvernance actuel, ses hommes et leurs procédés maffieux de gestion des biens du peuple, et de construire un état moderne, démocratique, avec des élites et des responsables à la hauteur de leur mission. Un état de démocratie et de bonne gouvernance, qui encourage et protège l’éclosion du savoir, l’innovation, la production de biens et la juste rétribution du travail de tous, selon la compétence et les efforts de chacun. Un état de justice sociale, la fin de la « Hogra », un pays tourné vers l’avenir. Durant les grands moments du mouvement populaire, un seul souhait, un seul objectif des Algériens : que leur pays redevienne ce que les promesses politiques de l’indépendance avaient fait miroiter au peuple, enfin libéré de 130 ans de colonisation. Ce travail reviendra également sur les revirements et les « retournements de vestes », le lâchage du président, les déclarations mortellement patriotes de certains responsables de partis, leur soutien inconditionnel à la feuille de route qu’a tenté d’imposer aux Algériens un dirigeant à la santé défaillante. Un chef d’état qui a tenté de jouer les prolongations en annulant les élections, ce qui n’est spécifié dans aucun article de la Constitution plusieurs fois modifiée durant ses 20 ans à la tête du pays. La résistance de ses citadelles de soutiens sera également consignée dans ce travail, FLN et RND en tête jusqu’à ce que la pression de la rue et la contestation interne ne les fassent revenir en arrière, et voir la réalité de la situation : Bouteflika est un président doublement fini. D’abord, par l’approche imminente de la fin de son mandat présidentiel, ensuite par le rejet total, par le peuple, de sa feuille de route. Durant cette « révolte » populaire (utilisons pour le moment ce terme et convoquons ici les sociologues pour se pencher sur l’épistémologie, la nature, l’esprit, et les objectifs politiques de ce mouvement du 22 février pour définir si vraiment il s’agit d’une révolution), il y avait également et surtout Ahmed Gaïd Salah. De menaçant au début, le chef de l’état major devient, au fur et à mesure de l’accroissement de la contestation populaire, du ralliement chaque vendredi de millions d’Algériens, des manifestations urbaines quasi quotidiennes de corporations professionnelles, des magistrats aux avocats, des enseignants aux étudiants, des syndicats autonomes, des travailleurs de zones industrielles, d’administrations, de médecins et travailleurs de la Santé, de l’Education, plus conciliant avec les protestataires. Et, à partir de la mi-mars, au lendemain du 4e vendredi consécutif de manifestations populaires, juste après le retour de Suisse du président, Gaïd Salah va progressivement se retourner contre le chef de l’état. Ses interventions, devenues quasi hebdomadaires, sont suivies et décryptées par les analystes, et le changement de ton que l’on perçoit à travers ces dernières est que les militaires se rangent définitivement du côté de la rue. Les slogans « djeich-chaab, khaoua-khaoua » (armée et peuple sont frères), ou « Silmya-Silmya » (pacifique-pacifique) donnent, du côté de la rue, le tempo à ces manifestations et à la philosophie du mouvement du 22 février. Plus aucun doute, le pouvoir sait qu’il a affaire à un peuple uni autour de ses revendications, discipliné dans la manière de les obtenir. Très vite, les forces de sécurité comprennent qu’elles n’ont pas affaire à des « manifestants du dimanche », ni à un mouvement populaire spontané qui va rapidement s’essouffler. Car, les scènes de ces milliers de familles investissant chaque vendredi les grands centres urbains du pays pour renforcer la contestation populaire, et grossir chaque semaine un peu plus les rangs des millions de manifestants, qui veulent faire « dégager le système », ne trompent pas sur les objectifs du peuple. Le chef de l’armée algérienne, qui compte dans ses rangs la fine fleur des militaires de ce côté-ci de la méditerranée, des officiers formés dans les plus grandes écoles militaires, va vite comprendre qu’il est illusoire de cautionner la démarche du président. Une démarche suicidaire, susceptible de plonger le pays dans le chaos, un scénario que Gaïd Salah avait d’ailleurs évoqué au début des manifestations, à Tamanrasset, et qu’Ahmed Ouyahia, alors Premier ministre, avait brandi, menaçant, contre le Hirak, devant le Parlement, moins d’une semaine après le début des manifestations contre le 5e mandat. Le ralliement de l’armée au mouvement populaire sera décisif. Il y’a eu aussi durant ce premier cycle du mouvement du 22 février, les commentaires intéressés de certaines capitales, Paris en tête. Mais également, le point de vue d’historiens émerveillés par la réaction salutaire de la rue face à la « tentation » du mandat de trop. L’intention principale de ce travail étant de capter et traduire le plus fidèlement possible les premiers instants historiques, les premières pulsions sociales d’un extraordinaire mouvement populaire, le début de la fin de l’ère Bouteflika, il n’est pas exclu qu’il y ait des événements non rapportés, oubliés ou partiellement évoqués. Nous nous en excusons. A l’origine de ce travail, il y avait l’idée de rapporter, à partir de matériaux tirés des comptes rendus de la presse, notamment électronique, et dont je fais partie, car le mouvement de revendication populaire est constant dans le temps et dans l’espace, le plus fidèlement possible tout ce qui a trait au mouvement du 22 février, jour après jour, heure après heure, vendredi après vendredi. Il y’a également la nécessité que je me suis assignée de limiter dans le temps ce travail et de rapporter arbitrairement les événements pendant 30 jours. C’est l’objectif que je m’étais fixé : parler des 30 jours de la contestation populaire du 22 février contre le pouvoir et le 5e mandat que briguait le président Bouteflika. Par la suite, la précipitation des événements à partir du 22 mars, avec la perspective du départ anticipé de Bouteflika, pratiquement poussé à la démission par le peuple et l’armée, a exigé une prolongation temporelle pour ce présent travail, bouclé dans la nuit du 5 avril 2019.
Depuis, le Hirak a poursuivi son petit bonhomme de chemin, harcelant et poussant les représentants du pouvoir à partir. A commencer par Abdelkader Bensalah, nommé chef de l’état en vertu de l’article 102, que défend toujours Ahmed Gaïd Salah, le chef de l’armée qui reste sourd aux appels de la rue pour la mise en place d’une transition pacifique, avec l’installation d’un gouvernement collégial, consensuel, chargé de gérer les affaires du pays et de préparer des élections présidentielles dans les meilleures conditions, et le plus tôt possible, après l’annulation de celles prévues constitutionnellement le 4 juillet prochain. Car le Hirak qui n’a obtenu que de maigres résultats après le départ de Bouteflika, l’incarcération de son frère Saïd, des généraux Mohamed Mediene et Othmane Tartag, ainsi que de Louisa Hanoune, ne compte pas s’arrêter et veut imposer, plus que jamais, sa sortie de crise : celle de bâtir un état moderne, démocratique. Entretemps, une campagne judiciaire à l’italienne (mani pulite), « mains propres », a déjà envoyé à la prison d’El Harrach plusieurs « oligarques », pour éviter d’utiliser le terme « soft » d’hommes d’affaires, des ministres et les deux ex-Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, en attendant leur procès. Pour le reste, le gouvernement de Nouredine Bedoui est toujours là, alors que la mission constitutionnelle de Bensalah devrait s’éteindre le 4 juillet prochain.
Chapitre I : La zénitude des vendredisants
Lorsqu’au soir du 2 avril, Abdelaziz Bouteflika annonce officiellement qu’il démissionne du poste de président de la république, écourtant de quelques semaines son 4e mandat, des millions d’Algériens se congratulent. Beaucoup sortent dans la rue, devenue leur exutoire et leur lieu de revendications pacifiques, manifester leur joie, fêter leur victoire. Ils viennent de franchir une première étape importante, de faire tomber une grande barrière, mais pas décisive, dans leur combat pacifique et joyeux pour recouvrer une dignité longtemps mise sous le boisseau par les différents régimes qui se sont succédé depuis le 5 juillet 1962. Quelques jours après les manifestations de BBA, Jijel, Kherrata et Khenchela, et à la veille du vendredi 22 février, Soufiane Djilali, président de « Jil Jadid » et coordinateur du Mouvement Mouwatana, souligne dans un entretien au site électronique « TSA » que « personne ne sait d’où sont venus ces appels anonymes à manifester (le vendredi 22 février) ». Il estime qu’il aurait fallu « qu’on sorte dans la rue dès l’annonce par le président de sa candidature à un 5e mandat. » « Il y a eu certes des annonces et des appels à une marche populaire le 22 février, mais personne ne sait qui est derrière cet appel. Nous avons été clairs et objectifs et avons appelé les citoyens à manifester en notre nom », explique t-il. Il précise cependant que « cela ne veut pas dire que nous sommes contre tout appel à manifester contre le 5e mandat, si les citoyens prennent cette responsabilité. Notre objectif est que le citoyen soit libre. » Commentant les premières manifestations de jeunes contre le pouvoir et le 5e mandat à BBA, Jijel, Kherrata et Khenchela, durant les jours ayant précédé l’éclosion populaire du vendredi 22 février, le président de Jil Jadid estime tout naturellement que « les Algériens sont sortis spontanément manifester contre le 5e mandat, car ils se sont sentis humiliés, et nous serons avec eux le 22 février. » Par ailleurs, à la veille des grandes manifestations populaires contre le mandat de trop, Sofiane Jilali affirme, face à une possible répression des manifestants, et la tentation totalitaire du pouvoir, que « le peuple est déjà sorti (à Kherrata, Kenchela, Jijel et Bordj Bou Arreridj). Les Algériens refusent le 5e mandat, et réprimer le peuple est devenu très difficile ». Dans les villes de l’intérieur ce n’est plus possible et nous appelons les Algériens à sortir en masse le 24 (appel de Mouwatana) et le 22 février (appel anonyme sur les réseaux sociaux) », explique Sofiane Djilali, qui conseille à tous les Algériens « que ces manifestations soient organisées dans un cadre pacifique. On doit être à la hauteur, même si on sait que c’est le pouvoir qui envoie les baltaguias (casseurs et voyous). Cela ne doit pas rester au niveau des communiqués ou des paroles en l’air : il faut que les Algériens sortent manifester contre le 5e mandat. » Et, depuis le 22 février dernier, date du grand début de la douce révolte des Algériens contre le régime en place, ce seront 45 jours de magnifiques manifestations et de marches dans la gaité d’un peuple, qui s’est retrouvé, qui a redécouvert les vertus de la fraternité, soixante ans après la démonstration historique du 11 décembre 1960 contre la colonisation française. Cette fois, les Algériens sont sortis pour faire tomber un système politique qui a dévoyé et englouti les promesses de la révolution de novembre 1954. Le 5 avril 2019 était le 7e vendredi consécutif après le début du soulèvement populaire, contre un système politique vieillissant, impur et qui n’a que trop duré. Tout comme le président Bouteflika, vingt ans au pouvoir, sans grandes réformes sociale, politiques et économiques sérieuses, en dépit des multiples promesses électorales. Un président sourd aux appels insistants de millions d’Algériens qui lui demandaient de partir, en s’arrogeant le droit anticonstitutionnel de poursuivre son 4e mandat. Pour tous les Algériens, de toutes les régions de ce vaste et beau pays, il était temps que la mascarade cesse. Depuis le 22 février, les Algériens se donnent rendez-vous chaque vendredi pour forcer le système, ses hommes, à partir, et ouvrir la voie à une nouvelle Algérie où, démocratie, justice, libertés ne seront guère des slogans. Tout simplement. Et de laisser le peuple décider en toute souveraineté de déléguer la gestion du pays à ses seuls représentants, qu’il aura à désigner par les urnes en toute transparence. Dans cet extraordinaire élan populaire, les Algériens ont (ré) inventé les marches et les manifestations pacifiques et, cerise sur le gâteau, le matériel du parfait manifestant « zen ». Ils doivent déposer les brevets de droits d’auteurs pour avoir inventé une nouvelle méthode de manifester et la panoplie du parfait contestataire, en colère contre le pouvoir : être drapé de l’emblème national, se munir de pancartes ou écriteaux pour exprimer ses revendications en temps réel et aller réclamer le respect de ses droits constitutionnels avec ses enfants, en famille, dans la joie. Et, si possible, avec le goûter des enfants. Les critères sont stricts, et les policiers antiémeutes qui encadrent depuis le début cet enivrant et chatoyant mouvement de ressac humain ruisselant entre les grands boulevards des villes du pays, sont là pour rappeler à l’ordre ceux qui ont « trop » la tête dans les nuages : il faut donc se munir d’un emblème national, peu importe la taille, d’une ou plusieurs pancartes au cas où son copain de « manif » n’en aurait pas, pour exprimer son rejet du système et de ses relais, d’un smartphone pour immortaliser le moment de douce révolte avec des selfies, avec des policiers surtout, à envoyer au reste du monde et aux copains « harragas » coincés du côté de « Barbes », « Porte de Clignancourt », quelque part en Toscane, en Catalogne et en Andalousie, et enfin afficher une profonde « zénitude » pour être un parfait « Vendredisant ». Le nouveau verbe « Vendredire », inventé par le génie des manifestants Algériens et une brochette de journalistes facétieux jusqu’à l’os, mais ne marchandant jamais avec la démocratie, la liberté d’expression et les droits de l’homme, signifie littéralement, selon une explication personnelle qui peut être contredite par les millions de manifestants pour un antidote populaire « anti-hogra » et « anti-système Bouteflika », aller manifester un vendredi et dire, s’exprimer dans la bonne humeur contre le pouvoir et le faire dégager par des slogans aussi sérieux au sens politique que moqueurs socialement. Voilà donc la définition personnelle de ce terme, nouveau, si beau et qui roule bien les « r » comme pour affirmer la puissance du pouvoir et du génie populaire algérien. Avec donc cet attirail du parfait manifestant « zen » et « hadhri » (urbanisé), on peut ainsi aller marcher et manifester sa colère contre le régime dans toutes les rues d’Algérie : Alger, Ghardaïa, Laghouat, Djelfa, ou d’El Bahia, de Tlemcen, de Tizi Ouzou, à Béjaia, au Cours de la révolution dans « la coquette », « au petit Paris » du côté de Bel Abbes, à Lagraph, Douar Essoug, et à Biskra, Bordj Menaïel, Akbou, Chlef, Ténès, Relizane, Tiaret, El Khemis et Miliana, l’ancien fief de l’Emir Abdelkader, à Bouira, à Jijel. Partout dans cette grande et belle Algérie, qui n’appartient qu’à son peuple, en scandant à l’unisson « pouvoir dégage », sinon « dégagez tous », « y en a marre de ce pouvoir ». Et, pour ceux qui ont la main sur le cœur, un bon couscous servi à même le macadam aux milliers de « vendredisants » et « vendredisantes », visiteurs d’un vendredi dorénavant consacré aux manifestations, le temps d’une « manif » conviviale et joyeuse contre le pouvoir, qui a croqué en moins de 20 ans des milliers de milliards de dollars, l’argent du peuple investi dans des « business » douteux dans des paradis fiscaux. Cette révolution tranquille et profondément populaire, qui se déroule maintenant depuis le 22 février, est la seconde par son ampleur et ses objectifs dans l’histoire du pays, après les manifestations du 11 décembre 1960, qui avaient montré au monde que les Algériens voulaient prendre leur destin en main. Ce jour là, tous les Algériens et les Algériennes sont sortis à travers le territoire national, pour réclamer leur indépendance, reprendre possession de leur pays et exiger le départ de la France coloniale. Près de soixante années plus tard, les fils et petits fils de ces Algériens et Algériennes, sont de nouveau sortis dans la rue réclamer les « clefs » de leur pays, mis sous séquestre depuis l’indépendance par un pouvoir qui s’est imposé par la terreur, la démagogie et la dilapidation des biens du peuple. Aujourd’hui, les Algériens, le peuple algérien, avec toutes ses composantes ethniques, veut reprendre son bien le plus précieux, sa liberté, car, il a trop supporté le mensonge érigé en doctrine d’état qui l’a maintenu dans une position de quasi-dépendance vis-à-vis d’un pouvoir dont le seul objectif était de conserver sa place, en reproduisant à l’infini son modèle de gestion autocratique du pays et de ses richesses. La dernière tentation du système d’opérer sa mutation par un incroyable tour de « passe-passe », c›est-à-dire prolonger le 4e mandat en annulant la présidentielle du 18 avril, lui a été fatale. Là, les Algériens, toutes tendances et catégories sociales et professionnelles confondues, ont dit « non ». En quoi alors consistait cette tentation des hommes de l’ombre, appelés « l’état profond », qui conseillent le président, (en plus de ses trois ou quatre conseillers déclarés), qui rédigent la plupart des messages adressés au peuple et qui lui sont attribués ? Gagner du temps en poussant vers la prolongation du 4e mandat dans le but de créer un nouveau « messie » du peuple et le proposer pour l’élection présidentielle qui devait, selon le plan « B » du pouvoir, se tenir après la révision en profondeur de la Constitution proposée par cette fameuse conférence nationale inclusive. Mais, ce scénario ne devait pas marcher car rejeté par plus de quarante millions d’Algériens. Parce que le mensonge d’état ne passe plus dans une Algérie 3.0, jeune et belle. Et, plus que tout, qui ne veut plus, dorénavant, être menée en bateau, ni roulée dans la farine. Si M. Bouteflika n’est pas un menteur, ayant des circonstances atténuantes dues à son état de santé, ceux qui ont voulu imposer un 5e mandat puis la prolongation du 4e, le sont. Pourquoi ? D’abord, il y’a l’annonce officielle, le 10 février dernier, le déclarant partant pour un 5e mandat. La direction de campagne est déjà installée et les comités de wilaya à pied d‘œuvre pour le traditionnel « T’bel » et le « méchoui » de circonstance, accompagnant officieusement la collecte des signatures. Le dossier de sa candidature est ficelé, avec notamment un certificat de bonne santé falsifié, puisque ce ne sera pas lui qui déposera son dossier, le 3 mars 2019, devant le conseil Constitutionnel, étant incapable de se déplacer en personne, encore moins de parler. Le dossier de candidature du président sortant a été effectivement déposé, sous l’œil des caméras, comme prévu le 3 mars en début de soirée par son nouveau directeur de campagne Abdelghani Zaalane, alors que les premières grandes manifestations populaires à travers le pays contre le 5e mandat ont débuté le 22 février, confirmant une semaine plus tard, le 1er mars, à travers de grandioses démonstrations pacifiques, que le peuple ne voulait plus ni de Bouteflika, ni du 5e mandat, encore moins d’un pouvoir qui a osé falsifier un simple certificat médical, véritable acte de « faux et usage de faux », venant de l’état. Depuis le vendredi 1er mars, les manifestations sont alors organisées chaque jour, et deviennent de plus en plus importantes autant dans la capitale vers où convergent des centaines de milliers de contestataires venant des villes et villages des wilayas limitrophes (Boumerdes, Blida, Médéa, et jusqu’à Ain Defla), que dans les grandes métropoles du pays, comme Skikda, Sétif, Annaba, Souk Ahras, Tébessa, Mostaganem, Ain Temouchent, Guelma, et Maghnia. Mais c’est dans la capitale du M’Zab, Ghardïa et ses villes-satellites (Berriane, Bounoura, Beni Izguen, Daya Ben ahoua, Melika, et El Attf) que les premières manifestations contre le régime et le « mandat de trop », dés le 22 février, sont les plus belles, avec ces mozabites chantant et dansant pour faire partir un système qui les a, estiment-ils, brimés. Les habitants de Ghardaïa, mozabites et Chaambis réunis, et sa région, ont vécu, au cours de ces cinq dernières années, des moments terribles, ponctués par plusieurs arrestations et des morts. Des événements douloureux, qui avaient endeuillé le pays et tous les Algériens. A partir du 22 février, c’est toute l’Algérie qui sort dire « Non ! » au 5e mandat, répondant à de mystérieux appels sur les réseaux sociaux, lancés juste après les premières manifestations pacifiques de Bordj Bou Arreridj et Jijel (15 février), Kherrata (16 février) et le raz de marée des « supporters » de Rachid Nekkaz à Khenchela, le 19 février. Le premier mouvement populaire pour un changement politique radical en Algérie est venu pourtant de Bordj Bou Arreridj, Jijel et Kherrata, des villes devenues symboles de la contestation et du refus du 5e mandat. Le vendredi 15 février, à Bordj Bou Arreridj comme à Jijel, puis le lendemain à Kherrata, les manifestants ont exprimé et porté dans la rue le malaise qui étouffait les jeunes Algériens. En plus d’une crise sociale profonde, dont le chômage, le sous-emploi, les problèmes de logement, l’inflation, la précarité sociale ambiante dans ces villes et villages livrés au népotisme, il y a surtout l’injustice sociale, la « Hogra ». « Hogra » dans la distribution de logements, dans les offres d’emploi, au niveau de l’administration pour l’obtention de documents administratifs nécessaires à la constitution de dossiers pour l’Anem ou l’Ansej ; il y a également la « Hogra » à l’école, dont les résultats des élèves varient en fonction du statut social et professionnel des parents ; « La Hogra » dans un système de Santé anachronique, lui-même « malade », lorsque les hôpitaux ne soignent que les « riches » et les proches de la « nomenklatura », et que le reste des Algériens peut mourir, faute d’un lit, d’une prise en charge à temps. Dans cette Algérie du pays profond en manque flagrant d’infrastructures et d’opportunités d’embauche avec le ralentissement des projets de réalisation induit par la baisse du budget des wilayas, les jeunes sont oubliés, marginalisés, vampirisés par un système social et politique qui ne leur accorde aucune chance de percer ou de faire leur vie, qui les a occultés des années durant. Ce qui explique la virulence des revendications lors de la manifestation du vendredi 15 février à Bordj Bou Arreridj où les jeunes sont sortis dans la rue dénoncer le 5e mandat. En des termes très violents, à la limite de la correction, ils ont insulté et stigmatisé les principales figures du pouvoir, dont Ahmed Ouyahia, avant d’appeler au changement, au départ de Bouteflika. Des appels à l’armée disant « nous sommes frères » sont lancés par les manifestants. Dans la foulée, ces derniers affirment que « les jeunes de BBA n’acceptent pas le 5e mandat », « Ya Ouyahia (!), l’Algérien n’est pas content », « ni casse, ni destruction, nous voulons le changement », ou « ce peuple ne veut pas de Bouteflika et Saïd ». Les premiers slogans, « Silmya-Silmya » sont ainsi lancés de la ville de Hadj Ben Ahmed Mohamed El Mokrani, une des figures de proue de l’insurrection de 1870 contre la colonisation française, après la promulgation du Senatus Consulte (14 juillet 1865), dans la région des Bibans et la petite Kabylie, depuis Seddouk. Le même vendredi, et à quelques centaines de kilomètres au-delà de la chaîne des Babors, c’est également Jijel, la capitale des Koutamas, qui se rebelle et refuse la fatalité d’un destin imposé par le pouvoir en place. Des centaines de jeunes sortent dans la rue et manifestent pacifiquement contre le 5e mandat que briguait Bouteflika. Comme à Bordj Bou Arreridj, la manifestation s’est déroulée dans le calme, sans heurts avec les forces de l’ordre.
Aux cris de « pouvoir assassin », « oulach Smah oulach », « Bouteflika dégage », des centaines de jeunes sont sortis le lendemain, samedi 16 février à Kherrata toute proche, séparée de Jijel et BBA par la chaîne des « Babors », dénoncer la volonté du pouvoir d’imposer aux Algériens le 5e mandat de Bouteflika. Vers dix heures, la petite ville où un chômage endémique sévit, est envahie par une grande foule, enhardie par le comportement des services de sécurité, qui laissent faire, et n’interviennent pas. Ils étaient, selon les correspondants de presse, près d’un millier de manifestants à avoir répondu à un appel lancé par des jeunes de la région, dont des médecins et des ingénieurs, pour marcher contre le mandat de trop. Ils ont sillonné la ville, sans être inquiétés par la police, pour aller ensuite organiser un sit-in devant le siège de la daïra, scandant des slogans hostiles au pouvoir et portant des banderoles sur lesquelles étaient écrits : « Non au mandat de la honte », « FLNdégage », « pouvoir assassin », ou « je suis Algérien, je suis contre le 5e mandat ». En fait, cette première réaction populaire a étonné autant les observateurs que les Algériens par la « passivité » des forces de sécurité, toujours promptes à réprimer toute contestation sociale, et fera tâche d’huile par la suite dans l’ensemble du pays. Ce torrent de colère des Algériens contre le pouvoir, va ainsi prendre naissance à BB Arreridj, Jijel et Kherrata, d’où sont partis avec la ville voisine de Sétif, en mai 1945, les cris de la révolution algérienne. L’avertissement lancé à partir de l’une des villes martyres de la terrible répression de l’armée coloniale, avec l’aide des colons, qui a commencé le 8 mai 1945, au sortir de la seconde grande guerre, ne sera pas entendu par le pouvoir et ses relais, les partis de l’Alliance présidentielle, qui rêvaient, éveillés, d’un dernier mandat, mais empêchent les partis d’opposition et la société civile de rêver, à leur tour, à une autre alternative politique que celle proposée aux Algériens sur un plateau plusieurs fois utilisé, au détour de l’élection présidentielle d’avril 2019. Le lendemain 17 février dans la capitale des Bibans, c’est « bis repetita » : les jeunes de BBA font l’actualité des manifestations anti-5e





























