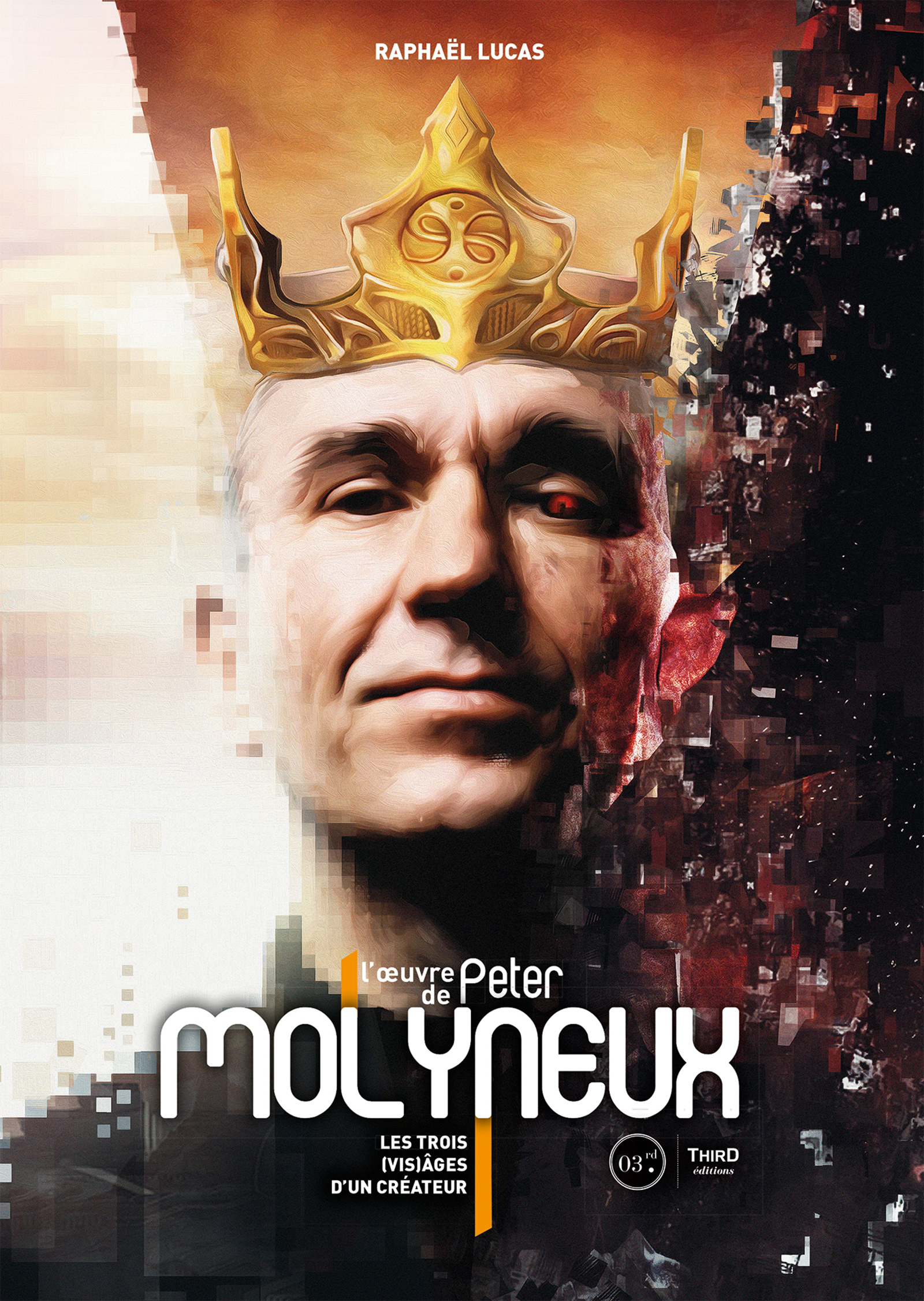Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Third Editions
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Découvrez les coulisses de la création de chaque épisode de la saga !
Cet ouvrage revient sur les coulisses de création des différents épisodes, l’histoire complète de tous les jeux ainsi que les grandes thématiques qui traversent la série. Raphaël Lucas, rédacteur pour Gamekult (site de jeux vidéo très important en France), cumule plus de quinze ans d’expérience dans le domaine du journalisme vidéoludique.
Suivez Raphaël Lucas, journaliste vidéoludique sur Gamekult, dans les souvenirs attachés aux histoires qui sont liées à chaque épisode et à chaque grande thématique de Legacy of Kain !
EXTRAIT
Ma rencontre avec
Legacy of Kain était donc logique, inévitable, comme nécessaire. Pourtant, elle est le fruit d’un simple hasard : je n’ai joué à
Blood Omen que par erreur. Et cette erreur, je la dois à
Cyber Flash, l’émission de Canal + animée par la présentatrice virtuelle, Cléo – encore un adorable monstre ! –, vers la fin des années 1990. Je ne suivais alors l’actualité du jeu vidéo que de loin, n’achetant un magazine qu’un mois sur deux, préférant alors investir dans
Casus Belli et
Mad Movies.
Cyber Flash était mon moyen de rester connecté au jeu vidéo. Et là, à l’écran, il y a ce
sprite, ce héros qui évolue en 2D dans un décor gothique magnifique, et puis cette musique, et puis ce thème : incarner un vampire. Le nom m’échappe cependant. Tant pis, le vendeur d’une boutique spécialisée saura bien m’aiguiller dans la bonne direction... Un vampire, de la 2D... Las. Dès le lancement, dès ce premier écran où l’on voit le héros vu du dessus, nous comprenons, mon frère et moi, que ce
Legacy of Kain : Blood Omen n’est pas du tout le jeu de plateforme avec éléments de RPG dont
Cyber Flash vantait les mérites. Ce
Castlevania : Symphony of the Night, je ne le dénicherai que plus tard, payant le prix fort pour la version avec manga et bande-son de la franchise dans une boutique, disparue depuis longtemps, non loin d’une Sorbonne dont je fréquentais alors les bancs. Qu’importe... Pour l’heure, il s’agissait de s’extirper de cette tombe après avoir été ignoblement assassiné, puis tout aussi brutalement ressuscité. Tout joueur de l’époque vous le dira, rien n’était plus sombre, violent et brutal que
Blood Omen : vociférations et plaintes d’êtres humains ligotés attendant la mort ; bruit du sang arraché/ propulsé de carotides broyées vers les crocs et la bouche de Kain ; son de lame sec, tranchant ; musique atmosphérique ; Vae victis proclamé après chaque trépas adverse ; mares d’hémoglobine, pénombre constante... Oui,
Legacy of Kain : Blood Omen installait parallèlement un malaise et une excitation croissants chez son joueur.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Une nouvelle fois, les éditions Third se penchent sur une série vidéoludique plus confidentielle, connue et appréciée des puriste : "Legacy of Kain". Cette saga de dark fantasy, ne comprenant que quelques titres, reste chère dans le coeur de nombreux joueurs, de par la singularité de son univers, ses héros si charismatiques, et ses mécaniques si innovantes. Le travail réalisé ici est impeccable. Création des jeux, description de l'univers de la série, analyse de ses thématiques (entre autres un développement passionnant sur la figure du monstre dans l'imaginaire collectif, ainsi qu'un rappel des inspirations lovecraftiennes de la saga), rien à dire, c'est parfait. Un superbe travail. -
Sotelo, Critiques Libres
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 433
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La saga Legacy of Kain. Entre deux mondesde Raphaël Lucas est édité par Third Éditions 32 rue d’Alsace-Lorraine, 31000 TOULOUSE [email protected]
Nous suivre : : @ThirdEditions : Facebook.com/ThirdEditions : Third Éditions
Tous droits réservés. Toute reproduction ou transmission, même partielle, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l’autorisation écrite du détenteur des droits.
Une copie ou reproduction par quelque procédé que ce soit constitue une contrefaçon passible de peines prévues par la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la protection des droits d’auteur.
Le logo Third Éditions est une marque déposée par Third Éditions, enregistré en France et dans les autres pays.
Directeurs éditoriaux : Nicolas Courcier et Mehdi El Kanafi Assistants d’édition : Damien Mecheri et Clovis Salvat Textes : Raphaël Lucas Préparation de copie : Zoé Sofer Relecture sur épreuves : Anne-Sophie Guénéguès Mise en pages : Julie Gantois Couvertures classique : Jordan Grimmer Couvertures « First Print » : Mathieu Moreau
Cet ouvrage à visée didactique est un hommage rendu par Third Éditions à la série de jeux vidéo Legacy of Kain. L’auteur se propose de retracer un pan de l’histoire des jeux vidéo Legacy of Kain dans ce recueil unique, qui décrypte les inspirations, le contexte et le contenu des différents épisodes à travers des réflexions et des analyses originales.
Legacy of Kain est une marque déposée de Square Enix. Tous droits réservés. Le visuel de la couverture est inspiré du travail des artistes des studios Silicon Knights et Crystal Dynamics sur les jeux Legacy of Kain.
Édition française, copyright 2019, Third Éditions. Tous droits réservés.
ISBN 978-2-37784-084-7
Dépôt légal : février 2019 Imprimé dans l’Union européenne par Grafo.
À Ezra et Celine.
« Don’t be afraid. »
(Elle le prend dans ses bras)
Au loin, j’aperçois un colossal Ronald McDonald holographique cheminant entre les silos à céréales et les arbres.
Oh, si j’avais de l’argent je ME ferais changer en l’un d’eux, et m’enverrais rôder dans la lande effrayer tout le monde.
(pleurs de bébé au loin en continu)
Parce que, vous voyez, j’ai ce genre de panorama autour de moi.
Parce que...
Parce que j’ai des épines.
Parce que j’erre entre les zones, même lorsque je ne suis pas supposé le faire.
Parce que j’ai la réputation d’être un individu suspect. Et qu’il est l’heure de faire du shopping.
Ozar Midrashim, par Information Society dans l’album Don’t Be Afraid (1997)
PRÉFACE
QUAND on a commencé à écrire sur les jeux vidéo il y a plus de vingt ans, la mémoire des débuts se retrouve facilement morcelée, un peu brouillonne. Mais il y a toujours quelques titres, quelques événements majeurs, dont le souvenir reste d’une vivacité et d’une clarté extraordinaires. Indubitablement, parmi l’avalanche de titres historiques des années 90, les épisodes de la série Legacy of Kain sont de ceux qui ne quittent ni ma mémoire ni mon cœur.
Du premier, Blood Omen (celui de Silicon Knights), qui a lancé l’univers de Nosgoth et sa mythologie, jusqu’à Defiance, conclusion ahurissante d’une saga course-poursuite entre Raziel et Kain, j’ai suivi tout du long cette série avec une passion toute particulière, même pour ses épisodes les moins réussis (Blood Omen 2, c’est toi que je regarde). Comme chez beaucoup d’autres, un titre au sein de la série m’est resté en particulier : Soul Reaver.
Je ne crois pas avoir autant écrit sur aucun autre jeu, tous supports et toutes époques confondus. Tout a commencé le jour où Rob Dyer, à l’époque président du studio Crystal Dynamics, est passé à la rédaction de Joypad, avec un disque fraîchement gravé d’une « First Playable » comme on dit dans le jargon : un premier (tout petit) bout de jeu jouable. Je crois qu’il n’avait même pas encore son nom. Rob semblait ne pas trop savoir ce qu’il avait entre les mains, et profitait de son tour des rédactions européennes, officiellement centré sur la marque phare du studio, Gex, pour sonder les quelques journalistes qu’il connaissait bien à l’époque. Sur ce disque, il n’y avait alors quasiment rien d’autre que Raziel, au milieu d’une seule salle, une première version du combat avec trois monstres identiques, et la mécanique de morphing du monde matériel au monde spirituel.
Lorsque j’ai activé le sort de passage dans le monde spirituel, et vu tout le décor se déformer et changer de teinte en temps réel, j’en suis resté bouche bée. Il n’en a pas fallu plus pour que le coup de foudre s’opère et que je ne lâche plus la production du jeu pendant les années qui ont suivi, jusqu’à sa sortie en août 1999 en France, après de multiples reports. Version après version, j’ai eu le privilège d’y jouer régulièrement, suivant de près les progrès du développement et me confortant chaque fois un peu plus sur cette première opinion mal dégrossie que ce serait un jeu qui marquerait l’histoire.
Et pour cause : beaucoup de gens l’ignorent, mais outre ses qualités ludiques, Soul Reaver est aussi le premier jeu de l’histoire à avoir implémenté des technologies devenues universelles. Sur la toute première PlayStation, ridicule comparativement aux machines dont nous disposons aujourd’hui, Soul Reaver est le premier à offrir ce cocktail d’action et d’aventure en pseudo-monde ouvert, avec un chargement continu (dit « streaming ») pour ne jamais couper le rythme d’un écran de loading ; une prouesse que seuls disques durs et cartouches pouvaient à l’époque se permettre, et encore, tant les lecteurs de disques optiques étaient lents. C’est aussi le premier, avant le Portal de VALVe, à avoir implémenté des portails de téléportation montrant, en 3D, la destination au travers du portail, et offrant de s’y rendre instantanément (toujours sans temps de chargement) simplement en les traversant. C’est, encore, le premier à avoir implémenté des techniques d’inverse kinematics dans son animation, permettant à Raziel de disposer ses pieds parfaitement sur n’importe quelle surface ou d’attraper des torches ou des lances accrochées aux murs, quelle que soit son orientation ; quelque chose que certains des jeux d’aujourd’hui ne font toujours pas, forçant des animations rigides traditionnelles. Premier, toujours, à avoir joué de Per-Vertex Coloring pour teinter les textures d’éclairages différents, obtenant un rendu que seuls de rares titres de sa génération ont su atteindre (comme Metal Gear Solid par exemple), se démarquant visuellement au passage du gros de la production de l’époque. C’est, enfin, l’un des premiers à franchir un nouveau palier d’excellence en termes de doublages, à la fois dans sa version originale et, plus rare encore à l’époque, dans le travail de localisation française. Un titre historique, vous dis-je.
Mais Soul Reaver, c’est aussi le jeu qui a propulsé Amy Hennig, plus connue pour son récent travail sur la série Uncharted chez Naughty Dog, dans ma galaxie de développeurs favoris, puis au fil des années, des rencontres, et des discussions en face-à-face, ou par Internet de l’ICQ d’alors jusqu’au Facebook d’aujourd’hui, parmi celles et ceux que j’ai la chance de bien connaître amicalement et de respecter autant à titre humain que pour leur travail et leur contribution à l’industrie. Avec cette série, Amy a pondu à mes yeux l’un des récits les plus réussis du jeu vidéo, s’attaquant à des thèmes difficiles, comme la notion philosophique de libre arbitre dans un monde gnostique. Un récit suffisamment habile pour subvertir la structure classique du monomythe (le « parcours du héros » de Campbell) et montrer qu’on pouvait écrire de vraies bonnes histoires de jeu vidéo. À la fois intimiste et épique, surprenant et inspiré, riche et accessible, son conte de violence cyclique sur fond de corruption et d’égocentrisme ne dépareillerait pas aujourd’hui comme métaphore de certaines des tragédies politiques qui s’étalent jour après jour dans l’actualité.
Plusieurs tentatives avortées de ressusciter la série ont eu lieu, après sa conclusion d’origine jouée dans Defiance (février 2004 en France). Je ne désespère pas ; même si d’un certain point de vue, la tâche d’égaler ces jeux semble vouée à l’échec tant mes souvenirs les ont couverts d’une patine à la beauté hypertrophiée par la subjectivité de la mémoire. En attendant, que vous ayez découvert ces jeux à l’époque ou que vous soyez simplement curieux de savoir pourquoi ma génération en parle aussi régulièrement, si vous tenez ce livre entre vos mains, vous avez certainement là un sésame pour (re)visiter Nosgoth sous un nouveau jour. C’est en tout cas tout le bien que je vous souhaite à sa lecture ; merci, Raphaël, d’offrir à cette saga une nouvelle tribune, elle la mérite amplement !
RaHaN
Biographie de Grégory « RaHaN » Szriftgiser
Entré par la grande porte des magazines Joypad et Joystick en plein âge d’or du jeu vidéo et de sa presse, au milieu des années 90, Grégory — plus connu sous son nom de plume, « RaHaN » — poursuit une carrière heureuse de journaliste jusqu’en 2013. Il co-crée le magazine Gaming en 2003, puis le site Internet Gameblog.fr en 2006 dont il assurera la rédaction en chef pendant sept ans, avant de sauter de l’autre côté de la barrière en rejoignant le studio d’Ubisoft Montréal avec lequel il collaborera pendant deux ans. Toujours basé au Canada, il dédie aujourd’hui son temps à de tout autres enjeux, autour de la recherche en intelligence artificielle, au sein de la société Age of Minds, qu’il co-fonde en 2017 aux côtés d’autres vétérans issus des industries du jeu vidéo et de la technologie.
Biographie de Raphaël Lucas
Raphaël Lucas cumule plus de dix-huit ans d’expérience dans le domaine du journalisme vidéoludique. D’abord lecteur de Tilt et adorateur d’AHL, il s’oriente ensuite vers un cursus universitaire. Titulaire d’une maîtrise d’Histoire à Paris 1, il devient pigiste chez PC Team, avant de collaborer à Gameplay RPG et à PlayMag. En octobre 2004, il intègre le groupe Future France et travaille pour Joypad, PlayStation Magazine, Consoles + ou encore Joystick – sans compter quelques contributions à des magazines consacrés au cinéma. Aujourd’hui, il a intégré la nouvelle mouture de Jeux Vidéo Magazine, et collabore également à la revue The Game et au site Gamekult. Il est aussi l’auteur de L’Histoire du RPG aux éditions Pix’n Love, de La Légende Final Fantasy I-II-III et est coauteur de BioShock. De Rapture à Columbia ainsi que de La Légende Final Fantasy IX. Plus concrètement, ses genres de prédilection sont, toutes époques confondues, le RPG (japonais et occidental), les jeux d’arcade et d’action-aventure, les FPS et quelques bizarreries expérimentales. Vous a-t-on dit qu’il était aussi amateur d’horreur et de fantastique littéraire et cinématographique ? Ou qu’il vouait un culte étrange au charabia de James Joyce, Thomas Pynchon et autres écrivains illisibles ?
AVANT-PROPOS
J’étais d’Ailleurs. J’étais Ailleurs.
J’aime les monstres, les créatures, les Autres, les démons, ceux dont on tait le nom, ceux qui errent dans la nuit, glissent dans la pénombre, chuchotent des mots et mondes secrets, terrés ou oubliés, aux oreilles des joueurs, lecteurs, cinéphiles et rêveurs. J’aime les monstres. Je les ai toujours aimés. Et ce, qu’ils incarnent une certaine idée de l’enfer (les Cénobites d’Hellraiser), l’émerveillement grotesque des contes de fées (les marionnettes de Jim Henson, les illustrations d’Arthur Rakham), la possibilité d’un Ailleurs et/ou d’un Après autre (Les clans de la lune de Nightbreed1), qu’ils incarnent une science-fantasy délurée (les jeux de rôle papier Jorune et Mechanical Dream), un classicisme désarçonnant d’efficacité (Dracula, la créature de Frankenstein et tous les Universal Monsters) ou des déclinaisons contemporaines (les ouvrages d’Anne Rice, de Clive Barker ou de Poppy Z. Brite). Que voulez-vous, on ne passe pas les premières années de sa vie les yeux fixés sur un écran magique à regarder Les Visiteurs du mercredi, Croque-vacances, L’Île aux enfants ou Temps X (et donc les séries La Quatrième Dimension et Au-delà du réel), ou à jouer avec les monstrueux Power Lords designés par Wayne Barlowe et édités par Revell, sans en ressortir un peu changé. Un peu Autre. Un peu différent.
Oui, j’aime les monstres.
Je suis moi-même un monstre.
Nous le sommes tous, en sommeil, en songe, enjeu, nous, joueurs qui choyons cet appel de la nuit, quand il n’y a plus que la rumeur d’une ville endormie et le ventilateur de la console, de l’ordinateur, pour occuper l’espace sonore, quand il n’y a plus que la lueur de la lucarne magique pour éclairer salon ou chambre, pour éclairer la pénombre.
Enfant, je me reconnaissais en Rahne Sinclair (« Wolfsbane »/« Félina ») ou Sam Guthrie (« Rocket »/ « Cannonball »), tombais amoureux d’Illyana Raspoutine (« Magik ») ou des autres élèves mutantes du professeur Xavier. Je n’étais pas à ma place, je n’étais pas né à la bonne époque, pas au bon endroit. J’étais d’Ailleurs. J’étais Ailleurs. Je ne rêvais que de rêver. Adolescent à la fin des années 1980, je me découvrais Autre, différent de mes camarades de collège et de lycée : fan de (heavy/trash/death) métal arborant des tee-shirts couverts de crânes, maître de jeux de rôle papier, amateur de programmation sur ordinateur, de cinéma et de littérature d’horreur, de comics, de mangas, de jeux vidéo et, accessoirement, passionné d’occultisme, collectionnant les ouvrages de Papus et d’Aleister Crowley et créant jusqu’à ce sigil personnel qui brille, bouillonne toujours en moi, et que j’invoque au besoin. Fou, j’étais fou de toute cette pop-contre-culture étrange, bizarre, alors rejetée par l’establishment, que je me faisais un plaisir d’injecter dans chaque dissertation de français au grand étonnement de mes professeurs. Je me passionnais pour l’esthétique SM de Clive Barker dans Hellraiser, m’amourachais des personnages de Sang d’Encre de Poppy Z. Brite, dévorais Stephen King, Lovecraft, bouffais tout ce que le vidéoclub du coin proposait en pellicules fantastiques, horrifiques et science-fictionnelles, du chef-d’œuvre Abattoir 5 au nanardesque Critters 2 en passant par les films de Tod Browning (Freaks) ou les productions sans moyens, mais pourtant jouissives, de Brian Yuzna (Re-Animator, Le Retour des morts-vivants 3 – Ah, Melinda Clarke !), voire me plongeant dans les désormais classiques (Candyman, Candyman, Candyman, Candyman, oups...). Et du côté des jeux vidéo ? Même punition. J’arpentais la plaine (que j’aurais voulue) sans fin de Shadow of the Beast, ressentais par l’imagination les tortures – démembrement, mécanisation du corps dépecé – infligées au malheureux héros de The Killing Game Show, rêvais de devenir le guerrier d’Altered Beast massacrant du zombie dans des cimetières et cavernes, le vampire de Fright Night, puis l’Alucard de Castlevania : Symphony of the Night. Plus tard, ce sera Vampire : The Masquerade - Bloodlines, Planescape : Torment et tant d’autres. Dès qu’un jeu mettait en scène un monstre ou un univers peu familier (les Yokaï de Kenseiden sur Master System), je me jetais dessus avec plus d’avidité que jamais.
J’étais d’Ailleurs. J’étais Ailleurs.
Et je crois toujours l’être. Un peu. Quelque part en moi.
Ma rencontre avec Legacy of Kain était donc logique, inévitable, comme nécessaire. Pourtant, elle est le fruit d’un simple hasard : je n’ai joué à Blood Omen que par erreur. Et cette erreur, je la dois à Cyber Flash, l’émission de Canal + animée par la présentatrice virtuelle, Cléo – encore un adorable monstre ! –, vers la fin des années 1990. Je ne suivais alors l’actualité du jeu vidéo que de loin, n’achetant un magazine qu’un mois sur deux, préférant alors investir dans Casus Belli et Mad Movies. Cyber Flash était mon moyen de rester connecté au jeu vidéo. Et là, à l’écran, il y a ce sprite, ce héros qui évolue en 2D dans un décor gothique magnifique, et puis cette musique, et puis ce thème : incarner un vampire. Le nom m’échappe cependant. Tant pis, le vendeur d’une boutique spécialisée saura bien m’aiguiller dans la bonne direction... Un vampire, de la 2D... Las. Dès le lancement, dès ce premier écran où l’on voit le héros vu du dessus, nous comprenons, mon frère et moi, que ce Legacy of Kain : Blood Omen n’est pas du tout le jeu de plateforme avec éléments de RPG dont Cyber Flash vantait les mérites. Ce Castlevania : Symphony of the Night, je ne le dénicherai que plus tard, payant le prix fort pour la version avec manga et bande-son de la franchise dans une boutique, disparue depuis longtemps, non loin d’une Sorbonne dont je fréquentais alors les bancs. Qu’importe... Pour l’heure, il s’agissait de s’extirper de cette tombe après avoir été ignoblement assassiné, puis tout aussi brutalement ressuscité. Tout joueur de l’époque vous le dira, rien n’était plus sombre, violent et brutal que Blood Omen : vociférations et plaintes d’êtres humains ligotés attendant la mort ; bruit du sang arraché/ propulsé de carotides broyées vers les crocs et la bouche de Kain ; son de lame sec, tranchant ; musique atmosphérique ; Vae victis proclamé après chaque trépas adverse ; mares d’hémoglobine, pénombre constante... Oui, Legacy of Kain : Blood Omen installait parallèlement un malaise et une excitation croissants chez son joueur. D’abord déçu de m’être trompé, je délaissai le jeu. Puis, après quelques jours d’observation de mon frère qui s’était pris d’affection pour ce « sanglant présage », je concluais que, oui, il fallait sans doute donner une chance à ce Zelda-like terriblement gore. Avide de ce sang de pixels, je le terminais par la suite plusieurs fois, me retrouvant prisonnier de cette étrange alchimie que j’évoquais précédemment, entre attrait et répulsion. Hypnotisé.
Et puis, Raziel, ah ! Raziel, je le découvris d’abord dans les deux pages que Joypad n° 77 (le numéro spécial E3) lui consacrait. Déjà, tout me fascinait : les poses, le monde, le moteur, ce crâne gigantesque ceint d’une brume opaque que je m’imaginai déjà visiter, et ce héros qui me rappelait autant les Universal Monsters que certains super-héros... Puis, avec le n° 82 de janvier 1999 et sa couverture dédiée, j’achevai d’être convaincu. Le magazine, l’article, je les dévorai, m’abîmant dans chaque image, dans chaque visuel imprimé. Soul Reaver, Raziel devinrent des obsessions. La démo du phare, livrée avec un des PlayStation Magazine, je la terminai plusieurs fois d’affilée, régulièrement. Et puis, il y eut la sortie du jeu. Jamais (jamais !) je n’ai passé autant de temps à observer, à décortiquer les mouvements d’un personnage ; à l’écouter marcher (ô, le son de ses pas sur le sol) et parler (sa voix en français) ; à l’examiner alors qu’il saute dans le vide, déploie ses ailes pour flotter au gré des vents, ou lorsqu’il s’accroupit, qu’il esquive – pas de côté – une attaque, qu’il plante ses « griffes » dans un bloc pour le déplacer ou le renverser ; qu’il gesticule dans les airs pour changer de dimension ; qu’il tire son « écharpe » pour aspirer de sa gueule béante, sans mâchoire inférieure, les âmes vertes qui filent dans les airs ; qu’il empale un adversaire au bout d’une lance, d’un pic ou qu’il le jette dans une eau qui le terrassera sur le coup ; qu’il se rattrape in extremis, in fine, à une corniche après un long vol plané... Ô, ce corps, cet écorché en mouvement... En comparaison, les personnages de jeu vidéo actuels me paraissent vides, stéréotypés, lisses, sans aspérités. Sans âme. Aucun ne me donne aujourd’hui la même sensation de réalité, de présence à son monde que Raziel à l’époque. Et qu’importent ces textures qui se déformaient légèrement – vivantes ! – en raison des limitations techniques d’alors, il y avait quelque chose, une sensation de « vrai » qui s’échappait de chaque animation de Soul Reaver, et que Tomb Raider et sa trop rigide Lara n’avaient alors su m’apporter. C’est aussi grâce à Soul Reaver que, bien avant Assassin’s Creed, j’ai découvert la puissance d’évocation de l’architecture dans un jeu vidéo, que j’ai compris la signification du syndrome de Stendhal. Là, devant les murailles décrépies de forteresses abandonnées, devant les ruines de cathédrales ou des rangées de colonnes brisées s’élevant dans les cieux nuageux, je restai coi, interdit, presque sonné. Raziel/moi n’étions rien, des insectes dans ce monde déchu dont il s’agissait d’escalader chaque pierre, de résoudre chaque énigme. Comme je l’avais fait précédemment du manoir de Resident Evil, puis du château de Castlevania : Symphony of the Night, j’épuisai Nosgoth de ses possibilités d’interaction. Je l’arpentais sans relâche, le faisant mien, jusque dans ses défauts, ses bugs, ses textures tremblotantes, qu’il devienne part de moi, de mes souvenirs, de ma mémoire, qu’il soit en moi à jamais, précieuse bulle temporelle bien rangée dans un des coffres, désormais couverts de poussière, de mon grenier de l’âme. Aujourd’hui encore, il me suffit d’aller chercher une image dans les classeurs désordonnés de mon esprit pour que, tel un livre pop-up, tout Nosgoth se déploie et ressurgisse en moi.
Vous l’avez compris, entre Legacy of Kain, Kain et Raziel, et moi s’est tissé un lien, le même genre de lien qui m’unit au Royaume des Devins de Clive Barker, à L’Arc-en-ciel de la gravité de Thomas Pynchon, au Gluau de John Hawkes, à Resident Evil, à Silent Hill, à Planescape : Torment, à Vagrant Story, aux Illuminations de Rimbaud, au Waste Land de T.S. Eliot, au Conan le Barbare de John Milius, au Batman : Le Défi ou à L’Étrange Noël de monsieur Jack de Tim Burton, aux jeux de rôle papier Rêve de dragon, Premières Légendes : Légendes Celtiques et L’Appel de Cthulhu... Des œuvres qui, à force de lectures, de visionnages, d’heures passées à en explorer chaque recoin, ont infusé en moi, sont devenues miennes, part de moi, de ma vie.
Écrire sur Blood Omen, sur Soul Reaver et les autres, c’est s’attaquer à l’une des franchises les plus complexes jamais élaborées. S’il ne s’agit pas (vraiment) de RPG, ses auteurs, Amy Hennig en tête, ont pris soin de développer un univers, de créer un scénario où voyages dans le temps, espace astral, questionnement sur le libre arbitre, la destinée et le sacrifice, le vampirisme, la divinité et autres thèmes s’entremêlent comme les fils d’une grande tapisserie sanglante. Mais écrire sur Legacy of Kain, c’est aussi se saisir d’une licence monstre partagée Entre deux mondes – les jeux annulés, et ceux sortis, les premiers contenant à l’état de graine, d’esquisse, les seconds –, entre deux époques – celle du jeu de plateforme-puzzle d’une 3D émergente contre celle, actuelle, cinématographique et accessible. Tout Legacy of Kain est d’ailleurs constamment en équilibre Entre deux mondes : ses deux « héros » Raziel et Kain séparés par l’espace, la géographie, le temps ; la Soul Reaver en deux versions – physique et spectrale – ; les deux plans de Soul Reaver, le corps partagé par les deux âmes de Dead Sun, les deux Kain de Dark Prophecy, etc.
Il ne s’agira pas dans ces pages de tout dire, de tout raconter sur Legacy of Kain : l’oeuvre est énorme, touffue, dense ; des sites très spécialisés dénombrent déjà les multiples coupes dans les jeux, extirpant du code et des CD, voire de pages de magazines, des visuels, lieux et fonctionnalités qui ont disparu des versions finales. Dans le cadre d’un ouvrage sans image (ou alors à recourir à l’ASCII ? Nico ? Mehdi ?), cette démarche n’a que peu d’intérêt... Non, pour parler de, pour dire Blood Omen et Soul Reaver, j’essaierai de (dé)montrer qu’il y a eu un moment Legacy of Kain/Soul Reaver, presque un moment PlayStation, un moment « Monstre » durant lequel les jeux d’action-aventure ont en partie lorgné vers le fantastique, vers l’horreur, vers le monstre « comme héros » : American McGee’s Alice (sur PC), Shadow Man, Akuji the Heartless, Oddworld, Nightmare Creatures II... et que j’étais là, moi aussi monstre, à vivre ce(s) moment(s).
Je montrerai aussi que tout Legacy of Kain est un monstre, un collage, une construction intellectuelle faite de bris épars, de restes, de morceaux, chacun de ses volets, chacun de ses membres dérobés à d’autres, mis en pièces puis recousus, réassemblés, transformés. La matière de Legacy of Kain est poreuse, éponge qui se laisse pénétrer, influencer... Une créature de Frankenstein vidéoludique... Et je ne vous parlerai pas, ou si peu, de Planescape : Torment, mon autre jeu de 1999, encore une histoire de monstres, de morts-vivants et d’univers étrange, de monde à dévoiler. Oui, encore un Freak Show pour geeks. Encore un univers pour moi, qui suis toujours Autre, Ailleurs, d’Ailleurs.
C’est donc à un grand tour, à une attraction de foire, merveilleuse et sordide, pleine d’éclats de rire et de larmes, de frayeurs, pleine de coups mesquins et de grandes ambitions, pleine de l’âme et du sang de ses auteurs que je vous convie dans les pages à suivre. Car tout, ou presque, le pire comme le meilleur, est arrivé aux différents créateurs de la série, ainsi qu’à ses personnages. Ce qui a permis à Legacy of Kain de culminer, de briller, puis, ailes brisées, de choir, comme l’ange déchu qu’aurait dû être Raziel.
Notes de l’auteur :
Cet ouvrage a été rédigé avec Dont’ Be Afraid d’Information Society en boucle dans les écouteurs – Empty, Closing In, Ending World et On The Outside ont rejoint Ozar Midrashim au rayon de mes chansons préférées –, ainsi qu’avec les bandes originales des deux premiers Soul Reaver et du premier Blood Omen.
Les employés de Crystal Dynamics, tout comme ceux qui ont travaillé sur différents titres de la franchise Legacy of Kain – ceux de Climax sur Dead Sun –, sont aujourd’hui encore soumis à des NDA (Non-Disclosure Agreement, soit accord de non-divulgation) qui les empêchent de parler, de discuter ou de se livrer à propos de leur travail sur Soul Reaver, suite notamment aux poursuites judiciaires et procès qui ont entaché les développements et sorties des premiers jeux de la franchise. Malgré nos demandes répétées, aucune nouvelle interview n’a donc été possible. Pour sa portion historique, cet ouvrage ne proposera donc que des extraits d’interviews d’époque.
1Cabal en français, toujours par Clive Barker.
CHAPITRE I - CRÉATION
LEGACY OF KAIN : BLOOD OMEN
De sanglants présages
“ Dream little one, dreamDream my little one, dreamThough the hunter in the nightFills your childish heart with frightFear is only a dreamSo dream little one, dream1 ”
Introduction du long-métrage La Nuit du chasseur (Charles Laughton, 1955)
Je n’ai d’abord pas accroché à Legacy of Kain : Blood Omen. Ainsi que je l’ai mentionné en préambule, en glissant le CD dans le lecteur de la PlayStation, je n’attendais pas un Zelda-like « adulte » et gore, sombre jusque dans ses réglages gamma, mais un jeu de plateforme aux effets visuels prononcés, aux musiques entraînantes, aux personnages charismatiques : une symphonie pour mes nuits perdues. Mon frère et moi partagions alors la console, chacun de nous ayant ses jeux de prédilection. Le cas échéant, notre vieille et poussiéreuse Megadrive, son The Revenge of Shinobi, son Phantasy Star IV : The End of The Millennium, ses deux Thunder Force – je rêvais secrètement des enfers chthoniens de Gynoug ! – m’attendaient dans le salon. Non, je n’avais pas besoin d’un Zelda sur PlayStation, j’étais déjà plongé dans l’excellent et tordu Alundra, ou dans un Final Fantasy VII que je recommençais plusieurs fois, squattant une version qu’un ami m’avait prêtée. Inutile de préciser qu’il n’a jamais revu son exemplaire... Pourtant, mon frère, avec qui je partageais mon amour du comics – je suivais Spawn, lui The Darkness – et des films d’horreur, insista. Il avait raison. Passé les premières minutes d’incertitude, passé les chargements intempestifs et ces vociférations de futures victimes qui s’entremêlent, couvrent jusqu’à la musique, Blood Omen parlait au jeune adulte que j’étais, lecteur assidu de Clive Barker et de Lovecraft, auteur amateur s’essayant à en reproduire les figures de style et les thèmes, imaginant de morbides mythologies. Quelques années plus tôt, en 1990-1992, j’écrivais déjà des articles à leur sujet, ainsi que sur Stephen King ou des adaptations de comics au cinéma, dans le fanzine de mon lycée nommé... Le p’tit monstre... Encore une histoire de monstres : on n’en sort pas.
Mon frère avait donc raison, Blood Omen faisait sens pour moi. Je sortais alors tout juste de ma période vampires, après avoir vu l’Entretien avec un vampire de Neil Jordan et avoir dévoré tout ce qu’Anne Rice avait écrit sur Lestat, Louis et consorts, ou encore les Âmes perdues de Poppy Z. Brite (depuis devenu Bily Martin). Mais il y avait là quelque chose d’inédit, d’inattendu dans cette violence, dans cette orgie de sang, quelque chose auquel le jeu vidéo ne m’avait alors pas habitué. Oui, comme une première fois, comme un...
Un commencement
« Un commencement est un moment d’une délicatesse extrême.2 » Un commencement, c’est aussi une impulsion, une intuition, parfois une épiphanie – inspiration divine – qui explose, dans le cerveau d’un créateur, dessinateur, auteur, programmeur ou game designer. Comme ces petits personnages aux cheveux verts fourmillant à l’écran, simple test technique d’affichage de sprites, qui voient Dave Jones et DMA Design imaginer Lemmings. Comme cette partie de Super Mario Kart durant laquelle le game designer Nick Burcombe baisse le son du téléviseur au minimum, lance le morceau techno Age of Love sur son lecteur de CD et explose son record. Le résultat de cette expérience ? WipEout. L’écrivain James Joyce (Ulysse, Finnegans Wake) en a parlé, de ces moments précis et précieux, de ces épiphanies : ses écrits n’étaient d’ailleurs emplis que de cela, du rappel de ces instants-miracles, de ces instants-révélations, recourant à des mots-valises aux sens s’interpénétrant, comme des « clefs des univers et de l’avenir » pour citer le poète américain Walt Whitman. Et si le game designer vétéran Arnold Hendrick (Darklands) vous expliquera que « C’est souvent l’équipe managériale de l’éditeur et le studio qui décident ce qu’ils veulent voir apparaître dans un jeu, dans quel genre ils vont l’inscrire. Et il y a rarement un game designer parmi ces décideurs... », la plupart de ces débuts découlent/ découlaient pourtant d’une idée, d’un concept, d’une illumination. Oui, d’une épiphanie. Demandez par exemple à Denis Dyack d’où provient Legacy of Kain : Blood Omen, et il vous livrera une liste d’influences plus ou moins directes, plus ou moins évidentes, chacune opérant comme une décharge électrique dans son cerveau – une ampoule allumée au-dessus de sa tête : la couverture des Piliers de la Terre pour ses... piliers, la série de romans La Roue du temps de Robert Jordan pour la complexe imbrication de ses trames narratives, etc. Pourtant, il a fallu un moment, un instant précis, précieux, un instant unique où Dyack et son équipe ont compris qu’il leur fallait abandonner l’hybride tactique-arcade de leurs débuts pour embrasser pleinement un action-RPG alors en plein essor.
Les chevaliers de silicone
Le déclic a lieu en 1993. Jusque-là, Silicon Knights, le studio fondé par Dyack en Ontario (Canada) juste après sa sortie de l’université, s’est surtout illustré par des jeux de stratégie reprenant très largement les concepts édictés par le studio Free Fall avec Archon3 (1983, EA). On le sait, depuis ses tout premiers débuts, le jeu vidéo est une grande machine à recycler, une bouffeuse d’inspiration : thématiques, systèmes, tout le monde copie tout le monde, chacun injectant suffisamment de soi – quelques idées, concepts, quelques différences visuelles – dans ses clones pour raisonnablement se différencier de son inspiration. Projetez-vous dans les années 1980, relisez un Tilt, et comptez le nombre de clones de Breakout, ou de son double « augmenté », « shoot-them up-isé », Arkanoid. De nombreux développeurs ne font d’ailleurs que cela : reproduire, améliorer, moderniser des mécaniques éprouvées par le temps et l’usage, tel ce chevelu, toujours hippie, Jeff Minter qui travaille, sculpte, affine la matière Tempest depuis 1994 et sa première adaptation console sur la Jaguar. Carlos Bordeu, fondateur d’ACE Team (Zeno Clash, Rock of Ages), me l’expliquait il y a quelques années, alors que je l’interviewais sur l’originalité peu commune de leur production : « Peu de jeux sont de véritables créations ex nihilo. Tous empruntent plus ou moins aux années d’expérience des générations précédentes. Et ceux qui essaient de nouvelles choses sont ceux qui font avancer l’industrie le plus, ainsi que ceux qui risquent le plus. Aussi, il est logique, naturel, sur un marché où la production est longue et onéreuse, que la plupart des acteurs préfèrent mesurer ces risques. »
Pour ses premières productions, et à l’exemple d’Archon donc, Silicon Knights mêle tactique au tour par tour – avec ce qu’il faut de placement d’unités – et combats arcade en temps réel. En 1992, Cyber Empires (connu sous le titre Steel Empire en Europe) est édité aux États-Unis par un Strategic Simulations, Inc. (SSI) qui se focalise alors sur le Computer-RPG après avoir décroché les droits de Donjons & Dragons en 1987. Seule originalité de cette toute première production de Silicon Knights, la possibilité de jouer à cinq joueurs en mode Hot Seat (l’un après l’autre), option aussi rare dans un jeu de stratégie du début des années 1990 qu’aujourd’hui. Un an plus tard, toujours publié par SSI avec cette fois l’estampille officielle D&D, Fantasy Empires, un Cyber Empires repensé pour se couler dans le moule du jeu de rôle de Gary Gygax et Dave Arneson, reprend un de leurs univers, alors peu exploité, Mystara. Et pour se rapprocher de D&D, d’une expérience jeu de rôle papier, Dyack & Cie intègrent certains de ses concepts clefs : personnages créés gagnant en expérience et progressant durant la campagne, maître de jeu/ donjon qui renseigne le joueur ou commente ses actions... Plus étonnant, le jeu s’ouvre sur une scène d’introduction où, face caméra, cette Divine Rose Trémière (terme qui désigne le MJ dans le JDR papier Nobilis) annonce au joueur qu’un challenge épique l’attend, voix digitalisée en sus. Mais, ainsi que le révélait Dyack, ce n’est qu’avec Dark Legions, un jeu de tactique encore plus inspiré du classique de Free Fall – le titre met en effet en scène des sorciers, démons, élémentaires et des... vampires, bref, un bestiaire littéralement arraché aux suppléments les plus sombres de Donjons & Dragons – que l’idée d’un jeu d’action-aventure émerge, aidée par deux autres facteurs : la sortie américaine, et le succès quasi immédiat, de The Legend of Zelda : A Link to the Past en 1991, ainsi que l’arrivée de la 3DO, bébé maudit de Trip Hawkins et de Panasonic.
« Il est vivant ! »
En octobre 1993, la 3DO sort enfin aux États-Unis. Avec ses spécifications notamment conceptualisées par R.J. Mikal – ingénieur à qui l’on doit Star Rider sur Laserdisc, l’Amiga 1000 ou la Lynx –, la machine « de » Trip Hawkins, l’ex-cofondateur d’Electronic Arts, se veut le premier standard 32 bits équipé d’un lecteur CD-ROM. Pour de nombreux développeurs et éditeurs, c’est le top départ pour une nouvelle génération de consoles. Oui, comme si la PlayStation 5 déboulait dans les rayonnages demain, aussi rapidement qu’un nouvel iPhone : oubliées les cartouches et leurs capacités très limitées, il s’agit pour tous les créatifs vidéoludiques de profiter des possibilités offertes par ce CD-ROM intégré.
Quelques mois plus tôt, Dyack a abandonné l’idée de percer avec des jeux de stratégie – même s’ils se sont bien vendus – et se lance avec son équipe dans la préproduction de plusieurs projets : « Rédigeons quelques propositions et commençons à en parler aux éditeurs. » Silicon Knights contacte différents acteurs du marché, sans réponse probante. Et puis, « il y a cette conférence 3DO à venir, et je pourrais essayer de rencontrer des gens là-bas. J’ai alors quelques idées que je veux écrire. L’une implique un vampire, et l’autre, de la technologie. » Durant l’événement, Dyack rencontre Lyle Hall, ancien de Virgin Mastertronic, fraîchement embauché par Crystal Dynamics, et alors producteur de Gex. « Nous recherchions des développeurs tiers qui avaient le talent et la capacité de développer des jeux originaux de grande qualité, se souvient Lyle Hall. Lors d’une conférence de développeurs, un autre producteur et moi avons rencontré Denis Dyack, fondateur de Silicon Knights. À l’époque, ils venaient de terminer Dark Legions pour SSI. Nous avons discuté de notre vision pour produire et publier des jeux à gros budgets, et cela correspondait parfaitement à l’ambition de Denis de développer des expériences épiques. Nous avons examiné trois concepts de jeu que Denis et son équipe avaient imaginés, et j’ai été immédiatement attiré par l’un d’entre eux nommé The Pillars of Nosgoth. » Les deux autres concepts pitchés par Dyack ? Too Human, une retranscription SF de la mythologie nordique qui ne sortira que des années plus tard avec l’insuccès que l’on connaît, et un troisième, toujours resté inédit, n’intéresseront pas Hall qui propose alors de regarder du côté de The Legend of Zelda. « Denis et son équipe créative étaient extrêmement passionnés par le fait de raconter une histoire, de faire voyager le joueur, ou par l’idée d’apporter une dimension cinématographique, narrative et artistique à un jeu sur console (...) Pour moi, il était évident que ce jeu méritait un style à la Zelda. Nous étions convaincus que nous pouvions vraiment faire évoluer le genre. »
La démarche de Lyle Hall est d’une logique implacable : le Zelda-like, c’est alors la grande tendance, et si les développeurs japonais en sont les maîtres, les studios occidentaux ont sans doute leur carte à jouer en empruntant une autre voie, en approchant le genre sous un nouvel angle, plus sombre, plus cruel peut-être. Et puis, le Japon a bien dérobé et tordu les mécaniques de RPG, pourquoi ne pas leur subtiliser quelques idées ? L’emprunt – conscient ou non – a été/est toujours au centre des développements de jeux, ainsi que vous le rappellerait le game designer Arnold Hendrick : « En tant que game designer, je pense qu’une connaissance large, très large, de tous les types de jeux est clairement nécessaire. Cela me permet de convoquer une grande variété d’outils de design que je peux utiliser pour les jeux qui ont besoin de création. Un designer qui ne s’inspire pas ou n’emprunte pas des idées à d’autres est un idiot. Le truc, c’est de comprendre quelles sont les bonnes idées, et comment les appliquer à des situations spécifiques. La plupart des designers que je respecte suivent une philosophie de design identique. » Toujours curieux des productions du moment – The Legend of Zelda est ainsi une déclinaison grand public des action-RPG préexistants sur ordinateurs occidentaux et japonais –, Shigeru Miyamoto ne pense pas différemment.
Prendre les Piliers de Nosgoth et en faire un jeu d’action-RPG : l’idée est imparable, et le succès probablement à la clef tant l’appétit des joueurs pour ce type d’expérience est désormais démontré. Et puis, la machine « de » Trip Hawkins permettrait d’intégrer voix enregistrées et musiques de qualité symphonique... Pour Lyle, la question de la plateforme ne se pose d’ailleurs pas : ce sera 3DO et rien d’autre. Crystal Dynamics a tout misé sur le nouveau poulain de Trip Hawkins et Panasonic, développant ses deux premiers jeux en exclusivité pour cette dernière : Crash’n Burn (sorti en 1993, programmé par Mark Cerny), une simulation arcade de course techniquement irréprochable, et Gex, un jeu de plateforme en 2D en 1994. Dans l’interview qu’il m’avait accordée pour Joypad Magazine (le numéro d’été 2010), Mark Cerny était revenu sur cet intérêt de Crystal Dynamics pour la 3D et la 3DO, ainsi que sur les difficultés posées par la machine : « J’ai été le premier créateur engagé par Crystal Dynamics, et mon job était d’imaginer des titres de lancement pour le Multiplayer 3DO. En fait, nous avons rencontré deux gros problèmes. D’abord, il était un peu tôt pour lancer un système avec des jeux en 3D. Même avec une ingénierie parfaite, il n’y avait pas assez de puissance de calcul en 1993 pour qu’une console de salon puisse afficher des graphismes en 3D avec un bonframerate. Et nous n’avions pas une ingénierie parfaite ! La 3DO a originellement été développée pour afficher de la 2D. La 3D, c’est presque venu après, aussi le rapport prix/performance était vraiment nul. Juste pour vous donner un détail, vous ne pouviez pas utiliser le CPU et le GPU en même temps, il fallait choisir l’un ou l’autre ! Aucune autre machine avant ou après la 3DO n’a fait ça. Pour nous, cela signifiait deux fois moins de puissance ! Le second problème, c’était le prix. Personne n’était prêt à payer 700 dollars pour une console. Il y a une limite à ce que peut accepter le marché, estimé à 400 dollars, et ce, même pour les acheteurs du premier jour ! »
Pour l’éditeur, un The Legend of Zelda-like, qui plus est orienté « joueurs adultes », constituerait un apport de poids à ce catalogue 3DO, l’élargissant à la plupart des genres alors à la mode : plateforme, course auto et action-RPG. Mais, au moment où Dyack et Hall entrevoient ce que pourrait devenir ce projet, The Pillars of Nosgoth n’est encore qu’à l’état d’ébauche, de vision.
De grandes inspirations
Les Piliers de Nosgoth, ce sont des dizaines de pages de notes et ratures, de croquis de personnages malingres, anormaux, de lieux gothiques en ruines, ainsi qu’un scénario en partie rédigé par Ken McCulloch, le partenaire de Dyack chez Silicon Knights. Tout est déjà là, prêt à être insufflé, engoncé dans un moule ludique, même si le studio ignore encore quelle forme réellement donner à cette aventure. Mais, déjà, quelque chose se dégage de ces images, de ces mots jetés et couvrant les feuilles de ce document de développement : des inspirations, des références, parfois sans rapport aucun avec cette fantasy sombre, morbide qui occupe alors les jours et nuits créatives de Dyack & Co. Premier concerné par ces influences extérieures, Kain, antihéros malgré lui, porté par une seule soif de vengeance. Pour reprendre le site officiel, « Kain a été en partie conçu d’après le personnage de Clint Eastwood dans Impitoyable. (...) Nous voulions poser la question, “ Qu’est-ce que le mal ? Peut-être simplement une question de perspective. ” Nous souhaitions créer un antihéros. » Sur un forum, Dyack s’étendra plus précisément sur l’influence d’Impitoyable : « Je ne suis pas un grand fan de western, mais après avoir vu ce film, j’ai été époustouflé. Il y était surtout question des personnages. Impitoyable, c’est la représentation ultime de la zone grise, sans “ bons ” ni “ méchants ”. Tous les personnages errent entre ces deux extrêmes, et chaque action a un prix, une conséquence. Après avoir vu ce long-métrage, j’ai immédiatement compris que notre industrie avait besoin qu’un jeu questionne les joueurs sur ces problématiques. Imaginez un jeu où tout le monde serait votre ennemi (y compris vous-même), un univers où vous devriez tuer des innocents pour survivre, un univers où vous seriez le pion ultime. Comment les joueurs réagiraient-ils dans cette situation, comment se sentiraient-ils ? Si tout le monde pense que vous êtes mauvais, l’êtes-vous vraiment ? Ou le mal n’est-il qu’une simple question de perspective ? » Autre source d’inspiration, évidente pour tous, que pourtant le fondateur de Silicon Knights ne révéla que récemment, lors d’une de ses émissions, The Quantum Tunnel, sur YouTube : Elric de Melniboné. Armé, comme Kain, d’une épée dévoreuse d’âme, sa lame noire Stormbringer, le personnage créé en 1961 par l’auteur Michael Moorcock se veut l’anti-Conan par excellence, l’antihéros de fantasy incarné : albinos, faible, drogué, manipulé par cette arme qui tue à sa place, diffuse son venin jusque dans son esprit pour le mener vers une, et une seule fin – forcément dramatique ! Un prince tragique ! Un pion ultime !
Et pour le décrire, cet Elric, qui mieux que son créateur dans le premier ouvrage le mettant en scène, Elric des Dragons : « Un teint d’une pâleur mortelle. De longs cheveux d’une blancheur laiteuse, qui tombent plus bas que les épaules. Des yeux en amande, de tristes yeux couleur de rubis, dans un beau et long visage. Deux fines mains de cette même blancheur cadavérique, qui émergent des manches vagues d’une robe jaune pour reposer sur les bras d’un fauteuil en rubis massif. » Et si Elric a inspiré Kain (et, on va le voir, également Geralt de Riv), il est lui-même le fruit d’influences antérieures comme le rappelle Moorcock dans son introduction à Elric le nécromancien : « Conçu en 1955 sous l’influence du Well of the Unicorn de Fletcher Pratt et de certains éléments dérivés des fables de chevalerie et des contes orientaux qui (par Merritt, Haggard, Burroughs et Howard interposés) avaient enchanté mon enfance, Elric fut le premier personnage que je destinai véritablement à un public adulte. L’idée fut délaissée tandis que je me consacrais à la rédaction de Sojan, une série de pastiches à la manière d’Edgar Rice Burroughs pour Tarzan Adventures. » Puis Moorcock se lasse de l’heroic-fantasy, la délaisse un temps avant que le destin ne les rattrape, lui et son antihéros albinos. « C’est seulement en 1959 que John Carnell me commanda une série pour sa revue Science Fantasy. [...] Carnell était en quête d’un personnage entièrement neuf. Je décidai donc de ressusciter Elric et de le faire aussi différent que possible des héros conventionnels de “ Sword and Sorcery ”. Le manuscrit original de 1955 fut exhumé et me servit de base de travail. Pour l’aspect physique d’Elric, je m’inspirai en grande partie de Zenith l’Albinos, un malfaiteur qui avait hanté, avant guerre, les pages de la série Sexton Blake (The Sexton Blake Library était en gros l’équivalent du feuilleton français Fantomas ou du Nick Carter américain ; je fus l’un de ses éditeurs dans les dernières années de son existence). Au moment où je me mis au travail, j’avais déjà perdu tout intérêt pour la science-fiction et le fantastique traditionnels, et je me tournais vers les œuvres d’écrivains tels que Camus, Brecht ou Borges. »
Aussi étonnant que cela puisse paraître, Elric comme Kain sont nés d’un rejet viscéral de lafantasy classique, de ses clichés – chevaliers, dragons, elfes et nains – trop souvent lus et exploités, « de la littérature Donjons & Dragons » pour reprendre les mots de Moorcock, leurs auteurs insufflant leurs obsessions, leur questionnement moral dans leur antihéros. Et qu’importe que celui de Dyack soit moins connecté à sa lame, Soul Reaver4, que l’antihéros de Moorcock ; qu’importe que le Prince de Melniboné soit un avorton comparé au bodybuildé Kain – du moins sur l’écran d’inventaire –, la référence est immédiatement visible, presque aussi assurée que pour le personnage principal de The Witcher. Et ce, même si Andrzej Sapkowski, grand connaisseur de fantasy occidentale avant même la création de Geralt de Riv, s’en défende. Son ouvrage, toujours non traduit, sur la fantasy, Rękopis znaleziony w smoczej jaskini. Kompendium wiedzy o literaturze fantasy, nous rappelle sa connaissance pointue du genre, l’auteur courant les librairies en quête de nouveautés à chaque sortie de son pays natal quand le mur de Berlin scindait encore l’Europe en deux.
D’autres références avouées par Dyack ? La série Necroscope de Brian Lumley : « Cet écrivain a créé une série [N.D.A. : de romans] sur les vampires scientifiquement crédible. Elle a particulièrement inspiré Ken [N.D.A. : McCulloch], l’auteur de nos scénarios. Lorsque nous imaginons des histoires, nous essayons de reprendre à notre compte des modèles classiques, tels ceux conçus par Shakespeare. Vous voyez, quand il rédigeait une pièce, son histoire proposait plusieurs niveaux de lecture. Pour distraire les roturiers ivres des premiers rangs, il insérait des plaisanteries, mais pour l’aristocratie assise aux balcons, ses métaphores prenaient des détours plus intellectuels. À Silicon Knights, le gore, le sang, c’est notre blague, mais pour ceux qui en veulent plus, il y a une vraie histoire dans Legacy of Kain. Nous avons essayé d’aborder la morale, le bien et le mal, la propagande et le destin d’une manière qui ne l’avait jamais été dans un jeu vidéo. » Dans Blood Omen, le gore, le sang amusent la galerie, choquent, quand les personnages, l’intrigue à tiroirs, les dialogues et monologues, eux, interrogent, se destinent aux joueurs plus exigeants. On le verra, Amy Hennig, plus tard, conservera la même approche pour ses Soul Reaver.
Au contraire de certains démiurges omnipotents, de control freaks comme Ken Levine (BioShock) ou Hironobu Sakaguchi (Final Fantasy) qui tiennent à toucher à tout, quitte à provoquer le chaos dans leur équipe, l’écriture n’est nullement la chasse gardée d’un Dyack ou d’un McCulloch chez Silicon Knights : « Généralement, tout le monde contribue à l’histoire – nous travaillons avec une mentalité de guilde où tout le monde apporte ses idées. J’ai créé le concept initial et le plan de l’histoire – il s’appelait initialement les “ Piliers de Nosgoth ”. Ensuite, tous les développeurs de Silicon Knights ont réfléchi et contribué aux diverses parties du scénario. Nous avons séparé le bon grain de l’ivraie. Puis Ken et moi avons mis sur papier l’histoire détaillée, et Ken a alors commencé à rédiger la version définitive et à concevoir les mythologies détaillées du monde de Nosgoth. » Par ailleurs, loin de créateurs qui s’imaginent capables de construire des mondes ex nihilo, sans inspiration extérieure – les fous ? –, Dyack ne voit, ainsi qu’on l’a déjà souligné, que de multiples inspirations se croisant, s’hybridant les unes les autres, avec les mythes comme structures fondamentales à l’édifice narratif, à la racine même de chaque histoire contée : « J’irais jusqu’à dire que toute la littérature et tous les divertissements sont influencés par les mythes : que les gens l’acceptent ou non, nous sommes fondamentalement immergés dans les mythologies de notre culture. D’une certaine manière, la mythologie définit la culture. C’est inévitable. Chaque scénario usuel revient presque toujours à certaines mythologies. » Dans Blood Omen, une vengeance sanglante mènera Kain et le joueur d’un bout à l’autre de Nosgoth. La vengeance, y a-t-il thème plus commun à toutes les cultures ?
La fin n’est que le commencement
Si le choix de la 3DO a d’abord tout de l’évidence – c’est alors théoriquement la console la plus puissante du marché et Crystal Dynamics y a misé tous ses deniers –, son incapacité à s’imposer comme norme, son échec commercial, puis son abandon pur et simple, poussent Silicon Knights et son éditeur à jeter leur dévolu sur la PlayStation de Sony, alors annoncée. On est fin 1993. Pillars of Nosgoth est abandonné purement et simplement. Et de ce trépas, de ce cadavre encore fumant et déjà fertile, naît Blood Omen : Legacy of Kain. Mais tout part à vau-l’eau. Et notamment le code du jeu lors de son adaptation pour la PlayStation. Le passage d’une console à l’autre n’est pas sans conséquences sur les chargements d’informations à partir du CD et leur mise en mémoire. D’où les ralentissements visibles, et les loadings brisant la continuité, la fluidité de l’aventure. « La Sony avait 3 Mo de RAM. 1 Mo était dédié à la vidéo (VRAM) et 2 Mo aux données (DRAM). Le problème avec Kain était que nous avions 2,5 Mo de graphismes (en VRAM) et 0,5 Mo de données (en DRAM). Cela signifiait que nous devions stocker les graphismes dans des parties de la machine où ils n’auraient pas dû se trouver. Cela explique la majeure partie des ralentissements éprouvés. », rappelle le site officiel.
De fait, tout Legacy of Kain : Blood Omen est affaire de concessions faites à la faiblesse technique supposée (ou de la mauvaise utilisation de la puissance) de la machine de Sony, ainsi que d’économies nécessaires pour achever le projet sans y perdre trop de plumes. Contrairement à de gros studios, Silicon Knights n’a pas les moyens de travailler sur des stations Silicon Graphics pour produire les cinématiques du jeu – on ne reviendra pas sur le gâchis de Square à l’époque de Final Fantasy VII, ses développeurs n’ayant pas compris que chaque séquence refaite leur coûtait beaucoup, beaucoup d’argent. De simples outils du commerce, et d’abord des ordinateurs (presque) accessibles à tous, comme des PC 486 ou des Pentium 90 avec des programmes comme 3D Studio, Animation Master ou Animator Studio sont donc mobilisés pour donner vie à ces séquences cinématographiques auxquelles Dyack tient tant. « Notre intention initiale était de réaliser les séquences cinématiques et de vol en haute résolution vidéo. Nous avons fait quelques calculs et constaté qu’avec la puissance dont nous disposions, il nous aurait fallu plus de temps que ce que nous avions à notre disposition. De plus, la PlayStation de Sony, et les PC d’ailleurs, n’auraient pas été en mesure d’afficher une vidéo fluide à cette résolution. » Concessions, oui, économie sur tous les postes imaginables, encore et toujours. Pour autant, le développeur prend le temps d’affiner, de détailler certains segments du jeu, comme les séquences de vol entre deux lieux. « Une grande quantité d’espace disque dur était nécessaire pour la séquence de vol, chacune nécessitant généralement 2 000 images (pour plus de 400 Mo par cinématique !). Les copier sur notre réseau de bureau était gourmand en ressources. Un “ Personal Animation Recorder ” (Enregistreur personnel d’animation) était utilisé pour lire la séquence d’images vidéo à la fréquence d’images désirée, afin que nous puissions prévisualiser notre travail. Les images vidéo étaient ensuite traitées dans un format vidéo spécifique à la PlayStation qui peut lire quinze images par seconde. » Enfin, toujours pour économiser de la place sur le CD-ROM, et à la manière des techniques usitées par Nintendo sur Super Mario Bros. ou par Square dans l’écran de présentation du premier Final Fantasy, les tuiles de pixels (tiles en anglais) sont produites de manière à pouvoir être disposées