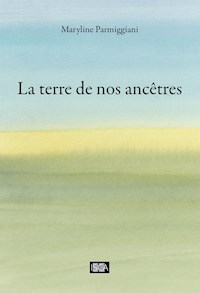
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Isca
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
En juillet 1975, Piet passe des vacances dans sa famille paternelle flamande, au bord de la Mer du Nord. Entre non-dits, révélations, intimidations et promesses arrachées, l’adolescent de 15 ans va, avec l’aide de sa cousine Alida, dénouer un à un les nœuds solidement serrés d’une histoire familiale quelque peu singulière.
Une plongée dans des secrets de famille où se côtoient l'Histoire de Belgique et les légendes de l’Irlande.
Parce que la terre de nos ancêtres n’est pas toujours celle que l’on croit et parce que les transmissions familiales prennent quelquefois des chemins sinueux.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Maryline Parmiggiani a des origines belges, un mari italien et deux belles-filles suisses alémaniques. Elle vit au bord du lac Léman depuis 1979. Elle a été secrétaire pendant vingt-cinq ans dans un service de consultation pour couples. Riche de cette expérience, de ce pluriculturalisme et de ses nombreuses lectures, elle s’est mise – sérieusement - à l’écriture depuis sa retraite.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maryline Parmiggiani
La terre de nos ancêtres
roman
© 2022, Maryline Parmiggiani.
Reproduction et traduction, même partielles, interdites.Tous droits réservés pour tous les pays.
ISBN 978-2-940-72348-5
On est de son enfance comme on est d’un pays.
A. de St-Exupéry
Bredene Camping
Il faut prononcer : BRÉ – DE – NE.
C’était, à l’époque, un bel endroit de la côte belge, le seul encore sauvage, à l’état naturel, des kilomètres de sable et de mer. Les dunes y formaient un monticule protecteur. Ici pas de front de mer, pas de bétonnage, pas d’agitations citadines. Juste la nature pure et rétive.
Une passerelle piétonne enjambait la route côtière et se prolongeait par un sentier creusé dans les dunes. Ce long couloir vers la mer était garni d’oyats, d’élymes des sables et de panicauts maritimes. Un chemin que Piet empruntait depuis l’enfance et chaque année, les mêmes sensations le gagnaient, une excitation teintée de réjouissances et d’appréhensions. Ses vacances à Bredene avaient toujours été pour lui une jonction entre deux mondes, le passage d’un horizon à un autre. Quand Piet quittait la passerelle, progressivement le vent venait le chercher, tourbillonnait, dansait, virevoltait et finissait toujours par l’enlacer. Piet progressait en toutes circonstances, quels que soient les obstacles, météo ou vacanciers, pour atteindre triomphalement le promontoire. Là, l’immensité de la mer l’aspirait tout entier. Il était happé, absorbé par l’horizon bleu. Piet ouvrait grand la bouche et l’air iodé s’engouffrait dans ses poumons pour le propulser aussi vite un mètre en arrière. Il ressemblait au bonhomme de ce jouet ancien qui défie les lois de l’équilibre grâce à ses balanciers. Piet vacillait mais restait debout. Le vent était vaincu. Alors, il hurlait de bonheur mais ses cris étaient aussitôt avalés par les éléments. Le vent était à nouveau vainqueur. Ce vent fidèle, impétueux, agaçant, envahissant restait à jamais le roi de la Mer du Nord. Il fallait l’écouter, comme disait Brel, celui de l’est, l’écouter tenir, celui d’ouest, l’écouter vouloir, celui du nord l’écouter craquer et enfin celui du sud l’écouter chanter1.
Bredene, c’était tout cela à la fois. La mer et le vent qui n’appartenaient à personne et une terre asséchée qui était celle de ses ancêtres. Cela avait été une certitude, du moins pendant un temps.
En ce mois de juillet 1975, tout se répétait une fois encore. Piet était arrivé la veille à la gare d’Ostende et avait pris le tram jaune qui longe tout le littoral, le kusttram, jusqu’à Bredene Camping. Comme chaque année depuis ses sept ans, il venait retrouver là ses grands-parents paternels, Albert et Luisa qu’il appelait affectueusement Opa et Oma. Il y avait aussi son oncle Maarten et sa tante Olga, et surtout, ses cousins Dirk et Alida.
Pour la première fois, il avait voyagé seul. Ses parents étaient restés sur le quai de leur petite ville de Wallonie. Son père l’avait gratifié de quelques conseils sur le changement de train à Bruxelles-Midi et d’un salut à tout le monde. Sa mère l’avait embrassé d’un baiser mouillé comme il les détestait. Enfin, c’est terminé, avait pensé Piet quand le train s’était ébranlé. Son père avait-il eu, à cet instant précis, la même pensée ? Fini la corvée de l’amener et surtout d’aller le rechercher en restant un ou deux jours, pour faire plaisir.
Aussitôt installé sur la banquette en similicuir de la deuxième classe, après un petit signe par la fenêtre, Piet avait ouvert La ballade de la mer salée. Il ne savait pas encore que cette lecture allait être, comme ce séjour, une révélation à bien des égards. Par sa lecture, il venait de s’embarquer pour la première aventure de Corto Maltese, ce pirate, bientôt légendaire, qui était en train de détrôner le Tintin de son enfance.
À l’origine, Albert, le grand-père paternel de Piet était paysan comme tous ceux qui l’avaient précédé. Ils avaient labouré leurs champs dans les polders, ces étendues artificielles de terre gagnées sur la Mer du Nord. Un travail harassant et récurrent d’assèchement et de culture. Après la Seconde Guerre mondiale, Albert avait commencé par louer quelques semaines par an des bouts de terrain à des campeurs et il s’était mis à rêver de vivre mieux. Se sentant épaulé par ses deux fils, Henri et Maarten, il avait fini par abandonner les cultures et développé un camping qu’ils baptisèrent De Vossenhol, le terrier du renard, en hommage à leurs ancêtres, les Vandenvos. Très vite, ils avaient construit de leurs mains les premiers bungalows et la saison touristique avait pu ainsi déborder des deux mois d’été. Un certain dimanche de juin 1959, Henri, le fils aîné, avait croisé sur la plage la belle Louise. Quelques semaines plus tard, il claquait la porte familiale pour rejoindre son amoureuse en Wallonie. La famille allait vivre des années de discorde. Pour Henri, ce fut un exil définitif.
En août 1967, à l’hôpital Sint-Jozef d’Ostende, Piet, qui s’appelait encore Pierre, fit la connaissance de sa famille flamande. La veille, son père était rentré du travail et avait fébrilement interpellé son épouse.
– Louise, fais les valises, on part pour Bredene !
C’était la première fois que Piet entendait ce nom. L’agitation de ses parents l’avait d’abord empêché de poser des questions. Il avait suivi sa mère à l’étage et assis sur le lit conjugal, l’avait regardée remplir une valise. Finalement, elle avait murmuré :
– La mère de papa est à l’hôpital, nous allons aller la voir.
– Mais, mais, elle n’est pas morte ? avait demandé Piet.
– Bien sûr que non, pourquoi dis-tu cela ? Enfin !
– Ben, j’ai cru qu’ils étaient tous morts puisqu’il ne fallait pas en parler.
– Mais non ! Écoute, c’est un peu compliqué. Va chercher quelques bandes dessinées, deux trois trucs pour jouer et mets-les dans ton kitbag rouge. Je m’occupe de tes habits.
– D’accord, avait dit Piet puis il s’était ravisé, Mam, c’est où Bre… ?
– Bré-de-ne, avait-elle articulé. C’est à la mer, près d’Ostende…
– C’est loin ?
– Deux petites heures.
Et elle avait rajouté fermement :
– Surtout pas de questions à ton père ! ça va l’énerver. On t’expliquera plus tard.
Piet, du haut de ses sept ans, avait relevé le fait qu’il partait à la mer voir la mère de son père et que ce voyage rendait ses parents très nerveux. Il était donc monté dans la voiture, avait sagement déployé son Journal de Tintin, néanmoins déterminé à sonder la conversation de ses parents. Mais rien n’avait filtré. Les adultes étaient restés silencieux. Les quelques heures indiquées par sa mère parurent une éternité et Piet finit par s’endormir sur la banquette arrière. Il fut réveillé par les jurons de son père qui cherchait à se garer.
Après l’angoissante traversée de l’hôpital par d’interminables couloirs blancs, Piet avait attendu avec sa mère dans une salle aux chaises orange destinées sans doute à réchauffer l’atmosphère aseptisée. Son père était réapparu après quelques minutes avec des nouvelles rassurantes mais surtout, derrière lui, deux portes battantes s’étaient ouvertes sur une nouvelle famille. Ils étaient tous venus, apparemment inquiets pour la grand-mère mais bien plus curieux encore d’assister au retour du trublion. Le salut le plus scruté avait été celui entre le grand-père et son fils Henri, un hochement de tête réciproque. Pour Piet, la brumeuse gêne des adultes s’évapora devant les sourires radieux de deux autres enfants à peine plus âgés que lui. Alida vint spontanément prendre son cousin Piet par la main pour le conduire vers le grand-père en disant : “Lui, c’est Opa !” dans un français approximatif. Les adultes se regardèrent et des éclats de rire retentirent enfin. Cet instant scella pour toujours un lien étroit entre les cousins mais surtout, contre toute attente, une rencontre éblouissante entre un grand-père et son petit-fils.
Et c’est ainsi que les ancêtres flamands s’installèrent durablement en Wallonie. Mentalement, cela va sans dire. De retour de son premier séjour de vingt-quatre heures à Bredene, Pierre, de son vrai nom de baptême, décréta qu’il s’appellerait désormais Piet. Le refus virulent de son père, disproportionné selon la mère, eut, dès le début, peu d’effet. Le gamin était têtu et débordait d’imagination, il utilisa tous les subterfuges. À la rentrée scolaire, il commença par convertir tous ses copains, mentit à l’instituteur, modifia systématiquement ses étiquettes de cahiers, les nominettes de ses vêtements, pourchassant avec la bouteille de Tipex de sa mère, la moindre trace francophone de son prénom : un coup de pinceau sur les trois dernières lettres, la tige du R vers le haut, une petite crolle2 vers le bas et la crevette était dans le filet, expression qu’il avait déjà reprise de son Opa, pour indiquer que le tour était joué. Appelé à la rescousse, le psychologue scolaire avait conseillé : « Si vous entrez en conflit permanent avec lui, vous n’y arriverez pas ! Mieux vaut accepter et vous verrez cela lui passera… ». Mais ce furent les mois qui passèrent et la situation persista. La mère se retrouva vite à arbitrer les joutes linguistiques entre père et fils. La seule chose qu’ils gardaient en commun était leur inflexibilité. De guerre lasse et quand il découvrit que sa femme s’était soumise en cachette, Henri accepta que tout le monde appelle son fils Piet, tout le monde sauf lui. Piet consentit alors à son tour de rester Pierre pour son père. Il transforma d’ailleurs curieusement cette soumission en privilège, éclairant ainsi en toute innocence le lien filial qui allait un jour préoccuper toute la famille.
Piet passait ainsi un mois d’été à Bredene. Et là, grand-père et petit-fils devenaient inséparables, l’un n’avait jamais autant parlé, raconté, montré, transmis, l’autre était si curieux, si affectueux, toujours enthousiaste et tellement candide. Au désespoir de son père qui ne lui avait jamais parlé dans sa langue maternelle, Piet apprit le flamand avec une grande facilité. À chaque vacance, Albert lui apprenait de nouvelles expressions, parfois même des jurons et le soir quand Piet les répétait malicieusement à table, Luisa levait les yeux au ciel, s’exclamant Oh my God ! en se signant au passage. Albert était très fier de son petit wallon devenu le plus flamand de toute la côte, comme il le proclamait.
Dans la voiture du retour, c’était toujours la même rengaine, Henri se crispait sur le volant en vociférant que le vieux cherchait à endoctriner son fils et les vacances finissaient toujours en drame. Piet n’y comprenait rien car malgré les hostilités réciproques, son père continuait à le conduire à Bredene chaque premier dimanche de juillet et à venir le rechercher chaque premier dimanche d’août. Louise, sa mère les accompagnait parfois, les années où elle s’en sentait le courage. Ils restaient alors quelques jours supplémentaires tous les trois dans un bungalow réservé au fond du camping. Toujours en retrait, Louise passait ses journées à la plage. Les réunions familiales consistaient surtout en des œillades pleines de non-dits, des conversations qu’Henri devait traduire et qui puaient les faux-semblants. Il aurait été plus simple de s’exprimer en français puisque tout le monde le parlait mais à la question naïvement posée un jour par Piet, la réponse du grand-père avait fusé : Het is Vlaanderen hier ! Et, oui, nous étions en Flandre et l’étrangère devait s’adapter. Au retour, dans la voiture, c’était cette fois la ritournelle de sa mère qui prévalait : C’est la dernière fois, je te le dis, ils ne me reverront plus jamais ! Je fais l’effort de venir, je mords sur ma chique3 et ils me traitent comme une moins que rien.
Et cela avait été en effet la dernière visite de sa mère. Piet gardait un souvenir très précis de ce dernier séjour. Après une partie de pêche à la crevette avec son grand-père et ses deux cousins, il avait déboulé fièrement dans la cuisine pour montrer ses prises et il avait trouvé sa grand-mère en train de rire de bon cœur avec ses deux belles-filles. Il avait été surpris, un bref instant, par la plénitude de ce moment, la vision singulière d’une famille joyeuse. Mais aussi vite, sans se retourner, il avait su que son grand-père venait de franchir la porte. Le sourire gêné de sa grand-mère et le silence brutal avaient glacé le cœur de Piet. Devait-il croire aux explications furtives qui lui avaient été fournies ? Entre incrédulité et absurdité… Tout cela parce qu’un jour un flamand marie une wallonne et qu’une wallonne ne parle pas flamand ?
Mais, voilà, cette année Piet avait quinze ans et il avait voulu se rendre seul à Bredene. Il libérait ainsi les adultes des contraintes qu’ils s’imposaient mais surtout il se protégeait, lui, d’un douloureux tiraillement. Par la fenêtre du train SNCB, il venait de découvrir d’autres paysages que ceux qu’il avait vus depuis la voiture de son père. Il y avait tellement d’aiguillages possibles, pas seulement le chemin emprunté par ses ancêtres, mais plein de routes, de contre-allées et de carrefours pour changer de direction. Piet avait été un enfant insouciant et joyeux qui avait vécu comme Tintin, des émotions pures, des aventures loufoques et des chasses aux trésors rocambolesques. La révélation de cette famille paternelle l’avait emporté dans une réalité rugueuse avec son lot d’amertume, de désillusions et de déloyautés. Il était en train de devenir un adolescent sensible, responsable et indépendant. Riche de cette pluralité familiale et linguistique, il pouvait maintenant partir à l’aventure, comme Corto, et choisir la direction de sa propre vie.
Alors ce matin, sur le sentier des dunes qui lui était si familier, abandonné au vent qui le faisait osciller entre deux mondes, pour la première fois, il ne résista pas et se laissa porter. Délesté du poids des vicissitudes des adultes, il se sentit plus léger et plus libre. Du moins, il le crut.
1 Le plat pays. Jacques Brel. 1962. © Fondation Jacques Brel.
2 Boucle. Belgicisme.
3 Se contenir, dissimuler ses sentiments (de colère, de chagrin). Belgicisme.
Piet, Alida, Dirk… et les autres
–Alors, vous venez ? Ça fait des plombes que je vous attends…
Alida avait passé le nez dans l’embrasure de la porte du bungalow.
– Allez-y sans moi, je suis crevé, annonça Dirk en replongeant la tête sous son oreiller.
– Chouette ! Les vacances commencent bien, objecta Piet.
Il saisit un linge de bain sur le dossier de la chaise, couvrit sa tignasse rousse de la casquette des Boston Celtics et claqua la porte derrière laquelle se perdirent les jurons de Dirk.
Alida prit son cousin par la taille et l’embrassa affectueusement sur la joue.
– Dis donc toi, tu as pris combien de centimètre depuis l’année passée ?
– En largeur ou en longueur ? demanda Piet en rigolant.
– Pas d’ici en tout cas, dit Alida en le chatouillant sous les côtes, quel graatmager4 !
– Un soret, tu veux dire ! Eh oui, j’ai même dépassé mes copains, Jeanke et Simon. Alors, fais gaffe ! dit-il en se soulevant sur la pointe de ses slaches5.
Piet, qui avait été un enfant plutôt chétif, le plus petit de sa volée scolaire, avait fait une poussée spectaculaire à l’adolescence. Il avait néanmoins conservé son visage juvénile et surtout des taches de rousseur, plus parsemées mais toujours bien présentes. Ses traits étaient harmonieux et fins, son air candide avait fait place à une certaine bonhomie. Une mâchoire carrée lui donnait l’air assuré et volontaire. Il ressemblait de plus en plus à son père, même chevelure fournie et cuivrée, mêmes iris, grises les jours de pluie, vertes par beau temps comme aimait les qualifier sa mère. Ils avaient la même dégaine, légère et nonchalante.
Sa cousine Alida était à peine plus âgée que lui, elle avait eu 16 ans au printemps. Piet avait été un peu intimidé en la retrouvant cet été, c’était devenu une beauté avec ses longs cheveux blonds qui ondulaient au rythme de son déhanchement, sa taille élancée, svelte et sportive. Son visage aussi s’était aminci, elle avait perdu son minois enfantin et son teint hâlé faisait ressortir davantage ses yeux clairs. Sa bouche plutôt charnue contrastait avec un petit nez pointu et l’ensemble lui donnait un charme particulier. Alida avait du tempérament et de la répartie, un caractère bien trempé et un sens inné du contact. Cette nature avenante lui venait de son enfance passée dans le camping, au milieu des touristes, là où les enfants se sociabilisent si facilement. Ce n’était pas le cas de son frère Dirk, d’un an son cadet. Il avait été tenu à l’écart, élevé par leur grand-mère. De santé fragile, trop perméable au moindre microbe pour être exposé aux quatre vents du camping, il était resté dans le nid douillet de l’appartement familial. Ce petit blondinet aux yeux noisette avait hérité de la corpulence de la lignée masculine, comme son père et son grand-père, trapue et plutôt courte sur jambes. Il était devenu un adolescent renfrogné et solitaire qui arrivait toujours le dernier à la plage et préférait passer ses après-midis au Las Vegas 2000 devant la course de voitures du Gran Trak 10 et ses soirées on ne sait z’où !
Alida avait quitté le bras de Piet et s’élançait maintenant dans le chemin des dunes pour rattraper un couple d’adolescents, deux silhouettes de même taille, sveltes et pâlichonnes dont le sommet du crâne rougeoyait de frisottis, courts pour lui et mi-longs pour elle. Piet n’était pas mécontent de se retrouver seul à cet instant pour traverser le passage, comme il l’appelait. À un endroit précis, il avait un rituel. Là, à la jonction des dalles et du sable, il fermait les yeux, se laissait porter par le vent et après exactement dix pas, dans une grande inspiration, il ouvrait en même temps les yeux et la bouche. Il reculait alors de deux pas et poussait un cri qui faisait immanquablement retourner les touristes les plus proches.
– Ne vous inquiétez pas, s’exclama Alida dans un anglais parfaitement fluide. C’est juste mon cousin qui salue la mer !
– Et il débarque d’où avec sa casquette des Celtics ? Des State’s ? demanda Nuala.
– Oh non, de… comment dit-on, Wallonie, French Belgium, balbutia Alida.
Colm toisa Piet et ironisa :
– Wallonia ? Are you sure ?
Alida héla Piet et fit les présentations :
– Piet, je te présente Nuala et Colm, mes nouveaux potes… depuis…
– Depuis hier, ajouta Nuala dans un éclat de rire.
– Hello, dit Piet en soulevant sa casquette.
Alida ajouta :
– Ils sont jumeaux et irlandais.
– Nobody’s perfect ! lança Colm.
Quelques minutes plus tard, ils étaient tous installés sur leur serviette respective, au pied des dunes, là où les autochtones savent que la marée et le vent de l’est ne viendront que très tard les perturber. Entre eux et la mer, des dizaines de familles commençaient à envahir la plage par cette belle et chaude matinée de juillet.
Piet fit connaissance avec ce jeune duo singulier. Il tomba immédiatement sous le charme de la jeune fille pétillante aux cheveux auburn et à la frange qui dissimulait de grands yeux verts. Nuala avait un petit nez retroussé parsemé de taches de rousseur et une fine bouche qui se ponctuait de deux fossettes lorsqu’elle parlait mais surtout lorsqu’elle souriait. Elle avait un tempérament joyeux et espiègle qui pouvait rapidement se transformer en une contenance réfléchie et analytique. Son frère jumeau, Colm, était une grande perche à la Gaston Lagaffe, aux yeux rieurs et à la chevelure hirsute avec des favoris d’au moins 5 centimètres. Il n’avait pas le sourire ravageur de sa sœur, ses canines étaient trop saillantes. Avec son jean à pattes d’eph et son t-shirt moulant, il paraissait tout droit débarqué de Wight. Son allure bohème traduisait un tempérament d’artiste, il allait dans quelques semaines entrer au prestigieux National College of Art and Design de Dublin. Sur le chemin de leurs vacances en Italie, Colm avait entraîné sa sœur jusqu’à Ostende pour visiter la maison natale de James Ensor, ce peintre dont il admirait l’œuvre mais aussi la libre-pensée.
Piet, d’abord content de pouvoir pratiquer son anglais, eut très vite des doutes sur la langue qu’il entendait. Rien à voir avec la langue professée au collège de St-Paul, les jumeaux avaient un fort accent chantant.
– J’ne suis pas sûr de tout comprendre, lança Piet à Alida, en flamand.
– Je parle français si tu veux, annonça Nuala qui avait supposé très justement la remarque de Piet.
– Moi, just un poti pieu ! interrompit Colm en montrant cinq centimètres de vide entre son pouce et son index.
– Alors compte sur moi pour t’apprendre, lui dit Alida d’un air malicieux.
Nuala expliqua :
– Nous les Irlandais, on ne veut surtout pas être confondus avec les Anglais, alors on chante en parlant. D’abord, on ne prononce pas leur fameux th, dit-elle en montrant sa langue entre ses dents. Nous, on dit t. Pas thank you but tank you, pas three but tree, en agitant trois doigts.
Et elle rajouta :
– Puis surtout, on ne prononce pas le g à la fin des ing ! interdit ! Good Mornin ! Come walkin… tu comprends ?
– Good Mornin, you come walkin with me ? lui proposa Piet.
– Go ! dit Colm en se levant et incitant tout le monde à s’élancer vers la mer.
Piet, un peu déçu, suivit tout de même. Il aurait préféré un tête-à-tête avec Nuala.
Après une demi-heure, Alida et Piet avaient retrouvé leur serviette de bain et le vent commençait à les sécher.
– Grrr, Elle est froide, hurla Piet.
– Tu as vu, il y a pire que nous… pour se jeter dans la Mer du Nord, dit Alida.
– La Mer d’Irlande doit être encore plus froide, on voit qu’ils aiment ça.
– Ils sont sympas hein ?
– Oui. Ils me plaisent bien, surtout elle, répondit Piet avec un sourire soutenu.
– Hum, j’ai l’impression que c’est réciproque…, annonça Alida.
– Ah oui, tu crois ?
– Hum, hum.
Piet passa les deux mains dans sa chevelure rousse, l’air satisfait. Il demanda :
– Et Dirk, il va comment ?
– C’est toujours pire, il passe ses nuits dehors, rentre saoul, dort la moitié de la journée, s’engueule avec les vieux. Tu sais qu’il a eu trois pètes6, en math, en histoire et… et… en français !!!
– Oh non, pas en français !
– Si ! Et qui c’est qui va l’aider à rattraper ?
– Ah non, je ne suis pas venu pour donner des leçons de français. Il va falloir qu’il me paie, non peut-être !
– Et des leçons de français à Nuala, ça tu es d’accord, ou bien ?
– Arrête de me charrier…
Piet se leva et rapprocha sa serviette tout à côté de celle de sa cousine. Il prit un ton confidentiel :
– Alors raconte, quoi de neuf sinon dans notre famille ?
– La sœur d’Opa est morte le mois dernier. Ton père te l’a dit ?
– Non, je ne savais pas. Elle avait quel âge ?
– Le même que Opa, puisqu’ils étaient jumeaux.
– Ah ben oui, c’est vrai.
– Vous n’étiez pas à l’enterrement, alors tu penses, il y a eu des commentaires…
– Je ne l’ai jamais vue moi cette tante…
– … tante Greta. Oh, nous non plus, on ne la connaissait pas bien, je l’avais vue une fois ou deux, je crois. Plutôt revêche. Oma et elle ne s’entendaient pas.
– Mais qu’est-ce qu’il y a dans cette famille pour que les gens ne se supportent pas ?
– Toujours les mêmes vieilles histoires. Cela ne m’étonnerait pas qu’ils ne le sachent même plus eux-mêmes, s’exclama Alida.
– Opa m’a raconté beaucoup d’histoires de son enfance mais maintenant que j’y pense, il ne parlait presque jamais de sa sœur. Ils étaient jumeaux tout de même.
Piet resta pensif. Alida n’y prêta pas attention, elle poursuivit :
– Après la messe, Dirk et moi, nous avons parlé avec un gars sympa, Charly, un des petits-fils de la tante. Il a 22 ans et fait des études d’Histoire à Leuven.
– Il habite où ?
– Pas loin, du côté de Bruges, il me semble.
– Et ils sont combien, nos petits-cousins ?
– Cinq, je crois, deux garçons et trois filles, si j’ai bien compris, ils n’étaient pas tous là.
– On devrait faire une fête, tous ensemble, s’exclama Piet.
– Alors là, bonjour l’ambiance. Je te laisse en parler à Opa, proposa Alida.
– Non, pas avec les vieux, juste nous, les jeunes ! On s’en fout de leurs histoires. On apprendrait à se connaître comme ça.
– Ben tiens justement, Charly nous a raconté que la tante Greta avait fait un arbre généalogique de la famille et qu’elle avait dit avant de mourir qu’il fallait nous en donner un exemplaire.
– Ah oui ? J’aimerais bien voir si moi, le petit wallon, je suis dessus… je suis la touche exotique dans cette famille de flamands roses, dit Piet en jetant une poignée de sable sur le ventre d’Alida.
– Arrête, c’est pas drôle, hurla Alida en se détournant.
Elle continua.
– À ce qu’il paraît, la tante Greta a retrouvé des ancêtres jusqu’en 1700, tu te rends compte. Elle hésita, heu… ou bien c’est jusqu’au xviie siècle, quelque chose comme ça…
Puis, en réajustant les deux coins de sa serviette et en époussetant les grains de sable, elle conclut.
– Moi, ça me fait flipper tous ces morts…
– Et ben moi, ça m’intéresserait de voir ça, répondit Piet distraitement.
Son attention était maintenant captée par Nuala qui venait de s’allonger à côté de lui, l’aspergeant de ses cheveux mouillés.
4 Très mince, “maigre comme une arête de poisson”. En Wallonie on dit “maigre comme un soret”, le soret étant le hareng.
5 Tongues. Belgicisme.
6 Échec scolaire dans une matière précise. Argot.
Petite et grande histoires
Maarten avait vu passer son fils devant la réception du camping et comptait bien le questionner sur la soirée de la veille. Il sortit et l’interpella :
– Eh fieu7, viens un peu voir ici !
– Je suis pressé, ils m’attendent, lança Dirk.
– Tu es rentré à quelle heure ?
– Heu…
– Difficile de t’en souvenir, hein ? Moi, je vais te le dire… c’était trois heures et tu étais fin bourré comme un Polonais ! Maarten donna une taloche sur la tête de son fils.
– On dit bourré comme…, objecta Dirk.
– Ne te fous pas de moi. Je ne veux pas que ça recommence, tu m’as bien entendu. Tu rentres pour minuit et tu passes me voir avant de te coucher. C’était notre accord. Sinon, ce sera ton grand-père qui prendra les choses en main et là, mon gars, je ne voudrais pas être à ta place.
– Ok Pa, répondit Dirk en passant ses doigts dans ses cheveux pour réajuster sa mèche de côté.
– Et je vous attends à quatorze heures, avec Piet, pour installer le matériel. Tu te rappelles au moins que nous sommes dimanche, lança Maarten en pointant son fils de l’index.
– Tu avais promis qu’on aurait droit à une semaine de vacances quand Piet allait venir, objecta Dirk.
– Les vacances, ce sera pour la semaine prochaine.
– Mais, on a prévu d’aller faire du cuistax8…
– Va le dire à ton grand-père !
Dirk tourna les talons en haussant les épaules. Il prit la direction de la plage.
Maarten retourna au bureau, une petite maisonnette en dur, faite de briques peintes à la chaux et sur laquelle l’inscription Réception en rouge dirigeait le plus déboussolé des touristes. À l’intérieur, il y avait toujours une présence familiale, la tante Olga, le plus souvent, accueillante et efficace. Elle jonglait entre les arrivées et les départs, les informations et les réclamations, les ventes de timbres et de cartes postales ainsi que les jetons pour les douches et la monnaie pour la cabine téléphonique. Sans oublier les annonces au haut-parleur, elle mettait un soin particulier à s’exprimer d’une voix douce et charmeuse, dans plusieurs langues, comme une hôtesse de l’air. Il n’y avait pas d’autres infrastructures, ni magasin, ni bar, ni restaurant, tout cela se trouvait à deux pas, au centre-ville. Deux exceptions néanmoins, le dimanche, un dépôt de pain frais et croissants le matin et l’apéro dansant le soir.
Maarten trouva son épouse en train de vendre la dernière baguette de pain.
– Ah te voilà, c’est pas trop tôt, fit-elle, je dois filer préparer les canapés pour ce soir.
Albert, le patriarche, était accoudé au coin du comptoir. Lui aussi venait d’arriver et il s’épongeait le front et la nuque avec son grand mouchoir à carreaux.
– Un w.-c. des douches centrales est encore bouché. Envoie Dirk, ordonna-t-il à son fils.
– Il vient de partir à la plage…
Le grand-père jura.
– Alors vas-y toi-même puisque tu n’es pas foutu de le garrotter. Moi, je vais chercher ta mère à l’église et boire l’apéro. Je viendrai voir vers quatre heures si tout est en ordre pour ce soir. N’oublie pas que ceux des 23 et 24 veulent qu’on leur remplace l’auvent. Et va changer les ampoules à la 16, je leur ai promis que ce serait fait aujourd’hui.
– Oui, Pa, répondit Maarten.
Le camping Vossenhol avait été l’un des premiers de la côte belge et il tenait à rester authentique. Il n’était pas question de verser dans l’arrogance luxueuse comme certains, ceux avec un restaurant gastronomique où les campeurs devaient penser à mettre une tenue du soir dans leur sac à dos ou ceux qui avaient investi dans des piscines, le comble au bord de la mer. Chez les Vandenvos, on pouvait encore planter sa tente, garer sa caravane, boire l’apéro en short et tirer sur le cochonnet. Le seul luxe au fil du temps avait été l’installation de bungalows, pour ceux qui venaient sans matériel, surtout hors saison et qui préféraient se sentir au sec. La devise de la maison se voulait implacable : Si vous venez à la mer, c’est pour vivre au simple comme au naturel ! Les palaces et les fanfreluches c’est bon pour Ostende et Knokke-le-Zoute ! aimait à dire le grand-père Albert. Généralement il rajoutait : Tout le monde ne s’appelle pas Léopold !





























