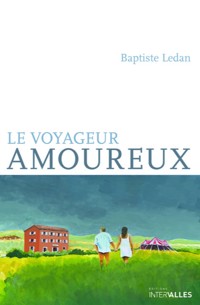Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Intervalles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Tomas Fischer, docteur en psychologie et chauffeur-routier, part se réfugier dans une ville isolée et lointaine après la mort de sa femme et de ses deux enfants. Il s’installe à Lasciate où la vie semble à l’arrêt : on s’y ennuie beaucoup, les voitures roulent au ralenti et l’alcool y est en apparence interdit. Tomas entame une nouvelle vie, clandestine, dans les marges de Lasciate, où son statut interlope lui permet de rendre bien des services. Mais Lasciate n’est pas une ville comme les autres, même si les politiques menées ressemblent à celles que l’on observe partout. Car un secret inouï distingue ses citoyens du commun des mortels.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"Plus qu’un roman, pas tout à fait un conte philosophique, Baptiste Ledan nous donne à lire un grand livre qui montre que l’intelligence n’est pas étrangère à l’émotion… On adore." - Librairie Au Saut du Livre
"C’est aussi un hymne à la diversité, au désordre pittoresque, à tout ce qui éveille les sens et donne une saveur à notre passage éphémère dans ce monde." - Blog de Kitty la Mouette
À PROPOS DE L'AUTEUR
Baptiste Ledan est né à Rennes en 1986 et vit à Pantin. Il a travaillé en politique, dans l’enseignement supérieur et en administration publique. Il est lauréat du prix du jeune écrivain en 2003 pour sa nouvelle « Le Cahier » et en 2011 pour « L’Eldorado », ainsi que du prix Don Quichotte de la nouvelle de la ville de Rueil-Malmaison en 2015. La Vie suspendue est son premier roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Vie suspendue
Baptiste Ledan
La Vie suspendue
Éditions Intervalles
« Déjà le Grand Khan cherchait dans son atlas les plans des villes que menacent incubes et malédictions : Enoch, Babylone, Yahoo, Butua, Brave New World.Il dit :Tout est inutile, si l’ultime accostage ne peut être que la ville infernale, si c’est là dans ce fond que, sur une spirale toujours plus resserrée, va finir le courant. »
Italo Calvino, Les Villes invisibles
Chapitre 1 – L’étranger
Jusqu’à l’âge de quarante ans, Tomas Fischer eut le goût des cimetières. Il s’y promenait comme l’on se rend à la campagne, pour trouver le calme et la sérénité. « Il y fait bon vivre : les gens sont polis, les allées bien entretenues et personne n’y parle trop fort, disait-il. L’endroit résume ce que nous sommes, pas grand-chose, et ce que nous serons, rien. Un mélange de grandeur et de pathétique se dégage des monuments que nous édifions pour nos morts ; insuffisants – comment une pierre et des mots gravés pourraient-ils résumer une vie humaine ? – et excessifs – tant d’énergie consumée pour un cœur qui a cessé de battre. »
Tomas aimait disserter sur les cimetières avec ses amis : ces conversations légères mettaient la mort à distance et donnaient l’illusion de la domestiquer.
La passion de Tomas pour les cimetières s’éteignit lorsque, à quarante ans et trois mois, il assista à l’enterrement de son épouse Céline et de ses deux enfants Elsa et Léo. Trois jours plus tôt, Tomas était en déplacement à Emona lorsque Clarisse Dumas, la sœur de Céline, l’avait appelé. Ils étaient morts tous les trois dans un accident de voiture. Céline avait fait un écart sur le pont de Langrais qu’elle empruntait chaque jour pour aller et revenir de l’école. La voiture avait basculé dans le vide et achevé sa chute trente mètres plus bas. Le conducteur qui roulait sur la voie de gauche et l’avait contraint à donner le coup de volant fatal ne fut jamais retrouvé.
Étienne Servan était ivre au moment des faits, bien qu’il fût seulement seize heures quarante-cinq. Il mourut vingt ans plus tard dans un lit d’hôpital, d’un cancer de l’estomac. Durant ces vingt années, il avait affronté chaque nuit l’image de cette voiture qui l’évitait de justesse puis passait par-dessus le parapet de sécurité, dont l’enquête démontra qu’il ne respectait pas les normes en vigueur. La vie d’Étienne, médiocre avant l’événement, ressemblait à cette chute ; si elle était plus lente et moins spectaculaire, elle était aussi inexorable, désespérante, et son issue était identique. Étienne Servan n’avait personne dans son entourage qu’il aurait pu qualifier d’ami et, pour y remédier, il s’efforçait d’inspirer la pitié aux personnes qu’il croisait. Cette pitié lui apparaissait comme la plus haute marque de considération qu’il pouvait attendre du monde extérieur. Étienne était conscient que l’épisode du pont de Langrais dissuaderait quiconque de ressentir la moindre commisération à son égard. Il n’eut donc jamais le courage de se dénoncer.
Il n’évoqua cette histoire qu’une fois, cinq ans plus tard, lorsqu’il voulut impressionner Élodie Sauttier, rencontrée une heure plus tôt au comptoir du Memphis auquel ils étaient accoudés tous les deux, quand il déclara qu’il avait « déjà tué quelqu’un ». Il était encore assez lucide pour ne pas en dire plus, reconnaissant tout juste que « ce n’était pas lui qui l’avait voulu » et que « c’était un événement qui hantait tous ses jours et toutes ses nuits ». Élodie Sauttier, qui avait provoqué cette confession en demandant à Étienne « la chose la plus folle qu’il ait faite », réagit comme tout le monde l’aurait fait. Même si l’homme qui se dressait face à elle représentait sa meilleure chance de sentir un pénis chaud et vivant à l’intérieur de son corps ce mois-ci, elle préféra ne pas courir le risque de se trouver nue dans sa chambre avec un inconnu lui ayant avoué un meurtre. Elle annonça à Étienne qu’elle sortait acheter des cigarettes et « passer à la pharmacie », en lui adressant un clin d’œil et en promettant de revenir vite. Elle rentra dans son deux-pièces, trois rues plus loin, après avoir vérifié qu’elle n’était pas suivie. Elle ne retourna jamais au Memphis, dont elle était jusque-là une cliente fidèle. Étienne l’attendit une heure et ne comprit que le lendemain, après avoir décuvé, la raison de la disparition d’Élodie. Il ne revint jamais au Memphis non plus et se promit d’emporter le secret de « l’affaire de Langrais » dans sa tombe, ce en quoi il tint parole. Élodie Sauttier, qui n’imagina jamais qu’elle était la seule dépositaire de cette incomplète confession, y repensait lorsqu’elle rentrait chez elle le soir après avoir bu, ce qui n’était pas exceptionnel, ou lorsqu’elle apercevait la devanture du Memphis. Elle finit par l’oublier quand elle déménagea pour se rapprocher de sa mère mourante. Elle suivit celle-ci dans la tombe quelques mois plus tard, terrassée par une cirrhose.
Quant à Mourrad Amini, le patron du Memphis, il perdit ce soir-là une habituée précieuse et un consommateur plus épisodique mais dont chacun des passages était profitable. Deux ans plus tard, il dut revendre son fonds de commerce à un opérateur téléphonique, sans savoir qu’il comptait parmi les nombreuses victimes collatérales de l’accident du pont de Langrais.
Tomas ne réussit pas à articuler un son tandis que Clarisse lui donnait les détails de l’accident en pleurant. Il lui envoya un sms après avoir raccroché pour la prévenir qu’il arriverait à Joubeville le lendemain matin. Il but ensuite trois litres de bières avant de reprendre la route. Il savait que c’était stupide et qu’il aurait pu tuer une femme et ses enfants. Il aurait pu se tuer aussi, ce qui l’inquiétait moins. Il arriva chez lui au petit matin. Il faisait froid, tout était silencieux. Il avala deux verres de whisky puis se coucha après avoir déposé la bouteille sur la table de nuit.
À l’enterrement, la foule était nombreuse, à cause des enfants. Cela ne le consolait pas. Il y avait beaucoup de gens qu’il ne connaissait pas. Des parents de l’école, des élus du quartier. Les premiers bénissaient le ciel que leurs enfants soient vivants, les autres étaient là pour que l’on ne leur reproche pas leur absence. Tomas les aurait expulsés du cimetière s’il avait été dans son état normal, mais il était resté sobre. Il n’était pas sûr, de surcroît, qu’un scandale l’aurait soulagé.
Les parents de Céline avaient loué une salle pour partager un café après la cérémonie. Il y avait aussi du rosé ; il évita d’en prendre. Les visages lui étaient plus familiers. On le regardait avec un mélange de compassion et de peur. Son malheur terrifiait les convives, comme s’il pouvait être contagieux. Ou que la douleur qu’il ressentait était aussi insoutenable à vivre qu’à observer. C’était un jour de printemps, il faisait beau mais les membres de Tomas restaient gelés. Il avait tellement froid à l’intérieur que les rayons du soleil ne pouvaient rien pour lui.
Tomas était orphelin depuis sept ans. Son père, Philippe, était décédé d’un cancer des poumons peu après son départ à la retraite. Sa mère, Claudine, avait été victime d’un accident cardio-vasculaire dans un lac où elle se baignait seule ; elle s’était noyée. C’était un mois après le mariage de Céline et Tomas. Fils unique, Tomas avait ressenti l’urgence de fonder une famille pour ne pas laisser disparaître sa lignée : Léo était né moins d’un an après, au mois de juin, et sa sœur, Elsa, vingt mois plus tard.
Le reste de sa famille se composait de deux cousins qui étaient venus à l’enterrement. Ils étaient restés dans un coin, embarrassés et isolés, et ils étaient partis tôt. La dernière fois que Tomas les avait vus, c’était à l’occasion de leurs mariages respectifs. Ils étaient venus aux obsèques sans leurs épouses et Tomas ignorait s’il s’agissait d’une forme de délicatesse ou si elles n’avaient tout simplement pas envie d’être là.
En fin d’après-midi, chacun rentra chez soi. Marc, le meilleur ami de Tomas, l’invita à dîner. Tomas n’en ressentait ni l’envie ni le courage mais il accepta. Ce ne pouvait pas être pire que la solitude. Marc avait été son témoin de mariage. Ils s’étaient connus au lycée, où ils passaient leurs soirées ensemble – à jouer aux jeux vidéo, puis à traîner dans les bars. Ils s’imaginaient aborder les filles qui buvaient des Panachés aux tables voisines ; ils inventaient des centaines d’approches différentes, puis ils fixaient l’écran qui diffusait un match de football avant d’avaler un sandwich-frites et de rentrer se coucher. Après le baccalauréat, leurs liens s’étaient distendus, sans jamais se rompre tout à fait. Lorsque Tomas avait commencé à travailler comme routier, après son doctorat, il s’était éloigné de ses camarades d’université et s’était rapproché de Marc. Marc croyait à la fidélité au temps passé et n’en voulait pas à Tomas de « dévaloriser le diplôme » et « d’abandonner la lutte des classes ». Tomas et Marc ne parlaient jamais de politique ou de philosophie. Lorsqu’ils avaient ce qu’ils appelaient « une conversation sérieuse », elle concernait leur rapport aux femmes et, plus tard, à leurs enfants. Ils avaient ainsi pu rester amis sans autre point commun qu’une adolescence partagée.
Dans la salle à manger silencieuse de Marc et Estelle Vidal, Tomas comprit qu’il n’avait pas d’amis intimes. Des camarades d’université étaient présents à l’enterrement, mais il n’avait pas su quoi leur dire et eux non plus. Il lui manquait quelqu’un d’assez éloquent pour se taire et avoir les gestes qu’il faut. Quelqu’un qui lui dirait ce qu’il devait faire. Marc essayait de nourrir la conversation, alternant entre les dernières nouvelles sportives, des considérations météorologiques et des commentaires sur la cérémonie du jour. Estelle lui jetait des regards noirs et les yeux de Marc, imitant ceux d’un cocker, répondaient « il faut bien que je dise quelque chose ». S’il n’avait pas été aussi désespéré, la situation aurait pu faire sourire Tomas.
Il était parti tôt, sans boire de café ni de digestif. La solitude était la seule solution. Non pas tant par désir de se retrouver avec lui-même mais parce que la compagnie des autres était insupportable.
Dans les jours qui suivirent, Marc et d’autres amis l’appelèrent et laissèrent des messages compatissants. Tomas ne décrocha pas. Il envoya à tous le même sms : « Je vais bien. Merci de ton soutien. Besoin d’être seul. Je t’embrasse, à bientôt. » Ses interlocuteurs étaient soulagés de ne pas devoir lui parler ou, pire, le rencontrer, même si les plus curieux auraient aimé voir le malheur en chair et en os, pour le frisson, comme on va au cinéma pour éprouver les émotions des autres sans avoir à les vivre, avant de regagner son foyer.
KWL Walting, l’employeur de Tomas, accordait une semaine de congé en cas de décès du conjoint et dix jours pour le décès d’un enfant. Cela ne pouvait pas se cumuler et qu’il s’agisse d’un enfant ou de deux, avec ou sans leur mère, le congé était identique : dix jours. Le médecin lui avait prescrit un arrêt de travail de trois mois – « c’est renouvelable, revenez me voir pour me dire comment ça va », avait précisé le docteur Cohn en soulevant un sourcil inquiet en direction de son patient. Tomas n’était pas revenu et, à la fin de son arrêt, Frank Meran, le responsable du pôle chauffeur pour la région de Joubeville au sein de KWL Walting, lui expliqua que la meilleure solution était un licenciement qui lui ouvrirait les droits au chômage. Tomas était d’accord : cela ne servait à rien d’attendre.
Tomas s’était interrogé sur l’endroit où il voulait vivre. Où il pouvait vivre. Il habitait dans l’appartement que Céline et lui avaient acheté dix ans plus tôt. Ils l’avaient aménagé au fil des années et des événements – le mariage, la naissance de Léo puis d’Elsa – pour qu’il s’adapte à leur désir – aux désirs de Céline surtout. Il la revoyait, contemplant les étagères qu’ils avaient fixées eux-mêmes. Il repensait à la transformation de la salle à manger en chambre de Léo, puis en chambre d’Elsa et de Léo ou aux travaux qu’ils avaient entrepris pour refaire la cuisine « à l’américaine ». À quatre, ils étaient à l’étroit dans ces 70 mètres carrés mais ils ne souhaitaient pas partir : ils appréciaient le quartier, le voisinage, et cet endroit leur appartenait. C’était chez eux. Tomas ne pouvait pas se résigner à le vendre ou à le louer. Il refusait de céder à un étranger la mémoire de Céline, de Léo et d’Elsa. Mais il ne pouvait plus vivre dans ce mausolée où chaque objet le faisait souffrir. Il s’effondrait en croisant un livre que Léo adorait, un cadre que Céline avait acheté lors de leur voyage de noces, une plante à laquelle Elsa aimait faire des câlins pour sentir l’odeur du tronc et les chatouilles des feuilles sur son corps.
Il lui paraissait absurde de déménager ailleurs dans Joubeville. Sa ville natale, celle où il avait grandi, étudié, travaillé, élevé ses enfants, était devenue un piège rempli de souvenirs. Chaque rue contenait une menace et tous les lieux qu’il avait aimés étaient maintenant infréquentables. Il fallait s’en aller.
Tomas écrivit à Marc : « J’ai besoin de partir, de voir du pays pour me reconstruire. Je sais que je peux compter sur toi : veille sur leur tombe, qu’elle soit propre et qu’il y ait des fleurs fraîches toutes les semaines. Je t’enverrai de l’argent tous les mois pour les frais, en attendant mon retour. Prends soin de toi, et surtout d’Estelle et de Lucas, ne t’inquiète pas pour moi, sois heureux. Je t’embrasse, à bientôt. »
Marc Vidal s’acquitta de sa tâche durant les trente-deux années qui suivirent – jusqu’à ce qu’il succombe dans les bras d’Estelle à un infarctus au cours de leur ébat mensuel. Pendant les cinq premières années, il se rendait au cimetière déposer les fleurs, puis il eut recours à une entreprise spécialisée qu’il rémunérait grâce aux virements de Tomas. Il le fit par fidélité à son ami, puis, lorsque le silence de Tomas finit par le blesser, par fidélité à ceux qui reposaient sous la tombe, et enfin par fidélité à lui-même, parce que l’on ne renonce pas à une tâche que l’on a accomplie durant des décennies sans se renier – et Marc ne se renia jamais. Il en fut récompensé de manière posthume. Estelle, qui trouvait que Marc avait donné trop de son temps pour soulager la bonne conscience d’un ami ingrat, eut recours aux versements de Tomas pour demander à la société funéraire de s’occuper de la tombe de son époux. Nul ne sait si Marc Vidal aurait consenti à ce détournement de fonds à son profit. Il est probable que Tomas n’y aurait pas trouvé grand-chose à redire. De toute façon, Tomas n’en sut jamais rien, tout comme il ignora tout du décès de Marc et de ce qu’il advint de tous ceux qui étaient présents à ses côtés au cimetière en ce triste jour de printemps où il avait fait ses adieux à Céline, Léo et Elsa.
Chapitre 2 – La ville invisible
À Lasciate, les avenues sont larges et les voitures roulent lentement. Il y a peu de maisons mais aucun bâtiment ne dépasse six étages. Tout y est propre et calme. Les passants ne flânent pas, se saluent peu et ne sourient que sur les publicités criardes qui parsèment les rues. Le port accueille des cargos de marchandises mais les bateaux de croisière n’y font pas étape. Aucun chemin piétonnier n’a été aménagé pour permettre aux passants de longer la mer, dont les vagues rugueuses et désordonnées offrent un contraste brutal avec le reste de la ville. La nuit tombe tôt et les nuages dissimulent souvent la lumière du jour. Au cœur de l’hiver il arrive que la neige offre un peu de grâce à la ville en décorant les toits et en blanchissant les façades de crépi ; le lendemain elle se transforme en boue et Lasciate retrouve sa teinte naturelle grisâtre.
Les Lascebberotes portent des vêtements bon marché fabriqués en Asie, se nourrissent de légumes importés et de fritures, lisent des romans policiers et regardent des séries télévisées produites aux États-Unis. L’organisation politique constitue la principale originalité de la ville qui est dirigée par un Conseil de Gouverneurs collégial dépourvu de présidence. Isolée du reste du monde par un désert de sel, la ville fut épargnée par les conquérants ambitieux, les empereurs mégalomanes et les armées sanguinaires. Trop reculée, dépourvue d’intérêt stratégique comme de richesses naturelles, elle vit en paix, loin du monde et de son tumulte.
Le théologien Jozef Rachantan, rédigea au XVIIIe siècle une étude intitulée Lasciate, son Histoire, ses Dieux, son Désespoir. Avant d’adopter tardivement le catholicisme, les Lascebberotes n’accordaient aucun crédit à l’hypothèse d’une vie après la mort. Selon leurs croyances archaïques, les Dieux lascebberotes, immortels et tout-puissants, avaient bâti le monde et continuaient d’y jeter un œil distrait, mais les hommes qu’ils avaient conçus ne disposaient que d’une durée de vie limitée. La dégénérescence de leur corps était inéluctable et la disparition de leur enveloppe charnelle coïncidait avec celle de leur esprit. Jozef Rachantan condamnait cette vision qui conduisait les autochtones à ne pas distinguer la chair de l’âme. Dans sa parabole sur « l’épine et la douleur », Ernst Moni, un philosophe lascebberote de l’an 1000, prétend que, « si c’est bien le corps qui subit la présence d’une épine de ronces coincée dans le pied, la douleur qu’elle inflige préoccupe notre esprit tout entier : c’est donc en soignant le corps que l’on peut trouver la réponse à toutes les peines de l’âme ». Pour Jozef Rachantan, Ernst Moni incarne l’« immaturité » de la pensée lascebberote et, comme l’enfant, confond la douleur et le malheur. Personne ne répondit à Jozef Rachantan : aucun lecteur de Lasciate, son Histoire, ses Dieux, son Désespoir n’avait été au bout des mille deux cent quarante-huit pages qu’il contenait et aucun exemplaire ne parvint jusqu’à Lasciate. Personne ne sut ce qui avait motivé Jozef Rachantan à consacrer plusieurs années de sa vie à l’étude d’un pays inconnu de tous.
Tomas Fischer avait découvert Lasciate quand il était routier. Il se souvenait de son isolement et de la mélancolie qui s’en dégageait. Quand il avait cherché une destination, il avait pensé qu’ici personne ne lui reprocherait sa solitude et sa tristesse. Il se rappelait aussi que l’alcool y était interdit ; c’était la seule chance pour lui de rester en vie.
Il prit une chambre dans l’hôtel où il avait l’habitude de dormir. Situé au sud de la ville, Le Voyageur était à l’image de celle-ci : simple, fonctionnel, sans charme ni imagination. On y trouvait tout ce que le confort moderne exige, rien de plus : une réception ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre, des petits déjeuners à volonté de six heures trente à neuf heures trente, des draps propres, des douches au débit correct, des téléviseurs usés qui retransmettaient les chaînes locales ainsi que les informations internationales. De vieilles photographies du port de Lasciate décoraient les couloirs. La première fois que Tomas était venu au Voyageur, Harold Purito en était déjà le gérant. Petit et bedonnant, sa calvitie en forme de tonsure lui donnait l’apparence d’un moine. Le roux éclatant des cheveux qui cernaient son crâne constituait sa seule touche de gaieté. D’une allure juvénile, Harold parlait peu et souriait encore moins. Tomas le trouvait sympathique, bien qu’il ne fît rien pour paraître comme tel.
Tomas arpenta la ville, longue d’une vingtaine de kilomètres. Il marchait six à huit heures par jour. Le Voyageur était situé à l’extrémité de « la zone de transit ». Au cours de ses promenades, Tomas traversait la zone industrielle, ses usines, ses entrepôts et son port, puis il longeait la zone commerciale et sa succession de grandes surfaces et de magasins d’ameublement. Il parvenait dans le quartier résidentiel du Gordola, avec ses parcs, ses immeubles modernes et les premiers magasins alimentaires. Après deux heures de marche, Tomas pénétrait dans le centre-ville, où se situaient les commerces, les bureaux, les cafés modernes et les lieux de divertissement – deux théâtres, un opéra, cinq cinémas et deux musées, l’un sur l’histoire de la ville et l’autre sur les beaux-arts. Plus au nord, le quartier administratif de Torchof accueillait les principales institutions de Lasciate, avant la zone historique, où se trouvaient le port vieux, ses barques centenaires et ses rares touristes égarés errant au milieu des rues colorées et des boutiques en torchis. Cette partie était rénovée avec tant de soin qu’elle paraissait factice. Les façades y étaient ravalées tous les trois ans et l’on avait l’impression d’évoluer dans un décor de film.
La propreté régnait partout. Dans les bars, des joueurs de dominos silencieux côtoyaient des machines à sous fluorescentes auxquelles personne ne touchait. Les restaurants s’animaient à midi, lorsque les employés de bureau venaient avaler un plat du jour. Les plus pressés déjeunaient en dix minutes. La plupart des commerces fermaient à la nuit tombée, vers dix-huit heures. Dans les magasins, les clients achetaient des tenues identiques à celles qu’ils portaient. Tomas trouvait cette méthode intéressante. Céline devait toujours le traîner dans les boutiques pour qu’il renouvelle sa garde-robe : il n’aimait pas les essayages et ne prenait aucun plaisir à choisir ses vêtements. La perspective de les retrouver à l’infini chaque année lui paraissait réconfortante.
Tomas passait ses journées à marcher dans la rue. Il était incapable de se concentrer sur un livre ou de regarder un film : les drames le faisaient pleurer et les comédies le mettaient en colère. Il pleurait plusieurs fois par jour et son ventre le faisait souffrir dès que les visages de Céline et de ses enfants s’imposaient à lui. Il était plus facile de ne penser à rien en mouvement.
Deux semaines après son arrivée, Harold Purito s’approcha de Tomas tandis qu’il finissait son petit déjeuner.
« Monsieur Fischer, avez-vous cinq minutes ?
— Bien sûr, j’ai toute la journée devant moi. »
Harold vérifia qu’il n’y avait personne autour d’eux. Il se pencha vers Tomas.
« Comme vous ne m’avez pas indiqué de date de départ, je voulais vous avertir qu’il n’est pas possible de séjourner à Lasciate plus d’un mois. C’est la durée maximale du visa de tourisme.
— Que se passe-t-il ensuite ?
— Le cas est rare. Je n’y ai jamais été confronté depuis que je tiens cet hôtel. J’imagine que vous devrez quitter la ville.
— C’est ennuyeux. J’avais dans l’idée de m’installer ici, de rester quelques années peut-être.
— Vous voulez rester ici des années ? Nous n’avons pas d’immigration. Le ministère est très strict et les Kouffoys trouvent la ville ennuyeuse.
— Les quoi ?
— Les Kouffoys. C’est le terme que nous utilisons pour désigner les étrangers. Ce n’est pas péjoratif, c’est notre façon de marquer une frontière.
— Je comprends. Cette ville m’offre le calme dont j’ai besoin. Quelles sont les démarches à effectuer pour être autorisé à rester ?
— Il faut aller au bureau de l’immigration. À votre place, je commencerais à chercher d’autres pays calmes, mais vous pouvez tenter votre chance. »
Tomas se rendit au Bureau de l’Immigration Légale de Lasciate et des Expulsions, le BILLE. Il fut accueilli par une fonctionnaire d’une vingtaine d’années, blonde aux yeux bleus, qu’il trouva belle même si elle refusa de lui accorder le moindre sourire.
« J’aurais souhaité m’installer à Lasciate plusieurs mois. On m’a dit qu’il était nécessaire de venir vous voir.
— On vous a bien renseigné. On vous a prévenu que votre demande serait rejetée ?
— On me l’a laissé entendre.
— C’est bien. Mieux vaut ne pas laisser prospérer des espoirs qui seraient déçus, vous ne pensez pas ?
— Bien sûr. Mais j’imagine que, si vous prenez la peine de les instruire, certaines demandes sont acceptées ?
La femme leva les yeux pour la première fois vers Tomas. Elle réfléchit avant de répondre.
« Nous n’avons pas beaucoup de demandes, alors nous pouvons les examiner. Êtes-vous médecin ?
— Non, mais j’ai un doctorat en psychologie. J’étais chauffeur routier.
— Hum. Vous êtes religieux ?
— Je suis de culture catholique, mais je n’ai jamais été pratiquant.
— Vous êtes riche ? Rentier ?
— J’ai de l’épargne. J’ai récemment bénéficié d’une assurance-décès. Dire que je suis riche serait exagéré.
— Prenez ce questionnaire. Complétez-le et renvoyez-le nous. Vous perdez votre temps, mais la bonne nouvelle, c’est que vous obtiendrez une réponse sous trois jours. Nous sommes très réactifs.
— Je vous remercie. Quelle chance me donnez-vous d’obtenir un accord ? »
La jeune femme observa Tomas.
« Vous m’avez l’air honnête. Si vous dites la vérité, 0 %. Si vous mentez, 1 %.
— C’est très clair. Merci beaucoup. »
Tomas rentra, découragé. Il avait longtemps été convaincu que tous les problèmes finissaient par s’arranger. Depuis l’accident, il avait revu son jugement. La vérité, c’est que tout finissait mal : il n’y avait que la mort au bout du chemin et, entre temps, une longue errance.
Deux jours après le dépôt de son dossier, il reçut une convocation du BILLE. Il se retrouva en face de la jeune femme blonde, dans le même bureau. Elle lui plaisait et son regard le troublait. C’était la première fois qu’il était excité par une femme depuis l’accident ; probablement à cause de sa dureté à elle et de la faiblesse infinie que lui ressentait.
Alicia Skorda – c’était le nom de la fonctionnaire – le fixa, esquissa un sourire, puis lui annonça que sa demande était rejetée. Il pouvait rester à Lasciate en bénéficiant d’un visa touristique encore une semaine. À l’expiration de ce délai, il devrait quitter le territoire, sous peine d’être emprisonné, puis expulsé. « Au début, on se contentait d’expulser les gens, mais c’était idiot : nous n’avions pas à prendre en charge ce qui aurait dû relever de leur responsabilité. Nous avons donc mis en place une année d’emprisonnement en guise de punition. Cela ne coûte pas plus cher à la collectivité puisque nous facturons le séjour en prison, et la logique est respectée. L’effet dissuasif fonctionne puisque nous n’avons connu aucun cas au cours des dix dernières années. » Elle conclut en indiquant que les services du BILLE se rendraient bientôt à l’adresse qu’il avait indiquée dans son formulaire pour s’assurer de son départ.
Le soir-même, Tomas dressa la liste des pays susceptibles de l’accueillir. Il n’avait jamais cherché à émigrer jusque-là. Il constatait maintenant que tous les États du monde avaient dressé des barrières empêchant aux corps étrangers de s’introduire durablement en leur sein. Les touristes étaient accueillis à bras ouvert mais, au bout de trois ou six mois, chacun était prié de boucler ses valises et de repartir plus loin. Parce qu’il était originaire d’un pays riche, il avait la chance de pouvoir circuler partout ou presque, mais il lui était interdit de s’installer où que ce soit hors de son continent d’origine. Tomas avait toujours trouvé choquant que des hommes interdisent à d’autres de vivre dans leur voisinage et que les malheureux qui avaient vu le jour sur une terre inhospitalière soient condamnés à y demeurer. Il expérimentait concrètement cette limite. Tomas n’avait pas envie de devenir un itinérant perpétuel. La perspective de faire sa valise et de monter dans un nouveau train tous les six mois l’épuisait. Parvenu à la conclusion qu’il était condamné à vivre clandestinement, il alla voir Harold.
« Vous aviez raison, le bureau d’immigration a refusé ma demande.
— Oui, ce sont des fonctionnaires consciencieux. Ils n’ont pas grand-chose à faire, alors ils le font bien et vite.
— C’est dommage, j’aurais tellement souhaité m’installer ici.
— Ce n’est pas de chance, oui.
— C’est le lieu dont j’avais besoin pour me reconstruire après la mort de ma femme et de mes enfants. »
Harold le dévisagea.
« Vous avez perdu votre épouse ?
— Oui. Accident de voiture. Mes enfants étaient à l’arrière.
— Je suis désolé.
— C’est gentil. Vous n’y êtes pour rien. »
Tomas restait planté devant le bureau de la réception, le regard dans le vide. Harold soupira.
« Je peux chercher une solution. Je ne promets rien, si ce n’est que le confort sera rudimentaire.
— Ce serait fantastique ! Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas douillet. Je ne le suis plus. »
Chapitre 3 – L’Eldorado
Harold Purito installa Tomas dans un hangar situé non loin du Voyageur. Cet entrepôt de pétrole dissimulait cinq petites chambres, une salle de bains partagée et une kitchenette. On accédait aux chambres par une porte cachée dans un placard. Chaque chambre était équipée d’une lucarne. Il était interdit de l’ouvrir en journée, mais elle permettait de renouveler chaque nuit l’air chargé d’essence.
Ses voisins étaient originaires de pays lointains. Ils avaient échoué ici par la faute de passeurs fantasques ou de courants marins inattendus. Ils n’avaient jamais eu l’intention de venir à Lasciate et aucun ne souhaitait y rester : ils ne connaissaient personne et aucune entreprise ne prenait le risque d’embaucher des clandestins à Lasciate.
Deux ans plus tôt, la police avait confié à Harold un groupe de naufragés afin qu’il les loge trois nuits dans l’attente de leur expulsion. Harold les avait traités avec humanité – en les nourrissant aussi bien que ses clients et en offrant un lit à chacun – et cela avait suffi pour que l’adresse du Voyageur circule parmi les réfugiés et les passeurs. Harold en avait pris son parti en hébergeant ceux qui passaient à travers les mailles de la police. Ils restaient quelques semaines avant de rejoindre un oncle, une sœur ou des cousins qui les attendaient dans des territoires plus familiers. C’était une activité risquée mais rentable. Il avait aménagé deux hangars qui appartenaient à l’entreprise d’un ami : celui dans lequel vivait Tomas et un autre, mitoyen.
Les clandestins n’avaient pas le droit de sortir de l’entrepôt pendant la journée. Tomas bénéficiait d’une dérogation car il passait inaperçu. Blanc, de taille moyenne, les cheveux châtains et les yeux bleus, il ressemblait à n’importe quel Lascebberote. Il cessa néanmoins de se rendre dans le centre-ville afin de ne pas croiser Alicia Skorda. Il ne s’arrêtait jamais dans les restaurants et les cafés – il y en avait beaucoup moins qu’à Joubeville et que partout où Tomas avait voyagé : son accent kouffoy le trahissait. Lorsqu’il avait faim ou soif, il achetait un sandwich ou de l’eau dans un supermarché. Quand il avait besoin de diluer sa solitude dans l’atmosphère d’un café, il se rendait à L’Eldorado comme Harold le lui avait recommandé.
« Ici vous serez en sécurité. La police ne vient pas à L’Eldorado. C’est une soupape. On peut y jouer de l’argent et certains s’y font servir de l’alcool. Toutes les villes ont besoin d’exutoires et Lasciate encore plus que les autres. Il ne s’y passe rien de violent ou de répréhensible. C’est simplement un endroit plus libre qu’ailleurs. »
Situé dans la zone de transit, à mi-chemin entre Le Voyageur et le hangar où dormait Tomas, L’Eldorado n’avait rien d’un tripot. Le comptoir en zinc était propre. Un téléviseur éteint décorait l’un des murs latéraux. Des tables rondes en faux marbre accueillaient des habitués et des consommateurs de passage, souvent des routiers. Il arrivait que l’un d’eux reconnaisse Tomas, qui le saluait et discutait avec lui. Tomas aimait y lire Les Nouvelles de Lasciate. Chaque numéro des Nouvelles semblait identique au précédent. La première fois, Tomas avait cru qu’il lisait l’édition de la veille par erreur. Les titres, les photos et les articles n’avaient pas changé mais la date en première page était bien celle du jour. Le lendemain, le phénomène s’était reproduit. Puis, au fil des jours, Tomas avait perçu les modifications qui intervenaient dans le journal. Les résultats sportifs étaient actualisés le lundi. Pour la vie politique, il y avait un Conseil des ministres le mardi matin et une réunion de l’Assemblée des Représentants du peuple le jeudi. Le premier lundi du mois, le Conseil des Gouverneurs faisait la une du journal. Aucune annonce notable n’en sortait jamais. Dans l’actualité internationale, il n’était question que de tsunamis, de famines, de guerres et d’attentats. Tomas avait toujours trouvé les journaux anxiogènes mais Les Nouvelles de Lasciate lui décrivaient l’Enfer sur terre. À l’inverse, les faits divers locaux se révélaient ennuyeux à l’extrême : il s’agissait de vols sans violence dans des supermarchés, de disputes conjugales – les policiers étaient appelés par les voisins dès que les insultes perçaient les murs – ou d’excès de vitesse – il était interdit de dépasser les vingt kilomètres à l’heure dans toute la cité. Leur traitement s’enrichissait au fil de l’enquête et, quand il n’y avait plus d’éléments nouveaux, ils disparaissaient au bout d’une semaine. Après trois mois de lecture assidue des Nouvelles de Lasciate, le crime le plus violent repéré par Tomas concernait un cambriolage qui avait mal tourné : les deux voleurs avaient frappé le chien pour le faire taire ; l’animal était blessé mais ses jours n’étaient plus en danger. Enfin, le quart de page consacré aux avis de naissances et de décès était actualisé tous les mois. Lire la nouvelle édition chaque matin, c’était comme jouer au jeu des sept différences ; il fallait être particulièrement attentif pour repérer les articles nouveaux et se souvenir de ceux qui avaient disparu.
Parmi les habitués de L’Eldorado, un quatuor se retrouvait sur une grande table en bois, au fond du bar, pour jouer aux dés. Harold les connaissait : « Ce sont des amis. Ils ne te poseront jamais de question. Le mieux est de ne jamais leur en poser. Je suis sûr que vous pourriez bien vous entendre. » Tomas lisait le journal à une table voisine pour observer leur partie de dés. L’un des joueurs arrivait souvent avant ses partenaires. En s’asseyant, il adressait à Tomas un bref mouvement de la tête. Le jour où il ajouta un sourire à ses salutations, Tomas lui demanda quelles étaient les règles du jeu qu’ils pratiquaient. L’homme émit un rire bref :
« Connaissez-vous le Yam’s ?
— J’y ai joué avec mes grands-parents, il y a longtemps.
— Vous vous souvenez des figures à réaliser et du comptage des points ?
— À peu près… »
Son interlocuteur se lança alors dans une explication compliquée où il était question de coefficients affectés à des colonnes auxquelles s’attachaient une variété de contraintes – suivre un ordre précis pour remplir les cases, se limiter à un ou deux lancers de dés, réaliser des scores supérieurs à ceux de ses adversaires. Tomas resta stoïque. Il répétait la fin des phrases qu’il entendait sans comprendre. Il sursauta lorsque l’homme lui lança :
« Enchanté, Hernando Soria.
— Enchanté, Tomas Fischer. Merci pour ces explications, Monsieur Soria. Il me faudra encore du temps pour saisir toutes les subtilités de vos règles.
— Bien sûr, nous avons le temps. Nous avons plus de temps qu’il n’en faut. »
Le deuxième joueur arriva à la table. Brun, moustachu, taciturne et ventripotent, c’était le plus petit des quatre.
« Monsieur Fischer, je vous présente Marcel Orsini. Marcel, je te présente Tomas Fischer. »
Tomas serra la main que Marcel Orsini lui tendait sans sourire. Hernando reprit la parole.
« Prenez un siège à côté de moi. C’est la meilleure façon d’apprendre. Vous pourrez observer ma grille. La seule règle à respecter est celle du silence. »
L’haleine d’Hernando empestait l’alcool. Les seules consommations que proposait L’Eldorado étaient des jus de fruit, du thé et du café, mais les habitués disposaient d’un régime de faveur. Tomas n’avait rien contre les buveurs, tant qu’ils ne prenaient pas le volant.
Hernando Soria lui présenta Jean Bayle et Pat O’Mailly, les deux derniers joueurs. Le premier portait une moustache blanchie par les années et ses yeux rieurs observaient Tomas avec sympathie. Le second avait le visage anguleux, des cheveux poivre et sel hirsutes et, bien qu’il parût le plus jeune, son front était déjà plissé de milliers de rides. Il sembla ne pas voir Tomas.
Tomas assista à la première partie. Il jugea plus poli de se retirer avant le début de la deuxième manche pour ne pas paraître s’imposer. Jean Bayle et Hernando Soria répondirent à son salut. Hernando lui adressa un clin d’œil : « À demain ! »
En rentrant dans son hangar, Tomas était inquiet. Cela faisait deux mois qu’il vivait clandestinement à Lasciate. Était-il prudent de nouer des relations ? Pouvait-il faire confiance à ces gens ? Une pensée finit par l’apaiser : il avait parlé à des gens et il avait envie de les revoir. Il avait envie de quelque chose, c’était déjà ça.
Chapitre 4 – La métamorphose
Tomas avait reçu de l’argent à la mort de Céline. Ils avaient souscrit une assurance-décès pour Léo et Elsa en cas d’accident mais c’était lui l’orphelin qui bénéficiait de cette prévoyance. Il avait de quoi tenir dix ans avec son niveau de dépense. Il mangeait peu. Il avait déjà perdu deux crans de ceinture. Il ne se pesait jamais et il ne savait pas combien de kilos cela représentait, mais il s’était dit que le prochain cran – le dernier – constituerait le signal qu’il faudrait se remettre à manger. Ses seules dépenses étaient son loyer et ses consommations à L’Eldorado, mais cela pouvait évoluer. Surtout, il s’ennuyait. Il décida de chercher un travail et s’en ouvrit à Harold.
« Je ne connais pas d’emploi que puisse occuper un Kouffoy. C’est compliqué de travailler sans en référer aux autorités. Et mieux vaut qu’ils ignorent votre existence. »
Harold jetait des coups d’œil à Tomas, comme s’il le jaugeait. Il reprit :
« Si vous voulez être utile, vous pourriez venir en aide à vos colocataires qui se languissent en attendant de trouver un moyen de partir. En comptant les deux hangars, il y a une dizaine de chambres soit une trentaine de destins bloqués qui désirent s’évader. Vous connaissez des chauffeurs routiers. Si vous leur dites que vous n’hésitez pas à embarquer des clandestins lors de vos trajets, vous pouvez les convaincre de vous imiter.
— Passeur n’est pas le métier dont je rêvais, enfant. Exploiter la misère des gens m’empêcherait de dormir.