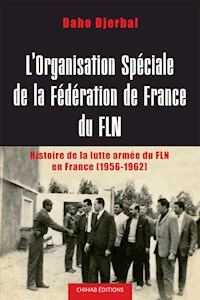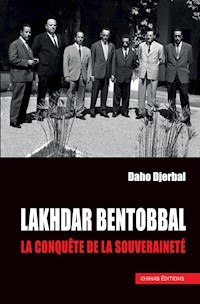
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Chihab
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Avec ce deuxième livre s’ouvre le temps des sacrifices consentis par les cadres et les militants du FLN ainsi que par les djounoud de l’ALN. S’ouvre aussi le temps des terribles épreuves subies par tous les Algériens pour faire face aux lois d’exception, aux déplacements et cantonnements forcés ainsi qu’aux meurtres de masse commis par l’armée française d’occupation et ses auxiliaires de service.
En mobilisant les moyens militaires les plus importants qu’ait pu connaître l’histoire de l’après-seconde-guerre-mondiale, en tentant de détruire l’organisation politique des villes et briser l’ALN, l’Etat français met en oeuvre une nouvelle stratégie inspirée de ses expériences indochinoises. Pour préparer le terrain à « l’auto-détermination » d’une Algérie nouvelle liée à jamais à la France, il fallait séparer le peuple de son avant-garde combattante, car le libre choix des Algériens ne pouvait se faire « avant la fin de l’insurrection ». Une Algérie « pacifiée » et une frange collaboratrice de la population pour une sorte de self-government, tel était le but de la stratégie de la Ve République française.
Résister, faire face et répondre à cette nouvelle donne imposée par une guerre asymétrique, tel était le défi à relever par le peuple algérien et son avant-garde politique et militaire.
S.L. Bentobbal met en lumière les crises et conflits intérieurs mettant en jeu les divergences quant à la ligne générale à suivre et aux options stratégiques non seulement pour la guerre qui se mène, mais aussi pour le devenir de l’Algérie indépendante. Indépendance dans la dépendance ou indépendance totale et souveraineté de l’Etat algérien, telle était la question.
Dans ce témoignage de l’intérieur, S.L. Bentobbal a estimé non seulement nécessaire mais aussi indispensable de faire parler ceux qui étaient sur le terrain, ses compagnons d’armes ainsi que ses pairs dans le gouvernement des Algériens par les Algériens.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Maître de conférences en histoire contemporaine à l'université d'Alger, Daho Djerbal est, depuis 1993, directeur de la revue Naqd, d'études et de critique sociale. Après une dizaine d'années de travaux en histoire économique et sociale, il s'oriente vers le recueil de témoignages d'acteurs de la lutte de libération en Algérie. Il travaille aussi à la relation entre histoire et mémoire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LAKHDAR BENTOBBAL
La conquête de la souveraineté
DAHO DJERBAL
LAKHDAR BENTOBBAL
La conquête de la souveraineté
CHIHAB EDITIONS
© Éditions Chihab, 2022.
www.chihab.com
Tél. : 021 97 54 53 / Fax : 021 97 51 91
ISBN : 978-9947-39-411-3
Dépôt légal : mars 2022
AVERTISSEMENT
Dès la fin des années 1970, après plus d’une décennie de recherches sur les formes de la domination coloniale, il m’avait été donné en tant que jeune historien de réfléchir sur la pertinence et les limites des démarches d’appréhension de la société algérienne dans le temps présent, la moyenne et la longue durée. Les disciplines et les catégories sociales de la sociologie et de l’historiographie classiques que nous avions apprises sur les bancs de l’université ne nous permettaient plus d’éclairer les crises profondes que notre société traversait dans tous les domaines, avec leur lot d’errements et d’affrontements incessants contre l’ennemi extérieur et contre l’adversaire réel ou présumé de l’intérieur.
Notre projet pour rendre compte d’un processus mis en œuvre en pleine lutte de libération nationale, et qui continuait de produire ses effets plus d’une décennie après l’indépendance, a été d’apporter par nos travaux un éclairage particulier à partir de sources orales puisées auprès de ceux-là mêmes qui ont eu à affronter le problème sur le terrain des faits.
D’abord, qui sont ces hommes ? D’où viennent-ils ? Comment sont-ils arrivés au politique ? Quelle était leur conception du pouvoir, de la Nation, de l’État, des hommes et de leur gouvernement ? Cette conception a-t-elle évolué avec le temps et quelles en ont été les déterminations ?
Il y avait donc lieu de s’interroger sur les origines de ces hommes et de ces femmes qui ont fait la décision, sur leur formation et leur appartenance politique, le poids relatif des groupes et de ceux qui les représentent dans les partis et les institutions qu’ils ont mis en place.
La rencontre avec Abdallah Bentobbal et l’entretien qu’il nous a accordé, Mahfoud Bennoune et moi-même, a duré cinq années, de 1980 à 1985. Le travail qui a suivi a été de faire passer, avec l’aide de Dalila Iamarène, le document oral enregistré à sa version écrite. Cela a pris cinq années pour aller du brouillon manuscrit revu et corrigé à la saisie sur machine à écrire, elle-même revue et corrigée, et enfin à la version définitive présentée selon un ordre chronologique et thématique.
L’ouvrage devait être publié dès 1985 par la SNED à laquelle il a été soumis. Puis, suite au refus déguisé du DG de cette dernière, j’ai été personnellement chargé de démarcher des éditions étrangères, cinq éditeurs parisiens au total. Il n’y a finalement pas eu d’accord sur la forme comme sur le fond avec ces dernières, plus préoccupées par la réception du document par le lectorat français.
Plus de quarante années plus tard, il m’a semblé d’une extrême importance de le rendre au peuple algérien auquel il était initialement destiné.
Comme pour le premier volume, le texte tel qu’il apparaît dans ce second volume est l’expression littérale du témoignage de Lakhdar Bentobbal ainsi que des cadres du FLN/ALN qu’il a sollicités pour corroborer ses dires ou rafraîchir sa mémoire. Pas un mot n’y a été ajouté ou retiré sans son accord.
En rendant ce travail sous sa forme actuelle, et en le transmettant au peuple algérien, j’ai la conviction d’avoir traduit un document oral pour en faire une référence pour la mémoire collective et pour la recherche en histoire contemporaine de l’Algérie.
Notre travail n’est pas d’écrire l’histoire mais de la transmettre. Et, pour reprendre Michel Foucault : « Et sous les oublis, les illusions, les mensonges qui essaient de nous faire croire, justement, qu’il y a un ordre ternaire, une pyramide de subordinations ou un organisme, sous ces mensonges qui essaient de nous faire croire que le corps social est commandé soit par des nécessités de nature soit par des exigences fonctionnelles, il faut retrouver la guerre qui continue, la guerre avec ses hasards et ses péripéties. Il faut retrouver la guerre, pourquoi ? Eh bien, parce que cette guerre ancienne est une guerre […] permanente. »
Daho Djerbal
Février 2022
PREMIERES CRISES DE DIRECTION
Péripéties tunisiennes
À Tunis, Kaci nous a emmenés chez des gens de sa région, des Algériens qui vivaient en Tunisie depuis vingt ou trente ans. Benkhedda1 et moi y avons vécu en totale clandestinité, sans sortir, ni de jour ni de nuit. Nous avons appris alors l’anarchie totale qui régnait de ce côté-là de la frontière. L’autorité tunisienne était bafouée, des groupes de l’ALN débordaient sur la Tunisie sans dépendre d’aucune autorité centrale. Les sections étaient dirigées par des individus venus des Aurès ou de la base de l’Est, mais aucune discipline n’était respectée et chacun agissait indépendamment des autres. Tout le monde se plaignait, tant les Algériens que les Tunisiens qui étaient dans l’impossibilité d’imposer leur souveraineté et leur autorité.
Nous avons remarqué que l’indépendance n’était pas totale en Tunisie. L’armée française était encore là et nos djounoud étaient armés. Ils avaient déjà tiré à plusieurs reprises sur les autorités tunisiennes et il leur arrivait aussi de se battre entre eux. Ils avaient procédé à des enlèvements. Un colonel français avait été kidnappé en plein Tunis. Les Tunisiens tremblaient à l’idée de représailles. Ils n’avaient pas tort car, quelque temps plus tard, les Français menèrent une grande opération pour libérer l’otage. Il a fallu beaucoup de tractations pour qu’il soit relâché, heureusement sain et sauf.
Ouamrane2, de son côté, avait beaucoup œuvré pour instaurer l’autorité du CCE. Les progrès étaient notables, mais la réussite n’était pas totale. Il était servi par le prestige de la révolution, l’autorité morale et la considération qu’on portait à un colonel de l’intérieur. Après cela, il s’est attelé à résoudre la crise de la Wilaya I. Quand nous sommes arrivés à Tunis, celle-ci arrivait à son dénouement. Mezhoudi s’était réuni avec tous les responsables des Nementchas qu’il avait fait sortir d’Algérie. Ouamrane en avait pris le commandement et avait constitué le premier conseil de wilaya de l’extérieur. Il avait nommé à sa tête un ancien lieutenant de l’armée française en retraite, Mahmoud Chérif3.
Ouamrane était au Caire quand nous sommes arrivés à Tunis et nous ne l’avons vu que quatre ou cinq jours plus tard. Quand nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté de la composition de ce conseil.
Entre-temps, j’avais rencontré Benaouda4 qui l’avait aidé à résoudre le conflit mais n’avait pas assisté à la réunion décisive. Je lui ai demandé des informations sur Mahmoud Chérif que je ne connaissais pas. Mahmoud Chérif était un ancien de l’UDMA et c’était la première fois, depuis le 1er novembre 1954, qu’un élément de l’UDMA prenait carrément la direction d’une wilaya. C’était en outre un ancien de l’armée française, chef du Dar al ‘askri5 et collaborateur des Français, jusqu’à la fin de l’année 1956, à Tébessa.
Les nôtres l’avaient arrêté et condamné à mort comme indicateur des Français. Il avait eu comme défenseur un membre de la Wilaya I, Salah Benali, qui avait fait une proposition :
– Il devra faire une action contre l’armée française. S’il meurt, on en sera débarrassés, s’il réussit, il entrera dans l’ALN.
La Wilaya I lui donna une unité avec laquelle il mena l’action. Ce fut un succès, mais Mahmoud Chérif en sortit avec une grave blessure. Je crois qu’il a eu tout le flanc gauche mitraillé. Il fut transporté à dos de mulet en Tunisie où il fut soigné. C’est à sa sortie d’hôpital qu’il se retrouva parachuté chef de wilaya.
Je crois qu’Ouamrane a décidé seul. Son jugement sur les hommes n’était certes pas toujours heureux. Il avait certainement été influencé par les Aurésiens alors en conflit avec les Nemencha. Mezhoudi aussi a eu un rôle dans l’affaire, mais Ouamrane a agi avec responsabilité, pour que les membres de la Wilaya I ne s’entretuent pas. C’était le plus important pour lui. Je ne pense pas qu’il ait fait des calculs. D’ailleurs, il a immédiatement reconnu ses torts quand nous avons évoqué le sujet, nous disant :
– Ce que vous dites est vrai, mais je ne le connaissais pas. Ils risquaient de s’entretuer encore. Il n’y a pas d’autorité ici et cela peut poser des problèmes avec les Tunisiens. J’ai cru bien faire…
À ce moment-là, je n’étais encore que chef de wilaya ; je n’avais aucune autre autorité. Malgré cela, j’ai donné mon avis devant Benkhedda. J’ai dit que Mahmoud Chérif ne me plaisait pas, que je ne l’acceptais pas et que c’était une très grave erreur de l’avoir nommé comme chef.
Ouamrane nous a avoué qu’on ne lui avait pas présenté les faits de cette façon. Les gens lui avaient affirmé que Mahmoud Chérif pouvait être l’unificateur de la Wilaya I parce qu’il n’était pas partie prenante dans le conflit entre les Aurésiens, ni dans le conflit Aurès-Nemencha.
Je considère toujours que c’était une grande erreur. C’est ainsi que nous avons commencé à perdre le pouvoir et non pas du fait du CNRA. D’abord, nous sommes sortis du pays et avons laissé les wilayas. Ensuite, nous avons donné l’arme de la révolution, c’est-à-dire les wilayas, à des gens qui n’avaient rien de commun avec elle. Les autres en ont profité et ont noué des alliances avec ces gens qui ont fini par avoir des forces entre leurs mains. C’est alors qu’ils ont eu les moyens d’élever la voix.
Je continue à dire que le CNRA n’y est pour rien. Ils n’ont pas pris le pouvoir ; c’est nous qui le leur avons donné. C’est l’un des nôtres qui l’a donné, consciemment ou inconsciemment. Mais le résultat est le même. Avec ou sans calcul, quelle que soit l’intention qu’on lui prête aujourd’hui, le résultat fut le même. Ouamrane lui-même a d’ailleurs été l’une des premières victimes de leurs décisions.
La rencontre du Caire
Nous nous sommes reposés quelques jours, avant que Abane et Dahlab qui venaient du Maroc ne nous rejoignent. Nous n’avons pas beaucoup tardé avant de partir pour Tripoli, puis le Caire.
Nous n’étions pas informés de la position des dirigeants détenus. D’ailleurs, nous n’étions encore que des individus et le CCE ne s’était pas encore réuni. Moi-même, je n’étais que chef de wilaya. Nous avons eu des discussions certes, mais c’était à bâtons rompus ; elles n’avaient aucun caractère formel.
Le Docteur Lamine6 était arrivé à Tunis, venant du Caire. C’était la première fois que nous nous rencontrions, excepté celle où je l’avais vu dans un meeting à Constantine. Il est resté deux jours puis il est reparti.
Au Caire, ce sont les Égyptiens qui ont pris l’initiative de nous inviter en organisant un banquet, plus officiel que politique. Ils avaient réuni ce jour-là, autour d’une même table, le conseil de la révolution égyptienne et les représentants de l’Algérie combattante. C’était surtout une première prise de contact, entre groupes ayant des affinités ou des relations personnelles. Ils cherchaient manifestement le moyen d’amorcer la discussion.
Quant à nous, nous n’avons pas eu de réunion immédiatement après notre arrivée mais seulement des contacts pour débattre du premier bilan. J’ai rencontré Boussouf7 que je n’avais plus croisé depuis la réunion des 22. Abane aussi, que je n’avais pas revu depuis le congrès de la Soummam, et Krim8 qui était venu avec moi mais avec qui je n’ai pas vraiment parlé des problèmes politiques.
Abane a demandé à me voir en particulier et nous sommes sortis en ville pour discuter. Il se plaignait de la discipline rigide qui régnait au Maroc9, de Boussouf et de son attitude de dictateur. Au Maroc, personne ne se connaissait ; les contacts étaient impossibles car les gens étaient cloisonnés dans des villas. Ils étaient eux-mêmes complètement isolés les uns des autres. Je crois que Abane ne savait pas que Boussouf et moi nous nous connaissions depuis notre plus jeune âge, que nous étions organisés dans les mêmes cellules et que nous avions fui ensemble, lors de la découverte de l’OS. Il ne connaissait pas l’état de nos relations, ni mon passé militant ; ce qui explique les propos bizarres qu’il m’a tenus et qui m’ont profondément choqué. Il disait :
– La révolution est maintenant entre nos mains, c’est nous qui la dirigeons. Il ne reste plus qu’un seul danger pour nous, c’est Boussouf et tu pourrais m’aider en l’éliminant.
Je n’ai pas avalé ce qu’il venait de me dire, mais je n’ai rien laissé paraître. J’ai demandé pourquoi. Il a répondu :
– Les gens se plaignent de lui. Il a commis beaucoup d’abus. Son organisation n’est connue de personne, elle est complètement clandestine. Il ne nous laisse contacter personne et, de ce fait, je n’ai pas confiance en lui. Il est très fort ; il a entre les mains plus du tiers de l’Algérie et des moyens tels qu’il devient un danger pour nous. Il faut voir comment l’éliminer.
Il a commencé à me jeter des fleurs :
– Tu es un honnête militant ; tu as toujours travaillé pour la révolution. J’ai su à la Soummam que tu étais intelligent, politisé…
Je n’ai rien dit, mais cela m’a déplu.
D’abord, il est venu après le déclenchement de la révolution, ai-je pensé, et il veut éliminer quelqu’un qui était là avant lui. De plus, il avance des arguments peu convaincants. Ce qui lui fait peur, c’est que Boussouf est un homme fort qui gère plus du tiers de l’Algérie. Ce ne sont pas là des motifs d’accusation. Ce n’est pas Boussouf qui a fait le découpage des régions. Il a été fait avant novembre 1954 et Boussouf en a hérité. D’ailleurs la Wilaya V a conservé son étendue jusqu’en 1962.
Quels qu’aient été les reproches faits à Ben M’hidi10 à la Soummam, nous l’avons toujours considéré comme l’un des plus proches de nous et un des meilleurs garants de l’esprit de la révolution. Nous lui avons toujours fait confiance, plus qu’en Abane.
Nous en voulions toujours à ce dernier pour les parachutages qu’il avait opérés à l’extérieur : des gens comme Kheireddine11 au Maroc, Lamine au Caire… Bien que celui-ci soit venu très vite à la révolution, il était de l’ancienne classe politique en qui nous n’avions pas grande confiance. Les noms que Abane avait imposés au CNRA étaient des gens comme Abbas12, Francis13, Mehri14 et Bouda15. C’était toute une équipe nommée à l’extérieur, avec des responsabilités et non pas comme de simples fonctionnaires.
J’ai aussi vu Krim et Boussouf. Krim a commencé à nous parler d’une manière beaucoup plus ouverte. Il ne l’avait pas fait plus tôt, en cours de route, peut-être à cause de la présence de Benkhedda. De plus, nous étions talonnés par l’armée française et donc trop occupés à assurer notre sécurité quotidienne. Il a commencé à parler de Abane.
– Maintenant que nous avons plus de temps et de sécurité pour nous réunir, je dois dire que Abane est devenu un danger pour la révolution. Pour tout ce qui s’est fait à Alger, il n’a demandé ni mon avis, ni celui de Ben M’hidi. II a pris les décisions, seul, et sa démarche devient de plus en plus personnelle. Il devient de plus en plus arrogant et se comporte en chef suprême de la révolution. Nous n’en avons jamais décidé ainsi. Nous avons désigné le CCE uniquement pour la coordination des wilayas, mais les grandes décisions doivent être discutées.
Krim nous a assuré - et il était formel - qu’il n’était pas au courant pour la grève des huit jours ni pour un certain nombre d’autres actions, comme l’envoi de représentants à l’extérieur. Abane en avait décidé seul, et quand lui, Krim, avait protesté à plusieurs reprises, son interlocuteur était entré dans une violente colère. Il devenait insupportable.
Après ce que m’avait dit Abane pour justifier l’élimination de Boussouf et les paroles de Krim, j’ai compris alors qu’il avait des vues lointaines. Il voulait écarter tous ceux qui avaient fait la révolution, peut-être pas en une seule fois, mais ce qui semblait sûr, c’est qu’il était gêné par notre présence. Il aurait les mains beaucoup plus libres, seul. Face aux anciennes élites politiques, il aurait mené la politique qu’il désirait. Il avait en outre fait des déclarations qui nous ont déplu. Pour la première fois, il posait le problème du « préalable de l’indépendance ». Là encore, il n’a demandé l’avis de personne. Le CNRA ne s’était pas encore réuni et il développait déjà des positions qui engageaient la stratégie de la lutte.
Je ne sais pas si Krim ou Boussouf ont eu la même réaction, mais moi, cela m’a déplu. J’ai demandé à Krim quelle était la raison de cette nouvelle position. Une telle condition posée à la France, je ne l’avais jamais vue auparavant. Krim me dit que Abane n’avait pas demandé son avis. C’était une position très grave. Cela voulait dire, en langage politique clair, qu’aucune négociation n’était possible avec la France avant qu’elle n’accepte le principe de l’indépendance. Mais, sur le plan militaire, cela voulait dire qu’il fallait mettre l’armée française à genoux pour imposer l’indépendance avant toute négociation.
En fait, il avait pris position contre nous, pour faire de l’extrémisme, de la surenchère, pour montrer que nous, chefs de wilaya - ce qu’on appelait alors les militaires - étaient des modérés et lui, le vrai révolutionnaire, le représentant authentique de la révolution.
Nous ne serions jamais arrivés à ce stade. Ni notre force, ni la position géographique de l’Algérie, ni la méthode de guérilla que nous avions adoptée ne nous auraient permis d’arriver à un rapport de forces équilibré, même après des dizaines d’années de lutte. Donc, c’était une démarche contre nous, pas contre la France. Il nous avait coincés et tout le monde avec. Car, même si nous défendions notre thèse au CNRA pour que ce préalable soit retiré, on ne pouvait opérer facilement puisque, de toutes les façons, c’était maintenant rendu public et il fallait que la France nous donne une contrepartie ou, du moins, un prétexte politique. Il fallait tenir compte de l’opinion algérienne, des combattants qui allaient nous accuser, moi et les autres, de ne pas être des révolutionnaires. Donc Abane ne l’avait pas fait pour défendre un principe ; c’était un moyen démagogique opérant contre nous.
C’est en ces termes que je me suis adressé à Krim et à Boussouf. Ils étaient d’accord avec moi que c’étaient des manœuvres visant à nous mettre dans l’embarras. J’ai dit alors que, puisque sa position soulevait des problèmes aussi graves, nous ne pouvions décider seuls.
– Il y a des responsables militaires à l’extérieur, nous devons les rassembler et demander conseil. Il faut que l’ALN et ses représentants de l’intérieur soient avec nous, sinon nous ne pourrions aller à l’encontre d’une décision du CNRA.
Les militaires remanient le CCE
Nous avons fait seuls une réunion de responsables militaires. Il y avait Krim, Boussouf, Ouamrane, Mahmoud Chérif, puisqu’il était chef de la Wilaya I, Lamouri16,Bouglez17, Benaouda et, pour la première fois depuis novembre 1954, j’ai rencontré un jeune homme maigre et blond. Comme je ne le connaissais pas, j’ai demandé son nom à Boussouf. Il me répond : « Boumediene ». Il ne m’a pas donné son nom de famille. Il était venu du Maroc avec lui. J’ai demandé à Boussouf s’il allait assister ou pas à la réunion. Il me dit que oui, car il avait l’intention de le nommer à sa place comme intérimaire de la V. Boumediene a donc assisté à la réunion. C’était sa première action politique sans être membre du conseil de la révolution ou membre du conseil de la wilaya. J’en parle maintenant car nous y reviendrons par la suite.
Krim a donné un aperçu de la situation à Alger, comment a travaillé le CCE, les conditions extrêmement difficiles qui les empêchaient de réfléchir, de se réunir. Il a parlé aussi de l’attitude de Abane, après notamment la mort de Ben M’hidi. Krim était seul avec, face à lui, Dahlab et Benkhedda qui suivaient toujours Abane.
Nous avons discuté et dit que la composition du CCE ne nous satisfaisait pas. Nous étions d’accord pour dire que Dahlab et Benkhedda n’avaient pas leur place au CCE. Restait le problème de Abane. On ne pouvait l’écarter, mais il ne devait plus diriger seul. Beaucoup ont proposé de désigner au CCE uniquement des gens qui avaient dirigé des wilayas. Ce serait une direction homogène à proposer au CNRA, mais le danger était qu’il fallait pratiquement faire un coup d’État pour l’imposer. Il était sûr que l’ensemble du Conseil serait contre, les membres de l’ancienne classe politique étant largement majoritaires. Les chefs de wilaya, si nous comptions les voix, n’étaient que cinq, la VI n’étant pas encore représentée. Il y avait aussi Amara Bouglez de la base de l’Est à la réunion des militaires. Il était évident que tous les autres seraient avec Abane.
Quand nous sommes allés informer Abane, il est entré dans une violente colère. Il a crié, tempêté, dit que c’était une décision illégale. Nous lui avons dit que nous allions soumettre la liste au CNRA. Nous avons demandé conseil à d’autres gens, fait des sondages. Nous avons vu Lamine Debaghine, des gens comme Abbas et certains autres, extérieurs au CNRA. Tout le monde était d’accord - enfin pas vraiment -, mais avec quelques réticences :
– Si vous agissez de la sorte, ce sera vu comme un durcissement de la révolution. Il faut prendre en compte l’opinion publique arabe, étrangère, française. Ils seront contre nous, ce qui n’est pas fait pour nous aider. Il faut mettre des hommes politiques ayant des noms connus à l’échelle nationale et internationale pour nous aider. Alors, seulement, nous soumettrons cette proposition sans problème au CNRA, sans avoir recours à la force et, surtout, sans être obligés d’éliminer un tas de personnes qui seront contre.
C’était alors presque une confrontation de forces, car Abane avait quand même réussi à se créer une légende, un nom, même à l’intérieur de certaines wilayas, comme la IV, ou dans les régions proches d’Alger.
La IV lui était presque acquise, si l’on excepte Ouamrane. Nous avons pensé que la crise risquait d’atteindre la base, ce qui serait mauvais pour la révolution. C’est ce qui nous a poussés à réfléchir à d’autres personnes que nous pourrions proposer. Un autre facteur nous y obligeait, nous n’avions jamais dirigé sur le plan politique pur, nous ne savions pas comment nous y prendre et nous avions peur de faire des erreurs, même de bonne foi. Ce ne serait bon ni pour la révolution, ni dans notre lutte contre l’ennemi commun. Quels seraient ces politiques qui pouvaient nous aider sur le plan de la tactique politique, sur le plan de la presse et, surtout, de la rédaction ? Car, en parlant franchement, aucun de nous ne pouvait assumer cette responsabilité, ni moi, ni Krim, ni Boussouf.
Nous avons commencé par choisir Lamine Debaghine, considéré comme le plus intègre de l’ancienne équipe politique, Mehri, parce qu’il était jeune et nouvellement entré au comité central du MTLD, donc pas encore blasé et Abbas, pour donner à l’opinion occidentale une apparence de modération du CCE. Nous avons ensuite dit que, pour la composition du CNRA, nous n’aurions pas recours à des méthodes illégales. Nous ferions passer cette équipe en respectant le statut du conseil lui-même.
La réunion a duré deux semaines environ, avec des crises successives. Nous en étions presque arrivés à la cassure. Abane refusait surtout l’éviction de Dahlab et de Benkhedda, mais nous étions intraitables. Les anciens du comité central du MTLD ne devaient plus être au CCE.
La réunion a donc duré deux semaines et n’a rassemblé que les chefs militaires. Quand nous trouvions des solutions, nous contactions des responsables. Quand nous ne trouvions pas d’accord, nous nous réunissions à nouveau jusqu’au jour où nous avons fini par arriver à un consensus avec les membres du CNRA. En fait, nous avions peur d’aller au CNRA sans solutions, ce qui aurait provoqué l’éclatement.
Tout a été réglé lors de cette première réunion. La tenue du CNRA18 était tout à fait formelle. Les décisions ont été acceptées en un seul jour. Tout avait été décidé auparavant, mais nous ne l’avions pas fait seuls puisque nous maintenions des contacts en dehors des présents.
Abane aussi se réunissait avec les autres membres du conseil. On venait nous dire qu’il se plaignait :
– Ces gens sont incapables de diriger la révolution, disait-il. Si on les laisse faire, ils risquent de la mener à l’aventure, ce sera la dictature.
Il agissait de la sorte avec les politiques qu’il avait réussi à influencer et même à effrayer, pour certains. De plus, nous étions inconnus pratiquement de tous les gens de l’extérieur, de Abbas, de Mehri, de Lamine, de Tewfik El Madani19, de M’hamed Yazid20 et de toute l’ancienne classe politique. Ils éprouvaient beaucoup plus de crainte que de respect envers nous. Ils savaient que l’ALN était entre nos mains, de même que l’organisation politique, et qu’eux n’avaient rien, aucune force sur laquelle s’appuyer. Nos noms leur étaient inconnus, sauf celui de Krim, mais ils ne l’avaient jamais vu auparavant. Il était connu seulement de deux ou trois d’entre eux qui l’avaient rencontré à Alger.
Nous consultions, quant à nous, régulièrement les responsables détenus et nous avons obtenu leur accord total. Leur avocat Chérif21, Algérien installé au Maroc, était notre intermédiaire. Nous échangions aussi des correspondances écrites où nous leur faisions part de nos positions que nous proposions, après leur accord, aux autres responsables. Ils ont marché à fond avec nous jusqu’à la tenue du CNRA.
C’est nous qui leur avons parlé de Dahlab et de Benkhedda et ils ont été aussi intransigeants que nous sur ce point. Nous ne les acceptions pas pour toute une série de raisons. Benkhedda nous avait combattus pendant et après la crise du MTLD ; même après le 1er Novembre, il continuait à tenir des réunions à Blida où il nous qualifiait d’aventuriers et qu’il ne fallait pas nous suivre22.
Nous avons vu qu’au CCE, et en tant que dirigeant, il ne jouait aucun rôle. Il était incapable d’avoir une position claire et d’assumer ses responsabilités. Je ne sais si c’était une question de caractère ou un simple manque d’envergure, mais sa présence au CCE n’apportait rien. Qu’il fut ou pas au CCE, ne changeait rien aux choses. Il ne représentait aucun courant, il n’était pas profond et il ne nous satisfaisait même pas sur le plan de la pensée.
Après avoir reçu l’accord des détenus de France, nous avons annulé deux décisions très importantes de la Soummam : la priorité de l’intérieur sur l’extérieur et celle du politique sur le militaire.
J’étais venu avec la mission de me réunir avec les autres en tant que membre du CNRA puisque j’étais devenu titulaire de cette instance après la mort de Zighout23, puis de rejoindre ma wilaya. Du fait que j’ai été nommé au CCE et que le CNRA avait décidé que le CCE resterait à l’étranger, je suis resté sur place et j’ai proposé au CCE de désigner Ali Kafi pour diriger la Wilaya II.
Nous avons fait passer la résolution du CCE au CNRA qui l’a votée avec répartition des membres dans les différents départements. Seules deux voix étaient contre la résolution. Celle de Abane et celle du Colonel Sadek24 (Slimane Dhilès).
Je ne me souviens pas de la répartition exacte des voix, mais la majorité légale avait été atteinte au moment du vote. Je ne me souviens pas si Dhilès était présent ou s’il avait voté par procuration.
Ce qui est sûr, par ailleurs, c’est que c’est Tayebi, et non Thaalbi25, qui, contrairement à certains dires, avait pris part au vote. Thaalbi était un ancien militant MTLD arrêté en 1945. Il professait dans une medersa libre à Maghnia. Il avait pris le maquis dès le début du déclenchement de la lutte armée, à Nador, sur la frontière, avec Boussouf et Boudiaf. Puis il avait été nommé chef de l’organisation au Maroc. Il avait travaillé pendant longtemps au Caire. Le CNRA l’a mis ensuite à ma disposition et je l’ai désigné à la tête de la Fédération de Tunisie où il est resté jusqu’en 1962. Son nom de guerre était Si Allal. Il était très connu en ce temps-là.
C’est donc la réunion préparatoire des militaires qui a été déterminante. Elle a bouleversé toute la situation et joué un rôle déterminant dans la composition de la nouvelle direction en répartissant les tâches comme suit :
Abbas …………… Information
Krim …………..... Affaires militaires, forces armées
Ouamrane …………… Armement
Boussouf …………… Liaisons
Lamine ……............ Affaires extérieures
Bentobbal …………… Organisation26
Mahmoud Chérif …………… Finances
Mehri …………… Affaires sociales27
Abane .................. Direction du journal El Moudjahid et de l’UGTA
Abane avait été pratiquement dégradé ; malgré cela, il continuait à créer des problèmes par le biais du journal El Moudjahid qu’il contrôlait étroitement. Le journal était devenu, de fait, le porte-parole de l’orientation politique. Il avait aussi utilisé l’UGTA28. Bien qu’elle ne jouait pas un grand rôle sur le plan intérieur, son audience apparaissait surtout sur la scène internationale. Il n’avait pas désarmé. Il avait seulement changé d’attitude et de tactique. Il avait placé comme chef de l’UGTA un ancien instituteur, Mouloud Gaïd29 (Aïssat Idir30 était déjà mort). Je ne sais pas comment le classer politiquement, mais c’était un ancien de l’UDMA et, en même temps, un ami de l’ancien administrateur français de Lafayette (Bougaa). C’était l’homme à tout faire de Tlili31 et de Ahmed Ben Salah32, qui était alors chargé de l’UGTT, et, en même temps, il était l’homme de main de Abane.
Le redressement de la situation née du congrès de la Soummam
Nous nous sommes réunis à Tunis et nous devions faire une déclaration très importante. Je ne me souviens pas au juste de la conjoncture : cela répondait-il à une initiative française ou, du moins, devions-nous clarifier notre position ? Je ne me souviens pas non plus de la date. Nous avions passé toute la première quinzaine d’août à préparer la réunion du CNRA.
À ce moment-là, concernant la conjoncture et le redressement de la révolution, surtout sur le plan de la composante humaine, il me semblait que nous avions amélioré la situation par rapport au 20 août 1956. Nous avions quand même subi un premier échec car nous n’avions pas pu imposer toutes les décisions prises pour redresser complètement la situation née du congrès de la Soummam. Le CCE ne correspondait pas encore totalement à l’idée que nous nous en faisions et, au CNRA, nous n’avions pas pu changer grand chose. Seul Brahim Mezhoudi avait été écarté ; il n’était plus membre suppléant et je considérais que c’était, malgré tout, un commencement. Bien que ce fût le seul changement, nous pouvions toujours former, avec Ouamrane, Krim et Boussouf, une équipe capable de s’imposer et, par notre présence au CCE, changer beaucoup de choses à travers un organisme légal.
L’idée d’un gouvernement provisoire n’avait pas encore germé, nous n’avions encore jamais parlé de cette possibilité. Je craignais que cela ne se transforme en problème de personnes. Nous avons su, par la suite, que dans la situation décrite par Abane, lors de son séjour au Maroc, il y avait du vrai. Nous l’avions appris par d’autres aussi. Cela était-il dû à la philosophie de Boussouf ou bien à la situation qui prévalait au Maroc ? Une partie de la colonie algérienne, du moins sa composante la plus active, travaillait dans l’administration française et collaborait étroitement avec les services de la Résidence. Était-ce par peur de ne pouvoir contrôler l’appareil que Boussouf avait érigé un système de clandestinité et de cloisonnement total ? De plus, l’armée française était toujours sur place en plus de l’armée d’occupation espagnole au Nord33. Toute l’organisation était en terrain ennemi ; c’était pratiquement la situation que nous vivions à l’intérieur du pays, ce qui faisait qu’il avait peur du noyautage. Il a donc été obligé d’instaurer une discipline sévère, ce qui a déplu à beaucoup. Certains n’ont pas pu supporter ce mode de vie. Ils étaient cloisonnés dans des villas, ne sortant pratiquement ni le jour, ni la nuit. Quelques-uns se sont enfuis, comme Belaïd Abdesslam34, qui a rejoint Tunis. Il a été considéré comme déserteur par la base de Nador où il travaillait à l’école des cadres. Ces derniers étaient formés pour être affectés à l’intérieur. Belaïd y enseignait l’histoire et la géographie, Laroussi Khelifa35, l’économie et Nourreddine Delleci36, les sciences politiques.
Il y a eu beaucoup de bruit autour de cette affaire. Boussouf, et avec lui Boumediene, avaient proposé au CCE de faire arrêter Belaïd. Je me suis opposé, avec d’autres à cette décision. Le ton est monté entre Boussouf et moi. Je lui ai dit :
– Si j’étais à sa place, j’aurais fait la même chose. Je ne le considère pas comme déserteur. C’est une réaction normale à ce système et elle peut se justifier.
Cela s’est passé bien après le bref séjour de Abane au Maroc ; une année après je crois. La situation n’était donc pas assez préoccupante pour instaurer une clandestinité aussi totale et une discipline que les gens supportaient très mal.
Ce que m’avait dit Abane, je n’en ai jamais parlé, ni à Krim, ni à Boussouf. Personne ne l’a jamais appris de moi. Je l’ai évoqué seulement des années plus tard, même si je considérais que Abane était allé trop loin, qu’il était dangereux.
À mon sens, cela ne pouvait s’arrêter à Boussouf mais toucher à tous les hommes qui avaient déclenché la révolution. D’après ce que j’ai appris de Krim (le fait que Abane prenait des décisions seul, sans demander son avis, ni même celui de Ben M’hidi, sous prétexte qu’il était difficile de tenir une réunion), j’en ai conclu que l’arrestation de Bitat l’avait arrangé dans un certain sens. Ce n’était pas de sa faute bien sûr, mais grâce à cela, il a eu les mains libres dans l’Algérois. J’en arrivais à penser qu’il voulait s’accaparer de la révolution, seul, avec des inconditionnels, c’est-à-dire, avec des gens qui lui devaient leur existence politique, des gens qui n’étaient au CNRA que grâce à lui.
La réunion préparatoire a donc été centrée sur le premier redressement de la situation. J’entends par là la situation marquée par la prise en main, si je puis dire, de pratiquement toute la révolution par Abane. C’était lui qui dirigeait en fait. Ouamrane l’avait un peu défendu, non pas qu’il l’aimât, mais il considérait que nous avions encore besoin de lui, que c’était un homme qui avait des idées et qui était encore capable de nous aider. Ce qui était vrai.
Sur le plan de la compétence, il nous dépassait dans beaucoup de domaines. Il nous dépassait surtout par ses capacités de dirigeant. Nous l’avons laissé au sein du CCE car cela nous posait des problèmes de l’en écarter. Nos bases de l’intérieur étaient loin, la Wilaya IV lui était acquise et la zone d’Alger, dont il avait réussi à avoir la représentation comme zone autonome, constituait pour lui une autre force, à l’intérieur. Dans la zone autonome d’Alger, son nom s’était imposé et des militants le respectaient.
Il avait une sorte de complexe par rapport aux chefs de wilaya qui tenaient les forces réelles du pays. Les chefs de wilaya étaient membres du CCE. Or, lui, n’avait pas encore de forces, donc pas de représentation réelle. Même si, théoriquement, Ouamrane était chef de la IV, c’était en fait lui, Abane, qui la dirigeait avec un certain Sadek qui l’aimait beaucoup et qui avait une grande confiance en lui. Donc, on ne pouvait faire rien d’autre que de le garder comme membre du CCE. Seulement, il devait se contenter de responsabilités qui ne touchaient pas à l’organisation politique ou militaire, qu’elle soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Algérie.
Nous voulions le « banaliser » et je crois que ce but a été atteint. Ce n’était plus le Abane d’Alger, l’arrogant qui faisait la pluie et le beau temps dans toute l’Algérie, et non plus seulement d’Alger, et qui était la terreur de tout le monde. Un jour, il s’en est pris à Yazid (nous ne le connaissions pas encore, le CCE n’ayant pas encore été remodelé) lui disant :
– J’ai appris le train de vie que tu mènes à New York et les dépenses auxquelles tu te livres. Tu vis en Américain. Je vais « t’arranger » ; tu verras, je vais te ramener à terre.
Il commençait à menacer les gens, et cela dès sa sortie du pays. Il ne s’adressait pas à nous de cette manière, mais il semait quand même la terreur à l’extérieur et les hommes politiques lui faisaient la cour. Après notre opération de redressement, les gens ont changé leur vision ; ce n’était plus le Abane légendaire qu’ils voyaient comme une foudre de guerre. Ils ont su aussi que nous n’étions pas sous son obédience. Abane entretenait un malentendu vis-à-vis des gens. Ils pensaient qu’il tenait en main pratiquement tous les chefs de wilaya et qu’il en faisait ce qu’il voulait. Nous leur avons montré que ce n’était pas le cas et que nous n’étions pas sous sa coupe.
Autre chose. Après la première déclaration faite par le CCE à Tunis37, il y a eu un petit incident entre Bourguiba et nous. Après la réunion, nous lui avons rendu visite à sa demande. Il a commencé par nous donner des leçons politiques. Pour lui, la déclaration était trop dure. Je crois que cela était en rapport avec le « préalable » qui avait été maintenu et surtout avec le style même de la déclaration. Il disait :
– Croyez-en mon expérience ! Expérimentez le Bourguibisme. Deux principes sont fondamentaux : être dur sur le plan de la lutte et très modéré sur le plan des revendications, pourvu qu’on ne perde pas de vue l’objectif.
Il se comportait envers nous plus qu’en conseiller ; il était le seul détenteur de la Science politique. Il était le seul à comprendre La Politique. Un accrochage l’a opposé à Lamine qui lui a affirmé que notre problème était différent de celui des Tunisiens. Quand nous sommes sortis, il n’était visiblement pas satisfait que l’on n’ait pas adhéré à ses idées. Mais, à cette époque, il avait peur des alliances que nous pouvions conclure avec ses opposants et nous avons dû le rassurer. Il avait des problèmes avec les yousséfistes. Mahsas38 et d’autres, avant notre arrivée, étaient les alliés de Benyoucef39 et, du fait de ses problèmes intérieurs, il n’était pas trop dur avec nous. Ce n’était pas encore le Bourguiba que nous connaîtrons plus tard.
L’affaiblissement du groupe dirigeant
Chacun est rentré à son département.
À Tunis, c’était l’anarchie avec les groupuscules, les débordements de la Wilaya I et de la base de l’Est, qui faisaient ce qu’elles voulaient, de même que les anciens partisans de Mahsas. Certains ont voulu arrêter Mahsas, mais Tlili l’a aidé à partir en Allemagne.
Mahsas ne reconnaissait pas le congrès de la Soummam et donc l’autorité qui en émanait. Il se considérait comme l’un des historiques, un des détenteurs de la légitimité, surtout après l’arrestation des cinq. Il se considérait comme leur représentant authentique. Il était à la Fédération de France (du FLN), mais ce n’était pas à ce titre qu’il rejetait les décisions de la Soummam.
Il y avait aussi le groupe des dissidents de la Wilaya I. C’étaient les alliés objectifs des yousséfistes quand ceux-ci étaient armés ; mais ils n’étaient pas des mahsasistes. Taleb Larbi40 tenait le Sud de la Tunisie et se comportait en véritable sécessionniste vis-à-vis du nouveau conseil de la Wilaya I.
Nous avons discuté au CCE de la grève des huit jours et de la grève des étudiants. Nous n’avons pas dit que c’était une erreur ou une action néfaste pour la révolution. Nous avons décidé que la grève, comme moyen de lutte, ne serait pas utilisée. Nous l’avons fait sans condamner la grève des étudiants puisque, de toute manière, elle a été positive sur le plan conjoncturel. Elle a permis la mobilisation de tous les lycéens et universitaires qui ont été nombreux à rejoindre le maquis. Nous n’avions, avant cela, pratiquement pas de lettrés et leur venue a constitué un grand apport, tant sur le plan politique et intellectuel que sur le plan organisationnel. Mais notre choix était de ne pas confirmer la continuation de la grève. Même Abane disait à ce moment-là qu’il ne l’avait pas décidée seul. C’étaient les dirigeants de l’UGEMA comme Lamine Khène41, etc. qui l’auraient imposée, et il n’était lui-même pas très convaincu de la portée de cette décision.
Sur le plan intérieur, une fausse théorie circulait, théorie que j’ai moi-même combattue avec Abane. C’était Krim qui la défendait, mais je ne sais pas d’où il tenait ce genre d’idées, surtout depuis qu’il avait été chargé des affaires militaires. J’ignore s’il l’a lue quelque part ou si quelqu’un l’a induit en erreur, mais il y croyait fermement. Je l’avais considérée à l’époque comme l’un des plus grands dangers qu’ait couru la révolution.
– Voilà mon plan, nous disait-il. Nous avons commencé par déclencher des actions isolées. C’était pratiquement du terrorisme dans les villes et des actes de sabotage à la campagne. Nous avons eu, par la suite, des difficultés énormes avec le MNA et les contre-révolutionnaires. Maintenant que le FLN domine tout le pays, nous devons passer à un autre stade. Puisque la guérilla est généralisée à travers tout le territoire, nous devons créer des zones franches.
À cette période, Krim avait comme collaborateur un nommé Idir42, commandant déserteur de l’armée française que nous avions trouvé au Caire. Krim l’avait pris comme chef de cabinet. Est-ce que l’individu, se considérant comme un professionnel de la guerre, a pris des clichés de l’histoire des guérillas les croyant applicables chez nous ? Je ne sais pas. En tout cas, j’ai expliqué à Krim ce qu’était une zone franche. J’ai expliqué que c’était une partie de territoire libérée de la présence française et qu’il faudrait des moyens pour la défendre contre les incursions militaires. Il faudrait de l’artillerie, des armes automatiques et, peut-être même, une fabrique d’armes et de munitions située dans la zone elle-même. De plus, il faudrait ravitailler la population qui y vivait. Or, nous n’avions même pas les moyens pour satisfaire les besoins vitaux en nourriture et en habillement. Ne parlons pas de ceux de l’armée qui y serait stationnée.
– Où sera créée cette zone franche ? avais-je demandé. Dans une région déterminée ? Ou bien en faudra-t-il une dans chaque wilaya ?
Krim a dit que l’on commencerait à le faire dans les zones frontalières. Or, nous n’avions encore aucun allié sûr. La Tunisie et le Maroc étaient vulnérables. L’armée française campait encore dans ces deux pays. En fait, nous étions encerclés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de nos frontières.
La discussion a duré peut-être quinze jours au CCE. Nous avons constaté que des divergences très graves étaient nées entre nous, alors que nous pensions être d’accord sur la pensée politique et sur l’art de faire la guerre, domaine extrêmement important, s’il en fut.
Nous avons discuté avec Abane qui était rentré depuis peu puisque maintenant les réunions se faisaient dans un CCE au grand complet. Les désaccords entre Krim et moi se sont accentués. Boussouf n’intervenait que rarement ; il ne s’occupait que de ses services. Nous avons eu peur, puisque Krim dirigeait ce département, qu’il ne s’oriente vers cette manière de faire la guerre. Cela aurait représenté une aubaine pour la France ; c’était lui faire un cadeau que de rassembler toutes nos forces, c’est-à-dire peu d’hommes en fait, dans un seul endroit. J’ai demandé à Krim ce qu’il comptait faire de sa zone franche. Il m’a répondu : “Ce sera la guerre de position.”
C’était une véritable folie que je ressentais comme un très grand danger pour la révolution. Notre opposition est allée encore plus loin. Je lui ai dit que je ne parlais plus au nom du CCE, que j’étais toujours chef de wilaya et, qu’à ce titre, je pouvais assurer que la Wilaya II ne marcherait pas. Il y a eu de nombreux autres incidents entre nous car il est revenu sur ce sujet pendant près d’une année.
C’était son dada et il arrivait chaque fois avec un nouveau projet à faire adopter par le CCE. Je l’ai systématiquement combattu et son projet n’est jamais passé, mais il nous a pris un temps très précieux. De plus, j’avais peur qu’il ne nous mette devant le fait accompli. Il commençait d’ailleurs à s’orienter dans cette voie et il était clair que subir un revers militaire dans ces conditions nous aurait anéantis pour toujours. Fort heureusement pour nous, il n’est jamais passé à l’action. De toute façon, c’était impossible car cela aurait obligé tous les postes militaires d’une région à se retirer et, surtout, à avoir les armes adéquates. Or, nous n’en avions pas, pas même des armes légères. Nos besoins étaient énormes. À la campagne, pratiquement toute la population demandait des armes, mais nous étions toujours restés en deçà de nos potentialités de lutte.
Nous avons demandé à Ouamrane quelles étaient nos réserves dans ce domaine. Il a répondu que nous en avions peu, mais que beaucoup de pays arabes s’étaient engagés à nous en fournir, mais, a-t-il précisé, seulement des armes légères. En fait, les pays arabes n’ont jamais dépassé ce stade dans l’aide qu’ils nous ont apportée et, de plus, c’étaient de vieux stocks laissés par les Anglais et les Allemands43. Ils nous livraient des armes périmées.
Ce sont là les premiers problèmes rencontrés avec Krim, et cela a créé une certaine distance entre nous. Ce n’était plus l’enthousiasme du début, quand nous formions équipe. Mahmoud Chérif, de son côté, a commencé à jouer la carte de Krim, surtout après le départ de Abane. Il se sentait faible, vu qu’il n’avait jamais été accepté par la Wilaya I. Il pensait que Krim était l’élément le plus important du groupe et misait sur lui. L’équipe au sein du CCE s’était affaiblie, elle qui voulait réaliser un redressement. Nous n’en étions pas à l’hostilité déclarée ou à de grands désaccords, mais il n’y avait plus le respect qu’on imposait auparavant.
C’était là le résultat des menaces qu’avait fait peser sur nous Abane. Les autres avaient vu que les militaires pouvaient être divisés et cela ne nous aidait pas à opérer le redressement souhaité. La délégation des affaires extérieures, à travers Lamine, ne jouait plus la carte de Abane ; elle s’était rangée à 100 % du côté de Krim.
La première réunion des colonels
Témoignages d'Ali Kafi
Après que Si Abdallah (Bentobbal) ait quitté la wilaya en compagnie de Krim Belkacem, Benkhedda, le commandant Kaci, Ali Oubouzar et de Boualem…, j’ai été appelé à une réunion des chefs de wilaya qui devait se tenir en Tunisie. Des modifications dans la composition du CCE étaient intervenues. On y avait ajouté de nouveaux membres dont Abdelhafid Boussouf, Lakhdar Bentobbal et Mahmoud Chérif, et éliminé d’autres.
Nous nous sommes rencontrés au centre logistique du FLN qui se trouvait au Mont Fleury. Il y avait là Abane Ramdane, Krim Belkacem, Lakhdar Bentobbal, Mahmoud Chérif et certains colonels, chefs de wilaya. J’étais personnellement accompagné de Benbaatouche44 alors considéré comme le responsable politique de la Wilaya II avec grade de commandant. Pour la Wilaya I, il y avait le colonel Lamouri et, pour la base de l’Est, Amara Bouglez. Ils étaient accompagnés du commandant Aouachria45. Quant à la Wilaya IV, elle était représentée par le colonel Sadek et le colonel Si Salah (Mohammed Zaamoum46). La Wilaya III avait délégué Mohammedi Saïd qui n’était alors que commandant. Le commandant Kaci, qui était affecté à la base de l’Est, s’était joint à nous. La Wilaya V n’était pas représentée.
C’était une réunion qui avait un caractère ordinaire. Elle avait commencé en présence des membres du CCE cités plus haut. Ceux-ci devaient cependant nous quitter peu de temps après en raison d’obligations pressantes les appelant à se réunir dans la capitale égyptienne. L’ordre du jour tournait essentiellement autour de questions militaires et le départ des membres de la direction politique ne devait pas en principe occasionner une suspension de séance. Nous avons continué à débattre des problèmes de l’organisation militaire, du ravitaillement en armes et des moyens à mettre en œuvre pour faire face à la ligne Morice47. Nous étions alors plus préoccupés par l’organisation des relations entre l’intérieur et l’extérieur que par les questions politiques.
Il restait toutefois le cas Abane que nous avons évoqué. Le problème commençait à se poser avec acuité et nous ne disposions pas alors de toutes les données qui nous auraient permis de prendre position. J’avais personnellement eu des entretiens séparés avec Bentobbal, puis avec Krim. Abane est venu lui-même me rendre visite au Belvédère de Tunis, dans la demeure de Rachid Gaïd. Il m’a parlé longuement, mais ses propos n’étaient guère rassurants. C’était le genre de paroles qui vous faisaient avoir des doutes sur la personne. Il faut dire que, depuis le congrès de la Soummam, nous étions prévenus. On nous avait fait part des tentatives d’un petit groupe de personnes, dont Abane, qui cherchait à s’emparer pour son propre compte du commandement de la révolution.
Nous étions alors très imprégnés de l’esprit du PPA. Militants issus du mouvement nationaliste, nous entretenions entre nous une confiance réciproque. Responsables ou subalternes, nous avions l’habitude de ne nourrir aucune suspicion les uns vis-à-vis des autres. Ce qui fait que nous n’avons pas cru bon de discuter l’information, aussi grave soit-elle, dont nous avaient fait part Zighout et Bentobbal au retour de la Soummam.
Nous étions engagés dans une lutte de libération que nous savions être très longue. Nous savions aussi que nous n’étions qu’au tout début de l’épreuve. Peu nous importait ce qui pouvait se passer sur le tas, comme on dit, mais nous placions la question de l’unité nationale par-dessus tout. Nous le faisions d’autant plus que nous étions totalement isolés les uns des autres. En dehors des lettres que nous échangions avec la Wilaya I ou la Wilaya III, nous ne savions rien, pour ainsi dire, de ce qui pouvait se passer au-delà de Bouira. Ce qui explique que chaque fois que nous apprenions que l’unité nationale se renforçait, c’était comme un jour de fête.
Or, Abane s’était exprimé en mettant en cause tous ceux qui faisaient partie du CCE, en commençant par Krim Belkacem. Ce dernier était d’ailleurs la cible principale de ses attaques. C’est ainsi que j’ai su qu’il y avait un problème. Jusque-là, malgré les rapports très étroits avec notre responsable immédiat, Bentobbal, rien n’avait filtré des difficultés apparues au sein de la direction. Nous avions pour habitude de garder pour nous toute information qui risquait de mettre en danger la révolution, que ce soit au niveau du plus haut responsable ou à celui du simple djoundi.
Je suis arrivé le 25 décembre 1957 à Ghardimaou48, ce qui fait que toutes les réunions et les rencontres dont je parle se sont déroulées en janvier 1958.
La Wilaya II a présenté à cette occasion un programme qu’elle comptait soumettre à la discussion pour un éventuel enrichissement. Il était question, dans ce document, d’un plan d’action pour faire face à la ligne Morice. Nous tentions, dans notre projet, de définir la signification de cette ligne tant sur le plan politique que militaire car nous étions arrivés au point que les wilayas ne pouvaient plus avoir de liens avec l’extérieur. La circulation de l’information, autant que celle des armes et des munitions, était quasiment interrompue.
Avant de partir pour l’Égypte, les membres du CCE ont pris connaissance du programme. Ils ont déclaré être par avance d’accord avec tout ce qui pourrait être fait pour aboutir à une solution du problème et ils nous laissaient seuls juges d’éventuels amendements qui pourraient être apportés au texte.
La discussion s’est donc poursuivie en l’absence de tout responsable politique membre de la direction. Après un long débat, on est parvenus à adopter le programme sans modification substantielle. Cependant, comme cela est devenu une habitude chez nous, les divergences sont apparues au moment de désigner la direction chargée d’exécuter le programme. Celui-ci concernait en effet tous les djounoud cantonnés aux frontières avec leur commandement. Il touchait la Wilaya I, la II et la base de l’Est qui s’était séparée de la wilaya du Nord Constantinois. À ce propos, nous voulions tout faire pour dépasser le problème posé par cette scission de la zone frontalière. Nous voulions par-dessus tout concentrer nos efforts sur la seule question de la direction politique. Nous disions même être prêts à nous retirer de cette dernière si cela pouvait faciliter les choses. Peu nous importait que le nouveau commandement soit constitué des seuls représentants de la I et de la base de l’Est.
Un différend eut alors lieu entre les colonels Lamouri et Amara Bouglez ainsi qu’entre Aouachria et Ahmed Nouaoura49 qui accompagnait Lamouri. Aucun d’entre eux n’était d’accord avec l’autre. Voyant cela, je leur ai dit que je n’étais plus en mesure de poursuivre une telle réunion. Considérant que l’accord de tous a été obtenu quant au programme, il ne me restait plus qu’à rejoindre ma wilaya, en laissant le soin au CCE de désigner la direction qu’il jugeait apte à en exécuter les tâches qui y étaient contenues.
Avant de quitter la séance, je me suis entendu avec Lamouri pour passer, en sa compagnie, la frontière. C’est un point extrêmement important qu’on retrouvera par la suite.
Lamouri avait été désigné à la tête de la Wilaya I à Tunis. Il y avait été ramené par Amirouche, après que tous deux soient passés par la Wilaya II où je les ai rencontrés à Beni Ferguène. Amirouche considérait alors avoir trouvé en Lamouri le meilleur homme qui fut pour diriger les Aurès-Nemenchas. Or, je connaissais Lamouri du temps où il était l’adjoint de Hihi El Mekki50, dans la zone du djebel Boutaleb. Il ne me semblait pas vraiment de taille à devenir commandant de wilaya. S’il devait y en avoir un, cela aurait été plutôt Hihi El Mekki et non Lamouri.
C’était un ancien militant de la région d’Arris, qui était déjà dans le groupe de Ben Boulaïd du temps où Bentobbal avait pris le maquis. Bentobbal m’avait alors dit :
– Quelle catastrophe ! Comment a-t-il pu préférer Lamouri à un aussi vieux militant, à quelqu’un qui a été responsable du PPA-MTLD et militant nationaliste bien avant 1937 ?
Je me souvenais de Lamouri du temps où il étudiait à Constantine. Contrairement à Hihi El Mekki, il n’était pas du tout un militant nationaliste.
Toujours est-il que j’ai proposé à Lamouri de rentrer avec moi et de passer par la Wilaya II afin qu’il puisse s’informer de la façon dont nous avions organisé notre région, et avoir là une bonne occasion de coordonner nos actions et d’homogénéiser nos structures. Je me suis engagé à repartir avec lui dans les Aurès après un séjour d’une ou deux semaines dans le Nord Constantinois. J’étais prêt à me déplacer moi-même vers la Wilaya I avec un certain nombre d’officiers et des unités de djounoud afin de l’aider à remettre tout en ordre dans sa région et rebâtir l’organisation selon le modèle que nous avions nous-mêmes mis en œuvre.
Le jour où nous avons décidé de prendre la route pour Ghardimaou, deux groupes nous avaient devancés pour choisir un itinéraire sûr. Habituellement et par prudence, j’empruntais toujours un troisième itinéraire. Grand bien me fit car, dans les deux premiers trajets contrôlés par les colonnes d’éclaireurs, des ratissages monstres avaient été menés par l’armée française. La route que j’avais empruntée était, quant à elle, restée sûre et très calme.
L’heure du départ de Tunis avait été fixée à 17 heures. À 16 heures, nous devions nous rencontrer, Lamouri et moi, au café Le Maghreb, situé près de la Porte de la Mer. Il était bien là au rendez-vous, mais combien grande fut ma surprise lorsque je l’ai vu, s’appuyant sur une canne, le pied bandé posé sur sa chaussure.
– Vois-tu, me dit-il, je ne me sens pas très bien… Le médecin m’a opéré… Il m’a déconseillé de voyager…
Nous nous sommes alors engagés dans une sorte de discussion à bâtons rompus qui avait tout l’air d’une discussion de bistrot. Lamouri s’est mis à attaquer les Kabyles, tous les Kabyles, sans distinction. Pas un n’échappait à sa vindicte que ce soit Krim, Abane ou, même, Ouamrane.
– Ils veulent prendre la direction, disait-il. Ils ne sont pas à la hauteur.
Les propos étaient très injurieux vis-à-vis des gens qu’il citait.
– Écoute, Lamouri, lui ai-je dit. Tu es encore jeune, tu viens à peine d’arriver et tu as été nommé à un poste extrêmement important. Comment peux-tu proférer de telles insanités sur de hauts responsables. Laisse-moi te dire que l’opération que t’a fait subir (Tedjini) Haddam51 n’est pas dans ton intérêt. Elle est dirigée contre toi et contre la Wilaya III. Il est en train de jouer un jeu dans lequel tu ne devrais pas tomber.
Cela n’a pas eu l’air de lui plaire. Il m’a reproché ma réaction, m’accusant d’être contre lui. Il a répété ne pas être en mesure d’aller avec moi à l’intérieur du pays.
– Lamouri, lui ai-je dit, je vois comment tu vas finir. La voie que tu es en train de suivre te mènera tout droit à mourir en traître et un jour j’apprendrai que tu es mort en traître.
Nous nous levâmes, Allaoua Benbaatouche et moi-même et nous quittâmes le lieu. Allaoua m’a reproché d’avoir pris à partie Lamouri avec tant de dureté.
– Écoute, Allaoua, lui ai-je répondu, d’adjudant de l’ALN, ce monsieur est propulsé au rang de colonel, chef de wilaya. À peine l’a-t-il été qu’il se met à injurier les membres du CCE. II complote avec Haddam qui l’a mis dans sa poche. Il s’est laissé faire une opération au pied pour ne pas rentrer au pays. Où va-t-il comme ça d’après toi ? Où va-t-il sinon vers la trahison ?
Nous avons donc quitté la Tunisie alors que les membres du CCE étaient encore au Caire. Cela se passait vers le 15-16 février, juste après le bombardement de Sakiet Sidi Youcef par l’aviation française. Quand nous sommes arrivés à Sakiet, Si Mahdjoub52 nous a informés qu’un accrochage avait eu lieu peu de temps auparavant, de l’autre côté de la frontière, entre des unités de la Wilaya II et l’armée française. Les djounoud avaient réussi, lors de cet accrochage, à récupérer des armes sur l’adversaire et s’étaient repliés en territoire tunisien.
Je lui ai dit alors :
– Par expérience, cette affaire me semble assez sérieuse. II n’est pas question de laisser nos troupes cantonnées en ce lieu. Les Français ne vont pas laisser passer l’affaire sans répliquer. Va immédiatement auprès de nos unités stationnées à Maater53 et à Beja54, rassemble-les avec armes et bagages, et disperse-les dans les fermes environnantes. Informes-en au préalable le sous-préfet de la région. Il ne faut pas que les Français vous découvrent et trouvent un quelconque prétexte à intervention.
Les Tunisiens nous ont aidés autant que possible à cacher nos troupes. Les hommes de Si Mahdjoub et de Mokrani se sont repliés en ordre dans les fermes. Le matin du 8 février, les avions français ont piqué droit sur le camp de l’ALN avant de pousser plus loin vers le village.
Ainsi s’est passée notre première visite en Tunisie.
Nommé commandant de la Wilaya II, j’ai fait rentrer avec moi Si Salah (Mohammed Zaamoum) ainsi qu’un certain nombre de médecins dont Mohammed Toumi, Aït Idir et Rahmouni.
Bentobbal
Les raisons de la première réunion des colonels que nous avions convoquée à Tunis étaient d’abord de nous permettre d’entendre les rapports sur la situation à l’intérieur du pays. Nous voulions connaître les besoins des wilayas et améliorer la coordination de nos forces. Le courrier était alors trop lent et irrégulier pour pouvoir espérer une quelconque efficacité dans le domaine. Nous voulions aussi nous informer de l’application de la politique que nous avions tracée. Qu’en était-il de l’organisation de l’intérieur ? Pouvions-nous risquer de faire parvenir des armes si cette question de l’organisation n’était pas réglée. Tous les maillons de la chaîne étaient-ils en place ? Pouvaient-ils nous garantir que les importantes sommes d’argent que nous faisions passer arrivaient effectivement à destination ?
Il y avait aussi la nécessité d’informer les responsables des wilayas des changements intervenus au sein de la direction. Ceux-ci étaient bien plus que de simples retouches. Beaucoup de colonels, chefs de wilaya, tenus à l’écart du premier CCE, y avaient été introduits cette fois-ci. Nous commencions aussi à soupçonner certains politiciens de vouloir, en se servant de Abane, s’emparer pour leur propre compte du commandement de la révolution et nous en éloigner du même coup.
Nous avons donc été amenés à procéder à une sorte de coup de force. Même si, par la suite, nous avons donné à l’opération un caractère officiel (le CNRA ayant entériné après coup les changements intervenus), il n’en reste pas moins que c’était un coup de force car, à l’époque, aucun des politiques n’était d’accord sur la nécessité du changement.
Tous étaient du côté de Abane dans leur opposition à la décision de remettre le commandement entre les mains des militaires. Nous devions donc en informer les responsables des wilayas pour éviter toute confusion dans les esprits et prévenir toute scission.
Ce n’est qu’après cette discussion que nous sommes partis au Caire, laissant les colonels traiter des autres points de l’ordre du jour dont la question de la ligne Morice et du passage des armes. Quels devaient être les moyens à mettre en œuvre pour parer à cette ligne qui n’en était alors qu’à ses débuts ? Il nous était encore possible de saboter sa mise en place. C’est à ce propos qu’il y a eu désaccord avec Bouglez.
La base de l’Est et la ligne Morice
Témoignages d'Ali Kafi
Je me souviens m’être accroché avec lui lorsqu’il m’avait fait part de son point de vue. Pour lui, il n’était pas question de saboter la ligne Morice car on pouvait en tirer un double avantage. D’abord, elle permettrait à l’organisation de percevoir un impôt sur les salaires versés aux ouvriers algériens qui participaient au chantier ; ensuite, il considérait qu’en participant à la pose du système de défense, les gens de la région pourraient nous informer de l’endroit où étaient placées les mines.
Bentobbal