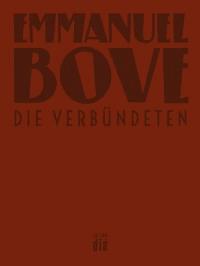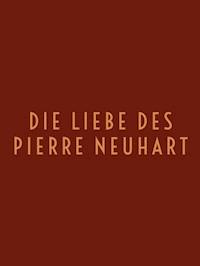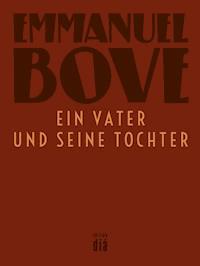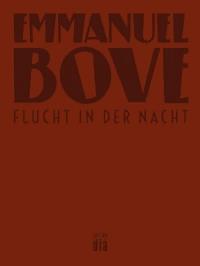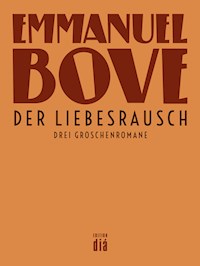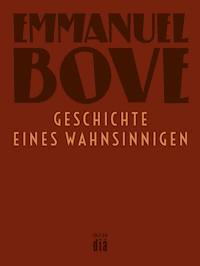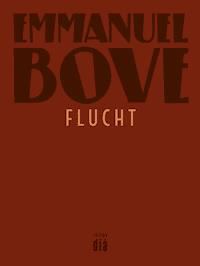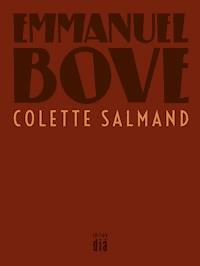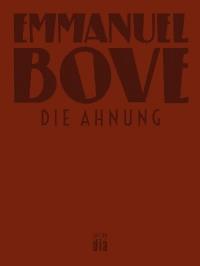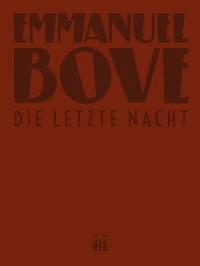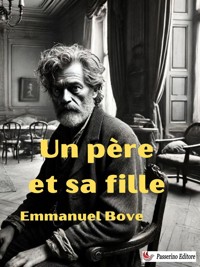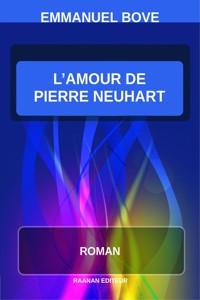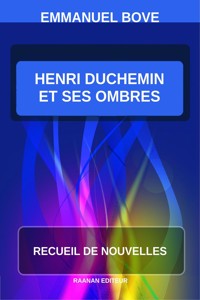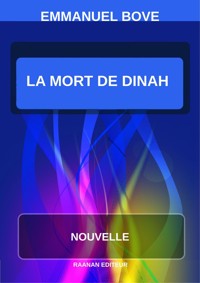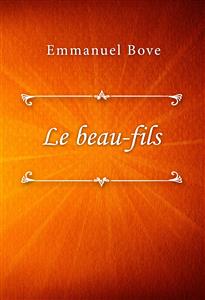
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Classica Libris
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Avec Le beau-fils, annoncé par son éditeur comme celui de la maturité, Emmanuel Bove livre son récit le plus ouvertement autobiographique. Encore adolescent, Jean-Noël perd son père. Annie, sa belle-mère, issue d’un milieu social aisé, va le prendre sous son aile ; mais Jean-Noël n’aura de cesse de la décevoir, errant d’une relation amoureuse à une autre, faisant traîner ses études. Basculant d’un milieu social à un autre, toujours en quête d’argent, il se laisse porter par les aléas de sa vie. Annie en serait-elle la clé ?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Emmanuel Bove
LE BEAU-FILS
Copyright
First published in 1934
Copyright © 2019 Classica Libris
1
Ce fut bien avant la guerre, en 1904 exactement, que Mademoiselle Annie Villemur de Falais fit la connaissance de Jean-Melchior Œtlinger. Elle avait vingt et un ans. Depuis plusieurs mois, elle suivait un cours mixte de peinture, non pas chez Julian ni à l’École des Beaux-Arts, mais dans une académie de la rue de la Grande-Chaumière, ce dont elle était fière, ce choix ne pouvant qu’indiquer une vocation véritable. Elle partageait l’admiration des autres élèves pour les préraphaélites. Ses frères, ses amies, son père même, venaient parfois assister d’une embrasure à une séance de pose, un peu gênés quand le modèle était un homme nu, mais n’osant le dire de peur de paraître pudibonds. Annie était une grande jeune fille blonde, embarrassée de sa beauté comme on l’est de sa jeunesse dans certaines professions. À force d’insistance, elle avait obtenu la permission de louer un atelier dans le haut de la rue d’Assas. Chaque semaine, elle y organisait de petites réceptions. Aux camarades de travail, pour la plupart des étrangers pauvres, ne manquait jamais de se joindre un membre de la famille Villemur qui veillait à ce que tout se passât convenablement. Ce fut justement à un de ces thés que le massier de l’académie, pour lequel Mademoiselle Villemur s’était prise de sympathie parce que, comme tous les massiers, il avait été choisi parmi les élèves les plus méritants de la classe, et qu’elle gardait de son éducation l’habitude d’être compatissante, lui amena un de ses amis, homme sombre, âgé d’une trentaine d’années, portant une barbe en pointe, vêtu assez cérémonieusement d’une jaquette. C’était le fils d’un professeur de Mulhouse, connu pour ses sentiments francophiles. À la mort de ce professeur, survenue en septembre 1895, Jean-Melchior Œtlinger, dont la majorité avait été fêtée en février de la même année, son frère aîné Martin et sa jeune sœur Catherine avaient vendu la maison paternelle et étaient venus se fixer à Paris, les garçons avec le désir de continuer leurs études, la fille avec celui de faciliter la tâche de ses frères en leur épargnant tous soucis domestiques. Ils s’étaient installés rue Pierre Nicole, dans un logement de deux pièces et une cuisine. Au commencement, ils demeurèrent parfaitement unis. La jeune fille ne sortait pas. Les deux frères ne se quittaient que pour suivre leurs cours. Si parfois l’un d’eux avait l’envie de visiter un musée, il en faisait part à son frère, lequel consultait Catherine. Finalement, quand ils étaient tous d’accord, mais pas avant, ils prenaient cette distraction. N’ayant pour toute fortune qu’un modeste héritage qui devait les faire vivre jusqu’à la fin de leurs études, ils se serraient instinctivement l’un contre l’autre, à la fois par économie et pour écarter ces tentations dont ils avaient entendu parler au cours de leur jeunesse. Mais bientôt Jean-Melchior se laissa aller à de petites trahisons. Peu à peu, il s’était enhardi. Les dangers contre lesquels on l’avait mis en garde lui étaient apparus moins grands. De santé fragile, d’un naturel indolent, il n’était fait pour aucun travail suivi. La paresse et la flânerie lui convenaient mieux que cette vie avec emploi du temps de la rue Pierre Nicole. Quand, quatre mois plus tard, il tomba amoureux d’Ernestine Mercier qui de l’âge de dix-sept ans à celui de trente et un ans avait vécu tantôt chez l’un, tantôt chez l’autre, toujours avec l’espoir que chacun de ses amants serait le dernier, il hésita longtemps à l’avouer. Ce ne fut que lorsqu’il ne put faire autrement qu’il ouvrit son cœur. Martin entra dans une vive colère. Jean-Melchior ignorait encore que lorsque nous nous retirons d’une association, même si en le faisant nous favorisons ceux qui la respectent, on nous en garde rancune. Il fut mis en demeure de choisir. Durant un mois entier, il ne put se décider. Dès cinq heures de l’après-midi, il avait de la fièvre. Il aimait son frère et sa sœur plus que tout au monde, plus, bien plus qu’Ernestine Mercier, mais celle-ci, c’était le plaisir, mille choses qu’il n’avait pas auprès des siens. Enfin, quand il comprit qu’il lui fallait prendre un parti, qu’il ne pouvait atermoyer plus longtemps, il fit sa malle, embrassa Catherine longuement, demanda à Martin de lui pardonner. Celui-ci, écartant les sentiments, lui parla argent. Il fut entendu qu’il lui remettrait ce qui lui revenait, déduction faite de sa participation au loyer. Jean-Melchior s’en fut ensuite retrouver Ernestine Mercier. Elle ne s’attendait pas à une telle preuve d’amour. Aussi, les premiers jours, n’osa-t-elle demander à Jean-Melchior dans quelle situation le mettait ce geste. Elle s’efforça de se montrer digne du sentiment qu’elle inspirait. Mais quand elle apprit que Jean-Melchior avait un peu d’argent, qu’il se disposait à vivre modestement de manière à être à même de terminer ses études, elle se moqua de lui. Elle le convainquit que la jeunesse n’avait qu’un temps, qu’on ne savait pas de quoi demain serait fait, qu’il fallait profiter de la vie quand on le pouvait. Ils habitèrent un hôtel confortable, prirent leurs repas non plus dans des crémeries mais dans des brasseries où ils s’attardaient, au milieu d’amis bruyants, jusqu’à trois heures du matin. Elle aspirait pourtant à devenir une petite bourgeoise considérée, mais plus tard, quand elle rencontrerait un homme qu’elle aimerait vraiment. À cause de sa maîtresse et surtout à cause de la fièvre que lui donnait le moindre effort, Jean-Melchior avait presque complètement abandonné ses études. Il se levait tard, fréquentait les amis d’Ernestine, avec lesquels il n’avait aucun point commun. Quant à son avenir, il était incapable de se le représenter. Il se laissait vivre au jour le jour, poursuivant sans cesse Ernestine de sa jalousie et de sa tendresse, s’enfermant à la moindre contrariété dans un mutisme qui durait plusieurs jours et duquel il sortait brusquement aigri, mais toujours épris. Au bout d’un an, il ne lui resta presque rien de la part d’héritage que Martin lui avait remise. Il lui fallut songer à vivre plus économiquement, d’autant plus que sa santé commençait à se ressentir de ces dérèglements. Ils louèrent un petit appartement, le meublèrent simplement. « Nous avons été inspirés », lui dit Ernestine un soir étouffant d’août 1897. Il ne comprit pas ce qu’elle entendait. Elle ne voulut pas s’expliquer, mais la nuit, dans ce lit qu’elle appelait son « domaine », et dont elle s’était fait un complice ayant à ses yeux autant de relief qu’un être vivant, elle apprit à Jean-Melchior, avec des minauderies insupportables, qu’il allait être père.
Par la suite, il ne se passa pas de jour qu’elle ne lui signalât les devoirs qui lui incomberaient. Leur nombre s’accroissait indéfiniment, sans éclipser pourtant le principal, à savoir qu’il allait être obligé de l’épouser. Pourtant si Jean-Melchior ne tenait plus à se marier, c’était sa faute à elle. Il le lui avait demandé, non pas qu’il en eût eu le désir, car en quittant son frère et sa sœur c’était à tout autre chose que fonder un foyer qu’il avait songé, mais à cause d’un scrupule venant de son éducation qui lui faisait difficilement concevoir l’amour en dehors du mariage. En lui ôtant ce scrupule qu’il ne demandait qu’à perdre, Ernestine n’avait pas prévu que les arguments dont elle s’était servie se retourneraient contre elle. Jean-Melchior ne pouvait croire que cette même femme qui avait accueilli ses supplications par des moqueries, cela au moment où il était en possession de son héritage et où elle eût eu tout intérêt à l’épouser, fût sincère dans son désir de se marier à présent qu’il n’avait plus rien et qu’il courait les rues à la recherche de leçons d’allemand. Aussi lui répondit-il chaque fois distraitement, convaincu qu’il avait été par Ernestine elle-même que cette question de mariage était sans importance.
Fin avril 1898, un enfant, qu’on prénomma Jean-Noël, naquit. La situation du ménage ayant encore empiré, Jean-Melchior demanda un secours à Martin. Quand celui-ci apprit que son frère avait dépensé tout ce qu’il possédait, qu’il vivait en outre avec une femme dont il venait d’avoir un fils, il le pria de ne plus revenir rue Pierre Nicole. De ce jour, les soucis devinrent plus nombreux. À part sa famille pour laquelle il avait toujours le même sentiment et dont la dureté l’avait plus peiné que révolté, il ne connaissait que des étudiants pleins de cette générosité de la jeunesse mais incapables de l’aider ou de le guider. Malgré les obstacles chaque jour plus difficiles à surmonter, malgré l’insistance d’Ernestine, il ne voulait d’aucun emploi fixe car il lui était apparu que ce n’était qu’en achevant ses études qu’il aurait la possibilité de sortir de ce mauvais pas. De temps en temps il donnait une leçon, ou bien il prenait un poste quelconque qu’il abandonnait deux mois plus tard. Au milieu d’une pareille existence, le désir qu’avait eu Ernestine de devenir la femme de Jean-Melchior s’était évanoui. L’idée de bonheur attaché au mariage en eût rendu pénible la célébration dans de pareilles circonstances. Plusieurs années s’écoulèrent ainsi dans la pauvreté et l’amertume. Les rapports de Jean-Melchior et de sa compagne étaient de plus en plus tendus. Elle lui reprochait de lui avoir donné un enfant tout en sachant ne pas avoir de quoi l’élever. Si elle était si malheureuse, c’était parce qu’elle était la naïveté même et qu’elle avait cru à toutes ses promesses. À chaque instant, elle le menaçait de le quitter et si, accablé, il ne la suppliait pas de n’en rien faire, elle se mettait à sangloter en disant qu’il ne l’aimait pas, qu’il faisait tout ce qu’il pouvait pour se débarrasser d’elle.
Jean-Noël était déjà âgé de sept ans lorsque Jean-Melchior fut présenté à Mademoiselle Villemur de Falais. Le monde qu’il entrevit autour de la jeune fille, l’atmosphère insouciante qui régnait dans l’atelier, firent sur lui un effet extraordinaire. Il revit Annie. Un jour, comme il se trouvait seul avec elle, il lui raconta sa vie. Ce récit la bouleversa. Dès le début, elle avait eu de la sympathie pour cet homme maladif dont la sincérité la surprenait. Bien qu’elle le connût à peine, il ne lui inspirait aucune méfiance, aucune crainte. Il représentait à ses yeux tout ce qu’elle ignorait et que, malgré cela, elle se sentît tellement en sécurité en sa présence l’emplissait de fierté.
Quand, six mois plus tard, Annie parla à sa famille de son désir d’épouser un jeune homme qu’elle avait connu à l’académie, ce qui n’était pas tout à fait exact, elle se heurta à une opposition inébranlable. Son père l’obligea à quitter son cours, son atelier. Il lui interdit de revoir tous les amis sans exception qu’elle s’était faits en dehors de sa famille. Des complications innombrables surgirent alors. Elle aimait Jean-Melchior. Il était à ses yeux un homme exceptionnel, supérieur même aux artistes qu’elle avait admirés. Ne lui avait-il pas dit, lorsqu’elle lui avait appris la colère de son père, qu’une jeune fille doit avant tout respecter la volonté de sa famille et que c’était faute de l’avoir fait lui-même qu’il avait été si malheureux ? Elle n’en continua pas moins à le voir à l’insu de ses parents. Quand ceux-ci l’apprirent, ils ne purent le croire. Annie n’était-elle pas la franchise même ? Elle ne leur avait jamais caché quoi que ce fût. Une grande scène eut lieu avenue de Malakoff, chez les Villemur. Il s’agissait de savoir si Annie avait vraiment l’intention d’épouser un petit Alsacien malade, sans fortune, sans avenir, déjà père d’un enfant. Elle répondit que c’était justement pour toutes ces raisons qu’elle aimait Jean-Melchior. Monsieur Villemur comprit que sa fille ne céderait pas. Durant un instant, son visage eut cette expression qu’a celui des hommes qui luttent contre eux-mêmes. Il pria Annie de le suivre. Il se rendit dans son cabinet de travail. Il était très calme. Pourtant, il passait plus souvent que de coutume les bouts parfaitement alignés de ses doigts sur ses sourcils.
– Tu veux te marier, dit-il posément, c’est ton droit. Mais je te demanderai de me présenter l’homme que tu as choisi.
– J’ai voulu le faire plusieurs fois. Tu as toujours refusé.
– Aujourd’hui, j’ai changé d’avis.
L’entrevue eut lieu. Dès que Monsieur Villemur aperçut Jean-Melchior, il se rendit immédiatement compte que l’espoir auquel il s’était raccroché était chimérique. Comment avait-il pu croire que ce Monsieur Œtlinger serait différent de ce qu’il avait imaginé ? C’était bien le personnage terne, à l’aspect maladif, se donnant le genre d’un artiste, qu’il avait reconstitué avec ce qu’Annie avait raconté de lui. Quand il fut seul avec sa fille, il ne jugea même pas utile de lui faire part de l’impression qu’avait faite sur lui Jean-Melchior. Il se contenta de lui dire qu’elle était libre d’épouser Monsieur Œtlinger, que, si elle le faisait, il lui remettrait sa dot, mais qu’il ne faudrait plus qu’elle songeât à revoir sa famille. Ceci admis, elle pouvait quitter la maison le soir même.
Pendant qu’Annie se débattait avec ses parents, car d’autres scènes de ce genre suivirent, Jean-Melchior préparait doucement Ernestine à une séparation. Il la désirait d’ailleurs depuis longtemps. Après la naissance de Jean-Noël, c’est-à-dire à partir du moment où Ernestine commença à tenir vraiment à lui, il avait déjà songé à reprendre sa liberté. Mais avant, il devait assurer la vie matérielle de celle qui, à l’entendre, lui avait donné les plus belles années de sa vie. Il n’en avait pas eu la possibilité. Le temps avait passé, les éloignant chaque jour davantage, si bien que lorsqu’il avait été conduit rue d’Assas, s’il avait pu sans mentir se présenter ainsi qu’un homme libre, il n’en était pas moins prisonnier comme au début de sa liaison. Libre, il l’était. Dès le matin, sous le prétexte de chercher un argent qu’il ne trouvait que rarement, il quittait sa maîtresse pour ne rentrer que lorsqu’elle dormait. Mais à transformer cette séparation morale en une séparation de fait, la difficulté était aussi grande que s’ils avaient été parfaitement unis, Ernestine feignant à la fois de lui être profondément attachée et d’adorer ce même enfant qu’elle ne faisait que maltraiter.
Le lendemain du jour où Jean-Melchior avait rencontré Monsieur Villemur, il se décida à attaquer franchement. Il dit à Ernestine que Jean-Noël grandissait, qu’il était à un âge où on commence à garder le souvenir de ce qu’on voit, qu’il était nécessaire de s’occuper sérieusement de son éducation, et que, en conséquence et parce qu’il ne pouvait faire autrement, il projetait de faire un mariage de raison. Il eut la faiblesse d’ajouter que la vie est ainsi faite qu’elle nous oblige souvent à sacrifier nos sentiments à l’intérêt. Ernestine entra dans une colère telle qu’il fallut lui donner des soins comme à un enfant atteint de convulsions, si bien que le calme, lorsqu’il revint, par le contraste qu’il fit avec les cris et les menaces qui l’avaient précédé, eut l’aspect d’une capitulation. Ernestine ne s’était pourtant pas résignée. Un mois plus tard, avec les mêmes simagrées que la première fois, elle annonça à Jean-Melchior, qu’elle était enceinte. Il ne voulut pas la croire. Il la conduisit chez un médecin. Elle l’était vraiment. Mademoiselle Villemur venait justement de quitter sa famille et de s’installer dans un hôtel dont le nom l’avait amusée chaque fois qu’elle avait traversé la place du Panthéon, l’hôtel des Grands Hommes. Il alla l’y retrouver, lui raconta ce qui venait de se passer, de peur qu’elle ne l’apprît de quelqu’un d’autre, et laissa entendre qu’il s’agissait d’un mensonge odieux. Il n’en avait pas la conviction mais, comme il n’avait pas non plus celle du contraire, ce fut avec tant d’indignation qu’il s’éleva contre ce qu’il appela une manœuvre désespérée, qu’Annie, bien qu’elle fût profondément humiliée, le crut. « Cette femme est capable de tout », dit-elle.
Au printemps 1906, Jean-Melchior et Annie se marièrent. Mais si ce mariage était mal considéré par les Villemur, il l’était trop bien par les Œtlinger. Ce fut donc pour fuir les parents d’Annie, qui malgré l’indifférence qu’ils simulaient ne désarmaient pas, et ce frère de Jean-Melchior devenu subitement autre, et cette Ernestine Mercier qui continuait à se faire appeler Madame Œtlinger et qui parlait de sa grossesse à qui voulait l’écouter, que les nouveaux mariés décidèrent de se fixer à Nice, ville dont le climat serait excellent pour Jean-Melchior et où il serait aisé de donner à Jean-Noël une solide instruction. Mais quand le moment vint de prendre l’enfant, de nouvelles difficultés surgirent. Malgré l’acquiescement qui lui avait été arraché contre une certaine somme d’argent, Ernestine Mercier ne voulut pas s’en séparer. Jean-Melchior se trouva réduit à procéder à un véritable enlèvement. Ce fut dramatique. Ernestine Mercier appela les voisins à l’aide, leur parla de son état, de l’inhumanité de l’homme pour lequel elle avait sacrifié sa vie. Finalement, tout s’arrangea et Jean-Melchior put emmener son fils qui pleurait et tremblait de peur.
2
Monsieur et Madame Œtlinger habitaient Nice depuis neuf ans lorsque, dans les premiers jours de février 1915, un télégramme parvint à leur adresse. Sans un mot de consolation ni d’affection, Monsieur Villemur annonçait à sa fille que Bertrand, son fils cadet, celui justement qui ne s’était pas élevé contre le mariage d’Annie, avait été grièvement blessé. Le soir même, elle partait pour Paris. Monsieur Œtlinger l’accompagna à la gare. Sous la verrière immense où chaque bruit avait un écho, sur le quai encombré de permissionnaires, de blessés, d’infirmières, Annie pleura. C’était la première fois depuis son mariage qu’elle se séparait de Jean-Melchior. De le faire en une circonstance aussi dramatique lui rappelait les années qui venaient de s’écouler. Elle eut le pressentiment que cette minute marquait le terme d’une période heureuse. Dans un instant, elle serait seule au milieu d’un monde dont elle s’imaginait avoir fui les peines et qui semblait déjà prendre sa revanche.
Une semaine plus tard, une tout autre femme descendit du train. Elle fit signe à un porteur, lui tendit elle-même ses bagages. Personne n’eût pensé que son frère avait été amputé d’une jambe quelques jours auparavant et qu’il se trouvait encore entre la vie et la mort. « Je te cause bien des ennuis, mon pauvre Melchior », dit-elle à son mari qui s’était avancé à sa rencontre. Elle faisait allusion aux lettres qu’elle lui avait écrites de Paris et dans lesquelles elle n’avait fait que consigner les événements qui s’étaient passés au cours de son voyage. Ils prirent une voiture découverte. La soirée était printanière. Le cheval s’en alla au pas. Dans l’air parfumé par une odeur de bois brûlé et de mimosa, loin de la guerre, c’était un soulagement de ne plus être pressé. Annie semblait indifférente. À la maîtrise qu’elle avait montrée en arrivant, afin de rassurer de loin son mari, avait succédé une grande lassitude. Elle se demandait si elle ne s’était pas trompée en épousant Jean-Melchior, si sa famille n’avait pas eu raison malgré tout de s’opposer à son mariage. Ce n’était pourtant pas qu’en vieillissant son amour eût diminué. Il s’était simplement transformé. Ce qui, jeune fille, lui avait paru si beau, la lutte, le départ, l’isolement avec un homme que l’on aime, tout cela avait été tué par ces réalités quotidiennes dont elle s’exagérait l’importance. En se retrempant dans cette famille qui était la sienne, où il lui semblait justement qu’il n’y avait aucune de ces réalités, où elle avait eu l’impression d’être une renégate, de s’être soustraite aux peines de tous, alors que jusque-là elle avait cru que c’était le contraire, qu’en quittant les siens elle avait quitté la sécurité bourgeoise, il lui était apparu qu’elle avait peut-être été aveuglée par l’amour. On l’avait reçue avec beaucoup de cordialité. Le fait qu’elle était venue seule, que par sa faute on ne pouvait compter son mari parmi les membres de la famille, avait plané sur les premiers entretiens. Puis, personne n’avait paru se souvenir de ce qui s’était passé. Un après-midi, elle avait même été voir, dans une maison de retraite de Neuilly, son ancienne femme de chambre, sa chère Élisabeth. En pleurant, celle-ci lui avait dépeint la tristesse dans laquelle son départ avait plongé sa famille. Tant de bienveillance rencontrée partout avait fait naître en elle des remords. Elle les avait chassés aussitôt parce qu’injustes envers son mari. Un soir, elle était restée près d’un quart d’heure en présence de son père sans que l’un et l’autre eussent prononcé une parole. Des amis étaient venus aux nouvelles. Leur devoir accompli, ils s’étaient longuement entretenus avec elle. On n’avait pas voulu qu’elle repartît tout de suite. On avait essayé de la persuader de rester à Paris. Et ce qui l’avait le plus touchée, ç’avait été quand sa mère, pourtant si froide d’ordinaire, lui avait demandé avec inquiétude si elle était heureuse.
Dans le train du retour, Annie avait songé à tout cela. S’était-elle conduite comme elle aurait dû ? N’était-elle pas partie trop vite ? Devant tant d’affection, n’aurait-elle pas dû prolonger son séjour à seule fin de montrer qu’elle avait été sensible aux attentions qu’on lui avait témoignées ? N’avait-elle pas fait preuve de sécheresse de cœur en rentrant à Nice avant de connaître le résultat de l’opération de Bertrand ? En quittant sa famille à la date qu’elle avait annoncée en arrivant, cela pour qu’on comprît qu’elle ne s’imposerait pas, n’avait-elle pas répondu par de la froideur à tant de bonté ? De quoi gardait-elle donc rancune à sa famille ? Celle-ci n’avait-elle pas fait que son devoir ? Puis, à la réflexion, il lui était apparu qu’elle n’eût pu agir autrement, non qu’elle fût d’une nature à supputer les avantages qu’on trouve à faire languir une réconciliation mais parce que, au cours de son existence de femme mariée, elle avait été fière, malgré ses plaintes, d’être exposée à ces mêmes soucis qui, jeune fille, lui avaient semblé réservés aux artistes seulement et qu’elle avait surtout tenu à ce que l’on sût à Paris que son mariage, loin de la diminuer, l’avait rendue meilleure. La situation d’exception où elle se trouvait, la chasse que lui donnait, ainsi qu’à Jean-Melchior, Ernestine Mercier, les précautions qu’ils prenaient pour cacher leur retraite, tout ce qui en un mot lui semblait n’arriver qu’à elle, l’entretenait dans l’illusion qu’elle avait une expérience plus grande de la vie que son propre père. Elle avait donc bien fait de partir à la date qu’elle s’était fixée. Elle avait montré ainsi aux siens, mieux que par des paroles, qu’elle n’avait ni rancune ni regrets, qu’elle était simplement devenue une femme.
Monsieur et Madame Œtlinger ne parlaient pas. Tout leur semblait léger et lointain. Les étoiles paraissaient s’être arrêtées de monter. Elles scintillaient à la hauteur où passent les nuages, chacune selon sa force. Annie respira profondément. Il ne restait rien des gens qu’elle avait vus, des propos qu’elle avait tenus. Les sabots du cheval, son grelot aussi gros qu’une pomme, chantaient à ses oreilles ? À toutes les fenêtres des hôtels, il y avait une lumière. Elles étaient toutes pareilles, chacune éclairant la même chambre, celle d’un blessé. Parfois le regard d’Annie rencontrait celui de son mari et tous deux se souriaient alors. Le seul fait de se retrouver après une séparation d’une semaine n’eût pas provoqué ce contentement si celle-ci n’avait pas été causée par un malheur. Il apportait avec lui, ce malheur, des perspectives de changement, il apportait ce que le ménage souhaitait confusément depuis des années, depuis surtout qu’il craignait de se trouver un jour dans le dénuement : l’espoir d’une réconciliation avec les Villemur. Annie n’avait pas encore parlé de son père ni de l’accueil qu’on lui avait fait. Jean-Melchior n’osait l’interroger. Bientôt, ils arrivèrent avenue Félix-Faure. La chaussée était large, luisante et bordée de palmiers. La voiture s’arrêta. Annie prit la main de son mari. Il leva les yeux. « Nous sommes arrivés », dit-elle avec vivacité. Elle se reprochait à présent d’avoir songé aux conséquences heureuses que pourrait avoir sur sa vie le malheur qui atteignait sa famille.
Au mois de mai de la même année, Bertrand mourut des suites de ses blessures. Depuis son retour, une correspondance suivie s’était établie entre Annie et ses parents. Ils ne lui avaient pas caché que l’état de Bertrand était très grave, mais comme chacune de leurs lettres avait été écrite avec le souci visible de plaire, cet état du frère avait pris l’aspect d’un prétexte à garder contact et seule avait compté la façon dont elles étaient commencées ou terminées. Aussi, en apprenant la mort de Bertrand, Annie, bien qu’elle eût dû s’y attendre, fut-elle frappée comme si son frère l’avait quittée une heure plus tôt en bonne santé. Comme elle faisait ses préparatifs de départ, elle reçut un second télégramme de son père lui demandant de venir le plus vite possible à Paris. Cette invitation lui fit oublier tout ce qui la séparait des siens. Ce fut à ce moment qu’elle eut l’idée de se faire accompagner par son mari. Mais quand elle lui fit part de son désir, elle eut la surprise de constater que ce projet ne lui causait aucune joie. Elle lui en demanda la raison. Après une hésitation, il lui répondit qu’elle se trompait, qu’au contraire il se réjouissait beaucoup de l’accompagner.
Si Monsieur Œtlinger avait essayé, un instant, de se soustraire à ce voyage, c’était qu’un événement, dont il n’avait pas voulu parler à sa femme, s’était produit une dizaine de jours plus tôt. À la déclaration de la guerre, sur l’insistance d’Annie dont la peur de l’avenir s’était décuplée, il avait diminué de moitié la pension qu’il faisait à Ernestine Mercier. Le mois de novembre 1914 ne s’était pas écoulé que celle-ci débarquait à Nice. Ce n’était d’ailleurs pas la première fois qu’elle faisait ce voyage. Dans les huit années qui avaient suivi le départ d’Annie et de Jean-Melchior, elle l’avait déjà fait trois fois. Mais celui qui nous occupe eut ceci de particulier qu’à l’encontre des précédents il ne comporta pas de retour. Jugeant qu’en temps de guerre, il est plus prudent de demeurer près de celui dont on dépend matériellement, elle s’installa avec son second fils à Menton. En plus de sa proximité de Nice et de la frontière, c’était une charmante petite ville, connue pour son climat, ce à quoi Ernestine Mercier attachait beaucoup de prix, sa santé et celle d’Émile étant aussi précieuses que celle de Jean-Melchior. À partir de ce jour, Monsieur Œtlinger fut en butte à toutes les tracasseries possibles. Tout était prétexte à Ernestine pour lui écrire, pour lui faire des reproches. Parmi ceux-ci, il en était un qu’elle n’oubliait jamais : Monsieur Œtlinger ne semblait pas considérer Émile comme son fils. « Je peux t’assurer, lui disait-elle dans chacune de ses lettres, qu’il est pourtant bien de toi. » Jean-Melchior ne le niait pas. Cela ne lui en était pas moins très désagréable, Annie n’ayant jamais voulu l’admettre. Mais Madame Mercier ne se contentait pas d’écrire. Par tous les moyens elle essayait de nuire à celui qui, comme elle le criait partout, l’avait abandonnée. Il y avait à peine trois mois qu’elle habitait Menton qu’elle s’était déjà fait de nombreux amis. Elle se faisait passer pour la véritable Madame Œtlinger. Celle qui avait pris sa place était une aventurière et si elle, Ernestine Mercier, s’était laissé supplanter, c’était par amour, parce qu’elle avait pitié de Jean-Melchior, pour lui épargner les soucis matériels. Ces histoires impressionnaient les petites gens dont elle s’entourait. Il s’en trouvait qu’elle avait toutes les peines à retenir d’aller plaider sa cause à Nice.
Ç’avait été sans doute une de ces personnes trop dévouées qui, il y avait deux semaines, avait écrit à Monsieur Œtlinger, sans la signer toutefois, une lettre dans laquelle elle le prévenait que Jean-Noël, qu’il n’avait pas hésité à favoriser au détriment de son autre fils Émile, menait une existence de débauché, qu’on le rencontrait, la nuit, dans des maisons mal famées, qu’il avait comme maîtresse une fille des rues. Cette lettre se terminait par des reproches auprès desquels ceux qui sortaient habituellement de la bouche d’Ernestine semblaient légers. N’était-il pas honteux d’enlever un enfant à sa mère pour l’autoriser ensuite à découcher toutes les nuits ? N’était-on pas en droit de se demander si un tel père n’était pas plutôt allemand que français ?
Monsieur Œtlinger avait appelé son fils. Ce garçon que nous avons vu dans les bras de son père cependant que Madame Mercier essayait de l’en arracher, était à présent un grand et maigre jeune homme de dix-sept ans. Son visage était boursouflé, de cette chair mate dont les pores sont visibles. Ses dents étaient plantées de telle manière qu’elles avançaient légèrement, si bien que, même lorsqu’il ne parlait pas, on les apercevait. De l’ensemble de sa personne se dégageait une impression de mollesse, de timidité, d’orgueil. Le front était ridé comme celui d’un vieillard ; les traits, le nez surtout, gros. Pourtant dans ce visage ingrat, il y avait comme une lumière qui venait du regard et qui faisait songer qu’à certains moments ce jeune homme pouvait être beau.
Avec douceur, de façon à ne pas froisser cette pudeur qu’il connaissait pour l’avoir éprouvée au temps qu’il habitait encore Mulhouse, Monsieur Œtlinger avait interrogé son fils. Il n’avait pas tardé à se rendre compte que si la lettre anonyme avait grossi les faits, elle n’en avait pas moins contenu une part de vérité. Jean-Noël avait fini par avouer que, ses parents couchés, il quittait parfois l’appartement pour rejoindre une femme dont il donna le nom et l’adresse en pleurant. Jean-Melchior calma son fils, lui laissa entendre qu’il n’avait rien fait que d’habituel à tous les jeunes gens et, alors que tout à sa confusion Jean-Noël était loin de songer à sa belle-mère, il ajouta, comme si la honte de son fils provenait de ce qu’il craignait qu’Annie n’apprît sa conduite, qu’il n’en parlerait jamais. C’était Monsieur Œtlinger qui, en réalité, craignait le plus qu’Annie n’apprît ce qui s’était passé. Si elle trouvait naturel qu’encore aujourd’hui elle souffrît des fautes ou des faiblesses passées de Jean-Melchior parce que celles-ci étaient, selon elle, inséparables des conditions dans lesquelles elle s’était mariée, tout souci nouveau, que son mari en fût directement ou indirectement la cause, la mettait hors d’elle. Pour cette raison, il était désagréable à Monsieur Œtlinger que quelque chose pût être reproché à son fils. Mais il lui eût été bien plus désagréable encore que celui-ci connût ses craintes. Il avait pour Jean-Noël une profonde adoration. Que son fils pût seulement soupçonner l’infériorité dans laquelle il se trouvait vis-à-vis d’Annie le faisait trembler, soucieux qu’il était de conserver ce prestige qui, malgré ses efforts, diminuait chaque jour. Depuis deux ans déjà, Jean-Noël l’évitait et, quand il ne pouvait le faire, il n’osait le regarder en face. Il était jaloux de son père. Il avait le sentiment que celui-ci n’était pas digne d’Annie, qu’il ne lui avait inspiré de l’amour que parce qu’il lui avait caché ce qu’il était réellement. Les années ne lui avaient pas fait oublier l’intimité qui avait existé entre son père et Ernestine Mercier. Il se souvenait nettement des scènes qui avaient éclaté dans le modeste appartement où s’était déroulée sa première enfance, des disputes à propos de sommes d’argent qui même au lycéen qu’il était aujourd’hui semblaient insignifiantes, de cette joie qu’il avait éprouvée à être mené rue d’Assas et, plus tard, dans cet hôtel auquel le voisinage du Panthéon ajoutait de la grandeur, et surtout de cette sécurité dans laquelle il se sentait dès qu’il se trouvait auprès d’Annie. Bien qu’il n’eût été qu’un enfant, il avait deviné combien différente de sa mère était cette étrangère qui n’élevait jamais la voix, qui vivait au milieu de livres, de couleurs, d’objets qui lui paraissaient précieux, comme ce petit ours de Berne. Aussi, quand au reçu de la lettre dont nous avons parlé Monsieur Œtlinger avait demandé à son fils de le conduire chez cette femme de mauvaise vie à laquelle il avait été fait allusion, Jean-Noël vit-il dans ce désir, non pas celui de connaître ses fréquentations, mais l’attirance qu’un homme obligé de vivre dans un milieu qui n’est pas le sien a pour ce qui lui rappelle son passé.
Une sorte d’entremetteuse avait reçu Monsieur Œtlinger et son fils et, sans s’étonner un instant que deux visiteurs aussi dissemblables pussent demander à parler à la même locataire, elle les avait priés d’attendre dans un petit salon à travers les murs duquel on percevait des cris et des rires. Puis ils avaient été introduits dans la chambre de la jeune femme. Elle les reçut en peignoir. À la vue du compagnon de son amant, si on peut donner ce titre à un lycéen amoureux, elle avait senti un danger. Désireuse avant tout de ne pas avoir d’ennuis, elle avait feint de n’avoir avec Jean-Noël que des rapports de camarades. Monsieur Œtlinger s’était excusé de la déranger. Puis, comme s’il faisait une visite de courtoisie, il avait parlé de banalités, si bien que Jean-Noël, malgré sa confusion, s’était demandé pourquoi son père, qu’il s’était attendu à voir en colère, avait tenu à cette entrevue, trop jeune qu’il était pour comprendre que Monsieur Œtlinger s’était mis volontairement dans une situation humiliante à seule fin d’obtenir de la pitié de son fils ce qu’il ne croyait pouvoir obtenir autrement.
Une semaine plus tard, la veille du jour où Monsieur Œtlinger s’était promis de retourner seul chez cette femme afin de s’assurer que tout était bien fini entre elle et son fils, la nouvelle de la mort de Bertrand était arrivée. « Et Jean-Noël, qu’allons-nous faire de lui ? » demanda Monsieur Œtlinger dans la soirée. Il craignait de laisser son fils sans surveillance. « Ce ne sera pas la première fois qu’il restera seul », répondit Annie sèchement. Une question aussi naturelle que celle que venait de lui poser son mari suffisait pour raviver les craintes qu’elle avait de l’avenir, pour lui faire appréhender qu’on n’exigeât d’elle quelque sacrifice. Mais elle se reprit aussitôt, ne voulant pas en un jour comme celui-ci paraître préoccupée de défendre sa fortune. Le lendemain matin, dans la même voiture qui devait l’amener à la gare une heure plus tard, Jean-Melchior conduisit son fils chez un professeur anglais du nom de Stevenson. Établi en France depuis une dizaine d’années, ce professeur prenait exclusivement en pension de jeunes compatriotes. Par déférence pour Annie, il avait consenti à une dérogation. Depuis longtemps il avait remarqué que Monsieur et Madame Œtlinger n’appartenaient pas au même milieu. Croyant flatter Annie, il lui laissait entendre dès qu’il était en sa présence qu’il devinait qui elle était. Pour cette raison Monsieur Œtlinger lui avait confié son fils, ce choix devant dans son esprit calmer l’irritation que sa femme montrait dès qu’elle s’engageait dans de nouvelles dépenses. Il s’était trompé pourtant, Madame Œtlinger ayant toujours eu pour ses admirateurs la plus complète indifférence.
3
Quand Monsieur et Madame Œtlinger arrivèrent à Paris, ils se firent conduire à l’hôtel des Grands Hommes. Annie ne songeait jamais au séjour qu’elle y avait fait sans se représenter l’amour sous un aspect romanesque. En sortant de la gare, il avait pourtant été dans son intention de se rendre directement avec son mari avenue de Malakoff. Cette adresse, elle l’avait même donnée à un chauffeur de taxi. Ce n’avait été qu’en cours de route que son projet d’imposer Jean-Melchior au moment où on allait enterrer Bertrand lui avait paru irréalisable et qu’elle avait compris qu’il valait mieux attendre quelques jours de manière à préparer Monsieur Villemur à cette rencontre.
Ce ne fut donc qu’après avoir accompagné son mari à l’hôtel qu’elle alla retrouver sa famille. Si quelqu’un se réjouissait de ce revirement, c’était Monsieur Œtlinger. Il n’était pas fâché que son entrevue avec les Villemur fût remise, quoiqu’à tout prendre il eût mieux aimé se rendre directement avenue de Malakoff, ce qui était naturel, que d’attendre le moment que choisirait Annie, ce qui aurait quelque chose de prémédité. Comment sa femme ne se rendait-elle pas compte de ce que son désir d’introduire Jean-Melchior chez les siens à la faveur d’un événement aussi douloureux que la mort de Bertrand avait de maladroit ? Comment s’imaginait-elle que ses parents croiraient aux raisons qu’elle voulait que son mari donnât de sa présence à Paris, et dont la plus invraisemblable était qu’il avait été tellement frappé par la mort de Bertrand qu’il avait absolument voulu dire de vive voix aux Villemur combien grande était sa peine ? Pour ne pas contrarier Annie, et malgré la gêne qu’il éprouvait à paraître à un moment où vraiment on avait autre chose à faire que de se réconcilier avec lui, il avait accepté. Mais qu’allaient penser les Villemur d’un homme qui surgirait comme d’une cachette alors que personne ne songeait à lui ?
Le lendemain, quand Annie le rejoignit, il lui fit part de ses craintes. Elle n’en tint aucun compte. La veille, elle avait fait plusieurs allusions sur son mari. Il était à Paris. La mort de Bertrand l’avait bouleversé. Par discrétion, il ne voulait pas se montrer. Dans les jours qui suivirent, elle continua à préparer son père à la visite de Jean-Melchior. Au bout d’une semaine Monsieur Villemur comprit enfin où voulait en venir sa fille. Il lui parut alors qu’elle n’avait plus cette délicatesse qu’il avait tant admirée chez elle quand elle était jeune fille. Ce changement n’était-il pas causé par l’homme dont elle était tombée amoureuse et pour lequel, encore aujourd’hui, elle ne craignait pas de froisser sa famille ? Aussi, quand Annie jugea le moment venu de tirer son mari de l’ombre, eut-elle la surprise de voir que l’accueil qu’on lui fit ne fut pas meilleur que celui qu’on lui avait fait dix ans auparavant. À la suite de cette tentative de conciliation, il y eut, pour la première fois depuis leur mariage, un certain malaise entre Annie et Jean-Melchior. Celui-ci qui, jusqu’à ce jour, n’avait voulu revoir aucun de ses anciens amis ni même son frère, parce qu’il avait senti que cela déplairait à sa femme, au lieu d’errer dans Paris, alla renouer quelques anciennes amitiés. Il revit son frère Martin, qui avait, paraît-il, brillamment réussi. Il le trouva installé au premier étage d’un immeuble modeste de la rue Claude-Bernard, dans un appartement donnant sur une cour. Comme Monsieur Œtlinger, c’est-à-dire pour des raisons de santé, il n’avait pas été mobilisé. Catherine, dont le mari était au front et qui depuis le début de la guerre était revenue habiter chez son frère, où elle faisait l’office de secrétaire, manifesta une grande joie à la vue de Jean-Melchior. « Elle meurt d’inquiétude. Tu devrais lui offrir l’hospitalité. Le changement, le soleil, remonteraient son moral », dit Martin, profitant de ce que sa sœur s’était absentée. « Je ne demande qu’à lui faire plaisir », répondit Monsieur Œtlinger.
Pendant ce temps, Jean-Noël était l’objet d’une surveillance spéciale de la part de Monsieur Stevenson. Celle-ci n’avait pas été recommandée au professeur. Il se croyait tenu à préserver ses autres pensionnaires d’une contamination possible. Quant à Ernestine Mercier, elle avait été avertie par un de ses nombreux amis de la mort de Bertrand et du départ de Monsieur et Madame Œtlinger. Ces deux événements, qui ne la regardaient pas, l’agitèrent beaucoup, tout ce qui se passait à Nice étant, à ses yeux, d’une importance capitale. Elle était impatiente d’agir, de signaler son existence, comme si, en une telle circonstance, on risquait de l’oublier. L’idée lui vint alors de rendre visite à son fils. Elle demanda à un certain Monsieur Grimal qui, en dehors des leçons qu’il donnait dans une école privée, s’occupait un peu de l’éducation d’Émile, ce qu’il pensait de son intention. Monsieur Grimal répondit évasivement. La raison principale de son amitié pour Madame Mercier était la situation très particulière de celle-ci. S’il la traitait en personne injustement frappée par des gens puissants, il n’en espérait pas moins qu’un jour il aurait l’occasion d’approcher ces gens. Aussi veillait-il à ne pas se compromettre, de manière que plus tard, s’il était appelé par exemple à témoigner ou à arbitrer un conflit quelconque, on ne pût lui reprocher cette amitié.
N’y tenant plus, Ernestine Mercier se rendit un matin à la pension de Monsieur Stevenson, non en mère abandonnée, mais en femme qui, si elle a refait sa vie, n’en a pas moins gardé une profonde tendresse pour le fils dont elle a été forcée de se séparer. Elle parla avec beaucoup d’affection, insinua qu’elle était d’une aussi bonne famille que celle qui lui avait ravi son mari et son enfant. Elle eut même cette parole énigmatique : « Le jour est proche où vous aurez une grande surprise », dont Monsieur Stevenson, par politesse, feignit de percer le sens. Elle demanda ensuite à voir son cher enfant et lorsque celui-ci lui fut amené, elle le regarda longuement, les lèvres serrées. Puis, comme si on pouvait tout admettre d’une femme se trouvant dans sa situation, elle versa quelques larmes, se cacha le visage dans ses mains, demanda un verre d’eau. Jean-Noël avait assisté à cette scène plutôt qu’il n’y avait pris part, écarlate de confusion. Le lendemain, il n’osa lever les yeux sur son professeur. Jamais il n’avait éprouvé une telle honte. Son seul désir était de quitter cette pension où, lui semblait-il, on ne le regardait plus qu’avec mépris. Aussi, quand son père fut de retour à Nice, la première chose qu’il lui demanda fut-elle de rentrer avenue Félix-Faure. Surpris, Monsieur Œtlinger chercha à savoir ce qui s’était passé. Comme Jean-Noël refusait de parler, il interrogea Monsieur Stevenson.
– Il ne s’est rien passé de particulier, répondit le professeur qui considérait l’existence de Madame Mercier comme un secret dont il n’eût pas dû être détenteur.
Quelques jours plus tard, Jean-Melchior apprit cependant de son fils ce qui était arrivé. L’attitude de Monsieur Stevenson lui revint à l’esprit. Annie avait justement téléphoné au professeur pour l’inviter à prendre le thé.
– Je ne veux plus le recevoir, dit Monsieur Œtlinger à sa femme.
Comme elle montrait de l’étonnement, comme surtout il ne voulait pas donner la raison de cette volonté, il lui dit qu’il courait des bruits fâcheux, qu’il se garda bien de préciser, sur Monsieur Stevenson. Annie avait une foi aveugle dans les jugements de son mari. Malgré l’amitié que Monsieur Stevenson lui inspirait, elle sourit.
– Le monde est étrange, n’est-ce pas ? dit-elle. Chaque jour on apprend une vilenie.
Quand Monsieur Stevenson s’aperçut de la froideur que lui témoignait Madame Œtlinger, il crut qu’elle provenait de ce qu’il avait reçu, bien malgré lui, Ernestine Mercier. Il se souvint d’une parole que celle-ci avait prononcée. « Monsieur Grimal, que vous connaissez bien, je crois, m’a dit que vous étiez un homme charmant. Je constate qu’il ne m’a pas menti. » La mauvaise humeur du professeur se porta sur Monsieur Grimal. Par un tiers, celui-ci l’apprit. S’il n’avait pas pour son collègue qui, quoique étranger, gagnait plus d’argent que lui, une bien grande sympathie, il ne tenait pas à se mettre en mauvais termes avec lui. Il lui écrivit une longue lettre dans laquelle, sur le ton hautain que l’on prend pour parler de choses désagréables auxquelles on a été mêlé malgré soi, il lui parla de Madame Mercier, des relations épisodiques qu’il avait avec elle. Au grand jamais il ne lui avait conseillé la démarche qu’elle avait faite. Il assura finalement Monsieur Stevenson de ses sentiments distingués et cordiaux et de son dévouement sincère. Faisant un tour complet, l’histoire revint à celle qui l’avait provoquée. Quand Ernestine Mercier s’aperçut en outre que Monsieur Grimal l’évitait, elle ne douta plus que Jean-Melchior n’eût manœuvré contre elle. Elle l’accusa d’avoir reproché à Monsieur Stevenson de l’avoir reçue en homme du monde qu’il était. Par retour du courrier, Monsieur Œtlinger lui répondit qu’elle se trompait, qu’il n’avait même jamais prononcé son nom en présence de Monsieur Stevenson. Elle courut montrer cette lettre à Monsieur Grimal qui, excédé, se débarrassa d’elle aussi vite qu’il le put.
Sur ces entrefaites justement Catherine arriva à Nice. Jean-Melchior l’avait attendue à la gare bien que les trains eussent parfois plusieurs heures de retard afin qu’elle ne se présentât pas avenue Félix-Faure. Depuis son retour, Annie était très abattue. Quoiqu’elle ne se l’avouât pas, elle avait beaucoup compté sur son dernier séjour à Paris pour faire admettre son mari dans sa famille. Elle avait même envisagé qu’à la fin de la guerre, peut-être même avant, Jean-Melchior et elle retourneraient à Paris pour y rester définitivement. Or, non seulement ses espoirs s’étaient montrés irréalisables, mais des rapports nouveaux, froids, corrects, s’étaient établis entre sa famille et elle. Annie avait alors été frappée par ce que le destin a d’étrange et d’inattendu. Elle avait toujours affirmé qu’il n’y aurait place entre ses parents et elle que pour un amour parfait, et à présent, sans qu’elle sût comment cela s’était fait, elle échangeait avec les siens une correspondance de cousins éloignés. Ç’avait donc été sans le dire à Annie que Monsieur Œtlinger avait été chercher sa sœur et que, sous le prétexte qu’il n’avait pas de domestiques, il l’avait envoyée à Menton, nantie d’une lettre pour Ernestine.
En rentrant, il se félicita de n’avoir pas suivi l’idée qu’il avait eue un instant, lorsque sa sœur était descendue du train, de l’héberger. Il trouva Annie de très mauvaise humeur.
– Il faut absolument prendre une décision, lui dit-elle.
Puis elle parla de faire des portraits, de gagner ainsi de quoi subvenir aux frais de la maison. Les quelques revenus qu’elle touchait encore pourraient alors leur servir d’argent qu’elle appelait de poche mais dont l’utilisation dépassait ce que l’on entend ordinairement par cette expression puisqu’elle s’étendait à tout ce qui n’était pas, comme elle disait, le « ménage ».
Un après-midi, comme elle se rendait à son atelier situé dans la vieille ville, son attention fut attirée par un écriteau pendu à la porte d’une maison délabrée. Un logement était à louer. Brusquement, sans réfléchir, elle entra dans cette maison, chercha le propriétaire. Un homme de soixante ans, courbé sur une canne, s’avança vers elle. Il était vêtu d’un costume de velours à côtes et portait un chapeau noir à larges bords. Une barbe blanche lui donnait l’apparence d’un modèle. Cet homme qu’elle n’avait jamais vu, avec lequel elle ne pouvait avoir aucun point commun, lui fit pourtant une grande impression. « Je viens de lire, lui dit-elle respectueusement, l’écriteau que vous avez fait accrocher à la porte de votre maison. » Il conduisit Annie dans une sorte d’atelier de menuiserie où cinq ou six chats dormaient les uns à côté des autres. Elle lui fit part de son désir de louer un appartement plus petit que celui qu’elle habitait. La guerre se prolongeait. Elle craignait d’être ruinée. Elle estimait qu’elle devait réduire son train de vie. Flatté et surpris par ces confidences, le propriétaire l’encouragea dans cette voie. Et elle le quitta, presque joyeuse, sur la promesse qu’il allait lui établir un bail.
Lorsqu’elle raconta à son mari qu’elle projetait de louer un logement dans la vieille ville, il ne partagea pas son enthousiasme. Il lui dit qu’elle s’exagérait ses craintes, que la guerre était sur le point de finir, que tout s’arrangerait, si bien qu’Annie rassurée, ne se rendit pas au rendez-vous que lui avait donné le propriétaire. Il vint la trouver. Il n’en fallut pas davantage pour faire renaître l’inquiétude d’Annie. Elle signa le bail. À partir de ce jour elle se sentit mieux. Cette paix fut pourtant de courte durée. Une semaine plus tard, Catherine sonnait à l’appartement de l’avenue Félix-Faure. Quand elle s’était présentée, avec la lettre de son frère, chez Madame Mercier, celle-ci s’était écriée : « C’est un comble ! » Comment, après ce qui s’était passé, Jean-Melchior avait-il eu le front de lui demander un service ! Elle n’avait pourtant pas osé renvoyer Catherine. Elle s’était contentée de la recevoir comme quelqu’un que seules les circonstances ont empêché de prendre position contre nous. Catherine, glacée par cet accueil, avait eu la maladresse de ne pas écouter les doléances d’Ernestine. Dès le lendemain, celle-ci s’était emportée au moindre prétexte. La vie étant devenue insupportable, Catherine était retournée à Nice.
Annie, contrairement à ce qu’on eût pu supposer, reçut aimablement la sœur de son mari. Mais quand elle apprit que ce n’était pas d’elle-même que celle-ci était venue à Nice, que c’était Jean-Melchior qui l’avait invitée, sans dire un mot, elle alla s’enfermer dans sa chambre. Monsieur Œtlinger voulut l’y rejoindre. La porte était fermée de l’intérieur. Il frappa à différentes reprises. Finalement Annie lui ouvrit. Ses paupières et le cerne de ses yeux étaient gonflés, mais secs. Ce n’était que vers les pommettes qu’apparaissaient des traces humides trahissant qu’elle avait pleuré.
– Il faut qu’elle reste, dit-elle avant que son mari eût le temps de prononcer une parole.
Elle avait eu des remords. Elle regrettait de s’être abandonnée à un mouvement d’humeur. Cette jeune femme n’avait-elle pas ses soucis ? Son mari n’était-il pas au front ? « Oublie, ajouta-t-elle, ce que j’ai dit. »
Après le dîner, tendre, changée, elle proposa à Jean-Melchior de sortir. La soirée était chaude. Un vent tiède venait de la mer, agitant doucement les palmiers qui, aux lumières des réverbères et des voitures, semblaient appartenir à un décor. Jean-Melchior avait pris le bras d’Annie et, en marchant, il le serrait contre lui. Bien que leurs hanches se touchassent, elle le précédait comme toujours, le regard fixé devant elle. Ils longèrent la promenade des Anglais, traversèrent la place Masséna, s’engagèrent dans l’avenue de la Gare. Il n’était pas tard. Devant le Petit Niçois, un attroupement lisait le communiqué. Ils s’assirent, comme ils aimaient à le faire, à la terrasse d’un grand café. Soudain Annie dit : « Je devrais lui téléphoner. » « À qui ? » demanda Jean-Melchior. Elle ne répondit pas. Il comprit alors qu’il s’agissait de ce fameux Monsieur Duncan dont elle parlait depuis des mois et qui, prétendait-elle, était prêt à lui offrir une fortune si elle consentait à faire son portrait. « Tu ne t’es donc pas aperçue que ce Monsieur Duncan fait des promesses mirifiques à tout le monde, justement parce qu’il est d’une avarice sordide. » Annie fut alors frappée par la pâleur de son mari. Au lieu de lui répondre, comme elle en avait le désir, qu’il se trompait, elle le regarda longuement, avec inquiétude. À ce moment, un maître d’hôtel s’approcha de Monsieur et Madame Œtlinger. C’était un Suédois, grand, jeune, aux yeux bleus, aux jointures maxillaires inégalement saillantes. Annie, qui aimait à découvrir de la distinction là où personne ne la cherchait, serra la main de Jean-Melchior. Il leva les yeux, fut confondu à son tour par la beauté du maître d’hôtel. « Quel âge avez-vous ? » lui demanda-t-il. Pendant plusieurs minutes, il lui posa toutes sortes de questions, cependant qu’Annie l’écoutait amusée. Puis il tint à savoir s’il avait des enfants. Le maître d’hôtel lui répondit qu’il avait une petite fille. Monsieur Œtlinger vanta alors les joies que donnent les enfants, si bien que le beau garçon, après une minute passée à s’assurer que son interlocuteur ne se moquait pas de lui, se joignit à cet éloge de la paternité. En quittant le café, Annie se mit à rire. « Pourquoi ris-tu ? » lui demanda son mari qui savait très bien qu’elle riait de la manie qu’il avait de chercher des sentiments paternels chez les hommes semblant le moins capables d’en avoir.
4
Le lendemain, Jean-Melchior ne se leva pas. Toute la nuit il avait eu la fièvre. Depuis longtemps déjà, il buvait jusqu’à dix verres d’eau avant de se coucher. Annie avait quitté trop jeune sa famille pour s’être familiarisée avec les maladies. Cette soif anormale ne l’avait jamais inquiétée. Ce matin-là, pourtant, elle appela un médecin. Dans l’après-midi, Monsieur Œtlinger fut radiographié. Il avait plusieurs lésions aux poumons. En outre, il était diabétique. Il fallait partir le plus vite possible pour Davos.
Jean-Noël, selon le désir de son père, fut confié à une famille parisienne que la vie de Monsieur et Madame Œtlinger avait longtemps intriguée. L’appartement fut fermé, sauf une chambre et la cuisine pour que Catherine, dont on n’avait pas eu le temps de s’occuper, eût un abri.
Annie s’était toujours entourée de gens quelconques, mais dont l’admiration lui épargnait les petits ennuis de la vie courante. En cette épreuve, Monsieur Saglioni montra que le dévouement respectueux qu’il avait témoigné jusqu’alors à Madame Œtlinger était sincère. Monsieur Saglioni était un vieux Niçois, fils de commerçants, commerçant lui-même. Il faisait un peu de politique, avait été conseiller municipal et était encore président d’un groupement touristique. Le soir même, elle courut chez le brave homme. Dans son affolement, elle lui raconta non seulement le drame mais tous les soucis qui l’accablaient. Une telle marque de confiance décupla la serviabilité de Monsieur Saglioni. Il la réconforta. « Laissez-moi faire », lui dit-il à plusieurs reprises. Il lui proposa même de s’enquérir auprès d’un notaire de ses amis du moyen le plus efficace de réduire au silence Madame Mercier. Mais Madame Œtlinger calma son zèle, désireuse qu’elle était en un moment aussi pénible de ne pas entamer de lutte avec une femme comme Ernestine. Elle chargea Monsieur Saglioni de remettre chaque mois à Madame Mercier une petite somme, de la prévenir de l’état de Jean-Melchior. Elle lui recommanda de ne dévoiler, sous aucun prétexte, sa nouvelle adresse. Elle le pria de se rendre de temps en temps, à ses moments perdus, avenue Félix-Faure pour s’assurer que tout y était en ordre, que Catherine ne manquait de rien et, à cet effet, elle lui remit une clef de l’appartement. Elle lui donna également le nom de la famille à laquelle Jean-Noël avait été confié afin qu’il pût prévenir le jeune homme au cas où il arriverait un malheur. Elle lui parla du bail qu’elle avait eu la légèreté de signer quelques jours auparavant, lui demanda de faire tout ce qu’il pourrait pour en obtenir la résiliation. En un mot, elle se rapportait entièrement à lui de tout, même des démarches immédiates à la Préfecture et au Consulat suisse. Le surlendemain, accompagnée d’une infirmière, elle conduisait Jean-Melchior à Davos.
Monsieur et Madame Montigny, leur fille dont le mari, Adrien Bérard, était mobilisé, et le fils que celui-ci avait eu d’une première femme morte en couches, ami de lycée de Jean-Noël et par qui justement les Œtlinger avaient fait connaissance de cette famille, habitaient depuis trois mois une jolie propriété non loin de l’avenue Félix-Faure. Ils avaient quitté Paris à cause des bombardements aériens. En quête de relations dès leur arrivée à Nice, Annie et Jean-Melchior, à qui ils avaient trouvé un genre parisien, comme ils disaient, leur avaient été vite sympathiques. N’était-il pas agréable de rencontrer en province des gens ayant les idées larges, avec lesquels on pouvait causer et avec lesquels on avait tant de goûts communs. Tout leur était prétexte à inviter les Œtlinger, Annie de préférence. Aussi, quand elle avait été les voir, sur la prière de Jean-Melchior, pour leur demander d’héberger Jean-Noël, acceptèrent-ils avec beaucoup de bonne grâce.
Un mois plus tard, Jean-Noël, que personne n’avait averti de la gravité du mal dont son père était atteint, que les Montigny laissaient agir à sa guise afin de ne pas être en reste de libéralisme avec Monsieur et Madame Œtlinger, et qui en profitait pour ne pas retourner au lycée bien qu’il fût à la veille de se présenter aux examens du baccalauréat, parvint à retrouver Gisèle. Il apprit alors avec étonnement que, jusqu’à sa maladie, Monsieur Œtlinger avait revu presque quotidiennement cette jeune femme, qu’il l’avait prise sous sa protection, qu’il l’avait fait inscrire dans un bureau de bienfaisance, que grâce à lui elle avait obtenu la situation assez inattendue de dame de compagnie auprès d’une vieille Anglaise. Jean-Noël crut d’abord que tout cela était une fable. Mais Gisèle lui donna de telles précisions, notamment sur sa famille à lui, qu’il n’en douta bientôt plus. Que son père eût pu fréquenter une femme comme Gisèle, à l’insu d’Annie nécessairement, l’emplit de honte. Il reconnaissait bien à cela cette absence de dignité dont il souffrait autant que de la vulgarité de sa mère. Malgré son humiliation, il n’en renoua pas moins avec Gisèle.