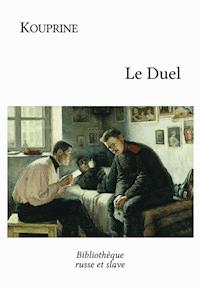Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliothèque russe et slave
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Le Bracelet de grenats et
Olessia sont deux histoires d'amour, deux petits joyaux. Le premier, publié en 1910, dépeint dans une teinte crépusculaire l'aristocratie russe, à travers la passion chaste et pure d'un homme pour une dame inaccessible.
Olessia est un des premiers récits de l'auteur et un de ses préférés, car très largement autobiographique. Le narrateur, envoyé dans une région aux confins de la Russie, y fait la rencontre d'Olessia, une jeune femme qui vit recluse dans les bois avec sa grand-mère que les villageois regardent comme une sorcière.
Traduction d'Henri Mongault, 1922, 1933.
EXTRAIT DU
BRACELET DE GRENATS
Vers la mi-août, la nouvelle lune amena brusquement une affreuse période d’intempéries comme seules en connaissent les côtes septentrionales de la Mer Noire. Tantôt, pendant des journées entières, un épais brouillard couvrait la terre et la mer, et l’énorme sirène du phare beuglait, nuit et jour, tel un taureau furieux. Tantôt, d’un matin à l’autre, tombait sans interruption une pluie fine comme de la poussière d’eau, changeant les chemins et les sentiers argileux en un épais bourbier où s’enfonçaient désespérément camions et voitures.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Alexandre Ivanovitch Kouprine, né le 26 août 1870 à Narovtchat et mort le 25 août 1938 à Léningrad, est un écrivain russe, aviateur, explorateur et aventurier qui est notamment connu pour son roman
Le Duel publié en 1905.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE
— LITTÉRATURE RUSSE —
Alexandre Kouprine
Куприн Александр Иванович
1870 – 1938
LE BRACELET DE GRENATS
Гранатовый браслет
OLESSIA
Олеся
1910 – 1898
Traduction d’Henri Mongault, Paris, 1922, 1933.
© La Bibliothèque russe et slave, 2014
© Henri Mongault, 1922, 1933
Couverture : Isaac BRODSKI, Portrait de l’épouse de l’artiste sur une terrasse, 1908.
Chez le même éditeur — Littérature russe
1. GOGOLLes Âmes mortes. Traduction d’Henri Mongault
2. TOURGUENIEVMémoires d’un chasseur. Traduction d’Henri Mongault
3. TOLSTOÏLes Récits de Sébastopol. Traduction de Louis Jousserandot
4. DOSTOÏEVSKIUn joueur. Traduction d’Henri Mongault
5. TOLSTOÏAnna Karénine. Traduction d’Henri Mongault
6. MEREJKOVSKILa Mort des dieux. Julien l’Apostat. Traduction d’Henri Mongault
7. BABELCavalerie rouge. Traduction de Maurice Parijanine
8. KOROLENKOLe Musicien aveugle. Traduction de Zinovy Lvovsky
9. KOUPRINELe Duel. Traduction d’Henri Mongault
10. GOGOLLe Révizor — Le Mariage. Traduction de Marc Semenoff
11. DOSTOÏEVSKIStépantchikovo et ses habitants. Traduction d’Henri Mongault
12. Les Bylines russes — La Geste du Prince Igor. Traductions de Louis Jousserandot et d’Henri Grégoire
13. PISSEMSKIMille âmes. Traduction de Victor Derély
14. RECHETNIKOVCeux de Podlipnaïa. Traduction de Charles Neyroud
15. TOURGUENIEVPoèmes en prose. Traduction de Charles Salomon
16. GONTCHAROVOblomov. Traduction de Jean Leclère
17. GOGOLVeillées d’Ukraine. Traduction d’Eugénie Tchernosvitow
LE BRACELET DE GRENATS
I
VERS la mi-août, la nouvelle lune amena brusquement une affreuse période d’intempéries comme seules en connaissent les côtes septentrionales de la Mer Noire. Tantôt, pendant des journées entières, un épais brouillard couvrait la terre et la mer, et l’énorme sirène du phare beuglait, nuit et jour, tel un taureau furieux. Tantôt, d’un matin à l’autre, tombait sans interruption une pluie fine comme de la poussière d’eau, changeant les chemins et les sentiers argileux en un épais bourbier où s’enfonçaient désespérément camions et voitures. Tantôt s’élevait du nord-ouest, du côté de la steppe, un furieux ouragan : et alors les cimes des arbres se balançaient sans cesse, pliant et se redressant comme des vagues sous la tempête, les toits en tôle des villas grondaient pendant la nuit comme si quelqu’un eût couru sur eux en souliers ferrés, les châssis des fenêtres tressaillaient, les portes claquaient et les tuyaux de cheminée hurlaient sauvagement. Quelques barques de pêche se perdirent au large, deux ne revinrent pas : quinze jours plus tard, les corps des pêcheurs furent rejetés à divers endroits du rivage.
Les baigneurs, pour la plupart Grecs et Juifs, gais et méfiants comme tous les Méridionaux, s’étaient hâtés de regagner la ville voisine. Sur la route détrempée s’allongeaient des files de charrettes, surchargées des plus hétéroclites ustensiles de ménage : matelas, divans, coffres, chaises, lavabos, samovars. À travers la mousseline opaque de la pluie, ce pitoyable bagage semblait usé, sale, misérable ; les servantes et cuisinières, juchées tout en haut sur une bâche mouillée, tenaient en mains des fers à repasser, des boîtes en fer-blanc et des paniers d’osier ; les chevaux harassés et en sueur s’arrêtaient à tous moments, tremblant des genoux, fumant et les flancs dilatés ; les voituriers encapuchonnés de nattes proféraient des injures à voix enrouée ; tout le charroi dégageait une impression triste, pénible, navrante. Plus lamentables encore paraissaient les villas désertées, devenues soudain immenses, vides et nues, avec leurs vitres brisées et leurs parterres saccagés, où erraient des chiens abandonnés et s’amoncelaient des tas d’ordures : bouts de cigarettes, papiers, tessons, écailles, cartons et fioles pharmaceutiques.
Mais au commencement de septembre, brusquement le temps changea. Les jours se succédèrent calmes et sereins, plus clairs, plus ensoleillés, plus chauds qu’au mois de juillet. Dans les champs desséchés, l’araignée d’automne jeta sur la pointe des chaumes l’éclat vacillant de sa toile. Les arbres apaisés se résignaient à laisser choir leurs feuilles jaunes, silencieusement.
La princesse Véra Nicolaïèvna Cheïne, femme du maréchal de noblesse de la province, n’avait pu quitter la plage, par suite de réparations à son hôtel. Et elle goûtait maintenant pleinement la joie des beaux jours tardifs, du silence, de la solitude, de l’air pur et de la brise salée, caresse légère de la mer.
II
EN outre, c’était aujourd’hui sa fête — le 17 septembre. De charmants et lointains souvenirs d’enfance lui rendaient ce jour à jamais cher, et toujours elle en attendait quelque surnaturel bonheur. Ce matin, avant de partir en ville où l’appelaient des affaires urgentes, son mari avait déposé sur sa table de nuit un écrin renfermant de splendides boucles d’oreilles en perles piriformes, et ce cadeau avait encore accru son allégresse.
Elle était seule dans toute la maison. Son frère Nicolas, vieux garçon qui vivait d’ordinaire avec eux, avait dû également se rendre en ville, au tribunal près duquel il exerçait les fonctions de procureur-substitut. Son mari avait promis d’amener à dîner quelques amis choisis parmi les plus intimes. Quelle chance que sa fête coïncidât avec leur séjour à la campagne ! En ville, il eût fallu donner un grand dîner, peut-être même un bal, tandis qu’ici on pouvait se contenter des plus minimes dépenses. En dépit — ou peut-être à cause — de sa situation fort en vue, le prince Cheïne joignait difficilement les deux bouts. Son immense patrimoine avait été fortement compromis par les dilapidations de ses ancêtres, et pourtant, il devait vivre au-dessus de ses moyens : les réceptions, la bienfaisance, la toilette, les chevaux, etc... exigeant beaucoup d’argent. La princesse Véra, dont l’ancienne passion pour son mari s’était depuis longtemps muée en une sincère, solide et fidèle amitié, l’aidait de toutes ses forces à éviter la ruine complète. Sans qu’il s’en doutât, elle se refusait bien des choses, et réduisait autant que possible son train de maison.
En ce moment, elle marchait par le jardin, attentive à couper avec des ciseaux des fleurs pour orner la table. Dans les plates-bandes nues et mal tenues, de gros œillets multicolores se dressaient encore çà et là, quelques giroflées ponctuaient de rares fleurs leurs fines gousses vertes à odeur de chou, et pour la troisième fois de l’année, les rosiers ouvraient de maigres boutons, rapetissés et comme dégénérés. Cependant dahlias, pivoines et asters étalaient leur froide et orgueilleuse beauté et répandaient dans l’air léger une odeur automnale, herbacée et mélancolique. Les autres fleurs, après leurs superbes amours et leurs trop plantureuses maternités estivales, couvraient doucement la terre des innombrables germes de la vie future.
Tout près, sur la route, se firent entendre les sons familiers d’une trompe d’automobile à trois tons, annonçant l’arrivée d’Anna Nicolaïèvna Frièssé, sœur de la princesse Véra, à qui, dès le matin, elle avait promis par téléphone de venir l’aider dans ses préparatifs de réception.
Véra se dirigea à la rencontre de sa sœur ; son ouïe fine ne l’avait point trompée : au bout de quelques instants, une élégante limousine s’arrêta devant le portail, et, sautant adroitement de son siège, le chauffeur ouvrit la portière.
Les deux sœurs s’embrassèrent tendrement. Depuis l’enfance, une chaude et prévenante amitié les unissait. Physiquement, elles différaient étrangement. L’aînée, Véra, tenait de sa mère, superbe Anglaise, une haute taille flexible, un visage tendre, mais froid, de belles mains un peu trop grandes, et une admirable chute d’épaules, comme en montrent les anciennes miniatures. La cadette au contraire avait hérité le sang mongol de son père, prince tatare, dont l’aïeul ne s’était fait baptiser qu’au commencement du XIXe siècle, et qui descendait directement de Tamerlan, ou plutôt Lang-Temir, ainsi qu’il nommait fièrement en langue tatare ce grand buveur de sang. D’une demi-tête plus petite que sa sœur, plutôt large d’épaules, Anna était toute vivacité, légèreté, raillerie. Ses pommettes saillantes, ses yeux bridés que la myopie lui faisait continuellement cligner, l’expression hautaine de sa petite bouche sensuelle et en particulier de sa grosse lèvre inférieure légèrement proéminente, tout son visage accusait fortement le type mongol. Il s’en dégageait pourtant un insaisissable, un incompréhensible charme, émanant peut-être du sourire, peut-être de la profonde féminité des traits, peut-être de la mimique effrontément coquette. Sa gracieuse laideur excitait et retenait l’attention des hommes beaucoup plus fréquemment et plus profondément que l’aristocratique beauté de sa sœur.
Son mari, fort riche et fort sot, ne faisait absolument rien, mais était attaché à une vague institution de bienfaisance et avait le titre de gentilhomme de la Chambre. Bien qu’elle le détestât, elle lui avait pourtant donné un fils et une fille, puis s’était décidée à ne plus être mère et avait tenu parole. Quant à Véra, elle désirait ardemment des enfants, et même le plus possible, mais ses espérances demeurant vaines, elle adorait d’un amour ardent et maladif ceux de sa sœur, gentils et anémiques, toujours corrects et obéissants, aux visages pâles comme de la farine, et aux cheveux de lin bouclés comme des perruques de poupée.
Le caractère d’Anna était pétri d’incohérence joyeuse et de charmantes, parfois étranges contradictions. Elle s’adonnait volontiers aux flirts les plus risqués dans toutes les capitales et toutes les villes d’eau de l’Europe, mais ne trompait jamais son mari, dont elle se moquait pourtant, à sa barbe comme derrière le dos ; fort dépensière, elle aimait follement les jeux de hasard, les danses, les impressions violentes, les spectacles équivoques, fréquentait à l’étranger les cafés mal famés ; mais se signalait en même temps par une bonté généreuse et par une sincère et profonde piété qui l’avait même amenée à se convertir secrètement au catholicisme. Son dos, sa poitrine et ses épaules étaient d’une rare beauté ; quand elle allait à quelque bal paré, elle se décolletait beaucoup plus que ne le permettaient la mode et les convenances, mais on prétendait que, sous sa robe si bas échancrée, elle portait toujours un cilice.
Véra, par contre, se montrait d’une sévère simplicité, d’une froide et quelque peu hautaine amabilité avec tout le monde ; indépendante, elle ne se départissait jamais d’un calme vraiment royal.
III
— MON Dieu, qu’il fait bon ici ! qu’il fait bon ! répétait Anna, trottinant à petits pas rapides à côté de sa sœur. Allons, si tu le veux bien, nous asseoir sur le banc tout en haut de la falaise. Il y a si longtemps que je n’ai vu la mer. Et quel air délicieux : le cœur exulte rien qu’à le respirer ! L’été dernier, à Miskhor, en Crimée, j’ai fait une découverte. Sais-tu ce que sent l’eau de mer à marée montante ? Le réséda, ma chère.
Véra eut un sourire câlin.
— Quelle riche imagination tu as !
— Non, non. Je me souviens qu’une fois, vous vous êtes tous moqués de moi quand j’ai prétendu trouver une nuance rose au clair de lune. Eh bien ! ces jours derniers, le peintre Boritskiï — celui qui fait mon portrait — m’a dit que j’avais raison et que tous les artistes savaient cela depuis longtemps.
— C’est ton nouveau flirt, ce peintre ?
— Tu ne sais qu’inventer, répliqua Anna en riant. Elle gagna rapidement le bord de la falaise abrupte, plongea ses regards dans l’abîme, et brusquement poussa un cri d’effroi et se rejeta en arrière en pâlissant.
— Comme c’est haut ! murmura-t-elle d’une voix affaiblie et tremblotante. Quand je regarde d’une aussi grande hauteur, je ressens toujours dans la poitrine un chatouillement à la fois délicieux et irritant... et une crispation dans les doigts de pied... Et pourtant, cela m’attire, cela m’attire...
Elle allait encore une fois se pencher, mais sa sœur la retint.
— Anna, chérie, au nom du ciel ! La tête me tourne quand je te vois si près du bord. Assieds-toi, je t’en prie.
— Calme-toi, je m’assieds. Regarde comme c’est beau. Impossible de se rassasier les yeux de ce spectacle ! Si tu savais comme je remercie Dieu des merveilles qu’il a créées pour nous !
Toutes deux se turent un instant. Sous leurs pieds à une énorme profondeur s’étendait la mer. Du banc où elles étaient assises, on n’apercevait point le rivage, ce qui augmentait encore la sensation de majesté et d’infini. Joyeuses et caressantes, les vagues azurées se déroulaient indolemment ; des stries brillantes et unies signalaient le courant et une barre d’un bleu foncé fermait l’horizon.
Non loin du rivage, des barques de pêche, difficilement discernables à l’œil nu — tant elles semblaient petites — sommeillaient au bercement des flots, tandis qu’au large un trois-mâts, revêtu de haut en bas d’uniformes voiles blanches harmonieusement bombées par le vent, paraissait immobile et comme suspendu en l’air.
— Je te comprends, remarqua pensivement la sœur aînée, mais sur moi la mer agit différemment. Quand, après une longue absence, je l’aperçois de nouveau, elle m’émeut, me réjouit, me trouble. Je crois toujours me trouver pour la première fois en présence de cette solennelle merveille. Puis, lorsque je m’y suis habituée, son vide, sa monotone étendue m’oppressent. Elle m’ennuie et je tâche de ne plus la regarder.
Anna sourit.
— L’an dernier, dit-elle malicieusement, nous partîmes de Ialta en grande cavalcade pour Outch-Koche, tu sais, tout là-haut au-dessus de la cascade. Nous fûmes d’abord pris dans le brouillard, il faisait très humide et très sombre et nous montions par un sentier escarpé entre les pins. Et tout d’un coup, au sortir du bois, la brume se dissipa. Nous nous trouvions sur une étroite avancée de rochers avec l’abîme sous nos pieds. Les villages en bas ressemblaient à des boîtes d’allumettes, les bois et les jardins à des touffes d’herbe. Tout le paysage s’étalait vers la mer, comme une carte de géographie. Et au loin, là-bas, la mer ! Jusqu’à cinquante verstes au large. Je me crus prête à m’envoler. Quelle beauté, quelle légèreté ! Enthousiasmée, je me retournai et dis au guide : « C’est beau, n’est-ce pas, Seïd Ogly ? » Et lui répondit en claquant de la langue : « Eh ! Madame, je vois cela tous les jours, si vous saviez comme j’en ai assez ! »
— Merci de la comparaison, dit Véra en riant. Vois-tu, nous autres, gens du nord, ne comprendrons jamais bien le charme de la mer. J’aime la forêt. Te rappelles-tu la nôtre à Iégorovskoïe ?... Peut-on jamais se lasser de la forêt ?
— Oh moi, tu sais, j’aime tout, répondit Anna, et surtout ma petite sœur, ma raisonnable Vérineka. Ne sommes-nous pas seules au monde ?
Elle se jeta au cou de son aînée et demeura serrée contre elle joue contre joue. Mais soudain elle se dégagea :
— Suis-je bête ! Nous sommes là à nous laisser émouvoir par la nature comme dans un roman, et j’ai oublié mon cadeau. Regarde. J’ai peur qu’il ne te plaise pas.
Elle tira de son sac à main un petit carnet curieusement relié : sur un vieux velours bleu passé et usé par le temps, un filigrane d’or terni entrelaçait son dessin compliqué, d’une adorable finesse, œuvre d’un artiste patient et consommé. Le carnet pendait à une chaînette d’or menue comme un fil, et renfermait en guise de feuilles de minces tablettes d’ivoire.
— Quel délicieux, quel ravissant bibelot ! s’exclama Véra en embrassant sa sœur. Merci, merci. Où as-tu trouvé ce trésor ?
— Chez un antiquaire. Tu connais ma manie de fouiller dans les vieilleries. C’est ainsi que j’ai déniché ce livre d’heures, car c’en est un : regarde, ici l’ornement a la forme d’une croix. À parler franc je n’ai trouvé que la reliure, et j’ai dû inventer tout le reste : tablettes, fermoir, crayon. J’ai eu beau expliquer à Molliné ce que je voulais, il n’est pas arrivé à comprendre. Je désirais un fermoir du même style que le décor, de ton mat, vieil or et finement ciselé, et il a mis je ne sais quelle horreur à la place. Mais la chaînette est bien ancienne, véritable travail vénitien.
Véra ravie examinait la jolie reliure.
— Quel âge peut bien avoir ce petit livre ? demanda-t-elle.
— Je n’ose fixer une date précise. Il doit remonter à la fin du XVIIe ou au milieu du XVIIIe siècle.
— C’est étrange, dit Véra en souriant pensivement. Je tiens en mains un objet qu’ont peut-être manié la Pompadour ou la reine Louise... Franchement, Anna, changer un livre d’heures en un carnet de dames, c’est là une espièglerie que toi seule pouvais inventer !... Mais il est temps de jeter un coup d’œil sur le ménage.
Elles gagnèrent la maison le long d’une grande terrasse en pierre, close de tous côtés d’une treille touffue. D’opulentes grappes de raisin noir « Isabelle », exhalant une légère odeur de fraise, pendaient lourdement dans le feuillage sombre où le soleil posait des plaques d’or. Les espaliers tamisaient une lumière verdâtre, qui pâlit soudain les visages des deux femmes.
— Tu feras servir ici ? demanda Anna.
— C’était en effet mon intention. Mais les soirées sont fraîches. Nous serons mieux dans la salle à manger. Ces messieurs pourront venir fumer ici.
— Attends-tu quelqu’un d’intéressant ?
— Je l’ignore encore. Je sais seulement que « grand-père » viendra.
— Ah, ce cher grand-père, quel plaisir ! s’écria Anna en battant des mains. Voilà, je crois bien, cent ans que je ne l’ai vu.
— Nous aurons ma belle-sœur, et, je crois, le professeur Spiéchnikov. Aussi hier ai-je complètement perdu la tête. Tu sais que tous deux — grand-père et le professeur — sont de fins gourmets. Mais, pas plus en ville qu’ici, on ne peut rien trouver, à n’importe quel prix. Luc a pu acheter des cailles à un chasseur de ses amis et s’ingénie à les préparer savamment. Il a aussi mis la main sur un assez bon rostbeaf — hélas ! l’inévitable rostbeaf — et sur de très belles écrevisses.
— Eh bien, mais c’est parfait. Ne te tourmente pas. Soit dit entre nous, la bonne chère est aussi ton péché mignon.
— Il y aura pourtant une rareté. Ce matin un pêcheur nous a apporté un « coq de mer1 », un véritable monstre : il fait peur à voir.
Anna, curieuse jusqu’à l’avidité de tout ce qui la concernait comme de tout ce qui ne la concernait pas, exigea tout de suite qu’on lui montrât cette bête extraordinaire.
Le cuisinier Luc, grand diable efflanqué, au visage glabre et jaunâtre, apporta une longue poissonnière blanche qu’il tenait soigneusement par les anses, attentif à ne pas répandre d’eau sur le parquet.
— Douze livres et demie, Excellence, dit-il en se rengorgeant avec l’amour-propre spécial aux cuisiniers. Nous venons de le peser.
Trop grand pour le récipient, le poisson gisait au fond, la queue repliée. Ses écailles chatoyaient de reflets d’or, ses nageoires brillaient d’un rouge vif, et sur chaque côté de son museau rapace s’élevaient deux longues ailes d’un bleu tendre plissées en éventail. Encore vivant il jouait convulsivement des ouïes.
Anna lui toucha la tête du petit doigt, mais le « coq », ayant soudainement frétillé de la queue, elle retira sa main en jetant un cri strident.
— Que Votre Excellence ne se tourmente pas, nous arrangerons tout pour le mieux, proféra le cuisinier qui semblait comprendre l’inquiétude de Véra. Un Bulgare nous a apporté tantôt deux melons superbes : ils rappellent les cantaloups, mais avec une odeur beaucoup plus aromatique. Je me permets encore de demander à Votre Excellence à quelle sauce servir le poisson : tartare, polonaise ou meunière ?
— Faites comme vous voudrez. Allez ! ordonna la princesse.
IV
DÈS cinq heures apparurent les premiers invités. Le prince Vassiliï Lvovitch amena sa sœur Lioudmila Lvovna Dourassov, bonne grosse veuve taciturne, son beau-frère Nicolas Nicolaïévitch, la célèbre pianiste Jenny Reiter, amie de pension de la princesse Véra (toutes deux avaient été élevées à l’Institut Smolniï) et un jeune et riche mauvais sujet, connu de toute la ville sous le sobriquet de Vassioutchok2, et fort précieux en société pour ses talents de chanteur, déclamateur et organisateur de tableaux vivants, spectacles et bazars de charité. Le mari d’Anna survint ensuite en automobile accompagné du vice-gouverneur von Sekk et du gros professeur Spiéchnikov, énorme masse rasée et hideuse. Enfin le général Anossov arriva dans un bon landau de louage, escorté de deux officiers : le colonel d’état-major Ponamariov, maigre et bilieux, vieilli avant l’âge, épuisé par un écrasant travail de bureau, et le lieutenant de hussards de la garde Bakhtinskiï, qui passait à Pétersbourg pour un danseur idéal et un incomparable commissaire de bal.
Le général Anossov, grand vieillard obèse, descendit péniblement du marchepied, s’appuyant d’une main à l’accotoir du siège, et de l’autre au dossier de la voiture. De la main gauche il tenait un cornet acoustique, et de la droite, une canne à embout de caoutchouc. Il avait le visage rouge, gros et commun, le nez charnu, et des yeux clignotants aux globes renflés en demi-cercles, empreints de cette expression débonnairement majestueuse, légèrement méprisante, particulière aux gens courageux et simples qui ont souvent vu le danger et la mort en face. Les deux sœurs, l’ayant reconnu de loin, accoururent à temps pour le soutenir sous chaque bras à sa descente de voiture, moitié plaisamment, moitié sérieusement.
— J’ai l’air d’un archevêque ! s’écria le général d’une agréable voix de basse voilée.
— Cher grand-père, dit Véra d’un ton de léger reproche. Nous vous attendons tous les jours, mais vous ne daignez même pas faire une apparition.
— Notre midi a fait perdre toute conscience à grand-père, reprit Anna. Vous pourriez, il me semble, vous souvenir de votre filleule. Vous jouez les Don Juan, Monsieur et vous avez complètement oublié notre existence...
Découvrant sa tête imposante, le général baisa à tour de rôle la main aux deux sœurs, puis les embrassa sur les joues et leur baisa de nouveau la main.
— Mes petites filles... attendez... ne me grondez pas, dit-il enfin en interrompant chaque mot de soupirs causés par un asthme invétéré. Ma parole d’honneur... ces maudits docteurs... ont baigné tout l’été mes rhumatismes... dans je ne sais quelle infecte... et puante bouillie... Et ils ne me laissaient pas partir... Vous êtes les premières... chez qui je viens... Je suis ravi.. de vous revoir... Êtes-vous toujours bien portantes ?... Vérotchka... te voilà devenue une véritable lady... le portrait vivant de ta mère... Eh bien, quand serai-je parrain ?
— Oh ! grand-père, je crains que ce ne soit jamais.
— Ne perds pas espoir... Prie le bon Dieu... Et toi, Anna, tu n’as pas du tout changé... À soixante ans... tu seras encore... pétulante comme une libellule... Mais attendez, que je vous présente mes officiers...
— Il y a longtemps que j’ai eu cet honneur ! dit en s’inclinant le colonel Ponamariov.
— J’ai déjà été présenté à la princesse à Pétersbourg, fit de son côté le hussard.
— Dans ce cas-là, Ania, je te présente le lieutenant Bakhtinskiï, danseur et tapageur, mais excellent cavalier. Bakhtinskiï, mon bon, retire donc de la voiture... là, c’est cela... parfait... En route, mes enfants... Que vas-tu nous faire manger, Véra ?... Depuis ma cure... j’ai un appétit... de sous-lieutenant...
Le général Anossov, ami dévoué du feu prince Mirza Boulat-Touganovskiï, avait, à la mort de celui-ci, reporté toute sa chaude amitié sur les filles de son vieux camarade. Il les connaissait depuis leur plus tendre enfance et avait même été parrain d’Anna. À cette époque il était — tout comme aujourd’hui — gouverneur de K..., grande forteresse à moitié déclassée, et fréquentait quotidiennement les Touganovskiï. Les enfants l’adoraient pour ses gâteries, ses cadeaux, ses loges au cirque et au théâtre, et les jeux entraînants auxquels, mieux que personne, il les initiait. Mais ce qui les enchantait le plus et laissait dans leur mémoire les plus fortes impressions, c’étaient ses récits de campagnes, de batailles, de campements au bivouac, de victoires et de retraites, de morts, de blessures, de froids rigoureux — lentes histoires d’allure tranquillement épique, racontées entre le thé du soir et l’heure détestée où l’on envoie les enfants dormir.
À la jauge de nos mœurs actuelles, ce débris du passé paraît une figure gigantesque et étrangement pittoresque. En lui fusionnaient harmonieusement ces traits simples, mais touchants et profonds, qui, même de son temps, étaient plus rares chez les soldats que chez les officiers, ces traits purement russes, rudes et frustes, dont la réunion compose une noble figure, rend notre soldat invincible et en fait un martyr et presque un saint, — ces traits consistant en une foi simple et naïve, une manière d’envisager gaiement et tout bonnement la vie, un courage froid et résolu, une humble résignation devant la mort, une pitié généreuse envers les vaincus, une patience infinie, et une incroyable endurance physique et morale.