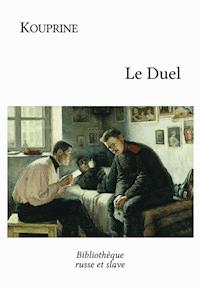
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliothèque russe et slave
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Romachov, jeune sous-lieutenant d'un régiment en garnison dans une ville de province, rêve d'une haute carrière mais se heurte aux violences de la vie quotidienne au sein de l'armée et à la vie provinciale dont la médiocrité l'écœure. Il ne trouve de lumière que dans son amour encore platonique pour Chourotchka, la femme d'un autre officier. Publié en 1905, peu après la fin de la guerre russo-japonaise, ce roman qui valut la célébrité à son auteur, lui-même ancien officier, fut perçu comme une critique sévère de l'armée russe et de sa décomposition.
Traduction du russe et introduction par Henri Mongault, 1922.
EXTRAIT
L'exercice du soir de la 6e compagnie tirait à sa fin ; les officiers subalternes regardaient leurs montres de plus en plus fréquemment et avec une impatience croissante. La compagnie s’initiait à la pratique du service de place. Les soldats étaient disséminés sur tout le terrain d’exercices : le long des peupliers bordant la route, à côté des appareils de gymnastique, devant les portes de l’école régimentaire, auprès des chevalets de pointage. Ils étaient supposés de faction devant une poudrière, devant le drapeau, devant un corps de garde, auprès de la caisse du régiment. Les caporaux de pose circulaient entre ces pseudo-postes et plaçaient les sentinelles ; on faisait la relève de la garde ; les sous-officiers inspectaient les postes et s’assuraient si leurs hommes connaissaient bien la consigne, en cherchant, tantôt à prendre par ruse le fusil aux sentinelles, tantôt à les obliger à quitter leur faction, tantôt à leur remettre en garde un objet quelconque, généralement leur propre casquette.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Alexandre Ivanovitch Kouprine, né le 26 août 1870 à Narovtchat et mort le 25 août 1938 à Léningrad, est un écrivain russe, aviateur, explorateur et aventurier qui est notamment connu pour son roman
Le Duel publié en 1905.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE
— LITTÉRATURE RUSSE —
Alexandre Kouprine
Куприн Александр Иванович
1870 — 1938
LE DUEL
Поединок
1905
Traduit du russe et introduction par Henri Mongault, Paris, Bossard, 1922.
© La Bibliothèque russe et slave, 2014
© Henri Mongault, 1922
Couverture : Leonid PASTERNAK, Nouvelles de la patrie (1899)
Chez le même éditeur — Littérature russe
1. GOGOLLes Âmes mortes. Traduction d’Henri Mongault
2. TOURGUENIEVMémoires d’un chasseur. Traduction d’Henri Mongault
3. TOLSTOÏLes Récits de Sébastopol. Traduction de Louis Jousserandot
4. DOSTOÏEVSKIUn joueur. Traduction d’Henri Mongault
5. TOLSTOÏAnna Karénine. Traduction d’Henri Mongault
6. MEREJKOVSKILa Mort des dieux. Julien l’Apostat. Traduction d’Henri Mongault
7. BABELCavalerie rouge. Traduction de Maurice Parijanine
8. KOROLENKOLe Musicien aveugle. Traduction de Zinovy Lvovsky
9. KOUPRINELe Duel. Traduction d’Henri Mongault
10. GOGOLLe Révizor — Le Mariage. Traduction de Marc Semenoff
11. DOSTOÏEVSKIStépantchikovo et ses habitants. Traduction d’Henri Mongault
12. Les Bylines russes. Édition de Louis Jousserandot
13. PISSEMSKIMille âmes. Traduction de Victor Derély
14. RECHETNIKOVCeux de Podlipnaïa. Traduction de Charles Neyroud
15. TOURGUENIEVPoèmes en prose. Traduction de Charles Salomon
PRÉFACE
En 1909, lors des fêtes du centenaire de Gogol, j’eus l’honneur d’être reçu à Moscou par Melchior de Vogüé. La conversation vint à tomber sur la nouvelle littérature russe. « Je me fais vieux et ne lis plus guère, me dit l’éminent critique — il devait mourir l’année suivante — ; cependant, pour charmer les loisirs du monotone voyage de la frontière allemande à Moscou, j’ai acheté un livre qui m’a produit une très vive impression. Ou je me trompe fort, ou une nouvelle étoile se lève au firmament des lettres russes. » Et il me tendit le roman, dont, aujourd’hui, la traduction intégrale est offerte au public français.
Alexandre Ivanovitch Kouprine est né en 1870 à Narovtchate, petite ville du gouvernement de Penza, où son père occupait un modeste emploi de fonctionnaire. Sa mère, née princesse Kalountchakov, appartenait à une famille tatare, très ancienne, mais appauvrie dès le règne de Pierre le Grand. Il perdit son père à trois ans. La famille vint habiter Moscou, où Kouprine passa son enfance. Il y fut élevé, d’abord au Corps des Cadets, puis à l’École Militaire Alexandre, dont les élèves devaient, en octobre 1917, se battre héroïquement pendant une semaine contre les insurgés bolchevistes. En 1890 il fut nommé sous-lieutenant au 46ede ligne, dit régiment du Dnièpre, qui tenait garnison à Proskourov, sordide bourgade de Petite-Russie, dont le Duel évoque l’incommensurable ennui. Quatre ans après, il démissionnait. Il avoue avoir regretté plus d’une fois par la suite que « le mirage de la gloire ait vaincu en lui l’esprit de corps », surtout lorsque le 46e se fut couvert de gloire pendant la grande guerre. Ce régiment fit, en effet, partie de la division, qui, laissée en arrière-garde pour couvrir la retraite des Carpathes en 1916, se défendit à coups de pierres, faute de cartouches !
Mais M. Kouprine ne pouvait plus résister aux appels tentateurs du démon littéraire, dont il était, depuis longtemps, possédé. Dès 1889, en effet, encore élève de l’École Militaire, il avait fait paraître dans un journal illustré de Moscou sa première nouvelle, ce qui lui valut une punition disciplinaire, pour n’avoir pas demandé à ses chefs l’autorisation de la publier. Il a raconté l’aventure avec beaucoup d’humour (Mon Premier-né). Cependant, à sa sortie du régiment, il ne s’adonna pas tout d’abord exclusivement aux lettres ; mais, doué d’un talent profondément réaliste, il voulut connaître l’immense Russie avant de la décrire. Il se jeta dans le tourbillon de la vie et, pendant quelques années, exerça maintes professions. Plutôt par curiosité que par besoin, il fut successivement journaliste, correcteur d’imprimerie, instituteur, choriste, acteur, géomètre, agriculteur, etc... Ces divers avatars ont laissé des traces dans ses ouvrages, où passent, extraordinairement vivants, une multitude de types que cette existence mouvementée lui permit d’étudier. Son œuvre plonge ses racines jusqu’au tuf même de la vie.
Cependant ses premières nouvelles attiraient sur lui l’attention du public : en 1900 il se consacrait définitivement à la carrière littéraire. Bientôt son roman Le Duel, publié pendant la guerre russo-japonaise (1904), et dans lequel on voulut — bien à tort — voir surtout un réquisitoire, lui valut la célébrité. En réalité, cette œuvre renfermait, dans le cadre d’une étude de mœurs militaires, une curieuse analyse psychologique, qui fait parfois songer à Stendhal.
Depuis lors, M. Kouprine devint un des écrivains les plus lus et les plus aimés du public russe et ses œuvres furent traduites dans toutes les langues de l’Europe.
Un second roman, La Fosse (1912), où il développait le thème magistralement esquissé dans la Maison Tellier, établissait définitivement sa renommée auprès du grand public, tandis qu’une belle évocation biblique, La Sulamite (1909), — une des rares œuvres russes où se ressente l’influence du Titan Flaubert — la consacrait parmi les lettrés. Une récente réédition de ce poème de pourpre et d’or donnait occasion au grand poète Balmont de le saluer comme une des pages les plus parfaites de la langue russe et de le comparer à « un cheval fougueux, un vin généreux, ou encore à une fleur somptueuse, baignée par le soleil estival, alors que la chaleur est encore ardente, mais que se devinent déjà d’angoissantes taches rouges parmi l’émeraude des feuilles ».
Cet Hymne triomphal à l’amour et à la mort trouvait dans le Bracelet de Grenats (1912) un beau pendant moderne, moins coloré, mais peut-être plus angoissant, parce que plus près de nous.
C’est en effet dans la nouvelle de mœurs et le conte qu’excelle principalement M. Kouprine. Il a atteint en ce genre une maîtrise telle qu’on peut l’appeler le Maupassant russe, mais un Maupassant moins distant, moins cruel, plus sensible à la pitié et à la douleur humaines. Il s’intéresse à toutes les manifestations de la vie. Ses récits nous mènent dans toutes les parties de la vaste Russie — avec toutefois une prédilection marquée pour la Russie occidentale et méridionale — et font défiler devant nous des représentants de tous les mondes : aristocrates (Le Bracelet de Grenats) ; hommes d’affaires (Moloch) ; officiers (L’Enseigne de Ligne) ; soldats (La Relève de Nuit) ; juifs (La Juive, La Noce) ; marins (Gambrinus) ; paysans d’Ukraine (Au Fond des Forêts) ; pêcheurs de Crimée (Les Lestrigons) ; petits fonctionnaires (Menuaille) ; acteurs (Comment je devins Acteur, Au Cirque) ; journalistes, etc... Les gens en marge de la société ont une large place en cette galerie si variée : espions (Le Capitaine Rybnikov) ; contrebandiers (Un Lâche) ; voleurs (Les Voleurs de Chevaux) ; filous (Le Disciple) ; sorcières (Olessia, — une Petite Fadette ukrainienne) ; prostituées. En fait, c’est aux petites gens, aux humbles, aux déshérités que vont ses sympathies. Celles-ci ne sont d’ailleurs jamais exprimées avec fracas, comme par exemple chez Gorki ; l’émotion n’est sollicitée par aucun artifice et sort tout entière du récit mené le plus souvent d’après la pure formule classique : action ramassée, étudiée dans sa crise. Parfois même c’est dans la demi-teinte que Kouprine obtient ses effets les plus poignants : dans ce sens le court récit intitulé En Famille et qu’admirait tant Tolstoï, est un véritable chef-d’œuvre.
Kouprine adore les enfants, pour qui il a écrit des contes ravissants (Le Caniche Blanc), les bêtes, qu’il a étudiées avec la même profondeur psychologique que leurs frères humains (Émeraude), la chasse, dont il nous donne de savoureuses descriptions (La Chasse aux Tétras), la nature, qu’il dépeint dans toute son œuvre avec une chaude richesse de tons. Il se plaît à séjourner à la campagne, avec ses chiens, parmi les fleurs, et préfère qu’on le complimente de ses succès d’horticulteur que de ses triomphes d’écrivain. Bon vivant, joyeux convive, il sait rire, don bien rare chez ses compatriotes ; et c’est pourquoi certaines de ses nouvelles (La Rougeole, Le Foudre, Comment je devins Acteur) sont si franchement amusantes.
Depuis quelque temps, M. Kouprine se sent attiré vers la nouvelle scientifique (Le Soleil Liquide), et écrit en ce moment un roman sur les débuts de l’aviation. L’occultisme l’a même tenté, et dans l’une de ses dernières œuvres (L’Étoile de Salomon), il s’est essayé à montrer combien apparaît indécise la limite qui sépare le rêve de la réalité.
Acuité de l’observation, ingéniosité de l’imagination, science de la composition, amour profond de la nature, haute conception de l’art, pitié simple et sans affectation, humour, franche gaieté, telles sont les qualités dominantes, grâce auxquelles M. Kouprine est si parfaitement accessible au public français. Enfin bien qu’il ne se départe jamais d’un strict objectivisme, une cordialité particulière, charmante, prenante, donne le ton à toute son œuvre. Peut-être apparaîtra-t-elle à travers les imperfections de la traduction.
H. M.
Alexandre KOUPRINE
I
L’EXERCICE du soir de la 6e compagnie tirait à sa fin ; les officiers subalternes regardaient leurs montres de plus en plus fréquemment et avec une impatience croissante. La compagnie s’initiait à la pratique du service de place. Les soldats étaient disséminés sur tout le terrain d’exercices : le long des peupliers bordant la route, à côté des appareils de gymnastique, devant les portes de l’école régimentaire, auprès des chevalets de pointage. Ils étaient supposés de faction devant une poudrière, devant le drapeau, devant un corps de garde, auprès de la caisse du régiment. Les caporaux de pose circulaient entre ces pseudo-postes et plaçaient les sentinelles ; on faisait la relève de la garde ; les sous-officiers inspectaient les postes et s’assuraient si leurs hommes connaissaient bien la consigne, en cherchant, tantôt à prendre par ruse le fusil aux sentinelles, tantôt à les obliger à quitter leur faction, tantôt à leur remettre en garde un objet quelconque, généralement leur propre casquette. Les anciens soldats, qui connaissaient mieux cette casuistique facétieuse, répondaient, dans ces différents cas, sur un ton des plus rébarbatifs : « Au large ! Je n’ai le droit de donner mon fusil à personne, sauf si j’en reçois l’ordre de Sa Majesté l’Empereur lui-même. » Mais les jeunes soldats s’embrouillaient. Ils ne savaient pas encore discerner les plaisanteries, les exemples, des véritables exigences du service, et ils passaient d’un extrême à l’autre.
— Khliebnikov ! diable de maladroit, criait le petit caporal Chapovalenko, alerte et rondelet, — et le timbre de sa voix indiquait qu’il souffrait, en sa qualité de gradé, de la maladresse de son subordonné, — combien de fois t’ai-je dit ce que tu avais à faire, imbécile ! De qui sont les ordres que tu viens d’exécuter ? Est-ce de celui que tu as arrêté ? Que le diable te... Réponds, pourquoi as-tu été mis en faction ?
Au troisième peloton il se produisit un incident sérieux. Le jeune soldat Moukhamedjinov, un Tatare, qui comprenait et parlait à peine le russe, était absolument déconcerté par les facéties de ses chefs — le réel et l’imaginaire. Il entra soudain en fureur, croisa la baïonnette et répondait à toutes les exhortations et à tous les ordres ces seuls mots péremptoires :
— Je vous embroche.
— Arrête, imbécile..., tâchait de lui faire entendre raison le sous-officier Bobylev. Tu sais bien qui je suis ? Je suis ton chef de poste ; par conséquent...
— Je vous embroche ! cria le Tatare d’un air effaré et méchant, les yeux injectés de sang et menaçant nerveusement de sa baïonnette quiconque l’approchait. Autour de lui avaient formé le cercle un certain nombre de soldats enchantés de cet incident comique qui leur permettait de se reposer une minute pendant leur fastidieux exercice.
Le commandant de la compagnie, capitaine Sliva, alla se rendre compte de ce qui se passait. Tandis qu’il gagnait d’un pas nonchalant, courbé et traînant les jambes, l’autre extrémité du terrain d’exercices, les officiers subalternes se réunissaient pour bavarder et fumer. Ils étaient trois : le lieutenant Vietkine, garçon de trente-trois ans, chauve, portant moustache, bon vivant, beau parleur, gai chanteur et franc ivrogne ; le sous-lieutenant Romachov, qui n’avait pas deux ans de présence au régiment, et le sous-enseigne Lbov, svelte et pétulant gamin aux yeux malicieux, caressants et bêtas, avec un éternel sourire sur des lèvres épaisses et naïves, et qui semblait tout farci de vieilles anecdotes de garnison.
— Quelle cochonnerie ! dit Vietkine, en jetant un coup d’œil sur sa montre en maillechort dont il referma rageusement le couvercle. Pourquoi diable retient-il la compagnie si longtemps ? Idiot !
— Mais si vous lui expliquiez cela à lui-même, Pavel Pavlytch ? conseilla Lbov d’un air futé.
— Eh diable ! allez le lui expliquer vous-même... Ce qu’il y a de certain, c’est que tout cela est inutile. Ils se démènent toujours avant les inspections. Ils font du zèle. Ils agacent le soldat, le tourmentent, le font tourner en Turc, et à l’inspection il restera planté comme une souche. Vous connaissez cette histoire de deux commandants de compagnie qui se disputaient pour savoir lequel de deux soldats appartenant respectivement à leurs unités mangerait le plus de pain. Ils choisirent deux gloutons réputés. L’enjeu du pari était important : une centaine de roubles, je crois. L’un des deux soldats mangea sept livres de pain et en resta là ; il ne pouvait plus en avaler davantage. Le capitaine s’en prit sur-le-champ au sergent-major : « Dis donc, toi, espèce de..., tu m’as fourré dedans ? » Le sergent-major, fixant les yeux, répondit : « Je ne puis savoir, Votre Haute Noblesse, ce qui lui est arrivé. Ce matin ; nous avons fait une répétition, il a bouffé huit livres en une seule séance. » Il en est de même de nos hommes... Ils répètent d’une façon stupide, et lors de l’inspection ils resteront cois.
— Hier... (Lbov éclata soudain de rire) hier, lorsque les exercices étaient déjà finis dans toutes les compagnies, je rentrais chez moi vers huit heures, il faisait complètement nuit. Je vis qu’à la 11e compagnie on faisait une théorie sur les sonneries. Les hommes psalmodiaient en chœur : « Pointez ! à hauteur de la poitrine-ti-rez ! » Je dis au lieutenant Androussévitch : « Pourquoi fait-on encore chez vous pareille musique ? » Il me répondit : « Nous sommes comme les chiens, nous aboyons à la lune. »
— Tout m’embête ! Zut ! bâilla Vietkine. Tiens, quel est ce cavalier ? C’est Bek, il me semble ?
— Mais oui, c’est Bek-Agamalov, confirma Lbov qui avait la vue perçante. Comme il se tient à cheval !
— Très bien, acquiesça Romachov. À mon avis il monte mieux que n’importe quel officier de cavalerie. Ho ! ho ! ho ! son cheval se met à danser. Bek fait des manières.
Sur la route passait lentement à cheval un officier en gants blancs et en uniforme d’adjudant-major. Il montait un grand et long alezan avec une queue courte, à l’anglaise. Le cheval s’échauffait, secouait avec impatience son cou rassemblé par le mors et faisait de fréquents changements de pieds.
— Pavel Pavlytch, Bek est-il vraiment Tcherkesse ? demanda Romachov à Vietkine.
— Je crois que oui. Parfois en effet on voit des Arméniens se faire passer pour des Tcherkesses et des Lezghiens ; mais Bek, il me semble, n’est pas menteur. Non, mais regardez comme il se tient à cheval !
— Attendez, je vais l’appeler, dit Lbov.
Il se fit un porte-voix de ses mains et cria d’un voix étouffée pour n’être pas entendu du commandant de compagnie.
— Lieutenant Agamalov ! Bek !
Le cavalier entendit l’appel, tira les rênes de sa monture, s’arrêta une seconde et regarda à droite. Puis, faisant tourner son cheval de ce côté et se courbant légèrement sur sa selle, il sauta avec souplesse le fossé et se dirigea au petit galop vers les officiers.
Il était d’une taille inférieure à la moyenne, maigre, bien musclé et très vigoureux. Son visage, au front fuyant, au nez fin et busqué, aux lèvres fortes et décidées, était mâle et beau et n’avait pas encore perdu la pâleur caractéristique de l’Orient, pâleur à la fois mate et basanée.
— Bonjour, Bek, dit Vietkine. Devant qui paradais-tu là-bas ? Devant des demoiselles ?
Bek-Agamalov serra la main à chacun des officiers, en se penchant négligemment. Il sourit et ses dents blanches et serrées parurent jeter un éclat de lumière sur tout le bas de son visage et sur ses petites moustaches noires bien soignées...
— Deux jolies petites Juives se promenaient là-bas. Mais que m’importe ! Je n’y fais pas attention.
— Nous savons que vous jouez aux dames d’une manière pitoyable ! dit Vietkine en secouant ironiquement la tête.
— Écoutez, Messieurs, — commença Lbov en riant d’avance de ce qu’il allait dire. Vous savez que le général Dokhtourov a dit des officiers d’ordonnance d’infanterie — tu entends, Bek, c’est à toi que ce discours s’adresse — que c’étaient les plus hardis cavaliers du monde...
— Ne blague pas, fendrik1, interrompit Bek-Agamalov, en poussant son cheval d’une pression de bottes et faisant mine de foncer sur le sous-enseigne.
— Parole d’honneur ! Ce ne sont pas des chevaux qu’ils ont, prétendait Dokhtourov, mais des guitares, des armoires, des bêtes poussives, boiteuses, borgnes, fourbues. Et pourtant, dès qu’ils reçoivent un ordre, ils partent à fond de train et lâchant les rênes, abandonnant les étriers, perdant leur casquette, franchissent au grand galop tous les obstacles, palissades, ravins ou fourrés. Oui, ce sont d’intrépides cavaliers !
— Qu’y a-t-il de neuf, Bek ? — interrogea Vietkine.
— Ce qu’il y a de neuf ? Rien, si ce n’est que je viens de voir le colonel attraper le lieutenant-colonel Lekh au mess des officiers. Il s’est emporté à tel point contre lui qu’on l’entendait sur la place de l’Église. Lekh était ivre comme une grive ; il ne pouvait dire ni papa ni maman. Il restait cloué sur place et chancelait, les mains derrière le dos. Mais Choulgovitch rugissait : « Quand vous parlez à votre colonel, veuillez ne pas garder les mains sur votre derrière ! » Et il y avait là des domestiques.
— Bien vissé, dit Vietkine, dans un sourire mi-ironique, mi-approbatif. À la 4e compagnie, il criait, dit-on, hier : « Pourquoi me fichez-vous le règlement sous le nez ? C’est moi qui suis le règlement pour vous, et pas de réplique ! je suis ici le Tsar et Dieu ! »
De nouveau Lbov se mit soudain à rire de ses propres pensées.
— Encore une chose, messieurs, l’adjudant-major du...e régiment a eu une histoire...
— Muselez-vous, Lbov, lui déclara sérieusement Vietkine. Qu’est-ce qui vous prend aujourd’hui ?
— Il y a une autre nouvelle, continua Bek-Agamalov. — Il tourna de nouveau son cheval dans la direction de Lbov et fonça sur lui par manière de plaisanterie. La bête secoua la tête et s’ébroua en épandant de l’écume autour d’elle. — Il y a encore une nouvelle. Le colonel exige que dans toutes les compagnies les officiers s’exercent au maniement du sabre sur des mannequins. À la 9e compagnie il leur a flanqué une belle frousse. Il a fourré Epifanov aux arrêts parce que son sabre n’était pas aiguisé. N’aie donc pas peur, fendrik ! — s’emporta soudain Bek-Agamalov contre le sous-enseigne. Il faut bien que tu t’habitues. Tu seras aussi un jour officier d’ordonnance et tu auras à cheval la contenance d’un moineau rôti sur un plat.
— Eh ! espèce d’Asiatique ! Va te promener avec ta vieille haridelle, rétorqua Lbov, en repoussant le museau du cheval. — À propos, Bek, connais-tu l’histoire de cet officier d’ordonnance du...e régiment qui avait acheté un cheval de cirque ? Il le montait un jour de revue, la bête se mit à défiler devant le commandant en chef en dansant le pas d’Espagne, tu sais : en levant les pieds et en chaloupant. Finalement elle se précipita dans la compagnie de tête : tu vois d’ici la confusion, les cris, le désordre. Mais le cheval ne voulait rien savoir et continuait allègrement son pas d’Espagne. Alors Dragomirov se fit un porte-voix de ses mains — tiens, comme cela — et cria : « Lieutenant, veuillez filer à la même allure au corps de garde, pour 21 jours ; en avant ma..rche ! »
— Hé ! bêtises ! — fit Vietkine en se renfrognant. Écoute, Bek, ta nouvelle de l’exercice du sabre sur des mannequins est réellement une surprise pour nous. Qu’est-ce que cela signifie ? Alors il ne nous restera plus le moindre loisir ? D’ailleurs on nous a apporté hier ce monstre.
Il montra le milieu du terrain d’exercices où se dressait un mannequin en terre glaise humide, et qui avait une certaine ressemblance avec une silhouette humaine, mais était dépourvu de bras et de jambes.
— Et alors ? vous avez sabré ? demanda avec curiosité Bek-Agamalov. Romachov, vous n’avez pas essayé ?
— Pas encore.
— Moi non plus ! grommela Vietkine — qu’ai-je besoin de m’occuper de ces idioties ? d’ailleurs, je n’en ai pas le temps. De neuf heures du matin à six heures du soir, on est cloué ici. C’est à peine si on a le temps de bouffer et d’avaler un verre de vodka2. Dieu merci ! je n’entends pas être traité en gamin...
— Eh, bougre d’original, ne faut-il pas qu’un officier sache se servir de son sabre ?
— Et pourquoi, s’il vous plaît ? Pour la guerre ? Avec les armes à tir rapide d’aujourd’hui, on ne te laissera pas approcher à cent pas, à quoi diable te servira ton sabre ? Je ne suis pas un officier de cavalerie. En cas de besoin, je prendrai plutôt mon fusil et, avec la crosse, pan, pan, sur les caboches. C’est plus sûr.
— C’est bien, mais en temps de paix ? Peut-on prévoir ce qui peut arriver ? Une émeute, une insurrection, ou bien...
— Eh bien, quoi ? À quoi me servira mon sabre ? Je ne me livrerai pas à la sale besogne de fendre les têtes des gens ! « Compagnie... feu ! » et l’affaire est dans le sac...
Bek-Agamalov prit un air mécontent.
— Allons, tu dis toujours des sottises, Pavel Pavlytch. Réponds sérieusement. Tu es en promenade ou au théâtre, ou bien, par exemple, tu te trouves au restaurant et quelque pékin t’insulte, ou même — prenons un cas extrême — te donne un soufflet. Que feras-tu ?
Vietkine haussa les épaules et serra dédaigneusement les lèvres.
— Hum ! en premier lieu, aucun pékin ne me frappera, parce qu’on ne frappe que celui qui a peur d’être frappé. En second lieu... que ferai-je ? Je lui enverrai une balle de revolver.
— Et si tu as laissé ton revolver chez toi ? demanda Lbov.
— Hum, diable... alors j’irai le chercher... Ce n’est pas plus malin que cela. On avait un jour insulté un cornette dans un café-chantant ; il se fit conduire chez lui en fiacre, rapporta son revolver et tua deux pékins. Et voilà tout !...
Bek-Agamalov secoua la tête avec dépit.
— Je sais, j’en ai entendu parler. Toutefois, le conseil de guerre reconnut qu’il avait agi avec préméditation et le condamna. Qu’y a-t-il de bien là dedans ? Non, si quelqu’un m’insultait ou me frappait...
Il n’acheva pas la phrase, mais sa petite main qui tenait les rênes se referma si fortement qu’elle en trembla. Lbov fut soudain secoué d’un rire éclatant.
— Encore ! dit sévèrement Vietkine.
— Messieurs... je vous prie... ha, ha, ha ! Au régiment de M... il y eut une histoire. Le sous-enseigne Kraouzé fit un scandale au club de la noblesse. Alors le maître d’hôtel l’empoigna par la patte d’épaule qu’il arracha presque complètement. Aussitôt Kraouzé sortit son revolver et... pan, dans la tête ! tué raide ! sur place. Un sale petit avocat intervint et sur lui aussi... pan ! Naturellement tout le monde se dispersa ; Kraouzé rentra tranquillement au camp et se dirigea du côté du drapeau, sur le front de bandière. La sentinelle cria : « Qui vive ! » — « Sous-enseigne Kraouzé, qui vient mourir sous les plis du drapeau ! » Il se coucha et se transperça le bras d’un coup de revolver. Il fut acquitté par le conseil de guerre.
— Fameux gaillard ! dit Bek-Agamalov.
La conversation commençait à rouler sur le thème favori des jeunes officiers, c’est-à-dire sur les vengeances tirées séance tenante, sans préméditation, meurtres qui restaient presque toujours impunis. Dans une toute petite ville, un cornette imberbe en état d’ivresse s’était jeté, le sabre à la main, au milieu d’un groupe d’Israélites qui célébraient la Pâque. À Kiev, un sous-lieutenant d’infanterie avait, dans une salle de danse, mortellement frappé de son sabre un étudiant qui l’avait heurté du coude au buffet. Dans certaine grande ville — autre que Moscou et Pétersbourg — un officier avait tué d’un coup de feu, « comme un chien », un civil qui, au restaurant, lui faisait remarquer que les gens bien élevés n’importunaient pas les dames qu’ils n’avaient pas l’honneur de connaître.
Romachov, qui, jusqu’alors, avait gardé le silence, rougit soudain de confusion, rajusta sans nécessité ses lunettes, toussota et se mêla à la conversation.
— Messieurs, voici ce que, de mon côté, je crois devoir ajouter : quand il s’agit d’un maître-d’hôtel... oui... parfaitement... Mais s’il s’agit d’un civil... comment dirai-je ?... Oui... allons... s’il s’agit d’un homme bien élevé, d’un noble... Pourquoi donc tomberais-je avec mon sabre sur un individu désarmé ? Pourquoi ne pourrais-je pas lui demander une réparation ? Malgré tout, nous sommes des gens cultivés, si je puis m’exprimer ainsi...
— Hé ! vous dites des absurdités, Romachov, interrompit Vietkine. Vous lui demanderez une réparation, mais il vous répondra : « Non, hé, hé, hé... Moi, ... vous savez, en principe, hé, hé... je n’admets pas le duel ! Je suis un adversaire des effusions de sang... Et, en outre, hé, hé... nous avons un juge de paix... » Voilà, et vous garderez toute votre vie votre gifle.
Bek-Agamalov sourit de son large sourire rayonnant.
— Ah bah ! tu es de mon avis ! Je te le dis, Vietkine ; apprends à sabrer. Chez nous, au Caucase, tout le monde s’y exerce dès l’enfance, sur des baguettes, sur des cadavres de mouton, sur de l’eau.
— Et sur les hommes ? ajouta Lbov.
— Et sur les hommes, répondit avec calme Bek-Agamalov. Et il faut voir comme on sabre bien ! D’un seul coup on fend un homme de l’épaule à la hanche, en biais. C’est ce qui s’appelle un coup ! Autrement cela ne vaut pas la peine de se salir les mains.
— Et toi, Bek, es-tu capable d’en faire autant ?
Bek-Agamalov poussa un soupir de regret.
— Non, je n’en suis pas capable... je coupe un jeune agneau en deux... je me suis aussi essayé sur le cadavre d’un veau... mais un homme... ma foi, non... je ne pourrais pas. J’enverrais sa tête voler au diable, je le sais ; mais comme cela, en biais... non. Mon père le faisait facilement...
— Eh bien, messieurs, allons essayer, supplia Lbov dont les yeux s’enflammèrent. Bek, mon ami, je vous en prie, allons...
Les officiers s’approchèrent du mannequin. Vietkine frappa le premier. Donnant une expression de férocité à son visage bon et niais, il fit gauchement avec son sabre un large moulinet et l’abattit de toutes ses forces sur le mannequin. En même temps sa gorge émit instinctivement le son caractéristique — khrias ! — qui échappe aux bouchers lorsqu’ils hachent de la viande. La lame s’enfonça d’une quinzaine de centimètres dans la terre glaise, et Vietkine l’en retira avec difficulté.
— Mauvais ! opina Bek-Agamalov en secouant la tête. À vous, Romachov.
Romachov tira son sabre du fourreau et, tout décontenancé, rajusta ses lunettes. Il était de taille moyenne, maigre et, bien qu’assez vigoureux, étant donné sa constitution physique, une excessive timidité le rendait maladroit. Il n’avait jamais été fort en escrime même pendant ses années d’école et, depuis un an et demi qu’il servait au régiment, il avait complètement oublié cet art. En levant le sabre au-dessus de sa tête, il porta en même temps, instinctivement, son bras gauche en avant.
— Le bras, lui cria Bek-Agamalov.
Mais il était trop tard. L’extrémité de son sabre ne fit qu’effleurer le mannequin. Comme Romachov s’attendait à une grande résistance, il perdit l’équilibre et vacilla. Le tranchant du sabre, frappant sa main gauche tendue en avant, lui déchira un lambeau de peau à la naissance de l’index. Le sang jaillit.
— Hé ! vous voyez ! s’écria d’un ton de dépit Bek-Agamalov, en descendant de cheval. C’est ainsi qu’on pourrait se trancher la main. Est-il possible aussi, de manier un sabre de cette façon ? Enfin, ce n’est rien, un simple bobo ; serrez fortement votre mouchoir autour de votre main, petite pensionnaire ! Tiens mon cheval, fendrik. Maintenant, vous allez voir. Le point capital, pour donner un coup de sabre, c’est de faire agir, non pas l’épaule ou le coude mais l’articulation du poignet. — Il fit tourner rapidement plusieurs fois le poignet de sa main droite et la lame de son sabre décrivit au-dessus de sa tête un cercle étincelant.
— Et maintenant, regardez, ajouta-t-il. Je place mon bras gauche derrière mon dos. Quand on donne un coup, il ne faut chercher ni à battre, ni à trancher l’objet, il faut agir comme si on sciait quelque chose, en retirant le sabre en arrière... vous comprenez ? Et surtout n’oubliez pas que le plat de la lame doit absolument être incliné par rapport à la surface à sabrer ; c’est indispensable. En agissant ainsi, vous obtenez un angle plus aigu. Tenez, voyez.
Bek-Agamalov recula à deux pas du mannequin, le visa de son regard perçant, puis, soudain, il fit scintiller son sabre très haut en l’air et, le corps tout entier penché en avant, dans un mouvement si rapide que les yeux éblouis avaient peine à suivre, il asséna un coup fulgurant. Romachov n’entendit que le sifflement aigu de l’air coupé par la lame d’acier et, au même instant, la moitié supérieure du mannequin s’effondra lourdement sur le sol. La surface coupée était aussi lisse que si elle avait été polie.
— Ah, diable ! voilà un coup ! s’exclama Lbov enthousiasmé. Bek, mon cher, recommence, je te prie.
— Mais oui, Bek, recommence, demanda Vietkine.
Mais Bek-Agamalov, craignant de gâter l’effet qu’il venait de produire, remit, en souriant, son sabre au fourreau. Il respirait difficilement et, à ce moment, avec ses yeux méchants largement ouverts, avec son nez busqué et ses dents découvertes, il ressemblait à quelque oiseau de proie fier et rapace.
— Peut-on appeler ça un coup de sabre ? — dit-il avec un dédain affecté. À l’âge de soixante ans, mon père, au Caucase, tranchait le cou d’un cheval ! Il faut s’exercer constamment, mes enfants. Chez nous, voici comment on procède : on place une tige d’osier dans un étau et on la fend d’un coup de sabre, ou bien on laisse couler d’une certaine hauteur un mince filet d’eau et on le coupe. S’il ne se produit pas d’éclaboussures, c’est que le coup a été bien donné. Allons, Lbov, à toi, maintenant.
Le sous-officier Bobylev arriva en courant, tout effrayé, et dit à Vietkine :
— Votre Noblesse... le colonel arrive !
— Gaar-de à vous ! cria d’une voix forte, traînante et sévère le capitaine Sliva, de l’autre extrémité du terrain.
Les officiers se séparèrent à la hâte et rejoignirent leurs pelotons respectifs.
Une grande calèche massive arriva de la route sur le terrain d’exercices et s’arrêta. Le colonel descendit péniblement d’un côté, faisant incliner de son poids tout le coffre de la voiture, tandis que, de l’autre côté, sautait prestement à terre l’adjudant-major du régiment, le lieutenant Fédorovski, un élégant officier de haute taille.
— Bonjour, 6e ! dit le colonel d’une voix pleine et calme.
Les soldats, d’une façon bruyante et discordante, crièrent des différents angles de la place :
— Nous vous souhaitons une bonne santé, Votre Haute Noblesse !
Les officiers portèrent la main à la visière de la casquette.
— Je vous prie de continuer les exercices, dit le colonel, en s’approchant du peloton le plus voisin.
Le colonel Choulgovitch était de très mauvaise humeur. Il passait devant les pelotons, posait des questions aux soldats sur le service de place, et, de temps à autre, les invectivait, lançant d’effroyables jurons avec cette virtuosité qui, en de telles occasions, est le propre des vieux militaires blanchis sous le harnois. Le regard fixe et tenace de ses yeux durs, ternes et d’une pâleur sénile semblait hypnotiser les soldats qui le considéraient sans clignoter, respirant à peine, immobiles et remplis de terreur. Le colonel était un vieillard énorme, obèse et imposant. Son visage charnu, très large à la hauteur des pommettes, allait en se rétrécissant vers le front, et se terminait en bas par une épaisse barbe argentée en forme de pelle, ce qui lui donnait l’aspect d’un grand losange irrégulier. Ses sourcils gris se dressaient hirsutes et rébarbatifs. Il parlait, en n’élevant presque pas la voix, mais chaque son émis par cet organe peu ordinaire, fameux dans la division — et auquel, entre parenthèses, il était redevable de sa brillante carrière — était distinctement entendu aux endroits les plus éloignés du vaste terrain d’exercices et jusque sur la route.
— Qui es-tu ? demanda brusquement le colonel arrêté devant le jeune soldat Charafoutdinov qui se trouvait près de la palissade du gymnase.
— Le soldat Charafoutdinov de la 6e compagnie, Votre Haute Noblesse ! cria avec empressement et d’une voix enrouée le Tatare.
— Imbécile ! Je te demande à quel poste tu as été placé ?
Le soldat, décontenancé par l’apostrophe et par l’aspect courroucé du colonel, gardait le silence, se contentant de cligner des paupières.
— Eh bien ? dit le colonel en haussant la voix.
— Une sentinelle est... inviolable... bégaya le Tatare au hasard... Je ne sais pas, Votre Haute Noblesse, finit-il par déclarer franchement, posément.
Le visage bouffi du colonel se colora d’un rouge brique et ses sourcils en broussailles se hérissèrent. Il jeta un regard circulaire autour de lui et demanda brusquement :
— Quel est l’officier chargé du peloton ?
Romachov s’avança et porta la main à sa casquette.
— C’est moi, Monsieur le colonel.
— Ha ! ha ! sous-lieutenant Romachov, vous devez bien vous occuper de vos hommes ! Les genoux réunis ! hurla soudain Choulgovitch, en roulant des yeux. Quelle attitude avez-vous en présence de votre colonel ? Capitaine Sliva, je vous fais remarquer que votre officier subalterne ne sait pas se tenir devant un supérieur dans l’exercice de ses fonctions... Et toi, âme de chien, dit Choulgovitch, en se retournant vers Charafoutdinov, quel est ton colonel ?
— Je ne sais pas, répondit le Tatare avec tristesse, mais promptement et fermement.
— Heu ! Je te demande quel est ton colonel ? qui... mais c’est moi ! Tu comprends, moi, moi, moi, moi, moi !...
Et Choulgovitch en même temps se frappait plusieurs fois la poitrine de toutes ses forces avec la paume de sa main.
— Je ne peux pas savoir...
Le colonel s’empêtra dans une phrase longue de vingt mots et farcie d’injures cyniques.
— Capitaine Sliva, veuillez mettre immédiatement ce fils de chien au piquet avec le chargement complet sur le dos ; qu’il pourrisse sous les armes, le coquin ! Quant à vous, sous-lieutenant, vous songez plus aux jupons qu’au service. Vous valsez, vous lisez Paul de Kock... Vous appelez ça un soldat, vous ? dit-il en plantant son doigt sur les lèvres de Charafoutdinov. — C’est un être honteux, infâme, ignoble, mais ce n’est pas un soldat. Il ne connaît pas le nom de son colonel... Vous m’étonnez, sous-lieutenant !
Romachov regardait ce visage aux cheveux gris, rouge et irrité ; il sentait son cœur battre et ses yeux s’obscurcir sous le coup de l’outrage et de l’émotion... Et soudain, d’une façon presque inattendue pour lui-même, il dit d’une voix sourde :
— C’est un Tatare, monsieur le colonel. Il ne comprend pas le russe, et, de plus...
Instantanément, Choulgovitch pâlit, ses joues flasques s’enflèrent et ses yeux devinrent hagards et effrayants.
— Comment ? — rugit-il d’une voix si peu naturelle et si assourdissante que des gamins juifs qui étaient assis près de la route sur la clôture se dispersèrent comme une volée de moineaux. — Comment ? vous répliquez ? Taisez-vous ! Un blanc-bec, un fendrik se permet... Lieutenant Fédorovski, vous annoncerez à l’ordre d’aujourd’hui que j’inflige au sous-lieutenant Romachov quatre jours d’arrêts à la chambre pour ne pas comprendre la discipline. Je notifie au capitaine Sliva une sévère réprimande pour n’avoir pas su inculquer à ses officiers subalternes les vrais principes concernant les obligations du service.
L’adjudant-major salua d’un air respectueux et impassible. Sliva, qui s’était courbé, avait un visage de bois sans expression et conservait toujours sa main tremblante à la visière de la casquette.
— C’est honteux, capitaine Sliva, grommela Choulgovitch en se calmant peu à peu. Vous, un des meilleurs officiers du régiment, un vieux militaire, vous tolérez de pareilles négligences chez vos officiers ! Serrez-leur la vis, dressez-les sans vous gêner. Inutile de se gêner avec eux. Ce ne sont pas des demoiselles, que diantre ! Ils ne tomberont pas en pâmoison...
Il tourna le dos brusquement et se dirigea vers sa calèche, accompagné de l’adjudant-major. Tandis qu’il s’asseyait, que la voiture gagnait la route et disparaissait derrière le bâtiment de l’école régimentaire, un silence craintif, embarrassé, pesait sur la place.
— Eh bien, mon cher monsieur ! dit sèchement Sliva au bout de quelques minutes, avec mépris et malveillance, quand les officiers se furent séparés pour rentrer chez eux, la langue vous a démangé ! Vous auriez dû rester immobile et vous taire, même si le tonnerre était tombé sur vous ! Et maintenant j’ai une réprimande à l’ordre, à cause de vous. Pourquoi diable vous a-t-on envoyé dans ma compagnie ? Vous me rendez les mêmes services qu’une cinquième patte à un chien. Vous devriez encore sucer le sein de votre nourrice et non pas...
Il n’acheva pas sa phrase, agita le bras d’un geste las et, tournant le dos au jeune officier, s’en alla traînant la jambe, courbé et affaissé sur lui-même, pour regagner son logement crasseux de vieux célibataire. Romachov suivit du regard le dos étroit et long de son capitaine et, malgré l’amertume que lui causait l’affront récent qu’il avait reçu publiquement, il se sentit pris, au fond de son cœur, de pitié pour cet homme solitaire, grossier, privé de toute affection et n’aimant que deux choses au monde : avoir une compagnie bien tenue, et se saouler tous les soirs, « avant l’oreiller », comme disaient les vieilles badernes du régiment.
Et comme Romachov avait, comme beaucoup de très jeunes gens, la naïve et quelque peu ridicule habitude de songer à soi à la troisième personne et de s’appliquer des phrases de romans feuilletons, il prononça mentalement ces mots :
« Ses bons yeux expressifs se voilèrent d’un nuage de tristesse... »
1. De l’allemand fæhndrich (enseigne). Appellation ironique, quelque peu méprisante des praporchtchiki (enseignes), elle est même parfois donnée à d’autres jeunes officiers d’un grade plus élevé. — H. M.
2. Eau-de-vie. — H. M.
II
PAR pelotons, les soldats avaient regagné leurs chambrées et le terrain d’exercices était maintenant désert. Romachov resta un instant indécis sur la route. Ce n’était pas la première fois depuis dix-huit mois de service qu’il ressentait avec tristesse son isolement au milieu d’étrangers malveillants ou indifférents, et se demandait avec angoisse où et comment il passerait sa soirée. Il éprouvait une véritable répugnance à la seule pensée d’aller au mess ou de rentrer à son logis. À cette heure le mess était sûrement désert : deux sous-enseignes y jouaient sans doute sur un vieux petit billard, buvaient de la bière, fumaient, et à chaque carambolage faisaient assaut de jurons et d’obscénités ; dans les salles flottait une odeur persistante de gargote. Cela puait l’ennui !
— Je vais aller à la gare, se dit Romachov. Peu m’importe !
Il n’y avait pas un seul restaurant dans ce misérable trou de Juifs. Les clubs, aussi bien celui des militaires que celui des civils, étaient dans un pitoyable état d’abandon. Aussi la gare était-elle l’unique endroit où les habitants allaient assez souvent faire bombance, s’amuser et même jouer aux cartes. Des dames s’y rendaient aussi à l’heure du passage des trains, petite distraction à la profonde monotonie de la vie provinciale.
Romachov aimait lui aussi à assister le soir à l’arrivée du rapide qui s’arrêtait là pour la dernière fois avant de franchir la frontière prussienne. Il éprouvait un charme étrange à voir apparaître à un détour et se précipiter à toute vapeur vers la gare ce train, composé en tout de cinq wagons flambant neufs, dont les yeux de feu grandissaient rapidement, jetant devant eux sur les rails des taches lumineuses, et qui, déjà prêt à brûler la station, s’arrêtait instantanément dans un violent fracas, « tel un géant s’accrochant dans sa fuite à un rocher », songeait Romachov. Hors des wagons, joyeusement illuminés comme pour une fête, se précipitaient de belles dames, distinguées, pimpantes, parées d’extraordinaires chapeaux et de costumes suprêmement élégants, des civils impeccablement habillés, insouciants, sûrs d’eux-mêmes, au verbe haut, aux gestes dégagés, au rire indolent, s’entretenant en français ou en allemand. Aucun d’eux n’accorda jamais la moindre attention à Romachov, mais celui-ci voyait en eux un fragment d’un monde inabordable, raffiné et magnifique, où la vie est une réjouissance perpétuelle.
Huit minutes passaient. La cloche du départ tintait, la locomotive sifflait, et le train flamboyant reprenait sa marche. On éteignait à la hâte les feux des quais et du buffet. La gare se replongeait dans les ténèbres quotidiennes. Et Romachov suivait toujours d’un regard mélancolique la lanterne rouge qui se balançait derrière le dernier wagon, se muait peu à peu en une étincelle à peine perceptible et disparaissait enfin dans la nuit noire.
« Je vais à la gare », se dit Romachov. Mais un regard jeté sur ses chaussures le fit rougir de honte. C’étaient de lourdes galoches en caoutchouc comme en portaient tous les officiers du régiment, profondes de trente centimètres et enduites d’une couche de boue noire et épaisse comme de la pâte. La vue de son manteau ne descendant que jusqu’aux genoux à cause de la boue, effiloché du bas et dont les boutonnières graisseuses béaient lamentablement, lui arracha un soupir. La semaine précédente, lorsqu’il faisait les cent pas devant le rapide, il avait remarqué, à la portière d’un wagon de 1re classe, une fort belle dame, élancée, bien faite, habillée de noir. Comme elle était sans chapeau, Romachov eut le temps d’apercevoir, rapidement mais distinctement, son nez fin et régulier, ses délicieuses lèvres petites et épaisses, ses splendides cheveux noirs ondulés, qui, peignés en raie au milieu de la tête, retombaient sur les joues, cachant les tempes, les oreilles et l’extrémité des sourcils. Derrière son épaule apparaissait un grand jeune homme en veston clair, au visage arrogant et aux moustaches relevées en croc, qui ressemblait vaguement à Guillaume II. La dame aperçut également Romachov et il sembla à celui-ci qu’elle le considérait attentivement, ce qui lui fit prononcer mentalement à son habitude : « Les yeux de la belle inconnue s’arrêtèrent avec plaisir sur la taille élancée du jeune officier. » Mais quand, au bout de dix pas, Romachov se fut retourné pour rencontrer encore une fois le regard de la belle dame, il s’aperçut qu’elle et son compagnon riaient de bon cœur en le regardant s’éloigner. Alors Romachov se représenta soudain avec une précision frappante et comme s’il se fût agi d’une autre personne, sa triste figure, ses caoutchoucs, son manteau, son visage pâle, sa myopie, sa gaucherie, sa maladresse ; — et, au souvenir de la belle phrase qu’il venait d’imaginer, une insupportable rougeur de honte empourpra son visage et une souffrance aiguë le poignit. Et ce soir encore, tandis qu’il marchait solitaire dans la demi-obscurité du crépuscule printanier, il rougit de honte en songeant à la honte passée.
— Non, décidément, je n’irai pas à la gare, — murmura-t-il envahi par une amère désespérance. Je fais un petit tour et je rentre chez moi...
On était au commencement d’avril. L’ombre tombait insensiblement. Les peupliers qui bordaient la route, les masures à toits de tuiles sur les deux côtés du chemin, les rares passants, tout s’obscurcit, perdit couleur et perspective ; tous les objets se changèrent en de plates silhouettes noires, dont les contours se dessinaient dans l’air obscur avec un délicieux relief. À l’occident, au delà de la ville, le crépuscule flamboyait. Dans le cratère d’un volcan incandescent et jetant de l’or en fusion, semblaient se précipiter de lourds nuages gorge de pigeon, rutilant de feux couleur de sang, d’ambre et de violette. Et au-dessus du volcan s’élevait, coupole verdoyante de turquoise et d’aigue-marine, le ciel vespéral printanier.
Avançant lentement sur la route, traînant avec peine ses pieds empêtrés dans ses énormes caoutchoucs, Romachov ne se lassait pas de contempler cet incendie magique. Depuis son enfance les beaux crépuscules le faisaient rêver à quelque existence radieusement mystérieuse. Tout là-bas, bien loin derrière les nuages et l’horizon, étincelait sous les rayons d’un soleil invisible d’ici, une ville merveilleuse, d’une éblouissante beauté, dérobée aux yeux par des nuages et éclairée d’un feu intérieur. Des pavés d’or y luisaient d’un insoutenable éclat, des coupoles et des tours aux toits de pourpre y dressaient leurs fantastiques architectures, des diamants miroitaient aux fenêtres, des drapeaux aux couleurs vives frissonnaient en l’air. Et cette cité lointaine et féerique abritait des êtres exultant de bonheur et de joie, dont toute la vie n’était qu’une suave musique, et pour qui la mélancolie et la tristesse même se teintaient d’une douceur et d’une beauté charmantes. Sur des places inondées de lumière, dans des jardins ombreux, parmi les fleurs et les fontaines, ils marchaient tels des dieux, lumineux et allègres, ne connaissant aucune borne à leur félicité, aucune limite à leurs désirs, ignorant la douleur, la honte et les soucis...
Inopinément Romachov revécut la scène récente du terrain d’exercices, les grossières invectives du colonel, l’affront subi et le sentiment de gêne — gêne poignante et enfantine à la fois — devant ses hommes. Ce dont il souffrait le plus, c’est d’avoir été réprimandé tout comme parfois il réprimandait ces silencieux témoins de sa honte d’aujourd’hui : il voyait là une atteinte à la différence des conditions, une humiliation portée à sa dignité d’officier et, pensait-il, d’homme.
Immédiatement, bouillonnèrent en sa tête, comme dans un cerveau de gamin — et en vérité il conservait bien des traits enfantins — de fantastiques, d’enivrantes pensées de vengeance. « Pourquoi m’arrêter à ces bêtises ! N’ai-je pas toute la vie devant moi ! » — se dit-il, et, entraîné par ses pensées, il marcha d’un pas plus assuré et respira plus profondément. « Pour leur faire la nique à tous, dès demain matin je me plonge dans les bouquins, et je prépare l’Académie d’État-Major1. Le travail mène à tout. Il n’y a qu’à vouloir. Je piocherai comme un enragé... Et à la stupéfaction générale je passerai un brillant examen. Alors tous diront sans doute : Qu’y a-t-il là d’étonnant ? Nous étions sûrs qu’il réussirait, c’est un jeune homme si charmant, si capable, si bien doué ! »
Et avec une étonnante lucidité, Romachov se vit déjà devenu savant officier d’état-major. Son nom est inscrit sur le tableau d’honneur de l’Académie. Les professeurs lui prédisent une brillante carrière, lui proposent de rester à l’École. Mais il préfère aller dans le rang. Il lui faut faire un stage de commandant de compagnie, et il désire à tout prix l’accomplir dans son ancien régiment. Il s’y présente, élégant, correct, condescendant et hautainement poli, comme les officiers d’état-major qu’il a vus sur des photographies ou aperçus aux grandes manœuvres de l’an passé. Il évite la société des officiers de ligne. La vulgarité, la familiarité, les cartes, les saouleries, tout cela ne lui est plus permis : il ne doit pas oublier qu’il parcourt une simple étape de sa glorieuse carrière future.
Voici que les manœuvres commencent. Un grand combat se livre entre les deux partis. Le colonel Choulgovitch ne comprend pas l’ordre de bataille, s’embrouille, s’agite et tracasse les gens : deux fois déjà le commandant de corps d’armée lui a fait envoyer un blâme par un officier d’ordonnance. « Tirez-moi de ce mauvais pas, capitaine, demande-t-il à Romachov. Par vieille amitié, hé ! hé ! hé ! Vous rappelez-vous comme nous nous chamaillions ? Allons, un bon mouvement ». Il a le visage confus et suppliant. Mais Romachov, se cambrant sur sa selle, répond dans un impeccable salut et avec un air tranquillement hautain : « Pardon, monsieur le colonel... C’est à vous qu’il appartient de diriger les mouvements du régiment. Mon devoir consiste uniquement à exécuter vos ordres... » Cependant le commandant de corps envoie déjà un troisième officier d’ordonnance porter une nouvelle réprimande au colonel...
Le brillant officier d’état-major Romachov ne cesse d’ajouter de nouveaux fleurons à ses états de service... Une grève éclate dans une grande aciérie. On y dirige en toute hâte la compagnie de Romachov. C’est la nuit, l’incendie rougeoie, la foule hurlante déferle, les pierres volent... Un beau et svelte capitaine s’avance en tête de sa compagnie. C’est Romachov. « Frères, déclare-t-il aux ouvriers, pour la troisième et dernière fois, je vous préviens que je vais faire tirer !... » Cris, sifflets, éclats de rire... Une pierre frappe Romachov à l’épaule, mais son visage franc et viril conserve son calme. Il se retourne vers ses soldats dont les yeux brillent de colère à la vue de l’outrage porté à leur chef adoré. « En plein sur la foule, feu de compagnie ! Compagnie, feu ! » Cent coups de feu se confondent en un seul... Un hurlement d’horreur, ... des dizaines de morts et de blessés s’effondrent... Les autres s’enfuient en désordre, quelques-uns se jettent à genoux, implorant grâce. L’émeute est vaincue. Romachov reçoit les félicitations de ses chefs et une décoration récompense son insigne vaillance...
Et puis, c’est la guerre... Non, avant la guerre, Romachov apprendra l’allemand à fond et ira faire de l’espionnage en Allemagne. Quelle audace ! Seul, complètement seul, un passeport allemand dans la poche, un orgue de barbarie sur le dos — attribut indispensable — il va de ville en ville, tourne la manivelle de sa boîte à musique, ramasse des pfennigs, simule l’imbécile et cependant lève en cachette des plans de forteresses, d’entrepôts, de casernes, de camps. De perpétuels dangers l’environnent. Son gouvernement l’a désavoué, il est hors la loi. S’il réussit à obtenir de précieux renseignements — c’est la fortune, l’avancement, la notoriété. Mais non — on le surprend, on l’exécute sans jugement, sans aucune formalité, au petit jour dans quelque fossé de caponnière. Par pitié, on lui offre de lui bander les yeux d’un mouchoir, mais il le jette fièrement à terre : « Croyez-vous donc qu’un officier digne de ce nom ait peur de regarder la mort en face ? » Un vieux colonel lui dit tout ému : « Écoutez, jeune homme, j’ai un fils de votre âge. Dites-nous seulement votre nom, votre nationalité et nous commuerons la peine de mort en celle de réclusion. » Mais Romachov l’interrompt avec une froide politesse : « C’est inutile, colonel, je vous remercie. Faites votre devoir. » Puis s’adressant au peloton d’exécution : « Soldats, — profère-t-il d’une voix ferme — en allemand bien entendu — je vous demande un service de camarade : droit au cœur ! » Un sentimental lieutenant, ayant peine à retenir ses larmes, agite un mouchoir blanc. Une salve...
Ce tableau se dressa si vivant et si précis dans son imagination que Romachov, qui depuis longtemps déjà marchait à grands pas et respirait à pleins poumons, frissonna soudain et s’arrêta sur place tout effrayé, le cœur battant et les poings convulsivement serrés. Mais aussitôt il se sourit à lui-même dans l’ombre, d’un sourire faible et contrit, se ressaisit et continua son chemin.
Bientôt cependant il se replongea irrésistiblement dans ses rêves, rapides comme un torrent. Une guerre sanglante et acharnée avait commencé contre la Prusse et l’Autriche. Un immense champ de bataille, des cadavres, des shrapnels, du sang ! C’est la bataille générale, décisive. Les dernières réserves arrivent, on attend de minute en minute l’apparition dans le dos de l’ennemi d’une colonne russe enveloppante. Il faut résister à l’effroyable pression de l’ennemi, il faut tenir coûte que coûte. Et c’est sur le régiment de Kérensk que l’adversaire dirige son feu le plus terrible, ses attaques les





























