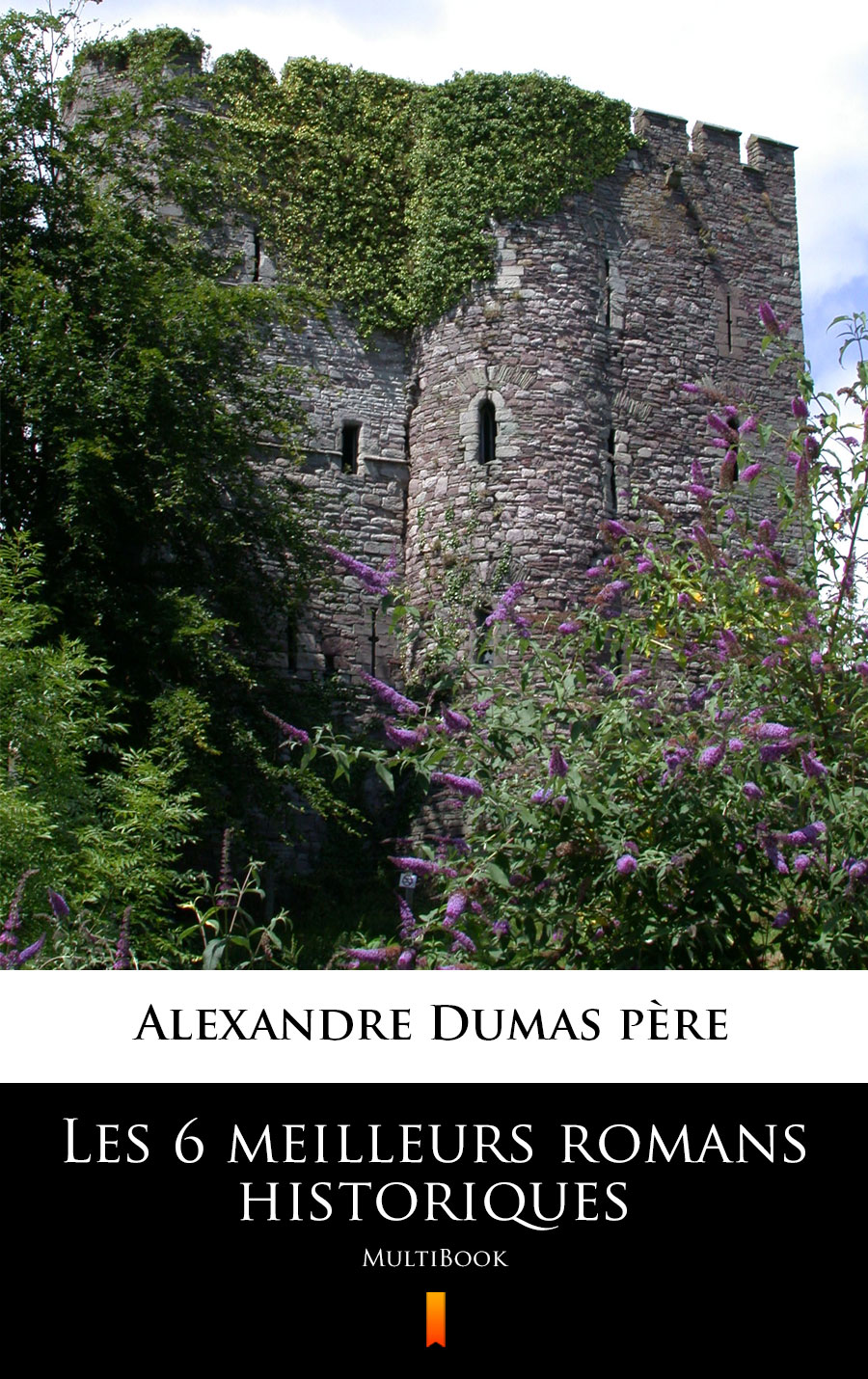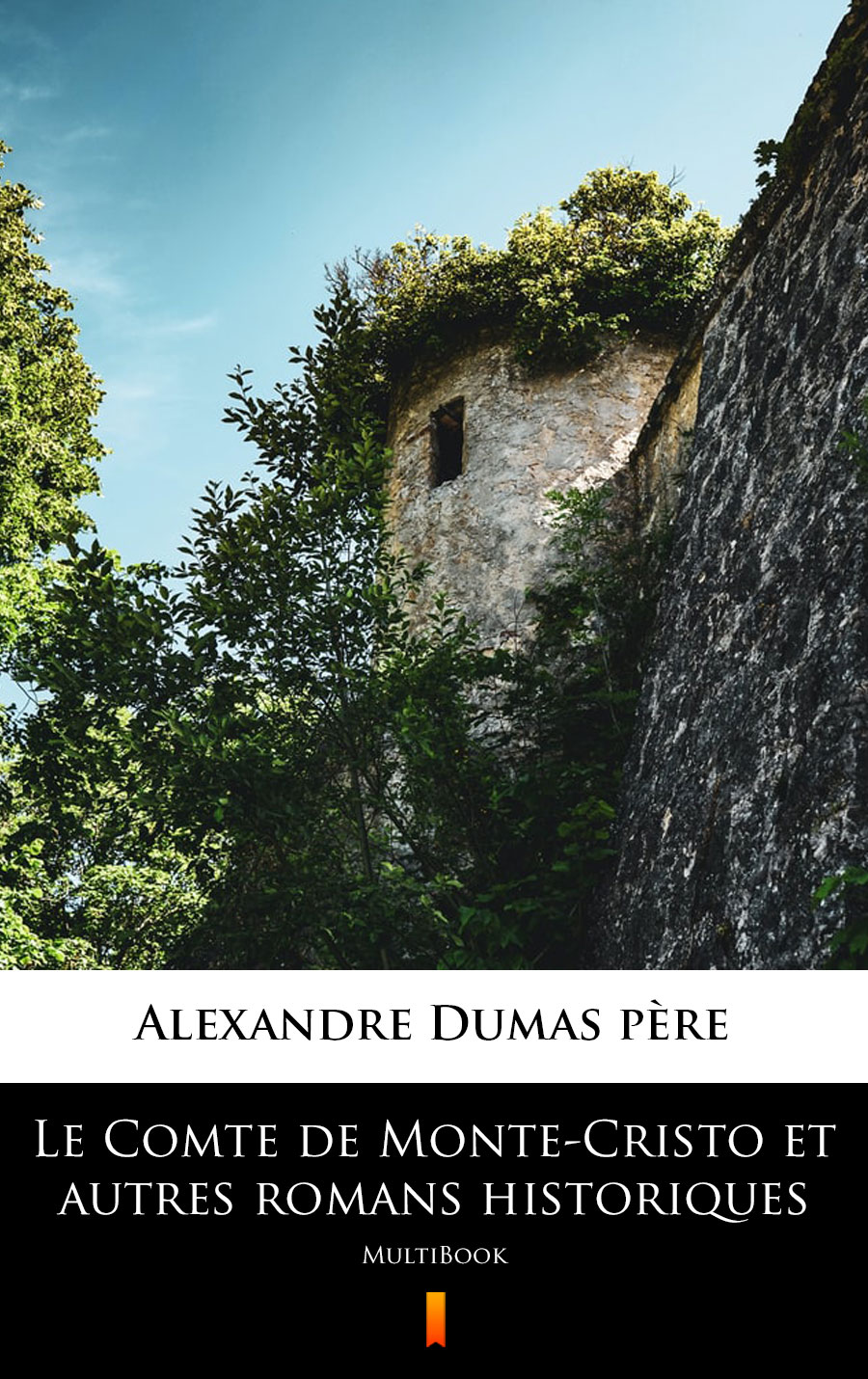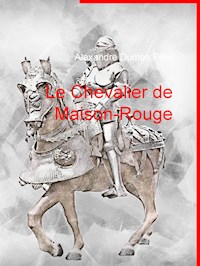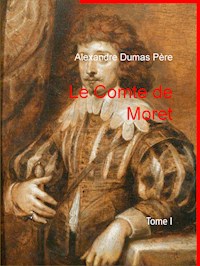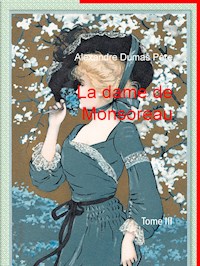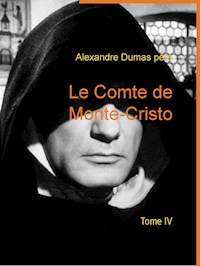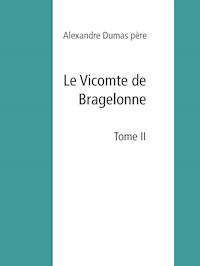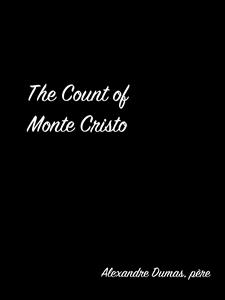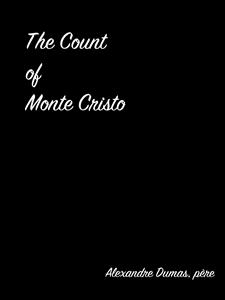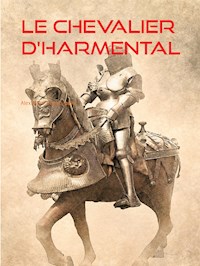
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Raoul d'Harmental, jeune aristocrate monté à Paris en 1711, est un aventurier plutôt susceptible et impétueux. S'étant illustré à la dernière victoire de Louis XIV, nommé colonel à cette occasion, d'Harmental se trouve après la mort du roi mêlé au conflit qui oppose le parti des princes légitimes et celui des bâtards. Philippe d'Orléans, prince légitime, est régent de France alors que Louis XV est encore enfant.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 780
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Chevalier d'Harmental
Pages de titreChapitre 1Chapitre 2Chapitre 3Chapitre 4Chapitre 5Chapitre 6Chapitre 7Chapitre 8Chapitre 9Chapitre 10Chapitre 11Chapitre 12Chapitre 13Chapitre 14Chapitre 15Chapitre 16Chapitre 17Chapitre 18Chapitre 19Chapitre 20Chapitre 21Chapitre 22Chapitre 23Chapitre 24Chapitre 25Chapitre 26Chapitre 27Chapitre 28Chapitre 29Chapitre 30Chapitre 31Chapitre 32Chapitre 33Chapitre 34Chapitre 35Chapitre 36Chapitre 37Chapitre 38Chapitre 39Chapitre 40Chapitre 41Chapitre 42Chapitre 43Chapitre 44Chapitre 45Chapitre 46Chapitre 47Chapitre 48PostScriptumPage de copyright1
Le Chevalier d'Harmental
Alexandre Dumas père
2
Chapitre 1
Le 22 mars de l’an de grâce 1718, jour de la micarême, un jeune
seigneur de haute mine, âgé de vingtsix à vingthuit ans, monté sur
un beau cheval d’Espagne, se tenait, vers les huit heures du matin, à
l’extrémité du pont Neuf qui aboutit au quai de l’École. Il était si
droit et si ferme en selle, qu’on eût dit qu’il avait été placé là en
sentinelle par le lieutenant général de la police du royaume, messire
Voyer d’Argenson.
Après une demiheure d’attente à peu près, pendant laquelle on le
vit plus d’une fois interroger des yeux avec impatience l’horloge de
la Samaritaine, son regard, errant jusquelà, parut s’arrêter avec
satisfaction sur un individu qui, débouchant de la place Dauphine, fit
demitour à droite et s’achemina de son côté.
Celui qui avait eu l’honneur d’attirer ainsi l’attention du jeune
cavalier était un grand gaillard de cinq pieds huit pouces, taillé en
pleine chair, portant au lieu de perruque une forêt de cheveux noirs
parsemée de quelques poils gris, vêtu d’un habit moitié bourgeois,
moitié militaire, orné d’un nœud d’épaule qui primitivement avait été
ponceau, et qui, à force d’être exposé à la pluie et au soleil, était
devenu jauneorange. Il était, en outre, armé d’une longue épée
passée en verrouil, et qui lui battait formidablement le gras des
jambes ; enfin, il était coiffé d’un chapeau autrefois garni d’une
plume et d’un galon, et qu’en souvenir sans doute de sa splendeur
passée, son maître portait tellement incliné sur l’oreille gauche, qu’il
semblait ne pouvoir rester dans cette position que par un miracle
d’équilibre.
3
Il y avait au reste dans la figure, dans la démarche, dans le port,
dans tout l’ensemble enfin de cet homme, qui paraissait âgé de
quarantecinq à quarantesix ans, et qui s’avançait tenant le haut du
pavé, se dandinant sur la hanche, frisant d’une main sa moustache et
faisant de l’autre signe aux voitures de passer au large, un tel
caractère d’insolente insouciance, que celui qui le suivait des yeux ne
put s’empêcher de sourire et de murmurer entre ses dents :
— Je crois que voilà mon affaire !
En conséquence de cette probabilité, le jeune seigneur marcha
droit au nouvel arrivant, avec l’intention visible de lui parler. Celui
ci, quoiqu’il ne connût aucunement le cavalier, voyant que c’était à
lui qu’il paraissait avoir affaire, s’arrêta en face de la Samaritaine,
avança son pied droit à la troisième position, et attendit, une main à
son épée et l’autre à sa moustache, ce qu’avait à lui dire le
personnage qui venait ainsi à sa rencontre.
En effet, comme l’avait prévu l’homme aux rubans orange, le
jeune seigneur arrêta son cheval en face de lui, et portant la main à
son chapeau :
— Monsieur, lui ditil, j’ai cru reconnaître à votre air et à votre
tournure que vous étiez gentilhomme. Me seraisje trompé ?
— Non, palsambleu ! monsieur, répondit celui à qui était adressée
cette étrange question en portant à son tour la main à son feutre. Je
suis vraiment fort aise que mon air et ma tournure parlent si
hautement pour moi, car pour peu que vous croyiez devoir me
donner le titre qui m’est dû, vous m’appellerez capitaine.
— Enchanté que vous soyez homme d’épée, monsieur, reprit le
cavalier en s’inclinant de nouveau. Ce m’est une certitude de plus
que vous êtes incapable de laisser un galant homme dans l’embarras.
— Soyez le bienvenu, pourvu que ce ne soit pas cependant à ma
bourse que ce galant homme ait recours, car je vous avouerai en toute
franchise que je viens de laisser mon dernier écu dans un cabaret du
port de la Tournelle.
— Il ne s’agit aucunement de votre bourse, capitaine, et c’est la
mienne au contraire, je vous prie de le croire qui est à votre
disposition.
4
— À qui aije l’honneur de parler, demanda le capitaine
visiblement touché de cette réponse, et que puisje faire qui vous soit
agréable ?
— Je me nomme le baron René de Valef, répondit le cavalier.
— Monsieur, lui ditil, j’ai cru reconnaître à votre air et à votre
tournure que vous étiez gentilhomme. Me seraisje trompé ?
— Non, palsambleu ! Monsieur, répondit celui à qui était adressée
cette étrange question en portant à son tour la main à son feutre. Je
suis vraiment fort aise que mon air et ma tournure parlent si
hautement pour moi, car pour peu que vous croyiez devoir me
donner le titre qui m’est dû, vous m’appellerez capitaine.
— Enchanté que vous soyez homme d’épée, monsieur, reprit le
cavalier en s’inclinant de nouveau. Ce m’est une certitude de plus
que vous êtes incapable de laisser un galant homme dans l’embarras.
— Soyez le bienvenu, pourvu que ce ne soit pas cependant à ma
bourse que ce galant homme ait recours, car je vous avouerai en toute
franchise que je viens de laisser mon dernier écu dans un cabaret du
port de la Tournelle.
— Il ne s’agit aucunement de votre bourse, capitaine, et c’est la
mienne au contraire, je vous prie de le croire qui est à votre
disposition.
— À qui aije l’honneur de parler, demanda le capitaine
visiblement touché de cette réponse, et que puisje faire qui vous soit
agréable ?
— Je me nomme le baron René de Valef, répondit le cavalier.
— Pardon, monsieur le baron, interrompit le capitaine, mais je
crois avoir, dans les guerres de Flandre, connu une famille de ce
nom.
— C’est la mienne, monsieur, attendu que je suis Liégeois
d’origine.
Les deux interlocuteurs se saluèrent de nouveau.
— Vous saurez donc, continua le baron de Valef, que le chevalier
Raoul d’Harmental, un de mes amis intimes, a ramassé cette nuit, de
compagnie avec moi, une mauvaise querelle qui doit finir ce matin
par une rencontre ; nos adversaires étaient trois et nous n’étions que
5
deux. Je me suis donc rendu ce matin chez le marquis de Gacé et
chez le comte de Surgis, mais par malheur ni l’un ni l’autre n’avait
passé la nuit dans son lit. Si bien que, comme l’affaire ne pouvait pas
se remettre, attendu que je pars dans deux heures pour l’Espagne, et
qu’il nous fallait absolument un second ou plutôt un troisième, je suis
venu m’installer sur le pont Neuf avec l’intention de m’adresser au
premier gentilhomme qui passerait. Vous êtes passé, je me suis
adressé à vous.
— Et vous avez, pardieu, bien fait ! Touchez là, baron je suis
votre homme. Et pour quelle heure, s’il vous plaît, est la rencontre ?
— Pour neuf heures et demie, ce matin.
— Où la chose doitelle se passer ?
— À la porte Maillot.
— Diable ! il n’y a pas de temps à perdre ! Mais vous êtes à
cheval et moi à pied : comment allonsnous arranger cela ?
— Il y aurait un moyen, capitaine.
— Lequel ?
— C’est que vous me fissiez l’honneur de monter en croupe.
— Volontiers, monsieur le baron.
— Je vous préviens seulement, ajouta le jeune seigneur avec un
léger sourire, que mon cheval est un peu vif.
— Oh ! je le reconnais, dit le capitaine en se reculant d’un pas et
jetant sur le bel animal un coup d’œil de connaisseur. Ou je me
trompe fort, ou il est né entre les montagnes de Grenade et la Sierra
Morena. J’en montais un pareil à Almanza, et je l’ai plus d’une fois
fait coucher comme un mouton quand il voulait m’emporter au
galop, et cela rien qu’en le serrant avec mes genoux.
— Alors vous me rassurez. À cheval donc, capitaine, et à la porte
Maillot !
— M’y voilà, monsieur le baron.
Et, sans se servir de l’étrier que lui laissait libre le jeune seigneur,
d’un seul élan le capitaine se trouva en croupe.
Le baron avait dit vrai : son cheval n’était point habitué à une si
lourde charge ; aussi essayatil d’abord de s’en débarrasser ; mais le
capitaine non plus n’avait point menti, et l’animal sentit bientôt qu’il
6
avait affaire à plus forts que lui.
De sorte qu’après deux ou trois écarts qui n’eurent d’autres
résultats que de faire valoir aux yeux des passants l’adresse des deux
cavaliers, il prit le parti de l’obéissance, et descendit au grand trot le
quai de l’École, qui, à cette époque, n’était encore qu’un port,
traversa, toujours du même train, le quai du Louvre et le quai des
Tuileries, franchit la porte de la Conférence, et, laissant à gauche le
chemin de Versailles, enfila la grande avenue des ChampsÉlysées
qui conduit aujourd’hui à l’arc de triomphe de l’Étoile.
Parvenu au pont d’Antin le baron de Valef ralentit un peu l’allure
de son cheval car il vit qu’il avait tout le temps d’arriver à la porte
Maillot vers l’heure convenue. Le capitaine profita de ce moment de
répit.
— Maintenant, monsieur, sans indiscrétion, ditil, puisje vous
demander pour quelle raison nous allons nous battre ? J’ai besoin ;
vous comprenez, d’être instruit de cela pour régler ma conduite
envers mon adversaire, et pour savoir si la chose vaut la peine que je
le tue.
— C’est trop juste, capitaine, répondit le baron. Voici les faits tels
qu’ils se sont passés. Nous soupions hier soir chez la Fillon. Il n’est
pas que vous ne connaissiez la Fillon, capitaine ?
— Pardieu ! c’est moi qui l’ai lancée dans le monde, en 1705,
avant mes campagnes d’Italie.
— Eh bien ! répondit en riant le baron, vous pouvez vous vanter,
capitaine, d’avoir formé là une élève qui vous fait honneur ! Bref,
nous soupions donc chez elle tête à tête avec d’Harmental.
— Sans aucune créature du beau sexe ? demanda le capitaine.
— Oh ! mon Dieu ! oui. Il faut vous dire que d’Harmental est une
espèce de trappiste, n’allant chez la Fillon que de peur de passer pour
n’y point aller, n’aimant qu’une femme à la fois, et amoureux pour le
quart d’heure de la petite d’Averne, la femme du lieutenant aux
gardes.
— Très bien.
— Nous étions donc là parlant de nos affaires, lorsque nous
entendîmes une joyeuse société qui entrait dans le cabinet à côté du
7
nôtre. Comme ce que nous avions à nous dire ne regardait personne,
nous fîmes silence et ce fut nous qui, sans le vouloir, écoutâmes la
conversation de nos voisins. Or, voyez ce que c’est que le hasard !
nos voisins parlaient justement de la seule chose qu’il aurait fallu que
nous n’entendissions pas.
— De la maîtresse du chevalier, peutêtre ?
— Vous l’avez dit. Aux premiers mots qui m’arrivèrent de leurs
discours, je me levai pour emmener Raoul ; mais, au lieu de me
suivre, il me mit la main sur l’épaule et me fit rasseoir.
— Ainsi donc, disait une voix, Philippe en tient pour la petite
d’Averne ?
— Depuis la fête de la maréchale d’Estrées, où, déguisée en
Vénus, elle lui a donné un ceinturon d’épée accompagné de vers où
elle le comparait à Mars.
— Mais il y a déjà huit jours, dit une troisième voix.
— Oui, répondit la première. Oh ! elle a fait une espèce de
défense, soit qu’elle tînt véritablement à ce pauvre d’Harmental, soit
qu’elle sût que le régent n’aime que ce qui lui résiste. Enfin, ce
matin, en échange d’une corbeille pleine de fleurs et de pierreries,
elle a bien voulu répondre qu’elle recevrait ce soir Son Altesse :
— Ah ! ah ! dit le capitaine, je commence à comprendre. Le
chevalier s’est fâché ?
— Justement ; au lieu d’en rire, comme nous aurions fait vous ou
moi, du moins je l’espère, et de profiter de cette circonstance pour se
faire rendre son brevet de colonel, qu’on lui a ôté sous le prétexte de
faire des économies, d’Harmental devint si pâle que je crus qu’il
allait s’évanouir. Puis, s’approchant de la cloison et frappant du
poing pour qu’on fît silence :
— Messieurs, ditil, je suis fâché de vous contredire, mais celui de
vous qui a avancé que madame d’Averne avait accordé un rendez
vous au régent, ou à tout autre, en a menti.
— C’est moi, monsieur, qui ait dit la chose et qui la soutiens,
répondit la première voix ; et s’il y a en elle quelque chose qui vous
déplaise, je me nomme Lafare, capitaine aux gardes.
— Et moi, Fargy, dit la seconde voix.
8
— Et moi, Ravanne, dit la troisième voix.
— Très bien, messieurs, reprit d’Harmental. Demain, de neuf
heures à neuf heures et demie, à la porte Maillot. Et il vint se rasseoir
en face de moi.
Ces messieurs parlèrent d’autre chose, et nous achevâmes notre
souper. Voilà toute l’affaire, capitaine, et vous en savez maintenant
autant que moi.
Le capitaine fit entendre une espèce d’exclamation qui voulait
dire : Tout cela n’est pas bien grave, mais, malgré cette demi
désapprobation de la susceptibilité du chevalier, il n’en résolut pas
moins de soutenir de son mieux la cause dont il était devenu si
inopinément le champion, quelque défectueuse que cette cause lui
parût dans son principe.
D’ailleurs, en eûtil eu l’intention, il était trop tard pour reculer.
On était arrivé à la porte Maillot, et un jeune cavalier, qui paraissait
attendre, et qui avait aperçu de loin le baron et le capitaine, venait de
mettre son cheval au galop, et s’approchait rapidement. C’était le
chevalier d’Harmental.
— Mon cher chevalier, dit le baron de Valef en échangeant avec
lui une poignée de main, permets qu’à défaut d’un ancien ami, je t’en
présente un nouveau.
Ni Surgis ni Gacé, n’étaient à la maison ; j’ai fait rencontre de
monsieur sur le pont Neuf, je lui ai exposé notre embarras et il s’est
offert à nous en tirer avec une merveilleuse grâce.
— C’est donc une double reconnaissance que je te dois, mon cher
Valef, répondit le chevalier en jetant sur le capitaine un regard dans
lequel perçait une légère nuance d’étonnement, et à vous, monsieur,
continuatil, des excuses de ce que je vous jette ainsi tout d’abord et
pour faire connaissance dans une si méchante affaire ; mais vous
m’offrirez un jour ou l’autre l’occasion de prendre ma revanche, je
l’espère, et je vous prie, le cas échéant, de disposer de moi comme
j’ai disposé de vous.
— Bien dit, chevalier, répondit le capitaine en sautant à terre, et
vous avez des manières avec lesquelles on me ferait aller au bout du
monde. Le proverbe a raison : il n’y a que les montagnes qui ne se
9
rencontrent pas.
— Quel est cet original ? demanda tout bas d’Harmental à Valef,
tandis que le capitaine marquait des appels du pied droit pour se
remettre les jambes.
— Ma foi ! je l’ignore, dit Valef ; mais ce que je sais, c’est que
sans lui nous étions fort empêchés. Quelque pauvre officier de
fortune, sans doute, que la paix a mis à l’écart comme tant d’autres.
D’ailleurs, nous le jugerons tout à l’heure à la besogne.
— Eh bien ! dit le capitaine, s’animant à l’exercice qu’il prenait,
où sont nos muguets, chevalier ? Je me sens en veine ce matin.
— Quand je suis venu audevant de vous, répondit d’Harmental,
ils n’étaient point encore arrivés ; mais j’apercevais au bout de
l’avenue une espèce de carrosse de louage qui leur servira d’excuse
s’ils sont en retard.
Au reste, ajouta le chevalier en tirant de son gousset une très belle
montre garnie de brillants, il n’y a point de temps perdu, car à peine
s’il est neuf heures et demie.
— Allons donc audevant d’eux, dit Valef en descendant à son
tour de cheval et en jetant la bride aux mains du valet de
d’Harmental ; car, s’ils arrivaient au rendezvous tandis que nous
bavardons ici, c’est nous qui aurions l’air de nous faire attendre.
— Tu as raison, dit d’Harmental.
Et, mettant pied à terre à son tour, il s’avança vers l’entrée du
bois, suivi de ses deux compagnons.
— Ces messieurs ne commandent rien ? demanda le propriétaire
du restaurant, qui se tenait sur la porte, attendant pratique.
— Si fait, maître Durand, répondit d’Harmental, qui ne voulait
pas, de peur d’être dérangé, avoir l’air d’être venu pour autre chose
que pour une promenade. Un déjeuner pour trois ! Nous allons faire
un tour d’allée et nous revenons.
Et il laissa tomber trois louis dans la main de l’hôtelier.
Le capitaine vit reluire l’une après les autres les trois pièces d’or,
et calcula avec la rapidité d’un amateur consommé ce que l’on
pouvait avoir au bois de Boulogne pour soixantedouze livres ; mais
comme il connaissait celui à qui il avait affaire, il jugea qu’une
10
recommandation de sa part ne serait point inutile ; en conséquence,
s’approchant à son tour du maître d’hôtel :
— Ah çà ! gargotier mon ami, lui ditil, tu sais que je connais la
valeur des choses, et que ce n’est point à moi qu’on peut en faire
croire sur le total d’une carte ? Que les vins soient fins et variés, et
que le déjeuner soit copieux, ou je te casse les os ! Tu entends ?
— Soyez tranquille, capitaine, répondit maître Durand ; ce n’est
pas une pratique comme vous que je voudrais tromper.
C’est bien. Il y a douze heures que je n’ai mangé : règletoi là
dessus.
L’hôtelier s’inclina en homme qui savait ce que cela voulait dire
et reprit le chemin de sa cuisine, commençant à croire qu’il avait fait
une moins bonne affaire qu’il n’avait d’abord espéré. Quant au
capitaine, après lui avoir fait un dernier signe de recommandation
moitié amical, moitié menaçant, il doubla le pas et rejoignit le
chevalier et le baron, qui s’étaient arrêtés pour l’attendre.
Le chevalier ne s’était pas trompé à l’endroit du carrosse de
louage. Au détour de la première allée, il aperçut ses trois adversaires
qui en descendaient. C’étaient, comme nous l’avons déjà dit, le
marquis de Lafare, le comte de Fargy et le chevalier de Ravanne.
Que nos lecteurs nous permettent de leur donner quelques courts
détails sur ces trois personnages, que nous verrons plusieurs fois
reparaître dans le cours de cette histoire.
Lafare, le plus connu des trois, grâce aux poésies qu’il a laissées,
et à la carrière militaire qu’il a parcourue, était un homme de trente
six à trentehuit ans, de figure ouverte et franche, d’une gaîté et d’une
bonne humeur intarissables, toujours prêt à tenir tête à tout venant à
table, au jeu et aux armes, sans rancune et sans fiel, fort couru du
beau sexe et fort aimé du régent, qui l’avait nommé son capitaine des
gardes, et qui, depuis dix ans qu’il l’admettait dans son intimité,
l’avait trouvé son rival quelquefois, mais son fidèle serviteur
toujours.
Aussi le prince, qui avait l’habitude de donner des surnoms à tous
ses roués et à toutes ses maîtresses, ne le désignaitil jamais que par
celui de bon enfant. Cependant, depuis quelque temps, la popularité
11
de Lafare, si bien établie qu’elle fût par de recommandables
antécédents, baissait fort parmi les femmes de la cour et les filles de
l’opéra. Le bruit courait tout haut qu’il se donnait le ridicule de
devenir un homme rangé. Il est vrai que quelques personnes, afin de
lui conserver sa réputation, disaient tout bas que cette conversion
apparente n’avait d’autre cause que la jalousie de mademoiselle de
Conti, fille de madame la duchesse et petitefille du grand Condé,
laquelle assuraiton, honorait le capitaine des gardes de monsieur le
régent d’une affection toute particulière. Au reste, sa liaison avec le
duc de Richelieu, qui passait de son côté pour être l’amant de
mademoiselle de Charolais, donnait une nouvelle consistance à ce
bruit.
Le comte de Fargy, que l’on appelait habituellement le beau
Fargy, en substituant l’épithète qu’il avait reçue de la nature au titre
que lui avaient légué ses pères, était cité, comme l’indique son nom,
pour le plus beau garçon de son époque. Ce qui, dans ce temps de
galanterie, imposait des obligations devant lesquelles il n’avait
jamais reculé, et dont il s’était toujours tiré avec honneur. En effet, il
était impossible d’être mieux pris dans sa taille que ne l’était Fargy.
C’était à la fois une de ces natures élégantes et fortes, souples et
vivaces, qui semblent douées des qualités les plus opposées des héros
de roman de ces tempslà.
Joignez à cela une tête charmante qui réunissait les beautés les
plus opposées, c’estàdire des cheveux noirs et des yeux bleus, des
traits fortement arrêtés et un teint de femme. Ajoutez à cet ensemble
de l’esprit, de la loyauté, du courage autant qu’homme du monde, et
vous aurez une idée de la haute considération dont devait jouir Fargy
auprès de la société de cette folle époque, si bonne appréciatrice de
ces différents genres de mérite.
Quant au chevalier de Ravanne, qui nous a laissé sur sa jeunesse
des mémoires si étranges que, malgré leur authenticité, on est
toujours tenté de les croire apocryphes, c’était alors un enfant à peine
hors de page, riche et de grande maison, qui entrait dans la vie par sa
porte dorée, et qui courait droit au plaisir qu’elle promet avec toute la
fougue, l’imprudence et l’avidité de la jeunesse. Aussi outraitil,
12
comme on a l’habitude de le faire à dixhuit ans, tous les vices et
toutes les qualités de son époque. On comprend donc facilement quel
était son orgueil de servir de second à des hommes comme Lafare et
Fargy dans une rencontre qui devait avoir quelque retentissement
dans les ruelles et dans les petits soupers.
13
Chapitre 2
Aussitôt que Lafare, Fargy et Ravanne virent déboucher leurs
adversaires à l’angle de l’allée, ils marchèrent de leur côté audevant
d’eux. Arrivés à dix pas les uns des autres, tous mirent le chapeau à
la main et se saluèrent avec cette élégante politesse qui était, en
pareille circonstance, un des caractères de l’aristocratie du dix
huitième siècle, et firent quelques pas ainsi, tête nue et le sourire sur
les lèvres, si bien qu’aux yeux d’un passant qui n’aurait point été
informé de la cause de leur réunion, ils auraient eu l’air d’amis
enchantés de se rencontrer.
— Messieurs, dit le chevalier d’Harmental, à qui la parole
appartenait de droit, j’espère que ni vous ni moi n’avons été suivis ;
mais il commence à se faire un peu tard, et nous pourrions être
dérangés ici ; je crois donc qu’il serait bon de gagner tout d’abord un
endroit plus écarté où nous soyons plus à notre aise pour vider la
petite affaire qui nous rassemble.
— Messieurs, dit Ravanne, j’ai ce qu’il vous faut : à cent pas d’ici
à peine, une véritable chartreuse ; vous vous croirez dans la
Thébaïde.
— Alors, suivons l’enfant, dit le capitaine ; l’innocence mène au
salut !
Ravanne se retourna et toisa des pieds à la tête notre ami au ruban
orange.
— Si vous n’avez d’engagement avec personne, mon grand
monsieur, dit le jeune page d’un ton goguenard, je réclamerai la
préférence.
14
— Un instant, un instant, Ravanne, interrompit Lafare. J’ai
quelques explications à donner à monsieur d’Harmental.
— Monsieur Lafare, répondit le chevalier votre courage est si
parfaitement connu que les explications que vous m’offrez sont une
preuve de délicatesse dont, croyezmoi bien, je vous sais un gré
parfait ; mais ces explications ne feraient que nous retarder
inutilement, et nous n’avons, je crois, pas de temps à perdre.
— Bravo ! dit Ravanne ; voilà ce qui s’appelle parler, chevalier ;
une fois que nous nous serons coupé la gorge, j’espère que vous
m’accorderez votre amitié. J’ai fort entendu parler de vous en bon
lieu, et il y a longtemps que je désirais faire votre connaissance.
Les deux hommes se saluèrent de nouveau.
— Allons, allons, Ravanne, dit Fargy, puisque tu t’es chargé
d’être notre guide, montrenous le chemin.
Ravanne sauta aussitôt dans le bois comme un jeune faon. Ses
cinq compagnons le suivirent. Les chevaux de main et le carrosse de
louage restèrent sur la route.
Au bout de dix minutes de marche, pendant lesquelles les six
adversaires avaient gardé le plus profond silence, soit de peur d’être
entendus, soit par ce sentiment naturel qui fait qu’au moment de
courir un danger l’homme se replie un instant sur luimême, on se
trouva au milieu d’une clairière entourée de tous côtés d’un rideau
d’arbres.
— Eh bien ! messieurs, dit Ravanne en jetant un regard satisfait
autour de lui, que ditesvous de la localité ?
— Je dis que si vous vous vantez de l’avoir découverte dit le
capitaine, vous me faites l’effet d’un drôle de Christophe Colomb !
Vous n’aviez qu’à me dire que c’était ici que vous vouliez aller, et je
vous y aurais conduit les yeux fermés, moi.
— Eh bien ! monsieur, répondit Ravanne, nous tacherons que
vous en sortiez comme vous y seriez venu.
— Vous savez que c’est à vous que j’ai affaire, monsieur de
Lafare, dit d’Harmental en jetant son chapeau sur l’herbe.
— Oui, monsieur, répondit le capitaine des gardes en suivant
l’exemple du chevalier ; et je sais aussi que rien ne pouvait me faire
15
tout à la fois plus d’honneur et de peine qu’une rencontre avec vous,
surtout pour un pareil motif.
D’Harmental sourit en homme pour qui cette fleur de politesse
n’était point perdue, mais il n’y répondit qu’en mettant l’épée à la
main.
— Il paraît, mon cher baron, dit Fargy s’adressant à Valef, que
vous êtes sur le point de partir pour l’Espagne ?
— Je devais partir cette nuit même, mon cher comte répondit
Valef, et il n’a fallu rien moins que le plaisir que je me promettais à
vous voir ce matin pour me déterminer à rester jusqu’à cette heure,
tant j’y vais pour choses importantes.
— Diable ! voilà qui me désole, reprit Fargy en tirant son épée ;
car si j’avais le malheur de vous retarder, vous êtes homme à m’en
vouloir mal de mort.
— Non point. Je saurais que c’est par pure amitié, mon cher
comte, répondit Valef. Ainsi, faites de votre mieux et tout de bon, je
vous prie, car je suis à vos ordres.
— Allons donc, allons donc, monsieur, dit Ravanne au capitaine,
qui pliait proprement son habit et le posait près de son chapeau ; vous
voyez bien que je vous attends.
— Ne nous impatientons pas, mon beau jeune homme, dit le vieux
soldat en continuant ses préparatifs avec le flegme goguenard qui lui
était naturel. Une des qualités les plus essentielles sous les armes,
c’est le sangfroid. J’ai été comme vous à votre âge, mais au
troisième ou quatrième coup d’épée que j’ai reçu, j’ai compris que je
faisais fausse route, et je suis revenu dans le droit chemin. Là !
ajoutatil en tirant enfin son épée, qui, nous l’avons dit, était de la
plus belle longueur.
— Peste, monsieur ! dit Ravanne en jetant un coup d’œil sur
l’arme de son adversaire, que vous avez là une charmante
colichemarde ! Elle me rappelle la maîtressebroche de la cuisine de
ma mère, et je suis désolé de ne pas avoir dit au maître d’hôtel de me
l’apporter pour faire votre partie.
— Votre mère est une digne femme, et sa cuisine une bonne
cuisine ; j’ai entendu parler de toutes deux avec de grands éloges,
16
monsieur le chevalier, répondit le capitaine avec un ton presque
paternel. Aussi je serais désolé de vous enlever à l’une et à l’autre
pour une misère comme celle qui me procure l’honneur de croiser le
fer avec vous. Supposez donc tout bonnement que vous prenez une
leçon avec votre maître d’armes, et tirez à fond.
La recommandation était inutile ; Ravanne était exaspéré de la
tranquillité de son adversaire, à laquelle, malgré son courage, son
sang jeune et ardent ne lui laissait pas l’espérance d’atteindre.
Aussi se précipitatil sur le capitaine avec une telle furie que les
épées se trouvèrent engagées jusqu’à la poignée. Le capitaine fit un
pas en arrière.
— Ah ! vous rompez, mon grand monsieur, s’écria Ravanne.
— Rompre n’est pas fuir, mon petit chevalier, répondit le
capitaine ; c’est un axiome de l’art que je vous invite à méditer.
D’ailleurs, je ne suis pas fâché d’étudier votre jeu. Ah ! vous êtes
élève de Berthelot à ce qu’il me paraît.
C’est un bon maître, mais il a un grand défaut : c’est de ne pas
apprendre à parer. Tenez, voyez un peu, continuatil en ripostant par
un coup de seconde à un coup droit, si je m’étais fendu, je vous
enfilais comme une mauviette.
Ravanne était furieux, car effectivement il avait senti sur son flanc
la pointe de l’épée de son adversaire, mais si légèrement posée qu’il
eût pu la prendre pour le bouton d’un fleuret. Aussi sa colère
redoubla de la conviction qu’il lui devait la vie, et ses attaques se
multiplièrent plus pressées encore qu’auparavant.
— Allons, allons, dit le capitaine, voilà que vous perdez la tête
maintenant, et que vous cherchez à m’éborgner. Fi donc ! jeune
homme, fi donc ! À la poitrine, morbleu ! Ah ! vous revenez à la
figure ? Vous me forcerez de vous désarmer ! Encore ? Allez
ramasser votre épée, jeune homme, et revenez à clochepied, cela
vous calmera.
Et d’un violent coup de fouet, il fit sauter le fer de Ravanne à
vingt pas de lui.
Cette fois, Ravanne profita de l’avis ; il alla lentement ramasser
son épée et revint lentement au capitaine, qui l’attendait la pointe de
17
la sienne sur le soulier. Seulement le jeune homme était pâle comme
sa veste de satin, sur laquelle apparaissait une légère goutte de sang.
— Vous avez raison, monsieur, lui ditil, et je suis encore un
enfant ; mais ma rencontre avec vous aidera, je l’espère à faire de
moi un homme. Encore quelques passes, s’il vous plaît, afin qu’il ne
soit pas dit que vous ayez eu tous les honneurs. Et il se remit en
garde.
Le capitaine avait raison : il ne manquait au chevalier que du
calme pour en faire sous les armes un homme à craindre. Aussi, au
premier coup de cette troisième reprise, vitil qu’il lui fallait apporter
à sa propre défense toute son attention ; mais luimême avait dans
l’art de l’escrime une trop grande supériorité pour que son jeune
adversaire pût reprendre avantage sur lui.
Les choses se terminèrent comme il était facile de le prévoir : le
capitaine fit sauter une seconde fois l’épée des mains de Ravanne ;
mais, cette fois, il alla la ramasser luimême et avec une politesse
dont au premier abord on l’aurait cru incapable.
— Monsieur le chevalier, lui ditil en la lui rendant, vous êtes un
brave jeune homme ; mais, croyezen un vieux coureur d’académies
et de tavernes, qui a fait, avant que vous ne fussiez né, les guerres de
Flandre ; quand vous étiez au berceau, celles d’Italie, et quand vous
étiez aux pages, celles d’Espagne : changez de maître ; laissez là
Berthelot, qui vous a montré tout ce qu’il sait ; prenez BoisRobert,
et je veux que le diable m’emporte si dans six mois vous ne m’en
remontrez pas à moimême !
— Merci de la leçon, monsieur dit Ravanne en tendant la main au
capitaine, tandis que deux larmes, qu’il n’était point le maître de
retenir, coulaient le long de ses joues ; elle me profitera, je l’espère.
Et, recevant son épée des mains du capitaine, il fit ce que celuici
avait déjà fait, il la remit au fourreau.
Tous deux reportèrent alors les yeux sur leurs compagnons pour
voir où en étaient les choses. Le combat était fini. Lafare était assis
sur l’herbe, le dos appuyé à un arbre : il avait reçu un coup d’épée
qui devait lui traverser la poitrine ; mais heureusement, la pointe du
fer avait rencontré une côte et avait glissé le long de l’os, de sorte
18
que la blessure paraissait au premier abord plus grave qu’elle ne
l’était en effet ; il n’en était pas moins évanoui, tant la commotion
avait été violente. D’Harmental, à genoux devant lui, épongeait le
sang avec son mouchoir.
Fargy et Valef avaient fait coup fourré : l’un avait la cuisse
traversée, l’autre le bras à jour. Tous deux se faisaient des excuses et
se promettaient de n’en être que meilleurs amis à l’avenir.
— Tenez, jeune homme, dit le capitaine à Ravanne en lui
montrant les différents épisodes du champ de bataille, regardez cela
et méditez ; voilà le sang de trois braves gentilshommes qui coule
probablement pour une drôlesse !
— Ma foi ! répondit Ravanne tout à fait calmé, je crois que vous
avez raison, capitaine, et vous pourriez bien être le seul de nous tous
qui ayez le sens commun.
En ce moment, Lafare ouvrit les yeux et reconnut d’Harmental
dans l’homme qui lui portait secours.
— Chevalier, lui ditil, voulezvous suivre un conseil d’ami ?
Envoyezmoi une espèce de chirurgien que vous trouverez dans la
voiture, et que j’ai amené à tout hasard ; puis, gagnez Paris au plus
vite, montrezvous ce soir au bal de l’opéra, et si l’on vous demande
de mes nouvelles, dites qu’il y a huit jours que vous ne m’avez vu.
Quant à moi, vous pouvez être parfaitement tranquille, votre nom ne
sortira point de ma bouche. Au reste, s’il vous arrivait quelque
mauvaise discussion avec la connétable, faiteslemoi savoir au plus
tôt, et nous nous arrangerions de manière que la chose n’eût pas de
suite.
— Merci, monsieur le marquis, répondit d’Harmental ; je vous
quitte parce que je sais vous laisser en meilleures mains que les
miennes ; autrement, croyezmoi, rien n’aurait pu me séparer de vous
avant que je vous visse couché dans votre lit.
— Bon voyage, mon cher Valef ! dit Fargy, car je ne pense pas
que ce soit cette égratignure qui vous empêche de partir. À votre
retour, n’oubliez pas que vous avez un ami, place LouisleGrand, n°
14.
— Et vous, mon cher Fargy, si vous avez quelque commission
19
pour Madrid, vous n’avez qu’à le dire, et vous pouvez compter
qu’elle sera faite avec l’exactitude et le zèle d’un bon camarade.
Et les deux amis, se donnèrent une poignée de main, comme s’il
ne s’était absolument rien passé.
— Adieu, jeune homme, adieu, dit le capitaine à Ravanne.
N’oubliez pas le conseil que je vous ai donné :
Laissez là Berthelot et prenez BoisRobert ; surtout soyez calme,
rompez dans l’occasion, parez à temps, et vous serez une des plus
fines lames du royaume de France. Ma colichemarde dit bien des
choses agréables à la maîtressebroche de madame votre mère.
Ravanne, quelle que fût sa présence d’esprit, ne trouva rien à
répondre au capitaine ; il se contenta de le saluer, et s’approcha de
Lafare, qui lui parut le plus malade des deux blessés.
Quant à d’Harmental, à Valef et au capitaine, ils gagnèrent l’allée
où ils retrouvèrent le carrosse de louage, et dans le carrosse le
chirurgien qui faisait un somme. D’Harmental le réveilla et lui
annonça, en lui montrant le chemin qu’il devait suivre, que le
marquis de Lafare et le comte de Fargy avaient besoin de ses
services. Il ordonna en outre à son valet de descendre de cheval et de
suivre le chirurgien, afin de lui servir d’aide ; puis, se retournant vers
le capitaine :
— Capitaine, lui ditil, je crois qu’il ne serait pas prudent d’aller
manger le déjeuner que nous avions commandé ; recevez donc tous
mes remerciements pour le coup de main que vous m’avez donné, et,
en souvenir de moi, comme vous êtes à pied, à ce qu’il me paraît,
veuillez accepter un de mes deux chevaux. Vous pouvez prendre au
hasard : ce sont de bonnes bêtes ; la plus mauvaise des deux ne vous
laissera pas dans l’embarras quand vous n’aurez besoin que de lui
faire faire huit à dix lieues en une heure.
— Ma foi ! chevalier, répondit le capitaine en jetant de côté un
regard sur le cheval qui lui était offert si généreusement, il ne fallait
rien pour cela ; entre gentilshommes, le sang et la bourse sont choses
qui se prêtent tous les jours.
Mais vous faites les choses de si bonne grâce que je ne saurais
vous refuser. Si vous aviez jamais besoin de moi pour quelque chose
20
que ce fût, souvenezvous, en revanche, que je suis à votre service.
— Et le cas échéant, monsieur, où vous retrouveraije ? demanda
en souriant d’Harmental.
— Je n’ai pas de domicile bien arrêté, chevalier ; mais vous aurez
toujours de mes nouvelles en allant chez la Fillon, en demandant la
Normande, et en vous informant à elle du capitaine Roquefinette.
Et comme les deux jeunes gens remontaient chacun sur son cheval
le capitaine en fit autant, non sans remarquer en luimême que le
chevalier d’Harmental lui avait laissé le plus beau des trois.
Alors, comme ils étaient près d’un carrefour, chacun prit sa route
et s’éloigna au grand galop.
Le baron de Valef rentra par la barrière de Passy et se rendit droit
à l’Arsenal, prit les commissions de la duchesse du Maine, de la
maison de laquelle il était, et partit le même jour pour l’Espagne.
Le capitaine Roquefinette fit trois ou quatre tours au pas, au trot et
au galop dans le bois de Boulogne, afin d’apprécier les différentes
qualités de sa monture, et ayant reconnu que c’était, comme l’avait
dit le chevalier, un animal de belle et bonne race, il revint fort
satisfait chez maître Durand, où il mangea à lui seul le déjeuner qui
était commandé pour trois.
Le même jour, il conduisit son cheval au marché aux chevaux, et
le vendit soixante louis. C’était la moitié de ce qu’il valait, mais il
faut savoir faire des sacrifices quand on veut réaliser promptement.
Quant au chevalier d’Harmental, il prit l’allée de la Muette,
regagna Paris par la grande avenue des ChampsÉlysées, et trouva en
rentrant chez lui, rue de Richelieu, deux lettres qui l’attendaient.
L’une de ces deux lettres était d’une écriture si bien connue à lui
qu’il tressaillit de tout son corps en la regardant, et qu’après y avoir
porté la main avec la même hésitation que s’il allait toucher un
charbon ardent, il l’ouvrit avec un tremblement qui décelait
l’importance qu’il y attachait. Elle contenait ce qui suit :
« Mon cher chevalier,
On n’est pas maître de son cœur, vous le savez, et c’est une des
misères de notre nature que de ne pouvoir longtemps aimer ni la
même personne ni la même chose. Quant à moi je veux au moins
21
avoir sur les autres femmes le mérite de ne pas tromper celui qui a
été mon amant. Ne venez donc pas à votre heure accoutumée car on
vous dirait que je n’y suis pas, et je suis si bonne que je ne voudrais
pas risquer l’âme d’un valet ou d’une femme de chambre en leur
faisant faire un si gros mensonge.
Adieu, mon cher chevalier ; ne gardez point de moi un trop
mauvais souvenir, et faites que je pense encore de vous dans dix ans
ce que j’en pense à cette heure, c’estàdire que vous êtes un des plus
galants gentilshommes de France.
Sophie d’Averne. »
— Mordieu ! s’écria d’Harmental en frappant du poing sur une
charmante table de Boulle qu’il mit en morceaux, si j’avais tué ce
pauvre Lafare, je ne m’en serais consolé de ma vie !
Après cette explosion, qui le soulagea quelque peu, le chevalier se
mit à marcher de sa porte à sa fenêtre d’un air qui prouvait que le
pauvre garçon avait encore besoin de quelques déceptions de ce
genre pour être à la hauteur de la morale philosophique que lui
prêchait la belle infidèle. Puis, après quelques tours, il aperçut à terre
la seconde lettre, qu’il avait complètement oubliée. Deux ou trois fois
encore il passa près d’elle en la regardant avec une superbe
indifférence ; enfin, comme il pensa qu’elle ferait peutêtre diversion
à la première il la ramassa dédaigneusement, l’ouvrit avec lenteur,
regarda l’écriture, qui lui était inconnue, chercha la signature, qui
était absente, et, ramené par cet air de mystère à quelque curiosité, il
lut ce qui suit :
« Chevalier,
Si vous avez dans l’esprit le quart du romanesque et dans le cœur
la moitié du courage que vos amis prétendent y reconnaître, on est
prêt à vous offrir une entreprise digne de vous et dont le résultat sera
à la fois de vous venger de l’homme que vous détestez le plus au
monde et de vous conduire à un but si brillant que, dans vos plus
beaux rêves, vous n’avez jamais rien espéré de pareil. Le bon génie
qui doit vous mener par ce chemin enchanté, et auquel il faut vous
fier entièrement, vous attendra ce soir, de minuit à deux heures, au
bal de l’Opéra. Si vous y venez sans masque, il ira à vous ; si vous y
22
venez masqué, vous le reconnaîtrez à un ruban violet qu’il portera sur
l’épaule gauche. Le mot d’ordre est : Sésame, ouvretoi ! Prononcez
le hardiment, et vous verrez s’ouvrir une caverne bien autrement
merveilleuse que celle d’AliBaba. »
— À la bonne heure ! dit d’Harmental ; et si le génie au ruban
violet tient seulement la moitié de sa promesse, ma foi ! il a trouvé
son homme !
23
Chapitre 3
Le chevalier Raoul d’Harmental, avec qui, avant de passer outre,
il est nécessaire que nos lecteurs fassent plus ample connaissance,
était l’unique rejeton d’une des meilleures familles du Nivernais.
Quoique cette famille n’eût jamais joué un rôle important dans
l’histoire, elle ne manquait pas cependant d’une certaine illustration,
qu’elle avait acquise, soit par ellemême, soit par ses alliances. Ainsi,
le père du chevalier, le sire Gaston d’Harmental, étant venu en 1682
à Paris, et ayant eu la fantaisie de monter dans les carrosses du roi,
avait fait, haut la main, ses preuves de 1399, opération héraldique
qui, s’il faut en croire un mémoire du parlement, aurait fort
embarrassé plus d’un duc et pair. D’un autre côté, son oncle
maternel, monsieur de Torigny, ayant été nommé chevalier de
l’Ordre, à la promotion de 1694, avait avoué, en faisant reconnaître
ses seize quartiers que le plus beau de son visage, comme on le disait
alors, était fait des d’Harmental, avec qui ses ancêtres étaient en
alliance depuis trois cents ans. En voilà donc assez pour satisfaire
aux exigences aristocratiques de l’époque sur laquelle nous écrivons.
Le chevalier n’était ni pauvre ni riche, c’estàdire que son père en
mourant lui avait laissé une terre située dans les environs de Nevers,
laquelle lui rapportait quelque chose comme vingtcinq ou trente
mille livres de rente.
C’était de quoi vivre fort grandement dans sa province ; mais le
chevalier avait reçu une excellente éducation, et il se sentait une
grande ambition dans le cœur ; il avait donc, à sa majorité, c’està
dire vers 1711, quitté sa province, et était accouru à Paris.
24
Sa première visite avait été pour le comte de Torigny, sur lequel il
comptait fort pour le mettre en cour. Malheureusement, à cette
époque, le comte de Torigny n’y était pas luimême. Mais comme il
se souvenait toujours avec grand plaisir, ainsi que nous l’avons dit,
de la famille d’Harmental, il recommanda son neveu au chevalier de
Villarceaux, et le chevalier de Villarceaux qui n’avait rien à refuser à
son ami le comte de Torigny, conduisit le jeune homme chez
madame de Maintenon.
Madame de Maintenon avait une qualité : c’était d’être restée
l’amie de ses anciens amants. Elle reçut parfaitement le chevalier
d’Harmental, grâce aux vieux souvenirs qui le recommandaient
auprès d’elle, et quelques jours après le maréchal de Villars étant
venu lui faire sa cour, elle lui dit quelques mots si pressants en faveur
de son jeune protégé, que le maréchal, enchanté de trouver une
occasion d’être agréable à cette reine in partibus, répondit qu’à
compter de cette heure il attachait le chevalier d’Harmental à sa
maison militaire, et s’empresserait de lui offrir toutes les occasions
de justifier la bonne opinion que son auguste protectrice voulait bien
avoir de lui.
Ce fut une grande joie pour le chevalier que de se voir ouvrir une
pareille porte. La campagne qui allait avoir lieu était définitive.
Louis XIV en était arrivé à la dernière période de son règne, à
l’époque des revers. Tallard et Marsin avaient été battus à Hochstett,
Villeroy à Ramillies, et Villars luimême, le héros de Friedlingen,
venait de perdre la fameuse bataille de Malplaquet contre
Marlborough et Eugène.
L’Europe, un instant étouffée sous la main de Colbert et de
Louvois, réagissait tout entière contre la France. La situation des
affaires était extrême ; le roi, comme un malade désespéré qui change
à chaque heure de médecin, changeait chaque jour de ministres. Mais
chaque essai nouveau révélait une impuissance nouvelle. La France
ne pouvait plus soutenir la guerre et ne pouvait pas parvenir à faire la
paix. Vainement elle offrait d’abandonner l’Espagne et de restreindre
ses frontières : ce n’était point assez d’humiliation. On exigeait que
le roi donnât passage aux armées ennemies à travers la France pour
25
aller chasser son petitfils du trône de Charles II, et qu’il livrât
comme places de sûreté Cambrai, Metz, La Rochelle et Bayonne, à
moins qu’il n’aimât mieux, dans un an pour tout délai, le détrôner
luimême à force ouverte. Voilà à quelles conditions une trêve était
accordée au vainqueur des Dunes, de Senef, de Fleurus, de
Steinkerque et de la Marsaille ; à celui qui, jusquelà, avait tenu dans
le pan de son manteau royal la paix et la guerre ; à celui qui
s’intitulait le distributeur des couronnes, le châtieur des nations, le
grand, l’immortel ; à celui enfin pour lequel, depuis un demisiècle,
on taillait le marbre, on fondait le bronze, on mesurait l’alexandrin,
on épuisait l’encens.
Louis XIV avait pleuré en plein conseil.
Ces larmes avaient produit une armée, et cette armée avait été
donnée à Villars.
Villars marcha droit à l’ennemi, dont le camp était à Denain, et
qui, les yeux fixés sur l’agonie de la France, s’endormait dans sa
sécurité. Jamais responsabilité plus grande n’avait chargé une tête.
Sur un coup de dé, Villars allait jouer le salut de la France.
Les alliés avaient établi, entre Denain et Marchiennes, une ligne
de fortifications que, dans leur orgueil anticipé, Albemarle et Eugène
appelaient la grande route de Paris. Villars résolut d’enlever Denain
par surprise, et, Albemarle battu, de battre Eugène.
Il fallait, pour réussir dans une si audacieuse entreprise, tromper
non seulement l’armée ennemie, mais l’armée française, le succès de
ce coup de main étant dans son impossibilité même.
Villars proclama bien haut son intention de forcer les lignes de
Landrecies.
Une nuit, à une heure convenue toute son armée s’ébranle et
marche dans la direction de cette ville. Tout à coup l’ordre est donné
d’obliquer à gauche ; le génie jette trois ponts sur l’Escaut. Villars
franchit le fleuve sans obstacle, se jette dans les marais que l’on
croyait impraticables, et où le soldat s’avance ayant de l’eau jusqu’à
la ceinture ; il marche droit aux premières redoutes, et les emporte
presque sans coup férir, s’empare successivement d’une lieue de
fortifications, atteint Denain, franchit le fossé qui l’entoure, pénètre
26
dans la ville, et, en arrivant sur la place, trouve son jeune protégé, le
chevalier d’Harmental, qui lui présente l’épée d’Albemarle, qu’il
venait de faire prisonnier.
En ce moment, on annonce l’arrivée d’Eugène. Villars se
retourne, atteint avant lui le pont sur lequel ce dernier doit passer,
s’en empare et attend.
Là, le véritable combat s’engage, car la prise de Denain n’a été
qu’une escarmouche.
Eugène pousse attaque sur attaque, revient sept fois à la tête de ce
pont briser ses meilleures troupes contre l’artillerie qui le protège et
contre les baïonnettes qui le défendent ; enfin ayant ses habits criblés
de balles, tout sanglant de deux blessures, monte sur son troisième
cheval, et le vainqueur de Hochstett et de Malplaquet se retire en
pleurant de rage et en mordant ses gants de colère. En six heures tout
a changé de face : la France est sauvée, et Louis XIV est toujours le
grand roi.
D’Harmental s’était conduit en homme qui d’un seul coup veut
gagner ses éperons. Villars, en le voyant tout couvert de sang et de
poussière, se rappela par qui il avait été recommandé, et le fit
approcher de lui, pendant qu’au milieu du champ de bataille même il
écrivait sur un tambour le résultat de la journée. En voyant
d’Harmental, Villars interrompit sa lettre.
— Êtesvous blessé ? lui demandatil.
— Oui, monsieur le maréchal, mais si légèrement que cela ne vaut
pas la peine d’en parler.
— Vous sentezvous la force de faire soixante lieues à cheval à
franc étrier sans vous reposer une heure, une minute, une seconde ?
— Je me sens capable de tout, monsieur le maréchal, pour le
service du roi et le vôtre.
— Alors, partez à l’instant même, descendez chez madame de
Maintenon, diteslui de ma part ce que vous venez de voir, et
annoncezlui le courrier qui en apportera la relation officielle. Si elle
veut vous conduire chez le roi, laissezvous faire.
D’Harmental comprit l’importance de la mission dont on le
chargeait, et, tout poudreux, tout sanglant, sans débotter, il sauta sur
27
un cheval frais et gagna la première poste ; douze heures après, il
était à Versailles.
Villars avait prévu ce qui devait arriver. Aux premiers mots qui
sortirent de la bouche du chevalier, madame de Maintenon le prit par
la main et le conduisit chez le roi. Le roi travaillait avec Voisin dans
sa chambre, contre l’habitude, car il était un peu malade. Madame de
Maintenon ouvrit la porte, poussa le chevalier d’Harmental aux pieds
du roi, et levant les deux mains au ciel :
— Sire, ditelle, remerciez Dieu ; car, Votre Majesté le sait, nous
ne sommes rien par nousmêmes, et c’est de Dieu que nous vient
toute grâce.
— Qu’y atil, monsieur ? parlez ! dit vivement Louis XIV, étonné
de voir à ses pieds ce jeune homme qu’il ne connaissait pas.
— Sire, répondit le chevalier, le camp de Denain est pris ; le
comte d’Albemarle est prisonnier, le prince Eugène est en fuite ; le
maréchal de Villars met sa victoire aux pieds de Votre Majesté.
Malgré la puissance qu’il avait sur luimême, Louis XIV pâlit ; il
sentit que les jambes lui manquaient, et il s’appuya à la table pour ne
pas tomber sur son fauteuil.
— Qu’avezvous, sire ? s’écria madame de Maintenon en allant à
lui.
— J’ai, madame, que je vous dois tout, dit Louis XIV : vous
sauvez le roi, et vos amis sauvent le royaume.
Madame de Maintenon s’inclina et baisa respectueusement la
main du roi.
Alors Louis XIV, encore tout pâle et tout ému, passa derrière le
grand rideau qui fermait le salon où était son lit, et l’on entendit la
prière d’actions de grâces qu’il adressait à demivoix au Seigneur ;
puis, au bout d’un instant, il reparut calme et grave, comme si rien
n’était arrivé.
— Et maintenant, monsieur, racontezmoi la chose dans tous ses
détails.
Alors d’Harmental fit le récit de cette merveilleuse bataille, qui
venait, comme par miracle, de sauver la monarchie. Puis, lorsqu’il
eut fini :
28
— Et de vous, monsieur, dit Louis XIV, vous ne m’en dites rien ?
Cependant, si j’en juge par le sang et la boue qui couvrent encore vos
habits, vous n’êtes point resté en arrière.
— Sire, j’ai fait de mon mieux, dit d’Harmental en s’inclinant ;
mais s’il y a réellement quelque chose à dire de moi, je laisse, avec la
permission de Votre Majesté, ce soin à monsieur le maréchal de
Villars.
— C’est bien, jeune homme, et s’il vous oublie, par hasard, nous
nous souviendrons, nous. Vous devez être fatigué, allez vous
reposer ; je suis content de vous.
D’Harmental se retira tout joyeux. Madame de Maintenon le
reconduisit jusqu’à la porte. D’Harmental lui baisa la main encore
une fois, et se hâta de profiter de la permission royale qui lui était
donnée, il y avait vingtquatre heures qu’il n’avait ni bu, ni mangé, ni
dormi.
À son réveil, on lui remit un paquet que l’on avait apporté pour lui
du ministère de la guerre. C’était son brevet de colonel.
Deux mois après, la paix fut faite. L’Espagne y laissa la moitié de
sa monarchie, mais la France resta intacte.
Trois ans après, Louis XIV mourut.
Deux partis bien distincts, bien irréconciliables surtout, étaient en
présence au moment de cette mort : celui des bâtards, incarné dans
monsieur le duc du Maine, et celui des princes légitimes, représenté
par monsieur le duc d’Orléans.
Si monsieur le duc du Maine avait eu la persistance, la volonté, le
courage de sa femme, LouiseBénédicte de Condé, peutêtre, appuyé
comme il l’était par le testament royal, eûtil triomphé ; mais il eût
fallu se défendre au grand jour, comme on était attaqué, et le duc du
Maine, faible de cœur et d’esprit, dangereux à force d’être lâche,
n’était bon qu’aux choses qui se passaient pardessous terre. Il fut
menacé de face, et dès lors ses artifices sans nombre, ses faussetés
exquises, ses marches ténébreuses et profondes lui devinrent inutiles.
En un jour, et presque sans combat, il fut précipité de ce faîte où
l’avait porté l’aveugle amour du vieux roi. La chute fut lourde et
surtout honteuse ; il se retira mutilé, abandonnant la régence à son
29
rival, et ne conservant de toutes les faveurs accumulées sur lui que la
surintendance de l’éducation royale, la maîtrise de l’artillerie et le
pas sur les ducs et pairs.
L’arrêt que venait de rendre le parlement frappait la vieille cour et
tout ce qui lui était attaché.
Le père Letellier alla audevant de son exil, madame de
Maintenon se réfugia à SaintCyr, et monsieur le duc du Maine
s’enferma dans la belle villa de Sceaux pour continuer sa traduction
de Lucrèce.
Le chevalier d’Harmental avait assisté en spectateur intéressé, il
est vrai, mais en spectateur passif, à toutes ces intrigues, attendant
toujours qu’elles revêtissent un caractère qui lui permît d’y prendre
part. S’il y avait eu lutte franche et armée, il se fût rangé du côté où
la reconnaissance l’appelait. Trop jeune et trop chaste encore, si on
peut le dire en matière politique, pour tourner avec le vent de la
fortune, il resta respectueux à la mémoire de l’ancien roi et aux
ruines de la vieille cour. Son absence du PalaisRoyal, autour duquel
gravitait à cette heure tout ce qui voulait reprendre une place dans le
ciel politique, fut interprétée à opposition, et un matin, comme il
avait reçu le brevet qui lui accordait un régiment, il reçut l’arrêté qui
le lui enlevait.
D’Harmental avait l’ambition de son âge : la seule carrière
ouverte à un gentilhomme de cette époque était la carrière des
armes ; son début y avait été brillant, et le coup qui brisait à vingt
cinq ans toutes ses espérances d’avenir lui fut profondément
douloureux. Il courut chez monsieur de Villars, dans lequel il avait
trouvé autrefois un protecteur si ardent. Le maréchal le reçut avec la
froideur d’un homme qui ne serait pas fâché, non seulement
d’oublier le passé, mais de voir le passé oublié. Aussi, d’Harmental
comprit que le vieux courtisan était en train de changer de peau, et il
se retira discrètement.
Quoique cet âge fût essentiellement celui de l’égoïsme, la
première épreuve qu’en faisait le chevalier lui fut amère ; mais il était
dans cette heureuse période de la vie où il est rare que les douleurs de
l’ambition trompée soient profondes et durables ; l’ambition est la
30
passion de ceux qui n’en ont pas d’autres, et le chevalier avait encore
toutes celles que l’on a à vingtcinq ans.
D’ailleurs, l’esprit du temps n’était point tourné encore à la
mélancolie. C’est un sentiment tout moderne, né du bouleversement
des fortunes et de l’impuissance des hommes. Au dixhuitième
siècle, il était rare que l’on rêvât aux choses abstraites, et que l’on
aspirât à l’inconnu ; on allait droit aux plaisirs, à la gloire ou à la
fortune, et pourvu qu’on fût beau, brave ou intrigant, tout le monde
pouvait arriver là. C’était encore l’époque où l’on n’était pas humilié
de son bonheur. Aujourd’hui, l’esprit domine de trop haut la matière
pour que l’on ose avouer que l’on est heureux.
Au reste, il faut l’avouer, le vent soufflait à la joie, et la France
semblait voguer, toutes voiles dehors, à la recherche de quelqu’une
de ces îles enchantées comme on en trouve sur la carte dorée des
Mille et une Nuits.
Après ce long et triste hiver de la vieillesse de Louis XIV,
apparaissait tout à coup le printemps joyeux et brillant d’une jeune
royauté : chacun s’épanouissait à ce nouveau soleil, radieux et
bienfaisant, et s’en allait bourdonnant et insoucieux, comme font les
papillons et les abeilles aux premiers jours de la belle saison.
Le plaisir, absent et proscrit pendant plus de trente ans, était de
retour ; on l’accueillait comme un ami qu’on n’espérait plus revoir ;
on courait à lui de tous côtés, franchement, les bras et le cœur
ouverts, et, de peur sans doute qu’il ne s’échappât de nouveau, on
mettait à profit tous les instants.
Le chevalier d’Harmental avait gardé sa tristesse huit jours ; puis
il s’était mêlé à la foule, puis il avait été entraîné par le tourbillon, et
ce tourbillon l’avait jeté aux pieds d’une jolie femme.
Trois mois il avait été l’homme le plus heureux du monde ;
pendant trois mois il avait oublié SaintCyr, les Tuileries, le Palais
Royal ; il ne savait plus s’il y avait une madame de Maintenon, un
roi, un régent ; il savait qu’il fait bon vivre quand on est aimé, et il ne
voyait pas pourquoi il ne vivrait pas et il n’aimerait pas toujours.
Il en était là de son rêve lorsque, ainsi que nous l’avons dit,
soupant avec son ami le baron de Valef dans une honorable maison
31
de la rue SaintHonoré, il avait été tout à coup brutalement réveillé
par Lafare.
Les amoureux ont, en général, le réveil mauvais, et l’on a vu que,
sous ce rapport, d’Harmental n’était pas plus endurant que les autres.
C’était, au reste, d’autant plus pardonnable au chevalier qu’il
croyait aimer véritablement, et que, dans sa bonne foi toute juvénile,
il pensait que rien ne pourrait reprendre dans son cœur la place de cet
amour ; c’était un reste de préjugé provincial qu’il avait apporté des
environs de Nevers.
Aussi, comme nous l’avons vu, la lettre si étrange, mais du moins
si franche, de madame d’Averne, au lieu de lui inspirer l’admiration
qu’elle méritait à cette folle époque, l’avait tout d’abord accablé.
C’est le propre de chaque douleur qui nous arrive de réveiller toutes
les douleurs passées, que l’on croyait disparues et qui n’étaient
qu’endormies.
L’âme a ses cicatrices comme le corps, et elles ne se ferment
jamais si bien qu’une blessure nouvelle ne les puisse rouvrir.
D’Harmental se retrouva ambitieux ; la perte de sa maîtresse lui avait
rappelé la perte de son régiment.
Aussi ne fallaitil rien moins que la seconde lettre si inattendue et
si mystérieuse, pour faire quelque diversion à la douleur du chevalier.
Un amoureux de nos jours l’eût jetée avec dédain loin de lui, et se
serait méprisé luimême, s’il n’avait pas creusé sa douleur de
manière à s’en faire, pour huit jours au moins, une pâle et poétique
mélancolie ; mais un amoureux de la régence était bien autrement
accommodant. Le suicide n’était pas encore découvert, et l’on ne se
noyait alors, quand d’aventure on tombait à l’eau, que si l’on ne
trouvait pas sous sa main la moindre petite paille où se retenir.
D’Harmental n’affecta donc pas la fatuité de la tristesse. Il décida,
en soupirant, il est vrai, qu’il irait au bal de l’opéra, et, pour un amant
trahi d’une manière si imprévue et si cruelle, c’était déjà beaucoup.
Mais, il faut le dire à la honte de notre pauvre espèce, ce qui le
porta surtout à cette philosophique détermination, c’est que la
seconde lettre, celle où on lui promettait de si grandes merveilles,
était d’une écriture de femme.
32