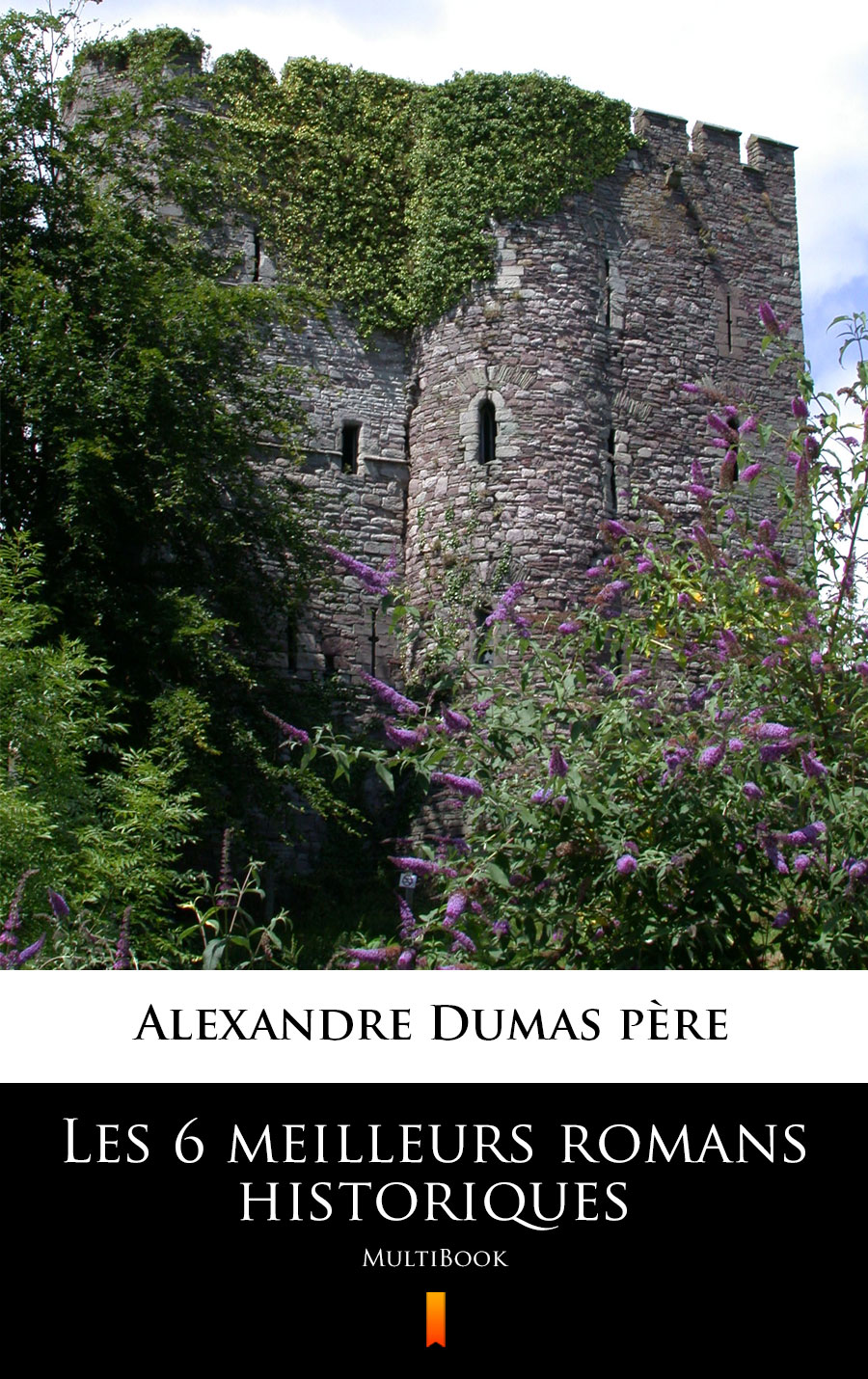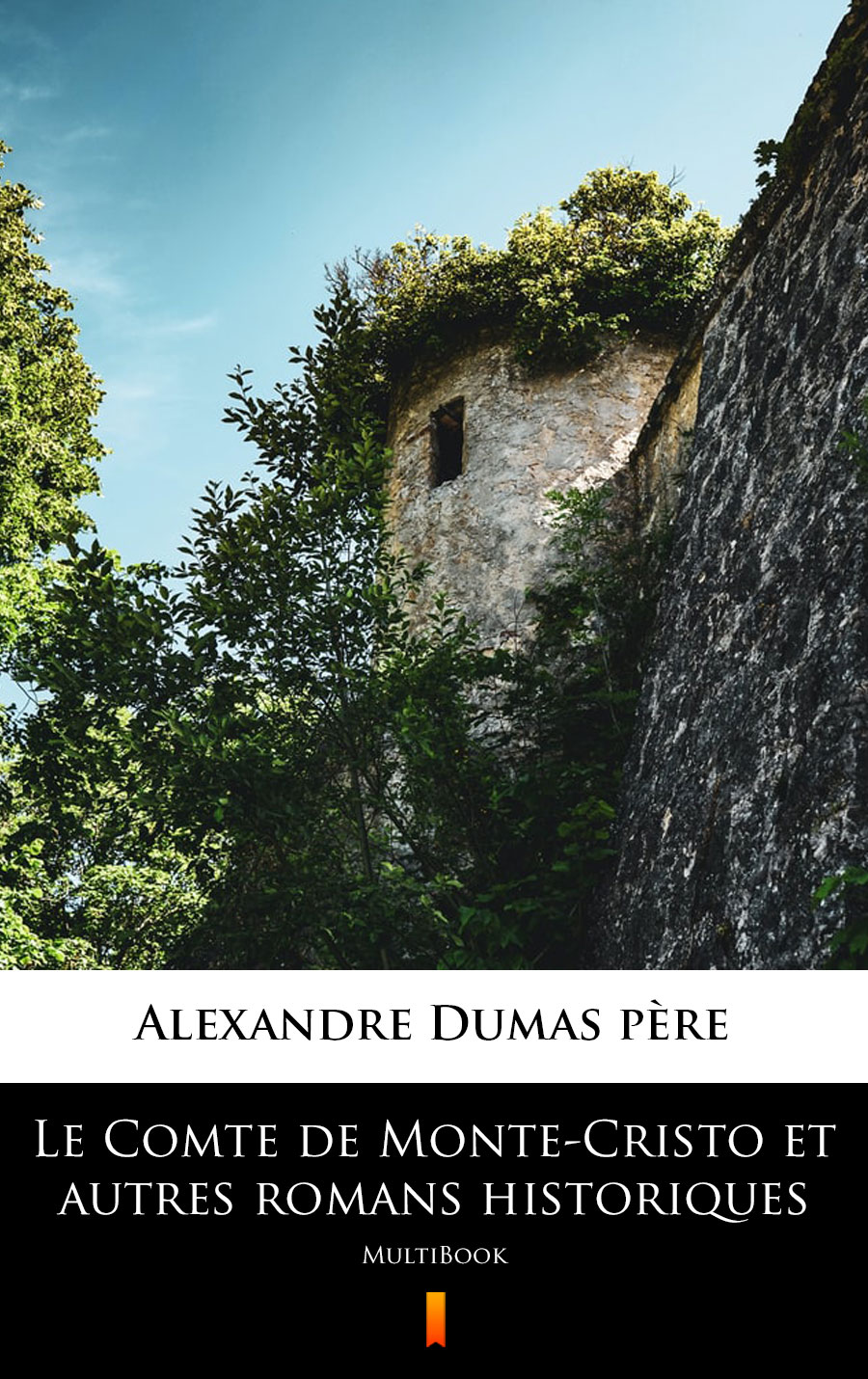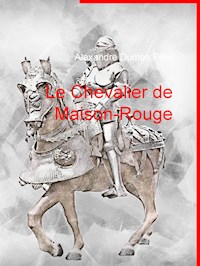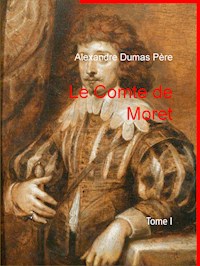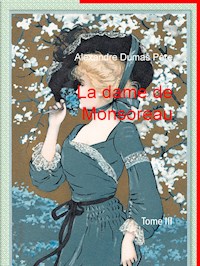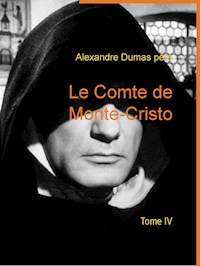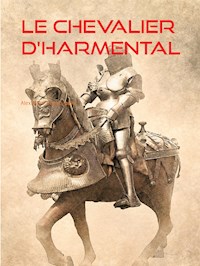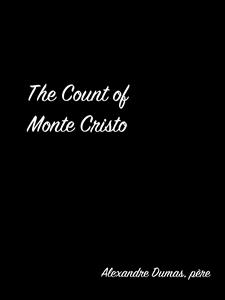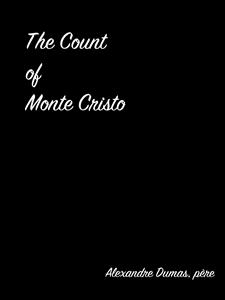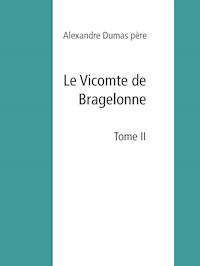
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
L'action se déroule entre 1660 et 1666. Dans Le Vicomte de Bragelonne, les héros des deux premiers livres ont beaucoup vieilli. ... Raoul, le vicomte de Bragelonne, le fils d'Athos, meurt à la guerre en se portant à la charge lors d'un combat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 772
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Vicomte de Bragelonne
Pages de titreVannesmaîtresseChapitre LXXXIII : Au HavreChapitre LXXXIV : En merChapitre LXXXV : Les tentesChapitre LXXXVI : La nuitLorraine pensait de Madamemademoiselle de MontalaisBuckinghamChapitre XCII : For ever !vicomte de Bragelonnel’eauChapitre XCVI : Le jeu du roiBaisemeaux de MontlezunBaisemeauxChapitre C : Les deux amiesChapitre CII : La dotChapitre CIV : Triple amourChapitre CVII : Le médiateurChapitre CIX : FontainebleauChapitre CX : Le bainaux papillonsFontainebleauroyaldu matinà l’auberge du Beau-PaonannéeChapitre CXXVIII : Missiondryadeet d’une dryadePage de copyright1
Le Vicomte de Bragelonne,
Tome II.
Alexandre Dumas père
2
Vannes
Porthos et d’Artagnan étaient entrés à l’évêché par une porte
particulière, connue des seuls amis de la maison.
Il va sans dire que Porthos avait servi de guide à d’Artagnan. Le
digne baron se comportait un peu partout comme chez lui.
Cependant, soit reconnaissance tacite de cette sainteté du personnage
d’Aramis et de son caractère, soit habitude de respecter ce qui lui
imposait moralement, digne habitude qui avait toujours fait de
Porthos un soldat modèle et un esprit excellent, par toutes ces
raisons, disons-nous, Porthos conserva, chez Sa Grandeur l’évêque
de Vannes, une sorte de réserve que d’Artagnan remarqua tout
d’abord dans l’attitude qu’il prit avec les valets et les commensaux.
Cependant cette réserve n’allait pas jusqu’à se priver de questions,
Porthos questionna.
On apprit alors que Sa Grandeur venait de rentrer dans ses
appartements, et se préparait à paraître, dans l’intimité, moins
majestueuse qu’elle n’avait paru avec ses ouailles.
En effet, après un petit quart d’heure que passèrent d’Artagnan et
Porthos à se regarder mutuellement le blanc des yeux, à tourner leurs
pouces dans les différentes évolutions qui vont du nord au midi, une
porte de la salle s’ouvrit et l’on vit paraître Sa Grandeur vêtue du
petit costume complet de prélat.
Aramis portait la tête haute, en homme qui a l’habitude du
commandement, la robe de drap violet retroussée sur le côté, et le
poing sur la hanche.
En outre, il avait conservé la fine moustache et la royale allongée
3
du temps de Louis XIII.
Il exhala en entrant ce parfum délicat qui, chez les hommes
élégants, chez les femmes du grand monde, ne change jamais, et
semble s’être incorporé dans la personne dont il est devenu
l’émanation naturelle. Cette fois seulement le parfum avait retenu
quelque chose de la sublimité religieuse de l’encens. Il n’enivrait
plus, il pénétrait ; il n’inspirait plus le désir, il inspirait le respect.
Aramis, en entrant dans la chambre, n’hésita pas un instant, et
sans prononcer une parole qui, quelle qu’elle fût, eût été froide en
pareille occasion, il vint droit au mousquetaire si bien déguisé sous le
costume de M. Agnan, et le serra dans ses bras avec une tendresse
que le plus défiant n’eût pas soupçonnée de froideur ou d’affectation.
D’Artagnan, de son côté, l’embrassa d’une égale ardeur. Porthos
serra la main délicate d’Aramis dans ses grosses mains, et
d’Artagnan remarqua que Sa Grandeur lui serrait la main gauche
probablement par habitude, attendu que Porthos devait déjà dix fois
lui avoir meurtri ses doigts ornés de bagues en broyant sa chair dans
l’étau de son poignet. Aramis, averti par la douleur, se défiait donc et
ne présentait que des chairs à froisser et non des doigts à écraser
contre de l’or ou des facettes de diamant.
Entre deux accolades, Aramis regarda en face d’Artagnan, lui
offrit une chaise et s’assit dans l’ombre, observant que le jour donnait
sur le visage de son interlocuteur.
Cette manœuvre, familière aux diplomates et aux femmes,
ressemble beaucoup à l’avantage de la garde que cherchent, selon
leur habileté ou leur habitude, à prendre les combattants sur le terrain
du duel. D’Artagnan ne fut pas dupe de la manœuvre ; mais il ne
parut pas s’en apercevoir.
Il se sentait pris ; mais, justement parce qu’il était pris, il se sentait
sur la voie de la découverte, et peu lui importait, vieux condottiere,
de se faire battre en apparence, pourvu qu’il tirât de sa prétendue
défaite les avantages de la victoire.
Ce fut Aramis qui commença la conversation.
– Ah ! cher ami ! mon bon d’Artagnan ! dit-il, quel excellent
hasard !
– C’est un hasard, mon révérend compagnon, dit d’Artagnan, que
4
j’appellerai de l’amitié. Je vous cherche, comme toujours je vous ai
cherché, dès que j’ai eu quelque grande entreprise à vous offrir ou
quelques heures de liberté à vous donner.
– Ah ! vraiment, dit Aramis sans explosion, vous me cherchez ?
– Eh ! oui, il vous cherche, mon cher Aramis, dit Porthos, et la
preuve, c’est qu’il m’a relancé, moi, à Belle-Île. C’est aimable, n’est-
ce pas ?
– Ah ! fit Aramis, certainement, à Belle-Île…
« Bon ! dit d’Artagnan, voilà mon butor de Porthos qui, sans y
songer, a tiré du premier coup le canon d’attaque. »
– À Belle-Île, dit Aramis, dans ce trou, dans ce désert ! C’est
aimable, en effet.
– Et c’est moi qui lui ai appris que vous étiez à Vannes, continua
Porthos du même ton.
D’Artagnan arma sa bouche d’une finesse presque ironique.
– Si fait, je le savais, dit-il ; mais j’ai voulu voir.
– Voir quoi ?
– Si notre vieille amitié tenait toujours ; si, en nous voyant, notre
cœur, tout racorni qu’il est par l’âge, laissait encore échapper ce bon
cri de joie qui salue la venue d’un ami.
– Eh bien ! vous avez dû être satisfait ? demanda Aramis.
– Couci-couci.
– Comment cela ?
– Oui, Porthos m’a dit : « Chut ! » et vous…
– Eh bien ! et moi ?
– Et vous, vous m’avez donné votre bénédiction.
– Que voulez-vous ! mon ami, dit en souriant Aramis, c’est ce
qu’un pauvre prélat comme moi a de plus précieux.
– Allons donc, mon cher ami.
– Sans doute.
– On dit cependant à Paris que l’évêché de Vannes est un des
meilleurs de France.
– Ah ! vous voulez parler des biens temporels ? dit Aramis d’un
air détaché.
– Mais certainement j’en veux parler. J’y tiens, moi.
– En ce cas, parlons-en, dit Aramis avec un sourire.
5
– Vous avouez être un des plus riches prélats de France ?
– Mon cher, puisque vous me demandez mes comptes, je vous
dirai que l’évêché de Vannes vaut vingt mille livres de rente, ni plus
ni moins. C’est un diocèse qui renferme cent soixante paroisses.
– C’est fort joli, dit d’Artagnan.
– C’est superbe, dit Porthos.
– Mais cependant, reprit d’Artagnan en couvrant Aramis du
regard, vous ne vous êtes pas enterré ici à jamais ?
– Pardonnez-moi. Seulement je n’admets pas le mot enterré.
– Mais il me semble qu’à cette distance de Paris on est enterré, ou
peu s’en faut.
– Mon ami, je me fais vieux, dit Aramis ; le bruit et le mouvement
de la ville ne me vont plus.
« À cinquante-sept ans, on doit chercher le calme et la méditation.
Je les ai trouvés ici. Quoi de plus beau et de plus sévère à la fois que
cette vieille Armorique ? Je trouve ici, cher d’Artagnan, tout le
contraire de ce que j’aimais autrefois, et c’est ce qu’il faut à la fin de
la vie, qui est le contraire du commencement. Un peu de mon plaisir
d’autrefois vient encore m’y saluer de temps en temps sans me
distraire de mon salut. Je suis encore de ce monde, et cependant, à
chaque pas que je fais, je me rapproche de Dieu.
– Éloquent, sage, discret, vous êtes un prélat accompli, Aramis, et
je vous félicite.
– Mais, dit Aramis en souriant, vous n’êtes pas seulement venu,
cher ami, pour me faire des compliments… Parlez, qui vous amène ?
Serais-je assez heureux pour que, d’une façon quelconque, vous
eussiez besoin de moi ?
– Dieu merci, non, mon cher ami, dit d’Artagnan, ce n’est rien de
cela. Je suis riche et libre.
– Riche ?
– Oui, riche pour moi ; pas pour vous ni pour Porthos, bien
entendu. J’ai une quinzaine de mille livres de rente.
Aramis le regarda soupçonneux. Il ne pouvait croire, surtout en
voyant son ancien ami avec cet humble aspect, qu’il eût fait une si
belle fortune.
Alors d’Artagnan, voyant que l’heure des explications était venue,
6
raconta son histoire d’Angleterre.
Pendant le récit, il vit dix fois briller les yeux et tressaillir les
doigts effilés du prélat.
Quant à Porthos, ce n’était pas de l’admiration qu’il manifestait
pour d’Artagnan, c’était de l’enthousiasme, c’était du délire. Lorsque
d’Artagnan eut achevé son récit :
– Eh bien ? fit Aramis.
– Eh bien ! dit d’Artagnan, vous voyez que j’ai en Angleterre des
amis et des propriétés, en France un trésor. Si le cœur vous en dit, je
vous les offre. Voilà pourquoi je suis venu.
Si assuré que fût son regard, il ne put soutenir en ce moment le
regard d’Aramis. Il laissa donc dévier son œil sur Porthos, comme
fait l’épée qui cède à une pression toute-puissante et cherche un autre
chemin.
– En tout cas, dit l’évêque, vous avez pris un singulier costume de
voyage, cher ami.
– Affreux ! je le sais. Vous comprenez que je ne voulais voyager
ni en cavalier ni en seigneur. Depuis que je suis riche, je suis avare.
– Et vous dites donc que vous êtes venu à Belle-Île ? fit Aramis
sans transition.
– Oui, répliqua d’Artagnan, je savais y trouver Porthos et vous.
– Moi ! s’écria Aramis. Moi ! depuis un an que je suis ici je n’ai
point une seule fois passé la mer.
– Oh ! fit d’Artagnan, je ne vous savais pas si casanier.
– Ah ! cher ami, c’est qu’il faut vous dire que je ne suis plus
l’homme d’autrefois. Le cheval m’incommode, la mer me fatigue ; je
suis un pauvre prêtre souffreteux, se plaignant toujours, grognant
toujours, et enclin aux austérités, qui me paraissent des
accommodements avec la vieillesse, des pourparlers avec la mort. Je
réside, mon cher d’Artagnan, je réside.
– Eh bien ! tant mieux, mon ami, car nous allons probablement
devenir voisins.
– Bah ! dit Aramis, non sans une certaine surprise qu’il ne chercha
même pas à dissimuler, vous, mon voisin ?
– Eh ! mon Dieu, oui.
– Comment cela ?
7
– Je vais acheter des salines fort avantageuses qui sont situées
entre Piriac et Le Croisic. Figurez-vous, mon cher, une exploitation
de douze pour cent de revenu clair ; jamais de non-valeur, jamais de
faux frais ; l’océan, fidèle et régulier, apporte toutes les six heures
son contingent à ma caisse. Je suis le premier Parisien qui ait imaginé
une pareille spéculation. N’éventez pas la mine, je vous en prie, et
avant peu nous communiquerons, J’aurai trois lieues de pays pour
trente mille livres.
Aramis lança un regard à Porthos comme pour lui demander si
tout cela était bien vrai, si quelque piège ne se cachait point sous ces
dehors d’indifférence. Mais bientôt, comme honteux d’avoir consulté
ce pauvre auxiliaire, il rassembla toutes ses forces pour un nouvel
assaut ou pour une nouvelle défense.
– On m’avait assuré, dit-il, que vous aviez eu quelque démêlé
avec la cour, mais que vous en étiez sorti comme vous savez sortir de
tout, mon cher d’Artagnan, avec les honneurs de la guerre.
– Moi ? s’écria le mousquetaire avec un grand éclat de rire
insuffisant à cacher son embarras ; car, à ces mots d’Aramis, il
pouvait le croire instruit de ses dernières relations avec le roi ; moi ?
Ah ! racontez-moi donc cela, mon cher Aramis.
– Oui, l’on m’avait raconté, à moi, pauvre évêque perdu au milieu
des landes, on m’avait dit que le roi vous avait pris pour confident de
ses amours.
– Avec qui ?
– Avec Mlle de Mancini.
D’Artagnan respira.
– Ah ! je ne dis pas non, répliqua-t-il.
– Il paraît que le roi vous a emmené un matin au-delà du pont de
Blois pour causer avec sa belle.
– C’est vrai, dit d’Artagnan. Ah ! vous savez cela ? Mais alors,
vous devez savoir que, le jour même, j’ai donné ma démission.
– Sincère ?
– Ah ! mon ami, on ne peut plus sincère.
– C’est alors que vous allâtes chez le comte de La Fère ?
– Oui.
– Chez moi ?
8
– Oui.
– Et chez Porthos ?
– Oui.
– Était-ce pour nous faire une simple visite ?
– Non ; je ne vous savais point attachés, et je voulais vous
emmener en Angleterre.
– Oui, je comprends, et alors vous avez exécuté seul, homme
merveilleux, ce que vous vouliez nous proposer d’exécuter à nous
quatre. Je me suis douté que vous étiez pour quelque chose dans cette
belle restauration, quand j’appris qu’on vous avait vu aux réceptions
du roi Charles, lequel vous parlait comme un ami, ou plutôt comme
un obligé.
– Mais comment diable avez-vous su tout cela ? demanda
d’Artagnan, qui craignait que les investigations d’Aramis ne
s’étendissent plus loin qu’il ne le voulait.
– Cher d’Artagnan, dit le prélat, mon amitié ressemble un peu à la
sollicitude de ce veilleur de nuit que nous avons dans la petite tour du
môle, à l’extrémité du quai. Ce brave homme allume tous les soirs
une lanterne pour éclairer les barques qui viennent de la mer. Il est
caché dans sa guérite, et les pêcheurs ne le voient pas ; mais lui les
suit avec intérêt ; il les devine, il les appelle, il les attire dans la voie
du port. Je ressemble à ce veilleur ; de temps en temps quelques avis
m’arrivent et me rappellent au souvenir de tout ce que j’aimais. Alors
je suis les amis d’autrefois sur la mer orageuse du monde, moi,
pauvre guetteur auquel Dieu a bien voulu donner l’abri d’une guérite.
– Et, dit d’Artagnan, après l’Angleterre, qu’ai-je fait ?
– Ah ! voilà ! fit Aramis, vous voulez forcer ma vue. Je ne sais
plus rien depuis votre retour, d’Artagnan ; mes yeux se sont troublés.
J’ai regretté que vous ne pensiez point à moi. J’ai pleuré votre oubli.
J’avais tort. Je vous revois, et c’est une fête, une grande fête, je vous
le jure… Comment se porte Athos ?
– Très bien, merci.
– Et notre jeune pupille ?
– Raoul ?
– Oui.
– Il paraît avoir hérité de l’adresse de son père Athos et de la force
9
de son tuteur Porthos.
– Et à quelle occasion avez-vous pu juger de cela ?
– Eh ! mon Dieu ! la veille même de mon départ.
– Vraiment ?
– Oui, il y avait exécution en Grève, et, à la suite de cette
exécution, émeute. Nous nous sommes trouvés dans l’émeute, et, à la
suite de l’émeute, il a fallu jouer de l’épée ; il s’en est tiré à
merveille.
– Bah ! et qu’a-t-il fait ? dit Porthos.
– D’abord il a jeté un homme par la fenêtre, comme il eût fait d’un
ballot de coton.
– Oh ! très bien ! s’écria Porthos.
– Puis il a dégainé, pointé, estocadé, comme nous faisions dans
notre beau temps, nous autres.
– Et à quel propos cette émeute ? demanda Porthos.
D’Artagnan remarqua sur la figure d’Aramis une complète
indifférence à cette question de Porthos.
– Mais, dit-il en regardant Aramis, à propos de deux traitants à qui
le roi faisait rendre gorge, deux amis de M. Fouquet que l’on pendait.
À peine un léger froncement de sourcils du prélat indiqua-t-il qu’il
avait entendu.
– Oh ! oh ! fit Porthos, et comment les nommait-on, ces amis de
M. Fouquet ?
– MM. d’Emerys et Lyodot, dit d’Artagnan. Connaissez-vous ces
noms-là, Aramis ?
– Non, fit dédaigneusement le prélat ; cela m’a l’air de noms de
financiers.
– Justement.
– Oh ! M. Fouquet a laissé pendre ses amis ? s’écria Porthos.
– Et pourquoi pas ? dit Aramis.
– C’est qu’il me semble…
– Si on a pendu ces malheureux, c’était par ordre du roi. Or, M.
Fouquet, pour être surintendant des finances, n’a pas, je pense, droit
de vie et de mort.
– C’est égal, grommela Porthos, à la place de M. Fouquet…
Aramis comprit que Porthos allait dire quelque sottise.
10
Il brisa la conversation.
– Voyons, dit-il, mon cher d’Artagnan, c’est assez parler des
autres ; parlons un peu de vous.
– Mais, de moi, vous en savez tout ce que je puis vous en dire.
Parlons de vous, au contraire, cher Aramis.
– Je vous l’ai dit, mon ami, il n’y a plus d’Aramis en moi.
– Plus même de l’abbé d’Herblay ?
– Plus même. Vous voyez un homme que Dieu a pris par la main
et qu’il a conduit à une position qu’il ne devait ni n’osait espérer.
– Dieu ? interrogea d’Artagnan.
– Oui.
– Tiens ! c’est étrange ; on m’avait dit, à moi, que c’était M.
Fouquet.
– Qui vous a dit cela ? fit Aramis sans que toute la puissance de sa
volonté pût empêcher une légère rougeur de colorer ses joues.
– Ma foi ! c’est Bazin.
– Le sot !
– Je ne dis pas qu’il soit homme de génie, c’est vrai ; mais il me
l’a dit, et après lui, je vous le répète.
– Je n’ai jamais vu M. Fouquet, répondit Aramis avec un regard
aussi calme et aussi pur que celui d’une jeune vierge qui n’a jamais
menti.
– Mais, répliqua d’Artagnan, quand vous l’eussiez vu et même
connu, il n’y aurait point de mal à cela ; c’est un fort brave homme
que M. Fouquet.
– Ah !
– Un grand politique.
Aramis fit un geste d’indifférence.
– Un tout-puissant ministre.
– Je ne relève que du roi et du pape, dit Aramis.
– Dame ! écoutez donc, dit d’Artagnan du ton le plus naïf, je vous
dis cela, moi, parce que tout le monde ici jure par M. Fouquet. La
plaine est à M. Fouquet, les salines que j’ai achetées sont à M.
Fouquet, l’île dans laquelle Porthos s’est fait topographe est à M.
Fouquet, la garnison est à M. Fouquet, les galères sont à M. Fouquet.
J’avoue donc que rien ne m’eût surpris dans votre inféodation, ou
11
plutôt dans celle de votre diocèse, m. Fouquet. C’est un autre maître
que le roi, voilà tout, mais aussi puissant qu’un roi.
– Dieu merci ! je ne suis inféodé à personne ; je n’appartiens à
personne et suis tout à moi, répondit Aramis, qui, pendant cette
conversation, suivait de l’œil chaque geste de d’Artagnan, chaque
clin d’œil de Porthos.
Mais d’Artagnan était impassible et Porthos immobile ; les coups
portés habilement étaient parés par un habile adversaire ; aucun ne
toucha.
Néanmoins chacun sentait la fatigue d’une pareille lutte, et
l’annonce du souper fut bien reçue par tout le monde. Le souper
changea le cours de la conversation.
D’ailleurs, ils avaient compris que, sur leurs gardes comme ils
étaient chacun de son côté, ni l’un ni l’autre n’en saurait davantage.
Porthos n’avait rien compris du tout. Il s’était tenu immobile parce
qu’Aramis lui avait fait signe de ne pas bouger. Le souper ne fut
donc pour lui que le souper. Mais c’était bien assez pour Porthos. Le
souper se passa donc à merveille.
D’Artagnan fut d’une gaieté éblouissante. Aramis se surpassa par
sa douce affabilité. Porthos mangea comme feu Pélops. On causa
guerre et finance, arts et amours. Aramis faisait l’étonné à chaque
mot de politique que risquait d’Artagnan. Celle longue série de
surprises augmenta la défiance de d’Artagnan, comme l’éternelle
indifférence de d’Artagnan provoquait la défiance d’Aramis.
Enfin d’Artagnan laissa à dessein tomber le nom de Colbert. Il
avait réservé ce coup pour le dernier.
– Qu’est-ce que Colbert ? demanda l’évêque.
« oh ! pour le coup, se dit d’Artagnan, c’est trop fort. Veillons,
mordioux ! veillons. »
Et il donna sur Colbert tous les renseignements qu’Aramis pouvait
désirer.
Le souper ou plutôt la conversation se prolongea jusqu’à une
heure du matin entre d’Artagnan et Aramis.
À dix heures précises, Porthos s’était endormi sur sa chaise et
ronflait comme un orgue.
À minuit, on le réveilla et on l’envoya coucher.
12
– Hum ! dit-il ; il me semble que je me suis assoupi ; c’était
pourtant fort intéressant ce que vous disiez.
À une heure, Aramis conduisit d’Artagnan dans la chambre qui lui
était destinée et qui était la meilleure du palais épiscopal. Deux
serviteurs furent mis à ses ordres.
– Demain, à huit heures, dit-il en prenant congé de d’Artagnan,
nous ferons, si vous le voulez, une promenade à cheval avec Porthos.
– À huit heures ! fit d’Artagnan, si tard ?
– Vous savez que j’ai besoin de sept heures de sommeil, dit
Aramis.
– C’est juste.
– Bonsoir, cher ami !
Et il embrassa le mousquetaire avec cordialité. D’Artagnan le
laissa partir.
– Bon ! dit-il quand sa porte fut fermée derrière Aramis, à cinq
heures je serai sur pied.
Puis, cette disposition arrêtée, il se coucha et mit, comme on dit,
les morceaux doubles.
13
Chapitre LXXIII : Où Porthos commence à être
fâché d’être venu avec d’Artagnan
À peine d’Artagnan avait-il éteint sa bougie, qu’Aramis, qui
guettait à travers ses rideaux le dernier soupir de la lumière chez son
ami, traversa le corridor sur la pointe du pied et passa chez Porthos.
Le géant, couché depuis une heure et demie à peu près, se prélassait
sur l’édredon. Il était dans ce calme heureux du premier sommeil qui,
chez Porthos, résistait au bruit des cloches et du canon. Sa tête
nageait dans ce doux balancement qui rappelle le mouvement
moelleux d’un navire. Une minute de plus, Porthos allait rêver.
La porte de sa chambre s’ouvrit doucement sous la pression
délicate de la main d’Aramis.
L’évêque s’approcha du dormeur. Un épais tapis assourdissait le
bruit de ses pas ; d’ailleurs, Porthos ronflait de façon à éteindre tout
autre bruit.
Il lui posa une main sur l’épaule.
– Allons, dit-il, allons, mon cher Porthos.
La voix d’Aramis était douce et affectueuse, mais elle renfermait
plus qu’un avis, elle renfermait un ordre. Sa main était légère, mais
elle indiquait un danger.
Porthos entendit la voix et sentit la main d’Aramis au fond de son
sommeil.
Il tressaillit.
– Qui va là ? dit-il avec sa voix de géant.
– Chut ! c’est moi, dit Aramis.
– Vous, cher ami ! et pourquoi diable m’éveillez-vous ?
– Pour vous dire qu’il faut partir.
14
– Partir ?
– Oui.
– Pour où ?
– Pour Paris.
Porthos bondit dans son lit et retomba assis en fixant sur Aramis
ses gros yeux effarés.
– Pour Paris ?
– Oui.
– Cent lieues ! fit-il.
– Cent quatre, répliqua l’évêque.
– Ah ! mon Dieu ! soupira Porthos en se recouchant, pareil à ces
enfants qui luttent avec leur bonne pour gagner une heure ou deux de
sommeil.
– Trente heures de cheval, ajouta résolument Aramis. Vous savez
qu’il y a de bons relais.
Porthos bougea une jambe en laissant échapper un gémissement.
– Allons ! allons ! cher ami, insista le prélat avec une sorte
d’impatience.
Porthos tira l’autre jambe du lit.
– Et c’est absolument nécessaire que je parte ? dit-il.
– De toute nécessité.
Porthos se dressa sur ses jambes et commença d’ébranler le
plancher et les murs de son pas de statue.
– Chut ! pour l’amour de Dieu, mon cher Porthos ! dit Aramis ;
vous allez réveiller quelqu’un.
– Ah ! c’est vrai, répondit Porthos d’une voix de tonnerre ;
j’oubliais ; mais, soyez tranquille, je m’observerai. Et, en disant ces
mots, il fit tomber une ceinture chargée de son épée, de ses pistolets
et d’une bourse dont les écus s’échappèrent avec un bruit vibrant et
prolongé.
Ce bruit fit bouillir le sang d’Aramis, tandis qu’il provoquait chez
Porthos un formidable éclat de rire.
– Que c’est bizarre ! dit-il de sa même voix.
– Plus bas, Porthos, plus bas, donc !
– C’est vrai.
Et il baissa en effet la voix d’un demi-ton.
15
– Je disais donc, continua Porthos, que c’est bizarre qu’on ne soit
jamais aussi lent que lorsqu’on veut se presser, aussi bruyant que
lorsqu’on désire être muet.
– Oui, c’est vrai ; mais faisons mentir le proverbe, Porthos,
hâtons-nous et taisons-nous.
– Vous voyez que je fais de mon mieux, dit Porthos en passant son
haut-de-chausses.
– Très bien.
– Il paraît que c’est pressé ?
– C’est plus que pressé, c’est grave, Porthos.
– Oh ! oh !
– D’Artagnan vous a questionné, n’est-ce pas ?
– Moi ?
– Oui, à Belle-Île ?
– Pas le moins du monde.
– Vous en êtes bien sûr, Porthos ?
– Parbleu !
– C’est impossible. Souvenez-vous bien.
– Il m’a demandé ce que je faisais, je lui ai dit : « De la
topographie. » J’aurais voulu dire un autre mot dont vous vous étiez
servi un jour.
– De la castramétation ?
– C’est cela ; mais je n’ai jamais pu me le rappeler.
– Tant mieux ! Que vous a-t-il demandé encore ?
– Ce que c’était que M. Gétard.
– Et encore ?
– Ce que c’était que M. Jupenet.
– Il n’a pas vu notre plan de fortifications, par hasard ?
– Si fait.
– Ah ! diable !
– Mais soyez tranquille, j’avais effacé votre écriture avec de la
gomme. Impossible de supposer que vous avez bien voulu me donner
quelque avis dans ce travail.
– Il a de bien bons yeux, notre ami.
– Que craignez-vous ?
– Je crains que tout ne soit découvert, Porthos ; il s’agit donc de
16
prévenir un grand malheur. J’ai donné l’ordre à mes gens de fermer
toutes les portes. On ne laissera point sortir d’Artagnan avant le jour.
Votre cheval est tout sellé ; vous gagnez le premier relais ; à cinq
heures du matin, vous aurez fait quinze lieues. Venez.
On vit alors Aramis vêtir Porthos pièce par pièce avec autant de
célérité qu’eût pu le faire le plus habile valet de chambre. Porthos,
moitié confus, moitié étourdi, se laissait faire et se confondait en
excuses.
Lorsqu’il fut prêt, Aramis le prit par la main et l’emmena, en lui
faisant poser le pied avec précaution sur chaque marche de l’escalier,
l’empêchant de se heurter aux embrasures des portes, le tournant et le
retournant comme si lui, Aramis, eût été le géant et Porthos le nain.
Cette âme incendiait et soulevait cette matière. Un cheval, en effet,
attendait tout sellé dans la cour. Porthos se mit en selle.
Alors Aramis prit lui-même le cheval par la bride et le guida sur
du fumier répandu dans la cour, dans l’intention évidente d’éteindre
le bruit. Il lui pinçait en même temps les naseaux pour qu’il ne hennît
pas…
– Puis, une fois arrivé à la porte extérieure, attirant à lui Porthos,
qui allait partir sans même lui demander pourquoi :
– Maintenant, ami Porthos, maintenant, sans débrider jusqu’à
Paris, dit-il à son oreille ; mangez à cheval, buvez à cheval, dormez à
cheval, mais ne perdez pas une minute.
– C’est dit ; on ne s’arrêtera pas.
– Cette lettre à M. Fouquet, coûte que coûte ; il faut qu’il l’ait
demain avant midi.
– Il l’aura.
– Et pensez à une chose, cher ami.
– À laquelle ?
– C’est que vous courez après votre brevet de duc et pair.
– Oh ! oh ! fit Porthos les yeux étincelants, j’irai en vingt-quatre
heures en ce cas.
– Tâchez.
– Alors lâchez la bride, et en avant, Goliath !
Aramis lâcha effectivement, non pas la bride, mais les naseaux du
cheval.
17
Porthos rendit la main, piqua des deux, et l’animal furieux partit
au galop sur la terre.
Tant qu’il put voir Porthos dans la nuit, Aramis le suivit des yeux ;
puis, lorsqu’il l’eut perdu de vue, il rentra dans la cour. Rien n’avait
bougé chez d’Artagnan.
Le valet mis en faction auprès de sa porte n’avait vu aucune
lumière, n’avait entendu aucun bruit.
Aramis referma la porte avec soin, envoya le laquais se coucher, et
lui même se mit au lit.
D’Artagnan ne se doutait réellement de rien ; aussi crut-il avoir
tout gagné, lorsque le matin il s’éveilla vers quatre heures et demie.
Il courut tout en chemise regarder par la fenêtre : la fenêtre
donnait sur la cour. Le jour se levait.
La cour était déserte, les poules elles-mêmes n’avaient pas encore
quitté leurs perchoirs.
Pas un valet n’apparaissait.
Toutes les portes étaient fermées.
« Bon ! calme parfait, se dit d’Artagnan. N’importe, me voici
réveillé le premier de toute la maison. Habillons-nous ; ce sera autant
de fait. »
Et d’Artagnan s’habilla.
Mais cette fois il s’étudia à ne point donner au costume de M.
Agnan cette rigidité bourgeoise et presque ecclésiastique qu’il
affectait auparavant ; il sut même, en se serrant davantage, en se
boutonnant d’une certaine façon, en posant son feutre plus
obliquement, rendre à sa personne un peu de cette tournure militaire
dont l’absence avait effarouché Aramis. Cela fait, il en usa ou plutôt
feignit d’en user sans façon avec son hôte, et entra tout à l’improviste
dans son appartement. Aramis dormait ou feignait de dormir.
Un grand livre était ouvert sur son pupitre de nuit ; la bougie
brûlait encore au-dessus de son plateau d’argent.
C’était plus qu’il n’en fallait pour prouver à d’Artagnan
l’innocence de la nuit du prélat et les bonnes intentions de son réveil.
Le mousquetaire fit précisément à l’évêque ce que l’évêque avait
fait à Porthos.
Il lui frappa sur l’épaule.
18
Évidemment ; Aramis feignait de dormir, car, au lieu de s’éveiller
soudain, lui qui avait le sommeil si léger, il se fit réitérer
l’avertissement.
– Ah ! ah ! c’est vous, dit-il en allongeant les bras. Quelle bonne
surprise ! Ma foi, le sommeil m’avait fait oublier que j’eusse le
bonheur de vous posséder. Quelle heure est-il ?
– Je ne sais, dit d’Artagnan un peu embarrassé. De bonne heure, je
crois. Mais, vous le savez, cette diable d’habitude militaire de
m’éveiller avec le jour me tient encore.
– Est-ce que vous voulez déjà que nous sortions, par hasard ?
demanda Aramis. Il est bien matin, ce me semble.
– Ce sera comme vous voudrez.
– Je croyais que nous étions convenus de ne monter à cheval qu’à
huit heures.
– C’est possible ; mais, moi, j’avais si grande envie de vous voir,
que je me suis dit : « Le plus tôt sera le meilleur. »
– Et mes sept heures de sommeil ? dit Aramis. Prenez garde,
j’avais compté là-dessus, et ce qu’il m’en manquera, il faudra que je
le rattrape.
– Mais il me semble qu’autrefois vous étiez moins dormeur que
cela, cher ami ; vous aviez le sang alerte et l’on ne vous trouvait
jamais au lit.
– Et c’est justement à cause de ce que vous me dites là que j’aime
fort à y demeurer maintenant.
– Aussi, avouez que ce n’était pas pour dormir que vous m’avez
demandé jusqu’à huit heures.
– J’ai toujours peur que vous ne vous moquiez de moi si je vous
dis la vérité.
– Dites toujours.
– Eh bien ! de six à huit heures, j’ai l’habitude de faire mes
dévotions.
– Vos dévotions ?
– Oui.
– Je ne croyais pas qu’un évêque eût des exercices si sévères.
– Un évêque, cher ami, a plus à donner aux apparences qu’un
simple clerc.
19
– Mordioux ! Aramis, voici un mot qui me réconcilie avec Votre
Grandeur. Aux apparences ! c’est un mot de mousquetaire, celui-là, à
la bonne heure ! Vivent les apparences, Aramis !
– Au lieu de m’en féliciter, pardonnez-le-moi, d’Artagnan. C’est
un mot bien mondain que j’ai laissé échapper là.
– Faut-il donc que je vous quitte ?
– J’ai besoin de recueillement, cher ami.
– Bon. Je vous laisse ; mais à cause de ce païen qu’on appelle
d’Artagnan, abrégez-les, je vous prie ; j’ai soif de votre parole.
– Eh bien ! d’Artagnan, je vous promets que dans une heure et
demie…
– Une heure et demie de dévotions ? Ah ! mon ami, passez-moi
cela au plus juste. Faites-moi le meilleur marché possible.
Aramis se mit à rire.
– Toujours charmant, toujours jeune, toujours gai, dit-il. Voilà que
vous êtes venu dans mon diocèse pour me brouiller avec la grâce.
– Bah !
– Et vous savez bien que je n’ai jamais résisté à vos
entraînements ; vous me coûterez mon salut, d’Artagnan.
D’Artagnan se pinça les lèvres.
– Allons, dit-il, je prends le péché sur mon compte, débridez-moi
un simple signe de croix de chrétien, débridez-moi un Pater et
partons.
– Chut ! dit Aramis, nous ne sommes déjà plus seuls, et j’entends
des étrangers qui montent.
– Eh bien ! congédiez-les.
– Impossible ; je leur avais donné rendez-vous hier : c’est le
principal du collège des jésuites et le supérieur des dominicains.
– Votre état-major, soit.
– Qu’allez-vous faire ?
– Je vais aller réveiller Porthos et attendre dans sa compagnie que
vous ayez fini vos conférences.
Aramis ne bougea point, ne sourcilla point, ne précipita ni son
geste ni sa parole.
– Allez, dit-il.
D’Artagnan s’avança vers la porte.
20
– À propos, vous savez où loge Porthos ?
– Non ; mais je vais m’en informer.
– Prenez le corridor, et ouvrez la deuxième porte à gauche.
– Merci ! au revoir.
Et d’Artagnan s’éloigna dans la direction indiquée par Aramis.
Dix minutes ne s’étaient point écoulées qu’il revint. Il trouva
Aramis assis entre le principal du collège des jésuites et le supérieur
des dominicains et le principal du collège des jésuites, exactement
dans la même situation où il l’avait retrouvé autrefois dans l’auberge
de Crèvecœur.
Cette compagnie n’effraya pas le mousquetaire.
– Qu’est-ce ? dit tranquillement Aramis. Vous avez quelque chose
à me dire, ce me semble, cher ami ?
– C’est, répondit d’Artagnan en regardant Aramis, c’est que
Porthos n’est pas chez lui.
– Tiens ! fit Aramis avec calme ; vous êtes sûr ?
– Pardieu ! je viens de sa chambre.
– Où peut-il être alors ?
– Je vous le demande.
– Et vous ne vous en êtes pas informé ?
– Si fait.
– Et que vous a-t-on répondu ?
– Que Porthos sortant souvent le matin sans rien dire à personne,
était probablement sorti.
– Qu’avez-vous fait alors ?
– J’ai été à l’écurie, répondit indifféremment d’Artagnan.
– Pour quoi faire ?
– Pour voir si Porthos est sorti à cheval.
– Et ?… interrogea l’évêque.
– Eh bien ! il manque un cheval au râtelier, le numéro 5, Goliath.
Tout ce dialogue, on le comprend, n’était pas exempt d’une
certaine affectation de la part du mousquetaire et d’une parfaite
complaisance de la part d’Aramis.
– Oh ! je vois ce que c’est, dit Aramis après avoir rêvé un
moment : Porthos est sorti pour nous faire une surprise.
– Une surprise ?
21
– Oui. Le canal qui va de Vannes à la mer est très giboyeux en
sarcelles et en bécassines ; c’est la chasse favorite de Porthos ; il
nous en rapportera une douzaine pour notre déjeuner.
– Vous croyez ? fit d’Artagnan.
– J’en suis sûr. Où voulez-vous qu’il soit allé ? Je parie qu’il a
emporté un fusil.
– C’est possible, dit d’Artagnan.
– Faites une chose, cher ami, montez à cheval et le rejoignez.
– Vous avez raison, dit d’Artagnan, j’y vais.
– Voulez-vous qu’on vous accompagne ?
– Non, merci, Porthos est reconnaissable. Je me renseignerai.
– Prenez-vous une arquebuse ?
– Merci.
– Faites-vous seller le cheval que vous voudrez.
– Celui que je montais hier en venant de Belle-Île.
– Soit ; usez de la maison comme de la vôtre.
Aramis sonna et donna l’ordre de seller le cheval que choisirait M.
d’Artagnan.
D’Artagnan suivit le serviteur chargé de l’exécution de cet ordre.
Arrivé à la porte, le serviteur se rangea pour laisser passer
d’Artagnan. Dans ce moment son œil rencontra l’œil de son maître.
Un froncement de sourcils fit comprendre à l’intelligent espion que
l’on donnait à d’Artagnan ce qu’il avait à faire.
D’Artagnan monta à cheval ; Aramis entendit le bruit des fers qui
battaient le pavé.
Un instant après, le serviteur rentra.
– Eh bien ? demanda l’évêque.
– Monseigneur, il suit le canal et se dirige vers la mer, dit le
serviteur.
– Bien ! dit Aramis.
En effet, d’Artagnan, chassant tout soupçon, courait vers l’océan,
espérant toujours voir dans les landes ou sur la grève la colossale
silhouette de son ami Porthos.
D’Artagnan s’obstinait à reconnaître des pas de cheval dans
chaque flaque d’eau. Quelquefois il se figurait entendre la détonation
d’une arme à feu. Cette illusion dura trois heures. Pendant deux
22
heures, d’Artagnan chercha Porthos.
Pendant la troisième, il revint à la maison.
– Nous nous serons croisés, dit-il, et je vais trouver les deux
convives attendant mon retour.
D’Artagnan se trompait. Il ne retrouva pas plus Porthos à l’évêché
qu’il ne l’avait trouvé sur le bord du canal.
Aramis l’attendait au haut de l’escalier avec une mine désespérée.
– Ne vous a-t-on pas rejoint, mon cher d’Artagnan ? cria-t-il du
plus loin qu’il aperçut le mousquetaire.
– Non. Auriez-vous fait courir après moi ?
– Désolé, mon cher ami, désolé de vous avoir fait courir
inutilement ; mais, vers sept heures, l’aumônier de Saint-Paterne est
venu ; il avait rencontré du Vallon qui s’en allait et qui, n’ayant voulu
réveiller personne à l’évêché, l’avait chargé de me dire que, craignant
que M. Gétard ne lui fît quelque mauvais tour en son absence, il allait
profiter de la marée du matin pour faire un tour à Belle-Île.
– Mais, dites-moi, Goliath n’a pas traversé les quatre lieues de
mer, ce me semble ?
– Il y en a bien six, dit Aramis.
– Encore moins, alors.
– Aussi, cher ami, dit le prélat avec un doux sourire, Goliath est à
l’écurie, fort satisfait même, j’en réponds, de n’avoir plus Porthos sur
le dos.
En effet, le cheval avait été ramené du relais par les soins du
prélat, à qui aucun détail n’échappait.
D’Artagnan parut on ne peut plus satisfait de l’explication.
Il commençait un rôle de dissimulation qui convenait parfaitement
aux soupçons qui s’accentuaient de plus en plus dans son esprit. Il
déjeuna entre le jésuite et Aramis, ayant le dominicain en face de lui
et souriant particulièrement au dominicain, dont la bonne grosse
figure lui revenait assez.
Le repas fut long et somptueux ; d’excellent vin d’Espagne, de
belles huîtres du Morbihan, les poissons exquis de l’embouchure de
la Loire, les énormes chevrettes de Paimbœuf et le gibier délicat des
bruyères en firent les frais.
D’Artagnan mangea beaucoup et but peu. Aramis ne but pas du
23
tout, ou du moins ne but que de l’eau. Puis après le déjeuner :
– Vous m’avez offert une arquebuse ? dit d’Artagnan.
– Oui.
– Prêtez-la-moi.
– Vous voulez chasser ?
– En attendant Porthos, c’est ce que j’ai de mieux à faire, je crois.
– Prenez celle que vous voudrez au trophée.
– Venez-vous avec moi ?
– Hélas ! cher ami, ce serait avec grand plaisir, mais la chasse est
défendue aux évêques.
– Ah ! dit d’Artagnan, je ne savais pas.
– D’ailleurs, continua Aramis, j’ai affaire jusqu’à midi.
– J’irai donc seul ? dit d’Artagnan.
– Hélas ! oui ! mais revenez dîner surtout.
– Pardieu ! on mange trop bien chez vous pour que je n’y revienne
pas.
Et là-dessus d’Artagnan quitta son hôte, salua les convives, prit
son arquebuse, mais, au lieu de chasser, courut tout droit au petit port
de Vannes.
Il regarda en vain si on le suivait ; il ne vit rien ni personne.
Il fréta un petit bâtiment de pêche pour vingt-cinq livres et partit à
onze heures et demie, convaincu qu’on ne l’avait pas suivi. On ne
l’avait pas suivi, c’était vrai. Seulement, un frère jésuite, placé au
haut du clocher de son église, n’avait pas, depuis le matin, à l’aide
d’une excellente lunette, perdu un seul de ses pas. À onze heures
trois quarts, Aramis était averti que d’Artagnan voguait vers Belle-
Île.
Le voyage de d’Artagnan fut rapide : un bon vent nord-nord-est le
poussait vers Belle-Île.
Au fur et à mesure qu’il approchait, ses yeux interrogeaient la
côte. Il cherchait à voir, soit sur le rivage, soit au-dessus des
fortifications, l’éclatant habit de Porthos et sa vaste stature se
détachant sur un ciel légèrement nuageux.
D’Artagnan cherchait inutilement ; il débarqua sans avoir rien vu,
et apprit du premier soldat interrogé par lui que M. du Vallon n’était
point encore revenu de Vannes.
24
Alors, sans perdre un instant, d’Artagnan ordonna à sa petite
barque de mettre le cap sur Sarzeau.
On sait que le vent tourne avec les différentes heures de la
journée ; le vent était passé du nord-nord-est au sud-est ; le vent était
donc presque aussi bon pour le retour à Sarzeau qu’il l’avait été pour
le voyage de Belle-Île. En trois heures, d’Artagnan eut touché le
continent ; deux autres heures lui suffirent pour gagner Vannes.
Malgré la rapidité de la course, ce que d’Artagnan dévora
d’impatience et de dépit pendant cette traversée, le pont seul du
bateau sur lequel il trépigna pendant trois heures pourrait le raconter
à l’histoire. D’Artagnan ne fit qu’un bond du quai où il était
débarqué au palais épiscopal.
Il comptait terrifier Aramis par la promptitude de son retour, et il
voulait lui reprocher sa duplicité, avec réserve toutefois, mais avec
assez d’esprit néanmoins pour lui en faire sentir toutes les
conséquences et lui arracher une partie de son secret.
Il espérait enfin, grâce à cette verve d’expression qui est aux
mystères ce que la charge à la baïonnette est aux redoutes, enlever le
mystérieux Aramis jusqu’à une manifestation quelconque.
Mais il trouva dans le vestibule du palais le valet de chambre qui
lui fermait le passage tout en lui souriant d’un air béat.
– Monseigneur ? cria d’Artagnan en essayant de l’écarter de la
main.
Un instant ébranlé, le valet reprit son aplomb.
– Monseigneur ? fit-il.
– Eh ! oui, sans doute ; ne me reconnais-tu pas, imbécile ?
– Si fait ; vous êtes le chevalier d’Artagnan.
– Alors, laisse-moi passer.
– Inutile.
– Pourquoi inutile ?
– Parce que Sa Grandeur n’est point chez elle.
– Comment, Sa Grandeur n’est point chez elle ! Mais où est-elle
donc ?
– Partie.
– Partie ?
– Oui.
25
– Pour où ?
– Je n’en sais rien ; mais peut-être le dit-elle à Monsieur le
chevalier.
– Comment ? où cela ? de quelle façon ?
– Dans cette lettre qu’elle m’a remise pour Monsieur le chevalier.
Et le valet de chambre tira une lettre de sa poche.
– Eh ! donne donc, maroufle ! fit d’Artagnan en la lui arrachant
des mains. Oh ! oui, continua d’Artagnan à la première ligne ; oui, je
comprends.
Et il lut à demi-voix :
« Cher ami, Une affaire des plus urgentes m’appelle dans une des
paroisses de mon diocèse.
J’espérais vous voir avant de partir ; mais je perds cet espoir en
songeant que vous allez sans doute rester deux ou trois jours à Belle-
Île avec notre cher Porthos.
Amusez-vous bien, mais n’essayez pas de lui tenir tête à table ;
c’est un conseil que je n’eusse pas donné, même à Athos, dans son
plus beau et son meilleur temps.
Adieu, cher ami ; croyez bien que j’en suis aux regrets de n’avoir
pas mieux et plus longtemps profité de votre excellente compagnie. »
– Mordioux ! s’écria d’Artagnan, je suis joué. Ah ! pécore, brute,
triple sot que je suis ! mais rira bien qui rira le dernier oh ! dupé,
dupé comme un singe à qui on donne une noix vide !
Et, bourrant un coup de poing sur le museau toujours riant du
valet de chambre, il s’élança hors du palais épiscopal.
Furet, si bon trotteur qu’il fût, n’était plus à la hauteur des
circonstances. D’Artagnan gagna donc la poste, et il y choisit un
cheval auquel il fit voir, avec de bons éperons et une main légère que
les cerfs ne sont point les plus agiles coureurs de la création.
26
Chapitre LXXIV : Où d’Artagnan court, où
Porthos ronfle, où Aramis conseille
Trente à trente-cinq heures après les événements que nous venons
de raconter, comme M. Fouquet, selon son habitude, ayant interdit sa
porte, travaillait dans ce cabinet de sa maison de Saint-Mandé que
nous connaissons déjà, un carrosse attelé de quatre chevaux
ruisselant de sueur entra au galop dans la cour.
Ce carrosse était probablement attendu, car trois ou quatre laquais
se précipitèrent vers la portière, qu’ils ouvrirent tandis que M.
Fouquet se levait de son bureau et courait lui-même à la fenêtre. Un
homme sortit péniblement du carrosse, descendant avec difficulté les
trois degrés du marchepied et s’appuyant sur l’épaule des laquais.
À peine eut-il dit son nom, que celui sur l’épaule duquel il ne
s’appuyait point s’élança vers le perron et disparut dans le vestibule.
Cet homme courait prévenir son maître ; mais il n’eut pas besoin de
frapper à la porte.
Fouquet était debout sur le seuil.
– Mgr l’évêque de Vannes ! dit le laquais.
– Bien ! dit Fouquet.
Puis, se penchant sur la rampe de l’escalier, dont Aramis
commençait à monter les premiers degrés :
– Vous, cher ami, dit-il, vous si tôt !
– Oui, moi-même, monsieur ; mais moulu, brisé, comme vous
voyez.
– Oh ! pauvre cher, dit Fouquet en lui présentant son bras sur
lequel Aramis s’appuya, tandis que les serviteurs s’éloignèrent avec
respect.
27
– Bah ! répondit Aramis, ce n’est rien, puisque me voilà ; le
principal était que j’arrivasse, et me voilà arrivé.
– Parlez vite, dit Fouquet en refermant la porte du cabinet derrière
Aramis et lui.
– Sommes-nous seuls ?
– Oui, parfaitement seuls.
– Nul ne peut nous écouter ? nul ne peut nous entendre ?
– Soyez donc tranquille.
– M. du Vallon est arrivé ?
– Oui.
– Et vous avez reçu ma lettre ?
– Oui, l’affaire est grave, à ce qu’il paraît, puisqu’elle nécessite
votre présence à Paris, dans un moment où votre présence était si
urgente là-bas.
– Vous avez raison, on ne peut plus grave.
– Merci, merci ! De quoi s’agit-il ? Mais, pour Dieu, et avant toute
chose, respirez, cher ami ; vous êtes pâle à faire frémir !
– Je souffre, en effet ; mais, par grâce ! ne faites pas attention à
moi. M. du Vallon ne vous a-t-il rien dit en vous remettant sa lettre ?
– Non : j’ai entendu un grand bruit, je me suis mis à la fenêtre ;
j’ai vu, au pied du perron, une espèce de cavalier de marbre ; je suis
descendu, il m’a tendu la lettre, et son cheval est tombé mort.
– Mais lui ?
– Lui est tombé avec le cheval ; on l’a enlevé pour le porter dans
les appartements ; la lettre lue, j’ai voulu monter près de lui pour
avoir de plus amples nouvelles : mais il était endormi de telle façon
qu’il a été impossible de le réveiller. J’ai eu pitié de lui, et j’ai
ordonné qu’on lui ôtât ses bottes et qu’on le laissât tranquille.
– Bien ; maintenant, voici ce dont il s’agit, monseigneur. Vous
avez vu M. d’Artagnan à Paris, n’est-ce pas ?
– Certes, et c’est un homme d’esprit et même un homme de cœur,
bien qu’il m’ait fait tuer nos chers amis Lyodot et d’Emerys.
– Hélas ! oui, je le sais ; j’ai rencontré à Tours le courrier qui
m’apportait la lettre de Gourville et les dépêches de Pellisson. Avez-
vous bien réfléchi à cet événement, monsieur ?
– Oui.
28
– Et vous avez compris que c’était une attaque directe à votre
souveraineté ?
– Croyez-vous ?
– Oh ! oui, je le crois.
– Eh bien ! je vous l’avouerai, cette sombre idée m’est venue, à
moi aussi.
– Ne vous aveuglez pas, monsieur, au nom du Ciel, écoutez
bien… j’en reviens à d’Artagnan.
– J’écoute.
– Dans quelle circonstance l’avez-vous vu ?
– Il est venu chercher de l’argent.
– Avec quelle ordonnance ?
– Avec un bon du roi.
– Direct ?
– Signé de Sa Majesté.
– Voyez-vous ! Eh bien ! d’Artagnan est venu à Belle-Île ; il était
déguisé, il passait pour un intendant quelconque chargé par son
maître d’acheter des salines. Or, d’Artagnan n’a pas d’autre maître
que le roi ; il venait donc comme envoyé du roi. Il a vu Porthos.
– Qu’est-ce que Porthos ?
– Pardon, je me trompe. Il a vu M. du Vallon à Belle-Île, et il sait,
comme vous et moi, que Belle-Île est fortifiée.
– Et vous croyez que le roi l’aurait envoyé ? dit Fouquet tout
pensif.
– Assurément.
– Et d’Artagnan aux mains du roi est un instrument dangereux ?
– Le plus dangereux de tous.
– Je l’ai donc bien jugé du premier coup d’œil.
– Comment cela ?
– J’ai voulu me l’attacher.
– Si vous avez jugé que ce fût l’homme de France le plus brave, le
plus fin et le plus adroit, vous l’avez bien jugé.
– Il faut donc l’avoir à tout prix !
– D’Artagnan ?
– N’est-ce pas votre avis ?
– C’est mon avis ; mais vous ne l’aurez pas.
29
– Pourquoi ?
– Parce que nous avons laissé passer le temps. Il était en
dissentiment avec la cour, il fallait profiter de ce dissentiment ;
depuis il a passé en Angleterre, depuis il a puissamment contribué à
la restauration, depuis il a gagné une fortune, depuis enfin il est
rentré au service du roi. Eh bien ! s’il est rentré au service du roi,
c’est qu’on lui a bien payé ce service.
– Nous le paierons davantage, voilà tout.
– Oh ! monsieur, permettez ; d’Artagnan a une parole, et, une fois
engagée, cette parole demeure où elle est.
– Que concluez-vous de cela ? dit Fouquet avec inquiétude.
– Que pour le moment il s’agit de parer un coup terrible.
– Et comment le parez-vous ?
– Attendez… d’Artagnan va venir rendre compte au roi de sa
mission.
– Oh ! nous avons le temps d’y penser.
– Comment cela ?
– Vous avez bonne avance sur lui, je présume ?
– Dix heures à peu près.
– Eh bien ! en dix heures…
Aramis secoua sa tête pâle.
– Voyez ces nuages qui courent au ciel, ces hirondelles qui fendent
l’air : d’Artagnan va plus vite que le nuage et que l’oiseau ;
d’Artagnan, c’est le vent qui les emporte.
– Allons donc !
– Je vous dis que c’est quelque chose de surhumain que cet
homme, monsieur ; il est de mon âge, et je le connais depuis trente-
cinq ans.
– Eh bien ?
– Eh bien ! écoutez mon calcul, monsieur : je vous ai expédié M.
du Vallon à deux heures de la nuit ; M. du Vallon avait huit heures
d’avance sur moi. Quand M. du Vallon est-il arrivé ?
– Voilà quatre heures, à peu près.
– Vous voyez bien, j’ai gagné quatre heures sur lui, et cependant
c’est un rude cavalier que Porthos, et cependant il a tué sur la route
huit chevaux dont j’ai retrouvé les cadavres. Moi, j’ai couru la poste
30
cinquante lieues, mais j’ai la goutte, la gravelle, que sais-je ? de sorte
que la fatigue me tue. J’ai dû descendre à Tours ; depuis, roulant en
carrosse à moitié mort, à moitié versé, souvent traîné sur les flancs,
parfois sur le dos de la voiture, toujours au galop de quatre chevaux
furieux, je suis arrivé, arrivé gagnant quatre heures sur Porthos ;
mais, voyez-vous, d’Artagnan ne pèse pas trois cents livres comme
Porthos, d’Artagnan n’a pas la goutte et la gravelle comme moi : ce
n’est pas un cavalier, c’est un centaure ; d’Artagnan, voyez-vous,
parti pour Belle-Île quand je partais pour Paris, d’Artagnan, malgré
dix heures d’avance que j’ai sur lui, d’Artagnan arrivera deux heures
après moi.
– Mais enfin, les accidents ?
– Il n’y a pas d’accidents pour lui.
– Si les chevaux manquent ?
– Il courra plus vite que les chevaux.
– Quel homme, bon Dieu !
– Oui, c’est un homme que j’aime et que j’admire ; je l’aime,
parce qu’il est bon, grand, loyal ; je l’admire, parce qu’il représente
pour moi le point culminant de la puissance humaine ; mais, tout en
l’aimant, tout en l’admirant, je le crains et je le prévois. Donc, je me
résume, monsieur : dans deux heures, d’Artagnan sera ici ; prenez les
devants, courez au Louvre, voyez le roi avant qu’il voie d’Artagnan.
– Que dirai-je au roi ?
– Rien ; donnez-lui Belle-Île.
– Oh ! monsieur d’Herblay, monsieur d’Herblay ! s’écria Fouquet,
que de projets manqués tout à coup !
– Après un projet avorté, il y a toujours un autre projet que l’on
peut mener à bien ! Ne désespérons jamais, et allez, monsieur, allez
vite.
– Mais cette garnison si soigneusement triée, le roi la fera changer
tout de suite.
– Cette garnison, monsieur, était au roi quand elle entra dans
Belle-Île ; elle est à vous aujourd’hui : il en sera de même pour toutes
les garnisons après quinze jours d’occupation. Laissez faire,
monsieur. Voyez-vous inconvénient à avoir une armée à vous au bout
d’un an au lieu d’un ou deux régiments ? Ne voyez-vous pas que
31
votre garnison d’aujourd’hui vous fera des partisans à La Rochelle, à
Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, partout où on l’enverra ?
« Allez au roi, monsieur, allez, le temps s’écoule, et d’Artagnan,
pendant que nous perdons notre temps, vole comme une flèche sur le
grand chemin.
– Monsieur d’Herblay, vous savez que toute parole de vous est un
germe qui fructifie dans ma pensée ; je vais au Louvre.
– À l’instant même, n’est-ce pas ?
– Je ne vous demande que le temps de changer d’habits.
– Rappelez-vous que d’Artagnan n’a pas besoin de passer par
Saint-Mandé, lui, mais qu’il se rendra tout droit au Louvre ; c’est une
heure à retrancher sur l’avance qui nous reste.
– D’Artagnan peut tout avoir, excepté mes chevaux anglais ; je
serai au Louvre dans vingt-cinq minutes.
Et, sans perdre une seconde, Fouquet commanda le départ.
Aramis n’eut que le temps de lui dire :
– Revenez aussi vite que vous serez parti, car je vous attends avec
impatience.
Cinq minutes après, le surintendant volait vers Paris.
Pendant ce temps, Aramis se faisait indiquer la chambre où
reposait Porthos.
À la porte du cabinet de Fouquet, il fut serré dans les bras de
Pellisson, qui venait d’apprendre son arrivée et quittait les bureaux
pour le voir.
Aramis reçut, avec cette dignité amicale qu’il savait si bien
prendre, ces caresses aussi respectueuses qu’empressées ; mais tout à
coup, s’arrêtant sur le palier :
– Qu’entends-je là-haut ? demanda-t-il.
On entendait, en effet, un rauquement sourd pareil à celui d’un
tigre affamé ou d’un lion impatient.
– Oh ! ce n’est rien, dit Pellisson en souriant.
– Mais enfin ?…
– C’est M. du Vallon qui ronfle.
– En effet, dit Aramis, il n’y avait que lui capable de faire un tel
bruit. Vous permettez, Pellisson, que je m’informe s’il ne manque de
rien ?
32
– Et vous, permettez-vous que je vous accompagne ?
– Comment donc !
Tous deux entrèrent dans la chambre.
Porthos était étendu sur un lit, la face violette plutôt que rouge, les
yeux gonflés, la bouche béante.
Ce rugissement qui s’échappait des profondes cavités de sa
poitrine faisait vibrer les carreaux des fenêtres.
À ses muscles tendus et sculptés en saillie sur sa face, à ses
cheveux collés de sueur, aux énergiques soulèvements de son menton
et de ses épaules, on ne pouvait refuser une certaine admiration : la
force poussée à ce point, c’est presque de la divinité.
Les jambes et les pieds herculéens de Porthos avaient, en se
gonflant, fait craquer ses bottes de cuir ; toute la force de son énorme
corps s’était convertie en une rigidité de pierre.
Porthos ne remuait pas plus que le géant de granit couché dans la
plaine d’Agrigente. Sur l’ordre de Pellisson, un valet de chambre
s’occupa de couper les bottes de Porthos, car nulle puissance au
monde n’eût pu les lui arracher.
Quatre laquais y avaient essayé en vain, tirant à eux comme des
cabestans.
Ils n’avaient pas même réussi à réveiller Porthos. On lui enleva
ses bottes par lanières, et ses jambes retombèrent sur le lit ; on lui
coupa le reste de ses habits, on le porta dans un bain, on l’y laissa
une heure, puis on le revêtit de linge blanc et on l’introduisit dans un
lit bassiné, le tout avec des efforts et des peines qui eussent
incommodé un mort, mais qui ne firent pas même ouvrir l’œil à
Porthos et n’interrompirent pas une seconde l’orgue formidable de
ses ronflements.
Aramis voulait, de son côté, nature sèche et nerveuse, armée d’un
courage exquis, braver aussi la fatigue et travailler avec Gourville et
Pellisson ; mais il s’évanouit sur la chaise où il s’était obstiné à
rester.
On l’enleva pour le porter dans une chambre voisine, où le repos
du lit ne tarda point à provoquer le calme de la tête.
33
Chapitre LXXV : Où M. Fouquet agit
Cependant Fouquet courait vers le Louvre au grand galop de son
attelage anglais.
Le roi travaillait avec Colbert. Tout à coup le roi demeura pensif.
Ces deux arrêts de mort qu’il avait signés en montant sur le trône lui
revenaient parfois en mémoire. C’étaient deux taches de deuil qu’il
voyait les yeux ouverts ; deux taches de sang qu’il voyait les yeux
fermés.
– Monsieur, dit-il tout à coup à l’intendant, il me semble parfois
que ces deux hommes que vous avez fait condamner n’étaient pas de
bien grands coupables.
– Sire, ils avaient été choisis dans le troupeau des traitants, qui
avait besoin d’être décimé.
– Choisis par qui ?
– Par la nécessité, Sire, répondit froidement Colbert.
– La nécessité ! grand mot ! murmura le jeune roi.
– Grande déesse, Sire.
– C’étaient des amis fort dévoués au surintendant, n’est-ce pas ?
– Oui, Sire, des amis qui eussent donné leur vie pour M. Fouquet.
– Ils l’ont donnée, monsieur, dit le roi.
– C’est vrai, mais inutilement, par bonheur, ce qui n’était pas leur
intention.
– Combien ces hommes avaient-ils dilapidé d’argent ?
– Dix millions peut-être, dont six ont été confisqués sur eux.
– Et cet argent est dans mes coffres ? demanda le roi avec un
certain sentiment de répugnance.
– Il y est, Sire ; mais cette confiscation, tout en menaçant M.
34
Fouquet, ne l’a point atteint.
– Vous concluez, monsieur Colbert ?…
– Que si M. Fouquet a soulevé contre Votre Majesté une troupe de
factieux pour arracher ses amis au supplice, il soulèvera une armée
quand il s’agira de se soustraire lui-même au châtiment.
Le roi fit jaillir sur son confident un de ces regards qui
ressemblent au feu sombre d’un éclair d’orage ; un de ces regards qui
vont illuminer les ténèbres des plus profondes consciences.
– Je m’étonne, dit-il, que, pensant sur M. Fouquet de pareilles
choses, vous ne veniez pas me donner un avis.
– Quel avis, Sire ?
– Dites-moi d’abord, clairement et précisément, ce que vous
pensez, monsieur Colbert.
– Sur quoi ?
– Sur la conduite de M. Fouquet.
– Je pense, Sire, que M. Fouquet, non content d’attirer à lui
l’argent, comme faisait M. de Mazarin, et de priver par-là Votre
Majesté d’une partie de sa puissance, veut encore attirer à lui tous les
amis de la vie facile et des plaisirs, de ce qu’enfin les fainéants
appellent la poésie, et les politiques la corruption ; je pense qu’en
soudoyant les sujets de Votre Majesté il empiète sur la prérogative
royale, et ne peut, si cela continue ainsi, tarder à reléguer Votre
Majesté parmi les faibles et les obscurs.
– Comment qualifie-t-on tous ces projets, monsieur Colbert ?
– Les projets de M. Fouquet, Sire ?
– Oui.
– On les nomme crimes de lèse-majesté.
– Et que fait-on aux criminels de lèse-majesté ?
– On les arrête, on les juge, on les punit.
– Vous êtes bien sûr que M. Fouquet a conçu la pensée du crime
que vous lui imputez ?
– Je dirai plus, Sire, il y a eu chez lui commencement d’exécution.
– Eh bien ! j’en reviens à ce que je disais, monsieur Colbert.
– Et vous disiez, Sire ?
– Donnez-moi un conseil.
– Pardon, Sire, mais auparavant j’ai encore quelque chose à
35
ajouter.
– Dites.
– Une preuve évidente, palpable, matérielle de trahison.
– Laquelle ?
– Je viens d’apprendre que M. Fouquet fait fortifier Belle-Île-en-
Mer.
– Ah ! vraiment !
– Oui, Sire.
– Vous en êtes sûr ?
– Parfaitement ; savez-vous, Sire, ce qu’il y a de soldats à Belle-
Île ?
– Non, ma foi ; et vous ?
– Je l’ignore, Sire, je voulais donc proposer à Votre Majesté
d’envoyer quelqu’un à Belle-Île.
– Qui cela ?
– Moi, par exemple.
– Qu’iriez-vous faire à Belle-Île ?
– M’informer s’il est vrai qu’à l’exemple des anciens seigneurs
féodaux, M. Fouquet fait créneler ses murailles.
– Et dans quel but ferait-il cela ?
– Dans le but de se défendre un jour contre son roi.
– Mais s’il en est ainsi, monsieur Colbert, dit Louis, il faut faire
tout de suite comme vous disiez : il faut arrêter M. Fouquet.
– Impossible !
– Je croyais vous avoir déjà dit, monsieur, que je supprimais ce
mot dans mon service.
– Le service de Votre Majesté ne peut empêcher M. Fouquet d’être
surintendant général.
– Eh bien ?
– Et que par conséquent, par cette charge, il n’ait pour lui tout le
Parlement, comme il a toute l’armée par ses largesses, toute la
littérature par ses grâces, toute la noblesse par ses présents.
– C’est-à-dire alors que je ne puis rien contre M. Fouquet ?
– Rien absolument, du moins à cette heure, Sire.
– Vous êtes un conseiller stérile, monsieur Colbert.
– Oh ! non pas, Sire, car je ne me bornerai plus à montrer le péril
36
à Votre Majesté.
– Allons donc ! Par où peut-on saper le colosse ? Voyons !
Et le roi se mit à rire avec amertume.
– Il a grandi par l’argent, tuez-le par l’argent, Sire.
– Si je lui enlevais sa charge ?
– Mauvais moyen.
– Le bon, le bon alors ?
– Ruinez-le, Sire, je vous le dis.
– Comment cela ?
– Les occasions ne vous manqueront pas, profitez de toutes les
occasions.
– Indiquez-les moi.
– En voici une d’abord. Son Altesse Royale Monsieur va se
marier, ses noces doivent être magnifiques. C’est une belle occasion
pour votre Majesté de demander un million à M. Fouquet ; M.
Fouquet, qui paie vingt mille livres d’un coup, lorsqu’il n’en doit que
cinq, trouvera facilement ce million quand le demandera Votre
Majesté.
– C’est bien, je le lui demanderai, fit Louis XIV.
– Si Votre Majesté veut signer l’ordonnance, je ferai prendre
l’argent moi-même.
Et Colbert poussa devant le roi un papier et lui présenta une
plume.
En ce moment, l’huissier entrouvrit la porte et annonça M. le
surintendant.
Louis pâlit.
Colbert laissa tomber la plume et s’écarta du roi sur lequel il
étendait ses ailes noires de mauvais ange.
Le surintendant fit son entrée en homme de cour, à qui un seul
coup d’œil suffit pour apprécier une situation.
Cette situation n’était pas rassurante pour Fouquet, quelle que fût
la conscience de sa force. Le petit œil noir de Colbert, dilaté par
l’envie, et l’œil limpide de Louis XIV, enflammé par la colère,
signalaient un danger pressant.
Les courtisans sont, pour les bruits de cour, comme les vieux
soldats qui distinguent, à travers les rumeurs du vent et des
37
feuillages, le retentissement lointain des pas d’une troupe armée ; ils
peuvent, après avoir écouté, dire à peu près combien d’hommes
marchent, combien d’armes résonnent, combien de canons roulent.
Fouquet n’eut donc qu’à interroger le silence qui s’était fait à son
arrivée : il le trouva gros de menaçantes révélations. Le roi lui laissa
tout le temps de s’avancer jusqu’au milieu de la chambre.
Sa pudeur adolescente lui commandait cette abstention du
moment.
Fouquet saisit hardiment l’occasion.
– Sire, dit-il, j’étais impatient de voir Votre Majesté.
– Et pourquoi ? demanda Louis.
– Pour lui annoncer une bonne nouvelle.
Colbert, moins la grandeur de la personne, moins la largesse du
cœur, ressemblait en beaucoup de points à Fouquet. Même
pénétration, même habitude des hommes. De plus, cette grande force
de contraction, qui donne aux hypocrites le temps de réfléchir et de
se ramasser pour prendre du ressort.
Il devina que Fouquet marchait au-devant du coup qu’il allait lui
porter.
Ses yeux brillèrent.
– Quelle nouvelle ? demanda le roi.
Fouquet déposa un rouleau de papier sur la table.
– Que Votre Majesté veuille bien jeter les yeux sur ce travail, dit-
il.
Le roi déplia lentement le rouleau.
– Des plans ? dit-il.
– Oui, Sire.
– Et quels sont ces plans ?
– Une fortification nouvelle, Sire.
– Ah ! ah ! fit le roi, vous vous occupez donc de tactique et de
stratégie, monsieur Fouquet.
– Je m’occupe de tout ce qui peut être utile au règne de Votre
Majesté, répliqua Fouquet.
– Belles images ! dit le roi en regardant le dessin.
– Votre Majesté comprend sans doute, dit Fouquet en s’inclinant
sur le papier : ici est la ceinture de murailles, là les forts, là les
38
ouvrages avancés.
– Et que vois-je là, monsieur ?
– La mer.
– La mer tout autour ?
– Oui, Sire.
– Et quelle est donc cette place dont vous me montrez le plan ?
– Sire, c’est Belle-Île-en-Mer, répondit Fouquet avec simplicité.
À ce mot, à ce nom, Colbert fit un mouvement si marqué que le
roi se retourna pour lui recommander la réserve. Fouquet ne parut
pas s’être ému le moins du monde du mouvement de Colbert, ni du
signe du roi.
– Monsieur, continua Louis, vous avez donc fait fortifier Belle-
Île ?
– Oui, Sire, et j’en apporte les devis et les comptes à Votre
Majesté, répliqua Fouquet ; j’ai dépensé seize cent mille livres à cette
opération.
– Pour quoi faire ? répliqua froidement Louis qui avait puisé de
l’initiative dans un regard haineux de l’intendant.
– Pour un but assez facile à saisir, répondit Fouquet, Votre Majesté
était en froid avec la Grande-Bretagne.
– Oui ; mais depuis la restauration du roi Charles II, j’ai fait
alliance avec elle.
– Depuis un mois, Sire, Votre Majesté l’a bien dit ; mais il y a près
de six mois que les fortifications de Belle-Île sont commencées.
– Alors elles sont devenues inutiles.
– Sire, des fortifications ne sont jamais inutiles. J’avais fortifié
Belle-Île contre MM. Monck et Lambert et tous ces bourgeois de
Londres qui jouaient au soldat. Belle-Île se trouvera toute fortifiée
contre les Hollandais à qui ou l’Angleterre ou Votre Majesté ne peut
manquer de faire la guerre.
Le roi se tut encore une fois et regarda en dessous Colbert.
– Belle-Île, je crois, ajouta Louis, est à vous, monsieur Fouquet ?
– Non, Sire.
– À qui donc alors ?
– À Votre Majesté.
Colbert fut saisi d’effroi comme si un gouffre se fût ouvert sous
39
ses pieds.
Louis tressaillit d’admiration, soit pour le génie, soit pour le
dévouement de Fouquet.
– Expliquez-vous, monsieur, dit-il.
– Rien de plus facile, Sire ; Belle-Île est une terre à moi ; je l’ai
fortifiée de mes deniers ; mais comme rien au monde ne peut
s’opposer à ce qu’un sujet fasse un humble présent à son roi, j’offre à
Votre Majesté la propriété de la terre dont elle me laissera l’usufruit.
Belle-Île, place de guerre, doit être occupée par le roi ; Sa Majesté,
désormais, pourra y tenir une sûre garnison.
Colbert se laissa presque entièrement aller sur le parquet glissant.
Il eut besoin, pour ne pas tomber, de se tenir aux colonnes de la
boiserie.
– C’est une grande habileté d’homme de guerre que vous avez
témoignée là, monsieur, dit Louis XIV.
– Sire, l’initiative n’est pas venue de moi, répondit Fouquet ;
beaucoup d’officiers me l’ont inspirée ; les plans eux-mêmes ont été
faits par un ingénieur des plus distingués.
– Son nom ?
– M. du Vallon.
– M. du Vallon ? reprit Louis. Je ne le connais pas. Il est fâcheux,
monsieur Colbert, continua-t-il, que je ne connaisse pas le nom des
hommes de talent qui honorent mon règne.
Et en disant ces mots, il se retourna vers Colbert. Celui-ci se
sentait écrasé, la sueur lui coulait du front, aucune parole ne se
présentait à ses lèvres, il souffrait un martyre inexprimable.
– Vous retiendrez ce nom, ajouta Louis XIV.
Colbert s’inclina, plus pâle que ses manchettes de dentelles de
Flandre.
Fouquet continua :
– Les maçonneries sont de mastic romain ; des architectes me
l’ont composé d’après les relations de l’Antiquité.
– Et les canons ? demanda Louis.
– Oh ! Sire, ceci regarde Votre Majesté, il ne m’appartient pas de
mettre des canons chez moi, sans que Votre Majesté m’ait dit qu’elle
était chez elle.
40
Louis commençait à flotter indécis entre la haine que lui inspirait
cet homme si puissant et la pitié que lui inspirait cet autre homme
abattu, qui lui semblait la contrefaçon du premier.
Mais la conscience de son devoir de roi l’emporta sur les
sentiments de l’homme.
Il allongea son doigt sur le papier.
– Ces plans ont dû vous coûter beaucoup d’argent à exécuter ? dit-
il.
– Je croyais avoir eu l’honneur de dire le chiffre à Votre Majesté.
– Redites, je l’ai oublié.
– Seize cent mille livres.
– Seize cent mille livres ! Vous êtes énormément riche, monsieur
Fouquet.
– C’est Votre Majesté qui est riche, dit le surintendant, puisque
Belle-Île est à elle.
– Oui, merci ; mais si riche que je sois, monsieur Fouquet…
Le roi s’arrêta.
– Eh bien ! Sire ?… demanda le surintendant.
– Je prévois le moment où je manquerai d’argent.
– Vous, Sire ?
– Oui, moi.
– Et à quel moment donc ?
– Demain, par exemple.
– Que Votre Majesté me fasse l’honneur de s’expliquer.
– Mon frère épouse Madame d’Angleterre.
– Eh bien, Sire ?
– Eh bien ! je dois faire à la jeune princesse une réception digne
de la petite-fille de Henri IV.
– C’est trop juste, Sire.
– J’ai donc besoin d’argent.
– Sans doute.
– Et il me faudrait…
Louis XIV hésita. La somme qu’il avait à demander était juste
celle qu’il avait été obligé de refuser à Charles II. Il se tourna vers
Colbert pour qu’il donnât le coup.
– Il me faudrait demain… répéta-t-il en regardant Colbert.
41
– Un million, dit brutalement celui-ci enchanté de reprendre sa
revanche.
Fouquet tournait le dos à l’intendant pour écouter le roi. Il ne se
retourna même point et attendit que le roi répétât ou plutôt
murmurât :
– Un million.
– Oh ! Sire, répondit dédaigneusement Fouquet, un million ! que
fera Votre Majesté avec un million ?
– Il me semble cependant… dit Louis XIV.
– C’est ce qu’on dépense aux noces du plus petit prince
d’Allemagne.
– Monsieur…
– Il faut deux millions au moins à Votre Majesté. Les chevaux
seuls emporteront cinq cent mille livres. J’aurai l’honneur d’envoyer
ce soir seize cent mille livres à Votre Majesté.
– Comment, dit le roi, seize cent mille livres !
– Attendez, Sire, répondit Fouquet sans même se retourner vers
Colbert, je sais qu’il manque quatre cent mille livres. Mais ce
monsieur de l’intendance (et par-dessus son épaule il montrait du
pouce Colbert, qui pâlissait derrière lui), mais ce monsieur de
l’intendance… a dans sa caisse neuf cent mille livres à moi.
Le roi se retourna pour regarder Colbert.
– Mais… dit celui-ci.
– Monsieur, poursuivit Fouquet toujours parlant indirectement à
Colbert, Monsieur a reçu il y a huit jours seize cent mille livres ; il a
payé cent mille livres aux gardes, soixante-quinze mille aux
hôpitaux, vingt-cinq mille aux Suisses, cent trente mille aux vivres,
mille aux armes, dix mille aux menus frais ; je ne me trompe donc
point en comptant sur neuf cent mille livres qui restent.
Alors, se tournant à demi vers Colbert, comme fait un chef
dédaigneux vers son inférieur :
– Ayez soin, monsieur, dit-il, que ces neuf cent mille livres soient
remises ce soir en or à Sa Majesté.
– Mais, dit le roi, cela fera deux millions cinq cent mille livres ?
– Sire, les cinq cent mille livres de plus seront la monnaie de
poche de Son Altesse Royale. Vous entendez, monsieur Colbert, ce
42
soir, avant huit heures.
Et sur ces mots, saluant le roi avec respect, le surintendant fit à
reculons sa sortie sans honorer d’un seul regard l’envieux auquel il
venait de raser à moitié la tête.
Colbert déchira de rage son point de Flandre et mordit ses lèvres
jusqu’au sang. Fouquet n’était pas à la porte du cabinet que
l’huissier, passant à coté de lui, cria :
– Un courrier de Bretagne pour Sa Majesté.
– M. d’Herblay avait raison, murmura Fouquet en tirant sa
montre : une heure cinquante-cinq minutes. Il était temps !
43