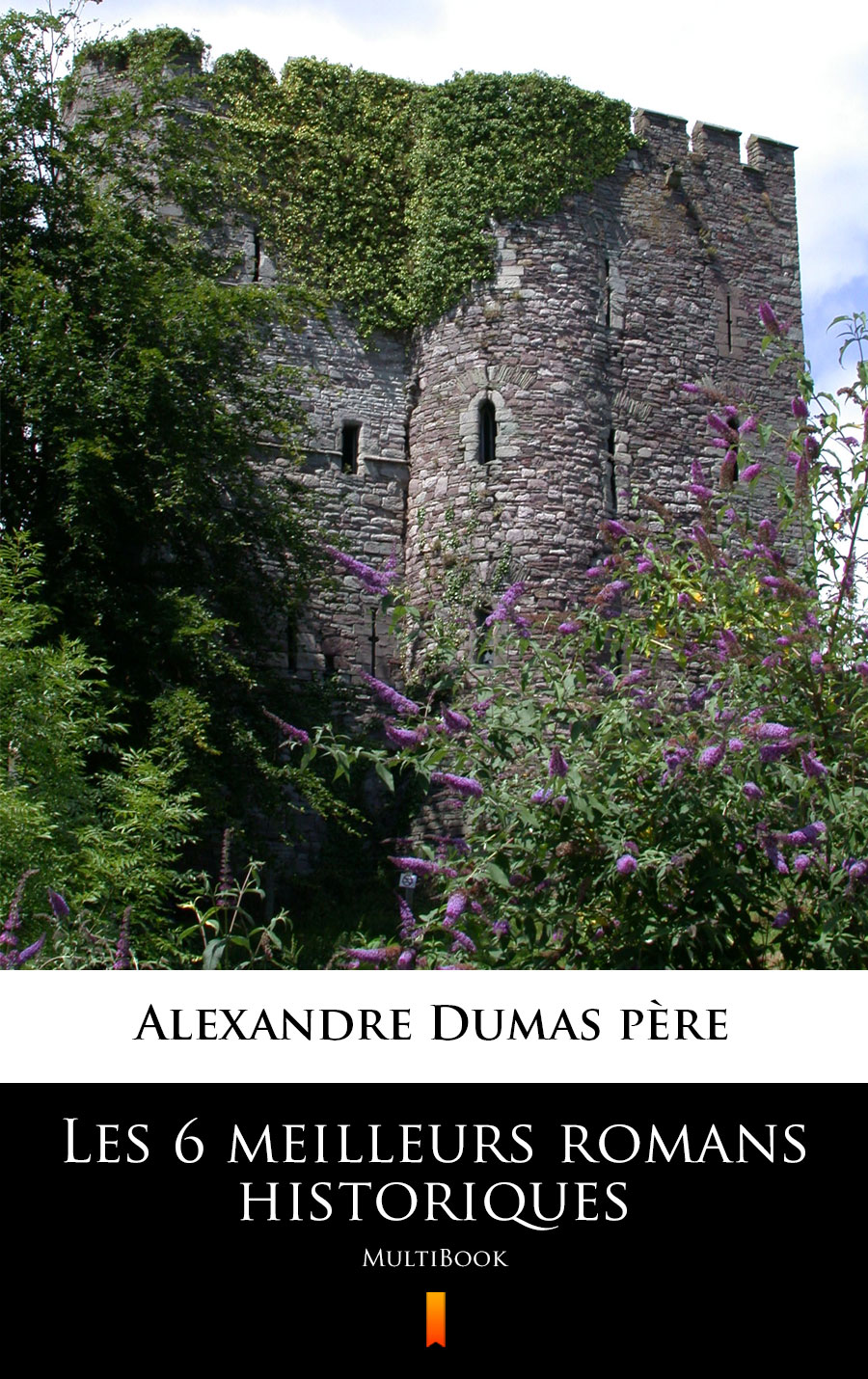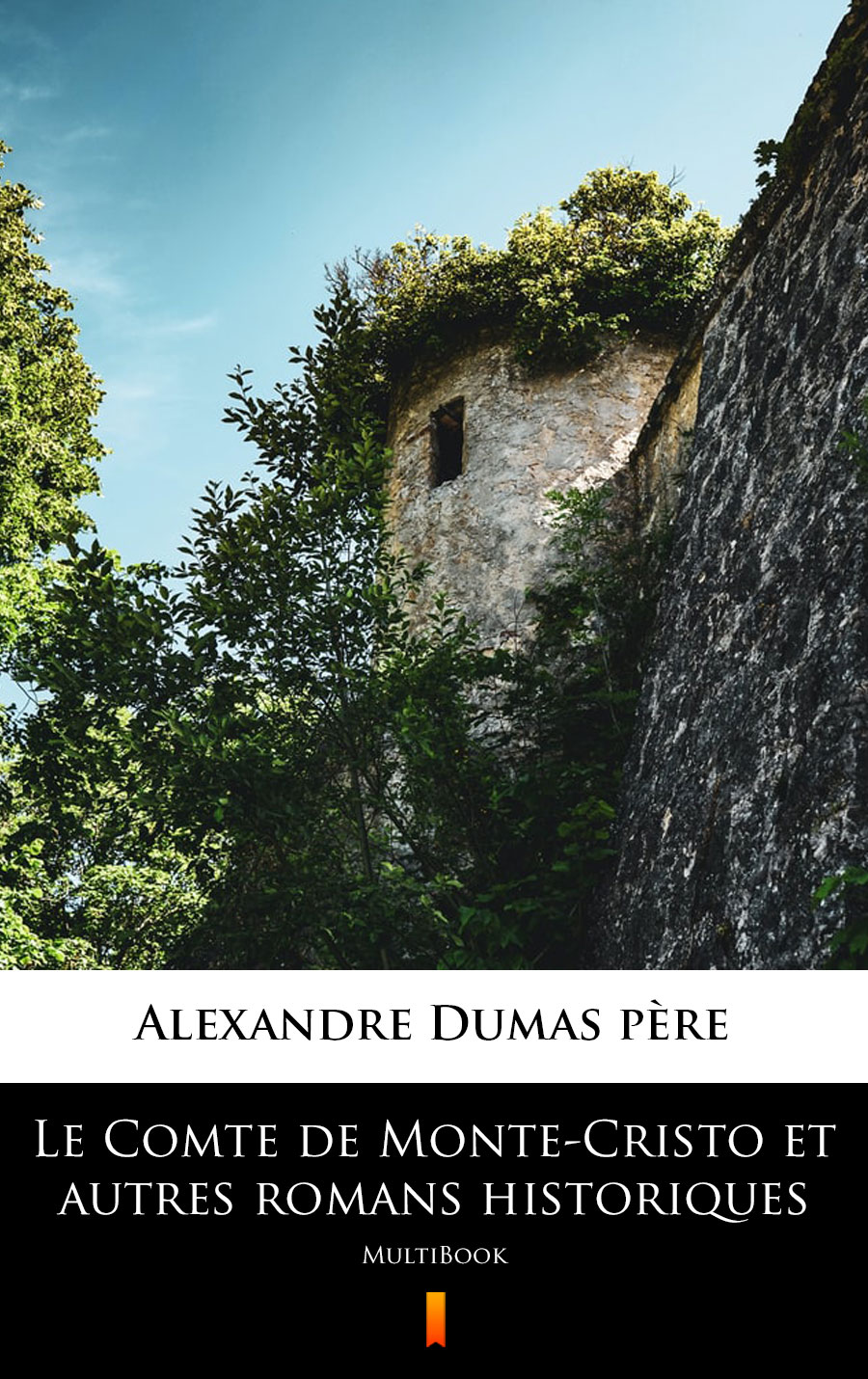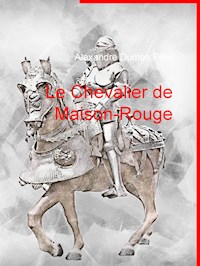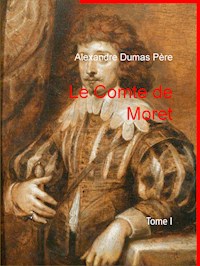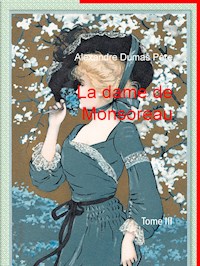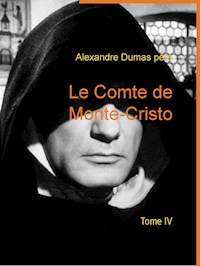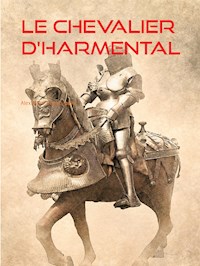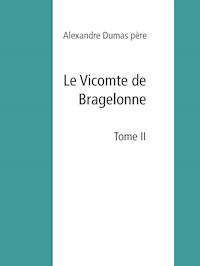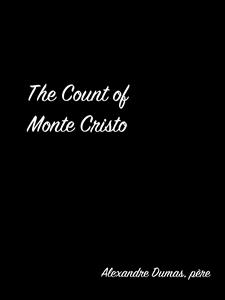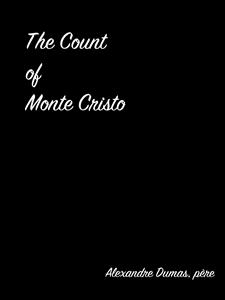Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Succédant chronologiquement au Speronare (Sicile) et au Capitaine Aréna (Iles Eoliennes et Calabre), Le Corricolo conclut les Impressions de voyage dans le Royaume de Naples par la découverte de sa capitale, à l'époque troisième ville d'Europe après Londres et Paris. Le titre se réfère au véhicule employé par Dumas et son compagnon, le peintre Jadin, dans cette folle équipée : une fragile petite voiture charriant une quinzaine de passagers parasites tirée par des chevaux en toute fin de carrière. Le tableau du corricolo dressé dans l'introduction est en soi une vraie promesse...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1046
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Corricolo
Pages de titrePREMIÈRE PARTIE.I – Osmin et Zaïda.II – Les Chevaux spectres.III – Chiaja.IV – Toledo.V – Otello.VI – Forcella.VII – Suite.VIII – Grand Gala.IX – Le Lazzarone.XI – Le roi Nasone.XII – Anecdotes.XIV – Anecdotes.XV – Les Vardarelli.XVI – La Jettatura.XVII – Le Prince de ***.XVIII – Le Combat.XXII – Le Miracle.XXIV – Le Capucin de Resina.XXV – Saint Joseph.DEUXIÈME PARTIE.II – Le Môle.III – Le Tombeau de Virgile.chien.V – La Place du Marché.VI – Église del Carmine.VIII – Pouzzoles.X – Le Golfe de Baïa.Naples.XIII – La Rue des Tombeaux.XIV – Petites Affiches.XV – Maison du Faune.XVI – La grande Mosaïque.XXI – Route de Rome.XXII – Gasparone.arrive à Florence.Page de copyright1
Le Corricolo
Alexandre Dumas père
2
PREMIÈRE PARTIE.
3
Introduction
Le corricolo est le synonyme de calessino, mais comme il n’y a
pas de synonyme parfait, expliquons la différence qui existe entre le
corricolo et le calessino.
Le corricolo est un espèce de tilbury primitivement destiné à
contenir une personne et à être attelé d’un cheval ; on l’attelle de
deux chevaux, et il charrie de douze à quinze personnes.
Et qu’on ne croie pas que ce soit au pas, comme la charrette à
bœufs des rois francs, ou au trot, comme le cabriolet de régie ; non,
c’est au triple galop ; et le char de Pluton, qui enlevait Proserpine sur
les bords du Symète, n’allait pas plus vite que le corricolo qui
sillonne les quais de Naples en brûlant un pavé de laves et en
soulevant leur poussière de cendres.
Cependant un seul des deux chevaux tire véritablement : c’est le
timonier. L’autre, qui s’appelle le bilancino, et qui est attelé de côté,
bondit, caracole, excite son compagnon, voilà tout. Quel dieu,
comme à Tityre, lui a fait ce repos ? C’est le hasard, c’est la
Providence, c’est la fatalité : les chevaux, comme les hommes, ont
leur étoile.
Nous avons dit que ce tilbury, destiné à une personne, en charriait
d’ordinaire douze ou quinze ; cela, nous le comprenons bien,
demande une explication. Un vieux proverbe français dit : « Quand il
y en a pour un, il y en a pour deux. » Mais je ne connais aucun
proverbe dans aucune langue qui dise : « Quand il y en a pour un, il y
en a pour quinze. »
Il en est cependant ainsi du corricolo, tant, dans les civilisations
4
avancées, chaque chose est détournée de sa destination primitive !
Comment et en combien de temps s’est faite cette agglomération
successive d’individus sur le corricolo, c’est ce qu’il est impossible
de déterminer avec précision. Contentonsnous donc de dire
comment elle y tient.
D’abord, et presque toujours, un gros moine est assis au milieu, et
forme le centre de l’agglomération humaine que le corricolo emporte
comme un de ces tourbillons d’âmes que Dante vit suivant un grand
étendard dans le premier cercle de l’enfer. Il a sur un de ses genoux
quelque fraîche nourrice d’Aversa ou de Nettuno, et sur l’autre
quelque belle paysanne de Bauci ou de Procida ; aux deux côtés du
moine, entre les roues et la caisse, se tiennent debout les maris de ces
dames.
Derrière le moine se dresse sur la pointe des pieds le propriétaire
ou le conducteur de l’attelage, tenant de la main gauche la bride, et
de la main droite le long fouet avec lequel il entretient d’une égale
vitesse la marche de ses deux chevaux.
Derrière celuici se groupent à leur tour, à la manière des valets de
bonne maison, deux ou trois lazzaroni, qui montent, qui descendent,
se succèdent, se renouvellent, sans qu’on pense jamais à leur
demander un salaire en échange du service rendu. Sur les deux
brancards sont assis deux gamins ramassés sur la route de Torre del
Greco ou de Pouzzoles, ciceroni surnuméraires des antiquités
d’Herculanum et de Pompéia, guides marrons des antiquités de
Cumes et de Baïa.
Enfin, sous l’essieu de la voiture, entre les deux roues, dans un
filet à grosses mailles qui va ballottant de haut en bas, de long en
large, grouille quelque chose d’informe, qui rit, qui pleure, qui crie,
qui hogne, qui se plaint, qui chante, qui raille, qu’il est impossible de
distinguer au milieu de la poussière que soulèvent les pieds des
chevaux : ce sont trois ou quatre enfans qui appartiennent on ne sait à
qui, qui vont on ne sait où, qui vivent on ne sait de quoi, qui sont là
on ne sait comment, et qui y restent on ne sait pourquoi.
Maintenant, mettez audessous l’un de l’autre, moine, paysannes,
maris, conducteurs, lazzaroni, gamins et enfans ; additionnez le tout,
5
ajoutez le nourrisson oublié, et vous aurez votre compte. Total,
quinze personnes.
Parfois il arrive que la fantastique machine, chargée comme elle
est ; passe sur une pierre et verse ; alors toute la carrossée s’éparpille
sur le revers de la route, chacun lancé selon son plus ou moins de
pesanteur. Mais chacun se retire aussitôt et oublie son accident pour
ne s’occuper que de celui du moine ; on le tâte, on le tourne, on le
retourne, on le relève, on l’interroge. S’il est blessé, tout le monde
s’arrête, on le porte, on le soutient, on le choie, on le couche, on le
garde. Le corricolo est remisé au coin de la cour, les chevaux entrent
dans l’écurie ; pour ce jourlà, le voyage est fini ; on pleure, on se
lamente, on prie. Mais si, au contraire, le moine est sain et sauf,
personne n’a rien ; il remonte à sa place, la nourrice et la paysanne
reprennent chacune la sienne ; chacun se rétablit, se regroupe, se
rentasse, et, au seul cri excitateur du cocher, le corricolo reprend sa
course, rapide comme l’air et infatigable comme le temps.
Voilà ce que c’est que le corricolo.
Maintenant, comment le nom d’une voiture estil devenu le titre
d’un ouvrage ? C’est ce que le lecteur verra au second chapitre.
D’ailleurs, nous avons un antécédent de ce genre que, plus que
personne, nous avons le droit d’invoquer : c’est le Speronare.
6
I – Osmin et Zaïda.
Nous étions descendus à l’hôtel de la Victoire. M. Martin Zir est
le type du parfait hôtelier italien : homme de goût, homme d’esprit,
antiquaire distingué, amateur de tableaux, convoiteur de chinoiseries,
collectionneur d’autographes, M. Martin Zir est tout, excepté
aubergiste. Cela n’empêche pas l’hôtel de la Victoire d’être le
meilleur hôtel de Naples. Comment cela se faitil ? Je n’en sais rien.
Dieu est parce qu’il est.
C’est qu’aussi l’hôtel de la Victoire est situé d’une manière
ravissante : vous ouvrez une fenêtre, vous voyez Chiaja, la Villa
Reale, le Pausilippe : vous ouvrez une autre, voilà le golfe, et à
l’extrémité du golfe, pareille à un vaisseau éternellement à l’ancre, la
bleuâtre et poétique Caprée ; vous en ouvrez une troisième, c’est
SainteLucie avec ses mellonari, ses fruits de mer, ses cris de tous les
jours, ses illuminations de toutes les nuits.
Les chambres d’où l’on voit toutes ces belles choses ne sont point
des appartemens ; ce sont des galeries de tableau, ce sont des
cabinets de curiosités, ce sont des boutiques de bricàbrac.
Je crois que ce qui détermine M. Martin Zir à recevoir chez lui des
étrangers, c’est d’abord le désir de leur faire voir les trésors qu’il
possède ; puis il loge et nourrit les hôtes par circonstance. À la fin de
leur séjour à la Vittoria, un total de leur dépense arrive, c’est vrai : ce
total se monte à cent écus, à vingtcinq louis, à mille francs, plus ou
moins, c’est vrai encore ; mais c’est parce qu’ils demandent leur
compte.
S’ils ne le demandaient pas, je crois que M. Martin Zir, perdu
7
dans la contemplation d’un tableau, dans l’appréciation d’une
porcelaine ou dans le déchiffrement d’un autographe, oublierait de le
leur envoyer.
Aussi, lorsque le dey, chassé d’Alger, passa à Naples, charriant
ses trésors et son harem, prévenu par la réputation de M. Martin Zir,
il se fit conduire tout droit à l’hôtel de la Vittoria, dont il loua les
trois étages supérieurs, c’estàdire le troisième, le quatrième et les
greniers.
Le troisième était pour ses officiers et les gens de sa suite.
Le quatrième était pour lui et ses trésors.
Les greniers étaient pour son harem.
L’arrivée du dey fut une bonne fortune pour M. Martin Zir ; non
pas, comme on pourrait le croire, à cause de l’argent que l’Algérien
allait dépenser dans l’hôtel, mais relativement aux trésors d’armes,
de costumes et de bijoux qu’il transportait avec lui.
Au bout de huit jours, HusseinPacha et M. Martin Zir étaient les
meilleurs amis du monde ; ils ne se quittaient plus. Qui voyait
paraître l’un s’attendait à voir immédiatement paraître l’autre.
Oreste et Pylade n’étaient pas plus inséparables ; Damon et
Pythias n’étaient pas plus dévoués. Cela dura quatre ou cinq mois.
Pendant ce temps, on donna force fêtes à Son Altesse. Ce fut à
l’une de ces fêtes, chez les prince de Cassaro, qu’après avoir vu
exécuter un cotillon effréné le dey demanda au prince de Tricasia,
gendre du ministre des affaires étrangères, comment, étant si riche, il
se donnait la peine de danser lui même.
Le dey aimait fort ces sortes de divertissemens, car il était fort
impressionnable à la beauté, à la beauté comme il la comprenait bien
entendu. Seulement il avait une singulière manière de manifester son
mépris ou son admiration. Selon la maigreur ou l’obésité des
personnes, il disait :
— Madame une telle ne vaut pas trois piastres. Madame une telle
vaut plus de mille ducats.
Un jour on apprit avec étonnement que M. Martin Zir et Hussein
Pacha venaient de se brouiller. Voici à quelle occasion le
refroidissement était survenu :
8
Un matin, le cuisinier de HusseinPacha, un beau nègre de Nubie,
noir comme de l’encre et luisant comme s’il eût été passé au vernis ;
un matin, disje, le cuisinier de HusseinPacha était descendu au
laboratoire et avait demandé le plus grand couteau qu’il y eût dans
l’hôtel.
Le chef lui avait donné une espèce de tranchelard de dixhuit
pouces de long, pliant comme un fleuret et affilé comme un rasoir.
Le nègre avait regardé l’instrument en secouant la tête, puis il était
remonté à son troisième étage.
Un instant après il était redescendu et avait rendu le tranchelard au
chef en disant :
— Plus grand, plus grand !
Le chef avait alors ouvert tous ses tiroirs, et ayant découvert un
coutelas dont il ne se servait luimême que dans les grandes
occasions, il l’avait remis à son confrère. Celuici avait regarde le
coutelas avec la même attention qu’il avait fait du tranchelard, et,
après avoir répondu par un signe de tête qui voulait dire :
« Hum ! Ce n’est pas encore cela qu’il me faudrait, mais cela se
rapproche, » il était remonté comme la première fois.
Cinq minutes après, le nègre redescendit de nouveau, et, rendant
le coutelas au chef :
— Plus grand encore, lui ditil.
— Et pourquoi diable avezvous besoin d’un couteau plus grand
que celuici ? demanda le chef.
— Moi en avoir besoin, répondit dogmatiquement le nègre.
— Mais pour quoi faire ?
— Pour moi couper la tête à Osmin.
— Comment ! s’écria le chef, pour toi couper la tête à Osmin.
— Pour moi couper la tête à Osmin, répondit le nègre.
— À Osmin, le chef des eunuques de Sa Hautesse ?
— À Osmin, le chef des eunuques de Sa Hautesse.
— À Osmin que le dey aime tant ?
— À Osmin que le dey aime tant.
— Mais vous êtes fou, mon cher ! Si vous coupez la tête à Osmin,
Sa Hautesse sera furieuse.
9
— Sa Hautesse l’a ordonné à moi.
— Ah diable ! c’est différent alors.
— Donnez donc un autre couteau à moi, reprit le nègre, qui
revenait à son idée avec la persistance de l’obéissance passive.
— Mais qu’a fait Osmin ? demanda le chef.
— Donnez un autre couteau à moi, plus grand, plus grand.
— Auparavant, je voudrais savoir ce qu’a fait Osmin.
— Donnez un autre couteau à moi, plus grand, plus grand, plus
grand encore !
— Eh bien ! je te le donnerai ton couteau, si tu me dis ce qu’a fait
Osmin.
— Il a laissé faire un trou dans le mur.
— À quel mur ?
— Au mur du harem.
— Et après ?
— Le mur, il était celui de Zaïda.
— La favorite de Sa Hautesse ?
— La favorite de Sa Hautesse.
— Eh bien ?
— Eh bien ! un homme est entré chez Zaïda.
— Diable !
— Donnez donc un grand, grand, grand couteau à moi pour
couper la tête à Osmin.
— Pardon ; mais que feraton à Zaïda ?
— Sa Hautesse aller promener dans le golfe avec un sac, Zaïda
être dans ce sac, Sa Hautesse jeter le sac à la mer… Bonsoir, Zaïda.
Et le nègre montra, en riant de la plaisanterie qu’il venait de faire,
deux rangées de dents blanches comme des perles.
— Mais quand cela ? reprit le chef.
— Quand, quoi ? demanda le nègre.
— Quand jetteton Zaïda à la mer ?
— Aujourd’hui. Commencer par Osmin, finir par Zaïda.
— Et c’est toi qui t’es chargé de l’exécution ?
— Sa Hautesse a donné l’ordre à moi, dit le nègre en se redressant
avec orgueil.
10
— Mais c’est la besogne du bourreau et non la tienne.
— Sa Hautesse pas avoir eu le temps d’emmener son bourreau, et
il a pris cuisinier à lui. Donnez donc à moi un grand couteau pour
couper la tête à Osmin.
— C’est bien, c’est bien, interrompit le chef ; on va te le chercher,
ton grand couteau. Attendsmoi ici.
— J’attends vous, dit le nègre.
Le chef courut chez M. Martin Zir et lui transmit la demande du
cuisinier de Sa Hautesse.
M. Martin Zir courut chez Son Excellence le ministre de la police,
et le prévint de ce qui se passait à son hôtel.
Son Excellence fit mettre les chevaux à sa voiture et se rendit chez
le dey.
Il trouva Sa Hautesse à demi couchée sur un divan, le dos appuyé
à la muraille, fumant du latakié dans un chibouque, une jambe repliée
sous lui et l’autre jambe étendue, se faisant gratter la plante du pied
par un icoglan et éventer par deux esclaves.
Le ministre fit les trois saluts d’usage, le dey inclina la tête.
— Hautesse, dit Son Excellence, je suis le ministre de la police.
— Je te connais, répondit le dey.
— Alors, Votre Hautesse se doute du motif qui m’amène.
— Non. Mais n’importe, sois le bienvenu.
— Je viens pour empêcher Votre Hautesse de commettre un
crime.
— Un crime ! Et lequel ? dit le dey, tirant son chibouque de ses
lèvres et regardant son interlocuteur avec l’expression du plus
profond étonnement.
— Lequel ? Votre Hautesse le demande ! s’écria le ministre.
Votre Hautesse n’atelle pas l’intention de faire couper la tête à
Osmin ?
— Couper la tête à Osmin n’est point un crime, reprit le dey.
— Votre Hautesse n’atelle pas l’intention de jeter Zaïda à la
mer ?
— Jeter Zaïda à la mer n’est point un crime, reprit encore le dey.
— Comment ! ce n’est point un crime de jeter Zaïda à la mer et de
11
couper la tête à Osmin ?
— J’ai acheté Osmin cinq cents piastres et Zaïda mille sequins,
comme j’ai acheté cette pipe cent ducats.
— Eh bien ! demanda le ministre, où Votre Hautesse en veutelle
venir ?
— Que, comme cette pipe m’appartient, je puis la casser en dix
morceaux, en vingt morceaux, en cinquante morceaux, si cela me
convient, et que personne n’a rien à dire. Et le pacha cassa sa pipe,
dont il jeta les débris dans la chambre.
— Bon pour une pipe, dit le ministre ; mais Osmin, mais Zaïda !
— Moins qu’une pipe, dit gravement le dey.
— Comment, moins qu’une pipe ! Un homme moins qu’une
pipe ! Une femme moins qu’une pipe !
— Osmin n’est pas un homme. Zaïda n’est point une femme : ce
sont des esclaves. Je ferai couper la tête à Osmin, et je ferai jeter
Zaïda à la mer.
— Non, dit Son Excellence.
— Comment, non ! s’écria le pacha avec un geste de menace.
— Non, reprit le ministre, non ; pas à Naples du moins.
— Giaour, dit le dey, saistu comment je m’appelle ?
— Vous vous appelez HusseinPacha.
— Chien de chrétien ! s’écria le dey avec une colère croissante ;
saistu qui je suis ?
— Vous êtes l’exdey d’Alger, et moi je suis le ministre actuel de
la police de Naples.
— Et cela veut dire ? demanda le dey.
— Cela veut dire que je vais vous envoyer en prison si vous faites
l’impertinent, entendezvous, mon brave homme ? répondit le
ministre avec le plus grand sangfroid.
— En prison ! murmura le dey en retombant sur son divan.
— En prison, dit le ministre.
— C’est bien, reprit Hussein. Ce soir je quitte Naples.
— Votre Hautesse est libre comme l’air, répondit le ministre.
— C’est heureux, dit le dey.
— Mais à une condition cependant.
12
— Laquelle ?
— C’est que Votre Hautesse me jurera sur le prophète qu’il
n’arrivera malheur ni à Osmin ni à Zaïda.
— Osmin et Zaïda m’appartiennent, dit le dey, j’en ferai ce que
bon me semblera.
— Alors Votre Hautesse ne partira point.
— Comment, je ne partirai point !
— Non, du moins avant de m’avoir remis Osmin et Zaïda.
— Jamais ! s’écria le dey.
— Alors je les prendrai, dit le ministre.
— Vous les prendrez ? vous me prendrez mon eunuque et mon
esclave ?
— En touchant le sol de Naples, votre esclave et votre eunuque
sont devenus libres. Vous ne quitterez Naples qu’à la condition que
les deux coupables seront remis à la justice du roi.
— Et si je ne veux pas vous les remettre, qui m’empêchera de
partir ?
— Moi.
— Vous ?
Le pacha porta la main à son poignard ; le ministre lui saisit le
bras audessus du poignet.
— Venez ici, lui ditil en le conduisant vers la fenêtre, regardez
dans la rue. Que voyezvous à la porte de l’hôtel ?
— Un peloton de gendarmerie.
— Savezvous ce que le brigadier qui le commande attend ? Que
je lui fasse un signe pour vous conduire en prison.
— En prison, moi ? je voudrais bien voir cela !
— Voulezvous le voir ?
Son Excellence fit un signe : un instant après, on entendit retentir
dans l’escalier le bruit de deux grosses bottes garnies d’éperons.
Presque aussitôt la porte s’ouvrit, et le brigadier parut sur le seuil,
la main droite à son chapeau, la main gauche à la couture de sa
culotte.
— Gennaro, lui dit le ministre de la police, si je vous donnais
l’ordre d’arrêter monsieur et de le conduire en prison, y verriezvous
13
quelque difficulté ?
— Aucune, Excellence.
— Vous savez que monsieur s’appelle HusseinPacha ?
— Non, je ne le savais pas.
— Et que monsieur n’est ni plus ni moins que le dey d’Alger ?
— Qu’estce que c’est que ça, le dey d’Alger ?
— Vous voyez, dit le ministre.
— Diable ! fit le dey.
— Fautil ? demanda Gennaro en tirant une paire de poucettes de
sa poche et en s’avançant vers HusseinPacha, qui, le voyant faire un
pas en avant, fit de son côté un pas en arrière.
— Non, il ne le faut pas, dit le ministre. Sa Hautesse sera bien
sage.
Seulement cherchez dans l’hôtel un certain Osmin et une certaine
Zaïda, et conduisezles tous les deux à la préfecture.
— Comment, comment, dit le dey, cet homme entrerait dans mon
harem !
— Ce n’est pas un homme ici, répondit le ministre ; c’est un
brigadier de gendarmerie.
— N’importe. Il n’aurait qu’à laisser la porte ouverte !
— Alors il y a un moyen. Faiteslui remettre Osmin et Zaïda.
— Et ils seront punis ? demanda le dey.
— Selon toute la rigueur de nos lois, répondit le ministre.
— Vous me le promettez ?
— Je vous le jure.
— Allons, dit le dey, il faut bien en passer par où vous voulez,
puisqu’on ne peut pas faire autrement.
— À la bonne heure, dit le ministre ; je savais bien que vous
n’étiez pas aussi méchant que vous en aviez l’air.
HusseinPacha frappa dans ses mains ; un esclave ouvrit une porte
cachée dans la tapisserie.
— Faites descendre Osmin et Zaïda, dit le dey.
L’esclave croisa les mains sur sa poitrine, courba la tête et
s’éloigna sans répondre un mot. Un instant après il reparut avec les
coupables.
14
L’eunuque était une petite boule de chaire, grosse, grasse, ronde,
avec des mains de femme, des pieds de femme, une figure de femme.
Zaïda était une Circassienne, aux yeux peints avec du cool, aux
dents noircies avec du bétel, aux ongles rougis avec du henné.
En apercevant HusseinPacha, l’eunuque tomba à genoux, Zaïda
releva la tête. Les yeux du dey étincelèrent, et il porta la main à son
canjiar.
Osmin pâlit, Zaïda sourit.
Le ministre se plaça entre le pacha et les coupables.
— Faites ce que j’ai ordonné, ditil en se retournant vers Gennaro.
Gennaro s’avança vers Osmin et vers Zaïda, leur mit à tous deux
les poucettes et les emmena.
Au moment où ils quittaient la chambre avec le brigadier, Hussein
poussa un soupir qui ressemblait à un rugissement.
Le ministre de la police alla vers la fenêtre, vit les deux
prisonniers sortir de l’hôtel, et, accompagné de leur escorte,
disparaître au coin de la rue Chiatamone.
— Maintenant, ditil en se retournant vers le dey, Votre Hautesse
est libre de partir quand elle voudra.
— À l’instant même ! s’écria Hussein, à l’instant même ! Je ne
resterai pas un instant de plus dans un pays aussi barbare que le
vôtre !
— Bon voyage ! dit le ministre.
— Allez au diable ! dit Hussein.
Une heure ne s’était pas écoulée que Hussein avait frété un petit
bâtiment ; deux heures après il y avait fait conduire ses femmes et ses
trésors. Le même soir il s’y rendait à son tour avec sa suite, et à
minuit il mettait à la voile, maudissant ce pays d’esclaves où l’on
n’était pas libre de couper le cou à son eunuque et de noyer sa
femme.
Le lendemain, le ministre fit comparaître devant lui les deux
coupables et leur fit subir un interrogatoire.
Osmin fut convaincu d’avoir dormi quand il aurait dû veiller, et
Zaïda d’avoir veillé quand elle aurait dû dormir.
Mais comme dans le code napolitain ces deux crimes de lèze
15
hautesse n’étaient point prévus, ils n’étaient passibles d’aucune
punition.
En conséquence, Osmin et Zaïda furent, à leur grand étonnement,
mis en liberté le lendemain même du jour où le dey avait quitté
Naples.
Or, comme tous les deux ne savaient que devenir, n’ayant ni
fortune ni état, ils furent forcés de se créer chacun une industrie.
Osmin devint marchand de pastilles du sérail, et Zaïda se fit
demoiselle de comptoir.
Quant au dey d’Alger, il était sorti de Naples avec l’intention de
se rendre en Angleterre, pays où il avait entendu dire qu’on avait au
moins la liberté de vendre sa femme, à défaut du droit de la noyer :
mais il se trouva indisposé pendant la traversée et fut forcé de
relâcher à Livourne, où il fit, comme chacun sait, une fort belle mort,
si ce n’est cependant qu’il mourut sans avoir pardonné à M. Martin
Zir, ce qui aurait eu de grandes conséquences pour un chrétien, mais
ce qui est sans importance pour un Turc.
16
II – Les Chevaux spectres.
J’avais été recommandé à M. Martin Zir comme artiste ; j’avais
admiré ses galeries de tableaux, j’avais exalté son cabinet de
curiosités, et j’avais augmenté sa collection d’autographes. Il en
résultait que M. Martin Zir, à mon premier passage, si rapide qu’il
eût été, m’avait pris en grande affection ; et la preuve, c’est qu’il
s’était, comme on l’a vu ailleurs, défait en ma faveur de son cuisinier
Cama, dont j’ai raconté l’histoire (voir le Speronare), et qui n’avait
d’autre défaut que d’être appassionnato de Roland et de ne pouvoir
supporter la mer, ce qui était cause que sur terre il faisait fort peu de
cuisine, et que sur mer il n’en faisait pas du tout.
Ce fut donc avec grand plaisir que M. Martin Zir nous vit, après
trois mois d’absence, pendant lesquels le bruit de notre mort était
arrivé jusqu’à lui, descendre à la porte de son hôtel.
Comme sa galerie s’était augmentée de quelques tableaux, comme
son cabinet s’était enrichi de quelques curiosités, comme sa
collection d’autographes s’était recrutée de quelques signatures, il me
fallut avant toute chose parcourir la galerie, visiter le cabinet,
feuilleter les autographes.
Après quoi je le priai de me donner un appartement.
Cependant il ne s’agissait pas de perdre mon temps à me reposer.
J’étais à Naples, c’est vrai ; mais j’y étais sous un nom de
contrebande ; et comme d’un jour à l’autre le gouvernement
napolitain pouvait découvrir mon incognito et me prier d’aller voir à
Rome si son ministre y était toujours, il fallait voir Naples le plus tôt
possible.
17
Or, Naples, à part ses environs, se compose de trois rues où l’on
va toujours, et de cinq cents rues où l’on ne va jamais.
Ces trois rues se nomment la rue de Chiaja, la rue de Tolède et la
rue de Forcella.
Les cinq cents autres rues n’ont pas de nom. C’est l’œuvre de
Dédale ; c’est le labyrinthe de Crète, moins le Minautore, plus les
lazzaroni.
Il y a trois manières de visiter Naples :
À pied, en corricolo, en calèche.
À pied, on passe partout.
En corricolo, l’on passe presque partout.
En calèche, l’on ne passe que dans les rues de Chiaja, de Tolède et
de Forcella.
Je ne me souciais pas d’aller à pied. À pied, l’on voit trop de
choses.
Je ne me souciais pas d’aller en calèche. En calèche, on n’en voit
pas assez.
Restait le corricolo, terme moyen, juste milieu, anneau
intermédiaire qui réunissait les deux extrêmes.
Je m’arrêtai donc au corricolo.
Mon choix fait, j’appelai M. Martin Zir. M. Martin Zir monta
aussitôt.
— Mon cher hôte, lui disje, je viens de décider dans ma sagesse
que je visiterai Naples en corricolo.
— À merveille, dit M. Martin. Le corricolo est une voiture
nationale qui remonte à la plus haute antiquité. C’est la biga des
Romains, et je vois avec plaisir que vous appréciez le corricolo.
— Au plus haut degré, mon cher hôte. Seulement, je voudrais
savoir ce qu’on loue un corricolo au mois.
— On ne loue pas un corricolo au mois, me répondit M. Martin.
— Alors à la semaine.
— On ne loue pas le corricolo à la semaine.
— Eh bien ! au jour.
— On ne loue pas le corricolo au jour.
— Comment donc loueton le corricolo ?
18
— On monte dedans quand il passe et l’on dit : « Pour un carlin. »
Tant que le carlin dure, le cocher vous promène ; le carlin usé, on
vous descend. Voulezvous recommencer ? vous dites : « Pour un
autre carlin ; » le corricolo repart, et ainsi de suite.
— Mais moyennant ce carlin on va où l’on veut ?
— Non, on va où le cheval veut aller. Le corricolo est comme le
ballon, on n’a pas encore trouvé moyen de le diriger.
— Mais alors pourquoi vaton en corricolo !
— Pour le plaisir d’y aller.
— Comment ! c’est pour leur plaisir que ces malheureux
s’entassent à quinze dans une voiture où l’on est gêné à deux !
— Pas pour autre chose.
— C’est original !
— C’est comme cela.
— Mais si je proposais à un propriétaire de corricoli de louer un
de ses berlingo au mois, à la semaine ou au jour ?
— Il refuserait.
— Pourquoi ?
— Ce n’est pas l’habitude.
— Il la prendrait.
— À Naples, on ne prend pas d’habitudes nouvelles : on garde les
vieilles habitudes qu’on a.
— Vous croyez ?
— J’en suis sûr.
— Diable ! diable ! J’avais une idée sur le corricolo ; cela me
vexera horriblement d’y renoncer.
— N’y renoncez pas.
— Comment voulezvous que je la satisfasse, puisqu’on ne loue
les corricoli ni au mois, ni à la semaine, ni au jour ?
— Achetez un corricolo.
— Mais ce n’est pas le tout que d’acheter un corricolo, il faut
acheter les chevaux avec.
— Achetez les chevaux avec.
— Mais cela me coûtera les yeux de la tête.
— Non.
19
— Combien cela me coûteratil donc ?
— Je vais vous le dire.
Et M. Martin, sans se donner la peine de prendre une plume et du
papier, leva le nez au plafond et calcula de mémoire.
— Cela vous coûtera, repritil, le corricolo, dix ducats ; chaque
cheval, trente carlins ; les harnais, une pistole ; en tout quatrevingts
francs de France.
— C’est miraculeux ! Et pour dix ducats j’aurai un corricolo ?
— Magnifique.
— Neuf ?
— Oh ! vous en demandez trop. D’abord, il n’y a pas de corricoli
neufs.
Le corricolo n’existe pas, le corricolo est mort, le corricolo a été
tué légalement.
— Comment cela ?
— Oui, il y a un arrêté de police qui défend aux carrossiers de
faire des corricoli.
— Et combien y atil que cet arrêté a été rendu ?
— Oh ! il y a cinquante ans peutêtre.
— Alors comment le corricolo survitil à une pareille
ordonnance ?
— Vous connaissez l’histoire du couteau de Jeannot.
— Je crois bien ! c’est une chronique nationale.
— Ses propriétaires successifs en avaient changé quinze fois le
manche.
— Et quinze fois la lame.
— Ce qui ne l’empêchait pas d’être toujours le même.
— Parfaitement.
— Eh bien ! c’est l’histoire du corricolo. Il est défendu de faire
des corricoli, mais il n’est pas défendu de mettre des roues neuves
aux vieilles caisses, et des caisses neuves aux vieilles roues.
— Ah ! je comprends.
— De cette façon, le corricolo résiste et se perpétue ; de cette
façon, le corricolo est immortel.
— Alors vive le corricolo, avec des roues neuves et une vieille
20
caisse ! Je le fais repeindre, et fouette cocher ! Mais l’attelage ? Vous
dite que pour trente francs j’aurai un attelage.
— Superbe ! et qui ira comme le vent.
— Quelle espèce de chevaux ?
— Ah ! dame ! des chevaux morts.
— Comment ! des chevaux morts ?
— Oui ; vous comprenez que pour ce prixlà, vous ne pouvez pas
exiger autre chose.
— Voyons, entendonsnous, mon cher monsieur Martin, car il me
semble que nous pataugeons.
— Pas le moins du monde.
— Alors expliquezmoi la chose ; je ne demande pas mieux que
de m’instruire, je voyage pour cela.
— Vous connaissez l’histoire des chevaux ?
— L’histoire naturelle ? M. de Buffon ? Certainement : le cheval
est, après le lion, le plus noble des animaux.
— Non pas, l’histoire philosophique ?
— Je m’en suis moins occupé ; mais n’importe ! allez toujours.
— Vous savez les vicissitudes auxquelles ces nobles quadrupèdes
sont soumis.
— Dame ! quand il sont jeunes, on en fait des chevaux de selle.
— Après ?
— De la selle, ils passent à la calèche ; de la calèche, ils
descendent au fiacre ; du fiacre, ils tombent dans le coucou ; du
coucou, ils dégringolent jusqu’à l’abattoir.
— Et de l’abattoir ?
— Ils vont où va l’âme du juste ; aux ChampsÉlysées, je
présume.
— Eh bien ! ici ils parcourent une phase de plus.
— Laquelle ?
— De l’abattoir, ils vont au corricolo.
— Comment cela ?
— Voici l’endroit où l’on tue les chevaux, au ponte della
Maddelena.
— J’écoute.
21
— Il y a des amateurs en permanence.
— Bon !
— Et lorsqu’on amène un cheval…
— Lorsqu’on amène un cheval ?
— Ils achètent la peau sur pieds trente carlins, c’est le prix ; il y a
un tarif.
— Eh bien ?
— Eh bien ! au lieu de tuer le cheval et de lui enlever la peau, les
amateurs prennent la peau et le cheval, et ils utilisent les jours qui
restent à vivre au cheval, sûrs qu’ils sont que la peau ne leur
échappera pas. Voilà ce que c’est que des chevaux morts.
— Mais que diable peuton faire de ces malheureuses bêtes !
— On les attelle aux corricoli.
— Comment ! ceux avec lesquels je suis venu de Salerne à
Naples ?…
— Étaient des fantômes de chevaux, des chevaux spectres !
— Mais ils n’ont pas quitté le galop !
— Les morts vont vite.
— Au fait, je comprends qu’en les bourrant d’avoine…
— D’avoine ? Jamais un cheval de corricolo n’a mangé d’avoine !
— Mais de quoi viventils ?
— De ce qu’ils trouvent ?
— Et que trouventils ?
— Toutes sortes de choses, des trognons de choux, des feuilles de
salade, de vieux chapeaux de paille.
— Et à quelle heure prennentils leur aliment ?
— La nuit on les mène paître.
— À merveille. Restent les harnais.
— Oh ! quant à cela, je m’en charge.
— Et des chevaux ?
— Des chevaux aussi.
— Et du corricolo ?
— Encore, si cela peut vous rendre service.
— Et quand tout cela seratil prêt ?
— Demain au matin.
22
— Vous êtes un homme adorable !
— Vous fautil un cocher ?
— Non, je conduirai moimême.
— Très bien. Mais en attendant, que ferezvous ?
— Avezvous un livre ?
— J’ai douze cents volumes.
— Eh bien ! je lirai. Avezvous quelque chose sur votre ville ?
— Voulezvous Napoli senza sole ?
— Naples sans soleil ?
— Oui.
— Qu’estce que c’est que cela ?
— Un ouvrage à l’usage des gens à pied, et qui vous sera plus
utile que tous les Ebels et tous les Richards de la terre.
— Et de quoi traitetil ?
— De la manière de parcourir Naples à l’ombre.
— La nuit.
— Non, le jour.
— À une heure donnée ?
— Non, à toutes les heures.
— Même à midi ?
— À midi surtout. Le beau mérite qu’il y aurait de trouver de
l’ombre le soir et le matin !
— Mais quel est le savant géographe qui a exécuté ce chef
d’œuvre ?
— Un jésuite ignorant, que ses confrères avaient reconnu trop bête
pour l’occuper à autre chose.
— Et cette besogne l’a occupé combien d’années ?
— Toute sa vie… C’est une publication posthume.
— Moyennant laquelle on peut, ditesvous ?…
— Partir d’où on voudra et aller où cela fera plaisir, à quelque
instant de la matinée ou à quelque heure de l’aprèsmidi que ce soit,
sans avoir à traverser un seul rayon de soleil.
— Mais voilà un homme qui méritait d’être canonisé !
— On ne sait pas son nom.
— Ingratitude humaine !
23
— Alors ce livre vous convient ?
— Comment donc ! c’est un trésor. Envoyezlemoi le plus tôt
possible.
Je passai la journée à étudier ce précieux itinéraire : deux heures
après, je connaissais mon Naples sans soleil, et je serais allé à
l’ombre du ponte della Maddalena au Pausilippe, et de la Vuaria à
SaintElmo.
Le soir vint, et avec le soir la fraîcheur. Alors, à cette douce brise
de mer, on vit toutes les fenêtres s’ouvrir comme pour respirer. Les
portes roulèrent sur leurs gonds, les voitures commencèrent à sortir,
Chiaja se peupla d’équipages, et la VillaReale de piétons.
Je n’avais pas encore mon équipage, je me mêlai aux piétons.
La VillaReale fait face à l’hôtel de la Victoire ; c’est la
promenade de Naples. Elle est située, relativement à la rue de Chiaja,
comme le jardin des Tuileries à la rue de Rivoli. Seulement, au lieu
de la terrasse du bord de l’eau, c’est la plage de l’Arno ; au lieu de la
Seine, c’est la Méditerranée ; au lieu du quai d’Orsay, c’est
l’étendue, c’est l’espace, c’est l’infini.
La VillaReale est, sans contredit, la plus belle et surtout la plus
aristocratique promenade du monde. Les gens du peuple, les paysans
et les laquais en sont rigoureusement exclus et n’y peuvent mettre le
pied qu’une fois l’an, le jour de la fête de la Madone du Pieddela
Grotte. Aussi ce jourlà la foule se pressetelle sous ses allées
d’acacias, dans ses bosquets de myrtes, autour de son temple
circulaire.
Chacun, homme et femme, accourt de vingt lieues à la ronde avec
son costume national.
Ischia, Caprée, Castellamare, Sorrente, Procida, envoient en
députation leurs plus belles filles, et la solennité de ce jour est si
grande, si ardemment attendue, qu’il est d’habitude de faire dans les
contrats de mariage une obligation au mari de conduire sa femme à la
promenade de la VillaReale, le 8 septembre de chaque année, jour
de la fête della Madona di PiediGrotta.
Tout au contraire des Tuileries, d’où l’on renvoie le public au
moment où il est le plus agréable de s’y promener, la VillaReale
24
reste ouverte toute la nuit. Les grandes grilles se ferment, il est vrai,
mais deux petites portes dérobées offrent aux promeneurs attardés
une entrée et une sortie toujours praticables à quelque heure que ce
soit.
Nous restâmes jusqu’à minuit assis sur le mur que vient battre la
vague. Nous ne pouvions nous lasser de regarder cette mer limpide et
azurée que nous venions de sillonner en tous sens et à laquelle nous
allions dire adieu. Jamais elle ne nous avait paru si belle.
En entrant à l’hôtel, nous trouvâmes M. Martin Zir, qui nous
prévint que toutes les commissions dont nous l’avions chargé étaient
faites, et que le lendemain notre attelage nous attendrait à huit heures
du matin à la porte de l’hôtel.
Effectivement, à l’heure dite, nous entendîmes sonner les grelots
de nos revenans ; nous mîmes le nez à la fenêtre, et nous vîmes le roi
des corricoli.
Il était fond rouge avec des dessins verts. Ces dessins
représentaient des arbres, des animaux et des arabesques. La
composition générale représentait le paradis terrestre.
Deux chevaux qui paraissaient pleins d’impatience disparaissaient
sous les harnais, sous les panaches, sous les pompons dont ils étaient
couverts.
Enfin un homme, armé d’un long fouet, se tenait debout près de
notre équipage, qu’il paraissait admirer avec toute la satisfaction de
l’orgueil.
Nous descendîmes aussitôt, et nous reconnûmes dans l’homme au
fouet Francesco, c’estàdire l’automédon qui nous avait amené en
calessino de Salerne à Naples. M. Martin Zir s’était adressé à lui
comme à un homme de l’état. Flatté de la confiance, Francesco avait
fait vite et en conscience. Il s’était procuré la caisse, il avait acheté
les chevaux, et il avait trouvé de rencontre des harnais presque
neufs ; enfin, malgré la prétention que nous avions manifestée de
conduire nousmêmes, il venait nous offrir ses services comme
cocher.
Je commençai par lui demander la note de ses déboursés : il me la
présenta. Comme l’avait dit M. Martin Zir, elle montait à quatre
25
vingtun francs.
Je lui en donnai quatrevingtdix ; il mit sa croix audessous du
total en forme de quittance ; puis je lui pris le fouet des mains, et je
m’apprêtai à monter dans notre équipage.
— Estce que ces messieurs ne me gardent pas à leur service ?
Nous demanda Francesco.
— Et pourquoi faire, mon ami ? répondisje.
— Mais pour faire tout ce dont je serai capable, et
particulièrement pour faire marcher vos chevaux.
— Comment ! pour faire marcher nos chevaux ?
— Oui.
— Nous, les ferons bien marcher nousmêmes.
— Il faudra voir.
— J’en ai mené de plus fringans que les tiens !
— Je ne dis pas qu’ils sont fringans, excellence.
— Et dans une ville où il est plus difficile de conduire qu’à
Naples, où jusqu’à cinq heures de l’aprèsmidi il n’y a personne dans
les rues.
— Je ne doute pas de l’adresse de son excellence, mais…
— Mais quoi ?
— Mais son excellence a peutêtre mené jusqu’ici des chevaux
vivans, tandis que…
— Tandis que ? Voyons, parle.
— Tandis que ceuxci sont des chevaux morts.
— Eh bien !
— Eh bien ! je ferai observer à son excellence que c’est tout autre
chose.
— Pourquoi ?
— Son excellence verra.
— Estce qu’ils sont vicieux, tes chevaux ?
— Oh ! non, excellence ; ils sont comme la jument de Roland, qui
avait toutes les qualités ; seulement toutes ces qualités étaient
contrebalancées par un seul défaut.
— Lequel ?
— Elle était morte.
26
— Mais s’ils ne marchent pas avec moi, ils ne marcheront avec
personne.
— Pardon, excellence.
— Et qui les fera marcher ?
— Moi.
— Je serais curieux de faire l’expérience.
— Faites, excellence.
Francesco alla d’un air goguenard s’appuyer contre la porte de
l’hôtel, tandis que je sautais dans le corricolo, où m’attendait Jadin,
et que je m’accommodais près de lui.
À peine établi, je rassemblai mes rênes de la main gauche, et
j’allongeai de la droite un coup de fouet qui enveloppa le bilancino et
le porteur.
Ni le porteur ni le bilancino ne bougèrent ; on eût dit des chevaux
de marbre.
J’avais opéré de droite à gauche, je recommençai en opérant cette
fois de gauche à droite. Même immobilité.
Je m’attaquai aux oreilles.
Ils se contentèrent de secouer les oreilles comme ils auraient fait
pour une mouche qui les eût piqués.
Je pris le fouet par la lanière et je frappai avec le manche.
Ils se contentèrent de tourner leur peau comme fait un âne qui
veut jeter son cavalier à terre.
Cela dura dix minutes.
Au bout de ce temps, toutes les fenêtres de l’hôtel étaient
ouvertes, et il y avait autour de nous un rassemblement de deux cents
lazzaroni.
Je vis que je donnais la comédie gratis à la population de Naples.
Comme je n’étais pas venu pour faire concurrence à Polichinelle,
je pris mon parti. À l’instant même je jetai le fouet à Francesco,
curieux de voir comment il s’en tirerait à son tour.
Francesco sauta derrière nous, prit les rênes que je lui tendais,
poussa un petit cri, allongea un petit coup de fouet, et nous partîmes
au galop.
Après quelques évolutions autour de la place, Francesco parvint à
27
diriger son attelage vers la rue de la Chiaja.
28
III – Chiaja.
Chiaja n’est qu’une rue : elle ne peut donc offrir de curieux que ce
qu’offre toute rue, c’estàdire une longue file de bâtimens modernes
d’un goût plus ou moins mauvais. Au reste, Chiaja, comme la rue de
Rivoli, a sur ce point un avantage sur les autres rues : c’est de ne
présenter qu’une seule ligne de portes, de fenêtres et de pierres plus
ou moins maladroitement posées les unes sur les autres. La ligne
parallèle est occupée par les arbres taillés en berceaux de la Villa
Reale, de sorte qu’à partir du premier étage des maisons, ou plutôt
des palais de la rue de Chiaja, comme on les appelle à Naples, on
domine cette seconde partie du golfe qui sépare de l’autre le château
de l’Oeuf.
Mais si la rue de Chiaja n’est pas curieuse par ellemême, elle
conduit à une partie des curiosités de Naples : c’est par elle qu’on va
au tombeau de Virgile, à la grotte du Chien, au lac d’Agnano, à
Pouzzoles, à Baïa, au lac d’Averne et aux ChampsÉlysées.
De plus et surtout, c’est la rue où tous les jours, à trois heures de
l’aprèsmidi pendant l’hiver, et à cinq heures de l’aprèsmidi pendant
l’été, l’aristocratie napolitaine fait corso.
Nous allons donc abandonner la description des palais de Chiaja à
quelque honnête architecte qui nous prouvera que l’art de la bâtisse a
fait de grands progrès depuis MichelAnge jusqu’à nous, et nous
allons dire quelques mots de l’aristocratie napolitaine.
Les nobles de Naples, comme ceux de Venise, n’indiquent jamais
de date à la naissance de leurs familles. Peutêtre aurontils une fin,
mais à coup sûr ils n’ont pas eu de commencement.
29
Selon eux, l’époque florissante de leurs maisons était sous les
empereurs romains ; ils citent tranquillement parmi leurs aïeux les
Fabius, les Marcellus, les Scipions. Ceux qui ne voient clair dans leur
généalogie que jusqu’au douzième siècle sont de la petite noblesse,
du fretin d’aristocratie.
Comme toutes les autres noblesses européennes, à quelques
exceptions près, la noblesse de Naples est ruinée. Quand je dis
ruinée, il est bien entendu qu’on doit prendre le mot dans une
acception relative, c’estàdire que les plus riches sont pauvres
comparativement à ce qu’étaient leurs aïeux.
Il n’y a pas, au reste, à Naples quatre fortunes qui atteignent cinq
cent mille livres de rente, vingt qui dépassent deux cent mille, et
cinquante qui flottent entre cent et cent cinquante mille. Les revenus
ordinaires sont de cinq à dix mille ducats. Le commun des martyrs a
mille écus de rentes, quelquefois moins. Nous ne parlons pas des
dettes.
Mais la chose curieuse, c’est qu’il faut être prévenu de cette
différence pour s’en apercevoir. En apparence, tout le monde a la
même fortune.
Cela tient à ce qu’en général tout le monde vit dans sa voiture et
dans sa loge.
Or, comme, à part les équipages du duc d’Éboli, du prince de
Sant’Antimo ou du duc de SanTheodo, qui sortent de la ligne, tout
le monde possède une calèche plus ou moins neuve, deux chevaux
plus ou moins vieux, une livrée plus ou moins fanée, il n’y a souvent,
à la première vue, qu’une nuance entre deux fortunes où il y a un
abîme.
Quant aux maisons, elles sont presque toutes hermétiquement
closes aux étrangers. Quatre ou cinq palais princiers ouvrent
orgueilleusement leurs galeries dans la journée, et fastueusement
leurs salons le soir ; mais pour tout le reste il faut en faire son deuil.
Le temps est passé où comme Ferdinand Orsini, duc de Gravina, on
écrivait audessus de sa porte : Sibi, suisque, et amicis omnibus ;
pour soi, pour les siens et pour tous ses amis.
C’est qu’à part ces riches demeures, qui perpétuent à Naples
30
l’hospitalité nationale, toutes les autres sont plus ou moins déchues
de leur ancienne splendeur. Le curieux qui, avec l’aide d’Asmodée,
lèverait la terrasse de la plupart de ces palais, trouverait dans un tiers
la gêne, et dans les deux autres la misère.
Grâce à la vie en voiture et en loge, on ne voit rien de tout cela.
On met sa carte au palais, mais on se rencontre au Corso, mais on fait
ses visites au Fondo ou à SaintCharles. De cette façon, l’orgueil est
sauvé ; comme François 1er on a tout perdu, mais du moins il reste
l’honneur.
Vous me direz qu’avec l’honneur on ne mange malheureusement
pas, et qu’il faut manger pour vivre.
Or, il est évident que, lorsqu’on prend sur mille écus de rente
l’entretien d’une voiture, la nourriture de deux chevaux, les gages
d’un cocher et la location d’une loge au Fondo ou à SaintCharles, il
ne doit pas rester grand’chose pour faire face aux dépenses de la
table. À cela je répondrai que Dieu est grand, la mer profonde, le
macaroni à deux sous la livre, et l’asprino d’Aversa à deux liards le
fiasco.
Pour l’instruction de nos lecteurs, qui ne savent probablement pas
ce que c’est que l’asprino d’Aversa, nous leur apprendrons que c’est
un joli petit vin qui tient le milieu entre la tisane de Champagne et le
cidre de Normandie. Or, avec du poisson, du macaroni et de
l’asprino, on fait chez soi un charmant dîner qui coûte quatre sous
par personne.
Supposez que la famille se compose de cinq personnes, c’est vingt
sous.
Restent neuf francs pour soutenir l’honneur du nom.
— Mais le déjeûner ?
— On ne déjeûne pas. Il est prouvé que rien n’est plus sain que de
faire un seul repas toutes les vingtquatre heures. Seulement le repas
change de nom et d’heure selon la saison où on le prend. En hiver, on
dîne à deux heures, et moyennant ce dîner on en a jusqu’au
lendemain deux heures. En été, on soupe à minuit, et moyennant ce
souper on en a pour jusqu’au lendemain minuit.
Puis il y a encore les élégans, qui mangent du pain sans macaroni
31
ou du macaroni sans pain pour s’en aller prendre le soir à grand
fracas une glace chez Donzelli ou chez Benvenuti.
Il va sans dire que cette hygiène n’est adoptée que par les petites
bourses. Ceux qui ont cinq cent mille livres de rente ont un cuisinier
français dont la filiation de certificats est aussi en règle que la
généalogie d’un cheval arabe. Ceuxlà font deux et quelquefois trois
repas par jour. Pour ceuxlà il n’y a pas de pays : le paradis est
partout.
Le premier plaisir de l’aristocratie napolitaine est le jeu.
Le matin on va au Casino et l’on joue ; l’aprèsmidi on va à la
promenade, et le soir au spectacle. Après le spectacle, on revient au
Casino et l’on joue encore.
L’aristocratie n’a qu’une carrière ouverte : la diplomatie. Or,
comme, si étendues que soient ses relations avec les autres
puissances, le roi de Naples n’occupe pas dans ses ambassades et
dans ses consulats plus d’une soixantaine de personnes, il en résulte
que les cinq sixièmes des jeunes nobles ne savent que faire, et par
conséquent ne font rien.
Quant à la carrière militaire, elle est sans avenir. Quant à la
carrière commerciale, elle est sans considération.
Je ne parle pas des carrières littéraires ou scientifiques, elles
n’existent pas : il y a à Naples, comme partout, plus que partout
même, une certaine quantité de savans qui disputent sur la forme des
pincettes grecques et des pelles à feu romaines, qui s’injurient à
propos de la grande mosaïque de Pompéia ou des statues des deux
Balbus. Mais cela se passe en famille, et personne ne s’occupe de
pareilles puérilités.
La chose importante, c’est l’amour. Florence est le pays du
plaisir :
Rome, celui de l’amour ; Naples, celui de la sensation.
À Naples, le sort d’un amoureux est décidé tout de suite. À la
première vue il est sympathique ou antipathique. S’il est
antipathique, ni soins, ni cadeaux, ni persistance ne le feront aimer.
S’il est sympathique, on l’aime sans grand délai : la vie est courte,
et le temps qu’on perd ne se rattrape pas.
32
L’amant préféré s’installe au logis ; on le reconnaît, malgré la
distance respectueuse où il se tient de la maîtresse de la maison, au
laisseraller avec lequel il s’assied et à la manière facile avec laquelle
il appuie sa tête contre les fresques. En outre, c’est lui qui sonne les
domestiques, qui reconduit les visiteurs et qui ramasse les poissons
rouges que les bambins font tomber du bocal sur le parquet.
Quant à l’amant malheureux, il s’en va tout consolé, certain que
son infortune ne sera pas constante et qu’il trouvera bientôt à
ramasser des poissons rouges ailleurs.
L’aristocratie napolitaine est peu instruite : en général, son
éducation est négligée sous le rapport intellectuel : cela tient à ce
qu’il n’y a pas dans tout Naples un seul bon collége, celui des
jésuites excepté. En compensation, ceux qui savent savent bien : ils
ont appris avec des professeurs attachés à leur personne. J’ai vu des
femmes plus fortes en histoire, en philosophie et en politique que
certains historiens, que certains philosophes et que certains hommes
d’État de France. La famille du marquis de Gargallo, par exemple,
est quelque chose de merveilleux en ce genre. Le fils écrit notre
langue comme Charles Nodier, et les filles la parlent comme madame
de Sévigné.
Les exercices physiques sont, au contraire, fort suivis à Naples :
presque tous les hommes montent bien à cheval et tirent
remarquablement le fusil, l’épée et le pistolet. Leur réputation sur ce
point est même assez étendue et à peu près incontestée. Ce sont des
duellistes fort dangereux.
Cette dernière période de notre alinéa nous amène tout
naturellement à parler du courage chez les Napolitains.
La nation napolitaine, toute proportion gardée et en raison de
l’état politique de l’Italie actuelle, n’est ni une nation militaire
comme la Prusse, ni une nation guerrière comme la France : c’est une
nation passionnée. Le Napolitain, insulté dans son honneur, exalté
par son patriotisme, menacé dans sa religion, se bat avec un courage
admirable. À Naples, un duel est aussi vite et aussi bravement
accepté que partout ailleurs ; et s’il varie sur les préliminaires, qui
appartiennent à des habitudes de localités, le dénouement en est
33
toujours mené à bout aussi vigoureusement qu’à Paris,
J’ai dit dans le Speronare, et à l’article de Palerme, quelle est
l’antipathie profonde qui sépare les deux peuples. On comprend donc
que les Siciliens et les Napolitains ne se trouvèrent pas plutôt en
contact, surtout à cette époque où les haines politiques étaient encore
toutes chaudes, que les querelles commencèrent d’éclater.
Quelques duels sans conséquence eurent lieu d’abord, mais
bientôt on résolut de confier en quelque sorte la cause des deux
peuples à deux champions choisis parmi leurs enfans : on y voulait
voir non seulement une haine accomplie, mais une superstitieuse
révélation de l’avenir.
Le choix tomba sur le marquis de Crescimani, Sicilien, et sur le
prince Mirelli, Napolitain. Ce choix fait et accepté par les
adversaires, on décida qu’ils se battraient au pistolet à vingt pas, et
jusqu’à blessure grave de l’un ou de l’autre champion.
Un mot sur le prince Mirelli, dont nous allons nous occuper
particulièrement.
C’était un jeune homme de vingtquatre ou vingtcinq ans, prince
de Teora, marquis de Mirelli, comte de Conza, et qui descendait en
droite ligne du fameux condottiere Dudone dit Conza, dont parle le
Tasse. Il était riche, il était beau, il était poète ; il avait par
conséquent reçu du ciel toutes les chances d’une vie heureuse ; mais
un mauvais présage avait attristé son entrée dans la vie. Mirelli était
né au village de Sant’Antimo, fief de sa famille. À peine euton su
que sa mère était accouchée d’un fils, que l’ordre fut envoyé à la
chapelle d’un couvent de mettre les cloches en branle pour annoncer
cet heureux événement à toute la population.
Le sacristain était absent ; un moine se chargea de ce soin, mais,
inhabile à cet exercice, il se laissa enlever par la volée de la corde, et
au plus haut de son ascension, perdant la tête, pris par un vertige, il
lâcha son point d’appui, tomba dans le chœur et se brisa les deux
cuisses. Quoique mutilé ainsi, le pauvre religieux ne se traîna pas
moins du chœur à la porte, où il appela au secours : on vint à son
aide, on le transporta dans sa cellule ; mais, quelque soin qu’on prît
de lui, il expira le lendemain.
34
Cet événement avait fait une grande sensation dans la famille, et
cette histoire, souvent racontée au jeune Mirelli, s’était profondément
gravée dans son esprit. Cependant il en parlait rarement.
Voilà l’homme que les Napolitains avaient choisi pour leur
champion.
Quant au marquis Crescimani, c’était un homme digne en tout
point d’être opposé à Mirelli, quoique les qualités qu’il avait reçues
du ciel fussent peutêtre moins brillantes que celles de son jeune
adversaire.
Au jour et à l’heure dits, les deux champions se trouvèrent en
présence : ni l’un ni l’autre n’était animé d’aucune haine personnelle,
et ils avaient vécu jusquelà, au contraire, plutôt en amis qu’en
ennemis.
En arrivant au rendezvous, ils marchèrent l’un à l’autre en
souriant, se serrèrent la main et se mirent à causer de choses
indifférentes, tandis que les témoins réglaient les conditions du
combat.
Le moment arrivé, ils s’éloignèrent de vingt pas, reçurent leurs
armes toutes chargées, se saluèrent en souriant, puis, au signal donné,
tirèrent tous les deux l’un sur l’autre : aucun des deux coups ne porta.
Pendant qu’on rechargeait les armes, Mirelli et Crescimani
échangèrent quelques paroles sur leur maladresse mutuelle, mais sans
quitter leur place. On leur remit les pistolets chargés de nouveau. Ils
firent feu une seconde fois, et, cette fois comme l’autre, ils se
manquèrent tous deux.
Enfin, à la troisième décharge, Mirelli tomba.
Une balle l’avait percé à jour audessus des deux hanches ; on le
crut mort, mais lorsqu’on s’approcha de lui on vit qu’il n’était que
blessé. Il est vrai que la blessure était terrible : la balle lui avait
traversé tout le corps, et avait en passant ouvert le tube intestinal.
On fit approcher une voiture pour transporter le blessé chez lui ;
on voulut le soutenir pour l’aider à y monter ; mais il écarta de la
main ceux qui lui offraient leurs secours, et, se relevant vivement par
un effort incroyable sur luimême, il s’élança dans la voiture en
disant :
35
« Allons donc ! il ne sera pas dit que j’aie eu besoin d’être soutenu
pour monter, fûtce dans mon corbillard ! » À peine futil entré dans
la voiture que la douleur reprit le dessus, et il s’évanouit. Arrivé chez
lui, il voulut descendre comme il était monté ; mais on ne le souffrit
point. Deux amis le prirent à bras et le portèrent sur son lit.
On envoya chercher le meilleur chirurgien de Naples, le docteur
Penza ; c’était un homme qui s’était fait dans la science un nom
européen.
Le docteur sonda la blessure et dit qu’il ne répondait de rien, mais
qu’en tout cas la cure serait longue et horriblement douloureuse.
— Faites ce que vous voudrez, docteur, dit Mirelli. Marius n’a pas
jeté un cri pendant qu’on lui disséquait la jambe, je serai muet
comme Marius.
— Oui, dit le docteur ; mais lorsque le chirurgien en eut fini avec
la jambe droite, Marius ne voulut jamais lui donner la gauche.
N’allez pas me laisser entreprendre une opération et m’arrêter au
milieu.
— Vous irez jusqu’au bout, docteur, soyez tranquille, répondit
Mirelli ; mon corps vous appartient, et vous pouvez l’anatomiser tout
à votre aise.
Sur cette assurance, le docteur commença.
Mirelli tint sa parole ; mais à mesure que la nuit s’approcha, il
parut plus agité, plus inquiet ; il avait une fièvre terrible. Sa mère le
gardait avec deux de ses amis. Vers les onze heures il s’endormit,
mais au premier coup de minuit il se réveilla. Alors, sans paraître
voir ceux qui étaient là, il s’appuya sur son coude et parut écouter.
Il était pâle comme un mort, mais ses yeux étaient ardens de
délire.
Peu à peu ses regards se fixèrent sur une porte qui donnait dans un
grand salon. Sa mère se leva alors et lui demanda s’il avait besoin de
quelque chose.
— Non, rien, répondit Mirelli. C’est lui qui vient.
— Qui, lui ? demanda sa mère avec inquiétude.
— Entendezvous le traînement de sa robe dans le salon ? s’écria
le malade. L’entendezvous ? Tenez, il vient, il s’approche ; voyez, la
36
porte s’ouvre… sans que personne la pousse… Le voilà… le voilà !
… il entre… il se traîne sur ses cuisses brisées… il vient droit à mon
lit. Lève ton froc, moine, lève ton froc, que je voie ton visage.
Que veuxtu ?… parle… voyons !… vienstu pour me chercher ?
… d’où sorstu ?… de la terre… Tenez, voyezvous ?… il lève les
deux mains ; il les frappe l’une contre l’autre ; elles rendent un son
creux, comme si elles n’avaient plus de chair… Eh bien ! Oui, je
t’écoute, parle !…
Et Mirelli, au lieu de chercher à fuir la terrible vision, s’approchait
au bord de son lit comme pour entendre ses paroles ; mais au bout de
quelques secondes d’attention, pendant lesquelles il resta dans la
pose d’un homme qui écoute, il poussa un profond soupir et tomba
sur son lit en murmurant :
— Le moine de Sant’Antimo !
C’est alors qu’on se rappela seulement cet événement arrivé le
jour de sa naissance, c’estàdire vingtcinq ans auparavant, et qui,
conservé toujours vivant dans la pensée du jeune homme, prenait un
corps au milieu de son délire.
Le lendemain, soit que Mirelli eût oublié l’apparition, soit qu’il ne
voulût donner aucun détail, il répondit à toutes les questions qui lui
furent faites qu’il ignorait complètement ce qu’on voulait lui dire.
Pendant trois mois l’apparition infernale se renouvela chaque nuit,
détruisant ainsi en quelques minutes les progrès que le reste du temps
le blessé faisait vers la guérison.
Mirelli ressemblait à un spectre luimême. Enfin, une nuit il
demanda instamment à rester seul, avec tant d’insistance, que sa
mère et ses amis ne purent s’opposer à sa volonté.
À neuf heures, tout le monde ayant quitté sa chambre, il mit son
épée sous le chevet de son lit et attendit.
Sans qu’il le sût, un de ses amis était caché dans une chambre
voisine, voyant par une porte vitrée et prêt à porter secours au malade
s’il en avait besoin.
À dix heures il s’endormit comme d’habitude, mais au premier
coup de minuit il s’éveilla.
Aussitôt on le vit se soulever sur son lit et regarder la porte de son
37
regard fixe et ardent ; un instant après il essuya son front, d’où la
sueur ruisselait ; ses cheveux se dressèrent sur sa tête, un sourire
passa sur ses lèvres : puis saisissant son épée, il la tira hors du
fourreau, bondit hors de son lit, frappa deux fois comme s’il eût
voulu poignarder quelqu’un avec la pointe de sa lame, et, jetant un
cri, il tomba évanoui sur le plancher.
L’ami qui était en sentinelle accourut et porta Mirelli sur son lit ;
celuici serrait si fortement la garde de son épée qu’on ne put la lui
arracher de la main.
Le lendemain, il fit venir le supérieur de Sant’Antimo et lui
demanda, dans le cas où il mourrait des suites de sa blessure, à être
enterré dans le cloître du couvent, réclamant la même faveur, en
supposant qu’il en échappât cette fois, pour l’époque où sa mort
arriverait, quelle que fût cette époque et en quelque lieu qu’il expirât.
Puis il raconta à ses amis qu’il avait résolu la veille de se
débarrasser du fantôme en luttant corps à corps, mais qu’ayant été
vaincu, il lui avait promis enfin de se faire enterrer dans son
couvent : promesse qu’il n’avait pas voulu lui accorder jusquelà,
tant il lui répugnait de paraître céder à une crainte, même religieuse
et surnaturelle.
À partir de ce moment, la vision disparut, et neuf mois après
Mirelli était complètement guéri.
Nous avons raconté en détail cette anecdote, d’abord parce que de
pareilles légendes, surtout parmi les contemporains, sont rares en
Italie, le pays le moins fantastique de la terre ; et ensuite parce
qu’elle nous a paru développer dans un seul homme trois courages
bien différens : le courage patriotique, qui consiste à risquer
froidement sa vie pour la cause de la patrie ; le courage physique, qui
consiste à supporter stoïquement la douleur ; et enfin le courage
moral, qui consiste à réagir contre l’invisible et à lutter contre
l’inconnu.
Bayard eût certainement eu les deux premiers, mais il est douteux
qu’il eût eu le troisième.
Maintenant passons au courage civil.
Nous sommes en 99 : les Français ont évacué la ville des délices.
38
Le cardinal Ruffo, parti de Palerme, descendu de la Calabre et
soutenu par les flottes turque, russe et anglaise, qui bloquent le fort, a
assiégé Naples, et, voyant l’impossibilité de prendre la ville défendue
du côté de la mer par Caracciolo, et du côté de la terre par Manthony,
Caraffa et Schiappani, a signé une capitulation qui assure aux
patriotes la vie et la fortune sauves :
Près de sa signature on lit celle de Foote, commandant la flotte
britannique ; de Keraudy, commandant la flotte russe ; et de Bonnieu,
commandant la flotte ottomane. Mais, dans une nuit de débauche et
d’orgie, Nelson a déchiré le traité. Le lendemain, il déclare que la
capitulation est nulle, que Bonnieu, Keraudy et Foote ont outrepassé
leurs pouvoirs en transigeant avec les rebelles, et il livre à la haine de
la cour, en échange de l’amour de lady Hamilton, les troupeaux de
victimes qu’on lui demande. Alors il y eut spectacle et joie pour bien
des jours, car on avait à peu près vingt mille têtes à faire tomber. Eh
bien ! Toutes ces têtes tombèrent, et pas une seule ne tomba
déshonorée par une larme ou par un soupir.
Citons au hasard quelques exemples.
Cyrillo et Pagano sont condamnés à être pendus. Comme André
Chénier et Roucher, ils se rencontrent au pied de l’échafaud ; là ils se
disputent à qui mourra le premier ; et comme aucun des deux ne veut
céder sa place à l’autre, ils tirent à la courte paille. Pagano gagne,
tend la main à Cyrillo, met la courte paille entre ses dents, et monte
l’échelle infâme, le sourire sur les lèvres et la sérénité sur le front.
Hector Caraffa, l’oncle du compositeur, est condamné à avoir la
tête tranchée ; il arriva sur l’échafaud ; on s’informe s’il n’a pas
quelque désir à exprimer.
— Oui, ditil, je désire regarder le fer de la mandaja.
Et il est guillotiné couché sur le dos, au lieu d’être couché sur le
ventre.
Quoique cet article soit consacré à l’aristocratie, un mot sur le
courage religieux. Ce courage est celui du peuple.
Au moment où Championnet marchait sur Naples, proclamant la
liberté des peuples et créant des républiques sur son passage, les
royalistes répandirent le bruit dans la ville que les Français venaient
39
pour brûler les maisons, piller les églises, enlever les femmes et les
filles et transporter en France la statue de saint Janvier. À ces
accusations, d’autant plus accréditées qu’elles sont plus absurdes, les
lazzaroni, que les mots d’honneur, de patrie et de liberté n’auraient
pu tirer de leur sommeil, se lèvent des portiques des palais dont ils
ont fait leur demeure, encombrent les places publiques, s’arment de
pierres et de bâtons, et à moitié nus, sans chefs, sans tactique
militaire, avec l’instinct de bêtes fauves qui gardent leur antre, leur
femelle et leurs petits, aux cris de : Vive saint Janvier ! vive la sainte
Foi ! mort aux Jacobins ! ils combattent soixante heures les soldats
qui avaient vaincu à Montenotte, passé le pont de Lodi, pris
Mantoue. Au bout de ce temps, Championnet n’était encore parvenu
qu’à la porte de SaintJanvier, et sur tous les autres points n’avait pas
encore gagné un pouce de terrain.
À tout cela on m’objectera sans doute la révolution de 1820, le
passage des Abruzzes, abandonné presque sans combat. Je répondrai
une seule chose : c’est que les chefs qui commandaient cette armée,
et qui avaient en face d’eux les baïonnettes autrichiennes, voyaient se
relever derrière eux les bûchers, les échafauds et les potences de 99.
C’est qu’ils se savaient trahis à Naples, tandis qu’eux venaient
mourir à la frontière ; c’est qu’enfin c’était une guerre sociale que
Pépé et Carrascosa avaient entreprise à leurs risques et périls, et que
le peuple napolitain n’avait pas sanctionnée.
Lorsque nous traversons Naples avec nos idées libérales, puisées,
non pas dans l’étude individuelle des peuples, mais dans de simples
théories émises par des publicistes, et que nous jetons un coup d’œil
léger à la surface de ce peuple que nous voyons couché presque nu
sur le seuil des palais et dans les angles des places où il mange, dort
et se réveille, notre cœur se serre à la vue de cette misère apparente,
et nous crions dans notre philanthropique élan : « Le peuple
napolitain est le peuple le plus malheureux de la terre. »
Nous nous trompons étrangement.
Non, le peuple napolitain n’est pas malheureux, car ses besoins
sont en harmonie avec ses désirs. Que lui fautil pour manger ? une
pizza ou une tranche de cocomero à mettre sous sa dent ; que lui faut
40
il pour dormir ? une pierre à mettre sous sa tête. Sa nudité, que nous
prenons pour une douleur, est au contraire une jouissance dans ce
climat ardent où le soleil l’habille de sa chaleur. Quel dais plus
magnifique pourraitil demander aux palais qui lui prêtent leur seuil
que le ciel de velours qui flamboie sur sa tête ? Chacune des étoiles
qui scintillent à la voûte du firmament n’estelle pas dans sa croyance
une lampe qui brûle au pied de la Madone ?
Avec deux grains par jour, ne se procuretil pas le nécessaire, et
de son superflu ne lui restetil pas encore de quoi payer largement
l’improvisateur du môle et le conducteur du corricolo ?
Ce qui est malheureux à Naples, c’est l’aristocratie, qui, à peu
d’exceptions près, est ruinée, comme nous l’avons dit à propos de la
noblesse de Sicile, par l’abolition des majorats et des fidéicommis ;
c’est la noblesse, qui porte un grand nom et qui n’a plus de quoi le
dorer, qui possède des palais et qui laisse vendre ses meubles.
Ce qui est malheureux à Naples, c’est la classe moyenne, qui n’a
ni commerce ni industrie, qui tient une plume et qui ne peut écrire,
qui a une voix et qui ne peut parler ; c’est cette classe qui calcule
qu’elle aura le temps d’être morte de faim avant qu’elle réunisse à
elle assez de nobles philosophes et de lazzaroni intelligens pour se
faire une majorité constitutionnelle.
Nous reviendrons en temps et lieu sur le mezzo ceto et sur les
lazzaroni. Cet article nous a déjà entraîné trop loin, puisqu’il ne
devait être consacré qu’à la noblesse ; mais de déduction en
déduction on fait le tour du monde. Que notre lecteur se rassure ;
nous nous apercevons à temps de notre erreur, et nous nous arrêtons
à Tolède.
41