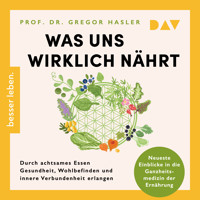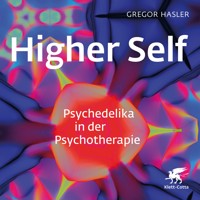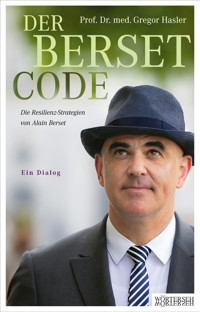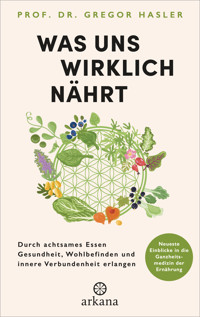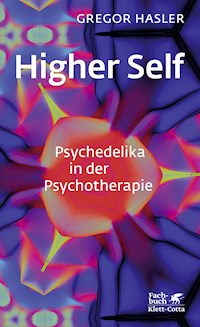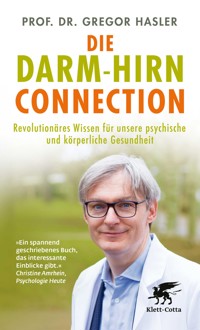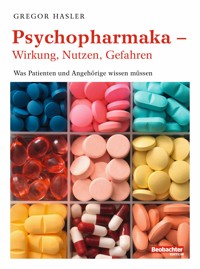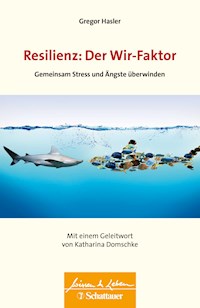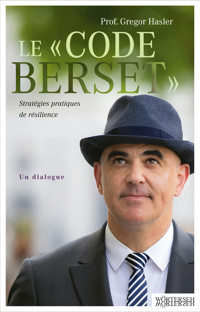
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wörterseh Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Dans un dialogue avec l'ancien conseiller fédéral Alain Berset, le professeur Gregor Hasler nous offre une plongée dans la psychologie et la neurobiologie de notre résilience individuelle. Ce faisant, il montre ce qui a permis à Alain Berset d'aider la Suisse à surmonter la pandémie avec relativement peu de dommages par rapport à d'autres pays. La manière dont il a su composer, d'une part avec l'énorme stress professionnel et d'autre part avec la pression psychique, notamment quand des menaces de mort furent prononcées contre lui et sa famille. La lecture offre des enseignements que nous pouvons activement intégrer dans notre vie quotidienne afin d'apprendre à mieux gérer un stress intense, à prendre les meilleures décisions dans des situations exigeantes et à découvrir nos forces cachées – pour une vie aussi épanouie et résiliente que possible. Le « Code Berset » ne nous offre pas seulement les derniers enseignements de la recherche scientifique sur la résilience, il nous révèle aussi les stratégies d'un management de crise exigeant.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Nous remercions pour le soutien à la traduction.
Les Éditions Wörterseh bénéficient d’un soutien structurel à l’édition de l’Office fédéral de la culture, Confédération Suisse, pour les années 2021 à 2025.
Tous droits réservés, y compris ceux de reproduction d’extraits et de reproduction électronique.
© 2025 Wörterseh, Lachen
Traduction : Marine MorandCorrection : Isabelle SbrissaAdaptation de la timeline : Valentin DecoppetMise en page de la couverture : Thomas JarzinaPhoto de couverture : Keystone/Peter KlaunzerMise en page, composition et réalisation : Beate SimsonImpression et reliure : CPI Books GmbH
ISBN 978-3-03763-163-8 ISBN 978-3-03763-859-0 (epub)
www.woerterseh.ch
« Plus les hommes agissent de façon planifiée, plus le hasard est à même de les frapper efficacement. »
Friedrich Dürrenmatt
Table
Sur le livre
Sur l’auteur
Introduction
1 Décider sous l’effet du stress
Garder une attitude positive à l’égard du changement
Intégrer un savoir interdisciplinaire
L’esprit de décision
Résister à la pression
La capacité à gérer les agressions
Résumé
2 La recherche de réseaux
Sensibilité sociale
Travailler en équipe
Rapports avec les individualistes
Atomisation de la société
Soutien social
S’entraîner à l’indépendance
Résumé
3 Contrôle de soi
Le calme dans la tempête
Gérer les débordements émotionnels
Le modèle de l’oignon
Gestion de la peur
Contrôle de soi et communication
Résumé
4 Neuroplasticité
Ressources mentales
Auto-efficacité
Analyser minutieusement l’impact
Le repos neuronal
Évolution personnelle
Résumé
5 La boussole éthique
Comparaison entre boussole éthique et morale
La moralisation peut affaiblir la résilience
Modèles de boussole éthique
Sentiment de cohérence
Transparence
Disposition à la responsabilité
Équité et valeurs éthiques
Droit et résilience
Culture du divertissement
Résumé
6 L’art de se consumer
L’engagement total comme facteur de succès
Sérénité
Motivation intrinsèque
L’art de l’ennui
Lifestyle
Prévenir activement le burn-out
Résumé
7 Optimisme réaliste
L’optimisme comme attitude pragmatique fondamentale
Recherche de solutions
Perspectives d’avenir
Résumé
Travail d’équipe
Qu’est-ce que le code Berset ? Conclusion
Au-delà du code Berset Postface
Remerciements
Appendice
TIMELINE – Coronavirus DFI 2020–2022
Sur le livre
Dans un dialogue avec l’ancien conseiller fédéral Alain Berset, le professeur Gregor Hasler nous offre une plongée dans la psychologie et la neurobiologie de notre résilience individuelle. Ce faisant, il montre ce qui a permis à Alain Berset d’aider la Suisse à surmonter la pandémie avec relativement peu de dommages par rapport à d’autres pays. La manière dont il a su composer, d’une part avec l’énorme stress professionnel et d’autre part avec la pression psychique, notamment quand des menaces de mort furent prononcées contre lui et sa famille. La lecture offre des enseignements que nous pouvons activement intégrer dans notre vie quotidienne afin d’apprendre à mieux gérer un stress intense, à prendre les meilleures décisions dans des situations exigeantes et à découvrir nos forces cachées – pour une vie aussi épanouie et résiliente que possible.
Le « Code Berset » ne nous offre pas seulement les derniers enseignements de la recherche scientifique sur la résilience, il nous révèle aussi les stratégies d’un management de crise exigeant.
« Quand on donne tout, les chances de succès augmentent. Mais ce qui me semble encore plus important, ce n’est pas le succès visible de l’extérieur, mais le succès personnel. Si j’ai tout donné, alors je n’ai rien à regretter. »
Alain Berset
Sur l’auteur
© Gregor Hasler
Le professeur Gregor Hasler, né en 1968, s’est intéressé à la recherche en neurologie après ses études. Depuis 2019, il est professeur ordinaire en psychiatrie et psychothérapie à l’Université de Fribourg et médecin-chef au Réseau fribourgeois de santé mentale. Ses activités de recherche se concentrent sur l’interaction des facteurs sociaux, psychiques et biologiques dans la gestion du stress. Il vit à Berne.
Introduction
Je travaille depuis de nombreuses années autour de la résilience. Le concept renvoie à cette capacité de résistance individuelle qui permet de surmonter les crises et le stress. À une époque où de plus en plus de gens sont stressés, il s’agit d’un sujet essentiel. En 2018, j’ai publié le livre Resilienz: Der Wir-Faktor[Résilience : le facteur collectif], dans lequel j’examinais entre autres le cas d’une pandémie comme facteur de stress. Le 15 août 2020, j’étais invité par Alain Berset, alors conseiller fédéral, à donner une conférence sur la résilience lors d’une retraite avec son équipe. S’en est suivie une collaboration autour de ce thème qui a perduré jusqu’à la fin du mois d’août 2023. La nature et la teneur de nos échanges sont couverts par le secret professionnel.
Mes activités d’enseignant à l’université ainsi que mes formations m’ont appris combien il est difficile d’expliquer les concepts relatifs à la résilience de manière claire et intéressante. Les défis auxquels a dû faire face Alain Berset en tant que ministre de la Santé pendant la pandémie de covid constituaient une occasion unique de rédiger un ouvrage pratique et accessible sur ce thème. C’est la raison pour laquelle je l’ai invité, après son retrait du Conseil fédéral, à s’entretenir avec moi sur le sujet. L’ouvrage se base sur nos conversations, qui se sont tenues entre janvier et mai 2024.
Le code Berset Ce concept désigne les principes, stratégies ou comportements qui ont aidé Alain Berset à renforcer sa capacité de résistance psychique. Il renvoie aux techniques utilisées pour gérer des tâches complexes et conséquentes ainsi que pour faire face à l’incertitude, la pression sociale et les menaces existentielles.
J’ai beaucoup appris de mes échanges avec Alain Berset, pendant et après la pandémie. Nos conversations se sont toujours déroulées d’égal à égal. Lorsque je l’interrompais, le critiquais ou le contredisais, il m’écoutait avec attention. Je pouvais voir qu’il était touché par mes remarques et observer ses réactions : l’étonnement, l’accord, la contradiction ou l’humour. Nos entretiens suffisaient à révéler sa capacité de résilience.
Chez Alain Berset, le personnage politique officiel transparaissait à peine. Je n’avais pas non plus affaire à un comédien extraverti. Le chef du Département fédéral de l’intérieur faisait plutôt penser à un capitaine sur le pont, prenant son travail très au sérieux, s’aidant de la boussole, de check-lists, d’échosondeurs et de radars météo pour tenir la barre d’une main assurée. Nous n’étions pas dans le glamour, mais dans le contrôle et la recherche de perfection.
Il faut rappeler ici que le Conseil fédéral a connu pendant la pandémie de covid une situation extrêmement difficile. En effet, conformément à notre système politique, il portait la responsabilité du bien commun. Il n’y avait pas eu d’épreuve semblable depuis la Seconde Guerre mondiale. Les tensions se sont entre autres traduites par des menaces de mort envers les responsables politiques.
Mon intention n’est pas, dans ce livre, de soumettre Alain Berset à un défi politique ni de l’allonger sur le divan afin de faire ressurgir des désirs obscurs et inconscients ou des secrets scandaleux. Le livre ne traite pas non plus en profondeur de stratégies de gestion de crise. Enfin, il n’y est pas non plus question de la politique de la santé menée par Alain Berset au Conseil fédéral entre 2012 et 2023 et dont je n’étais, en tant que médecin et psychiatre, pas satisfait. L’ouvrage traite plutôt de quelque chose qui m’a énormément impressionné chez Alain Berset : cette qualité individuelle qui lui a permis de supporter pendant des mois et des années, sans interruption prolongée, une pression et des charges à peine concevables.
J’ai pu accompagner Alain Berset et observer au quotidien comment il gérait sans faiblir le stress, l’incertitude et la complexité dans sa vie privée et professionnelle. En tant que neuroscientifique, je me demandais souvent ce qui se passait dans son cerveau. Afin de rendre compte du volume de travail et de la pression médiatique auxquels il était exposé, j’ai ajouté à la fin du livre (p. 179) une chronologie spéciale concernant la pandémie. Cet aperçu résume les activités principales du Département fédéral de l’intérieur durant le covid.
J’ai choisi sept facteurs de résilience scientifiquement établis et qui donnent une image du savoir intuitif d’Alain Berset sur ce sujet, savoir dont je connaissais l’existence grâce à nos entretiens. Ces facteurs m’ont servi à structurer nos conversations ainsi qu’à organiser et compléter les propos d’Alain Berset avec les connaissances scientifiques actuelles. Un chapitre est consacré à chacun de ces facteurs. Ainsi, les lecteurs et lectrices pourront d’une part acquérir une compréhension approfondie de la résilience, d’autre part découvrir des approches pratiques utiles au quotidien.
Le premier facteur décrit la nécessité de garder le contrôle dans des situations de stress, de ne pas repousser ou éviter la prise de décision et de ne pas s’abandonner à des réactions impulsives, l’attente et l’inaction devant elles-mêmes résulter d’une décision consciente.
Le deuxième facteur met en valeur le rôle essentiel des relations sociales en période de stress intense. La conversation pointe le risque qui existe à se retirer de la vie sociale et à se couper de son entourage, dans la mesure où c’est précisément dans les moments de pression que notre réseau d’aide, mais aussi les personnalités plus individualistes qui nous entourent, s’avèrent indispensables.
Le troisième facteur traite de la maîtrise de soi et de son environnement, notamment grâce à une communication adaptée. Savoir garder une part de contrôle est en effet une qualité essentielle pour la résilience et le succès. Alain Berset souligne que le véritable contrôle dépend de la situation et ne peut être maintenu en permanence. Il est important de se ménager des pauses dédiées à la réflexion et à la régénération afin de garder la tête froide dans les moments décisifs.
Alain Berset a le don de développer des solutions et de hiérarchiser les priorités, même en cas de stress chronique. Je nomme ce quatrième facteur la « neuroplasticité », c’est-à-dire la capacité du cerveau à s’adapter à un état de stress durable et à en tirer des enseignements.
Le cinquième facteur évoque l’importance d’avoir une boussole éthique solide. Afin de surmonter une crise sans en garder des séquelles, il faut en effet être disposé à prendre ses responsabilités et à agir en accord avec ses valeurs cardinales.
Le sixième facteur se rapporte aux sentiments positifs et à l’inspiration, qui sont essentiels pour surmonter les difficultés, en particulier sous pression, lorsque les émotions négatives dominent en raison de la réaction au stress.
Le septième facteur, l’optimisme réaliste, représente pour Alain Berset un outil pragmatique qui l’aide à trouver des solutions même dans les situations difficiles.
J’ai par la suite structuré ces entretiens sur la base de facteurs de résilience scientifiquement établis. Les notions propres à la recherche sur la résilience ainsi que leur contexte scientifique sont expliqués par des encadrés insérés dans le texte, lui-même divisé en sous-chapitres. Chacun porte un titre faisant référence à des éléments précis du code Berset et est résumé en fin de chapitre.
Enfin, pas plus qu’ailleurs, Alain Berset ne s’exprime dans ce livre sur les évènements relatifs à sa personne, parfois qualifiés dans l’espace public de « scandales ». Cette stratégie consistant à ne pas prendre position face à des reproches infondés fait intégralement partie du code Berset ; elle est également expliquée dans l’ouvrage.
Gregor Hasler, été 2024
1 Décider sous l’effet du stress
Les réactions de panique et le fait de rester figé tel un reptile sont des réactions de stress typiques qui conduisent souvent à des décisions défavorables, précipitées voire à de mauvais choix. Les réactions de ce type se sont développées afin de survivre à des dangers imminents comme une attaque de fauve. En revanche, elles ne sont pas adaptées pour résister à des situations de stress prolongé telles qu’une pandémie, une crise économique, des parents imprévisibles ou un environnement de travail anxiogène.
Notre cerveau n’a pas la constitution idéale pour gérer un stress permanent et diffus. Ce genre de stress chronique est souvent la cause principale de décisions erronées, d’une incapacité à faire des choix ou encore de maladies. Sur le long terme, le stress peut altérer la pensée rationnelle et conduire à des dommages physiques comme l’hypertension artérielle ou des maladies cardiaques, ainsi qu’à des dysfonctionnements psychiques.
Garder une attitude positive à l’égard du changement
Gregor Hasler En tant que conseiller fédéral et ministre de la Santé vous avez dû, pendant la pandémie de covid, faire face à une période de grande incertitude. Qu’est-ce qui vous a aidé dans ces moments-là ?
Alain Berset J’ai essayé de garder une vision large, portant sur la situation dans son ensemble. J’ai fréquemment été confronté à des situations où beaucoup de paramètres échappaient à un contrôle direct. La plupart du temps, il est impossible de tout comprendre, il y a toujours une part d’incertitude. Mais le mouvement, c’est-à-dire la dynamique d’une situation, donne la possibilité d’orienter certains paramètres.
GH J’entends dans ces propos beaucoup de dynamique et peu de certitude. Personnellement, je préfère ce qui est fiable, ce qui a été vérifié, l’évidence scientifique. C’est pour ça que je suis devenu médecin et chercheur, et non pas artiste ou auteur de science-fiction. À l’inverse de la science, où la clé du succès réside dans le fait de se focaliser sur quelque chose, il était essentiel pour vous d’avoir dans cette crise une vision large, puisque vous ne pouviez pas vous concentrer uniquement sur quelques facteurs. Mais permettez-moi une remarque critique : sans cette focalisation et cette concrétisation, ne court-on pas le risque de prendre des décisions de manière arbitraire ?
AB La politique m’a appris ceci : il ne faut pas vouloir essayer de tout comprendre et de tout régler – c’est irréaliste. Il faut plutôt tenter de comprendre l’évolution des choses et de dégager les paramètres que l’on peut influencer. C’est ce que nous avons fait à l’époque, de manière intuitive, avec le Conseil fédéral et toute mon équipe.
GH En tant que scientifique, je ne peux pas dire que l’idée me rend très enthousiaste. Votre propos me rappelle toutefois cet enseignement, central chez les stoïciens de l’Antiquité, de la résilience, c’est-à-dire la capacité de faire clairement la différence entre ce que nous pouvons changer et ce que nous ne pouvons pas changer.
AB Oui, exactement. Mais ce principe doit être appliqué à une évolution, il n’est pas statique. Nous observons la situation de départ, en suivons l’évolution et jugeons de l’influence que nous pourrons avoir sur la suite. À chaque mesure, à chaque décision, nous nous sommes toujours demandé : la conséquence est-elle « neutre voire plutôt positive » ou bien est-elle « neutre voire plutôt négative » ? Nous voulions systématiquement nous assurer que les mesures prises étaient plutôt positives voire neutres, c’est-à-dire qu’elles ne provoqueraient pas de dommage. Seules ces mesures-là ont été envisagées. Lorsque l’une d’elles était évaluée comme seulement neutre voire comme négative, il nous a paru plus sage de ne pas la mettre en œuvre.
GH L’appréciation d’une mesure reste néanmoins toujours incertaine. En l’occurrence, l’incertitude ne portait pas seulement sur la dangerosité du virus lui-même, mais aussi sur chacune des mesures prises contre lui.
AB Effectivement, on ne peut pas attendre que tout soit clair – il faut agir. Nous ne pouvions pas rester indéfiniment dans l’observation. Il fallait, juste avant de prendre une décision, lâcher prise et se lancer. C’est pendant mon doctorat que j’ai appris à lâcher prise. J’ai vu comment certaines personnes restaient enlisées pendant des années, simplement parce qu’elles voulaient rendre un travail parfait. Quelqu’un m’a dit un jour qu’une thèse de doctorat ne serait jamais parfaite, qu’elle ne devait pas être parfaite. C’est plutôt une étape pour laquelle il faut prévoir une fin. À chaque décision, ce lâcher-prise est important.
GH En ce qui concerne la thèse, je ne partage pas votre opinion. J’aime lire des contributions scientifiques qui ont été mûrement réfléchies. Mais je vous accorde que les perfectionnistes ont plus de mal à se montrer résilients que ceux qui ne prennent pas tout trop au sérieux. Pourriez-vous citer un autre exemple où la perfection peut poser problème ?
AB L’achèvement de la pandémie est un bon exemple. Une pandémie s’arrête à l’instant où quelqu’un le déclare avec autorité. Mais bien sûr, il faut que cela arrive au bon moment, c’est-à-dire quand elle passe sous le radar de la politique. C’est forcément artificiel, car ce radar peut être influencé politiquement. À l’heure où nous parlons, la pandémie se poursuit. Mais une fois qu’on a décidé qu’elle était passée, alors il faut lâcher prise.
GH Et après ça ? N’y a-t-il pas eu parfois des doutes concernant les décisions arrêtées après avoir lâché prise ?
AB Bien sûr. Tout cela est dû au caractère dynamique de la situation. Le lâcher-prise ne fonctionne que pour un temps. Ensuite, la situation évolue de minute en minute. Je me souviens très bien de cette période en 2021, entre Noël et le jour de l’An, alors que l’incertitude autour du développement du variant Omicron était la plus grande. J’étais dans un chalet à la montagne et je suivais la situation chaque matin et chaque après-midi. Je voulais être sûr qu’il ne fallait pas corriger notre stratégie.
GH Vous avez souligné l’incertitude en politique, également une part d’arbitraire dans les décisions, même dans l’achèvement de la pandémie. Peut-on dire ouvertement qu’une appréciation est incertaine ? Cela ne risque-t-il pas de déclencher la peur ?
AB Beaucoup de responsables, en politique ou dans d’autres domaines, donnent dans des situations très incertaines l’impression de pouvoir tout comprendre et tout maîtriser. Ce n’est pas mon cas. J’ai toujours dit clairement que je n’étais pas sûr, moi non plus, que chaque décision soit la bonne. Cela permet de relativiser le pouvoir d’une décision, en sachant qu’on pourra toujours la corriger plus tard. J’ai toujours dit : il est impossible de tout savoir, et si quelqu’un en sait plus que moi, je suis heureux de pouvoir apprendre de cette personne. Mais il me fallait quand même agir, même sans avoir toutes les réponses. En tant que conseiller fédéral, j’avais la responsabilité de prendre des décisions et de les défendre. Le fait de communiquer de façon transparente sur une décision est bien perçu, car les gens comprennent que l’on prend au sérieux la situation dans toute son incertitude. C’est effectivement le cas, je n’enjolive rien, je ne donne pas l’impression de tout savoir.
GH Est-ce durant la pandémie que vous avez développé cette idée de la transparence ?
AB Non, j’ai toujours travaillé avec les doutes, et non contre eux. Je doute pratiquement de tout. Les doutes stimulent ma créativité. C’est dû au mouvement – à mon attrait pour le mouvement et pour le côté dynamique de la politique. Tout en gardant une cohérence, bien entendu – du moins tout en m’efforçant de garder une cohérence. En tant qu’ancien sportif d’endurance, ces deux éléments – la conviction d’une part que l’incertitude est une réalité, d’autre part que la vie signifie le mouvement – m’ont donné de bonnes bases afin de gérer la pandémie.
Intégrer un savoir interdisciplinaire
Le dilemme psychologique des spécialistes Dans le quotidien, par exemple quand on doit faire face à un chef imprévisible, à un conjoint ou une conjointe lunatique, on s’appuie sur son expérience et son intuition afin d’évaluer les dangers sociaux. Durant la pandémie, on a heureusement pu recourir à la recherche scientifique pour prendre des décisions politiques sur la base de données empiriques. C’est ainsi que subitement, des chercheurs et chercheuses se sont retrouvés à devoir se positionner publiquement en tant qu’experts et à conseiller les responsables politiques. Les défis de cette situation étaient multiples : des données généralement insuffisantes pour obtenir une évaluation scientifiquement fondée ; des risques variés ne relevant pas d’un seul domaine de spécialisation, lui-même souvent très limité ; le besoin de pronostics, d’informations portant sur l’avenir, ce qui dépasse souvent le travail de la recherche ; enfin, des interactions complexes avec des médias préférant privilégier les nouvelles alarmistes à celles plus positives.
Certaines études montrent d’ailleurs que les spécialistes dont les propos suscitent la peur sont perçus comme plus compétents que ceux qualifiant un risque de minime – ce qui peut affecter la confiance en soi de ces derniers. En outre, l’opinion publique et les médias attendaient des décisions ou des recommandations de la part des scientifiques. Mais cela ne relevant pas de leur compétence, ces derniers devaient s’abstenir de s’exprimer publiquement sur ce point – une situation que beaucoup ont mal vécue.
GH Vous avez dit un jour avoir surestimé la science au début de la pandémie. Quel était le sens de ces propos ?
AB Avant tout, je souhaite mettre une chose au clair : durant la pandémie, une très bonne collaboration s’est développée entre la science et la politique. À ma connaissance, jamais les échanges n’avaient été aussi étroits. Les spécialistes ont largement contribué à une gestion efficace de la crise. C’est surtout dans les premiers temps que sont survenues des situations que je trouvais problématiques.
La Suisse abrite de nombreux spécialistes en épidémiologie, en virologie et autres domaines spécialisés, chacun possédant une expertise essentielle. Dès le début de la pandémie, beaucoup se sont montrés sur la réserve, mais certains opportunistes en ont profité pour donner une plus grande visibilité à leurs idées – en toute bonne foi, je suppose. Les premières estimations étaient très divergentes, mais les seuls à se faire entendre étaient souvent ceux qui défendaient les scénarios les plus pessimistes. Tout cela a créé du désordre. Petit à petit, nous avons appris à collaborer de façon plus organisée : une task force scientifique (la Science Task Force) a été mise en place, regroupant des épidémiologues, virologues et experts en éthique, ainsi qu’une task force économique et une task force de la société civile. À partir de là s’est formé un petit groupe vers lequel convergeaient tous les domaines d’expertise.
Cette Science Task Force, qui rassemblait beaucoup d’expertes et d’experts, a fourni un travail exemplaire, d’excellente qualité. Elle présentait en outre un avantage : ses membres participaient au travail de groupe, soutenaient les déclarations communes et orientaient leurs positions sur celles de la task force ; à partir du moment où ils n’en faisaient plus partie, ils ne pouvaient plus s’exprimer en son nom. Il y a bien eu quelques manquements, mais cela a tout de même permis de mettre fin au désordre initial en matière de communication.
GH Vous décrivez là des techniques de management de crise. La recherche sur la résilience montre qu’une bonne préparation joue un rôle clé dans la résistance individuelle. Par ailleurs, vous avez plusieurs fois insisté sur une stricte séparation des rôles entre science et politique. Pourquoi ?
AB Je me suis vite aperçu que les propos très clairs et univoques des scientifiques ne correspondaient pas toujours à l’incertitude de la situation. Ils laissaient selon moi trop peu de place au doute. J’en ai tiré cette conclusion : il était plus facile pour les spécialistes de considérer comme élevés les risques de la pandémie et de préconiser des mesures strictes, dont ils n’avaient pas ensuite à porter la responsabilité. Si rien ne se passait, ils pouvaient prétendre que c’était grâce aux mesures prises. Si des choses graves se produisaient, ils pouvaient dire que les mesures avaient été trop tardives et leur mise en œuvre trop laxiste.
Si un expert scientifique veut être toujours du bon côté, il suffit de réclamer tôt des mesures strictes, car ainsi on ne porte pas la responsabilité de leurs conséquences sociales et politiques. Cette observation m’a renforcé dans l’idée que dans le contexte pandémique, la politique et la science avaient des rôles fondamentalement différents, leur responsabilité respective n’étant pas la même. J’ai toujours insisté là-dessus.
GH Les spécialistes ont-ils accepté cette répartition des rôles ?
AB Jamais ils ne m’ont forcé à faire quoi que ce soit contre mon gré, et d’ailleurs, ils ne l’auraient pas pu. Mais il y a bien eu des conflits de cet ordre-là dans la toute première phase. Je me souviens d’une réunion avec des représentants de gouvernement des cantons romands en mars 2020. Chacun était venu accompagné d’une ou d’un spécialiste. Ces spécialistes étaient d’accord sur le fait que la situation était absolument dramatique et qu’il fallait décréter pour la population une interdiction totale de sortir de chez soi. Par provocation, j’ai alors demandé s’il fallait envoyer l’armée pour vérifier que personne ne sorte de son appartement. À mon grand étonnement, les spécialistes m’ont répondu : « Oui, c’est exactement ce qu’il faut faire. » Je voyais que sous l’effet du stress et de l’incertitude, ces personnes avaient tendance à tenir des propos extrêmes.
Mon scepticisme envers des mesures aussi drastiques tenait aussi à la réalité proprement suisse. Je m’étais rendu compte que nombre de personnes n’avaient aucune idée de la réalité concrète de la population suisse, pensant que n’importe qui pouvait prendre l’air sur son balcon ou dans son jardin. Je devais parfois leur rappeler que la majorité des gens dans notre pays ne dispose pas d’un jardin, et que beaucoup vivent dans de petits appartements sans balcon. Celui qui décide des mesures à prendre doit avoir connaissance des réalités sociales. Les mesures ne sont appliquées que si elles sont praticables et compréhensibles. Si elles sont trop strictes, elles risquent de passer à côté de leur objectif.
GH En plus d’une expertise trop restreinte et de facteurs personnels encourageant les scientifiques à préférer les mesures strictes à d’autres plus légères, quelles difficultés ont encore pu entraver l’intégration des observations scientifiques dans vos prises de décision ?
AB Je tiens tout d’abord à souligner qu’il m’a fallu un certain temps avant de cerner les domaines où l’assistance des spécialistes était la plus utile. En effet, les éléments scientifiques n’aidaient pas toujours à préparer ni à prendre rapidement des décisions politiques. Pour vous donner un exemple : le nombre de reproduction de base, c’est-à-dire le ratio 0, indique combien de personnes ont été contaminées par un individu dans un laps de temps donné. Ce ratio aide à comprendre une dynamique dans le passé, mais pas à pronostiquer son évolution. On ne peut le mesurer précisément qu’avec un écart de deux à trois semaines. Pour mon équipe et moi, qui devions prendre des décisions au jour le jour et les ajuster, ces analyses portant sur le passé n’apportaient pas d’aide.
GH Comment avez-vous fait face à l’incertitude concernant l’avenir ?
AB Nous avons développé notre propre méthode : j’ai dû, parmi toutes les informations sur la pandémie, trier et choisir celles qui me serviraient à prendre des décisions. Les principaux paramètres concernaient le nombre total de cas, le nombre de nouveaux cas, le nombre de tests réalisés et leurs résultats. Les chiffres variant largement selon le jour de la semaine, nous ne pouvions pas comparer le lundi avec le mardi. Il était plus pertinent de comparer entre eux les lundis, les mardis etc. – c’était dû notamment aux méthodes utilisées pour déclarer un nouveau cas ainsi qu’à la disponibilité des tests. Je commandais et recevais chaque jour les chiffres dans un tableau Excel. Ma méthode n’était pas très scientifique, mais très pragmatique et assez efficace. Elle était bien moins précise que le ratio 0 mais nous permettait d’identifier une tendance beaucoup plus rapidement que si nous nous étions appuyés uniquement sur ce critère-là. Avec cette méthode, j’ai par exemple pu constater que la catastrophe annoncée entre Noël 2020 et le jour de l’An 2021 n’avait pas lieu.
Science vs intuition Il est important d’analyser scientifiquement les méthodes considérées comme utiles par les dirigeantes et dirigeants. Il existe pour ça différentes approches. Le psychologue allemand Gerd Gigerenzer, chercheur renommé, spécialiste du jugement, a découvert dans ses études que les stratégies complexes de prise de décision se basant sur la science échouaient souvent du fait d’un regard trop rétrospectif. Il a constaté que bien souvent, il suffisait pour établir des pronostics de règles simples, basées sur quelques repères décisifs et permettant ainsi de dégager les informations essentielles. L’approche d’Alain Berset et de son équipe me rappelle plutôt Warren Buffett, un des investisseurs les plus riches du monde. Au lieu de se baser sur des analyses financières complexes, Buffett a développé ses propres outils prédictifs. L’un d’eux porte sur les marchandises acheminées en train, ce qui constitue selon lui un indicateur économique simple et objectif.
GH En tant que scientifique, je m’inquiète de voir les décideurs développer des méthodes individuelles, non soumises à la vérification. Comprenez-vous mon inquiétude ?
AB Oui, bien sûr. Les problèmes tiennent également au fait qu’en science, la critique se fait presque exclusivement dans le cadre de peer-reviews, c’est-à-dire d’un examen par les pairs. Il n’y a pas de tradition pour une critique venant de l’extérieur, ce qui pose problème en premier lieu à la science. Je ne suis pas du tout sceptique envers la science, je pense d’ailleurs que la politique devrait s’appuyer plus largement sur ses connaissances. L’implication de la recherche scientifique et des spécialistes durant la pandémie a été décisive. La science a apporté une contribution incroyablement importante et moi-même j’ai beaucoup appris d’elle. Après un démarrage difficile, la collaboration a très bien fonctionné, elle s’est déroulée dans un climat de grande confiance mutuelle. J’ai appris beaucoup de choses sur la science et je crois qu’inversement, les scientifiques ont beaucoup appris sur la politique. Il y a eu un véritable rapprochement.
L’important est de se mettre d’accord sur les différents rôles et sur le fait que la science formule ses recommandations sous forme de scénarios. Les décisions concernant les mesures sont quant à elles rattachées à une responsabilité et relèvent clairement du domaine politique. Les scientifiques peuvent certes proposer des mesures, en revanche, prévoir comment celles-ci seront reçues par la population, évaluer leur mise en œuvre et les risques qu’elles impliquent relèvent rarement de leur domaine de compétence. Les mesures ont des conséquences non seulement sanitaires et économiques, mais aussi sociales – on le voit par exemple dans l’accès des enfants à l’éducation. Les conséquences des mesures prises peuvent être énormes.
Aujourd’hui, on voit bien que la gestion de la pandémie dépassait largement l’endiguement du virus. Nous devions tenir compte de tout, notamment des conséquences sociales que pouvaient avoir les mesures. Il s’agissait de trouver l’équilibre entre les risques tout en sachant deviner s’il était ou non possible d’obtenir une majorité. C’est seulement une fois cet équilibre trouvé que la mise en place concrète avait lieu. Prendre des mesures trop fortes peut s’avérer contre-productif.
GH La liberté académique a pour moi une valeur inestimable. Elle protège la science des simplifications et des abus, elle est aussi à la base de valeurs scientifiques telles que la précision, la clarté et la vérification empirique. Mais de cette liberté découlent également des devoirs, entre autres l’ouverture au dialogue. Je suis comme vous d’avis qu’une collaboration étroite entre la politique et la science doit nécessairement passer par des échanges personnels réguliers et un respect mutuel.
AB Oui et d’ailleurs, nous avons eu beaucoup de réunions avec la Science Task Force durant la pandémie, au moins cinquante, parfois en ligne, mais aussi régulièrement en présentiel. Des membres de l’OFSP, l’Office fédéral de la santé publique, ainsi que les représentants des cantons étaient également présents à ces réunions. En outre, mon équipe était en contact étroit et quasi quotidien avec cette task force. Celle-ci rassemblait des épidémiologues mais aussi des experts en éthique, des sociologues et des économistes. J’ai toujours souligné les rôles différents de la science et de la politique et j’ai pris parfois la liberté de ne pas suivre les conseils des experts.
GH Pouvez-vous citer un exemple ?
AB Je me souviens bien de décembre 2021, un mois après l’apparition du variant Omicron : les spécialistes prévoyaient l’apparition d’une nouvelle catastrophe, ils pensaient qu’il fallait donc à nouveau tout fermer. Des nouvelles extrêmement alarmantes nous parvenaient d’Afrique du Sud selon lesquelles même les enfants étaient hospitalisés. En Europe, la première réaction a été de tout fermer encore une fois. Nous n’avons pas suivi ces recommandations. En revanche, les avions en provenance d’Afrique du Sud ont été bloqués, ce qui n’a vraisemblablement pas apporté grand-chose – difficile de juger.