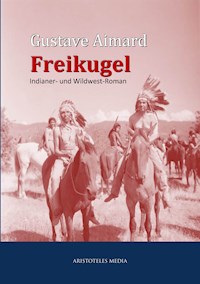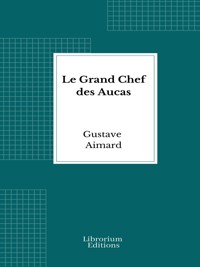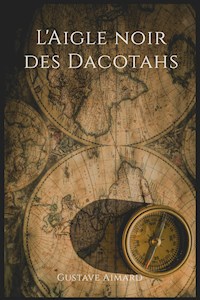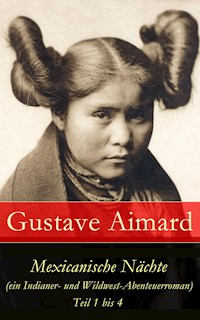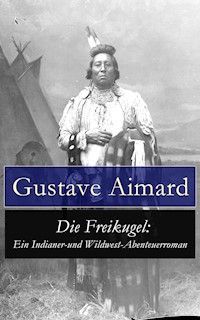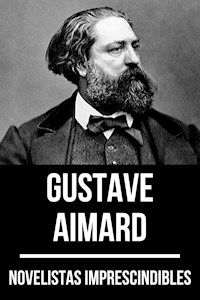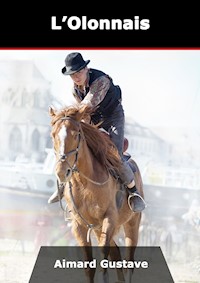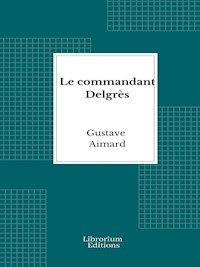
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Les hautes montagnes qui occupent le centre de l’île de la Guadeloupe et vers lesquelles, depuis le bord de la mer, le terrain s’élève peu à peu par marches immenses et magnifiques comme un escalier de géant, ont toutes été, à une époque reculée, des volcans redoutables.
En effet, leurs laves sont encore amoncelées par blocs noirâtres et monstrueux, depuis leurs cimes chenues jusqu’aux sables du rivage.
Et ce qui prouve clairement la vérité de cette assertion, c’est que, ainsi que nous l’avons rapporté plus haut, le sommet le plus élevé de ces montagnes, la reine de toutes les autres, la Soufrière enfin, bouillonne encore aujourd’hui avec un bruit formidable et lance incessamment d’épaisses vapeurs par les soupiraux de ses ténébreux abîmes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Gustave Aimard
Le commandant Delgrès
Le Chasseur de rats
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782383838043
I
L’Œil Gris et le sergent Kerbrock voyagent de compagnie dans des chemins très peu frayés.
Les hautes montagnes qui occupent le centre de l’île de la Guadeloupe et vers lesquelles, depuis le bord de la mer, le terrain s’élève peu à peu par marches immenses et magnifiques comme un escalier de géant, ont toutes été, à une époque reculée, des volcans redoutables.
En effet, leurs laves sont encore amoncelées par blocs noirâtres et monstrueux, depuis leurs cimes chenues jusqu’aux sables du rivage.
Et ce qui prouve clairement la vérité de cette assertion, c’est que, ainsi que nous l’avons rapporté plus haut, le sommet le plus élevé de ces montagnes, la reine de toutes les autres, la Soufrière enfin, bouillonne encore aujourd’hui avec un bruit formidable et lance incessamment d’épaisses vapeurs par les soupiraux de ses ténébreux abîmes.
Ces hautes montagnes de la Guadeloupe sont toutes couvertes de forêts ; forêts séculaires, primitives, où n’a jamais retenti le bruit de la cognée des bûcherons ; que seuls connaissent les nègres marrons qui s’y réfugient, et quelques rares chasseurs de grives et d’agoutis.
Ces forêts vierges servent de barrières et à la fois de ceinture aux mornes ; elles sont presque impénétrables ; des arbres gigantesques de tous les âges, couchés les uns sur les autres dans un pêle-mêle effroyable, pourrissent au milieu des arums qui les enveloppent et des lianes qui le couronnent.
D’autres arbres se dressent majestueusement du milieu de ces fourrés, avec des épanouissements de branches dévorant un immense espace autour d’eux, sans que l’ombre épaisse qu’ils projettent au loin empêche la végétation échevelée et furieuse de se presser autour de leurs trônes.
Lorsqu’on foule ces débris entassés, craquant et s’effondrant à chaque pas, on sent, en pressant ce terrain, des vapeurs étouffantes que le sol envoie au visage ; toutes les plantes surgissant de cet engrais éternel ont un aspect pléthorique et vénéneuxqui atterre.
On est fasciné à l’aspectde cettenature cyclopéenneexagérant toutes lesproportions et changeant en arbres jusqu’aux bruyères.
Parfois, le soleil descend au milieu des ténèbres crépusculaires de ces océans de verdure, par quelque déchirure que la chute d’un fromager ou d’un palmier séculaire a faite à la voûte feuillue ; alors les plantes que ces rayons ont visitées se parent de fleurs ravissantes, perdues dans ces gouffres où nul regard ne les cherche, où nulle main ne les cueille jamais.
Rien n’est mélancolique et silencieux comme ces grands bois, où nul oiseau ne vole et ne chante, où l’on ne voit que par hasard un agouti craintif, se glissant dans des fourrés inextricables ; dont le seul bruit appréciable est le bourdonnement monotone et continu des insectes qu’entretient et qu’échauffe le détritus des forêts.
L’homme perdu dans ces solitudes peut être considéré comme mort ; jamais il ne parviendra à en sortir ; les murailles mouvantes dont il est entouré lui forment un vert linceul qui l’enveloppe de toutes parts et dont il lui est impossible de soulever le poids, pourtant si léger en apparence, mais si lourd en réalité ; tous ses efforts pour sortir des réseaux immenses qui l’enlacent ne font qu’enresserrer davantage les flexibles anneaux ; ses forces s’épuisent dans une lutte insensée, il chancelle, veut résister encore, tombe et ne se relève plus ; c’en est fait ; la mort implacable étend vers lui sa main de squelette, et lui, ce vivant, si plein de jeunesse, de sève, de courage, de volonté, il est vaincu ; il se couche haletant et succombe dans d’horribles souffrances, au milieu de cette luxuriante et puissante végétation qui semble lui sourire railleusement, à quelques pas à peine du but qu’il voulait atteindre, sans se douter que, pendant de longues heures, il a vainement consumé toute son énergie à tourner toujours dans le même cercle, sans avancer d’un pas vers la délivrance.
C’était dans une de ces clairières, qui, ainsi que nous l’avons dit, se trouvent parfois dans les forêts vierges, quatre hommes, assis sur des troncs d’arbres renversés, causaient entre eux à voix basse, tout en mangeant de bon appétit un agouti à demi grillé sur les charbons, et buvant à longs traits du tafia renfermé dans une gourde, qu’ils se passaient de main en main.
Ces quatre hommes étaient des noirs, un cinquième, assis un peu à l’écart, le coude sur le genou et la tête dans la main, dormait ou réfléchissait ; l’immobilité de statue dans laquelle depuis longtemps il demeurait et ses yeux fermés, prêtaient également à ces deux suppositions.
Les noirs n’étaient autres que des nègres marrons ; ils avaient chacun un fusil appuyé contre la cuisse et une hache passée dans la ceinture ; hache dont ils se servaient pour se tracer une route à travers ce fouillis de lianes si étroitement enchevêtrées les unes dans les autres ; près d’eux, sur le sol, se trouvaient des régimes de bananes, des sapotilles, plusieurs noix de coco et une quantité d’autres fruits de toutes sortes, dont ils paraissaient apprécier beaucoup la saveur.
À quelques pas de là, dans un hamac en fils d’aloès de plusieurs couleurs, suspendu entre deux énormes fromagers, une jeunefemme était couchée et dormait.
Cette jeune femme, dont la respiration douce et régulière et le sommeil calme et paisible ressemblait à celui d’un enfant, était Mlle Renée de la Brunerie, enlevée la nuit précédente avec une si audacieuse témérité, dans l’habitation de son père, au milieu de ses amis et de ses défenseurs.
Il était un peu plus de cinq heures du soir, le soleil baissait rapidement à l’horizon ; l’ombre des arbres grandissait en s’allongeant d’une façon démesurée, le ciel commençait à prendre une teinte plus sombre ; à l’approche de la nuit les grondements rauques de la Soufrière, sur les pentes de laquelle courait cette forêt vierge, devenaient plus distincts et plus menaçants.
Soudain, par un mouvement brusque, mais parfaitement calculé, les nègres se couchèrent le fusil en avant, derrière les énormes troncs d’arbres qui, un instant auparavant, leur servaient de sièges.
Leurs oreilles félines avaient perçu un bruit faible, à peine appréciable, mais se rapprochant rapidement de l’endroit où ils étaient campés, et sur la cause duquel il fut bientôt impossible de se tromper.
Seul, l’homme dont nous avons parlé, un mulâtre, n’avait pas fait un geste, ni semblé attacher la plus minime attention à ce qui inquiétait si fort les nègres marrons.
Bientôt on aperçut un noir se glissant avec précaution entre les arbres ; ce noir portait un bandeau sanglant autour de la tête, il en avait un second sur la poitrine, et enfin un troisième enveloppait son bras au-dessus du coude.
Malgré ces trois blessures, ce nègre paraissait frais et dispos ; son visage était souriant ; il marchait avec légèreté au milieu des débris de toutes sortes qui, à chaque pas, entravaient sa marche ; son fusil était rejeté en bandoulière et il tenait à la main une hache avec laquelle, probablement, il avait taillé un chemin pour parvenir jusqu’à l’endroit qu’il venait d’atteindre.
Ce nègre était Pierrot, que nous avons vu si chaudement poursuivi pendant le change audacieux qu’il avait donné ; il avait réussi à s’échapper par miracle, mais non sans emporter avec lui le plomb des chasseurs.
En le reconnaissant, les nègres avaient repris leurs places, et s’étaient tranquillement remis à manger.
– Bonjour, dit le noir en s’approchant.
– Bonjour, répondirent laconiquement les autres.
– Où est massa Télémaque ?
– Là. Est-ce qu’il y a du nouveau ? demanda curieusement un des marrons en étendant le bras dans la direction où se trouvait le mulâtre.
– Cela ne te regarde pas, fit Pierrot.
L’autre haussa les épaules avec dédain et se remit à manger.
Pierrot s’avança alors vers Télémaque ; mais celui-ci sembla alors se réveiller tout à coup, il se leva et lui fit signe de le suivre dans une direction opposée.
– Eh bien ? lui demanda-t-il lorsqu’ils se trouvèrent placés à égale distance des noirs et du hamac ; as-tu des nouvelles ?
– Oui, massa.
– Tu as fait tes courses ?
– Toutes.
– Parle, je t’écoute.
– Par quoi faut-il commencer ?
– Par ce que tu voudras.
– Par l’habitation alors ?
– Par l’habitation, soit.
– Tout est en rumeur là-bas ; ils font des battues de tous les côtés ; le marquis a expédié plusieurs courriers à la Basse-Terre ; puis il s’est résolu à s’y rendre lui-même.
– Il est parti ?
– Et arrivé.
– Bien, continue.
– Le commandeur, M. David, est maintenant le chef de l’habitation ; des postes nombreux ont été établis du côté de la haie ; toute surprise serait désormais impossible.
– À présent, cela m’est égal.
– C’est juste, fit le nègre en jetant un regard du côté du hamac, mais cela nous a coûté cher.
– Possible, mais aussi nous avons réussi.
– On ne peut pas dire le contraire.
– Et le Chasseur de rats ?
– Il a disparu depuis cette nuit.
– Seul ?
– Non, en compagnie d’un sergent français.
– Cela ne vaut rien. Personne ne sait où il est allé ?
– Personne.
– Ce vieux diable doit être sur nos traces ; il connaît nos repaires aussi bien que nous.
– C’est probable ; cet homme est notre mauvais génie ; nous ferons bien de nous tenir sur nos gardes.
– Ah ! ici je ne le crains pas.
– C’est égal, massa, on ne se repent jamais d’avoir été prudent ; cet homme est bien fin.
– Tu as toujours peur, toi !
– Ce n’est pas ce que vous disiez ce matin, massa.
– J’ai tort, excuse-moi, Pierrot ; c’est grâce à toi seul que nous avons réussi ; mais, sois tranquille, mes précautions sont prises, si rusé que soit le Chasseur, cette fois son flair de limier sera mis en défaut.
– Je le désire vivement, massa ; cependant, je vous avoue que je n’ose l’espérer.
– Continue.
– De l’habitation je me suis rendu, selon vos ordres, au fort Saint-Charles.
– Ah ! ah ! As-tu réussi à y pénétrer ?
– Certes, et cette blessure au bras en est une preuve.
– Qu’est-ce que c’est que cela ?
– Une balle qu’un grenadier français m’a envoyée, et qui m’a traversé le bras au moment où, après avoir trompé les sentinelles, je frappais à la poterne de l’Est ; pas autre chose.
– Enfin, tu es entré, c’est le principal.
– Je suis entré, oui, massa.
– As-tu vu le capitaine Ignace ?
– Oui ; il m’a interrogé ; je lui ai raconté tout ce que mous avons fait.
– Que t’a-t-il répondu ?
– Il a froncé le sourcil et il a grommelé je ne sais quoi entre ses dents ; j’ai cru entendre : « C’est trop cher ; cette péronnelle ne vaut pas le quart du sang généreux qu’elle a fait verser. »
– Est-ce tout ? fit Télémaque avec un mouvement d’épaules.
– Non, massa. Massa Ignace s’est enfermé seul avec moi dans une chambre, il m’a fait boire un verre de bon tafia et il m’a donné quatre gourdes, des belles gourdes toutes neuves.
– Passe ces détails.
– Puis il m’a dit, continua imperturbablement Pierrot : « Je suis content de toi, tu es un brave. »
– C’est convenu ! mais au fait ! au fait ? dit Télémaque en frappant du pied avec impatience.
– J’y arrive, massa. Alors massa capitaine Ignace a ajouté : « Tu vas retourner tout de suite auprès de Télémaque, tu lui diras que je suis très satisfait de lui, qu’il faut qu’il se hâte ; que ce soir à dix heures je ferai une sortie sur les lignes du côté du Galion ; afin de faciliter son entrée dans le fort ; Télémaque se tiendra prêt ; il passera à travers les lignes et filera rapidement sur nos derrières pendant que nous protégerons son entrée dans Saint-Charles. »
– Hum ! ce ne sera pas facile, cela.
– C’est ce que j’ai fait observer à massa Ignace.
– Ah ! et il ne t’a pas rompu les os ?
– Non, mais il a ajouté : « Tu diras à Télémaque que je le veux. »
– Il le veut ! il le veut ! tout cela est bel et bien, mais la besogne est rude.
– Beaucoup ; les Français enveloppent complètement le fort ; ils ne laissent pénétrer personne dans leurs retranchements.
– Cependant tu les as traversés deux fois, toi ?
– Oui, mais j’étais seul et malgré cela j’ai attrapé une balle.
– Enfin, nous essayerons : à l’impossible, nul n’est tenu.
– Un homme n’est pas de fer.
– De quel côté se fera la sortie ?
– Par la courtine de l’ouest, du côté du Galion.
– C’est, en effet, l’endroit le plus propice.
– Oui.
– Et tu m’as dit à dix heures ?
– À dix heures, oui, massa.
– À la grâce de Dieu ! nous tenterons l’affaire ; ce qui m’inquiète surtout, c’est ce vieux démon de Chasseur.
– L’Œil Gris ?
– Oui ; s’il a suivi notre piste, comme j’ai tout lieu de le supposer, puisqu’il a quitté cette nuit l’habitation, il pourra nous causer bien de l’embarras.
– Ah ! cela est malheureusement possible.
– Bah ! ne nous décourageons pas ainsi à l’avance. Tu dois être fatigué et avoir faim, repose-toi et mange ; chaque heure amène avec soi ses ennuis ; profitons des quelques moments de tranquillité qui nous restent encore ; après, eh bien ! nous verrons !
– Tout cela n’est pas rassurant, grommela à part lui Pierrot en se dirigeant vers ses compagnons. C’est égal, je regrette beaucoup de m’être jeté si sottement dans cette bagarre, et surtout d’avoir quitté l’atelier où j’étais si heureux, ajouta-t-il en poussant un énorme soupir.
Et le pauvre diable alla s’asseoir tout pensif.
Télémaque était assez contrarié de l’ordre que lui faisait donner le capitaine Ignace ; il comprenait fort bien toutes les difficultés presque insurmontables de cette expédition ; il en calculait toutes les chances dont bien peu, évidemment, étaient en sa faveur ; seul, cette affaire, tout en lui présentant d’énormes difficultés, ne lui paraissait cependant pas impossible ; mais, en compagnie d’une femme à laquelle il lui était enjoint péremptoirement de témoigner les plus grands égards et le plus profond respect, les conditions changeaient complètement ; l’affaire se présentait sous un jour tout différent et qui était loin de diminuer les difficultés, si nombreuses déjà, de cette audacieuse entreprise.
Le mulâtre en était là de ses réflexions qui n’avaient rien de positivement gai, lorsque Mlle de la Brunerie ouvrit les yeux, se redressa sur son hamac, et, après avoir jeté un regard triste, presque désespéré, autour d’elle, lui adressa doucement la parole.
– Monsieur, lui demanda-t-elle, prétendez-vous donc me faire errer ainsi longtemps, en votre compagnie, à travers ces inextricables forêts ?
– Mademoiselle, lui répondit-il respectueusement, ce soir même nous arriverons.
– Dans quel endroit, s’il vous plaît ?
– Dans celui où j’ai reçul’ordre de vous conduire.
– Toujours les mêmes réponses, toujours le même système de mystères et de réticences. Prenez-y garde, monsieur, tout cela finira peut-être plus tôt que vous ne le supposez, et vous payerez cher le crime que vous avez commis en m’enlevant violemment et d’une façon si odieuse à ma famille.
– Mademoiselle, j’ai déjà eu l’honneur de vous le dire, je ne suis qu’un instrument entre les mains bien plus puissantes des hommes que je sers ; une machine qui ne raisonne, ni ne discute ; je reçois des ordres, j’obéis ; mon rôle se borne là ; il serait souverainement injuste à vous, mademoiselle, de vous en prendre à moi de ce qui vous arrive, lorsque, au contraire, la responsabilité en doit remonter tout entière à ceux qui m’emploient.
– Est-ce aussi à ces personnes, dont vous vous obstinez à taire le nom, dit-elle avec ressentiment que je dois attribuer les procédés humiliants et surtout arbitraires dont vous usez envers moi ?
– Je ne crois pas, sur l’honneur, mademoiselle, m’être un seul instant écarté du respect que je vous dois.
– En effet, monsieur, je le constate ; vous êtes très respectueux en paroles, mais malheureusement vos actes forment un complet contraste avec ces paroles mielleuses ; je vous le répète une fois encore, je ne suis pas aussi abandonnée que vous feignez de le supposer ; j’ai des amis nombreux, dévoués, ils me cherchent, ils approchent ; peut-être même en ce moment sont-ils beaucoup plus près de nous que vous ne le croyez.
Au même instant, comme pour affirmer la réalité des paroles ou plutôt des menaces de la jeune fille, un bruit assez fort se fit entendre dans les halliers ; mais ce bruit, qui frappa distinctement l’oreille exercée des nègres marrons, ne parvint pas à celle de Mlle de la Brunerie.
Le mulâtre essaya de sonder les masses de verdure qui l’entouraient, mais l’obscurité déjà assez épaisse sous le couvert de la forêt ne lui permit de rien distinguer.
– Mademoiselle, reprit-il avec vivacité, l’heure est venue de nous remettre en route.
– Encore ? dit-elle avec découragement.
– Un peu de courage, mademoiselle ; cette fois est la dernière, mais la marche que nous avons à faire est longue, hérissée de dangers ; il nous faut partir à l’instant.
– Et si je refusais de vous suivre ? reprit-elle avec hauteur.
– Je serais, à mon grand regret, forcé de vous y contraindre, mademoiselle, répondit Télémaque d’une voix à l’accent de laquelle il n’y avait pas à se méprendre.
– Oui, voilà les procédés généreux dont vous faites un si bel étalage, et le respect dont vous prétendez ne jamais vous écarter envers moi, monsieur.
Télémaque et les nègres étaient de plus en plus inquiets ; ils sentaient qu’un danger s’approchait ; ils jetaient autour d’eux des regards anxieux ; le bruit que déjà ils avaient entendu se renouvelait plus intense et semblait être beaucoup plus rapproché de leur campement.
Le mulâtre fronça le sourcil.
– Mademoiselle, dit-il froidement mais nettement, voulez-vous, oui ou non, consentir à nous suivre ?
– Non, dit-elle avec force.
– Vous y êtes bien résolue ?
– Oui !
– Alors, excusez-moi, mademoiselle, et n’imputez qu’à vous-même ce qui arrive. Je suis obligé d’exécuter les ordres que j’ai reçus. Faites, vous autres !
En moins d’une minute, la jeune fille fut enveloppée dans son hamac, solidement garrottée, sans cependant qu’on lui fit le moindre malet deux nègres s’emparèrent d’elle après que Télémaque lui eût enveloppé la tête d’un voile de gaze qui, sans gêner la respiration, l’empêchait cependant de voir.
– Il était temps, murmura le mulâtre en passant la main sur son front inondé d’une sueur froide. Allons, en route, vivement ! Ne voyez-vous donc pas que nous sommes suivis ? ajouta-t-il avec colère.
Les nègres ne se firent pas répéter deux fois cet avertissement ; ils disparurent sous les taillis.
Presque aussitôt les branches s’écartèrent, et deux hommes, précédés d’une meute de chiens ratiers, firent irruption dans la clairière.
Ces deux hommes étaient le Chasseur et le sergent Ivon Kerbrock, dit l’Aimable.
Les chiens allaient et venaient le nez à terre, sentant et furetant dans toutes les directions.
– Ils ont campé ici, dit le Chasseur ; à peine sont-ils partis depuis cinq minutes.
– Nonobstant, comment pouvez-vous savoir cela, vieux Chasseur ? répondit le sergent.
L’Œil Gris haussa les épaules.
– Regardez le feu, dit-il.
– Je le vois, vieux Chasseur, même qu’il me semble ardent ; mais, peu n’importe.
– Eh bien ? vous ne comprenez pas ?
– Parbleure ! je comprends que c’est un feu, et queprobablement, il ne s’est pas allumé tout seul ; peu n’importe d’ailleurs par qui il a été allumé.
– Au contraire, cela importe beaucoup ; les hommes qui l’ont allumé se sentaient suivis de si près qu’ils sont partis sans prendre la peine de l’éteindre.
– Au fait, que je considère que vous avez subrepticement raison ; les moricauds ont filé en nous entendant venir.
– Grâce à vous, qui faites en marchant un bruit d’enfer ; sans cela nous les surprenions.
– Ah dame ! camarade, que j’entrevois du vrai dans ce que vous dites ; les routes sont si mal entretenues dans ces parages déserts et sauvages, qu’il est très difficile, foncièrement parlant, pour un homme civilisé, de les parcourir sans se casser les reins.
Le Chasseur se mit à rire.
– Êtes-vous fatigué ? lui demanda-t-il.
– Moi, un ancien de la Moselle, fatigué ? Jamais ! vieux Chasseur !
– Alors reprenons la chasse ; voyez, les chiens sont inquiets.
– Pauvres petites bêtes, elles ont, sans vous commander, beaucoup plus d’intelligence que bien des gens que je connais ; que peu n’importe de qui je parle.
– En effet, cela ne fait rien. Partons-nous, sergent ?
– Un modeste instant, simplement pour allumer Juliette.
– Qu’est-ce que c’est que cela, Juliette ?
– C’est ma pipe, vieux Chasseur.
– Êtes-vous fou ? Allumer votre pipe ? Il ne manque plus que cela pour nous faire découvrir.
– De vrai ?
– Pardieu ! vous devez le comprendre.
– Sacrebleure ! En voilà, par exemple, un chien de métier, qu’on ne peut pas tant seulement griller une bouffarde à sa convenance ; peu n’importe, il me payera ce désagrément fastidieux plus cher qu’à la cantine, le premier qui me tombera dessous la patte.
Et le sergent serra sa pipe d’un air tragique.
– Tombons dessus en double et pinçons-les le plus tôt possible ! ajouta-t-il ; je fumerai ensuite ; peu n’importe ce qui surviendra.
– Allons ; mes bellots ! allons, en chasse ! dit le Chasseur à ses chiens.
Ceux-ci partirent aussitôt sous bois ; les deux hommes les suivirent.
– Surtout, je vous en supplie, sergent, pas un mot, même à voix basse.
– Sans vous commander, vieux Chasseur, je serai muet comme un phoque ; as pas peur ! je connais la consigne aussi bien que quiconque ; voilà qui est dit.
La nuit était complètement tombée, les ténèbres si épaisses dans ces inextricables fourrés de verdure, qu’à moins de quatre pas de distance, il était impossible de distinguer le moindre objet.
Mais à part le danger de se casser le cou à chaque minute ou de tomber brusquement à la renverse en buttant contre une racine, ou de se jeter sur un arbre placé par hasard en travers du passage, il était impossible de s’égarer ; les nègres ne pouvaient dissimuler leurs traces, car ils étaient eux-mêmes contraints de tracer leur chemin au milieu de cet impénétrable fouillis, la hache à la main ; ceux qui venaient ensuite n’avaient plus qu’à suivre cette voie.
Cependant plus les deux hommes avançaient, plus la forêt s’éclaircissait ; les buissons et leshalliers se faisait moins serrés, les arbres s’écartaient à droite et à gauche : selon toutes les probabilités, ils n’allaient pas tarder à déboucher dans la savane à la grande satisfaction du sergent Kerbrock dont la marche n’était qu’une suite de culbutes, plus ou moins risquées ; ce qui, malgré les observations réitérées du Chasseur, lui faisait pousser des exclamations retentissantes qui s’entendaient au moins à cent pas à la ronde.
Tout à coup ils se trouvèrent sur une déclivité assez rapide : la forêt ne présentait plus alors qu’un bois assez facile à traverser ; au bout d’un instant, ils émergèrent sur une savane immense couverte de bruyères assez hautes au milieu de laquelle, à une portée de fusil à peu près devant eux, ils virent bondir, comme une bande de daims effarouchés, les ombres noires des marrons que depuis si longtemps, ils suivaient à la piste.
Ils avaient descendu ainsi, sans s’en douter, jusqu’à deux cents mètres au plus du rivage de la mer, et ils se trouvaient à une assez courte distance des retranchements du Galion.
Le Chasseur comprit aussitôt la tactique des noirs ; avant un quart d’heure, abrités par les fortifications du fort Saint-Charles, où maintenant il était évident pour lui qu’ils se rendaient, ils lui échappaient sans retour.
Il redoubla d’efforts et courut avec une rapidité extrême, suivi pas à pas par le sergent qui se piquait d’honneur et préférait de beaucoup cette course plate à travers la savane, à celle si désagréablement accidentée que, pendant de longues heures, il avait faite dans la forêt.
Les nègres, embarrassés par la jeune fille qu’ils étaient contraints de porter sur leurs épaules, perdaient peu à peu du terrain, malgré l’agilité avec laquelle ils dévoraient l’espace ; ils sentaient l’ennemi sur leurs pas.
– Y sommes-nous ? Demanda tout à coup l’Œil Gris sans ralentir sa course.
– Parbleure ! répondit le sergent, toujours courant.
– Alors, en joue, et visons bien : Feu !
Les deux coups éclatèrent à la fois.
Sans s’être communiqué leurs intentions, les deux hommes avaient visé les noirs porteurs du hamac.
Les pauvres diables roulèrent foudroyés sur le sol.
Deux autres remplacèrent aussitôt les morts ; et lafuite recommença, plus rapide et plus échevelée que jamais.
Cependant, ces deux coups de feu avaient donné l’éveil tout le long de la ligne ; maintenant c’était à travers une fusillade soutenue que les fugitifs étaient obligés de passer.
Bientôt, des cinq hommes, deux seulement restèrent debout.
Ils continuèrent à pousser hardiment en avant.
À ce moment, une violente canonnade éclata sur les parapets du fort, et de nombreuses troupes de révoltés sortis par deux poternes secrètes se ruèrent, la baïonnette en avant, sur les glacis.
Il y eut alors une mêlée sanglante et acharnée entre les assiégeants et les assiégés ; mêlée d’autant plus terrible qu’elle avait lieu dans les ténèbres et à l’arme blanche.
Le Chasseur et le sergent n’avaient point abandonné la poursuite des noirs de Télémaque.
Tout en courant, ils avaient rechargé leurs armes, et malgré les péripéties du combat dont les glacis étaient en ce moment le théâtre, ils n’avaient pas perdu de vue une seconde ceux que depuis si longtemps ils chassaient ; deux nouveaux coups de feu éclatèrent ; l’un des deux derniers nègres tomba comme une masse, le second chancela, mais, par un effort suprême de volonté, se raidissant contre la douleur et réunissant toutes ses forces, il enleva le hamac, le jeta résolument sur son épaule et recommença à fuir.
Soudain, sans qu’il pût se rendre compte de lafaçon dont cela était arrivé, il reconnut avec effroi que ses deux ennemis étaient près de lui, qu’ils se tenaient à ses côtés.
Il y eu, de part et d’autre, une seconde d’hésitation, puis comme d’un commun accord, les deux hommes fondirent, la baïonnette en avant, sur le nègre.
Il leur fit bravement tête.
Les deux baïonnettes s’étaient enfoncées à la fois dans son dos et dans sa poitrine.
Cependant par un effort surhumain, il posa son lourd fardeau à terre, et saisissant, malgré sa double blessure, son fusil par le canon, il le brandit au-dessus de sa tête en criant d’une voix vibrante :
– À moi, Ignace ! à Télémaque !
– Ah ! chien marron ! s’écria le Chasseur en redoublant ses coups.
– À moi, Ignace ! à moi ! cria de nouveau le mulâtre en portant au sergent Kerbrock un coup d’assommoir terrible que celui-ci évita à moitié, mais qui cependant le fit rouler sur le sol.
En ce moment, une foule de révoltés se rua de ce côté, ayant le capitaine Ignace à leur tête.
– Ah ! tu ne m’échapperas pas, cette fois ! je te tuerai, chien ! s’écria le Chasseur exaspéré par la chute de son compagnon.
Et d’un dernier coup de baïonnette, il cloua le mulâtre sur le sol.
Mais le fruit de sa victoire lui échappa.
Seul, et n’ayant en main que son fusil déchargé, au moment où il se baissait pour s’emparer du hamac, il fut brusquement repoussé par le capitaine Ignace qui enleva le précieux fardeau sur ses puissantes épaules.
Le Chasseur fut, malgré lui, contraint de reculer devant la masse des révoltés qui se précipitaient sur lui.
Mais il ne voulut pas abandonner son pauvre compagnon à la barbarie des noirs ; il le chargea sur ses épaules, et alors seulement il consentit à rétrograder, mais pas à pas, comme un lion vaincu, et sans cesser de faire face à ses ennemis.
Il est vrai que ceux-ci ayant atteint le but qu’ils se proposaient, c’est-à-dire s’emparer de la jeune fille, ne poussèrent pas la sortie plus loin ; au contraire, ils regagnèrent en toute hâte le fort, sous la protection de leurs canons, tirant à pleine cible.
II
Ce que l’Œil Gris appelle trancher une question
Le premier soin du Chasseur, après s’être ouvert passage à travers les rangs des révoltés et avoir, à grand-peine, regagné les lignes de l’armée française, avait été de porter le sergent Ivon Kerbrock à l’ambulance.
Le sergent avait bientôt repris connaissance ; les parbleure et les sacrebleure s’échappaient de ses lèvres avec une volubilité et un retentissement de bon augure pour sa prochaine guérison.
Cependant la crosse du fusil de Télémaque, en retombant sur sa tête, la lui avait horriblement fendue.
Mais une tête cassée, ce n’est rien pour un Breton, et le sergent Ivon Kerbrock soutenait avec cet entêtement et cet aplomb particuliers aux fils de la vieille Armorique, que le mulâtre n’était qu’un maladroit, que son coup de massue n’était qu’une égratignure et que les pen-bas des gars de Landivisiau, pays qui lui avait donné le jour, faisaient de bien autres blessures, lorsqu’ils se chamaillaient après boire et se rossaient de bonne amitié ; que cela n’était rien du tout, et que dès qu’il aurait bu un verre d’eau-de-vie, il serait parfaitement en état de suivre son compagnon, dont il ne voulait pas se séparer et à qui il devait la vie.
Le Chasseur eut une peine énorme à l’empêcher de mettre cette folle résolution à exécution ; il ne fallut rien moins que la toute-puissante intervention du chirurgien-major de l’armée, pour que l’entêté Breton consentît à se laisser panser, et que le Chasseur réussit à se débarrasser de lui ; mais ce ne fut que lorsqu’il eut solennellement promis qu’il reviendrait près de lui le lendemain matin, dès le point du jour, pour lui faire quitter l’ambulance et l’emmener.
Enfin, après avoir amicalement pressé la main du sergent qui lui dit avec émotion :
– Sacrebleure ! vieux Chasseur, que peu n’importe, que vous êtes un vrai homme !
L’Œil Gris s’était éloigné en toute hâte.
Il voulait se rendre à la Basse-Terre, où il avait appris par hasard d’un officier, que M. de la Brunerie, après avoir confié la défense de sa plantation à M. David, son commandeur, s’était retiré aussitôt après l’enlèvement de sa fille, afin de se concerter avec le général Richepance sur les moyens à employer pour retrouver les traces de son enfant et la reprendre à ses ravisseurs.
C’était le planteur que le chasseur voulait voir.
Celui-ci était bien connu de tous les soldats de l’armée française dont il lui fallait traverser les lignes ; il leur avait servi de guide pendant leur trajet de la Pointe-à-Pitre aux Trois-Rivières, aussi lui fournit-on avec empressement tous les renseignements qu’il demanda sur l’arrivée de La Brunerie ; personne ne s’opposa à son passage, et il arriva à la Basse-Terre sans avoir été inquiété.
Il était environ neuf heures et demie du soir, lorsque le Chasseur pénétra dans la ville.
La poursuite obstinée à laquelle il s’était livré contre les ravisseurs de Renée de la Brunerie, en contraignant ceux-ci à chercher le plus promptement possible un refuge dans la forteresse, avait donné l’éveil au camp, et obligé le capitaine Ignace, qui s’était tout de suite douté de ce qui se passait au dehors, à brusquer la sortie ; sans cet incident imprévu, elle n’aurait pas eu lieu avant dix heures, ainsi que, dans la forêt, Pierrot en avait prévenu Télémaque.
Où étaient maintenant Pierrot et Télémaque, ces séides si fidèlement dévoués au capitaine Ignace ? Étendus morts sur les glacis du fort Saint-Charles ; tués par l’implacable Chasseur, comme l’avaient été avant eux leurs autres compagnons.
Mais cela importait peu au capitaine, puisque son expédition avait réussi et qu’il tenait enfin la jeune fille en son pouvoir.
Le général Richepance, d’après l’invitation faite par M. de la Brunerie lui-même, lorsqu’ils avaient été présentés l’un à l’autre à la Pointe-à-Pitre, s’était installé sur la place Nolivos, dans la magnifique maison appartenant au planteur.
Peut-être, sans oser se l’avouer à lui-même, le général Richepance espérait-il que M. de la Brunerie, pendant le temps que dureraient les troubles se retirerait à la Basse-Terre en compagnie de sa fille, et qu’il aurait alors l’occasion de voir, plus sauvent qu’il ne l’avait pu jusque-là, celle qu’il aimait si ardemment et de lui faire sa cour.
Le général avait même écrit auplanteur, en lui envoyant un détachement de soldats, une lettre dans laquelle il l’engageait fortement, par prudence, à ne pas persévérer dans son intention de défendre en personne la Brunerie, contre les attaques probables des insurgés.
Mais M. de la Brunerie, après avoir pris connaissance de la lettre du général qui lui avait été remise par le lieutenant Dubourg, y avait répondu immédiatement par une lettre dans laquelle il disait en substance que, tout en remerciant chaleureusement le général du bon conseil qu’il lui donnait et du secours qu’il lui envoyait, malheureusement il ne pouvait le suivre ; plusieurs planteurs de ses voisins étant venus chercher un refuge à la Brunerie, il devait, par convenance, demeurer au milieu d’eux ; non seulement pour leur rendre le courage qu’ils avaient perdu, mais encore, ce qui était beaucoup plus grave, pour s’acquitter envers ses amis et voisins malheureux de ces devoirs d’hospitalité considérés dans toutes les colonies, comme tellement sacrés que nul, sous peine d’infamie, n’oserait se hasarder à s’y soustraire.
Le général Richepance ne voulut point insister ; mieux que personne il comprenait la valeur de telles raisons, mais son espoir si tristement déçu, le rendit d’autant plus malheureux que sa position exigeait qu’il cachât son chagrin au fond de son cœur, et qu’il montrât un visage froid et impassible aux regards curieux et surtout scrutateurs des envieux et des ennemis dont il était entouré.
Aussi fut-ce avec une surprise extrême que, le jour dont nous parlons, vers onze heures du matin, le général vit arriver à l’improviste M. de la Brunerie, seul, à la Basse-Terre.
Le général, fort inquiet de ne pas voir Mlle de la Brunerie, s’informa aussitôt de la jeune fille auprès du planteur.
Alors M. de la Brunerie, avec des larmes de désespoir, lui rapporta dans leurs plus grands détails les événements affreux dont, le jour précédent et la nuit suivante, son habitation avait été le théâtre et l’enlèvement audacieux de sa fille.
En apprenant ainsi, d’une façon si subite, cette nouvelle terrible à laquelle il était si loin de s’attendre, le général fut atterré ; sa douleur fut d’autant plus grande qu’il était contraint d’avouer son impuissance à tirer une vengeance immédiate de ce rapt odieux, et à venir en aide à ce père accourant vers lui, plein d’espoir, pour lui demander secours et protection contre les lâches ravisseurs de sa fille.
Mais ces ravisseurs, quels étaient-ils ? Dans quel but avaient-ils enlevé Renée de la Brunerie ? Où l’avaient-ils conduite ?
À ces questions terribles, ni le père, ni le général ne savaient que répondre ; ils ne pouvaient que confondre leurs larmes et attendre.
Attendre en pareille circonstance est un supplice cent fois plus affreux que la mort !
Ce supplice, ils le subissaient, et ils courbaient la tête avec désespoir, sans qu’il leur fût possible de prendre une détermination quelconque, puisqu’ils ne possédaient aucun renseignement pour guider leurs recherches.
Une seule lueur apparaissait pour eux dans ces ténèbres épaisses ; lueur bien faible à la vérité, mais suffisante cependant pour leur rendre un peu d’espoir.
Car l’homme est ainsi fait, et Dieu l’a voulu pour que sa créature supportât, sinon avec courage, du moins avec résignation, la vie, ce pesant fardeau, qui, sans cela, accablerait ses faibles épaules, que dans ses plus cuisantes douleurs, l’espoir restât comme un phare au fond de son cœur, pour lui donner la force nécessaire de suivre cette route ardue, accomplir ce travail de Sisyphe qu’on nomme la bataille de la vie ; combat terrible et sans merci où le vae victis est appliqué avec une si implacable dureté.
Cet espoir qui soutenait en ce moment le général et le planteur, reposait entièrement sur le dévouement sans bornes et tant de fois éprouvé de l’Œil Gris ; cet homme mystérieux qui s’était, pour ainsi dire, constitué de sa propre autorité le gardien de la jeune fille.
Immédiatement après l’enlèvement, le Chasseur s’était mis à la poursuite des ravisseurs ; il avait juré qu’il les retrouverait, et jamais il n’avait failli à sa parole.
Tout, pour les deux hommes, se résumait donc, ainsi que nous l’avons dit plus haut, dans ce seul mot, d’une si désolante logique ; attendre !
Le général, rentré tard dans la soirée d’une visite assez longue faite aux travaux de siège, par lui poussé avec cette ardeur qu’il mettait à toutes choses, achevait à peine de dîner ; il avait congédié les officiers de son état-major et ses aides de camp et venait, en compagnie de M. de la Brunerie, de quitter la salle àmanger et de passer au salon, lorsqu’un domestique lui annonça qu’un homme assez pauvrement vêtu, mais se disant batteur d’estrade de l’armée républicaine, insistait pour être introduit auprès du général Richepance, auquel, disait-il, avait d’importantes communications à faire.
Richepance, occupé à s’entretenir avec M. de la Brunerie sur les mesures qu’il avait jugé nécessaire de prendre pour la découverte des ravisseurs de la jeune fille, et fort contrarié d’être ainsi dérangé, en ce moment surtout, car il était près de dix heures, demanda d’un air de mauvaise humeur certains renseignements sur cet individu.
– Mon général, répondit le domestique, c’est un grand vieillard, tout vêtu de cuir fauve ; il porte un long fusil, et a sur ses talons toute une meute de petits chiens.
– C’est notre ami ! s’écria le planteur avec émotion.
– Faites entrer cette personne, ordonna aussitôt le général.
– Ici, mon général ? s’écria le domestique au comble de la surprise, en jetant un regard de regret sur les meubles et les tapis.
– Oui, ici, répondit en souriant le général, avec ses chiens et son fusil ; allez.
Le domestique sortit, stupéfait d’un pareil ordre.
Un instant plus tard, la porte se rouvrit et le Chasseur parut.
Il salua et demeura immobile au milieu du salon, appuyé sur son fusil ; ses chiens à ses pieds, selon leur habitude.
– Eh bien ? demandèrent à la fois les deux hommes.
– J’ai retrouvé Mlle Renée de la Brunerie, ainsi que je m’y étais engagé, messieurs, répondit le Chasseur d’une voix sombre et presque basse, avec une émotion contenue.
– Enfin ! s’écria avec un mouvement de joie le général dont le visage s’épanouit.
– Où est-elle ? ajouta le planteur en joignant les mains avec prière. Parlez, Chasseur, parlez, au nom du ciel !
– Ne vous réjouissez pas à l’avance, messieurs ; votre douleur en deviendrait bientôt plus amère.
– Que voulez-vous dire ? s’écrièrent à la fois les deux hommes.
– Ce que je dis, messieurs : j’ai retrouvé Mlle de la Brunerie, cela est vrai ; je sais où elle est. Mais, hélas ! malgré mes efforts désespérés, et Dieu m’est témoin que j’ai tenté l’impossible pour la délivrer, je n’ai pu y réussir ; la fatalité était sur moi.
– Mon Dieu ! s’écria douloureusement le planteur.
– Expliquez-vous, au nom du ciel, mon vieux camarade ? En quel lieu se trouve actuellement cette malheureuse jeune fille ? ajouta le général.
– Elle est entrée, il y a une demi-heure, dans le fort Saint-Charles, messieurs.
– Au fort Saint-Charles ?
– Au pouvoir de Delgrès !
– Alors elle est perdue !
– Oh ! le monstre ! Mais comment ce malheur est-il arrivé, mon ami ?
– Depuis hier minuit, en compagnie d’un sergent français nommé Ivon Kerbrock, j’ai suivi pas à pas les ravisseurs sans prendre une heure de sommeil, un instant de repos ; marchant à travers les sentes inextricables d’une forêt vierge, au milieu de laquelle ces misérables s’étaient réfugiés, au coucher du soleil, j’ai failli surprendre leur campement ; j’arrivai cinq minutes à peine après leur départ ; je continuai sans me décourager cette chasse à l’homme ; la forêt traversée, ils entrèrent dans la savane. Le sergent Kerbrock et moi, nous les voyions détaler devant nous avec la rapidité de daims effarés, emportant sur leurs épaules la jeune fille garrottée dans un hamac.
– Ma pauvre enfant ! s’écria le planteur en cachant dans ses mains son visage inondé de larmes.
– Continuez, continuez, mon brave ? dit le général d’une voix nerveuse.
– Ils étaient six hommes résolus répondit le Chasseur, nous n’étions que deux, et pourtant la chasse continua, implacable, acharnée ; les ravisseurs couraient vers le Galion ; de deux coups de fusil, deux rebelles tombèrent, tués raides ; les autres redoublèrent de vitesse ; leurs efforts étaient prodigieux, désespérés ; ils se sentaient perdus et pourtant ils ne s’arrêtaient pas ; cependant nous gagnions du terrain, l’alarme avait été donnée par les coups de feu ; toute la ligne des retranchements était illuminés par une fusillade incessante, trois autres nègres furent tués ; un seul restait debout, il se chargea résolument du fardeau que ses compagnons avaient été contraints d’abandonner ; celui-là était un mulâtre nommé Télémaque, le plus déterminé de tous ; le chef, probablement, de cette sinistre expédition ; il avait, sans doute, des intelligences dans la place ; il était attendu, car il courut droit au fort en appelant à l’aide ; ses cris furent entendus des rebelles, ils se ruèrent à son secours ; il y eut alors une mêlée terrible sur les glacis même du fort ; le sergent et moi nous poussions toujours en avant sans rien voir, sans rien entendre ; Télémaque fut éventré de deux coups de baïonnette par le sergent et par moi ; mais je vous le répète, l’appel de cet homme avait été entendu ; en tombant sous nos coups, le mulâtre avait, par un effort suprême, renversé le sergent, le crâne fendu ; j’eus un instant l’espoir de sauver la jeune fille ; hélas ! cet espoir n’eut que la durée d’un éclair ; un gros de rebelles fondit sur moi comme une bande de loups furieux ; la jeune fille, enlevée dans les bras du capitaine Ignace, fut emportée dans le fort sans que je réussisse à m’y opposer. Je voulais vivre pour me venger ; je chargeai le pauvre sergent sur mes épaules, et, la rage dans le cœur, je me résignai à reculer devant ces misérables, mais sans cesser de combattre ; je pris à peine le temps de déposer mon brave camarade à l’ambulance, et je suis accouru ici. Voilà tout ce qui s’est passé, mon général. Voilà ce que j’ai fait, monsieur de la Brunerie ; un homme ne pouvait, je crois, faire davantage.
– Non ! oh ! non ! s’écria le général avec élan.
– Je vous remercie du fond du cœur, dit tristement le planteur. Hélas ! si vous, si brave, si dévoué, vous n’avez pas réussi à sauver ma pauvre enfant, c’est qu’elle ne devait pas l’être ! Mon Dieu ! mon Dieu !
Il y eut un assez long silence, pendant lequel on n’entendait que les sanglots étouffés de M. de la Brunerie.
Le Chasseur se tenait toujours, froid et impassible en apparence, debout et immobile au milieu de la pièce.
Le général réfléchissait.
– Que faire ? murmura-t-il avec découragement au bout d’un instant ; tout nous échappe.
– Il nous reste un espoir, dit le Chasseur.
– Un espoir ? s’écria vivement le général.
– Oui, mon général ; je veux tenter un moyen suprême ; je réponds presque du succès.
– Parlez vite, mon ami, de quoi s’agit-il ? Puis-je vous êtes bon à quelque chose ?
– Certes, mon général, car l’exécution du projet que j’ai formé dépend de vous seul.
– Oh ! alors, s’il en est ainsi, soyez tranquille, mon brave, vous pouvez compter sur moi ; et, maintenant, dites-moi franchement ce que vous comptez faire.
– Une chose bien simple, mongénéral ; je veux, demain, me présenter en parlementaire aux rebelles, et cela de votre part.
– Vous feriez cela ?
– Je le ferai, je l’ai résolu.
– Folie !... murmura le planteur qui avait relevé la tête et écoutait anxieusement.
– Peut-être ! répondit le Chasseur. Me permettez-vous de faire cette dernière tentative, mongénéral ?
– Vous avez ma parole, monbrave ; seulement il est de mon devoir de vous faire observer que les rebelles ont déclaré que tout parlementaire serait considéré comme espion et immédiatement fusillé par eux.
– J’ai fait toutes ces réflexions, mon général.
– Et malgré ce danger terrible, imminent, suspendu sur votre tête, vous persistez ?
– Je persiste, oui, mon général ; il serait oiseux d’insister davantage sur ce sujet ; de plus, je vous le répète, je réponds presque du succès de cette tentative.
Le général Richepance se leva sans répondre ; il fit quelques tours de long en large dans le salon, marchant avec agitation et en proie à une émotion d’autant plus violente qu’il essayait de la renfermer en lui.
Au bout de quelques instants il s’arrêta enfin devant le Chasseur, dont le regard interrogateur suivait ses mouvements avec inquiétude.
– Mon ami, lui dit-il d’une voix profonde, vous n’êtes pas un homme ordinaire ; il y a en vous quelque chose de grand et de simple à la fois que je ne puis définir ; je ne vous connais que depuis bien peu de temps, mais cela m’a suffi cependant pour vous apprécier à votre juste valeur ; renoncez, je vous prie, à cette folle entreprise, qui ne peut avoir pour vous qu’un dénouement terrible ; si grand que soit l’intérêt que je porte à Mlle de la Brunerie, et Dieu, qui lit dans mon cœur, sait quel ardent désir j’ai de la sauver ! eh bien ! je ne puis prendre sur moi la responsabilité d’un pareil acte ; vous laisser ainsi vous livrer à vos implacables ennemis et vous vouer à une mort inévitable et horrible.
Le Chasseur hocha tristement la tête.
– Mon général, répondit-il avec une émotion contenus, je vous rends grâce pour le grand intérêt que vous daignez témoigner à un pauvre diable tel que moi ; mais à quoi suis-je bon sur cette terre, où je pèse depuis si longtemps sans profit pour personne ? À rien. Une occasion se présente de me dévouer pour une enfant à laquelle j’ai dû la vie dans une circonstance terrible ; laissez-moi, je vous en supplie du fond de mon cœur, payer à elle, et à son père la dette de la reconnaissance ; peut-être ne retrouverai-je jamais une aussi belle occasion que celle-ci pour m’acquitter.
– Mais, malheureux entêté que vous êtes ! s’écria le général, qui, sous une feinte colère, essayait de cacher l’émotion réelle qui le gagnait, c’est à la mort que vous marchez !
– Eh ! qu’importe, mon général ? qu’importe que je vive ou que je sois massacré par ces bêtes féroces, si en mourant j’ai la joie immense de sauver cette belle et chaste jeune fille et de la rendre à son père, que le désespoir de sa perte accable d’une douleur que seul son retour pourra consoler ?
– Je vous en supplie, mon ami, n’insistez pas davantage pour obtenir ce consentement que je ne veux et que je ne dois pas vous donner.
– J’insiste et j’insisterai, au contraire, de toutes mes forces, mon général, car il faut que vous m’accordiez ce que je vous demande.
– Jamais ! s’écria le général Richepance d’une voix ferme.
Il y eut un nouveau silence.
Le général avait repris sa promenade saccadée à travers le salon ; M. de la Brunerie pleurait ; le Chasseur semblait préoccupé.