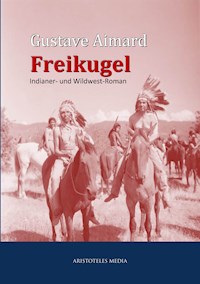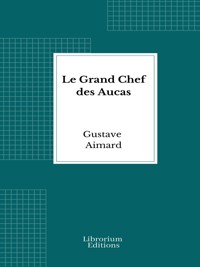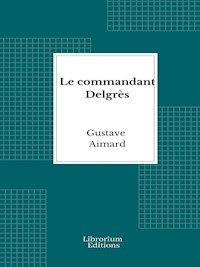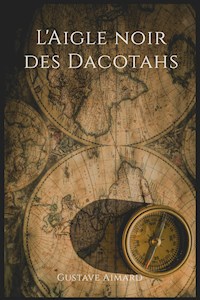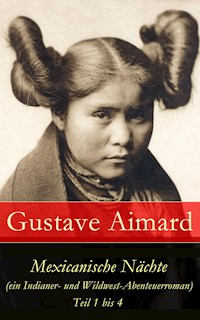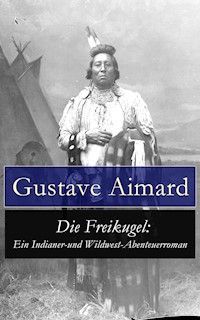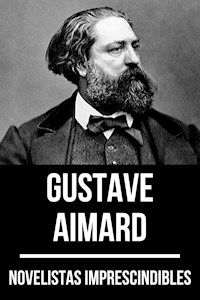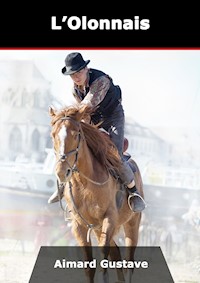1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Dès les premiers jours de la découverte de l’Amérique, ses plages lointaines sont devenues le refuge et le rendez-vous des aventuriers de toutes sortes dont l’audacieux génie, étouffé par les entraves de la vieille civilisation européenne, cherchait à prendre son essor.
Les uns demandaient au Nouveau-Monde la liberté de conscience, le droit de prier Dieu à leur guise ; d’autres, brisant leurs épées pour en faire des poignards, assassinaient des nations entières pour voler leur or et s’enrichir de leurs dépouilles ; d’autres, enfin, natures indomptables, cœurs de lions dans des corps de fer, ne reconnaissant aucun frein, n’acceptant aucunes lois et confondant le mot liberté avec le mot licence, formèrent presque à leur insu cette formidable association des Frères de la Côte, qui fit un instant trembler l’Espagne pour ses possessions et avec laquelle Louis XIV, le roi-soleil, ne dédaigna pas de traiter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
La Grande flibuste
Gustave Aimard
1862
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782383838104
LAGRANDE FLIBUSTE
ILa Feria de Plata.
Dès les premiers jours de la découverte de l’Amérique, ses plages lointaines sont devenues le refuge et le rendez-vous des aventuriers de toutes sortes dont l’audacieux génie, étouffé par les entraves de la vieille civilisation européenne, cherchait à prendre son essor.
Les uns demandaient au Nouveau-Monde la liberté de conscience, le droit de prier Dieu à leur guise ; d’autres, brisant leurs épées pour en faire des poignards, assassinaient des nations entières pour voler leur or et s’enrichir de leurs dépouilles ; d’autres, enfin, natures indomptables, cœurs de lions dans des corps de fer, ne reconnaissant aucun frein, n’acceptant aucunes lois et confondant le mot liberté avec le mot licence, formèrent presque à leur insu cette formidable association des Frères de laCôte, qui fit un instant trembler l’Espagne pour ses possessions et avec laquelle Louis XIV, le roi-soleil, ne dédaigna pas de traiter.
Les descendants de ces hommes extraordinaires existent toujours en Amérique, et lorsque quelque soudain cataclysme révolutionnaire jette, après une lutte de quelques instants sur ses plages les natures étranges que le flot populaire a brusquement fait monter à la surface, elles vont instinctivement se ranger autour des petits-fils des grands aventuriers, dans l’espoir dé tenter, eux aussi, des choses extraordinaires à leur suite.
À l’époque où je me trouvais en Amérique, le hasard me rendit témoin de l’une des plus audacieuses, entreprises qui aient été conçues et exécutées par ces hardis aventuriers. Ce coup de main jeta un tel éclat que, pendant quelques mois, il occupa la presse et éveilla la curiosité et les sympathies du monde entier.
Des raisons, que nous laissons au lecteur le soin d’apprécier, nous ont engagé à changer les noms des personnages qui ont joué les principaux rôles dans ce drame étrange, tout en narrant les faits avec la plus grande exactitude historique.
Il y a une dizaine d’années environ, la découverte des riches placeres de la Californie éveilla subitement les instincts aventureux de milliers d’hommes jeunes et intelligents, qui, abandonnant patrie et famille, s’élancèrent pleins d’enthousiasme vers le nouvel Eldorado, où la plupart ne devaient rencontrer que la misère et la mort, après des souffrances et des déboires sans nombre.
La route est longue d’Europe en Californie. Beaucoup d’individus s’arrêtèrent à mi-chemin, les uns à Valparaiso, les autres au Callao, quelques-uns à Mazatlan ou à San-Blas, la plupart atteignirent San-Francisco.
Il n’entre pas dans le cadre que nous nous sommes tracé de revenir sur les détails, trop connus maintenant, des déceptions de toutes sortes dont furent assaillis les malheureux émigrants dès le premier pas qu’ils firent sur cette terre, où ils s’étaient figuré n’avoir qu’à se baisser pour ramasser l’or ; ainsi que l’on dit vulgairement, à pleines mains.
C’est à Guaymas, six mois après la découverte des placeres, que nous prions le lecteur de nous suivre.
Déjà, dans un précédent ouvrage, nous avons parlé de la Sonora[1] ; mais comme l’histoire que nous nous proposons de narrer se passe tout entière dans cette province éloignée du Mexique, nous compléterons la description que nous n’avons alors que légèrement esquissée.
Le Mexique est sans contredit le plus beau pays du monde, tous les climats s’y trouvent réunis. Sa superficie actuelle est immense ; elle n’a pas moins de 575,080 kilomètres. Malheureusement sa population, loin d’être en rapport avec son territoire, ne s’élève à peine qu’à 7,200,000 habitants, parmi lesquels s’en trouvent près de 6,000,000 appartenant aux races indiennes ou mélangées.
La confédération mexicaine comprend le district fédéral de Mexico, vingt et un États et trois territoires ou provinces n’ayant pas d’administration intérieure indépendante.
Nous ne dirons rien du gouvernement, par la raison toute simple que jusqu’à présent l’état normal de cette magnifique et malheureuse contrée a toujours été l’anarchie.
Cependant le Mexique semble être une république fédérative, au moins de nom, bien que le seul et véritable pouvoir reconnu soit le sabre.
Le premier des sept États situés sur l’océan Atlantique est l’État de Sonora. Cet État s’étend du nord au sud, entre le Rio-Gila et le Rio-Mayo ; il est séparé à l’est de l’État de Chihua-hua par la Sierra-Verde, et à l’ouest il est baigné par la mer Vermeille ou mer de Cortez, ainsi que la plupart des cartes espagnoles s’obstinent encore aujourd’hui à la nommer.
L’État de Sonora est un des plus riches du Mexique, à cause des nombreuses mines d’or dont son sol est émaillé ; malheureusement ou heureusement, suivant le point de vue auquel on voudra se placer, la Sonora est sans cesse sillonnée par d’innombrables tribus indiennes, contre lesquelles ses habitants doivent incessamment lutter ; aussi les guerres continuelles avec ces hordes sauvages, le frottement qui en est la conséquence, le mépris de la vie et l’habitude de verser le sang humain sous le premier prétexte venu, ont-ils imprimé aux Sonoriens et donné à leurs mœurs une allure fière et décidée, un cachet de noblesse et de grandeur qui les sépare entièrement des autres États et les fait partout reconnaître au premier coup d’œil.
Malgré la grande étendue de son territoire et son long cordon de côtes, le Mexique ne possède, en réalité, que deux ports véritables sur l’océan Pacifique,
Ces deux ports sont Guaymas et Acapulco.
Les autres ne sont, en fait, que des rades foraines dans lesquelles les navires redoutent de chercher un abri, surtout lorsque le terrible cordonazo souffle impétueusement du sud-ouest et bouleverse le golfe de Californie.
Nous ne parlerons ici que de Guaymas.
Cette ville, fondée depuis quelques années seulement à l’embouchure du fleuve San-José, semble appelée à devenir bientôt un des principaux ports du Pacifique.
La position militaire de Guaymas est admirable.
Comme toutes les villes de l’Amérique espagnole, ses maisons sont basses, peintes en blanc et à toits plats, seul, le fort placé à la cime d’un roc, et dans lequel se rouillent quelques canons sur des affûts rongés par le soleil, est d’une teinte jaunâtre qui se marie avec la nuance d’ocre de la grève, où viennent mourir parmi les pousses vigoureusement serrées des mangliers, dont elles vivifient les rameaux échevelés, les lames rosées de la mer Vermeille ; derrière la ville s’élèvent comme d’imposants créneaux les croupes escarpées de hautes montagnes aux flancs sillonnés de ravines creusées par le passage des eaux des époques diluviennes, et dont les crêtes brunes se perdent dans les nuages.
Malheureusement, nous sommes contraint d’avouer que ce port, malgré son titre ambitieux de ville, n’est encore qu’une misérable bourgade sans église et sans auberge, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de cabarets ; au contraire, et cela se conçoit dans un port situé aussi près de San-Francisco, ils y pullulent.
L’aspect de Guaymas est triste ; on sent que, malgré les efforts des Européens et des aventuriers pour galvaniser cette population, la longue tyrannie espagnole qui, pendant trois siècles, a pesé sur elle, l’a sinon complètement atrophiée, mais du moins plongée dans une dégradation et une infériorité morales telles qu’il lui faudra bien des années encore pour s’en relever.
Le jour où commence notre histoire, vers deux heures de l’après-midi, malgré le soleil incandescent dont les rayons pesaient d’aplomb sur la ville, Guaymas, d’ordinaire si calme à cette heure, où tous les habitants, vaincus par la chaleur, dorment au fond de leurs maisons, présentait un aspect animé qui aurait surpris l’étranger que le hasard aurait amené en ce moment, et lui aurait immanquablement fait supposer qu’il allait assister à l’un des mille pronunciamentos qui éclosent chaque année dans ce malheureux pays.
Cependant il n’en était rien.
L’autorité militaire, représentée par le général San Benito, gouverneur de Guaymas, était ou semblait être satisfaite du gouvernement.
Les contrebandiers, les leperos et les hiaquis continuaient à vivre à peu près en bonne intelligence, sans trop se plaindre du pouvoir.
D’où provenait donc l’agitation extraordinaire qui régnait dans la ville ?
Quelle raison assez forte tenait éveillée toute cette indolente population et lui faisait oublier sa siesta ? Depuis trois jours la ville était en proie à la fièvre de l’or.
Le gouverneur, se rendant aux supplications de plusieurs négociants considérables, avait autorisé pour cinq jours une feria de plata, littéralement, une foire à l’argent.
Des jeux, tenus par des personnes de distinction, étaient ouverts au public dans les principales maisons.
Mais ce qui imprimait à cette fête un cachet d’étrangeté impossible à rencontrer ailleurs, c’est que sur les places et dans toutes les rues étaient installées en plein air des tablée de monté, sur lesquelles ruisselait l’or, et où quiconque possédait un réal vaillant avait le droit de le risquer, sans distinction de caste ni de couleur.
Au Mexique, tout se fait autrement que dans les autres pays, tout sort de la loi commune. Les habitants de cette contrée, sans souvenirs du passé qu’ils veulent oublier, sans foi dans l’avenir auquel ils ne croient pas ne vivent que pour le présent et mènent l’existence avec cette fiévreuse énergie particulière aux races qui sentant leur fin prochaine.
Les Mexicains ont deux goûts prononcés qui les gouvernent entièrement ; le jeu et l’amour. Nous disons goût et non passion, parce que les Mexicains ne sont susceptibles d’aucun de ces grands mouvements de l’âme qui surexcitent les facultés, dominent la volonté et ébranlent l’économie humaine en développant une puissance d’action énergique et forte.
Les groupes étaient nombreux et animés autour des tables de monté. Cependant tout se passait avec un ordre et une tranquillité que rien ne venait troubler jamais, bien que nul agent du pouvoir ne circulât dans les rues pour maintenir la bonne intelligence et surveiller les joueurs.
À la moitié environ de la calle de la Merced, l’une des plus larges de Guaymas, en face d’une maison de belle apparence, était installée une table recouverte d’un tapis vert, surchargée d’onces d’or, derrière laquelle se tenait un homme d’une trentaine d’années, à la figure fine et matoise, qui, un jeu de cartes à la main et le sourire aux lèvres, conviait par les plus engageantes paroles les nombreux spectateurs qui l’entouraient à tenter la fortune.
— Allons, caballeros, disait-il d’une voix mielleuse, en promenant un regard provocateur sur les misérables, fièrement drapés dans des guenilles, qui le considéraient d’un air presque indifférent, je ne puis gagner toujours, le sort va changer, j’en suis sûr ; voyez, il y a cent onces ; qui les tient ?
Il se tut.
Nul ne répondit.
Le banquier, sans se décourager, fit glisser dans ses doigts une ruisselante cascatelle d’onces dont les fauves reflets étaient capables de donner le vertige au cœur le plus éprouvé :
— C’est un beau denier, cent onces, caballeros ; avec cela, l’homme le plus laid est certain de séduire la plus belle. Voyons, qui les tient ?
— Bah ! fit un lepero avec une moue dédaigneuse ; qu’est-ce que cela, cent onces ? Si vous ne m’aviez pas gagné jusqu’à mon dernier tlaco, Tio-Lucas, je vous les tiendrais, moi.
— Je suis désespéré, seigneur Cucharès, répondit en s’inclinant le banquier que la veine vous ait été si contraire ; je serais heureux si vous daigniez me permettre devons prêter une once.
— Plaisantez-vous, dit le lepero en se redressant avec orgueil. Gardez votre or, Tio-Lucas, je sais la façon de m’en procurer autant que j’en voudrai, quand bon me semblera ; mais, ajouta-t-il en s’inclinant avec la plus exquise politesse, je ne vous en suis pas moins reconnaissant de votre offre généreuse.
Et il tendit au banquier, par-dessus la table, une main que celui-ci serra avec effusion.
Le lepero profita de l’occasion pour enlever, de la main qui était libre, une pile d’une vingtaine d’onces placée à sa portée.
Tio-Lucas dissimula une grimace ; mais il feignit de n’avoir rien vu.
Après cet échange mutuel de bons procédés, il y eut un instant de silence.
Les spectateurs n’avaient rien perdu de ce qui venait de se passer ; aussi attendaient-ils curieusement le dénouement de cette scène.
Ce fut le señor Cucharès qui le premier entama de nouveau l’entretien :
— Oh ! s’écria-t-il tout à coup en se frappant le front, je crois, par Nuestra Señora de la Merced, que je perds la tête !
— Pourquoi donc, cabellero ? demanda le Tio-Lucas, visiblement inquiet de cette exclamation.
— Caraï ! c’est bien simple, reprit l’autre, ne vous ai-je pas dit tout à l’heure que vous m’aviez gagné tout mon argent ?
— Vous me l’avez dit, en effet, ces caballeros l’ont entendu comme moi ; jusqu’au dernier ochavo, ce sont vos propres expressions.
— Je me le rappelle parfaitement, voilà ce qui me rend furieux.
— Comment ! s’écria le banquier avec un feint étonnement, vous êtes furieux de ce que je vous ai gagné ?
— Eh non ! ce n’est pas cela.
— Qu’est-ce donc alors ?
— Caramba ! c’est que je me suis trompé et qu’il me reste encore quelques onces.
— Pas possible !
— Voyez plutôt.
Le lepero fouilla dans sa poche, et avec une effronterie sans pareille, il étala aux yeux du banquier l’or qu’il venait à l’instant de lui voler.
Celui-ci ne sourcilla pas.
— C’est incroyable, dit-il.
— Hein ? fit le lepero en fixant sur lui un œil étincelant.
— Oui, il est incroyable que vous, señor Cucharès, vous ayez ainsi manqué de mémoire.
— Enfin, puisque je me suis souvenu, tout peut se réparer, nous allons poursuivre notre jeu.
— Fort bien ; va pour cent onces alors, n’est-ce pas ?
— Du tout ; je ne possède pas cette somme.
— Bah ! cherchez bien !
— C’est inutile, je sais que je ne l’ai pas.
— Ceci est on ne peut plus contrariant.
— Pourquoi donc ?
— Parce que je me suis juré de ne pas jouer moins.
— Ainsi, vous ne voulez pas tenir vingt onces ?
— Je ne le puis ; il n’en manquerait qu’une des cent, que je ne tiendrais pas.
— Hum ! fit le lepero, dont les sourcils se froncèrent… est-ce une insulte, Tio-Lucas ?
Le banquier n’eut pas le temps de répondre. Un homme d’une trentaine d’années, monté sur magnifique cheval noir, s’était depuis quelques secondes arrêté devant la table, écoutant, en fumant nonchalamment son pajillo, la discussion du banquier et du lepero.
— Va pour cent onces ! dit-il en s’ouvrant avec le poitrail de son cheval un chemin jusque auprès de la table, sur laquelle il laissa tomber une bourse pleine d’or.
Les deux interlocuteurs levèrent subitement la tête.
— Voilà les cartes, cavallero, s’empressa de dire le banquier, heureux de cet incident qui le débarrassait provisoirement d’un dangereux adversaire.
Cucharès leva les épaules avec dédain et regarda le nouveau venu.
— Oh ! s’écria-t-il d’une voix étouffée, el Tigrero viendrait-il pour Anita ? Je le saurai.
Et il se rapprocha tout doucement de l’étranger, auprès duquel il se trouva bientôt.
Celui-ci était un cavalier de haute mine, au teint olivâtre, au regard magnétique et à la physionomie franche et décidée.
Son costume, de la plus grande richesse, ruisselait d’or et de diamants.
Il portait, légèrement incliné sur l’oreille gauche, un feutre de vison à larges ailes, dont la forme était entourée d’une golilla d’or fin ; son dolman, de drap bleu, brodé en argent, laissait voir une chemise de batiste d’une blancheur éblouissante, sous le col de laquelle passait une cravate de crêpe de Chine attachée par un anneau de diamants ; ses calzoneras, serrées aux hanches par une ceinture de soie rouge à franges d’or galonnées et garnies de deux rangs de boutons en diamants, étaient ouvertes sur le côté et laissaient flotter son calzon de dessous ; il portait des botas vaqueras en cuir gauffré, richement brodées, attachées au-dessous du genou par une jarretière de tissu d’argent ; sa manga, reluisante d’or était coquettement relevée sur son épaule droite.
Son cheval, à la tête petite et aux jambes fines comme des fuseaux, était splendidement accoutré ; las armas de agua, le zarape attaché sur sa croupe, et sa magnifique anquera garnie de chaînettes d’acier, lui complétaient un harnachement dont on ne peut en Europe se faire une idée.
Comme tous les Mexicains d’une certaine classe, lorsqu’ils voyagent, l’étranger était armé de pied en cap, c’est-à-dire qu’en sus du lasso attaché à sa selle et du fusil placé en travers de ses arçons, il avait encore une longue épée au côté et une paire de pistolets à la ceinture, sans compter le couteau dont on voyait le manche damasquiné en argent sortir de l’une de ses bottes vaqueras.
Enfin, tel que nous venons de le présenter, cet homme était le type complet du Mexicain de la Sonora, toujours prêt à la paix comme à la guerre, ne redoutant pas plus l’une qu’il ne méprisait l’autre.
Après s’être poliment incliné devant Tio-Lucas, il prit les cartes que celui-ci lui offrait et les retourna un instant entre ses doigts en regardant autour de lui.
— Eh ! fit-il en jetant un regard amical au lepero, vous êtes ici, compadre Cucharès ?
— Pour vous servir, don Martial, répondit l’autre en portant la main à l’aile délabrée de son feutre.
L’étranger sourit.
— Veuillez être assez bon pour tailler à ma place tandis que j’allumerai mon pajillo.
— Avec plaisir ! s’écria le lepero.
El Tigrero ou don Martial, comme il plaira au lecteur de le nommer, sortit un mechero d’or de sa poche et battit impassiblement le briquet, tandis que le lepero tirait les cartes.
— Señor, dit celui-ci d’une voix piteuse.
— Eh bien ?
— Vous avez perdu.
— Bon. Tio-Lucas, prenez cent onces dans ma bourse.
— Je les ai, Seigneurie, répondit le banquier ; vous plait-il de jouer encore ?
— Certes ! mais plus de misères, hein ? j’aimerais assez à intéresser la partie.
— Je tiendrai ce qu’il plaira à votre Seigneurie d’exposer, répondit le banquier, dont l’œil expert avait, au fond de la bourse de l’étranger, découvert, parmi une assez forte quantité d’onces, une quarantaine de diamants de la plus belle eau.
— Hum ! êtes-vous réellement homme à tenir ce que je voudrais ?
— Oui.
L’étranger le regarda fixement.
— Même si je jouais mille onces d’or[2].
— Je tiendrai le double, si votre seigneurie ose le jouer, dit imperturbablement le banquier.
Un sourire méprisant plissa une seconde fois les lèvres hautaines du cavalier.
— J’ose toujours, dit-il.
— Ainsi, deux mille onces ?
— C’est convenu.
— Taillerai-je ? demanda timidement Cucharès.
— Pourquoi pas ? répondit l’autre d’un ton léger.
Le lepero saisit les cartes d’une main tremblante d’émotion.
Il y eut un frémissement d’intérêt parmi les joueurs qui entouraient la table.
À ce moment, une fenêtre s’ouvrit à la maison devant laquelle Tio-Lucas avait établi son monté, et une ravissante jeune fille s’accouda négligemment sur le balcon en regardant d’un air distrait dans la rue.
L’étranger se tourna vers le balcon, et, se haussant sur ses étriers :
— Salut à la belle Anita, dit-il en ôtant son chapeau et saluant profondément,
La jeune fille rougit, lui lança un regard expressif sous ses longs cils de velours, mais elle ne répondit pas un seul mot.
— Vous avez perdu, seigneurie, dit le Tio-Lucas avec un accent joyeux qu’il ne put complètement dissimuler.
— Fort bien, répondit l’étranger sans même le regarder, fasciné qu’il était par la charmante apparition du balcon.
— Vous ne jouez plus ?
— Au contraire. Je double.
— Hein ? fit le banquier en reculant malgré lui d’un pas à cette proposition.
— Je me trompe, j’ai une autre proposition à vous faire.
— Laquelle, seigneurie ?
— Combien avez-vous là, fit-il en désignant la table d’un geste dédaigneux.
— Mais… au moins sept mille onces.
— Pas davantage ?… hum ! c’est peu.
Les assistants regardaient avec une stupeur mêlée d’effroi cet homme extraordinaire qui jouait des onces et des diamants comme d’autres jouaient des ochavos.
La jeune fille devint pâle ; elle jeta un regard suppliant à l’étranger.
— Ne jouez plus, murmura-t-elle d’une voix tremblante.
— Merci, s’écria-t-il, merci, señorita, vos beaux yeux me porteront bonheur ; je donnerais tout l’or qui est sur cette table pour la fleur de suchil que vous tenez à la main, et que vos lèvres ont effleurée.
— Ne jouez plus, don Martial, répéta la jeune fille, en se rejetant vivement en arrière et en refermant la fenêtre.
Mais, soit hasard, soit tout autre raison, sa main laissa échapper la fleur de suchil.
Le cavalier fit bondir son cheval, la rattrapa au vol et la cacha dans son sein, après l’avoir baisée avec passion à plusieurs reprises.
— Cucharès, dit-il au lepero, retournez une carte.
Celui-ci obéit.
— Seis de copas, dit-il.
— Voto à brios ! s’écria l’étranger, la couleur du cœur, nous devons gagner. Tio-Lucas, je vous joue sur cette carte tout l’or amoncelé sur votre table.
— Le banquier, pâlit, il hésita ; les assistants avaient les yeux fixés sur lui.
— Bah ! At-il au bout d’une minute, il est impossible qu’il gagne. J’accepte, seigneurie, dit-il.
— Comptez la somme que vous avez.
— C’est inutile, seigneur, il y a neuf mille quatre cent cinquante onces d’or[3].
À l’annonce de ce chiffre formidable, les assistants poussèrent une exclamation d’admiration et de convoitise à la fois.
— Je vous croyais plus riche, dit ironiquement l’étranger. Enfin, va pour neuf mille quatre cent cinquante onces.
— Cette fois, taillerez-vous, seigneurie ?
— Non ; il est incontestable pour moi que vous allez perdre, Tio-Lucas. Je veux que vous soyez bien convaincu que je gagne loyalement. Pour cela, faites-moi le plaisir de tailler vous-même ; vous serez ainsi, ajouta-t-il avec ironie, l’artisan de votre ruine et n’aidez de reproches à adresser à personne.
Les assistants trépignaient de plaisir en voyant la façon chevaleresque dont agissait l’étranger. En ce moment, la rue était littéralement pleine de monde que l’attrait de cette partie étrange avait rassemblé de tous les coins de la ville.
Un silence de mort planait sur cette foule anxieuse, tant était grand l’intérêt que chacun prenait au dénoûment heureux ou malheureux de cette partie grandiose et jusque-là sans exemple.
Le banquier essuya la sueur qui perlait sur son front livide ; et d’une main tremblante il saisit la première carte.
Quelques secondes, il la balança entre le pouce et l’index avec une hésitation manifeste.
— Allez donc, lui cria en ricanant Cucharès.
Tio-Lucas laissa machinalement tomber la carte en détournant la tête.
— Seis de copas ! s’écria le lepero d’une voix stridente.
Le banquier poussa un hurlement de douleur.
— J’ai perdu ! murmura-t-il.
— J’en étais sûr, dit le cavalier toujours impassible. Cucharès, ajouta-t-il, portez cette table et l’or qu’il y a dessus à doña Anita ; je vous attends ce soir où vous savez.
Le lepero s’inclina respectueusement : aidé par deux vigoureux gaillards, il exécuta l’ordre qu’il venait de recevoir et entra dans la maison pendant que l’étranger s’éloignait à toute bride et que Tio-Lucas, revenu du rude coup qu’il venait de recevoir, tordait philosophiquement une cigarette en répétant à ceux qui voulaient à toute force lui donner des consolations :
— J’ai perdu, c’est vrai, mais contre un bien beau joueur et sur un bien beau coup. Bah ! plus tard j’aurai ma revanche.
Puis, lorsque sa cigarette fut faite, le pauvre banquier décavé l’alluma et s’en alla d’un pas tranquille.
La foule n’ayant plus de prétexte pour rester là, ne tarda pas à se dissiper à son tour.
↑
Les Trappeurs de l’Arkansas
, 1 vol. in-12, Amyot, éditeur.
↑
Environ 82,000 francs.
↑
Environ 784,320 francs de notre monnaie. (Historique.)
IIDon Sylva de Torrès.
Guaymas est une ville toute nouvelle, construite un peu au jour le jour, selon le caprice des émigrants, que nulle loi n’est venue contraindre à des alignements, souvent monotones et toujours ennuyeux. Du reste, hâtons-nous de dire que, à part quelques maisons auxquelles on puisse réellement appliquer ce nom, les autres ne sont que d’affreux bouges, bâtis en pisé et déplorablement sales.
Dans la calle de la Merced, la principale, ou, pour être plus vrai, la seule rue de la ville, car les autres ne sont que des cloaques, s’élevait une maison à un étage, garnie d’un balcon et ornée d’un péristyle soutenu par quatre piliers, comme les autres habitations de Guaymas. Elle était recouverte d’une couche de chaux d’une éblouissante blancheur, et son toit était plat.
Le propriétaire de cette maison était un des plus riches mineros de la Sonora, possesseur d’une dizaine de mines, toutes en exploitation ; il se livrait en sus à l’élève des bestiaux, et possédait plusieurs haciendas dispersées dans la province, et dont la plus petite avait au moins autant d’étendue que l’un de nos départements de France.
Je suis certain que si don Sylva de Torrès avait voulu liquider sa fortune et se rendre compte un jour de ce qu’il possédait, il aurait réalisé plusieurs centaines de millions.
Don Sylva de Torrès était venu depuis quelques mois habiter Guaymas, où il ne faisait ordinairement que de fort courtes apparitions, et encore à de très-longs intervalles.
Cette fois, contrairement à ses habitudes, il avait amené avec lui sa fille Anita ; aussi, toute la population de Guaymas était-elle en proie à la plus grande curiosité et tous les regards étaient-ils fixés sur l’hôtel de don Sylva, tant la conduite de l’haciendero paraissait extraordinaire.
Renfermé dans sa demeure, dont les portes ne s’ouvraient que devant quelques privilégiés, don Sylva laissait marcher les bavardages sans paraître s’en soucier le moins du monde, poursuivant, selon toute apparence, la réalisation de certains projets dont l’importance l’empêchait de s’occuper de ce que l’on disait et pensait de lui.
Bien que les Mexicains soient excessivement riches et qu’il aiment à se faire honneur de leurs richesses, ils n’ont aucune idée du confortable ; chez eux règne la plus grande incurie. Leur luxe, s’il est permis d’employer cette expression, est brutal, sans discernement comme sans valeur réelle.
Ces hommes, habitués pour la plupart à la rude vie des déserts américains, à lutter continuellement contre les intempéries d’un climat souvent mortel et les aggressions incessantes des Indiens qui les cernent de toutes parts, campent plutôt qu’ils n’habitent dans les villes, croyant avoir tout fait lorsqu’ils ont follement prodigué l’or et les diamants.
Les habitations mexicaines sont là pour prouver la justesse du jugement que nous portons. À part l’inévitable piano européen qui se prélasse dans un angle de tous les salons, on ne rencontre que quelques butacas incommodes, des tables mal équarries, de mauvaises gravures enluminées, pendues le long des murs blanchis à la chaux, et voilà tout.
La demeure de don Sylva ne différait en aucune façon des autres, et comme partout, pour rentrer à l’écurie en revenant de l’abreuvoir, les chevaux du maître étaient contraints de traverser, tout ruisselants d’eau, le salon, que leurs pieds avaient à demi décarrelé et où ils laissaient de larges traces de leur passage.
Au moment où nous introduisons le lecteur dans la maison de don Syla de Torrès, deux personnes, un homme et une femme, étaient assis et causaient, ou du moins échangeaient à longs intervalles quelques paroles dans le salon.
Ces deux personnages étaient don Sylva et sa fille Anita.
Le croisement des races espagnole et indienne a produit le plus beau type plastique qui se puisse voir.
Don Sylva, bien qu’il fût âgé de près de cinquante ans, en paraissait quarante à peine ; sa taille était haute, bien prise, sa démarche noble, son visage sévère, mais empreint d’une grande douceur. Il portait le costume mexicain dans sa plus rigoureuse exactitude ; mais les vêtements qui le couvraient étaient d’une richesse que certes peu de ses compatriotes auraient pu, non pas surpasser, mais seulement égaler.
Anita, couchée sur un canapé, à demi enfouie dans des flots de soie et de gaze, comme un colibri caché dans de la mousse, était une charmante enfant de dix-huit ans au plus, dont les yeux noirs pudiquement voilés par de longs cils de velours, étaient pleins de voluptueuses promesses que ne démentaient pas les contours onduleux et serpentins de son corps délicieusement modelé. Ses moindres gestes avaient une grâce et une majesté que complétait le ravissant sourire de ses lèvres de corail. Son teint, légèrement doré par le soleil américain, donnait à son visage une expression impossible à rendre, et enfin toute sa personne exhalait un suave parfum d’innocence et de candeur qui attirait la sympathie et inspirait l’amour.
Comme toutes les Mexicaines dans l’intérieur de leurs maisons, elle ne portait qu’une légère robe de mousseline brochée ; son rebozo était jeté négligemment sur ses épaules, et une profusion de fleurs de jasmin s’étalait dans sa chevelure d’un noir bleuâtre, qu’elle embaumait.
Anita semblait rêveuse ; parfois l’arc de ses sourcils se fronçait sous l’effort de la pensée qui l’obsédait ; son sein se soulevait, et son pied mignon, chaussé de pantoufles fourrées de duvet de cygne, frappait impatiemment le sol.
Don Sylva de Torrès, lui aussi, paraissait mécontent ; après avoir jeté un regard sévère à sa fille, il se leva, et s’approchant d’elle :
— Vous êtes une folle, Anita ; votre action est extravagante ; une jeune fille bien née ne doit, dans aucun cas, agir ainsi que vous venez de le faire…
La jeune Mexicaine ne répondit que par une moue significative et un imperceptible haussement d’épaules.
Son père continua :
— Surtout, dit-il en appuyant sur chaque syllabe, dans votre position vis-à-vis du comte de Lhorailles.
La jeune fille se redressa comme si un serpent l’eût piquée, et fixant un regard interrogateur sur le visage impassible de l’haciendero :
— Je ne vous comprends pas, mon père répondit-elle.
— Vous ne me comprenez pas, Anita ? je ne puis le croire. N’ai-je pas formellement promis votre main au comte ?
— Qu’importe, si je ne l’aime pas. Voulez-vous donc me condamner à être malheureuse toute ma vie ?
— C’est au contraire votre bonheur que j’ai recherché dans cette union. Je n’ai que vous, Anita, pour me consoler de la perte douloureuse de votre mère bien-aimée. Pauvre enfant, vous êtes encore, grâce à Dieu, à cet âge béni du ciel où le cœur s’ignore lui-même et où les mots bonheur et malheur n’ont aucune signification. Vous n’aimez pas le comte, dites-vous ; tant mieux ! votre cœur est libre ; lorsque plus tard vous aurez été à même d’apprécier les nobles qualités de celui que je vous donne pour mari, alors vous me remercierez d’avoir exigé ce mariage qui aujourd’hui vous cause un si grand chagrin.
— Mais, mon père, fit vivement la jeune fille d’un air dépité, mon cœur n’est pas libre, vous le savez bien.
— Je sais, doña Anita de Tores, reprit sévèrement l’haciendero, qu’un amour indigne de vous et de moi ne peut entrer dans votre cœur. Par mes aïeux, je suis Christiano Viejo, si quelques gouttes de sang indien se trouvent dans mes veines, je n’en ai que plus profondément gravé dans l’âme ce que je dois à la mémoire de mes ancêtres. Notre premier aïeul, Antonio de Sylva, lieutenant de Hernando Cortez, épousa, il est vrai, une princesse mexicaine de la famille de Moctecuzoma, mais tous nos autre ascendants sont Espagnols.
— Ne sommes-nous donc pas Mexicains, mon père ?
— Hélas ! pauvre enfant, qui peut dire qui nous sommes et ce que nous sommes ? Notre malheureux pays, depuis qu’il a secoué le joug espagnol, se débat convulsivement et s’épuise sous les efforts incessants d’ambitieux de bas étage qui d’ici à peu d’années lui auront ravi jusqu’à cette nationalité que nous avons eu tant de peine à conquérir ; ces luttes honteuses nous rendent la risée des autres peuples et surtout font la joie de nos avides voisins, qui, l’œil invariablement fixé sur nous, se préparent à s’enrichir de nos dépouilles dont ils ont happé quelques bribes en nous enlevant plusieurs de nos riches provinces.
— Mais, mon père, je suis femme, moi, par conséquent en dehors de la politique ; je n’ai rien à voir avec les gringos.
— Plus que vous ne croyez, ma fille. Je ne veux pas qu’à un jour donné les immenses propriétés que mes ancêtres et moi avons acquises à force de travail deviennent la proie de ces hérétiques maudits. Voilà pourquoi, afin de les sauvegarder, j’ai résolu de vous faire épouser le comte de Lhorailles. Il est Français, il appartient à l’une des plus nobles familles de ce pays : de plus c’est un beau et hardi cavalier de trente ans à peine, qui joint aux qualités physiques les qualités morales les plus précieuses ; il appartient à une nation forte et respectée, qui sait, en quelque coin du monde qu’ils se trouvent, protéger ses nationaux. En l’épousant, ta fortune est à l’abri de tout revers politique.
— Mais je ne l’aime pas, mon père.
— Niaiserie, chère enfant. Ne parlons plus de cela ; je veux bien oublier la folie dont il y a quelques instants tu t’es rendue coupable, mais à la condition que tu oublieras ce Martial.
— Jamais ! s’écria-t-elle avec résolution.
— Jamais ? c’est bien long, ma fille ; vous réfléchirez, j’en suis sûr. Du reste, quel est cet homme ? d’où sort-il ? le savez-vous ? On le nomme Martial el Tigrero, voto a dios ! Ce n’est pas un nom cela ! Cet homme vous a sauvé la vie en arrêtant votre cheval qui s’était emporté ? eh bien, est-ce une raison pour qu’il devienne amoureux de vous et vous de lui ? Je lui ai offert une magnifique récompense qu’il a refusée avec le plus suprême dédain ; tout est dit ; qu’il me laisse tranquille ; je n’ai et ne veux rien avoir de plus à démêler avec lui.
— Je l’aime ! mon père, reprit encore la jeune fille.
— Tenez, Anita, vous m’impatienteriez si je ne me contraignais pas ; assez sur ce sujet, préparez-vous à recevoir convenablement le comte de Lhorailles. J’ai juré que vous seriez son épouse, et, Cristo ! Cela sera quand je devrais vous traîner de force à l’autel.
L’haciendero prononça ces paroles avec une telle résolution dans la voix et un si ferme accent, que la jeune fille comprit que mieux valait pour elle paraître céder et cesser une discussion qui ne pouvait que s’envenimer et avoir peut-être de graves conséquences ; elle baissa la tête et se tut, tandis que son père marchait à grands pas d’un air mécontent dans le salon.
La porte s’entr’ouvrit, un peone passa discrètement la tête par l’entrebâillement.
— Que voulez-vous ? demanda don Sylva en s’arrêtant.
— Seigneurie, répondit cet homme, un caballero, suivi de quatre autres portant une table couverte de pièces d’or, demande à parler à la señorita.
L’haciendero lança à sa fille un regard d’une exprèssion indéfinissable.
Doña Anita baissa la tête avec confusion.
Don Sylva réfléchit un instant, puis son visage s’éclaira :
— Faites entrer, dit-il.
Le peon se retira, mais il revint au bout de quelques minutes, précédant notre ancienne connaissance Cucharès, toujours drapé dans son zarapé en loques et guidant les quatre leperos portant la table.
En entrant dans le salon, Cucharès se découvrit respectueusement, salua avec courtoisie l’haciendero et sa fille, et d’un geste enjoignit aux porteurs de poser la table au milieu de la pièce.
— Señorita, dit-il d’un ton mielleux, le señor don Martial, fidèle à l’engagement qu’il a pris vis-à-vis de vous, vous supplie humblement de recevoir le gain fait par lui au monté comme un faible témoignage de son dévouement et de son admiration.
— Drôle ! s’écria avec colère don Sylva en faisant un pas vers lui, savez-vous bien en présence de qui vous vous trouvez ?
— Mais en présence de doña Anita et de son respectable père, répondit imperturbablement le coquin en se drapant majestueusement dans ses guenilles, je n’ai pas que je sache, manqué au respect que je dois à l’un ou à l’autre.
— Retirez-vous sur le champ en enlevant cet or, dont ma fille n’a que faire.
— Vous m’excuserez, seigneurie ; j’ai reçu l’ordre d’apporter ici cet or, avec votre permission je l’y laisserai ; don Martial ne me pardonnerait pas d’agir autrement.
— Je ne connais pas don Martial, ainsi qu’il vous plaît de nommer l’homme qui vous envoie, je ne veux avoir rien de commun avec lui.
— C’est possible, seigneurie ; cela ne me regarde pas, vous vous expliquerez avec lui si bon vous semble ; pour moi, maintenant que ma mission est remplie, je vous baise les mains.
Et après s’être de nouveau incliné devant les deux personnages, le lepero sortit majestueusement, suivi à pas comptés, par ses quatre acolytes.
— Voyez ! s’écria don Sylva avec violence, voyez, ma fille, à quel affront m’expose votre folie.
— Un affront ! mon père, répondit-elle timidement ; je trouve au contraire que don Martial agit en véritable caballero, et qu’il me donne une grande preuve d’amour : cette somme est immense.
— Ah ! dit don Sylva avec colère, c’est ainsi que vous le prenez ! eh bien, moi aussi je vais agir en caballero, voto a brios ! vous allez voir. À moi, quelqu’un !
Plusieurs peones entrèrent.
— Ouvrez les fenêtres ! commanda-t-il.
Les domestiques obéirent.
Le rassemblement n’était pas encore dissipé, bon nombre d’individus continuaient à stationner devant la maison ou à rôder aux environs.
L’haciendero se pencha en dehors. D’un geste il demanda le silence.
Instinctivement la foule se tut et se rapprocha, devinant qu’il allait se passer quelque chose d’intéressant pour elle.
— Señores caballeros y amigos, dit l’haciendero d’une voix forte, un homme que je ne connais pas a osé offrir à ma fille l’or gagné par lui au monté. Doña Anîta méprise de tels présents, surtout venant d’un individu avec lequel elle ne veut entretenir aucunes relations amicales ou autres. Elle me prie de vous distribuer cet or, auquel elle ne veut toucher en aucune façon ; elle désire faire éclater ainsi en présence de tous le mépris que lui inspire l’homme qui a osé lui faire une telle insulte.
Le discours improvisé par l’haciendero fut couvert des applaudissements frénétiques des leperos et autres mendiants réunis, dont les yeux étincelaient de convoitise.
Anita sentait des larmes brûlantes inonder ses paupières, malgré les efforts inouïs auxquels elle se condamnait pour demeurer impassible, son cœur était près de se briser.
Sans se préoccuper de sa fille, don Sylva ordonna à ses domestiques de jeter les onces dans la rue.
Alors une pluie d’or commença littéralement à tomber sur les misérables qui se ruaient avec une ardeur sans nom sur cette manne d’une nouvelle espèce.
La calle de la Merced offrait alors le plus singulier spectacle qui se puisse imaginer.
L’or pleuvait, pleuvait toujours ; il semblait inépuisable.
Les misérables se précipitaient comme des coyotes à la curée sur le précieux métal, renversant et foulant aux pieds les plus faibles d’entre eux.
Au plus beau moment de cette averse, un cavalier apparut en courant à toute bride.
Étonné, confondu par ce qu’il voyait, un instant il s’arrêta pour regarder autour de lui ; puis il éperonna son cheval, et, à force de distribuer des coups de chicote à droite et à gauche, il parvint à fendre la foule amoncelée et roulant comme une mer en furie d’un bout à l’autre de la rue, et il atteignit la maison de l’haciendero, dans laquelle il entra.
— Voici le comte de Lhorailles, dit laconiquement don Sylva à sa fille.
En effet, au bout d’un instant, le comte entra dans le salon.
— Ah ça ! cria-t-il en s’arrêtant sur le seuil de la porte, quelle singulière idée avez-vous donc, don Sylva ? Sur mon âme, vous vous divertissez à jeter des millions par la fenêtre pour le plus grand divertissement des leperos et autres coquins de même sorte.
— Ah ! c’est vous señor comte, répondit tranquillement l’haciendero : soyez le bien venu ; je suis à vous dans un instant, encore ces quelques poignées, et c’est fini.
— À votre aise, dit en riant le comte ; j’avoue que le caprice est original : et s’approchant de la jeune fille, qu’il salua avec la plus exquise politesse : Daignerez-vous, señorita, continua-t-il, me donner le mot de cette énigme, qui, je l’avoue, m’intéresse au dernier point ?
— Demandez à mon père, señor, répondit-elle avec une certaine sécheresse qui rendait toute conversation impossible.
Le comte feignit de ne pas remarquer cette nuance ; il s’inclina en souriant, et se laissant tomber sur une butacca :
— J’attendrai, dit-il nonchalamment. Rien ne me presse.
L’haciendero, en disant à sa fille que le mari qu’il lui destinait était un beau cavalier, ne l’avait nullement flatté. Le comte Maxime Gaétan de Lhorailles était un homme de trente ans au plus, d’une taille svelte, dégagée, un peu au-dessus de la moyenne. Ses cheveux blonds le faisaient reconnaître pour un fils du Nord ; ses traits étaient beaux, son regard expressif, ses mains et ses pieds dénotaient la race ; tout en lui sentait le gentilhomme de bonne souche, et si don Sylva ne s’était pas plus trompé au moral qu’il ne l’avait fait au physique, le comte de Lhorailles était réellement un cavalier accompli.
Enfin l’haciendero épuisa tout l’or que Cucharès lui avait apporté ; il fit à son tour voler la table dans la rue, ordonna de refermer les fenêtres, et vint en se frottant les mains s’asseoir auprès du comte.
— Là ! dit-il d’un air joyeux, voilà qui est fait ; maintenant je suis tout à vous.
— D’abord un mot.
— Dites.
— Excusez-moi ; vous savez que je suis étranger, et comme tel avide de m’instruire.
— Je vous écoute.
— Depuis que j’habite le Mexique, j’ai vu quantité de coutumes extraordinaires ; je devrais être blasé sur l’imprévu ; cependant je vous avoue que ce que je viens de voir passe pour moi tout ce que j’avais remarqué jusqu’à présent. Je désirerais être fixé, et savoir si cdeci est une coutume dont je ne me doutais pas jusqu’à présent,
— De quoi parlez-vous donc ?
— Eh ! mais de ce que vous faisiez lorsque je suis arrivé, de cet or que vous semiez à pleines mains en rosée bienfaisante sur les bandits de toute espèce rassemblés devant votre maison ; vilaines plantes, soit dit entre nous, pour les arroser ainsi.
Don Sylva se mit à rire.
— Non ce n’est pas une coutume, répondit-il.
— Fort bien. Ainsi, vous vous donniez le passe-temps royal de jeter un million à la canaille ? Peste ! don Sylva, il faut être riche comme vous l’êtes pour se permettre une telle fantaisie.
— Ce n’est pas ce que vous croyez.
— Cependant j’ai vu pleuvoir les onces.
— En effet, mais elles ne m’appartenaient pas.
— De mieux en mieux, cela se complique ; vous augmentez considérablement ma curiosité.
— Je vais la satisfaire.
— Je suis tout oreilles, car cela devient intéressant pour moi comme un conte des Mille et une Nuits.
— Hum ! fit l’haciendero eu hochant la tête, cela vous intéresse plus que vous ne le supposez peut-être.
— Il serait possible ?
— Vous allez en juger.
Doña Anita était au supplice : elle ne savait quelle contenance tenir. Comprenant que son père allait tout divulguer au comte, elle ne se sentit pas le courage d’assister à cette révélation et se leva en chancelant.
— Messieurs, dit-elle d’une voix faible, je me sens indisposée ; soyez assez bons pour me permettre de me retirer.
— En effet, s’écria le comte en s’élançant vers elle et lui offrant le bras pour la soutenir, vous êtes pâle, doña Anita. Permettez-moi de vous accompagner jusqu’à votre appartement.
— Je vous remercie, caballero ; je suis assez forte pour m’y rendre seule, et, tout en vous étant reconnaissante de votre offre, dispensez-moi de l’accepter.
— Comme il vous plaira, señorita, fit le comte intérieurement piqué de ce refus.
Don Sylva eut, une seconde, la pensée d’ordonner à sa fille de demeurer ; mais la pauvre enfant lui jeta un regard si désespéré qu’il ne se sentit pas le courage de lui imposer une plus longue torture.
— Allez, mon enfant lui dit-il.
La jeune fille se hâta de profiter de la permission ; elle s’élança hors du salon et se réfugia dans sa cbambre à coucher, où elle se laissa tomber sur un siège en fondant en larmes.
— Qu’a donc doña Anita ? demanda le comte avec intérêt dès qu’elle fut sortie.
— Des vapeurs, la migraine, que sais-je ? répondit l’haciandero en haussant les épaules ; toutes les jaunes filles sont ainsi ; dans quelques instants elle n’y pensera plus.
— Tant mieux I je vous avoue que j’étais inquiet.
— Maintenant que nous sommes seuls, ne voulez-vous pas que je vous donne le mot de l’énigme qui semblait tant vous intéresser ?
— Au contraire, parlez sans plus attendre, j’ai de mon côté plusieurs choses importantes à vous annoncer.
IIIDeux vieilles connaissances du lecteur.
À cinq kilomètres environ de la ville s’élève le village de San-José de Guaymas, vulgairement nommé le Rancho.
Ce pueblo misérable se compose seulement d’une place de médiocre grandeur, coupée à angle droit par deux rues bordées de masures délabrées, habitées par les Indiens hiaquis, dont un grand nombre s’engage chaque année à Guaymas pour travailler comme ouvriers du port, charpentiers, commissionnaires, etc., et tous ces aventuriers sans aveu dont pullulent les plages du Pacifique depuis la découverte des placeres de la Californie.
La route qui conduit de Guaymas à San-José est tracée à travers une plaine aride et sablonneuse, où ne poussent que quelques nopals et quelques cactus rabougris, dont les branches désolées sont couvertes de poussière et font la nuit l’effet de blancs fantômes.
Le soir du jour où commence cette histoire, un cavalier enveloppé dans un zarapé relevé jusqu’aux yeux, suivait cette route et se dirigeait au galop vers le Rancho.
Le ciel, d’un bleu foncé, était émaillé d’étoiles brillantes ; la lune, parvenue au tiers de sa course, éclairait la plaine silencieuse et allongeait indéfiniment les grandes ombres des arbres sur la terre nue.
Le cavalier, sans doute pressé d’atteindre le but d’une course qui n’était pas sans péril à cette heure avancée, excitait incessamment de la voix et de l’éperon sa monture, qui ne paraissait pas cependant avoir besoin de ces exhortations sans cesse renouvelées.
Le cavalier avait presque traversé les landes incultes et était sur le point de s’engager dans les bois épais d’arbres du Pérou qui avoisinent le Rancho, lorsque tout à coup son cheval fit un bond de côté et s’arquebouta fortement sur les quatre pieds en reculant et couchant les oreilles.
Un bruit sec annonça que le cavalier avait armé ses pistolets ; puis cette précaution prise à tout hasard, il jeta un regard investigateur autour de lui.
— Ne craignez rien, caballero ! cria une voix franche et sympathique ; seulement obliquez un peu à droite, si cela vous est égal.
L’inconnu regarda et vit presque sous les pieds de sa monture un homme agenouillé et tenant dans ses mains la tête d’un cheval gisant en travers de la route.
— Que diable faites-vous là ? dit-il.
— Vous le voyez, répondit l’autre avec tristesse, je fais mes adieux à mon pauvre compagnon ; il faut avoir vécu longtemps au désert pour comprendre le prix d’un ami comme celui-là.
— C’est vrai, fit l’étranger ; et mettant immédiatement pied à terre : Est-il donc mort ? ajouta-t-il.
— Non, pas encore ; mais, malheureusement, il n’en vaut guère mieux.
Et il soupira.
L’étranger se pencha sur l’animal, dont le corps était agité de frémissement nerveux, lui écarta les paupières et le considéra attentivement.
— Votre cheval a un coup de sang, dit-il au bout d’un instant ; laissez-moi faire.
— Oh ! s’écria l’autre, croyez-vous pouvoir le sauver ?
— Je l’espère, répondit laconiquement le premier interlocuteur.
— Caraï ! si vous faites cela, ce sera entre nous à la vie et à la mort. Ce pauvre Negro, mon vieux compagnon de courses !
Le cavalier baigna les tempes et les naseaux du cheval avec un peu d’eau mélangée de rhum ; au bout de quelques minutes, l’animal sembla se ranimer ; son œil voilé et terne devint brillant et il essaya de se relever.
— Tenez-le ferme, dit le médecin improvisé.
— Soyez tranquille. Là, là ! ma bonne bête ; là, Negro, mon garçon, quieto, quieto, c’est pour ton bien, fit-il en le caressant.
L’intelligent animal semblait comprendre ; il tournait la tête vers son maître et lui répondait par des hennissements plaintifs.
Le cavalier, pendant ce temps, avait fouillé dans sa ceinture, et se courbant de nouveau sur le cheval :
— Surtout tenez ferme ! recommanda-t-il de nouveau.
— Qu’allez-vous faire ?
— Je vais le saigner.
— Oui, c’est cela, je le savais ; mais malheureusement je n’osais me hasarder à le saigner moi-même de crainte de le tuer en voulant le sauver.
— Y êtes-vous ?
— Allez.
Soudain l’animal fit un brusque mouvement causé par le froid de la blessure, mais son maître le serra de façon à neutraliser ses efforts.
Il y eut pour les deux hommes une minute d’anxiété : le sang ne sortait pas ; enfin une goutte noirâtre apparut à l’endroit de la piqûre, puis une seconde, remplacée bientôt par une troisième, et un long jet de sang noir et écumeux s’élança au dehors.
— Il est sauvé ! s’écria le cavalier en essuyant sa lancette et la remettant dans sa trousse.
— Je vous revaudrai celle-là, foi de Belhumeur ! dit avec émotion le maître du cheval ; vous m’avez rendu un de ces services qui ne s’oublient pas.
Et par un mouvement irrésistible il tendit la main à l’homme qui s’était si providentiellement trouvé sur sa route. Celui-ci répondit franchement à cette chaleureuse étreinte. Désormais tout était dit entre eux : ces deux hommes, qui quelques instants auparavant ne se connaissaient pas, ignoraient l’existence l’un de l’autre, étaient amis, liés par un de ces services qui dans les pays américains ont une immense valeur.
Cependant le sang perdait peu à peu sa teinte noirâtre, il devenait vermeil et coulait avec abondance ; la respiration du cheval haletante et saccadée était devenue facile et régulière. Le premier inconnu fit la saignée copieuse ; puis lorsqu’il jugea le cheval en bonne voie, il arrêta le sang.
— Maintenant, dit-il, que comptez-vous faire ?
— Ma foi, je n’en sais rien ; Votre aide m’a déjà été si utile que je ne veux agir que d’après vos conseils.
— Où alliez-vous lorsque cet accident vous est arrivé ?
— Au Rancho.
— C’est aussi là que je me rends ; nous n’en sommes qu’à quelques pas, vous monterez en croupe derrière moi, nous conduirons votre cheval en bride, et nous partirons si vous le voulez.
— Je ne demande pas mieux. Vous croyez que mon cheval ne pourrait pas me porter ?
— Peut-être le ferait-il, car c’est une noble bête ; mais cela serait imprudent, vous risqueriez de le perdre ; mieux vaut, croyez-moi, employer le moyen que je vous ai indiqué.
— Oui, mais je crains…
— Quoi donc ? interrompit l’autre vivement, ne sommes-nous pas amis ?
— C’est juste. J’accepte.
Le cheval se releva assez lestement, et les deux hommes qui s’étaient si singulièrement rencontrés se mirent en route tous deux, ainsi que cela avait été convenu, montés sur le même animal.
Une vingtaine de minutes plus tard ils atteignirent les premières maisons du Rancho.
À l’entrée du village, le maître du cheval arrêta sa monture et se tournant vers son compagnon :
— Où voulez-vous descendre ? lui demanda-t-il.
— Cela m’est égal, répondit l’autre ; je saurai toujours me reconnaître. Allons d’abord où vous allez.
— Ah ! fit le cavalier en se grattant la tête, c’est que moi je ne vais nulle part.
— Comment ! vous n’allez nulle part ?
— Ma foi non. Vous me comprendrez dans un instant. Je suis aujourd’hui même débarqué à Guaymas ; le Rancho n’est pour moi que la première étape d’un voyage que j’entreprends dans le désert, et qui probablement doit être bien long.
Aux reflets de la lune, dont un rayon jouait en ce moment sur le visage de l’étranger, son compagnon considéra quelques secondes sa physionomie noble et pensive, où la douleur avait creusé déjà de profonds sillons.
— De sorte, lui dit-il enfin, que tous les logements vous seront bons ?
— Une nuit est bientôt passée. Je ne demande qu’un abri pour mon cheval et pour moi.
— Eh bien, si vous voulez me laisser vous servir de guide à mon tour, avant dix minutes vous aurez cela.
— J’accepte.
— Je ne vous promets pas un palais, je vous conduirai dans un pulqueria où moi-même j’ai l’habitude de descendre, lorsque le hasard m’amène dans le pays. Vous trouverez la société un peu mélangée ; mais que voulez-vous, à la guerre comme à la guerre, et, ainsi que vous l’avez dit vous-même, une nuit est bientôt passée.
— À la grâce de Dieu ! et en route.
Passant alors ses bras sous ceux de son compagnon, le nouveau guide saisit les rênes du cheval et le dirigea vers une maison située aux deux tiers environ dé la rue où ils se trouvaient et dont les fenêtres mal jointes flamboyaient dans la nuit comme les bouches d’une fournaise, tandis que des cris, des rires, des chants et des grincements aigres et saccadés de jarabès indiquaient que si le reste du pueblo était plongé dans le sommeil, là, du moins, on veillait.
Les deux inconnus s’arrêtèrent devant la porte de cette auberge de bas étage.
— Votre parti est-il bien pris ? demanda le premier à l’autre,
— Parfaitement, répondit celui-ci.
Le guide frappa alors à tour de bras sur la porte vermoulue.
On fut assez longtemps à répondre : enfin une voix rauque cria de l’intérieur, tandis que le plus grand silence succédait comme par enchantement au vacarme qui avait régné jusqu’à alors.
— Quien vive ?
— Gente depaz ! répondit l’étranger.
— Hum ! fit la voix, ce n’est pas un nom, cela. Quel temps fait-il ?
— Un pour tous, tous pour un ; le cormuel souffle à décorner les bœufs sur la cime du Cerro-del-Huerfano.
La porte s’ouvrit immédiatement ; les voyageurs entrèrent.
D’abord ils ne purent rien distinguer au milieu de l’atmosphère épaisse et fumeuse de la salle et marchèrent au hasard.
Le compagnon du premier cavalier était bien connu dans cet antre, car le maître de la maison et plusieurs autres personnes s’empressèrent à l’envi autour de lui.
— Caballeros, dit-il en désignant la personne qui le suivait, ce señor est mon ami ; je vous prie d’avoir pour lui les plus grands égards.
— Il sera traité comme vous-même, Belhumeur, répondit celui qui paraissait être le maître de ce bouge ; vos chevaux ont été conduits au corral, où on les a mis à même d’une botte d’alfalfa. Quant à vous, la maison vous appartient, vous pouvez en disposer à votre gré.
Pendant cet échange de compliments, les étrangers étaient parvenus à se frayer un chemin au milieu de la foule : ils avaient traversé la salle et avaient à grand’peine réussi à s’asseoir dans un coin devant une table sur laquelle l’hôte avait lui-même placé du pulque, du mezcal, du chinguirito, du refino de Catalogne et du vin de Xérès.
— Caramba ! señor Huesped, s’écria en riant celui qu’à plusieurs reprises déjà on avait nommé Belhumeur, vous êtes généreux aujourd’hui.
— Ne voyez-vous pas que j’ai un angelito, répondit l’autre gravement.
— Ainsi, votre fils Pedrito…
— Il est mort ! je tâche de bien recevoir mes amis, afin de mieux fêter l’entrée au ciel de mon pauvre enfant, qui, n’ayant jamais péché, est un ange auprès de Dieu !
— C’est très-juste, fit Belhumeur, en trinquant avec ce père si peu désolé.
Celui-ci vida d’un trait son gobelet de refino et s’éloigna.
Les étrangers, accoutumés déjà à l’atmosphère dans laquelle ils se trouvaient, jetèrent alors un regard autour d’eux.
La salle de la pulqueria offrait un aspect des plus curieux.
Au milieu, une dizaine d’individus à mines patibulaires, couverts de haillons et armés jusqu’aux dents, jouaient avec fureur au monté. Particularité assez étrange, mais qui cependant ne semblait étonner aucun des honorables joueurs, un long poignard était planté dans la table à la droite du banquier, et deux pistolets reposaient à sa gauche. À quelques pas de là, des hommes et des femmes plus qu’à moitié ivres dansaient en chantant avec des gestes lubriques et des cris furieux aux sons aigres de deux ou trois vihuelas et jarabes. Dans l’angle le plus apparent de la salle, une trentaine de personnes étaient réunies autour d’une table, au milieu de laquelle un jeune enfant de cinq ans au plus était assis sur un siège de cannes. Cet enfant présidait la réunion ; il portait ses plus beaux habits, avait une couronne de fleurs sur la tête, et une profusion de fleurs jonchaient la table autour de lui.
Mais hélas ! le front de cet enfant était pâle, ses yeux vitreux, son teint plombé, marqué de taches violettes ; son corps avait cette roideur des cadavres ; il était mort : c’était l’angelito dont le digne pulquero fêtait l’entrée au ciel.