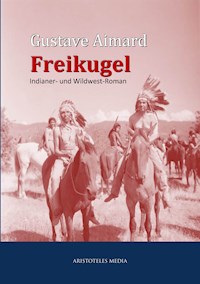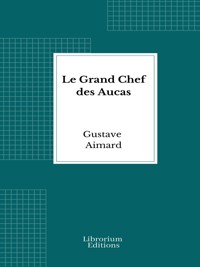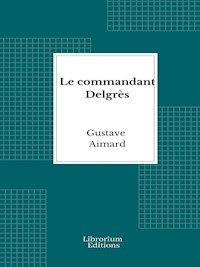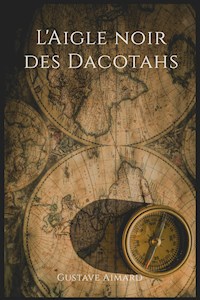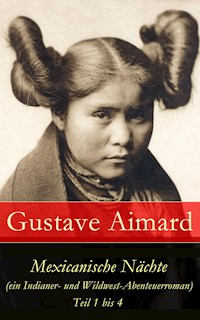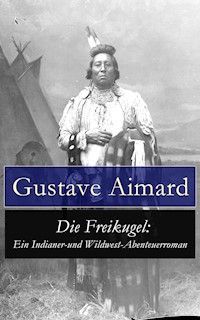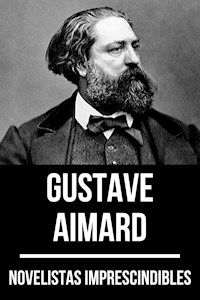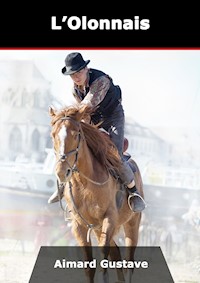0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Les Français ont été souvent accusés, avec une apparence de raison, de connaître beaucoup moins leur propre histoire que celle des autres peuples anciens ou modernes.
On pourrait ajouter, mais cette fois avec raison, que la partie la plus négligée et par conséquent presque entièrement ignorée de cette histoire, est celle qui se rapporte à nos colonies ; que ces colonies soient en Afrique, en Amérique on en Océanie ; c’est-à-dire qu’elles soient situées aux confins du monde, ou seulement à quelques centaines de lieues de nos côtes.
Et pourtant que de liens étroits nous rattachent à ces colonies si dédaignées ! Que de souvenirs glorieux elles nous rappellent !
Que de preuves de dévouement et de fidélité elles ont données à la France dans les circonstances les plus critiques !
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Gustave Aimard
Le Chasseur de rats
Les révoltés ou l’Œil Gris
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782383838036
Le Chasseur de rats
À
Armand Lapointe
L’auteur de la Chasse aux fantômes, de la Vie parisienne et de tant d’autres ouvrages aimés du public.
Son ami,
Gustave Aimard.
Paris, le 20 mars 1876.
I
Qui était le mystérieux personnage auquel on donnait le nom de l’Œil Gris ?
Les Français ont été souvent accusés, avec une apparence de raison, de connaître beaucoup moins leur propre histoire que celle des autres peuples anciens ou modernes.
On pourrait ajouter, mais cette fois avec raison, que la partie la plus négligée et par conséquent presque entièrement ignorée de cette histoire, est celle qui se rapporte à nos colonies ; que ces colonies soient en Afrique, en Amérique on en Océanie ; c’est-à-dire qu’elles soient situées aux confins du monde, ou seulement à quelques centaines de lieues de nos côtes.
Et pourtant que de liens étroits nous rattachent à ces colonies si dédaignées ! Que de souvenirs glorieux elles nous rappellent !
Que de preuves de dévouement et de fidélité elles ont données à la France dans les circonstances les plus critiques !
Pour ne parler ici que des Antilles, ces gracieuses corbeilles de fleurs aux parfums si doux et si enivrants, surgies du sein des eaux et disséminées comme de ravissantes oasis sur les flots bleus de l’Atlantique ; terres bénies où tout sourit au cœur et sur lesquelles la vie s’écoule comme un rêve féerique des Mille et une Nuits ; à combien de batailles terribles ont-elles assisté ! Quelles luttes acharnées ont-elles soutenues avec une énergie et une abnégation héroïques pour résister, soit au révoltes des noirs, soit aux attaques plus formidables encore de puissants envahisseurs étrangers afin de rester françaises et se conserver à cette mère patrie qu’elles aiment avec passion, peut-être à cause de sa constante ingratitude envers elles.
La Guadeloupe est, sans contredit, la plus complètement belle de ces îles charmantes qui composent l’écrin précieux de l’archipel Colombien ou des Antilles ; perles d’un irréprochable orient, égrenées par la main toute-puissante du Créateur, de son mystérieux chapelet de merveilles, et semées par lui à l’entrée du golfe du Mexique.
Rien ne saurait exprimer l’impression d’enivrante langueur qui s’empare des sens lorsque, après une longue et monotone traversée, le cri : terre ! est à l’improviste poussé par la vigie ; que l’eau se fait plus bleue et plus transparente ; que d’acres senteurs, portées sur l’aile humide de la brise, viennent gonfler les poumons d’un air vivifiant et embaumé ; qu’aux premiers rayons du soleil levant, comme l’antique Aphrodite sortent de l’écume de la mer, on voit tout à coup apparaître, se dessiner, vagues, indistinctes encore, et à demi voilées par une gaze brumeuse qui en estompe légèrement les contours, les côtes verdoyantes et pittoresquement découpées de la Guadeloupe, avec ses chaînes de montagnes volcaniques, dont les pilons hauts et chenus semblent s’incliner devant l’imposante Soufrière, constamment couronnée d’un nuage de fumée jaunâtre qui monte en tournoyant vers le ciel et lui fait une éblouissante auréole.
L’anse à la Barque est une baie profonde qui doit sans doute son nom singulier à la première barque qui y aborda ; c’est dans cette baie, une des plus belles de la Guadeloupe, que commence notre histoire.
Elle est située entre le quartier des Habitants et celui de Bouillante, à peu de distance de la Basse-Terre ; sa plage, formée d’un sable jaune et fin, est terminée par un pourtour de collines élevées, couvertes de cocotiers et de palmistes, étagés en amphithéâtre de la façon la plus pittoresque, et qui lui donnent un aspect ravissant.
Cette baie, assez large, et profonde de plus d’un kilomètre, a une entrée fort étroite défendue par deux batteries dont les feux se croisent, construites sur les pointes Coupard et Duché.
En temps ordinaire, l’anse à la Barque est presque déserte ; une trentaine de pêcheurs à peine s’y abritent tant bien que mal, dans de misérables espèces de huttes d’une architecture essentiellement primitive, faites avec quelques bambous plantés en terre et surmontés d’une toiture en vacois ; mais les jours de fête, et Dieu sait s’ils sont nombreux aux colonies, l’aspect de l’anse à la Barque change comme par enchantement ; elle s’anime, se peuple en quelques heures, et de calme et silencieuse qu’elle était, elle devient tout à coup bruyante et tumultueuse.
C’est dans cette baie que se donnent rendez-vous les noirs, les gens de couleur et les créoles des quartiers limitrophes, pour se divertir, boire et chanter, boire et chanter surtout.
Le jour où s’ouvre notre récit, le 4 mai 1802 ou, ainsi qu’on le disait alors, le 14 floréal an X, vers sept heures du soir, l’anse à la Barque présentait l’aspect le plus pittoresque et le plus animé ; une quarantaine d’ajoupas construits à la hâte et illuminés au moyen de lanternes vénitiennes, suspendues en festons après les arbres, regorgeaient de buveurs appartenant à toutes les teintes de la gamme humaine, depuis le noir d’Afrique jusqu’au blanc d’Europe, en passant par le Métis, le Mulâtre, le Quarteron, le Capre, le Mamalucco, et tant d’autres dont la nomenclature est interminable.
Les rafraîchissements, si tant est qu’on puisse leur donner ce nom, à profusion débités aux consommateurs, se composaient exclusivement de rhum, de tafia, de genièvre et d’eau-de-vie de France ; accompagnée de quelques vieux sirops aigris par l’âge et le climat, et complétés parfois, mais à de longs intervalles, par d’excellentes limonades ; pour être vrai, nous constaterons que seuls les alcools à fortes doses formaient la base des rafraîchissements dont s’abreuvaient les consommateurs altérés, groupés soit dans les ajoupas, soit sous les nombreux bosquets improvisés pour la circonstance ; bosquets mystérieusement éclairés par quelques rares lanternes en papier de couleur.
Ce soir-là, il y avait à l’anse de la Barque un bamboula, en réjouissance des assurances de paix données par le conseil de l’île et affichées à profusion dans toute la colonie ; aussi, malgré l’état d’inquiétude que faisait naître, parmi la population blanche, le provisoire dans lequel le pays était plongé depuis que, par un décret de la Convention, en date du 16 pluviôse an II, les noirs avaient été déclarés libres ; inquiétude qui prenait chaque jours des proportions plus grandes à cause des vexations de toutes sortes dont étaient accablés les habitants paisibles ; ceux-ci, confiants dans les promesses du général Magloire Pélage, homme de couleur et patriote sincère, qui n’avait pas hésité à assumer sur lui seul la lourde responsabilité de mettre un terme à cet état de choses, avaient-ils oublié leurs préoccupations ; et, avec cette insouciante imprévoyance créole dont aucun péril, si grand qu’il fût, ne saurait triompher, ils étaient accourus de toutes parts pour assister au bamboula.
Une foule bigarrée se promenait sur la plage, riant et causant, sans jamais se mêler, chaque caste évitant soigneusement tout contact avec une autre ; seuls les Banians ou petits blancs, ces singuliers colporteurs des colonies, circulaient à travers la foule sans le moindre embarras ; accostant les groupes divers avec un éternel et banal sourire stéréotypé sur les lèvres ; et offrant avec le même entrain et la même politesse leurs marchandises aux Blancs et aux Noirs, aux Capres et aux Mulâtres ; les canonniers et les soldats des deux batteries étaient aussi venus prendre part à la fête ; ils n’étaient pas les moins turbulents.
Devant un ajoupa où trônait majestueusement une magnifique mulâtresse de trente ans au plus, connue sous le nom de maman Mélie, et qui jouissait de la réputation de débiter, sans augmentation de prix, les meilleurs rafraîchissements de l’anse à la Barque, quatre ou cinq bosquets avaient été établis ; deux de ces bosquets étaient occupés ; le premier, par deux noirs de pure race Mozambique, taillés en hercules, au regard louche et à la mine sournoise ; ces noirs, tout en buvant du tafia à pleins verres, causaient entre eux d’une voix basse et contenue, en lançant par intervalles des regards menaçants et chargés de haine vers le second bosquet, sous lequel trois personnes de race blanche étaient assises.
Ces trois personnes devaient appartenir à la plus haute société de la colonie, car un nègre d’un certain âge, porteur d’une bonne figure et vêtu d’une riche livrée, se tenait debout à l’entrée du bosquet, assez loin pour ne pas entendre la conversation de ses maîtres, et assez près pour exécuter à l’instant les ordres qu’il leur plairait de lui donner. En effet, ce digne nègre qui répondait au nom tant soit peu bucolique de Myrthil appartenait à M. le marquis de la Brunerie, l’un des planteurs les plus riches et les plus influents de l’île ; c’était le marquis lui-même qui, en ce moment, se trouvait assis sous le bosquet, en compagnie de sa fille, mademoiselle Renne de la Brunerie et du capitaine Paul de Chatenoy, son parent éloigné, aide de camp du général Sériziat, à la suite duquel il était arrivé quelques semaines auparavant à Marie-Galante, où le général avait provisoirement établi sa résidence.
La famille de la Brunerie, alliée aux Houël, aux Boulogne, aux Raby, aux Boisseret, les plus anciennes maisons de la colonie, celles qu’on nommait les coseigneurs, a toujours tenu un rang élevé et joué un rôle important dans les affaires de la Guadeloupe, depuis l’époque où elle s’y est fixée en 1635, lorsque les Français s’établirent dans l’île après en avoir chassé les Caraïbes.
Dans les premières années du dix-huitième siècle, le marquis de la Brunerie, alors soupçonné d’avoir donné asile sur ses domaines à plusieurs protestants proscrits, accusé en outre, de faire une vive opposition au gouvernement colonial, fut décrété de prise de corps ; mais, prévenu secrètement il eut le temps de mettre ordre à ses affaires et d’éviter en quittent l’île, l’arrestation dont il était menacé ; avant son départ, il avait eu, dit-on, – car toute cette affaire fut toujours enveloppée d’un mystère impénétrable, – la précaution, pour éviter la confiscation, de faire un transport fictif de tous ses biens à son frère cadet.
Que devint le marquis après cette fuite ? On l’ignora toujours. Quelques personnes qui l’avaient beaucoup connu affirmèrent, au commencement de la régence, que, par une nuit sombre et orageuse, une goélette avait jeté l’ancre à l’anse aux Marigots, qu’une embarcation s’était détachée de ce navire et avait mis à terre un passager, qui n’était autre que le marquis de la Brunerie ; que celui-ci s’était enfoncé dans l’intérieur de l’île, se dirigeant vers l’habitation d’Anglemont, alors habitée par son frère, où on l’avait vu entrer, mais dont personne ne l’avait vu sortir ; le lendemain, au lever du soleil, l’anse aux Marigots était déserte, la goélette avait disparu.
Ces bruits, rapidement propagés, causèrent une vive émotion à la Guadeloupe ; une enquête fut faite, sans résultat ; puis les années s’accumulèrent, de graves événements surgirent, cette affaire ténébreuse fut oubliée ; la vie et la mort du marquis restèrent à l’état d’indéchiffrable énigme ; personne ne revendiqua ses biens en son nom ; son frère eu jouit sans être inquiété et les légua en mourant à son fils qui, ainsi que son père l’avait fait, prit le nom et le titre de marquis de la Brunerie, sans que jamais on essayait de les lui contester.
Le marquis de la Brunerie dont nous nous occupons, était le fils de ce la Brunerie ; à l’époque où nous le rencontrons, c’était un homme de soixante ans, encore vert, d’une taille élevée, de manières élégantes et d’une physionomie douce, sympathique et empreinte d’une constante mélancolie ; doué de qualités sérieuses, d’une intelligence développée par l’étude, il faisait partie de cette noblesse éclairée, dans les rangs de laquelle les grands penseurs du dix-huitième siècle avaient recruté de si nombreux et de si ardents adeptes.
En apprenant l’établissement de la République en France, M. de la Brunerie avait, sans regret, fait l’abandon de ses titres pour devenir simple citoyen ; depuis lors, il avait suivi, sans se démentir, la ligne de conduite qu’il s’était tracé ; aussi, loin de déchoir, son influence s’était accrue, et il était considéré comme un des hommes les plus honorables de la Guadeloupe.
Son cousin, le capitaine Paul de Chatenoy, avait vingt-cinq ans ; c’était un beau et fier jeune homme, à l’âme ardente et enthousiaste, passionné pour la carrière qu’il avait embrassée et qui semblait lui promettre un brillant avenir. Il aspirait en secret à la main de sa cousine, union que M. de la Brunerie aurait vue peut-être avec plaisir, mais dont la jeune fille paraissait ne se soucier que médiocrement.
Renée de la Brunerie, âgée de dix-sept ans, était belle de cette excentrique beauté créole à laquelle aucune autre ne saurait être comparée. Nonchalamment assise comme elle l’était en ce moment, sous ce bosquet verdoyant que tachetaient çà et là des jasmins d’Espagne, au milieu de ce cadre vert et embaumé, irisé par la lumière des lanternes de lueurs changeantes et fugitives, le buste légèrement penché en arrière, ses grands yeux bleus aux regards rêveurs, errants à l’aventure et sans but, avec des flots de cheveux noirs tombant sur ses blanches épaules, son front pure transparent comme de la nacre, elle ressemblait, dans la demi-obscurité du feuillage, à l’une de ces pâles apparitions créées par le génie poétique d’Ossian.
La jeune fille ne prenait aucune part à la conversation, elle ne l’entendait même pas, elle rêvait.
Cependant cette conversation était très animée et surtout fort intéressante : M. de la Brunerie et de Chatenoy causaient politique.
Le planteur s’étonnait à bon droit que le général Sériziat, au lieu de se rendre directement à la Guadeloupe, ainsi qu’il en avait reçu l’ordre du premier consul à son départ de France, eût prêté l’oreille aux calomnies de l’ex-capitaine général Lacrosse, cet homme que sa tyrannie et ses concussions avaient rendu odieux aux habitants, et que le général Pélage, pour lui sauver la vie, s’était vu contraint d’arrêter et de chasser de la colonie ; que, cédant aux insinuations de cet homme méprisé de tous, et qui s’était réfugié à la Dominique sous la protection anglaise, le général Sériziat eût noué des relations avec lui, au point de l’aller visiter au milieu du camp volant que, depuis quelques semaines, cet homme avait eu l’audace d’établir aux Saintes, sans doute dans le but de tenter un débarquement à la Guadeloupe, et de replonger le pays dans l’anarchie, en excitant la guerre civile.
Le capitaine, fort peu diplomate de sa nature et très embarrassé pour répondre, essayait d’éluder, autant que possible, les questions pressantes que lui adressait le planteur ; n’ayant à donner que des raisons spécieuses, il se bornait à dire que le général Sériziat, ignorant complètement les faits qui, depuis dix ans, s’étaient passés dans la colonie, craignait de se compromettre avec les partis ; qu’il temporisait en attendant l’arrivée prochaine de l’expédition partie de France sous les ordres du général Richepance, qu’il considérait comme son chef immédiat et dont, par une initiative maladroite, il ne voulait pas faire manquer les plans.
Pendant que M. de la Brunerie et le capitaine causaient ainsi, dans le bosquet voisin, les deux nègres dont nous avons parlé plus haut, avaient entre eux une conversation sur un sujet complètement différent, mais qui ne laissait pas que de les intéresser vivement.
Ces nègres étaient sans nul doute des Marrons ; tout en eux, leurs vêtements, leurs manières, l’inquiétude qui, parfois, éclatait dans leurs regards fureteurs, le décelait clairement ; il fallait que ces hommes fussent doués d’une extrême audace, ou que des motifs d’une haute gravité réclamassent leur présence en ce lieu, pour qu’ils eussent osé se risquer, un soir de bamboula, à l’anse à la Barque, au milieu de tant de gens dont la plupart les connaissaient et pouvaient, même sans mauvaise intention, les perdre en trahissant leur incognito.
Le lecteur sera sans doute surpris de nous voir mettre en scène des nègres marron, c’est-à-dire des esclaves en état de rébellion, dans un pays où, avons-nous dit, la liberté des hommes de couleur avait été proclamée.
Cette surprise cessera sans doute lorsque nous aurons dit que le décret de la Convention, bien que promulgué à la Guadeloupe par le représentant Hugues, resta presque à l’état de lettre morte dans la colonie ; trop d’intérêts étaient en jeu pour qu’il fut exécuté.
Après le départ du représentant de la Convention nationale, les colons, guidés par une cupidité odieuse et aidés par des gouverneurs qui se firent leurs complices, rétablirent, sinon de droit, du moins de fait, l’esclavage des nègres. La plus grande partie des noirs et des mulâtres ne voulurent pas se soumettre aux exigences illégales du gouvernement colonial ; ils se jetèrent dans les mornes et furent malgré le décret d’émancipation considérés comme marrons ou révoltés. Des troubles naquirent de cet état de choses ; ils s’augmentèrent des menées des anglais et prirent une forme très menaçante après le décret déplorable du premier consul ; décret rétablissant légalement l’esclavage.
Les expéditions de Saint-Domingue et de la Guadeloupe n’eurent en réalité d’autre but que l’exécution de ce décret, à la fois inique et impolitique et qui fit tant de mal à la France.
– Allons, Saturne, mon ami, dit l’un des noirs à l’autre, en lui versant du tafia, bois un coup, cela te remettra ; jamais je ne t’ai vu aussi triste.
– Ah ! massa Pierrot, répondit mélancoliquement Saturne en vidant son verre d’un trait ; j’ai le cœur malade.
– Tu n’es qu’un poltron ; de quoi as-tu peur ?
– Je n’ai pas peur pour moi, massa Pierrot.
– Pour qui donc alors ?
– Pour massa Télémaque ; je crains qu’il ne lui soit arrivé malheur.
– Saturne, mon ami, tu es un niais ; massa Télémaque est le bras droit du capitaine Ignace, il ne peut rien lui arriver.
– C’est possible ; pourtant...
– Tais-toi ! interrompit brusquement son camarade ; c’est moi qui t’ai recommandé à massa Télémaque ; je lui ai répondu de toi ; tu sais pourquoi nous sommes ici ; fais attention à ne pas faiblir quand le moment d’agir sera venu, sinon je te promets que je saurai te punir.
– Je ferai mon devoir, massa Pierrot ; ne craignez rien de moi.
– C’est bon, tu es averti ; nous verrons cela. À ta santé !
Et ils burent.
Au moment où Pierrot se versait une nouvelle rasade, une ombre se dessina à rentrée du bosquet, ombre massive et gigantesque, et un homme pénétra sous le feuillage, après avoir écrasé d’un vigoureux coup de poing les deux lanternes en papier qui éclairaient tant bien que mal l’intérieur du bosquet.
– Sacrebleu ! êtes-vous fous ? grommela-t-il d’un ton de mauvaise humeur, en se laissant tomber plutôt qu’il ne s’assit sur un siège.
– Massa Télémaque ! s’écrièrent les deux noirs.
– Silence ! brutes que vous êtes, reprit-il ; ce lieu est-il propice pour crier ainsi mon nom ! Pourquoi avez-vous laissé ces deux lanternes allumées ?
– Mais, massa... murmura Pierrot.
Télémaque ne lui donna pas le temps d’achever la phrase sans doute assez embrouillée qu’il commençait.
– Afin qu’on vous reconnaisse plus facilement, n’est-ce pas, idiots que vous êtes ? interrompit-il en haussant les épaules avec mépris.
Les nègres baissèrent humblement la tête sans répondre.
Ce Télémaque était un mulâtre gigantesque, taillé en athlète, aux traits repoussants et aux regards fauves ; il portait clairement le mot : Potence, écrit sur son front déprimé comme celui d’un félin.
Après avoir bu une large rasade de tafia, il reprit :
– Est-elle là ?
– Oui, massa, répondit vivement Pierrot.
– Seule !
– Non ; vous pouvez l’apercevoir d’ici ; elle est accompagnée de son père et de son cousin de France, l’aide de camp du général Sériziat.
– Tant mieux, murmura Télémaque d’une voix sourde.
Il y eut un instant de silence pendant lequel les trois hommes remplirent et vidèrent d’autres verres à plusieurs reprises ; Télémaque jetait autour de lui des regards inquiets et fureteurs.
Après une légère hésitation, le mulâtre se pencha en avant, et poussa un cri doux et modulé, ressemblant à s’y méprendre à celui du courlis, cri que deux fois il répéta à un court intervalle.
Quelques minutes s’étaient à peine écoulées, lorsque maman Mélie se glissa silencieusement sous le bosquet ; la mulâtresse tremblait, son visage avait cette teinte d’un gris terreux qui est la pâleur des nègres ; elle tenait par contenance une bouteille de tafia de chaque main. Après les avoir posées sur la table, elle se tint immobile devant Télémaque, qui fixait sur elle son regard lançant des lueurs fauves.
Il fallait que le mulâtre possédât sur cette femme une puissance occulte bien grande, pour la contraindre ainsi à tout abandonner pour accourir à son premier signal et se mettre à ses ordres, elle si dédaigneuse et si hautaine d’ordinaire, même envers les personnes qu’elle avait intérêt à ménager.
– Eh ! eh ! te voilà, dit enfin Télémaque en ricanant. Bonsoir, maman Mélie.
– Bonsoir, répondit-elle brusquement ; que me voulez-vous, missa Télémaque ? Parlez vite, je suis pressée.
– Nous le sommes tous ; reprit-il sur le même ton. Je suis ici de la part du capitaine Ignace.
– Je le sais, il m’a prévenue hier.
– C’est bien. Es-tu décidée à lui obéir ?
La mulâtresse frissonna et baissa la tête sans répondre.
– Es-tu décidée à obéir aux ordres que tu as reçus ? reprit durement le mulâtre.
– Pourquoi le capitaine Ignace veut-il tuer mamzelle ? murmura Mélie avec hésitation.
– Que t’importe ! Ce ne sont pas tes affaires.
– Mamzelle Renée est bonne pour les pauvres gens de couleur, insista la mulâtresse d’une voix insinuante ; elle leur fait beaucoup de bien ; le capitaine Ignace ne la connaît pas ; il ne peut vouloir sa mort.
– Tu as tort et raison à la fois, maman Mélie, répondit le mulâtre avec un rire féroce ; il ne connaît pas mamzelle Renée, cependant il veut qu’elle meure.
– Pourquoi la tuer ?
– Je pourrais ne pas répondre à cette question, mais ce soir je me sens de bonne humeur et je consens à te satisfaire ; écoute-moi et fais ton profit de mes paroles : L’Œil Gris, le vieux Chasseur de rats... tu le connais, celui-là, n’est-ce pas ?
– L’Œil Gris est un méchant obi, il est l’ennemi des noirs, répondit la mulâtresse en frissonnant ; il tue sans pitié les pauvres marrons qu’il poursuit dans les mornes comme des bêtes sauvages ; le Chasseur de rats possède un grigri qui le rend invulnérable ; les balles s’aplatissent sur son corps ; les sabres et les poignards se brisent en le touchant ; tous les hommes de couleur le détestent.
– C’est cela même, dit le mulâtre d’une voix sourde ; vingt fois le capitaine Ignace a tenté de le tuer, vingt fois il a échoué ; le grigri du Chasseur de rats a été plus puissant que celui du capitaine ; voyant cela, Ignace se fit faire un Quienbois, par la sorcière de la Pointe-noire ; alors il apprit que la vie du vieux Chasseur était attachée à celle de mamzelle Renée, parce qu’il l’aime comme si elle était sa fille, et qu’en tuant l’enfant du planteur, l’Œil Gris mourrait aussitôt. Me comprends-tu ?
– Oui, je vous comprends, répondit-elle en hochant tristement la tête ; mais c’est bien cruel de tuer une si bonne et si belle mamzelle.
– Il le faut ; d’ailleurs, c’est une blanche.
– C’est vrai, pauvre enfant, sa peau est blanche, mais son cœur est semblable aux nôtres.
– Qu’importe cela ! Obéiras-tu ? Songe que le capitaine Ignace peut t’y contraindre.
– Il est inutile de menacer, répondit maman Mélie avec un frisson d’épouvante. J’obéirai.
– Quand cela ?
– Avant une heure, elle sera morte.
– Prends garde de te jouer de moi !
– J’obéirai, reprit-elle d’une voix nerveuse.
– Va ! J’attendrai ici l’accomplissement de ta promesse.
La mulâtresse fit un geste de désespoir et elle disparut.
– À boire ! dit le mulâtre en tendant son verre à Saturne qui le remplit ; bientôt nous saurons si ce démon de Chasseur est véritablement invulnérable.
– Nous n’avons qu’une heure à attendre, dit Pierrot d’un air câlin, ce n’est rien.
– J’espère que cette fois nous réussirons, reprit le mulâtre ; j’ai bon espoir ; cet homme, qui toujours, jusqu’à présent, était, on ne sait comment, averti des embuscades que nous lui tendions, on ne l’a pas aperçu depuis hier ; personne ne l’a vu ; donc, il ne sait rien, sans cela il serait ici.
– C’est positif, ponctua Pierrot.
– Silence ! s’écria tout à coup Saturne.
– Pourquoi silence ?
– Regardez ! le voilà ! reprit le noir en étendant le bras dans la direction de la plage.
– L’œil Gris... ! murmurèrent les deux hommes avec une indicible épouvante.
Par un mouvement instinctif, dominés par la terreur superstitieuse que leur inspirait cet homme étrange, ils se blottirent en tremblant au fond du bosquet et demeurèrent immobiles dans les ténèbres, effarés et respirant à peine.
L’Œil Gris étant, sinon le principal, mais tout au moins un des plus importants personnages de cette histoire, il est indispensable de le bien faire connaître au lecteur. Dix ans environ avant l’époque où commence notre récit, le trois-mâts de Nantes, l’Aimable-Sophie, arriva à la Basse-Terre, venant de Québec. Au nombre de ses passagers, il se trouvait un homme qui, pendant toute la traversée, avait été un problème insoluble pour l’équipage et pour le capitaine lui même.
Cet homme connu seulement sous le nom de L’Œil Gris, avait soldé d’avance son passage en onces mexicaines ; de plus, il avait été chaudement recommandé au capitaine par un des principaux négociants de Québec ; il était donc parfaitement en règle de toutes les façons ; il n’y avait pas la moindre observation à lui adresser.
Quant aux curieux qui avait tenté de l’interroger, il les avait si vertement reçus au premier mot qu’ils avaient hasardé, que tout de suite l’envie leur était passée de continuer ou même de lier connaissance avec lui.
C’était d’ailleurs un homme sociable, ne se plaignant jamais de rien ; passant des journées entières à se promener de long en large sur le pont, sans parler à personne, et dont la seule distraction consistait à tirer au vol, sans jamais les manquer, les frégates, les damiers ou les alcyons assez imprudents pour se risquer trop près du navire.
L’inconnu avait, ou du moins paraissait avoir soixante ans ; peut-être était-il plus âgé ; peut-être l’était-il moins ; nul n’aurait pu dire au juste son âge.
C’était un grand vieillard de près de six pieds, d’une verdeur, d’une agilité et d’une vigueur extraordinaires ; sa maigreur brune et osseuse laissait presque à nu le jeu actif et passionné de ses muscles. Ce qui frappait dans son étrange physionomie, c’était un type fort prononcé dont le galbe mince, effilé, saillant, tenait quelque chose de l’Arabe, bien que sa peau, tannée par le froid, le chaud, le vent, la pluie et le soleil, eut la couleur de la brique ; la rudesse pénétrante de ses yeux presque ronds, ardents et mobiles, dont le disque était un charbon et le regard une effluve magnétique ; sa barbe d’un blond fauve, semée de quelques fils d’argent, tombait en éventail sur sa poitrine. Il avait le front large, pur et échancré ; à la moindre émotion, au plus léger pli qui se formait sur ce front si lisse d’ordinaire, ses longs cheveux fauves avaient la singulière propriété de se hérisser, et alors cette figure extraordinaire prenait une ressemblance frappante avec celle de l’aigle.
Le costume de cet homme était aussi bizarre que l’était sa personne.
Il se composait d’un vêtement entier, veste, culotte et guêtres montant sur le genou, le tout en peau de daim à demi tannée ; il couvrait sa tête avec bonnet en peau de renard dont la queue lui pendait par derrière jusqu’au milieu du dos ; une large ceinture, en cuir comme le reste de son costume, lui serrait étroitement les hanches et soutenait, à droite, un sac à balles et une poire à poudre faite d’une corne de buffle, à gauche, un couteau de chasse à lame large et effilée, et une hache.
Ainsi vêtu, chaussé d’épais souliers en cuir fauve, et tenant à la main un long fusil de boucanier, cet homme avait un aspect imposant qui attirait la sympathie ; on sentait qu’il y avait dans cette nature rebelle quelque chose de fort et de puissant qui devait être respecté.
À peine le trois-mâts l’Aimable Sophie eut-il laissé tomber son ancre dans la rade de la Basse-Terre, que le passager se fit mettre à terre, traversa la ville sans s’y arrêter et s’enfonça le fusil sur l’épaule dans les mornes.
Plusieurs mois s’écoulèrent sans qu’on entendit parler de lui ; il chassait, non pas la grosse bête ni le fauve, la Guadeloupe ne possède et n’a jamais possédé aucun animal nuisible ; or, cet homme, véritable chasseur et Chasseur canadien qui plus est, c’est-à-dire accoutumé à lutter corps à corps avec les ours, et à combattre les animaux les plus redoutables, devait mener une existence assez insipide dans cette île, où, pour lui, la chasse était réduite à sa plus simple expression.
Il paraît qu’il comprit bientôt ce que cette position avait de précaire ; avec cette rapidité de conception qui était un des côtés saillants de son caractère, il résolut de modifier complètement sa manière de vivre et de tirer parti au point de vue de l’intérêt général de ses qualités de chasseur ; cette résolution prise, il l’exécuta immédiatement de la façon suivante.
Nous avons dit que la Guadeloupe ne possède pas d’animaux nuisibles ; nous nous sommes trompés : elle possède des rats énormes apportés par les navires ; ces rongeurs sont de véritable plaie pour le pays ; ils dévorent tout ; un champ de cannes à sucre ou de café dans lequel ils se mettent est perdu pour son propriétaire ; en moins de quelques jours tout est ravagé ; leurs dommages sont immenses ; aussi les planteurs se sont ils entendus pour payer une prime considérable aux gens assez avisés pour les délivrer de ces hôtes incommodes.
Notre personnage fit venir, on ne sut jamais d’où, deux couples de ces chiens que l’on nomme aujourd’hui ratiers ; il les dressa en conséquence et se fit chasseur de rats ; il parcourut alors les plantations, suivi, sur les talons, par une demi-douzaine de chiens microscopiques aux oreilles droites, au flair infaillible, à l’œil de feu, aux jarrets de fer et aux muscles d’acier, avec lesquels il fit aux rats une guerre implacable, d’où vint le nom de Chasseur de rats qui fut immédiatement ajouté à celui d’Œil Gris, sous lequel il était déjà connu.
Mais cette occupation, si lucrative, qu’elle fut, ne suffisait pas pour satisfaire l’ardente activité de ce singulier personnage ; il lui fallait employer son fusil, devenu pour lui un meuble presque inutile.
À cette époque, la Guadeloupe, en proie à la guerre civile, suite au soulèvement des noirs, pullulait de nègres marrons, d’autant plus redoutables qu’ils s’étaient réfugiés dans des mornes inaccessibles, du haut desquels, comme un vol de vautours, ils s’abattaient sur les habitations et les livraient au pillage.
Les fauves que depuis si longtemps l’Œil Gris cherchait vainement, il les avait enfin trouvés ; il dressa ses ratiers à dépister les nègres rebelles, et il se fit résolument chasseur, non plus seulement de rats cette fois, mais de marrons.
Cette chasse incessante à l’homme qu’il avait ajouté à son commerce eut pour résultat de lui faire connaître l’île et les mornes comme s’il y fût né.
Les esclaves fugitifs ne trouvaient plus de retraites assez sûres pour se soustraire aux poursuites de leur implacable ennemi ; celui-ci les relançait jusque dans les mornes ignorés où pendant si longtemps ils avaient joui de la plus complète impunité.
Les fugitifs, ainsi harcelés, jurèrent une haine noire à l’homme qui s’était donné la tâche de les détruire.
Le Chasseur eut alors une lutte terrible à soutenir ; s’il échappa à la mort, ce ne fut que par des miracles d’adresse, d’astuce et de courage ; maintes fois il faillit succomber sous les coups de ces malheureux, réduits au désespoir, car toujours il chassait seul, sans autres auxiliaires que ses ratiers qui ne pouvaient le défendre sérieusement.
Un jour, cependant, sa fortune habituelle sembla l’abandonner. Attaqué à l’improviste par une dizaine de nègres marrons, malgré des prodiges de valeur et après une lutte qui avait pris des proportions épiques, accablé sous le nombre, il tomba ; ses ennemis, acharnés après lui, se préparaient à lui couper la tête, pour être bien certains de l’avoir tué, lorsqu’un bruit soudain les obligea, à leur grand regret, à gagner au pied et à prendre la fuite.
À peine eurent-ils disparu dans les méandres de la route qu’une jeune fille ou plutôt une enfant de neuf, dix ans, montée sur un charmant poney et accompagnée de plusieurs serviteurs noirs, se montra à l’angle du chemin.
Cette jeune enfant était Renée de la Brunerie.
En apercevant ce corps étendu à travers du sentier qu’elle suivait, et perdant son sang par vingt blessures, la jeune fille se sentit prise d’une immense pitié ; d’ailleurs, elle connaissait le Chasseur pour l’avoir vu venir plusieurs fois à l’habitation, où il ne faisait, du reste, que de rares apparitions et seulement lorsqu’il y était mandé ; il paraissait éprouver, on ne savait pourquoi, une répulsion invincible pour la famille de la Brunerie. Renée ne songea à rien de tout cela ; elle vit un homme en danger de mort, et, sans hésiter, elle résolut de le sauver.
Le Chasseur fut transporté à l’habitation ; là, les soins les plus attentifs lui furent prodigués.
Renée, malgré sa jeunesse, ne se fia à personne du soin de veiller sur le blessé ; elle le soigna avec une abnégation et un dévouement extraordinaires, ne le quittant ni jour, ni nuit ; constamment attentive à ce qu’il ne manquât de rien.
Le marquis de la Brunerie voyait avec joie la conduite de sa fille, le soin avec lequel elle surveillait son blessé, ainsi qu’elle le nommait ; il était fier de lui reconnaître, dans un âge aussi tendre, des sentiments aussi nobles et aussi élevés ; il la laissa donc libre d’agir à sa guise.
Le blessé guérit, grâce aux soins de sa jeune garde-malade.
Alors commença entre le vieillard et l’enfant une de ces intimités dont rien ne saurait exprimer la douceur ; toute de tendresse de la part de l’enfant, toute de dévouement de celle du vieillard, naïve et profonde des deux côtés.
Le Chasseur, tout en continuant à rester, pour les autres membres de la famille de la Brunerie, brusque, brutal et presque hostile à l’occasion, devint pour Renée presque un père ; s’ingéniant sans cesse à lui apporter les plumes les plus rares, les fleurs les plus belles ; tous ces riens, enfin, qui plaisent tant aux enfants.
Deux ans plus tard, la jeune fille tomba gravement malade, un instant on désespéra de sa vie ; cette fois le Chasseur paya amplement la dette qu’il avait contractée, en devenant à son tour, le sauveur de celle qui l’avait sauvé.
La douleur du vieillard fut immense lorsque l’époque arriva où, selon la coutume contractée aux colonies, Renée dut se rendre en France pour y terminer son éducation, et qu’il fut contraint de se séparer d’elle.
Pendant tout le temps que dura l’absence de la jeune fille, le Chasseur ne parut pas une seule fois à la plantation ; il ne faisait plus rien qui vaille ; son existence s’écoulait triste et décolorée ; il vivait à l’aventure, pour ne pas mourir ; il voulait la revoir !
Lorsque le retour prochain de Renée de la Brunerie fut annoncé, il surveilla attentivement les navires qui apparaissaient dans les atterrissages de la Guadeloupe.
Lorsqu’elle débarqua à la Basse-Terre, la première personne sur laquelle se reposa son regard fut le Chasseur qui, retiré un peu à l’écart, appuyé sur son long fusil, la contemplait d’un air attendri, s’émerveillant de la revoir si belle.
Il recommença alors à fréquenter l’habitation de la Brunerie ; Renée était revenue.
C’était bien le Chasseur que les trois nègres marrons avaient aperçu ; il n’y avait pas le moindre doute à avoir sur son identité.
Le Chasseur, suivi pas à pas par ses ratiers, marchait doucement, le fusil sous le bras, le front pensif, et ne semblant accorder, tant il se concentrait en lui-même, qu’une très médiocre attention à ce qui se passait autour de lui.
Il traversait insoucieusement les groupes qui s’ouvraient, soit par crainte, soit par respect, pour lui livrer passage.
Il arriva ainsi devant le bosquet au fond duquel les marrons étaient réfugiés, presque évanouis de terreur.
Les ratiers, moins préoccupés que leur maître, tombèrent aussitôt en arrêt en grondant sourdement.
Les nègres se crurent perdus.
Mais, en ce moment, soit hasard, soit tout autre mot, le Chasseur releva la tête et, à quelques pas de lui seulement, il aperçut Renée de la Brunerie.
Son front soucieux s’éclaircit subitement, un doux sourire entrouvrit ses lèvres ; il pressa le pas et se dirigea droit au bosquet où se trouvait la jeune fille.
Les chiens, voyant leur maître s’éloigner, se résignèrent à le suivre ; mais ce ne fut qu’après avoir longtemps hésité qu’ils levèrent enfin leur arrêt.
Cette fois les nègres étaient sauvés, ou, du moins, ils le supposaient.
II
Comment fut interrompu le bamboula de l’Anse à la Barque et ce qui en advint.
Le Chasseur de rats, après avoir passé devant les trois redoutables conspirateurs, sans même soupçonner leur présence, continua paisiblement sa route, et s’arrêta à l’entrée du bosquet sous lequel étaient assis les membres de la famille de la Brunerie.
Comme si un secret pressentiment eût averti la jeune fille de la présence de son ami, soudain elle tressaillit et tourna la tête de son côté.
– Bonsoir, père, lui dit-elle d’une voix caressante, je vous attendais.
– Et moi je vous cherchais, répondit-il avec intention. Bonsoir, mademoiselle Renée.
Et il pénétra sous le bosquet.
Un trait de flamme jaillit à travers les longues prunelles de la jeune fille, elle reprit avec émotion en lui désignant un siège :
– Asseyez-vous là, près de moi, vous avez bien tardé ?
– Vous voilà, Chasseur, lui dit amicalement M. de la Brunerie en lui tendant la main. Soyez le bienvenu.
– Avez-vous appris quelque chose ? ajouta le capitaine de Chatenoy en imitant le mouvement du planteur.
– Je le crois, répondit le vieillard avec un sourire énigmatique. Votre serviteur, messieurs.
Il porta la main à son bonnet d’un air cérémonieux, sans paraître remarquer le geste affectueux des deux hommes, et il s’assit sur le siège que la jeune fille lui avait indiqué à son côté.
– Vous vous faites toujours pour nous un messager de bonnes nouvelles, lui dit Renée, qui prenait plaisir à l’entendre causer.
– Dieu veuille que jamais je ne vous en apporte de mauvaises, chère demoiselle !
– Vous avez donc appris quelque chose ?
– Je ne sais pourquoi, mais j’ai presque la certitude que vous me remercierez de ce que, ce soir, je vous annoncerai.
– Moi ?... père... fit Renée toute surprise.
– Peut-être, mon enfant. N’êtes-vous pas un peu curieuse de savoir pour quelle raison, depuis deux jours, je ne vous ai pas fait ma visite habituelle à la plantation ?
– Oui, père, très curieuse et surtout très colère contre vous ; parlez tout de suite.
– Patience, chère petite, bientôt vous serez satisfaite.
Dans la famille de la Brunerie, tout le monde était accoutumé depuis longtemps, et M. de la Brunerie lui-même, à entendre le vieux Chasseur et la jeune fille se parler sur ce ton ; personne ne songeait à se formaliser d’une familiarité que, de la part de tout autre que le vieux Chasseur, le planteur aurait sévèrement réprimée ; d’ailleurs, la volonté de mademoiselle Renée de la Brunerie était une loi suprême devant laquelle grands et petits s’inclinaient avec respect, sans même la discuter ; et puis, tout le monde, dans la famille, aimait cet homme si simple et si réellement bon sous sa rude écorce.
– De quoi s’agit-il donc ! Vous me semblez ce soir tout confit en mystères, mon vieil ami ? demanda M. de la Brunerie avec un certain intérêt.
Le Chasseur promena un regard interrogateur autour de lui, comme pour s’assurer qu’aucun espion n’était embusqué sous le feuillage, et baissant la voix, en se penchant vers ses interlocuteurs :
– N’attendez-vous pas des nouvelles de France ? dit-il.
– Oh ! oui ! s’écria involontairement la jeune fille ; et, presque aussitôt, elle baissa la tête en rougissant, honteuse sans doute de s’être laissée emporter, malgré elle, à prononcer une imprudente parole.
Mais l’attention des deux hommes était trop éveillée pour qu’ils remarquassent cette exclamation partie du cœur ; elle passa inaperçue.
– Eh bien, reprit mystérieusement le Chasseur, je vous en apporte, et des plus fraîches encore.
– De France ? demanda l’officier en souriant.
– Pas tout à fait, capitaine ; de la Pointe-à-Pitre, seulement.
– Ah ! ah ! fit le planteur dont les sourcils se froncèrent imperceptiblement. Que se passe-t-il donc là ?
– À la Pointe-à-Pitre, rien d’extraordinaire, monsieur ; mais en mer beaucoup de choses pour ceux qui ont de bons yeux ; et grâce à Dieu, malgré mon âge, les miens ne sont pas encore trop mauvais.
– Il y a des bâtiments en vue ? s’écrièrent les trois personnes avec une surprise mêlée de joie.
– Silence ! dit le Chasseur en jetant un regard anxieux autour de lui, songez où nous sommes.
– C’est juste, répondit le planteur ; ces bâtiments sont nombreux ?
– Oui, j’en ai compté dix.
– Dix !
– Tout autant ; deux vaisseaux, quatre frégates, une flûte et trois transports.
– Alors, s’il en est ainsi, s’écria vivement le planteur, il ne saurait y avoir le moindre doute ; c’est l’expédition que nous a annoncée le général Sériziat et que nous attendons depuis si longtemps.
– Plus bas, monsieur, je vous le répète, il y a des oreilles ouvertes sous ces charmilles ; nous ne savons qui peut nous entendre, dit le Chasseur en posant un doigt sur ses lèvres.
– Vous avez raison, reprit M. de la Brunerie ; mais cette nouvelle m’a tellement troublé, que je ne sais plus ce que je fais ni ce que je dis.
– Il faudrait s’assurer si ces navires font réellement partie de l’expédition, observa le capitaine.
– C’est ce que j’ai fait, capitaine, répondit son interlocuteur ; je suis monté dans une pirogue, et je me suis rendu à bord du vaisseau le Redoutable ; un bâtiment magnifique portant le guidon de vice-amiral à son mât de misaine ; là j’ai appris tout ce que je désirais savoir.
La jeune fille ne dit rien ; elle regarda le Chasseur. Celui-ci souriait ; elle sentit un rayon de joie inonder son cœur, et ses yeux se levèrent vers le ciel, comme pour de muettes actions de grâces.
– Parlez, vieux Chasseur, s’écria impétueusement le planteur.
– Attendez, fit le capitaine.
– Que voulez-vous donc, mon cousin ?
– Pardieu ! fit gaiement l’officier, trinquer avec le messager de la bonne nouvelle.
Il fit un signe au valet toujours immobile à l’entrée du bosquet ; le noir s’éloigna aussitôt.
Vous ne serez donc jamais sérieux ? dit le planteur en haussant les épaules.
– Ainsi vous vous êtes rendu à bord du vaisseau le Redoutable ? ajoute-t-il.
– Oui, monsieur ; je me suis ainsi assuré que ces navires composent en effet l’escadre sur laquelle est embarquée l’expédition attendue depuis si longtemps ; cette escadre est commandée par le vice-amiral Bouvet ; elle porte trois mille quatre cent soixante-dix hommes de troupes de débarquement.
– Savez-vous par quels officiers supérieurs sont commandées ces troupes ?
– Je m’en suis informé, mais je ne sais si je me souviendrai bien exactement des noms de ces officiers, répondit le Chasseur de rats, en jetant à la dérobée un regard sur la jeune fille.
Celle-ci fixait sur lui ses grands yeux bleus avec une expression poignante.
– Le commandant en chef de l’expédition est le général Antoine Richepance, un excellent militaire, à ce que tout le monde s’accorde à dire, reprit-il.
– Ah ! murmura faiblement Renée en portant la main à son cœur et semblant sur le point de défaillir.
Mais personne ne remarqua ni ce cri, ni ce mouvement, excepté peut-être le Chasseur.
Il continua.
– Ce général, bien que très jeune, à peine a-t-il trente-deux ans, a déjà de remarquables états de service ; sous les ordres de Hoche et Moreau, il a fait plusieurs actions d’éclat.
– J’en ai souvent entendu parler avec de grands éloges, dit le capitaine. Qui vient ensuite ?
– Un de vos parents, je crois, monsieur, le général de brigade Gobert.
– En effet, s’écria le planteur, et un digne fils de notre pays ; je l’ai connu tout jeune avant la Révolution ; je serais heureux de le revoir.
– Oh ! oui ! murmura la jeune fille comme pour dire quelque chose.
Mais ses pensées volaient éperdues car les ailes séduisantes de ses rêves de dix-sept ans.
– Les autres officiers supérieurs, reprit le Chasseur de rats, sont : le général de brigade Du Moutier et l’adjudant commandant, chef d’état-major Ménard. Vous seuls à la Guadeloupe, messieurs, connaissez cette importante nouvelle ; l’escadre louvoie bord sur bord en vue de l’île, elle ne mouillera pas avant deux jours à la Pointe-à-Pitre, c’est-à-dire avant le 16 floréal.
– Quels motifs donne-t-on à ce retard ? demanda le capitaine.
– Je n’ai rien pu découvrir à ce sujet.
– Il faut, sans perdre un instant, courir à la Basse-Terre, s’écria vivement le capitaine.
– Oui, c’est ce que nous devrons faire, malheureusement nous ne le pouvons pas, répondit le planteur avec dépit ; nous sommes obligés de retourner d’abord à l’habitation.
– Pourquoi donc cela, monsieur ? demanda le Chasseur.
– Par une raison fort simple : nos chevaux ne nous seront pas envoyés avant minuit.
– J’ai supposé cela, monsieur ; aussi en me rendant ici, comme c’était à peu près mon chemin, je suis passé par la Brunerie et j’ai, de votre part, donné l’ordre à M. David, votre commandeur, de vous expédier immédiatement dix chevaux. Avant une demi-heure, une heure au plus, ils seront ici.
– Pardieu ! s’écria le planteur avec joie, vous êtes un homme précieux, vous songez à tout.
– J’y tâche, monsieur, surtout lorsque j’espère pouvoir vous être utile, ajouta le Chasseur en regardant la jeune fille qui lui souriait doucement.
En ce moment éclata à l’improviste un épouvantable charivari mêlé de chants, de cris, de rires et d’appels joyeux, la conversation fut forcément interrompue. C’était le bamboula qui commençait.
– Allons faire un tour sur la plage en attendant les chevaux, dit le capitaine.
– Soit, allons, répondit M. de la Brunerie.
Les deux hommes se levèrent.
La jeune fille fit un mouvement pour les imiter, mais, sur un signe du Chasseur, elle se laissa retomber sur sa chaise.
– Tu ne viens pas te promener avec nous, mignonne ? lui demanda son père.
– Non ; si vous me le permettez, cher père, je préfère rester ici ; la chaleur est accablante. Je me sens un peu fatiguée, ajouta-t-elle en rougissant légèrement.