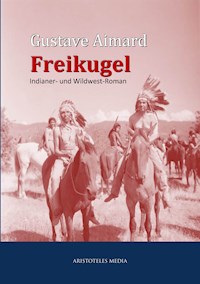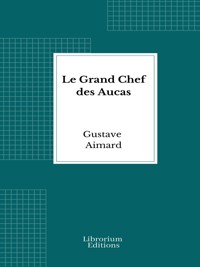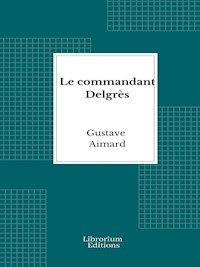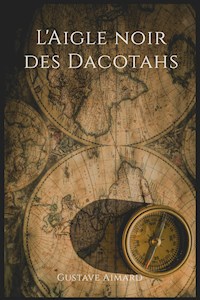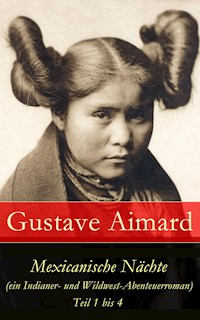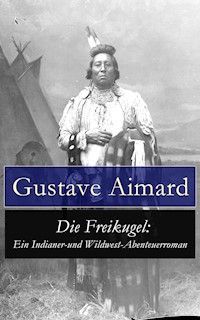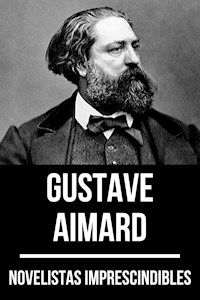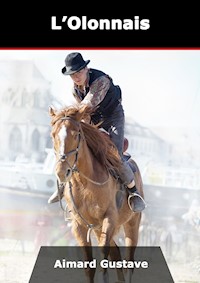0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Au Mexique, la population n’est divisée qu’en deux classes : la classe élevée et la classe inférieure ; il n’y a pas de rang intermédiaire pour lier les deux extrêmes ; aussi la cause des deux cent trente-neuf révolutions qui, depuis la déclaration de l’indépendance, ont bouleversé ce pays, est-elle facile à comprendre ; la puissance intellectuelle se trouve entre les mains d’un petit nombre, et c’est par cette minorité remuante et ambitieuse que s’effectuent toutes les révolutions ; d’où il résulte que le pays est gouverné par le despotisme militaire le plus complet, au lieu d’être une république libre.
Cependant les habitants des États de Sonora, de Chihuahua et du Texas ont conservé encore aujourd’hui cette physionomie sévère, sauvage, énergique que l’on chercherait vainement dans les autres États de la confédération.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Gustave Aimard
Le chercheur de pistes
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782383837015
Première partie
Le Cèdre-Rouge
I
La forêt vierge
Au Mexique, la population n’est divisée qu’en deux classes : la classe élevée et la classe inférieure ; il n’y a pas de rang intermédiaire pour lier les deux extrêmes ; aussi la cause des deux cent trente-neuf révolutions qui, depuis la déclaration de l’indépendance, ont bouleversé ce pays, est-elle facile à comprendre ; la puissance intellectuelle se trouve entre les mains d’un petit nombre, et c’est par cette minorité remuante et ambitieuse que s’effectuent toutes les révolutions ; d’où il résulte que le pays est gouverné par le despotisme militaire le plus complet, au lieu d’être une république libre.
Cependant les habitants des États de Sonora, de Chihuahua et du Texas ont conservé encore aujourd’hui cette physionomie sévère, sauvage, énergique que l’on chercherait vainement dans les autres États de la confédération.
Sous un ciel plus froid que celui de Mexico, l’hiver, qui couvre souvent les rivières de ces régions d’une épaisse couche de glaces endurcit les fibres des habitants, épure leur sang, purifie leur cœur et en fait des hommes d’élite qui se distinguent par leur courage, leur intelligence et leur profond amour pour la liberté.
Les Apaches, qui habitaient originairement la plus grande partie du Nouveau-Mexique, ont peu à peu reculé devant la hache des pionniers, ces enfants perdus de la civilisation, et retirés dans d’immenses déserts qui couvrent le triangle formé par le rio Gila, le del Norte et le Colorado, ils font presque impunément des courses sur les frontières mexicaines, pillant, brûlant et dévastant tout ce qu’ils rencontrent sur leur passage.
Les habitants des contrées que nous avons citées plus haut, tenus en respect par ces protées insaisissables, sont dans un état de guerre continuelle contre eux, toujours prêts au combat, fortifiant leurs haciendas (fermes), et ne voyageant que les armes à la main.
El Paso del Norte peut être regardé comme l’ultima Thule de la partie civilisée du Mexique. Au-delà, vers le nord et le nord-ouest, s’étendent les vastes plaines incultes de Chihuahua, le bolson de Mapimi et les déserts arides du rio Gila.
Ces immenses déserts, nommés Apacheria, sont encore aujourd’hui aussi inconnus qu’ils l’étaient à la fin du XVIe siècle.
El Paso del Norte doit son nom à sa situation près d’un gué, ou Paso du rio del Norte. Cet établissement est le plus ancien de tous ceux du Nouveau-Mexique ; sa fondation remonte à 1585, c’est-à-dire à la fin du XVIe siècle.
L’établissement actuel est épars dans une étendue de dix milles environ, le long des bords du del Norte, et compte 4000 habitants au plus.
La plaza, ou village del Paso, est située à la tête de la vallée ; à l’extrémité opposée est le presidio de San Elezario. Tout l’intervalle est rempli par une ligne continue de maisons blanches à toits plats, enfouies dans des jardins et entourées de vignobles.
À un mille au-dessus du passage, la rivière est barrée et l’eau conduite par un canal de dérivation appelé Acequia madre dans la vallée qu’elle arrose.
C’est à quelques milles à peine de cet établissement que commence l’Apacheria.
On sent que le pas de l’homme civilisé n’a foulé que timidement et à de rares intervalles cette contrée toute primitive où la nature, libre de se développer sous l’œil tout-puissant du Créateur, prend des aspects d’une fantaisie et d’une beauté incroyables.
Par une belle matinée du mois de mai, que les Indiens nomment wabigon-quisis (lune des fleurs), un homme de haute taille, aux traits durs et accentués, monté sur un fort cheval à demi sauvage, déboucha au grand trot de la plaza, et après quelques minutes d’hésitation employées sans doute à s’orienter, il appuya résolument les éperons aux flancs de sa monture, traversa le gué, et après avoir laissé derrière lui les nombreux cotonniers qui, en cet endroit, couvrent les bords du fleuve, il se dirigea vers les épaisses forêts qui verdissaient à l’horizon.
Ce cavalier était revêtu du costume adopté sur les frontières, costume pittoresque que nous décrirons en deux mots.
L’inconnu portait un dolman de drap vert, galonné en argent, qui laissait voir une chemise de batiste brodée, dont le col rabattu était fermé par une cravate de soie noire, négligemment attachée à la Colin par une bague en diamant, en guise de nœud. Il portait une culotte de drap vert galonné d’argent, garnie de deux rangées de boutons du même métal, retenus aux hanches par une ceinture de soie rouge à franges d’or. La culotte, entrouverte sur les côtés jusqu’au milieu de la cuisse, laissait librement flotter le caleçon de fine toile de dessous ; ses jambes étaient défendues par une bande de cuir brun gaufré et brodé, nommé bottes vaqueras, attachées au bas du genou par un tissu d’argent. À ses talons résonnaient d’énormes éperons. Une manga, resplendissante d’or, relevée sur l’épaule, garantissait le haut de son corps et sa tête était abritée des rayons ardents du soleil par un chapeau de feutre brun galonné, à larges bords, dont la forme était serrée par une large toquilla d’argent qui en faisait deux ou trois fois le tour.
Sa monture était harnachée avec un luxe gracieux qui en faisait ressortir toute la beauté. Une riche selle en cuir gaufré, garnie d’argent massif, sur le derrière de laquelle était attaché le zarapé ; de larges étriers mauresques en argent, aux arçons de belles armes d’eau ; une élégante anquera faite de cuir ouvragé, garnie de petites chaînettes d’acier, recouvrait entièrement la croupe, et tombant jusqu’au milieu des cuisses du cheval, retentissait au moindre mouvement du coureur.
L’inconnu semblait, par le luxe qu’il déployait, appartenir à la haute classe de la société : à son côté droit pendait un machete, deux pistolets étaient passés dans sa ceinture, le manche d’un long couteau sortait de sa botte droite, et il tenait en travers devant lui un superbe rifle damasquiné.
Penché sur le cou de son cheval lancé au galop, il s’avançait rapidement sans jeter un regard autour de lui, bien que le paysage qui se déroulait à ses côtés fût un des plus majestueux et des plus attrayants de ces régions.
Le fleuve formait les plus capricieux méandres au milieu d’un terrain accidenté de mille façons bizarres.
Çà et là, sur des plages de sable et de gravier, on voyait étendus avec leurs branches, des arbres énormes que le courant plus faible avait laissés épars et qui, séchés par le soleil, montraient par leur couleur lavée qu’ils étaient morts depuis plusieurs siècles.
Auprès des endroits bas et marécageux, erraient lourdement des caïmans et des crocodiles.
Dans d’autres endroits où le fleuve coulait presque uniformément, ses rives étaient unies et couvertes de gros arbres butés ou serrés par des lianes qui, après s’y être entortillées, retombaient jusqu’à terre où elles plongeaient pour s’élancer de nouveau dans l’espace, en formant les plus extravagantes paraboles.
Les bois fourrés laissaient entrevoir de temps en temps de petites prairies, des marécages, ou un sol uni couvert d’ombrages inaccessibles aux rayons du soleil et parfois embarrassés d’arbres morts de vieillesse ; plus loin, d’autres, qui semblaient jeunes encore à cause de la couleur et de la solidité de leur écorce, se réduisaient en poussière au moindre souffle du vent.
Sur des rives élevées à pic, où la rapidité de l’eau indiquait l’inégalité du sol, des terres éboulées laissaient voir d’énormes racines sans appui et annonçaient la chute des colosses déjà inclinés, qu’elles ne soutenaient plus que par artifice.
Parfois le terrain tout à fait miné en dessous, réduit à son propre poids, entraînait avec lui le bois qu’il portait, et faisait, en tombant, retentir un bruit confus produit par l’écoulement des terres, le sifflement des branches qui se rompaient après leur vibration, et dont le fracas, répercuté par les échos que forme la hauteur des immenses forêts qui règnent le long du fleuve, avait quelque chose de grandiose dans ce désert dont il n’est donné à aucun être humain de sonder les effrayants mystères.
Cependant l’inconnu galopait toujours, l’œil ardemment fixé devant lui, ne semblant rien voir.
Plusieurs heures se passèrent ainsi ; le cavalier s’enfonçait de plus en plus dans la forêt ; il avait quitté les rives du fleuve et n’avançait plus qu’avec des difficultés inouïes, au milieu de l’inextricable fouillis d’herbes, de branches et de buissons qui, à chaque pas, arrêtait sa marche et le contraignait à des détours sans nombre.
Seulement, parfois il tirait la bride, lançait un regard vers le ciel, puis il repartait en murmurant à demi-voix ce seul mot :
– Adelante ! (en avant !)
Enfin il s’arrêta dans une vaste clairière, jeta un regard soupçonneux aux environs, et, rassuré probablement par le silence de plomb qui pesait sur le désert, il mit pied à terre, entrava son cheval et lui ôta la bride, afin qu’il pût brouter les jeunes pousses.
Ce devoir accompli, il se laissa nonchalamment aller sur le sol, tordit une cigarette de maïs entre ses doigts, sortit un mechero d’or de sa ceinture et battit le briquet.
Cette clairière était assez grande : d’un côté, l’œil s’étendait facilement au loin sur les prairies, dans l’espace laissé libre par les arbres, et permettait de distinguer des daims et des chevreuils qui paissaient avec sécurité ; du côté opposé, la forêt, de plus en plus sauvage, semblait, au contraire, un infranchissable mur de verdure.
Tout était abrupt et primitif dans ce lieu, que le pied de l’homme avait si rarement foulé.
Certains arbres, tout à fait ou en partie desséchés, offraient les restes vigoureux d’un sol riche et fécond ; d’autres, également antiques, étaient soutenus par des lianes entortillées qui, avec le temps, avaient presque égalé la grosseur de leur premier appui : la diversité des feuilles offrait le plus bizarre mélange. D’autres, recelant dans leur tronc creux un fumier qui, formé des débris de leurs feuilles et de leurs branches à demi mortes, avait échauffé les graines qu’ils avaient laissé tomber, semblaient, par les arbrisseaux qu’ils renfermaient, promettre un dédommagement de la perte de leurs pères.
Dans les prairies, la nature toujours prévoyante semble avoir voulu mettre à l’abri des injures du temps certains vieux arbres, patriarches des forêts, affaissés sous le poids des siècles, en leur formant un manteau d’une mousse grisâtre qui pend en festons depuis la cime des plus hautes branches jusqu’à terre, en affectant les dessins et les découpures les plus étranges.
L’inconnu, étendu sur le dos, sa tête soutenue par les deux mains croisées, fumait avec cette béatitude pleine de nonchalance et de paresse, particulière aux Hispano-Américains.
Il ne s’interrompait dans cette douce occupation que pour tordre une nouvelle cigarette et jeter un regard aux environs en murmurant :
– Hum ! il me fait bien attendre.
Il lâchait une bouffée de fumée bleuâtre et reprenait sa première position.
Plusieurs heures s’écoulèrent ainsi. Tout à coup, un froissement assez fort se fit entendre dans les broussailles, à quelque distance derrière l’inconnu.
– Ah ! ah ! fit-il, je crois que voilà enfin mon homme.
Cependant le bruit devenait de plus en plus fort et se rapprochait rapidement.
– Arrivez donc ! que diable, s’écria le cavalier en se redressant, voilà assez longtemps que vous me faites attendre, par Notre-Dame del Pilar !
Rien n’apparaissait ; la clairière était toujours solitaire, bien que le bruit eût acquis une certaine intensité.
L’inconnu, surpris du mutisme obstiné de celui auquel il s’adressait et surtout de sa persistance à ne pas se montrer, se leva afin de savoir à quoi s’en tenir.
En ce moment son cheval pointa les oreilles, renâcla avec force et fit un brusque mouvement pour se dégager du lasso qui le retenait.
Notre homme s’élança vivement vers lui et le flatta de la main et de la voix.
Le cheval tremblait de tous ses membres, et faisait des bonds prodigieux pour s’échapper. L’inconnu, de plus en plus surpris de ces mouvements extraordinaires, se retourna.
Tout lui fut alors expliqué.
À vingt pas de lui au plus, accroupi sur la maîtresse branche d’un énorme cyprès, un magnifique jaguar à la robe splendidement mouchetée fixait sur lui deux yeux ardents en passant sur ses mâchoires avec une volupté féline sa langue rugueuse, rouge comme du sang.
– Ah ! ah ! dit à demi-voix l’inconnu sans autrement s’émouvoir, ce n’est pas toi que j’attendais ; mais c’est égal, sois le bienvenu, compagnon ; caraï ! nous allons en découdre.
Sans perdre le jaguar de vue, il s’assura que son machete sortait facilement du fourreau, ramassa son rifle, et ces précautions prises, il s’avança résolument vers la bête féroce qui le regardait venir sans changer de position.
Arrivé à dix pas du jaguar, l’inconnu jeta sa cigarette, que jusque-là il avait conservée, épaula son arme et mit le doigt sur la détente.
Le jaguar se ramassa sur lui-même et se prépara à s’élancer en avant.
Au même instant un hurlement strident s’éleva du côté opposé de la clairière.
– Tiens ! tiens ! tiens ! dit à part lui l’inconnu avec un sourire, il paraît, qu’ils sont deux, et moi qui croyais avoir affaire à un jaguar célibataire ! Cela commence à devenir intéressant, et il lança un regard de côté.
Il ne s’était pas trompé, un second jaguar, un peu plus grand que le premier, fixait sur lui des yeux flamboyants.
II
La lutte
Les habitants de la frontière mexicaine sont habitués à lutter continuellement contre les fauves, hommes ou bêtes, qui incessamment les attaquent ; l’inconnu ne s’émut donc que médiocrement de la visite inattendue des deux jaguars.
Bien que sa position entre ces féroces ennemis fût assez précaire et qu’il ne se dissimulât nullement le danger qu’il courait seul contre eux, il n’en résolut pas moins de leur faire bravement tête.
Sans perdre de vue le jaguar que le premier il avait aperçu, il obliqua légèrement en faisant quelques pas en arrière, de façon à avoir ses ennemis presque en face, au lieu de se trouver entre eux.
Cette manœuvre, qui exigea un temps assez long, réussit au-delà de ses espérances.
Les jaguars le regardaient en se pourléchant et en se passant la patte derrière l’oreille avec ces mouvements pleins de grâce particuliers à la race féline.
Les deux fauves, certains de leur proie, semblaient jouer avec elle et ne se hâtaient pas de la saisir.
Tout en ayant l’œil au guet, le Mexicain ne s’endormait pas dans une trompeuse sécurité ; il savait que la lutte qu’il allait entreprendre était une lutte suprême et il prenait ses précautions.
Les jaguars n’attaquent l’homme que contraints par la nécessité ; ceux-ci cherchaient surtout à saisir le cheval.
La noble bête, solidement attachée par son maître, s’épuisait en vains efforts pour rompre les liens qui la retenaient et s’échapper.
Elle tremblait de terreur aux âcres émanations des fauves.
L’inconnu, dès que ses précautions furent prises complètement, épaula son rifle une seconde fois.
En ce moment, les jaguars levèrent la tête en couchant les oreilles et humant l’air avec inquiétude.
Un bruit presque imperceptible s’était fait entendre dans les broussailles.
– Qui va là ? demanda le Mexicain d’une voix forte.
– Un ami, don Miguel de Zarate, répondit-on.
– Ah ! c’est vous, don Valentin, reprit le Mexicain ; vous arrivez à propos pour assister à une belle chasse.
– Ah ! ah ! reprit l’homme qui avait déjà parlé, puis-je vous aider ?
– Inutile, seulement hâtez-vous si vous voulez voir.
Les branches s’écartèrent brusquement et deux hommes apparurent dans la clairière. À la vue des jaguars, ils s’arrêtèrent, non de crainte, car ils posèrent tranquillement à terre la crosse de leurs rifles, mais afin de laisser au chasseur toutes les facilités de sortir victorieux de son téméraire combat.
Les jaguars semblèrent comprendre que le moment d’agir était venu ; comme d’un commun accord, ils se rassemblèrent sur eux-mêmes et bondirent sur leur ennemi.
Le premier frappé au vol par une balle qui lui traversa l’œil droit, roula sur le sol, où il resta immobile.
Le second fut reçu à la pointe du machete duchasseur, qui, son rifle déchargé, était tombé un genou en terre, le bras gauche garanti par son zarape en avant et le machete de la main droite.
L’homme et le tigre tombèrent l’un sur l’autre en se débattant.
Après une lutte de quelques secondes, un seul des deux adversaires se releva.
Ce fut l’homme.
Le tigre était mort.
Le machete du chasseur, guidé par une main ferme, lui avait traversé le cœur de part en part.
Pendant ce rapide combat, les nouveaux venus n’avaient pas fait un geste, ils étaient demeurés spectateurs impassibles de ce qui s’était passé.
Le Mexicain se releva, plongea deux ou trois fois son machete dans l’herbe pour en essuyer la lame, et se retournant froidement vers les étrangers :
– Que tal ? Qu’en dites-vous ? fit-il.
– Parfaitement joué, répondit le premier ; c’est un des plus jolis coups doubles que j’aie vus de ma vie.
Les deux hommes jetèrent leurs fusils sur l’épaule et s’avancèrent vers le Mexicain, qui rechargeait son rifle avec autant de sang-froid et d’un air aussi tranquille que s’il ne venait pas d’échapper par un miracle d’adresse à un danger terrible.
Le soleil descendait rapidement à l’horizon, l’ombre des arbres prenait une longueur prodigieuse, le globe du soleil apparaissait comme une boule de feu au milieu de l’azur limpide du ciel.
La nuit n’allait pas tarder à venir, le désert se réveillait ; de toutes parts on entendait, dans les sombres et mystérieuses profondeurs de la forêt vierge, les sourds hurlements des coyotes et des bêtes fauves mêlés aux chants des oiseaux perchés sur toutes les branches.
Splendide concert chanté par tous les hôtes libres et indomptés des prairies à la gloire de Dieu, salut sublime adressé au soleil sur le point de disparaître.
Le désert, silencieux et morne pendant les fortes chaleurs du jour, sortait de sa torpeur maladive à l’approche du soir, et se préparait à prendre ses ébats nocturnes.
Les trois hommes, réunis dans la clairière, rassemblèrent des branches sèches, en firent un monceau et y mirent le feu.
Ils avaient sans doute l’intention de bivaquer une partie de la nuit en cet endroit.
Dès que les flammes du bûcher montèrent joyeusement vers le ciel en longues spirales, les deux inconnus sortirent de leurs gibecières des tortillas de maïs, quelques camotes cuites à l’eau et une gourde de pulque ; ces divers comestibles furent par eux complaisamment étalés sur l’herbe, et les trois hommes commencèrent un repas de chasseur.
Lorsque la gourde eut circulé plusieurs fois, que les tortillas eurent disparu, les nouveaux venus allumèrent leur pipe indienne, et le Mexicain tordit un papelito.
Bien que ce repas eût été court, il dura cependant assez longtemps pour que la nuit fût complètement tombée avant qu’il fût terminé.
Une obscurité complète planait sur la clairière, les reflets rougeâtres de la flamme du foyer se jouaient sur les visages énergiques des trois hommes et leur donnaient une apparence fantastique.
– Maintenant, dit le Mexicain après avoir allumé sa cigarette, je vais, si vous me le permettez, vous expliquer pourquoi j’avais si grande hâte de vous voir.
– Un instant encore, répondit un des chasseurs : vous savez que dans les déserts les feuilles ont souvent des yeux et les arbres des oreilles ; si d’après ce que vous m’avez laissé entrevoir je ne me trompe pas, vous nous avez donné rendez-vous ici afin que notre entrevue fût secrète.
– En effet, j’ai le plus grand intérêt à ce que rien de ce qui se dira ici ne soit entendu ou seulement soupçonné.
– Fort bien, Curumilla ; allez.
Le second chasseur se leva, saisit son rifleet s’éloigna à pas de loup.
Bientôt il disparut dans l’obscurité.
Son absence fut assez longue.
Tout le temps qu’elle dura, les deux hommes restés auprès du feu n’échangèrent pas une parole.
Enfin, après une demi-heure, le chasseur revint s’asseoir aux côtés de ses compagnons.
– Eh bien ? demanda celui qui l’avait envoyé à la découverte.
– Mes frères peuvent parler, répondit-il laconiquement, le désert est tranquille.
Sur cette assurance les trois hommes bannirent toute inquiétude ; la prudence cependant ne les abandonna pas : ils reprirent leur pipe, et tournant le dos au feu afin de pouvoir parler tout en surveillant les environs :
– Nous sommes prêts à vous entendre, dit le premier chasseur.
– Écoutez-moi avec la plus grande attention, caballeros, répondit le Mexicain. Ce que vous allez entendre est de la plus haute importance.
Les deux hommes inclinèrent silencieusement la tête.
Le Mexicain prit la parole.
Avant que d’aller plus loin, il nous faut faire connaître au lecteur les deux hommes que nous venons de mettre en scène, et retourner quelques pas en arrière, afin de bien faire comprendre pourquoi don Miguel Zarate, au lieu de les recevoir chez lui, leur avait donné rendez-vous au milieu d’une forêt vierge.
Les deux chasseurs paraissaient Indiens au premier coup d’œil ; mais, en les examinant avec attention, on reconnaissait à certains signes que l’un d’eux était un de ces trappeurs blancs, dont l’audace est devenue proverbiale au Mexique.
Leur aspect et leur équipement offraient un singulier mélange de la vie sauvage et de la vie civilisée ; leurs cheveux étaient d’une longueur remarquable ; dans ces contrées où l’on ne combat souvent un homme que pour la gloire de lui ravir sa chevelure, c’est une coquetterie de l’avoir longue et facile à saisir.
Les deux chasseurs la portaient élégamment tressée, et entremêlée de peaux de loutre et de cordons aux vives couleurs.
Le reste de leur costume répondait à ce spécimen de leur goût.
Une blouse de chasse de calicot d’un rouge éclatant leur tombait jusqu’aux genoux ; des guêtres garnies de rubans de laine et de grelots entouraient leurs jambes, et leur chaussure se composait de ces moksens constellés de perles fausses que savent si bien confectionner les squaws.
Une couverture bariolée et serrée aux hanches par une ceinture de cuir de daim tanné achevait de les envelopper, mais non pas assez, cependant, pour qu’à chacun de leurs mouvements on ne pût voir briller en dessous le fer des haches, la crosse des pistolets, et la poignée des machetes dont ils étaient armés.
Quant à leurs rifles, inutiles en ce moment et négligemment jetés à terre auprès d’eux, si on les avait dépouillés du fourreau de peau d’élan garni de plumes qui les recouvrait, on aurait pu voir avec quel soin leurs possesseurs les avaient ornés de clous de cuivre et peints de différentes couleurs ; car tout, chez ces deux hommes, portait l’empreinte des coutumes indiennes.
Le premier des deux chasseurs était un homme de trente-huit ans au plus, d’une taille élevée et bien prise ; ses membres musculeux et bien attachés dénotaient une grande vigueur corporelle, jointe à une légèreté sans égale ; bien qu’il affectât toutes les manières des Peaux-Rouges, il était facile de reconnaître qu’il appartenait non seulement à la race blanche sans mélange, mais encore au type normand ou gaulois.
Il était blond ; ses grands yeux bleus et pensifs, ornés de longs cils, avaient une expression de tristesse indéfinissable ; son nez était légèrement busqué, sa bouche grande et ornée de dents d’une éblouissante blancheur ; une épaisse barbe d’un blond cendré couvrait le bas de son visage ; sa physionomie respirait la douceur, la bonté et le courage sans forfanterie, mais complété par une volonté de fer.
Son compagnon appartenait, lui, évidemment à la race indienne, dont il avait tous les signes caractéristiques ; mais, fait étrange, il n’était pas cuivré comme les aborigènes américains du Texas et du Nord-Amérique ; son teint était brun et légèrement olivâtre.
Il avait le front haut, le nez recourbé, les yeux petits mais perçants, la bouche grande et le menton carré ; bref, il offrait le type complet de la race araucane, qui habite, au sud du Chili, un mince territoire.
Ce chasseur avait le front ceint d’un bandeau couleur de pourpre, dans lequel, au-dessus de l’oreille droite, était plantée une plume d’aigle des Andes, signe qui sert à distinguer les ulmènes ou chefs des Aucas.
Ces deux hommes, que le lecteur a sans doute reconnus déjà et qui ont joué un rôle important dans un de nos précédents ouvrages1, étaient Valentin Guillois, l’ancien sous-officier de spahis, et Curumilla, son ami, l’ulmen de la tribu du Grand-Lièvre.
Par quel concours inouï de circonstances Valentin et son ami, que nous avons quittés dix ans auparavant au Chili, dans l’hacienda de la Paloma, se trouvaient-ils à présent au fond des forêts vierge de l’Apacherie, à près de deux mille lieues du pays où nous les avons laissés ?
C’est ce que nous allons expliquer au lecteur, en ouvrant une parenthèse indispensable pour l’intelligence des faits qui vont suivre.
Du reste, le moment est des mieux choisis pour ouvrir cette parenthèse, puisque les trois chasseurs causent gaiement autour de leur brasier, que la nuit est sombre, la forêt tranquille, et que rien ne semble devoir venir troubler leurs confidences.
III
Don Miguel Zarate
Si le Mexique était mieux gouverné, ce serait sans contredit un des pays les plus riches du globe.
En effet, c’est dans cette contrée que se trouvent les fortunes particulières les plus considérables.
Depuis que les Américains des États-Unis ont révélé au monde, en s’emparant de la moitié du Mexique, où tend leur ambition, les habitants de ce beau pays sont un peu sortis de la torpeur dans laquelle ils se complaisaient et ont tenté de grands efforts pour coloniser leurs provinces et appeler sur leur sol, si riche et si fécond, des hommes intelligents, travailleurs et industrieux, qui pussent changer la face des choses et faire régner l’abondance et la richesse partout où, avant eux, ne se trouvaient que ruines, désolation, incurie et misère.
Malheureusement, les nobles efforts tentés jusqu’à ce jour sont, par une fatalité incompréhensible, restés sans résultat, soit à cause de l’apathie naturelle des habitants, soit par la faute du gouvernement mexicain lui-même.
Cependant de grands propriétaires, comprenant toute l’opportunité de la mesure proposée et combien il était de leur intérêt de combattre l’influence mortelle, pour leur nationalité, des invasions américaines, se sont généreusement dévoués à la réalisation de cette grande question d’économie sociale qui, malheureusement, devient de plus en plus irréalisable.
En effet, dans l’Amérique du Nord deux races ennemies se trouvent en présence :
La race anglo-saxonne et la race espagnole.
Les Anglo-Saxons sont dévorés d’une ardeur de conquête et d’une rage d’envahissement que rien ne peut arrêter ni même retarder.
On ne peut voir sans étonnement les tendances expansives de ce peuple mobile et singulier, composé hétérogène de toutes les races que la misère ou les mauvais instincts ont, dans le principe, chassé d’Europe, et qui se sent gêné dans un immense territoire que pourtant sa faiblesse numérique l’empêche d’occuper tout entier.
Emprisonné dans le réseau de ses vastes frontières, se faisant un droit de la force, il déplace continuellement les limites de ses voisins et empiète sans relâche sur des terrains dont il n’a que faire.
Journellement des compagnies d’émigrants abandonnent leurs demeures et, le rifle sur l’épaule, la hache à la main, elles se dirigent vers le Sud comme poussées par une volonté plus forte qu’elles, sans que les montagnes, les déserts, les forêts vierges ou les larges fleuves soient assez puissants pour les contraindre à faire halte quelques instants.
Les Américains du Nord se figurent, en général, qu’ils sont les instruments de la Providence, chargés par les décrets du Tout-Puissant de peupler et de civiliser le nouveau monde.
C’est avec une impatience fébrile qu’ils comptent les heures qui doivent encore s’écouler jusqu’au jour, prochain dans leur pensée, où leur race et leur système gouvernemental occuperont tout l’espace compris entre le cap Nord et l’isthme de Panama, à l’exclusion des républiques espagnoles d’un côté et des colonies anglaises de l’autre.
Ces projets, dont les Américains du Nord ne font nullement mystère, mais dont, au contraire, ils se vantent hautement, sont parfaitement connus des Mexicains, lesquels détestent cordialement leurs voisins et emploient tous les moyens en leur pouvoir pour leur créer des difficultés et mettre des entraves à leurs invasions successives.
Au nombre des propriétaires du Nouveau-Mexique qui se résolurent à faire de grands sacrifices afin d’arrêter ou du moins de retarder l’invasion imminente du Nord-Amérique, il y en avait un, le plus riche et peut-être le premier de tous par son intelligence et l’influence dont à juste titre il jouissait dans le pays.
Il se nommait don Miguel Acamarichtzin Zarate.
Quoi qu’on en dise, la population indienne au Mexique dépasse du double la population blanche ; et possède une énorme influence.
Don Miguel Zarate descendait en ligne directe d’Acamarichtzin, premier roi de Mexico, dont le nom s’était, comme un précieux héritage, conservé dans sa famille.
Propriétaire d’une fortune incalculable, don Miguel vivait dans ses immenses propriétés comme un roi dans son empire, aimé et respecté des Indiens, qu’il protégeait efficacement chaque fois que l’occasion s’en présentait, et qui avaient pour lui une vénération qu’ils poussaient presque jusqu’à l’idolâtrie, car ils voyaient en lui le descendant d’un de leurs rois les plus célèbres et le défenseur né de leur race.
Au Nouveau-Mexique la population indienne a beaucoup augmenté depuis un demi-siècle. Certains auteurs prétendent même qu’elle est aujourd’hui plus nombreuse qu’avant la conquête, ce qui est possible avec l’apathie des Espagnols et l’incurie qu’ils ont sans cesse déployée dans leurs luttes contre elle.
Mais les Indiens sont demeurés stationnaires au milieu de la marche incessante du progrès et de la civilisation ; ils conservent encore aujourd’hui intacts les traits principaux de leurs anciennes mœurs. Épars çà et là dans de misérables villages ou ranchos, ils vivent en tribus séparées, gouvernés par leurs caciques ; c’est à peine s’ils ont mêlé quelques mots espagnols à leurs idiomes, qu’ils parlent comme au temps des Aztèques.
Le seul changement apparent qui se soit effectué en eux, c’est leur conversion au catholicisme, conversion plus que problématique, puisqu’ils conservent avec le plus grand soin tous les souvenirs de leur ancienne religion, qu’ils en suivent tous les rites en secret, et qu’ils en ont gardé toutes les superstitieuses pratiques.
Ces Indiens, au Nouveau-Mexique surtout, bien que nommés Indios fidèles (Indiens fidèles), sont toujours prêts, à la première occasion, à se liguer avec leurs congénères du désert et, dans les excursions des Comanches et des Apaches, il est rare que des Indiens fidèles ne leur servent pas d’éclaireurs, de guides et d’espions.
La famille de don Miguel Zarate s’était, quelques années après la conquête de cet aventurier de génie nommé Cortès, retirée au Nouveau-Mexique, qu’elle n’avait plus quitté depuis.
Don Miguel avait suivi avec soin la politique de sa famille en resserrant le plus possible les liens d’amitié et de bon voisinage qui, depuis un temps immémorial, le liaient aux Indiens, fidèles ou non.
Cette politique avait porté ses fruits. Tous les ans, au mois de septembre, que les comanches nomment la lune du Mexique, tant ils ont pris l’habitude de leurs incursions périodiques contre les blancs, lorsque les terribles guerriers rouges, précédés par le meurtre et l’incendie, se ruaient comme un torrent sur les malheureux habitants qu’ils massacraient et sur les fermes qu’ils saccageaient, sans pitié ni pour l’âge ni pour le sexe, seules les propriétés de don Miguel Zarate étaient respectées, et non seulement on ne lui causait aucun dommage, mais encore si parfois, sans intention, un champ était foulé sous le pas des chevaux, ou quelques arbres brûlés ou arrachés par des pillards, le mal était immédiatement réparé sans que le propriétaire eût besoin de se plaindre.
Cette conduite des Indiens n’avait pas laissé que de soulever contre don Miguel une jalousie extrême de la part des habitants, qui se voyaient ruinés périodiquement par les Indios bravos. On avait porté contre lui des plaintes vives au gouvernement de Mexico ; mais quels que fussent le pouvoir de ses ennemis et les moyens qu’ils avaient employé pour le perdre, le riche hacendero n’avait jamais été inquiété sérieusement, d’abord parce que le Nouveau-Mexique est trop éloigné de la capitale pour que ses habitants aient rien à redouter de ceux qui gouvernent, et qu’ensuite don Miguel était trop riche pour qu’il ne lui fût pas facile d’imposer silence à ceux qui étaient le plus disposés à lui nuire.
Don Miguel de Zarate, dont nous avons, dans un précédent chapitre, fait le portrait au lecteur, était resté veuf après trois ans de mariage, avec deux enfants, un fils et une fille, âgés, à l’époque où s’ouvre ce récit, le fils de vingt-quatre ans et la fille de dix-sept.
Doña Clara, ainsi se nommait la fille de don Miguel, était la plus charmante enfant qui se puisse imaginer ; elle avait une de ces têtes de vierge de Murillo, dont les grands yeux noirs ombragés de longs cils soyeux, le front pur et la bouche rêveuse, semblent promettre des joies divines ; son teint, légèrement bruni par les chauds rayons du soleil, avait ce reflet doré qui sied tant aux femmes de ces contrées intertropicales ; elle était petite, mais toute mignonne et toute gracieuse.
Douce et naïve, ignorante comme une créole, cette délicieuse enfant était adorée par son père, qui voyait revivre en elle la femme qu’il avait tant aimée.
Les Indiens la suivaient des yeux, lorsque parfois elle passait pensive en effeuillant une fleur devant leurs misérables jacales (huttes), et courbant à peine les plantes sur lesquelles elle posait son pied délicat ; dans leur cœur ils comparaient cette frêle jeune fille, aux contours suaves et vaporeux, à la vierge des premières amours, cette sublime création de la religion indienne, qui tient une si grande place dans la mythologie aztèque.
Don Pablo Zarate, le fils de l’hacendero, était un homme de haute taille, fortement charpenté, aux traits durs et caractérisés, au regard hautain, bien qu’empreint de douceur et de bonté.
Doué d’une force peu commune, adroit à tous les exercices du corps, don Pablo était renommé dans toute la contrée pour son talent à dompter les chevaux les plus fougueux et la justesse de son coup d’œil à la chasse. Déterminé chasseur, hardi coureur des bois, ce jeune homme, lorsqu’il avait un bon cheval entre les jambes et son rifle à la main, ne connaissait pas, homme ou bête, d’ennemi capable de lui barrer le passage.
Le respect et la vénération qu’ils avaient pour le père, les Indiens, avec leur foi naïve, les reportaient sur le fils, en qui ils se figuraient voir la personnification de Huitzilopochtli, ce terrible dieu de la guerre des Aztèques auquel, lors de la dédicace de son teocali, soixante-deux mille victimes humaines furent sacrifiées en un seul jour.
Les Zarate étaient donc, à l’époque où commence cette histoire, de véritables rois au Nouveau-Mexique.
La félicité dont ils jouissaient fut tout à coup troublée par un de ces incidents vulgaires qui, bien que peu importants en eux-mêmes, ne laissent pas que de causer une perturbation générale et un malaise sans cause apparente, par cela même qu’il est impossible de les prévoir ou de les prévenir. Voici le fait :
Don Miguel Zarate possédait aux environs del Paso de vastes propriétés qui s’étendaient au loin, consistant pour la plupart en haciendas, en immenses prairies et en forêts.
Un jour, don Miguel revenait de faire, comme il en avait l’habitude, une visite à ses haciendas ; il était tard, et il pressait son cheval afin d’atteindre avant la nuit le gué de la rivière, lorsqu’à trois ou quatre lieues au plus de l’endroit vers lequel il se dirigeait, au moment où il allait entrer dans un épais bois de cotonniers qu’il lui fallait traverser avant d’atteindre le gué, son attention fut tout à coup tirée par des cris mêlés à des grognements qui partaient du bois dans lequel il allait s’engager.
L’hacendero s’arrêta afin de se rendre bien compte du bruit insolite qu’il entendait, et pencha la tête en avant afin de voir ce qui se passait.
Mais il lui fut impossible de rien distinguer au travers du chaos de lianes et de broussailles qui interceptaient la vue.
Cependant le bruit devenait de plus en plus fort, les cris redoublaient, mêlés à des jurons et des exclamations de colère.
Le cheval du Mexicain couchait les oreilles, renâclait et refusait d’avancer.
Cependant il fallait prendre un parti. Don Miguel pensa que peut-être un homme attaqué par les bêtes fauves courait un danger imminent ; il ne consulta que son cœur, et, malgré la répugnance visible de son cheval, il l’obligea à marcher en avant et à entrer dans le bois.
À peine avait-il fait quelques pas, qu’il s’arrêta étonné devant l’étrange spectacle qui s’offrit à sa vue.
IV
Les peccaris
Au milieu d’une clairière gisait un cheval éventré après lequel s’acharnaient six ou huit peccaris, tandis qu’une dizaine d’autres attaquaient à coups de boutoir un arbre énorme sur les plus hautes branches duquel un homme était réfugié.
Expliquons au lecteur, qui probablement les connaît fort peu, quels animaux sont les peccaris.
Les peccaris tiennent le milieu entre le porc domestique et le sanglier.
Bien que la taille de cet animal ne dépasse pas ordinairement 70 centimètres de hauteur, et à peu près un mètre de longueur du groin à la naissance de la queue, il est cependant sans contredit un des animaux les plus dangereux et les plus redoutés de l’Amérique septentrionale.
La mâchoire du peccari est garnie de boutoirs assez semblables à ceux du sanglier, mais droits et tranchants, dont la longueur varie entre huit et quinze centimètres.
Par la forme de son corps il ressemble au porc, mais les soies clairsemées sur sa peau rugueuse sont colorées par zone ; la partie la plus proche de la peau est blanche et la pointe d’une teinte chocolat. Dès que l’animal entre en fureur, ces soies se hérissent comme les piquants du porc-épic.
Les mouvements des peccaris sont vifs et rapides comme ceux de l’écureuil ; ils vivent ordinairement en troupes de quinze, trente et même cinquante individus.
La force de la tête, du cou et des épaules de ces animaux est telle que lorsqu’ils chargent, rien ne peut résister à l’impétuosité de leurs attaques.
Une particularité assez remarquable de cette espèce est cette rugosité informe qu’ils ont sur le dos et qui contient une liqueur musquée qui s’évapore dès que l’animal est en colère.
Le peccari se nourrit préférablement de glands, de racines, de baies de grains, de cannes à sucre et de reptiles de toutes sortes ; il est prouvé que les serpents les plus venimeux sont dévorés par eux sans qu’ils en soient incommodés le moins du monde.
La façon dont gîte le peccari est assez singulière ; sa bauge est toujours placée au milieu des canniers touffus et impénétrables qui se trouvent dans les endroits marécageux, auprès d’arbres séculiers comme on en rencontre tant dans les forêts vierges, géants foudroyés, mais debout encore, avec leurs grappes de lianes et de vignes vierges.
Les troncs de ces arbres, qui mesurent parfois jusqu’à douze mètres de circonférence, sont creux pour la plupart et offrent un abri commode aux peccaris qui s’y retirent chaque soir vingt et vingt-cinq ensemble, s’introduisant à reculons les uns après les autres dans la cavité, de façon que la dernier a l’extrémité de son groin placée juste à l’entrée du trou, et reste pour ainsi dire en vedette, chargé de veiller sur le repos de ses compagnons.
Les peccaris sont d’une férocité sans bornes, ils ne connaissent pas le danger ou du moins le méprisent complètement ; ils attaquent toujours en troupe et combattent avec une rage sans pareille jusqu’à ce que le dernier succombe, quel que soit l’ennemi qu’ils aient devant eux.
Aussi, hommes et bêtes, chacun fuit la rencontre de ces animaux terribles ; le jaguar lui-même, si fort et si redoutable, devient leur proie, si pour son malheur il a l’imprudence de s’attaquer à eux.
Voici de quelle façon ils procèdent pour vaincre le fauve.
Quant un jaguar a blessé un peccari, ceux-ci se réunissent, lui donnent la chasse et le poursuivent jusqu’à ce qu’ils parviennent à le cerner.
Lorsque toute issue lui est fermée, le jaguar, croyant échapper à ses ennemis, se réfugie sur un arbre ; mais les peccaris ne renoncent pas à leur vengeance : ils s’établissent au pied de l’arbre, recrutant sans cesse de nouveaux alliés et attendant patiemment que, poussé à bout par la faim et la soif, le jaguar se décide à descendre de sa forteresse improvisée.
C’est ce qui ne manque pas d’arriver au bout de deux ou trois jours au plus ; le fauve se décide enfin à s’élancer ; il bondit au milieu de ses ennemis qui l’attendent de pied ferme et l’attaquent bravement ; une bataille terrible s’engage, et le tigre, après avoir jonché le terrain de victimes, succombe enfin sous l’effort des assaillants et est déchiré à coups de boutoir.
D’après tout ce que nous venons de dire, il est facile de comprendre combien la position de l’homme juché au sommet d’un arbre et entouré de peccaris était précaire.
Ses ennemis semblaient déterminés à ne pas quitter la place ; ils tournaient sournoisement autour de l’arbre, attaquaient sa base à coups de boutoir, puis, reconnaissant l’inutilité de leurs efforts, ils se couchaient tranquillement auprès du cadavre du cheval, que déjà ils avaient sacrifié à leur colère.
Don Miguel se sentait ému de pitié pour le pauvre diable dont la position se faisait d’instant en instant plus critique.
Vainement il se creusait la tête pour venir en aide au malheureux dont la perte était assurée.
Attaquer les peccaris aurait été une imprudence extrême et n’aurait produit d’autre résultat que celui de détourner sur lui la fureur de ces animaux, sans pour cela sauver celui qu’il voulait secourir.
Cependant le temps pressait ; que faire ? comment sans se sacrifier soi-même, sauver l’homme qui courait un si grand péril ?
Le Mexicain hésita longtemps. Laisser sans secours cet homme dont la mort était certaine, semblait impossible à don Miguel. Cette idée, qui plusieurs fois déjà s’était présentée à sa pensée, il l’avait énergiquement repoussée, car elle lui semblait monstrueuse.
Enfin il résolut, coûte que coûte, de tenter l’impossible en faveur de cet homme inconnu, que, par cette solidarité qui règne au désert, il se serait, au fond du cœur, accusé plus tard d’avoir tué s’il ne le sortait pas du péril dans lequel il se trouvait.
La position de l’inconnu était d’autant plus critique que, dans sa précipitation à se mettre à l’abri des attaques de ses ennemis, il avait laissé tomber son rifle qui était sur le sol au pied de l’arbre, et, par conséquent, n’avait pas d’armes pour se défendre et tâcher de se sauver de haute lutte.
Malgré la finesse de leur odorat, les peccaris n’avaient pas éventé l’approche de don Miguel, qui, par un hasard providentiel, avait pénétré dans le bois du côté opposé au vent.
Le Mexicain mit pied à terre en poussant un soupir, flatta un instant son cheval, qu’il débarrassa en un tour de main de ses harnais.
Le noble animal, habitué aux caresses de son maître, remuait la tête avec de petits mouvements de joie et fixait sur lui ses grands yeux intelligents.
Don Miguel ne put retenir un soupir ; une larme coula sur ses joues hâlées. Sur le point d’accomplir le terrible sacrifice qu’il s’imposait, il hésita.
C’était son compagnon fidèle, presque un ami dont il allait se séparer ; mais la vie d’un homme était en jeu : le Mexicain refoula dans son cœur les sentiments qui l’agitaient et sa résolution fut prise.
Il passa une longe au cou de son cheval, et, malgré sa résistance obstinée, il l’obligea à s’avancer jusqu’à l’entrée de la clairière où les peccaris étaient rassemblés.
Un frêle rideau de lianes et de feuilles le dérobait seul à leur vue.
Arrivé là, don Miguel s’arrêta ; il eut encore une seconde d’hésitation, une seule, puis saisissant un morceau d’amadou, qu’il alluma tout en flattant le pauvre animal, il le lui introduisit dans l’oreille.
L’effet en fut subit et terrible. Le cheval poussa un hennissement de douleur, et, rendu fou par la brûlure, il bondit en avant et se précipita dans la clairière en cherchant vainement à se débarrasser de cet amadou qui se consumait dans son oreille en lui occasionnant une souffrance horrible.
Don Miguel s’était vivement jeté de côté et suivait d’un regard anxieux le résultat de la terrible tentative qu’il venait de faire pour sauver l’inconnu.
À la vue du cheval qui apparut subitement au milieu d’eux, les peccaris se relevèrent brusquement, formèrent un groupe compact et s’élancèrent tête baissée à la poursuite du cheval, sans penser davantage à l’homme.
L’animal, aiguillonné encore par la terreur que lui causaient ses féroces ennemis, détalait avec la rapidité d’une flèche, brisant du poitrail tous les obstacles qu’il trouvait sur son passage, et suivi de près par les peccaris.
L’homme était sauvé !
Mais à quel prix !
Don Miguel étouffa un dernier soupir de regret et s’élança dans la clairière.
L’inconnu était déjà descendu de l’arbre où il avait trouvé un abri, mais l’émotion qu’il avait éprouvée était tellement forte qu’il restait assis à terre, presque sans connaissance.
– Alerte, alerte ! lui dit vivement don Miguel, hâtons-nous, nous n’avons pas un instant à perdre, les peccaris peuvent se raviser et revenir d’un moment à l’autre.
– C’est vrai, murmura l’inconnu d’une voix sourde en jetant autour de lui un regard épouvanté ; partons, partons de suite !
Il fit un effort sur lui-même, saisit son rifle et se releva.
Par un pressentiment dont il ne put se rendre compte, don Miguel éprouva malgré lui, à l’aspect de cet homme que jusque-là il avait à peine regardé, un sentiment de défiance et de dégoût invincible.
Par suite de la vie qu’il était obligé de mener sur ces frontières fréquentées par des gens de toutes sortes, bien souvent l’hacendero s’était trouvé en rapport, avec des chasseurs et des trappeurs qui étaient loin de payer de mine, mais jamais, jusque-là, le hasard ne l’avait placé en présence d’un individu d’une aussi sinistre apparence.
Cependant il ne laissa rien voir de ce qu’il éprouvait, et engagea cet homme à le suivre.
Celui-ci ne se fit pas répéter l’invitation : il avait hâte de s’éloigner de ce lieu où il avait été si près de trouver la mort.
Grâce à la connaissance que le Mexicain avait du pays, le bois fut bientôt traversé, et les deux hommes, au bout d’une heure de marche à peine, arrivèrent sur le bord du del Norte, juste en face du village.
Leur course avait été si rapide, leur préoccupation si grande, qu’ils n’avaient pas échangé une parole tant ils redoutaient à chaque instant de voir apparaître les peccaris.
Heureusement il n’en fut rien, et ils atteignirent le gué sans être inquiétés de nouveau.
Don Miguel s’était chargé des harnais de son cheval, il les jeta sur le sol et regarda autour de lui dans l’espoir de découvrir quelqu’un qui pût l’aider à traverser la rivière.
Son attente ne fut pas trompée : juste au moment où ils arrivaient au gué, un arriero se préparait à passer de l’autre côté du fleuve avec sa recca de mules ; il s’offrit, avec cette générosité innée chez les Mexicains, de les conduire tous deux au Paso.
Les deux hommes acceptèrent avec empressement, montèrent chacun sur une mule, et une demi-heure plus tard, ils se trouvèrent en sûreté dans le village.
Après avoir donné quelques réaux à l’arriero pour payer le service qu’il lui avait rendu, don Miguel reprit les harnais de son cheval et fit un pas pour s’éloigner.
L’inconnu l’arrêta :
– Nous nous séparons ici, caballero, dit-il d’une voix rude, avec un accent anglais fortement prononcé ; mais avant de nous quitter, laissez-moi vous exprimer ma profonde reconnaissance pour la façon noble et généreuse dont vous m’avez sauvé la vie au péril de la vôtre.
– Monsieur, répondit simplement le Mexicain, je n’ai fait que mon devoir en vous sauvant : au désert, tous les hommes sont frères et se doivent protection ; ne me remerciez donc pas, je vous prie, pour une action bien simple : tout autre à ma place eût agi comme je l’ai fait.
– Peut-être, reprit l’inconnu ; pourtant soyez assez bon, je vous prie, pour me dire votre nom, afin que je sache à qui je dois la vie.
– Cela est inutile, fit don Miguel en souriant ; seulement, comme je vous crois étranger à ce pays, laissez-moi vous donner un conseil.
– Lequel, monsieur ?
– Celui de ne plus, dorénavant, vous attaquez aux peccaris ; ce sont des ennemis terribles que l’on ne peut vaincre que lorsque l’on se trouve en nombre, un homme seul commet, en les attaquant, une folie impardonnable dont il est toujours victime.
– Soyez convaincu, monsieur, que la leçon que j’ai reçue aujourd’hui me profitera et que jamais, je ne me fourrerai dans un guêpier semblable ; j’ai été trop près de payer cher mon imprudence. Mais je vous en prie, monsieur, ne nous séparons pas sans que je sache le nom de mon sauveur.
– Puisque vous l’exigez, monsieur, apprenez-le donc : je suis don Miguel Zarate.
L’inconnu lui jeta un regard étrange, en réprimant un mouvement de surprise.
– Ah ! fit-il d’un ton singulier, merci don Miguel Zarate ; sans vous connaître personnellement, je savais déjà votre nom.
– C’est possible, répondit l’hacendero, car je suis fort connu dans ce pays, où ma famille est établie depuis de longues années.
– Moi, monsieur, je suis celui que les indiens nomment Quitchasta-jouté, le mangeur d’hommes ; et les chasseurs, mes confrères, le Cèdre-Rouge.
Et après avoir porté la main à son bonnet, par forme de salut, cet homme jeta son rifle sur l’épaule, tourna sur lui-même et s’éloigna à grands pas.
Don Miguel le suivit un instant des yeux, puis il se dirigea tout pensif vers la maison qu’il habitait au Paso.
L’hacendero ne se doutait pas qu’il avait sacrifié son cheval favori pour sauver la vie à son ennemi le plus implacable.
V
La blessure
Au lever du soleil, don Miguel Zarate, monté sur un excellent cheval, quitta le Paso et se dirigea vers l’hacienda, qu’il habitait avec sa famille.
Cette hacienda était située à quelques milles du presidio de San Elezario, dans une position délicieuse ; on la nommait l’hacienda de la Noria (la ferme du Puits).
La propriété habitée par don Miguel Zarate s’élevait au centre du vaste delta formé par le del Norte et le rio San-Pedro, ou rivière du Diable.
C’était une de ces fortes et massives constructions comme seuls les Espagnols savaient en bâtir lorsqu’ils étaient maîtres absolus du Mexique.
L’hacienda formait un grand parallélogramme soutenu, de distance en distance, par d’énormes contreforts de pierre de taille, de même que toutes les habitations des frontières, qui sont plutôt des forteresses que des maisons, elle n’était percée sur la campagne que de rares et étroites fenêtres ressemblant à des meurtrières, et garnies de solides barreaux de fer.
Cette demeure était entourée d’un épais mur d’enceinte, garni à son sommet d’espèces de créneaux nommés almenas, qui indiquaient la noblesse du propriétaire.
En dedans de ce mur, mais séparés des appartements principaux, se trouvaient les communs, composés des écuries, des remises, des granges et du logement des peones.
À l’extrémité de la cour s’élevait, dans l’angle de l’hacienda, au-dessus de son toit en terrasse, le haut clocher carré de la chapelle.
Cette chapelle était desservie par un moine nommé Fray Ambrosio.
Une campagne magnifique formait à cette ferme une splendide ceinture.
Au fond d’une vallée, longue de plus de cinquante milles, se trouvaient des bois de cactus de forme conique, surchargés de fleurs et de fruits, et dont le tronc avait jusqu’à cinq et six pieds de diamètre.
Don Miguel employait un nombre considérable de peones, à cause de la culture de la canne à sucre qu’il faisait sur une grande échelle.
Chacun sait que la canne se plante en la couchant horizontalement dans des sillons d’un demi-pied de profondeur. De chaque nœud sort une tige qui atteint une hauteur de trois mètres environ, et que l’on coupe au bout d’un an pour en extraire le sucre.
Rien de pittoresque comme l’aspect que présente un champ de cannes.
Il faisait une de ces superbes matinées américaines pendant lesquelles la nature semble en fête.
Le centzontle (le rossignol américain) jetait souvent les notes harmonieuses de son chant ; les cardinaux à la gorge rose, les oiseaux bleus, les perroquets, gazouillaient et babillaient gaiement sous la feuillée ; au loin dans la plaine galopaient par troupes de légers antilopes, de craintifs asshatas, et parfois, à l’extrême limite de l’horizon, passaient en galopant des manadas effarés de chevaux sauvages, qui soulevaient des flots d’une poussière impalpable sous le choc de leurs sabots rapides.
Quelques alligators, nonchalamment étendus dans la vase du fleuve, séchaient leurs écailles au soleil, et, au plus haut des airs, de grands aigles de la Sierra Madre planaient majestueusement au-dessus de la vallée.
Don Miguel s’avançait rapidement au sobre-paso, allure favorite des ginetes mexicains, et qui consiste à faire lever les jambes de devant du cheval, tandis que celles de derrière rasent presque le sol, espèce d’amble particulier, qui est très doux et très rapide.
L’hacendero ne mit guère que quatre heures à franchir la distance qui le séparait de son habitation, où il arriva vers neuf heures du matin.
Il fut reçu sur le seuil de sa demeure par sa fille, qui, prévenue de son arrivée, s’était hâtée de venir au-devant de lui.
Don Miguel était absent de chez lui depuis une quinzaine de jours ; ce fut donc avec le plus grand plaisir qu’il reçut les caresses de sa fille.
Lorsqu’il l’eut embrassée à plusieurs reprises, tout en continuant à la tenir étroitement serrée dans ses bras, il la considéra attentivement pendant quelques secondes.
– Qu’as-tu donc, mi querida Clara ? lui demanda-t-il avec intérêt, tu sembles toute triste ; serais-tu donc fâchée de me voir ? ajouta-t-il en souriant.
– Oh ! vous ne le croyez pas, mon père, répondit-elle vivement, vous savez combien votre présence me rend heureuse au contraire.
– Merci, mon enfant ; mais d’où vient alors la tristesse que je vois répandue sur tes traits ?
La jeune fille baissa les yeux sans répondre.
Don Miguel jeta un regard inquisiteur autour de lui.
– Où est don Pablo, dit-il, comment n’est-il pas venu à ma rencontre, serait-il absent de l’hacienda ?
– Non, mon père, il est ici.
– Eh bien, alors, d’où provient qu’il ne se trouve pas auprès de toi ?
– C’est que... dit la jeune fille en hésitant.
– C’est que ?
– Il est malade.
– Malade ! mon fils ! s’écria don Miguel.
– Je me trompe, reprit doña Clara.
– Explique-toi, au nom du Ciel !
– C’est que, mon père, Pablo est blessé.
– Blessé ! exclama l’hacendero, et, repoussant brusquement sa fille, il se précipita vers la maison, monta rapidement les quelques marches du perron, traversa plusieurs salles sans s’arrêter, et arriva dans la chambre de son fils.
Le jeune homme était étendu pâle et défait sur son lit.
En apercevant son père, il sourit en lui tendant la main.
Don Miguel aimait beaucoup son fils, qui était son seul héritier.
Il s’avança vers lui.
– Quelle est cette blessure dont on m’a parlé ? lui demanda-t-il avec agitation.
– Moins que rien, mon père, répondit le jeune homme en échangeant un regard d’intelligence avec sa sœur qui entrait à ce moment, Clara est une folle qui, dans sa tendresse, vous a alarmé à tort.
– Mais enfin tu es blessé ? reprit le père.
– Oui, mais je vous répète que ce n’est rien.
– Enfin explique-toi ; où et comment as-tu reçu cette blessure ?
Le jeune homme rougit et garda le silence.
– Je veux le savoir, dit avec insistance don Miguel.
– Mon Dieu, mon père, répondit don Pablo d’un ton de mauvaise humeur, je ne comprends pas pourquoi vous vous inquiétez ainsi pour une cause aussi futile ; je ne suis pas un enfant pour lequel on doive trembler à la moindre égratignure, bien des fois je me suis blessé sans que vous vous en soyez si fort préoccupé.
– C’est possible ; mais la façon dont tu me réponds, le soin que tu sembles vouloir mettre à me laisser ignorer la cause de cette blessure, en tout me dit que, cette fois, tu veux me cacher quelque chose de grave.
– Vous vous trompez, mon père, et vous allez en convenir vous-même.
– Je ne demande pas mieux ; parle, Clara, mon enfant, va donner l’ordre de tout préparer pour le déjeuner. Je meurs littéralement de faim.
La jeune fille sortit.
– À nous deux maintenant, reprit don Miguel. Et d’abord où es-tu blessé ?
– Oh ! mon Dieu, j’ai l’épaule égratignée légèrement ; si je suis couché, il y a dans mon fait plus de paresse que d’autre chose.
– Hum ! qui t’a ainsi égratigné l’épaule ?
– Une balle.
– Comment ? une balle ! Tu t’es donc battu, malheureux ! s’écria don Miguel en tressaillant.
Le jeune homme sourit, pressa la main de son père, et se penchant vers lui :
– Voici ce qui s’est passé, lui dit-il :
– J’écoute, répondit don Miguel en faisant sur lui-même un effort pour se calmer.
– Deux jours après votre départ, mon père, continua don Pablo, je surveillais, ainsi que vous me l’aviez recommandé, les travaux de la sucrerie et la coupe des cannes, lorsqu’un chasseur que vous avez souvent vu rôder aux environs de l’habitation, un certain Andrès Garote, m’accosta au moment où, après avoir donné quelques ordres au majordome, j’allais rentrer. Après m’avoir salué obséquieusement, suivant son habitude, le drôle sourit cauteleusement, et, baissant la voix afin de ne pas être entendu de ceux qui m’entouraient : « N’est-ce pas, don Pablo, me dit-il, que vous donneriez de bon cœur une demi-once à celui qui vous apprendrait une nouvelle importante ? – C’est selon, lui dis-je, car connaissant l’homme de longue date, je savais qu’il n’y avait pas trop à s’y fier. – Bah ! votre grâce est si riche, reprit-il insidieusement, qu’une misérable somme comme celle-là, est moins que rien dans sa poche, au lieu que dans la mienne elle me ferait grand bien. » À part ses défauts, ce drôle nous a parfois rendu quelques petits services ; et puis, comme il le disait, une demi-once n’est qu’une misère ; je la lui donnai, il se hâta de la faire disparaître dans son habit, et se penchant à mon oreille : Merci, don Pablo, me dit-il, je ne vous volerai pas votre argent ; votre cheval est reposé, il peut fournir une longue course : rendez-vous à la vallée du Bison, là vous apprendrez quelque chose qui vous intéressera. Ce fut en vain que je le pressai de s’expliquer plus clairement, il me fut impossible d’en rien tirer davantage. Seulement, avant de me quitter : Don Pablo, ajouta-t-il, vous avez de belles armes, munissez-vous-en, on ne sait pas ce qui peut arriver. Je ne sais pourquoi la confidence tronquée de ce drôle, ses réticences même, éveillèrent ma curiosité ; je résolus de me rendre à la vallée du Bison afin d’avoir le mot de cette énigme.
– Andrès Garote est un coquin qui te tendait un piège, dans lequel tu es tombé, mon fils, interrompit don Miguel.
– Non, mon père, vous vous trompez : Andrès a été loyal envers moi, je n’ai que des remerciements à lui faire ; seulement, peut-être, aurait-il dû s’expliquer plus catégoriquement.
L’hacendero hocha la tête d’un air de doute.
– Continue, dit-il.
– J’entrai à l’habitation, je pris mes armes, puis, monté sur Negro, mon coureur noir, je me dirigeai vers la vallée du Bison. Vous savez, mon père, que l’endroit que nous nommons ainsi, et qui nous appartient, est une immense forêt de cèdres et d’érables de près de quarante milles de tour et traversée dans toute sa longueur par un large affluent du rio San-Pedro.
– Certes, je le sais, et je compte, l’année prochaine, y faire exécuter des abatis dans les hautes futaies.
– Vous n’aurez pas besoin de vous donner cette peine, fit le jeune homme en souriant, un autre a pris ce soin pour vous.
– Hein ? qu’est-ce que cela veut dire ? s’écria l’hacendero avec colère ; qui a osé ?