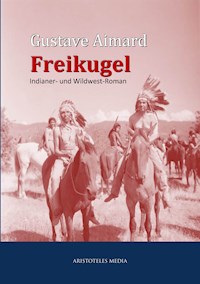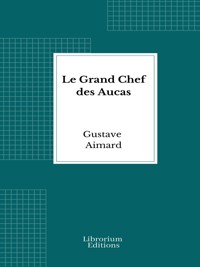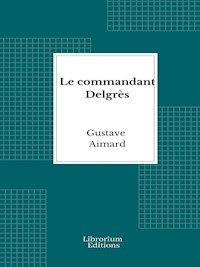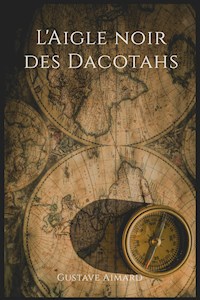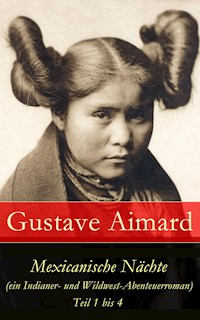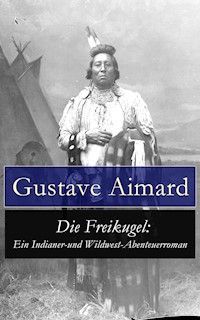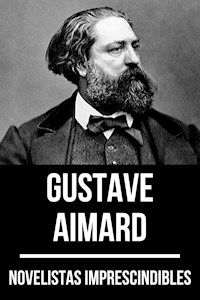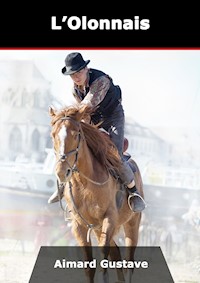2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Un seul ami lui était resté fidèle dans sa détresse ; cet ami était un des chiens de son maître qui n'avait pas voulu l'abandonner et que de guerre las Boute-Feu avait fini par laisser en arrière, sans plus s'en occuper que de son engagé, dont il se croyait débarrassé à tout jamais. Ce fut alors que, poussé à bout par le désespoir et la nécessité, se révéla le caractère résolu, l'énergie indomptable de cet homme qui, blessé et privé de tout secours, au lieu de se laisser abattre par la douleur et de s'abandonner soi-même, se raidit au contraire contre l'adversité et entreprit bravement de lutter jusqu'au bout pour sauver sa vie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ourson Tête-de-Fer
Pages de titrePage de copyrightGustave Aimard
Ourson Tête-de-Fer
Les rois de l’océan
Ourson Tête-de-Fer
Édition de référence :
Paris, Amyot, Éditeur, 1876.
Deuxième édition
À
Monsieur Paul Granier de Cassagnac
rédacteur du journalle Pays,
chevalier de la Légion d’honneur.
Mon cher Paul,
Tous deux nous faisons partie de la grande République des Lettres. Cette confraternité littéraire m’a fait vous connaître, il y a un an à peine. Ce laps de temps si court m’a permis cependant d’apprécier ce qu’il y a en vous de cœur et d’intelligence.
Malgré la différence sensible qui existera toujours entre nos opinions politiques, c’est avec un plaisir véritable que je vous dédie ce livre, qui a servi de trait d’union à notre liaison, et que je saisis ainsi l’occasion de me dire hautement et sincèrement
Votre ami
Gustave Aimard
Paris, 15 octobre 1868.
Causerie en forme d’introduction, dans laquelle l’auteur révèle au lecteur comment il fut amené, au moment où il s’en doutait le moins, à raconter la présente histoire.
Lors de mon dernier voyage en Amérique, voyage dont, soit dit en passant, la date, bien que je ne la fixe pas ici, n’est pas aussi éloignée que beaucoup de mes excellents amis de la presse ou autres feignent de le croire ; le bâtiment sur lequel j’avais pris passage au Havre, fatigué par plusieurs coups de vents successifs reçus par le travers des Petites-Antilles, laissa arriver plein vent arrière sur l’île Saint-Christophe où il se réfugia, le plus vite possible, afin d’aveugler une voie d’eau assez considérable que ses pompes ne réussissaient pas à affranchir, ainsi que disent les matelots dans leur pittoresque langage.
L’île Saint-Christophe dont j’ai parlé dans un précédent ouvrage sur les Frères de la Côte, ces grands déclassés du dix-septième siècle, mais que je ne connaissais pas alors, fut en réalité le berceau des flibustiers ; ce fut de là qu’ils partirent, pour s’abattre, comme un vol de vautours, sur l’île de la Tortue et Saint-Domingue.
L’île Saint-Christophe que les Caraïbes nommaient Liamniga, fait aujourd’hui partie des Antilles anglaises dans les Leeward-Islands, ou îles sous le vent ; elle se trouve à quatre-vingt-dix kilomètres O.-N.-O. d’Antigoa, et à cent vingt-cinq kilomètres de la Guadeloupe, tout auprès et au N-.O. de l’île Nevis ; par 170° 18’ de latitude N. et 65° de longitude O. Sa longueur totale est de vingt-quatre kilomètres ; d’origine volcanique, comme la plupart des autres îles des Antilles, elle est montagneuse et traversée par une chaîne, dont le mont Misère – mount misery – qui n’est qu’un volcan éteint haut de 1128 mètres, est le point culminant.
Cette île, aujourd’hui très florissante et qui fait un commerce considérable de rhum, de sucre, de café, de coton, etc, est très peuplée.
Les Français, au dix-huitième siècle, la nommaient l’île Douce ; un proverbe très répandu dans les Antilles disait :
La noblesse est à Saint-Christophe, les bourgeois sont à la Guadeloupe, les soldats à la Martinique, et les paysans à la Grenade.
Malgré toutes, les vicissitudes éprouvées par cette île, pendant près d’un siècle, avant d’être définitivement cédée à l’Angleterre par le Traité de Versailles, quelques familles françaises ont continué à l’habiter ; et la plupart d’entre elles jouissent d’une réputation méritée de loyauté et d’intelligence ; ces familles, quoique vivant sous la protectorat de l’Angleterre, sont restées essentiellement françaises, et bien que descendantes des premiers possesseurs de l’île, elles se considèrent comme étrangères et ne reconnaissent d’autre autorité que celle du consul français de la Basse-Terre, chef-lieu de l’île.
Le capitaine du navire m’avait averti en jetant l’ancre à Sandy-Point, que notre séjour serait assez long et que nous resterions au moins trois semaines à Saint-Christophe.
Je fus d’abord assez contrarié ; mais comme l’habitude des voyages et la fréquentation des hommes m’a muni, grâce à Dieu, d’une assez forte dose de philosophie pratique, je pris assez facilement mon parti de ce contretemps, et je cherchai à me mettre en mesure de passer ces trois semaines le moins désagréablement possible.
Ce n’était pas chose facile : les Anglais, fort peu accessibles chez eux et qui ne se piquent pas d’une grande urbanité envers les étrangers, sont inabordables dans leurs colonies ; d’ailleurs, j’avoue, en toute humilité, que jamais je n’ai éprouvé une grande sympathie pour ces insulaires égoïstes, froids, compassés, orgueilleux, qui professent un mépris profond pour tous les étrangers et, quoi qu’on en dise, haïssent les Français, qui le leur rendent bien, surtout en Asie, en Afrique et en Amérique, partout enfin où ces Carthaginois modernes ont des comptoirs.
Je ne songeai donc pas un seul instant à me présenter aux autorités de l’île ou à me faire présenter dans une famille anglaise. Le thé m’affadit le cœur et la morgue britannique me donne des crispations nerveuses.
Après avoir bouleversé tous mes papiers, je finis par découvrir une lettre de recommandation, qu’à tout hasard un de mes amis créoles de la Guadeloupe, et aujourd’hui rédacteur de l’un de nos grands journaux politiques, m’avait donnée la veille de mon départ de Paris.
– On ne sait pas ce qui peut arriver, m’avait-il dit en me remettant cette lettre ; peut-être des circonstances impossibles à prévoir conduiront-elles vos courses vagabondes à l’île Saint-Christophe ; je connais votre anglophobie, voici un mot pour un de nos parents fixé aux environs, je crois, de la Basse-Terre, je ne sais trop où ; car je ne l’ai jamais vu et je ne suis pas allé dans l’île ; mais ne craignez rien, présentez-vous hardiment, ce papier à la main, et vous serez bien reçu.
Je mis cette lettre avec beaucoup d’autres au fond d’un portemanteau et je n’y songeai plus.
Les paroles du capitaine et la menace d’un séjour prolongé à Saint-Christophe me remirent en mémoire la lettre de recommandation si dédaignée ; et ce fut avec un véritable mouvement de joie que je finis par la découvrir sous un amas de paperasses.
Cette lettre était adressée à monsieur le comte Henry de Châteaugrand, propriétaire à Saint-Christophe.
Je serrai ce précieux talisman dans mon portefeuille et je me fis descendre à terre.
Mon premier soin, aussitôt débarqué, fut de louer un cheval et un guide, moyennant deux livres, ce qui était assez cher pour un voyage de deux heures à peine, et de me diriger vers la Basse-Terre, où j’arrivai à trois heures de l’après-dîner.
Pendant tout le trajet je n’échangeai pas un mot avec mon guide, ce qui lui donna une haute opinion de ma personne ; je me contentai d’admirer le paysage qui était fort beau et surtout très accidenté.
Il faut rendre cette justice aux Anglais que, partout où ils prennent pied, ils impriment immédiatement un cachet particulier au pays, quel qu’il soit, lui donnent la vie, le mouvement et cette activité fébrile qui est le secret de leur prospérité commerciale. J’ai rarement vu de terres mieux cultivées, de routes plus soigneusement entretenues et de plus charmants cottages, même en Europe.
Ce ravissant tableau m’enchantait, cette petite île, point perdu dans l’immensité de l’Atlantique, respirait le bien-être et la prospérité ; c’était au point que j’en rougissais intérieurement pour nous autres Français, si maladroits pour tout ce qui regarde la colonisation, et qui avons réussi, grâce au système militaire si solidement et si malencontreusement établi dans nos colonies, à résoudre ce problème cependant si difficile, qui consiste à changer en quelques années d’occupation le pays le plus fertile et le plus peuplé en une terre aride et en un vaste désert.
En arrivant à la Basse-Terre, mon guide me demanda respectueusement si je descendais à l’hôtel Victoria.
Dans toutes les colonies anglaises, il y a un hôtel Victoria et un hôtel d’Albion.
Je le priai de me conduire directement au consulat de France.
Cinq minutes plus tard, je mettais pied à terre devant la maison du consul.
C’était un délicieux cottage entre cour et jardin, situé sur le quai même.
Je tressaillis de joie en apercevant les larges plis de notre cher drapeau tricolore onduler au souffle capricieux de la brise de mer. À l’étranger, je suis chauvin, je l’avoue en toute humilité, et je suis beaucoup de l’avis du brave général Lallemand qui disait, que tout Français sur le sol étranger devait représenter la France et la faire respecter en sa personne.
Le poste de vice-consul, dans cette île, est une des plus agréables sinécures qui soient au monde ; il n’entre pas trois navires français à Saint-Christophe par an, le vice-consul en serait réduit à se croiser les bras du matin au soir, comme le consul général du roi de Siam à Paris, si notre représentant, homme éminemment distingué et naturaliste fanatique, n’avait pas réussi à se créer des occupations particulières, qui ne lui laissaient pas un instant de loisir.
Monsieur Ducray, je cacherai sous ce pseudonyme le nom de cet excellent homme, auquel je suis redevable de n’être pas mort du spleen à Saint-Christophe, monsieur Ducray avait quarante cinq ans, il était grand, bien fait ; ses manières étaient élégantes ; sa physionomie ouverte, fine et spirituelle, était essentiellement sympathique ; il appartenait à une de ces familles françaises dont j’ai parlé plus haut, et jouissait d’une grande considération, même auprès des autorités anglaises de l’île.
Il me reçut à ravir, et m’obligea tout d’abord à congédier mon guide et mon cheval, en me disant que je lui appartenais pour tout le temps de mon séjour à Saint-Christophe ; un domestique noir se chargea de mon portemanteau, monsieur Ducray m’entraîna à sa suite, et il me conduisit à une chambre charmante prenant jour sur le port.
– Vous voilà chez vous, me dit monsieur Ducray en souriant, vous habiterez ici pendant tout le temps de votre séjour dans l’île.
Et comme je voulus me récrier et lui faire observer combien l’intrusion d’un étranger dans sa demeure pouvait avoir pour lui de désagrément et lui occasionner d’ennuis et de gêne.
– D’abord, cher monsieur, vous n’êtes pas un étranger, mais un compatriote, c’est-à-dire un ami ; d’ailleurs liberté entière, entrez, sortez, faites ce qu’il vous plaira, reprit-il, personne ne songera à s’informer de vos affaires ; ensuite je suis seul en ce moment, Mme Ducray et sa fille sont à Antigoa, chez une de leurs proches parentes, où elles doivent passer deux mois encore ; je suis donc provisoirement garçon ; donc, non seulement vous ne me gênez en rien, mais encore vous me rendez un véritable service en acceptant franchement mon hospitalité.
Il n’y avait rien à répondre à cela ; je serrai la main de monsieur Ducray et tout fut dit.
Il me laissa remettre un peu d’ordre dans ma toilette, puis je le rejoignis.
Monsieur Ducray avait été averti le matin même de notre arrivée, il attendait le capitaine à dîner.
Je regrettai de ne pas avoir averti celui-ci, dans mon empressement à descendre à terre, de l’excursion que je projetais ; mais le mal était fait, il n’y avait plus à y revenir.
– J’ai oublié de vous avertir, reprit en souriant monsieur Ducray, que la cloche sonne quatre fois par jour, pour le déjeuner, le lunch, le dîner et le souper qui a lieu à huit heures du soir.
– Ah çà, mais vous mangez donc toute la journée ? lui demandai-je en riant.
– À peu près, me répondit-il sur le même ton, nous avons adopté les coutumes anglaises, et vous savez que les Anglais sont grands mangeurs et surtout grands buveurs ; mais que cela ne vous inquiète pas ; ici on ne mange, et on ne boit que lorsqu’on a faim et soif ; ainsi vous voilà averti ; d’ailleurs la cloche sonnée, on n’attend personne pour se mettre à table : vous n’avez donc pas à vous gêner avec nous plus que nous ne nous gênerons avec vous. Il faut en prendre votre parti, cher monsieur, je vous ai bel et bien confisqué à mon profit. Que voulez-vous ? il ne vient pas assez souvent des Français sur cet îlot perdu, pour qu’on les laisse échapper, lorsque, par hasard, quelques-uns se fourvoient dans nos parages. Venez voir mes collections, elles sont fort belles et surtout très curieuses.
Je le suivis aussitôt.
Ce que monsieur Ducray appelait modestement ses collections était tout simplement un musée, qui occupait cinq grandes pièces de sa maison ; il avait réuni là avec une patience et une intelligence remarquables, des spécimens de la flore si riche et si nombreuse de toutes les Antilles grandes et petites. La faune des ces îles également très richement représentée sous les deux formes mammologique et entomologique ; puis venaient des minéraux de toutes sortes et de toutes espèces, des antiquités caraïbes, découvertes Dieu sait comment ; et tout cela rangé et étiqueté avec un ordre et un soin à rendre jaloux un employé supérieur de notre muséum de Paris.
Humboldt, d’Orbigny et deux ou trois autres savants illustres avaient visité ce musée ou ces collections, comme il plaira au lecteur de les nommer, et ils en avaient été émerveillés.
Il y avait de quoi ; je n’avais quant à moi jamais rien vu de si curieux et de si intéressant.
Trois heures s’écoulèrent avec une rapidité extrême au milieu de toutes ces merveilles, que je ne me lassais pas d’admirer, et je serais resté là sans m’en douter jusqu’au soir, si un domestique noir n’était venu nous déranger, en annonçant à monsieur Ducray l’arrivée de monsieur Dumont, mon capitaine.
Monsieur Dumont attendait le vice-consul au salon ; le brave capitaine fut d’abord assez surpris de me voir là, il me croyait tout simplement à Sandy-Point ; tout s’expliqua.
Cinq minutes plus tard nous nous mettions à table.
La conversation roula d’abord sur la France et les événements qui s’y étaient passés depuis quelques mois ; le capitaine avait apporté un paquet de journaux dont il fit cadeau à monsieur Ducray, qui, ignorant complètement les affaires d’Europe, fut très flatté de cette occasion de se remettre un peu au courant de notre politique nationale ; puis lorsque les bases d’un emprunt à la grosse, que le capitaine voulait contracter pour parer aux avaries de son bâtiment, eurent été discutées et passées entre lui et le vice-consul, la conversation fit un brusque crochet et tout naturellement tomba sur l’île Saint-Christophe.
Là, monsieur Ducray était sur son terrain, et avec la plus obligeante complaisance, il nous mit au courant des habitudes des créoles de l’île, des plaisirs en très petit nombre et des ressources très restreintes que le pays offrait aux étrangers.
– Vous avez plusieurs familles françaises, demanda le capitaine ? Sont-elles riches, bien vues ?
– Elles sont en général fort riches, et très bien vues des autorités anglaises, bien qu’elles n’aient avec elles que très peu de points de contacts, et des rapports excessivement rares, répondit monsieur Ducray. Toutes ces familles sont restées françaises ; aucunes sollicitations, aucunes flatteries n’ont pu les contraindre à accepter la naturalisation anglaise, elles restent obstinément attachées à leur nationalité. Leurs enfants, élevés en France pour la plupart, servent leur pays soit dans la magistrature soit dans la diplomatie, puis leur dette payée à leur patrie, ces soldats, ces magistrats ou ces diplomates, reviennent ici finir tranquillement leurs jours.
– Savez-vous que c’est tout simplement magnifique, ce que vous nous dites là, m’écriai-je.
– Cela n’a rien de bien extraordinaire, reprit avec bonhomie monsieur Ducray ; la politique a des exigences auxquelles les particuliers ne sont pas tenus de se soumettre ; il en est à peu près de même dans toutes les anciennes possessions françaises ; cependant je dois avouer que ces préjugés, c’est le nom que les Anglais donnent à notre attachement à la mère patrie, ces préjugés, sont ici beaucoup plus invétérés que partout ailleurs.
– À quelle cause attribuez-vous ce fait, demandai-je curieusement ?
– Dans le principe, Saint-Christophe a été possédé en commun par les Français et les Anglais ; par un hasard singulier, en même temps que des aventuriers français y débarquaient d’un côté, des aventuriers anglais y arrivaient d’un autre. Ces aventuriers vécurent d’abord en bonne intelligence, puis les Français finirent, par expulser complètement les Anglais et par demeurer maîtres de l’île entière ; les Anglais essayèrent, à plusieurs reprises, de reprendre pied sur l’île, mais toujours vainement ; mais vous savez, ajouta-t-il, que ce que les Anglais veulent ils le veulent bien, l’entêtement est leur plus précieuse qualité. Le Traité de Versailles trancha définitivement la question en leur faveur, mais il fut stipulé que les familles françaises qui voudraient continuer de résider dans l’île seraient libres de le faire tout en conservant leur nationalité ; ces familles descendaient toutes des premiers occupants, chacune d’elles comptait, au nombre de ses ascendants, au moins un de ces célèbres flibustiers qui, pendant près d’un siècle, tinrent l’Europe en échec et firent trembler l’Espagne, à la puissance de laquelle ils portèrent les premiers et les plus rudes coups.
– Ainsi les représentants actuels sont les descendants...
– Des flibustiers, qui plus tard s’emparèrent de la Tortue, interrompit-il, et de plus de la moitié de l’île Saint-Domingue, moi-même je suis arrière-petit-fils de ce fameux Ducray, qui, avec cent hommes seulement, s’empara de la Grenade et la mit à rançon ; le marquis de la Motheherbue est allié de très près à monsieur d’Ogeron, le baron Ducasse descend du célèbre flibustier que Louis XIV nomma chef d’escadre ; le chevalier du Plessis, le baron du Rossey, le comte de Châteaugrand, le chevalier Levasseur, descendent tous d’aventuriers qui ont tous joui d’une réputation universelle ; vous comprenez très bien que ces hommes, dont les ancêtres avaient fondé l’influence française en Amérique, sont jaloux de leur titre de Français et tiennent à habiter une terre dont leurs ancêtres sont partis sous la conduite de Montbars pour accomplir de si grandes choses.
– Certes, je le comprends et je suis fier pour mon pays de cette fidélité inviolable à notre patrie commune ; mais pardon, parmi les personnes dont vous avez cité les noms, il m’a semblé vous entendre prononcer celui de monsieur le comte de Châteaugrand.
– Je l’ai prononcé, en effet, monsieur, répondit le consul avec son charmant sourire, et c’est peut-être le plus honorable et le plus vénéré, ce nom nous est cher à bien des titres ; connaîtriez-vous monsieur le comte de Châteaugrand ?
– Comment le connaîtrai-je, monsieur, si je ne suis jamais venu dans ce pays ?
– Cela n’empêcherait pas, monsieur ; d’ailleurs vous pouvez connaître des Châteaugrand de la branche cadette ; cette famille est originaire de l’Angoumois où quelques-uns de ses membres résident encore.
– Non, monsieur, je suis tout prosaïquement porteur d’une lettre de recommandation qu’à mon départ de Paris M. P... de C..., de la Guadeloupe, a bien voulu me remettre pour M. le comte Henry de Châteaugrand.
– Oh ! vous serez bien reçu par le comte Henry, monsieur, et je me charge dès demain de vous présenter moi-même.
– Vous me comblez, monsieur ; mais quel est donc, s’il vous plaît, ce comte Henry dont vous semblez ne prononcer le nom qu’avec vénération.
M. Ducray sourit et s’appuyant sur la table tout en jouant machinalement avec son couteau :
– Monsieur, me dit-il, le comte Henry de Châteaugrand est une de ces natures d’élite, un de ces grands caractères comme la nature n’en coule qu’un sur cent millions peut-être ; vous allez lui être présenté, il est donc nécessaire que je vous le fasse connaître en deux mots.
– Je vous aurai une grande obligation de cette complaisance.
– Le comte Henry de Châteaugrand a aujourd’hui quatre-vingt-seize ans ; c’est un homme de haute taille, aux traits énergiques, fins et distingués à la fois ; son œil est vif ; sa physionomie douce, spirituelle, a une expression de bonté inexprimable à laquelle les longues mèches de sa chevelure argentée, et sa barbe blanche tombant presque sur sa poitrine, impriment un cachet de grandeur et de majesté. Malgré son âge avancé, le comte est robuste encore, sa taille est droite, sèche, nerveuse ; il monte à cheval et chasse comme s’il n’avait que quarante ans ; la fatigue et la maladie n’ont pas de prise sur cette vigoureuse nature ; à moins d’accident imprévu, il est taillé pour vivre cinquante ans encore. Tel il est au physique, tel il est au moral ; après avoir fait la guerre d’Amérique avec Rochambeau et le marquis de la Fayette, il suivit en France son ancien général et son ami ; en 1789 il avait vingt-sept ans, il fut un des rares gentilshommes qui saluèrent avec un véritable enthousiasme l’aurore de l’ère régénératrice qui commençait à poindre. M. de Châteaugrand est issu de race guerrière, sa place était donc aux armées ; en 1792, il partit comme volontaire pour la frontière du nord ; il assista comme aide de camp de Pichegru à la prise des lignes du Wissembourg ; en 1795 il était général ; plus tard il suivit en Égypte le général Bonaparte, le 18 brumaire l’attrista, il comprit l’abîme vers lequel l’enthousiasme irraisonné des masses entraînait la France ; le héros de Lodi et des Pyramides, marchait à pas de géant vers le but qu’il s’était marqué ; les populations fascinées le suivaient en l’acclamant ; ce n’était plus Bonaparte, ce n’était pas encore Auguste, c’était César, il n’avait plus qu’à étendre le bras pour saisir la pourpre impériale et confisquer à son profit les libertés si chèrement conquises par près de quinze ans d’une lutte gigantesque, soutenue contre toute l’Europe en armes ; la dernière heure de la République sonna, le comte de Châteaugrand comprit que le rôle des véritables soldats de 1792 était fini, que désormais toutes les aspirations de la France seraient étouffées et absorbées par la gloire d’un seul homme ; le comte courba tristement la tête, brisa son épée ; et pour toujours il quitta la France en pleurant sur elle et sur ses destinées ; il revint à Saint-Christophe, où il s’enferma comme dans une imprenable citadelle, et que depuis, il n’a plus quitté ; voilà quel homme est le comte de Châteaugrand. Chaque victoire nouvelle de la fulgurante épopée impériale le faisait tressaillir comme un lion blessé ; cette utopie grandiose de la reconstruction du trône de Charlemagne l’effrayait ; dès 1800 il prévoyait 1814 ; ses prévisions se réalisèrent ; il en gémit amèrement, car derrière le titan foudroyé, il voyait le corps pantelant de la France, agonisante et se débattant dans les affres de la mort ; mais il demeura fidèle à son serment et à ses convictions : bien des offres lui furent faite, il les repoussa toutes. En apprenant la révolution de 1848, il sourit tristement : Où est l’enthousiasme de 92 ? dit-il ; un gouvernement ne s’impose pas, quelque soit le nom qu’il se donne ; on ne refait pas deux fois la même chose ; la chute alors est grotesque ou misérable. Depuis lors pas un mot n’est sorti de sa bouche, touchant les événements politiques ; il vit patriarcalement au milieu de sa famille ; mais ses yeux sont sans cesse tournés vers cette France pour laquelle il a prodigué son sang sur vingt champs de bataille, dont il s’est exilé volontairement et qu’il ne reverra jamais.
Le capitaine Dumont et moi, nous avions écouté ce récit si simple et si beau avec une émotion profonde.
– Sacrebleu ! s’écria le capitaine, votre comte de Châteaugrand est un rude homme.
– Oui, reprit en souriant monsieur Ducray, c’est un homme dont le cour est immense, capable de tous les sacrifices et qui mourra ignoré de son pays pour lequel il a tant fait.
– L’ingratitude des peuples est l’auréole que Dieu met au front des grands citoyens.
– Mais je n’insisterai pas davantage sur ce sujet ; demain, monsieur, vous verrez le comte et vous le jugerez. Messieurs, voici des cigares de la Havane, je vous les garantis excellents.
– Un mot encore s’il vous plaît, monsieur, dis-je en choisissant un cigare.
– Parlez, monsieur.
– Et ce comte de Châteaugrand descend, lui aussi, d’un célèbre flibustier.
– Du plus grand de tous peut-être ; car sa gloire fut toujours sans tache : il ne fut ni cruel comme Montbars l’Exterminateur son ami, ni pillard comme Morgan, ni féroce comme l’Olonnais, ni débauché et vindicatif comme le Beau Laurent ; cet homme, dont les exploits firent si longtemps trembler l’Espagne pour ses colonies, obligea ses ennemis mêmes à l’admirer.
– Oh ! je sais son nom alors, m’écriai-je vivement ; car les annales de la flibuste, écrites par Olivier Oexmelin, ne citent qu’un homme qui ressemble au splendide portrait que vous venez de faire.
– Et cet homme ? dit en souriant le consul.
– C’était Ourson Tête-de-Fer.
– Eh bien, cher monsieur, reprit monsieur Ducray en se levant pour nous conduire sur la terrasse afin de jouir de la brise de mer, le comte Henry de Châteaugrand est l’arrière-petit-fils de Ourson Tête-de-Fer.
À cette révélation, je demeurai littéralement frappé de stupeur, tant j’étais loin de m’y attendre.
Quoique le lit que m’avait donné monsieur Ducray fût excellent, cependant la curiosité que j’éprouvais m’avait causé une telle surexcitation nerveuse que la nuit entière s’écoula sans que j’essayasse de dormir ou que j’en eusse seulement envie.
J’avais hâte de me trouver en face de cet homme qu’on m’avait représenté si grand et chez lequel, après quatre générations écoulées, revivaient, épurées par une civilisation plus complète, les nobles qualités de son ancêtre.
Car Ourson Tête-de-Fer était un de mes vieux amis : j’avais lu et relu cent fois sa vie si belle, ses aventures si étranges et ses exploits si extraordinaires, dans les quelques auteurs qui se sont occupés de ces grands déclassés du dix-septième siècle et qui se donnaient à eux-mêmes le nom significatif de Frères de la Côte.
Mais plusieurs points étaient demeurés constamment obscurs pour moi, dans les relations que j’avais lues si avidement et qui parlaient du célèbre aventurier ; sans doute Olivier Oexmelin, cet auteur si véridique, qui lui-même avait assisté comme acteur à la plupart des scènes qu’il raconte avec une si naïve bonhomie, et les autres auteurs qui avaient traité le même sujet, ne connaissaient de Ourson Tête-de-Fer que l’homme public, le héros, et ignoraient complètement l’homme privé ; car nulle part je n’avais trouvé de détails sur l’existence particulière de cet homme, qui m’apparaissait toujours enveloppé d’une auréole glorieuse, et qui cependant devait avoir aimé, souffert et lutté comme tous les autres membres de la grande famille humaine.
C’était ce point sombre que je brûlais d’éclaircir, ces détails si précieux que je voulais connaître.
Nul homme n’est grand pour son valet de chambre, a dit je ne sais qui ; cette parole, beaucoup plus spécieuse qu’exacte, tourmentait, aiguillonnait ma curiosité, et me poussait à essayer de découvrir par tous les moyens ces détails intimes qui ont tant de prix pour la connaissance complète de l’homme que l’on veut peindre ressemblant.
Le jour parut enfin à mon grand soulagement ; cependant je dus patienter encore, et ne pas donner à mon excellent hôte une fâcheuse opinion de moi, par une précipitation maladroite à me présenter à lui et le mettre dans l’obligation de remplir la promesse qu’il m’avait faite.
Vers huit heures du matin pourtant, je n’y pus tenir davantage et je descendis.
Mon hôte était complètement habillé.
Il m’attendait en fumant un cigare, tout en se promenant de long en large dans le salon.
– Ah ! fit-il en m’apercevant, vous voilà. Eh ! il me semble que vous avez bien dormi.
– Parfaitement, répondis-je avec un sourire en songeant que je n’avais pas fermé l’œil.
– Moi, je suis debout depuis six heures ; toutes les affaires de la chancellerie sont terminées. Je veux vous donner ma journée tout entière.
– Tout en vous remerciant de votre inépuisable complaisance, je regrette de vous causer cet embarras.
– De quel embarras parlez-vous ? cher monsieur.
– Mais d’abord, ce travail matinal.
Monsieur Ducray se mit à rire.
– Vous plaisantez, me dit-il ; on se lève de très bonne heure dans les colonies, afin de profiter de la brise de mer, les affaires se font le matin. Dans le milieu du jour les maisons sont fermées, tout le monde dort.
– Pardieu, m’écriai-je avec dépit, c’est fait pour moi !
– Qu’est-ce qui est fait pour vous ? me demanda-t-il avec étonnement.
– Eh ! sapristi, ce qui m’arrive ; figurez-vous que ma curiosité de voir le comte Henry est si grande que je n’ai pas dormi une minute de toute la nuit, et que je ne me suis pas levé dans la crainte de vous importuner en vous paraissant trop matinal.
– Ah ! s’écria-t-il en riant, cher monsieur, combien vous vous êtes trompé ; jugez-en. J’ai contracté, ou du moins fait contracter à votre capitaine l’emprunt à la grosse dont il avait besoin ; il est parti pour Sandy-Point il y a une demi-heure, son argent en poche et fort content, je vous assure.
– Je le crois.
– Puis, ainsi que je vous l’ai dit, j’ai réglé les affaires de la chancellerie ; j’ai fait un tour sur le port, de plus, j’ai expédié au comte de Châteaugrand un exprès pour lui annoncer notre arrivée, de sorte qu’on nous attend à déjeuner ; puis je suis venu ici fumer un cigare en vous attendant ; croyez-vous encore que vous m’auriez désobligé en descendant de meilleure heure ? Mais ne parlons plus de cela, buvons un verre de vieux rhum, allumons un puro et à cheval ! nous avons trois lieues à faire.
Ce qui était dit fut fait, cinq minutes plus tard nous étions à cheval, après avoir bu un verre d’excellent rhum et allumé un cigare non moins excellent.
Deux domestiques noirs, en livrée et à cheval comme nous, nous suivaient à distance respectueuse.
La matinée était magnifique, l’air tiède, la brise fraîche ; nous suivions une route aussi parfaitement entretenue qu’une allée d’un parc royal, bordée de ces magnifiques végétaux des tropiques qui répandent une si agréable fraîcheur ; des milliers d’oiseaux chantaient à plein gosier, blottis sous la feuillée, et nous voyons sauter de branche en branche, en nous faisant les grimaces les plus grotesques, des singuliers petits singes particuliers à l’île Saint-Christophe et dont l’espèce ne se rencontre que là.
Ces animaux sont, soit dit en passant, un véritable fléau pour les colons qui ne savent comment s’en délivrer, et dont ils dévastent les récoltes.
Après trois quarts d’heure de marche à peu près, nous arrivâmes au pied d’une falaise assez élevée, au sommet de laquelle était bâtie une maison ou plutôt un château magnifique, entouré de tous les côtés, excepté de celui de la mer, d’une végétation luxuriante et presque enfoui dans un véritable océan de verdure.
– Voyez-vous ce château ? me dit M. Ducray,
– Certes, je le vois, et il me semble magnifique.
– Il l’est en effet ; eh bien ! saluez mon cher compatriote. À la place où se trouve aujourd’hui ce château, où nous nous rendons, s’élevait, à une autre époque, une maisonnette construite par Montbars, à son arrivée en Amérique, et la première qu’il ait habitée sur le sol du Nouveau-Monde ; c’est là où fut organisée la fameuse expédition qui devait donner aux Frères de la Côte l’île de la Tortue et une partie de l’île de Saint-Domingue.
– Hum ! la position était bien choisie, pour une aire, c’est un véritable nid d’aigle.
– Ou de vautour ; cette maison fut donnée à Ourson Tête-de-Fer, son matelot, par Montbars lui-même, quelque temps après la fameuse expédition de Carthagène de Indias.
Tout en causant ainsi, nous avions franchi la rampe assez escarpée qui conduit au château et nous étions arrivés sur une large esplanade en terrasse, entourée de murs et garnie d’arbres ; après avoir franchi une grille en fer forgé, curieusement travaillée, et avoir pendant près de cinq minutes suivi une large allée bordée d’aloès et de cactus cierges, nous nous arrêtâmes devant un perron de marbre à double escalier, au haut duquel un vieillard de haute stature, à la barbe longue et blanche, à la physionomie douce et fière à la fois, nous attendait.
Au portrait que m’en avait fait, la veille, M. Ducray, je reconnus aussitôt le comte de Châteaugrand : il n’y avait pas à s’y tromper, la ressemblance était frappante.
La réception fut des plus cordiales, le comte prit pour la forme ma lettre d’introduction, sur laquelle il jeta à peine les yeux, et après m’avoir serré affectueusement la main et souhaité la bienvenue, il nous précéda et nous introduisit dans un immense salon, meublé entièrement à la mode de la fin du dix-huitième siècle, c’est-à-dire des dernières années de Louis XVI. Personne ne se trouvait dans le salon, lorsque nous y fûmes introduits.
Le comte nous invita à nous rafraîchir, selon l’hospitalière coutume créole, qui fait que dans chaque appartement des rafraîchissements sont préparés d’une façon permanente, afin que l’étranger n’ait même pas besoin de formuler un désir. Puis tout en fumant et se rafraîchissant, on causa en attendant le déjeuner.
J’avoue que j’étais très peu à la conversation ; dès mon entrée dans le salon, mon attention avait été complètement absorbée par un magnifique tableau signé : Philippe de Champaigne, 1672, c’est-à-dire un des derniers chefs-d’œuvre de ce grand peintre, puisqu’il mourut en 1674.
Ce tableau de dimensions colossales, puisqu’il avait plus de quinze pieds de haut, était seul dans le salon ; il représentait un paysage accidenté de l’île Saint-Domingue : à droite un boucan, un homme à genoux, à demi vêtu et dont on apercevait à peine le visage, faisait sécher des viandes sur la barbacoa ; au fond, on entrevoyait à travers une éclaircie, entre les arbres d’une épaisse forêt, plusieurs soldats espagnols, armés de longues lances et qui semblaient s’avancer avec des précautions étranges.
Sur le devant du tableau et semblant sortir de la toile tant il était vivant, se tenait un homme, de trente-deux à trente-trois ans, vêtu d’une blouse de toile bise, tâchée de graisse et de sang, de larges chausses descendant jusqu’aux genoux, laissant les jambes nues, et chaussé de brodequins en cuir fauve ; une ceinture en peau de crocodile serrait sa taille ; dans cette ceinture étaient passés à gauche, dans un large étui aussi en peau de crocodile, quatre longs couteaux, à droite un sac à balle et une corne de taureau.
Cet homme appuyait ses deux mains croisées sur l’extrémité du canon d’un long fusil, à garniture d’argent, dont la crosse reposait près de son pied gauche ; auprès de lui étaient couchés trois chiens courants au poil fauve moucheté de noir, au large poitrail et aux longues oreilles pendantes, et trois sangliers.
Les traits de cet homme, sauf la différence d’âge et la couleur d’un noir bleu de ses cheveux flottants et de la barbe qui couvrait sa poitrine, avaient une ressemblance frappante avec ceux du comte de Châteaugrand, même expression, fine, spirituelle et énergique à la fois, même éclair dans le regard ; un rayon de soleil se jouait sur le visage de cet homme ou il jetait une ombre qui imprimait à sa physionomie un cachet d’inexprimable mélancolie.
C’était bien là, à n’en pas douter, le portrait saisi, pour ainsi dire, sur le fait d’un de ces redoutables flibustiers ou boucaniers de Saint-Domingue, qui traitaient d’égal à égal avec les plus puissants souverains.
Ce boucanier devait être un des ancêtres du comte, probablement Ourson Tête-de-Fer lui-même.
Ma préoccupation était si grande que le comte finit par la remarquer ; il suivit la direction de mon regard, et avec une charmante bonhomie :
– Ah ! ah ! me dit-il, vous regardez cette peinture ? Eh bien qu’en pensez-vous, mon cher compatriote.
– Je pense, monsieur le comte, que c’est un chef-d’œuvre.
– Oui, Philippe de Champaigne excellait surtout dans les portraits, ainsi que vous le savez sans doute.
– C’est donc un portrait, m’écriai-je avec une naïve hypocrisie ?
– Oui, dit-il en relevant fièrement la tête, c’est le portrait de mon aïeul, le capitaine Ourson Tête-de-Fer ; il voulut être peint ainsi dans son costume de boucanier, lors de son retour en France après son mariage.
– Comment ! m’écriai-je ; mais m’arrêtant à propos devant l’énormité que j’allais prononcer, je me tus subitement.
Le comte sourit.
– Ne connaissez-vous donc pas l’histoire de ce célèbre chef des Frères de la Côte, reprit-il ?
– Très peu, monsieur le comte, et je le regrette bien vivement, car jamais histoire ne m’a plus intéressé que celle-là.
En ce moment la cloche sonna et le comte nous fit passer dans la salle à manger.
Plusieurs personnes nous attendaient ; parmi elles se trouvaient trois dames, jeunes encore et fort belles, et quatre hommes dont deux avaient de vingt à vingt-cinq ans.
Les quatre hommes étaient : les deux premiers, les gendres du comte ; les deux plus jeunes, ses neveux.
Monsieur de Châteaugrand me présenta ; puis on se mit à table.
– J’ai encore deux fils, me dit le comte, mais ils sont absents ; le premier est contre-amiral et commande la station du Brésil, l’autre est général de division et se trouve, je crois, en ce moment à Rome.
Je passai deux jours au château, le comte ne voulait pas me laisser retourner à la Basse-Terre.
Mes visites se renouvelèrent, et cela si bien que bientôt je pris l’habitude de venir tous les jours dîner au château et passer la soirée avec le comte et sa famille.
Le comte causait fort bien, ce qu’on ne sait plus faire aujourd’hui ; sa mémoire, qui était très bonne et très sûre, lui fournissait une quantité d’anecdotes piquantes, sur les dernières années du règne de Louis XVI et les premières de la Révolution ; il avait connu intimement tous les personnages célèbres de ces deux époques et racontait sur eux des choses excessivement curieuses.
Il avait été lié avec Danton, Camille Desmoulins, les deux Robespierre, Saint-Just, Fouché, et il me faisait voir ces hommes, qui eurent une si grande influence sur la Révolution, sous un jour tout différent que celui sous lequel je les avais envisagés jusque-là.
Le comte ne jugeait ni n’appréciait, il contait franchement, nettement ce qu’il avait vu et entendu, et laissait à son auditeur à tirer la conséquence de ce qu’il lui avait dit.
Nos soirées s’écoulaient avec une rapidité extrême dans ces charmantes causeries, entremêlées parfois, mais rarement, de musique ; car le piano, ce fléau créé pour le désespoir de nos oreilles, a franchi aujourd’hui et pénétré même jusqu’à cette si inoffensive île de Saint-Christophe.
Cependant une chose me tourmentait : souvent j’avais essayé de mettre la conversation sur les boucaniers, et chaque fois le comte avait aussitôt détourné cette conversation ; il semblait prendre un malin plaisir à me taquiner en ne voulant pas me laisser formuler nettement la demande que j’avais constamment sur les lèvres, sans jamais pouvoir parvenir à l’articuler.
Le temps passait rapidement ; depuis près d’un mois j’étais à Saint-Christophe, le capitaine Dumont avait terminé les réparations de son navire, il embarquait des vivres et de l’eau ; sous deux jours il devait appareiller.
Je me sentais triste de quitter ces hôtes qui m’avaient si bien accueilli, moi étranger ; je ne savais comment prendre congé d’eux, j’hésitais à le faire et je reculais le plus possible le moment de cette séparation, qui devait être éternelle.
Pourtant il fallut enfin me résoudre à annoncer mon départ ; le lendemain à huit heures du matin, le navire mettait sous voiles, le soir même, je devais être rendu à Sandy-Point et m’embarquer immédiatement.
Le capitaine avait eu l’obligeance de me prévenir qu’un canot m’attendrait jusqu’à minuit : il était huit heures du soir, je n’avais pas un instant à perdre,
La séparation fut pénible, cette charmante famille s’était habituée à moi et me considérait déjà comme un vieil ami ; tous voulurent m’accompagner jusqu’à la grille, où un domestique de monsieur Ducray m’attendait avec deux chevaux, que cet excellent homme avait mis à ma disposition.
Les adieux se prolongèrent assez longtemps, puis il fallut se séparer ; je partis.
À onze heures du soir, j’arrivai à Sandy-Point ; au moment où j’allais m’embarquer dans le canot qui devait me conduire à bord, le domestique qui m’avait accompagné m’arrêta respectueusement :
– Pardon, Massa, me dit-il, monsieur le comte m’a chargé de vous remettre cela, en m’ordonnant de vous dire que c’était un souvenir qu’il vous donnait pour que vous n’oubliez pas la famille de Châteaugrand.
Je pris le paquet soigneusement enveloppé, ficelé et cacheté qu’il me donna, je lui mis un louis dans la main et je descendis dans le canot.
Le lendemain, lorsque je m’éveillai, nous étions sous voiles, l’île de Saint-Christophe n’apparaissait plus à l’horizon que comme un nuage bleuâtre qui l’effaçait de plus en plus et ne tarderait pas à disparaître.
Je me souvins alors du mystérieux paquet, que le comte de Châteaugrand m’avait fait remettre d’une façon si singulière, je l’ouvris ; mais tout à coup je jetai un cri de joyeuse surprise et je le laissai tomber. Je me hâtai de le ramasser ; puis, après avoir poussé le verrou intérieur de ma cabine pour n’être pas dérangé, je m’assis à mon bureau et je posai soigneusement le paquet devant moi.
Ce paquet contenait d’abord un billet de quelques lignes.
Ce billet était à mon adresse.
Il était ainsi conçu :
« Mon cher compatriote,
« Pardonnez-moi le malin plaisir que j’ai semblé prendre à détourner l’entretien chaque fois que vous ayez essayé de le faire tomber sur mon noble ancêtre : ce sont taquineries de vieillard quinteux dont vous ne devez pas me garder rancune.
« Je pense, comme vous, que les boucaniers ou flibustiers du dix-septième siècle ne sont pas connus ou, ce qui est pire, le sont mal.
« Boucanier, flibustier, ces deux mots sont devenus synonymes de voleur, d’assassin et de pirate.
« Rien n’est plus faux cependant, les flibustiers avaient beaucoup de ressemblance avec les pèlerins de Portsmouth ; comme eux ils cherchaient la liberté de conscience et réclamaient celle des institutions ; de plus qu’eux ils voulaient la liberté des mers, la franchise du commerce et l’extinction du monopole odieux que les Espagnols avaient organisé à leur profit sur presque la totalité du Nouveau Monde.
« Les flibustiers étaient des libres-penseurs et surtout des initiateurs.
« La France leur a dû ses plus belles colonies, l’Espagne la perte de sa puissance.
« Le mal qu’ils ont fait est oublié, le bien est resté ; la France en a profité tout en les flétrissant du nom de pirates, après avoir traité avec eux et les avoir avoués et protégés.
« Elle leur devait cette suprême insulte, son ingratitude lui faisait un devoir de s’acquitter ainsi envers eux des immenses services qu’ils lui avaient si généreusement rendus.
« Vous voyez, mon cher compatriote, que je n’ai rien oublié des quelques causeries à bâtons rompus que nous avons eues sur les flibustiers, et que je partage entièrement votre opinion à leur sujet.
« Acceptez, je vous prie, en souvenir des bonnes heures que nous avons passées ensemble et de ma sincère amitié, le manuscrit ci-joint : il est entièrement de la main de mon aïeul, c’est une espèce de journal écrit par lui, au jour le jour, où se trouvent des documents précieux non seulement sur lui, mais encore sur quelques-uns de ses plus célèbres compagnons.
« Dans quel but mon aïeul a-t-il écrit ce journal ? Je l’ignore. Peut-être voulait-il, lui aussi, écrire une histoire des flibustiers ; mais si telle a été d’abord son intention, il a sans doute renoncé à ce projet ; car je n’ai retrouvé, dans les archives de notre maison, rien qui y ait trait, même indirectement.
« Croyez, etc.
« Henry, comte de Châteaugrand. »
J’ouvris aussitôt le paquet, il contenait en effet un manuscrit sur parchemin, il n’y avait pas à se tromper à la date : l’encre jaunie, la forme des lettres, l’orthographe, tout prouvait qu’il était bien réellement du milieu du dix-septième siècle.