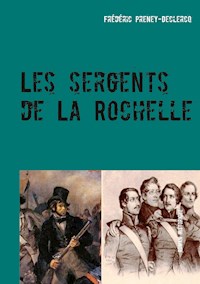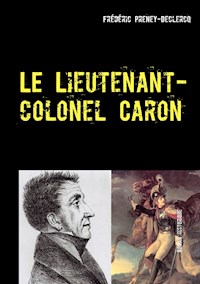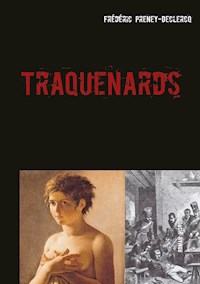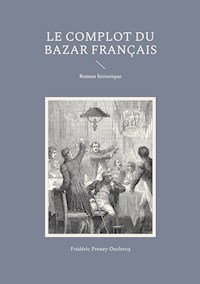
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Les enquêtes de l'inspecteur Eugène Chenard et les aventures du capitaine Jean-Baptiste Dumoulin, ex-officier d'ordonnance de Bonaparte.
- Sprache: Französisch
Après les manifestations de juin 1820 qui ont causé la mort d'un étudiant parisien, Jean Baptiste Dumoulin, ancien officier d'ordonnance de Bonaparte, fomente un complot afin de renverser Louis XVIII, "l'odieux Bourbon revenu dans les fourgons de l'étranger". En quelques semaines, la conjuration rassemble dans le secret d'une galerie marchande, rue Cadet, à Paris, nombre d'officiers impériaux mécontents de la fin de leur carrière militaire, la jeunesse des écoles et le parti des indépendants mené par le vieux Lafayette, le Héros des Deux Mondes, le révolutionnaire de 1789... Comme chez Alexandre Dumas, le ton est juste, les dialogues sonnent bien, le suspense reste vivant, l'aventure est à chaque page, sans oublier l'amour, et on voudrait que cela dure plus longtemps - Jean-Pierre Thomas - Critique Culture - Histoire de l'Histoire - Petites Affiches n°95.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 917
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture :
La conspiration du 19 août ; gravure de l’époque dans « Histoire de la Restauration Illustrée 1814 – 1830 » de J. A. Dulaure – page 145.
Nouvelle édition revue et corrigée
En 2005, j’ai publié une première version de ce roman, aujourd’hui caduque. Voici la seule version autorisée. Frédéric Preney-Declercq.
À mon épouse Morgan, pour sa relecture du texte, ses judicieux conseils et ses tendres encouragements.
Du même auteur
Le complot du Bazar français
Le Charbonnier L’insurrection de Saumur – 1822
Le lieutenant-colonel Caron Colmar – 1822
Traquenards Paris et Colmar – 1822
Les sergents de La Rochelle Paris et Strasbourg – 1822
Le prisonnier d’Olmütz
Sommaire
Prologue
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Chapitre 25
Chapitre 26
Chapitre 27
Chapitre 28
Chapitre 29
Chapitre 30
Chapitre 31
Chapitre 32
Chapitre 33
Chapitre 34
Chapitre 35
Épilogue
Quelques personnages
Les officiers français au passé impérial :
Bérard Charles : âgé de 38 ans, né à Romans, chef de bataillon dans la légion des Côtes-du-Nord en poste à Paris, demeurant, rue du Faubourg du Temple, n°78.
Caron Augustin : âgé de 46 ans, né à Creuse, lieutenantcolonel de dragon en retraite. Officier de la légion d'honneur, marié à une Prussienne rencontrée sous l’Empire et retiré à Colmar.
Dentzel Jean-Chrétien : âgé de 34 ans, lieutenant-colonel de cavalerie en non-activité, vivant à Paris.
Dumoulin Jean-Baptiste : 34 ans en 1822, officier d’ordonnance de Napoléon, rentier, demeurant à Paris. Fils d’un riche gantier de Grenoble, il s’est désintéressé en 1814 de l’entreprise familiale pour devenir un agent actif du retour de Napoléon exilé sur l’île d’Elbe. Le 5 mars 1815, il organisa la chute de Grenoble. Napoléon en fit son officier d’ordonnance. Promu capitaine, Jean-Baptiste Dumoulin fut blessé à Waterloo et capturé par les Anglais.
Fabvier Charles : Lorrain, baron impérial, âgé de 36 ans, négociant patenté et colonel en non-activité, demeurant à Paris, il est le type même du héros de la seconde génération des armées napoléoniennes et est devenu l’une des figures en vue du parti libéral, ami du général Lafayette.
Groscœur Jacques : 38 ans, ancien tambour-maître, propriétaire du Café de l’Orient et oncle de l’étudiant Nicolas Joubert.
Lavocat Gaspard : âgé de 26 ans, né à Montigny (Ardennes), sous-lieutenant à la demi-solde, logé rue Saint Thomas du Louvre.
Maziau Antoine : âgé de 43 ans, né à Versailles, lieutenantcolonel dans les chasseurs à cheval de l’ex-garde impériale, demeurant à Paris, rue Neuve-des-Petits-Champs, n°16.
Nantil Noël : âgé de 30 ans, né à Pont-à-Mousson (Meurthe), capitaine dans la légion de la Meurthe, en garnison à Paris.
Pailhès Antoine : 41 ans, baron impérial et colonel, mis en non-activité à la chute de Napoléon. Ami du lieutenantcolonel Caron.
Sauset Louis-Antoine : baron impérial, 47 ans, né à Arzelières, ancien colonel de la garde impériale et administrateur du Bazar français – une galerie marchande couverte par une verrière (une innovation pour l’époque) –, rue Cadet, n°11.
Les héroïnes du roman :
Alexandrine Maziau : lingère, fiancée, puis femme du lieutenant-colonel Maziau.
Catherine : âgée de 21 ans, originaire de Touraine, employée au Café de l’Orient.
Helena Caron : 25 ans, originaire de Prusse et femme du lieutenant-colonel Caron, vivant à Colmar.
Marie : âgée d’une vingtaine d’année. Originaire de Bretagne, Daoulas. Courtisane et maîtresse du capitaine Jean-Baptiste Dumoulin.
Margaret : 16 ans, Anglaise, employée à l’auberge du Grand Turc et amante du sous-lieutenant Gaspard Lavocat.
Les étudiants parisiens :
Duguied Pierre : né à Paris, étudiant en droit et commis négociant en vins.
Joubert Nicolas : étudiant en droit, fils d’un curé d’Angoulême, élu député du clergé aux États généraux, sécularisé en 1793 et nommé préfet du nord sous le Consulat.
Lamy Antoine ; né à Custine, étudiant en philosophie, exreceveur de l’enregistrement, demeurant à Paris, rue de l’Université, n°39.
Les personnages politiques :
Le général Georges Lafayette : 63 ans, député, l’ancien marquis Gilbert du Motier de La Fayette, le « Héros des Deux Mondes », « l’homme de 1789 », étendard vivant des mouvements antiroyaliste sous la Restauration.
Georges-Washington Lafayette : 41 ans, fils du général Lafayette, militaire et homme politique français.
Jacques Laffitte : 53 ans, banquier et homme politique. Député de Paris.
Louis XVIII : 65 ans, roi de France depuis la fin de l’Empire et son retour d’exil, frère puîné de Louis XVI, guillotiné en 1793.
Jacques Manuel : 45 ans, avocat libéral et député. Grand orateur, ses opinions lui valurent beaucoup d'ennemis parmi les députés ultras.
Rey Joseph : âgé de 40 ans, né à Grenoble, avocat, demeurant à Paris, rue des Grands-Augustins, n°21. Ami d’enfance de l’officier d’ordonnance Jean-Baptiste Dumoulin.
Prologue
18 juin 1815, onze heures trente du matin.
La brume d’orage qui avait régné depuis l’aube sur la forêt de Soignes et ses alentours était encore perceptible. Des nuées de vapeur se cramponnaient toujours sur quelques reliefs de-ci de-là. Néanmoins le soleil prenait le dessus et ses rayons séchaient doucement la terre belge, gorgée d’eau depuis la veille.
Tel un signe annonciateur funeste, un immense corbeau croassa dans le ciel gris bleu. Après un coup d’œil sur la silhouette noire, Jean-Baptiste Dumoulin se pencha sur l’encolure de son cheval et caressa la crinière de l’animal. Pour la première fois depuis son départ de la ferme du Gros Caillou1, le Grenoblois se sentait nerveux.
L’impatience de la mêlée sans doute ? songea-t-il en regardant sa montre à gousset dont la grande aiguille approchait du chiffre VII. Tss-tss, l’instant est imminent, se dit-il, suivi d’un mouvement furtif de sa pomme d’Adam.
Réfugié sur une hauteur, derrière un épais taillis, le cavalier observa le paysage. Devant lui, la chaussée descendait vers un vallon assez profond, pour remonter ensuite, en longeant les clôtures d’une large ferme – baptisée la Haie-Sainte – vers un haut plateau. Sur sa droite, Jean-Baptiste devinait au loin la présence d’un hameau.
Probablement Papelotte, pensa-t-il, se remémorant la carte d’état-major consultée deux heures plus tôt.
Soudain, tel le brusque réveil d’un volcan, le bruit du canon déchira le silence champêtre pour se maintenir, roulant et oppressant. Effet immédiat, des dizaines d’oiseaux, en groupe ou solitaire, s’enfuirent par volées, tandis que l’acier et la poudre provoquaient force agitations humaines dans cette plaine vallonnée, située à une vingtaine de kilomètres de Bruxelles.
Tassé sur sa monture, l’officier d’ordonnance fixa l’objectif à atteindre. Moins de mille mètres le séparaient de l’état-major du prince Jérôme. Au signal de feu, la division de ce dernier s’était lancée comme prévu sur la droite des positions anglaises, retranchées autour de l’imposante ferme d’Hougoumont2.
Le geste lent, Dumoulin se dressa sur ses étriers, cherchant à apercevoir ce début de bataille. Effort inutile, la distance était trop grande et les alentours fortement boisés, l’estafette impériale ne distinguant qu’une inquiétante fumée noire, mais il percevait par à coup des clameurs guerrières et des salves de coups de fusil. L’œil toujours rivé sur l’horizon, il se rassit sur sa selle, renifla fébrilement en réajustant son bicorne et grimaça. Désireux d’achever sa mission, le cavalier constatait avec inquiétude que son choix d’itinéraire était réduit. Il lui faudra traverser une zone pour le moins incertaine !
Au fil des secondes, sa bouche devint sèche et sa respiration haletante, alors qu’un flot de pensées mélancoliques traversait son esprit. Les paupières fermées, Jean-Baptiste s’entrevit, il y avait quatre mois à peine, jouissant d’une existence facile et bourgeoise. Mordious ! Que la vie était surprenante, jura-t-il entre ses dents. Hier riche gantier… Et aujourd’hui, dans un sacré guêpier ! Pourquoi ? Comment ? Le prestige de l’Empereur… ? Il avait agi sur lui avec une puissance qu’il n’aurait jamais soupçonnée…
Relâchant les muscles de ses épaules, l’officier d’ordonnance s’abandonna en un long soupir, puis son regard se troubla, ses idées s’agitèrent, subitement même ses entrailles se nouèrent avec douleur.
Waouh ! La mort, songea-t-il avec effroi, portant une main crispée sur le ventre. Pourrait-elle ce jour lui dévoiler sa sombre face ? Si tôt, si soudainement… Non, il le refusait ! Pas encore… Vivre !
Le guerrier français souffla devant lui, ses yeux se plissèrent et malgré lui, un tremblement agita ses doigts longs et soignés. Le désespoir semblait triompher, lorsqu’il sursauta. Le vent lui apportait des sons de voix. Anglaises ! Dans un réflexe, le capitaine Dumoulin saisit son sabre et son pistolet. Les palpitations de son cœur s’accélérèrent.
Allons, se dit-il avec force, réalisant le danger à venir et l’obligation d’y faire face. Fais-toi honneur ! Il serra sa mâchoire, avant de respirer à plein nez, à s’enivrer l’esprit.
« Pour l’Empereur, mon bel ami ! Vive l’Empereur ! » s’écriat-il, les poumons emplis d’air.
À ces mots, les yeux injectés de sang, l’officier d’ordonnance quitta son abri et lança son coursier droit sur la position des troupes du prince Jérôme. Les images défilèrent très vite. Jean-Baptiste découvrit que l’Anglais était proche. Un alignement d’éclaireurs surgit de la végétation. Ivre d’émotion, le militaire français perçut à peine les crépitements des armes que déclenchait son passage. Il s’accrocha à sa monture lancée en une cavalcade effroyable. En une fraction de seconde, le capitaine impérial réalisa qu’il ne pourrait pas éviter le contact. Il obliqua alors sur sa gauche et percuta l’ennemi, là où le relief accidenté semblait être un allié. Le Grenoblois vit se dresser une haie de baïonnettes. Avec son arme à feu, il tira à bout portant sur un assaillant côté gauche, lui traversant la gorge. À droite, son sabre moulina et coucha un ou deux individus en un bruit sec de chair coupée. La bave aux lèvres, Jean-Baptiste réalisa qu’il n’y avait devant lui plus d’obstacle. Il était passé !
Dans un état second, l’officier d’ordonnance se dirigea vers une ligne de combattants qui l’acclamait, constatant avec surprise qu’il n’était qu’à une centaine de mètres de l’avant-poste des lignes françaises. Il piqua droit sur le drapeau tricolore qui s’agitait dans les mains d’un soldat aux cheveux hirsutes et à l’épaisse moustache. Dans un effort nerveux, l’homme calma son cheval au milieu d’un bataillon d’infanterie, excité par le spectacle offert. Un officier se précipita et saisit au mors l’animal.
« Pardieu, chapeau bas, le brave ! s’exclama-t-il en caressant l’encolure couverte d’écume de la bête. En vous apercevant surgir, tel un diable derrière ces sentinelles anglaises, nous ne vous donnions guère de chance de nous rejoindre. »
D’un bond, Jean-Baptiste descendit de sa monture et, faisant face à ce jeune gradé au visage marqué de la petite vérole, se positionna au garde à vous.
« Capitaine Dumoulin, officier d’ordonnance de l’Empereur, marmotta-t-il d’une voix étouffée par son récent effort. Heureux de te connaître, l’ami. »
Sous les yeux railleurs de ses soldats, l’officier d’infanterie réagit réglementairement, faisant claquer ses talons.
« Sous-lieutenant Gaspard Lavocat du 5e régiment de la Garde, mon capitaine, répondit-il gaiement. Fier de vous accueillir. »
Les deux hommes se sourirent.
« Foutre ! poursuivit l’officier en se tournant vers ses troupiers, aux faciès toujours moqueurs. N’avez-vous jamais vu comment l’on se salue dans l’armée impériale ? À croire qu’il ne règne que l’indiscipline parmi les braves que je commande. Je ne vois autour de moi qu’une bande de coupe-jarret. L’Empereur s’est fourvoyé en s’imaginant bâtir une armée respectable en soixante jours3.
- Emmène-nous au feu, lieutenant, marmonna un jeune volontaire, et tu verras ce que c’est, une discipline marquée.
- Les braves du 5e ne sentent que le feu et la poudre, lieutenant, annonça un ancien, la voix ferme.
- L’Empereur en personne le sait, dit Jean-Baptiste, amusé par la causerie.
- Vive l’Empereur ! cria aussitôt un gaillard édenté.
- Vive l’Empereur ! » reprirent en cœur tous les individus autour.
Les regards brillaient. Pas un seul guerrier français ne doutait un instant de la grande victoire du jour. Derrière leur Petit Caporal4, une nouvelle fois, la Grande Armée marcherait et triompherait à coup sûr.
L’officier d’ordonnance accepta une gourde que lui tendait un vieux tirailleur et but presque avec délice une eau coupée à l’eau-devie, mais à l’arrière-goût de fer. En remerciement, Jean-Baptiste donna une accolade au vétéran puis, soucieux, ausculta son fidèle destrier, dernier présent de son père, disparu depuis d’une grippe foudroyante.
« Parbleu ! Un vrai miracle, mon capitaine, constata Lavocat. Vous avez dû bouter une dizaine de ces diables rouges, et qu’avonsnous là ? Juste le souvenir d’un coup de baïonnette sans gravité, sur le poitrail de votre bel animal.
- En effet, lieutenant, un vrai coup de chance », répondit Jean-Baptiste d’un ton dubitatif.
Pour la première fois depuis son arrivée, il se retourna et revit la maigre forêt d’où il s’était élancé. Dans un mélange d’effroi et de surprise, il découvrit que l’horizon n’était plus qu’une ligne écarlate. Un peloton de guards5 s’était positionné face à l’avant-poste impérial, à une distance d’environ cent cinquante pieds.
« Oui, maintenant ce serait trop tard ; le passage est foutrement condamné, dit Gaspard avec un rire nerveux. Vous êtes passé au bon moment, mon capitaine.
- Probablement, lieutenant, mais oublions, déclara ce dernier d’une voix quelque peu chevrotante. Allez ! Conduis-moi auprès du frère de l’Empereur, et discutons sur le chemin, si tu le veux bien. »
Le sous-lieutenant Lavocat s’éloigna, donna de brèves instructions à ses hommes et, son fusil à l’épaule, revint près de l’officier d’ordonnance.
« Dis-moi donc d’où tu viens ? lui dit Jean-Baptiste en attrapant son cheval par les rênes. Tu me parais bien jeune pour un vieux brave.
- Je suis des Ardennes, mon capitaine, de Montigny exactement… et j’ai déjà vingt ans, répondit le juvénile sous-lieutenant d’un timbre enjoué en se redressant perceptiblement. J’arrive de Saint-Cyr, ajouta-t-il fièrement, avant de jeter une œillade sur la légion d’honneur qui ornait le frac à la hussarde de couleur bleu barbeau de son compagnon. Et vous, mon capitaine ? interrogea-t-il à son tour. Racontez-moi vos faits d’armes. »
Apercevant le coup d’œil porté sur sa médaille, Jean-Baptiste sourit. Brièvement, il songea à l’année écoulée, puis amorça un récit rapide.
« Figure-toi, lieutenant, dit-il, que je découvre également ce qu’est une campagne militaire. Avant l’abdication de 1814, je n’avais jamais imaginé m’engager. Et puis un jour, aléa de l’existence, tout s’est enchaîné. L’été dernier, j’ai revu par hasard un vieil ami. Ce compatriote avait été chirurgien de la garde. Il m’a alors prié de participer à ses côtés à un projet absolument inconscient. J’ai accepté et tout a été très vite. Je te passe les détails, mais nous avons organisé l’itinéraire du retour impérial de l’île d’Elbe, puis j’ai facilité la chute de Grenoble. En récompense, l’Empereur m’a décoré de la croix. Ensuite il m’a fait son officier d’ordonnance et m’a nommé capitaine dans la garde impériale. Et aujourd’hui, je suis là avec lui, en Belgique, au pied de ce Mont-Saint-Jean. C’est ainsi, qu’à vingt-neuf ans, je commence, comme toi, ma carrière dans les armes. »
Les deux novices échangèrent un sourire puis en silence, poursuivirent leur chemin le long d’un sentier boueux. Au loin, le bruit des canons s’intensifiait. Après un signe de son guide, le capitaine Dumoulin entrevit d’un coup le quartier-général du prince Jérôme. Remontant sur sa monture, il se tourna une dernière fois vers le sous-lieutenant Lavocat.
« Adieu, l’Ardennais, lui dit-il d’un ton fraternel. Sois brave, et… mordious, fais attention à toi. La journée risque d’être dure. »
Sans un mot en retour, Gaspard le salua d’un geste de la main, puis s’en retourna à grands pas vers sa position et ses soldats. Son coursier au trot, le cavalier se dirigea vers le cordon protecteur de l’ex-roi de Westphalie6.
Il était maintenant treize heures ; Jean-Baptiste rechargeait son pistolet, un modèle d’arçon an IX avec son embouchoir en laiton. Il venait de terminer les soins nécessaires sur son cheval. L’agitation régnait autour de lui. L’officier d’ordonnance se préparait à repartir. Il saisit la dépêche préparée pour l’Empereur. Par deux fois, les troupes de Jérôme Bonaparte s’étaient élancées à l’assaut, mais la résistance de l’aile droite anglaise avait été plus forte que prévu. Aucun des épais murs de la ferme d’Hougoumont n’avait cédé. La division française était actuellement obligée de se replier sous un déluge de feu. Les pertes étaient lourdes.
« Ça a été la caguade, marmonna avec un accent du Languedoc, un officier, blessé à une main, mais annonce à l’Empereur que cette foutue ferme tombera bientôt ! »
Jean-Baptiste sourit.
« Si le Petit Caporal te demande quel est le couillon qui t’a annoncé cette nouvelle, poursuivit l’homme. Dis-lui qu’il s’agit du baron et colonel Antoine Pailhès.
- Je vous le promets, mon colonel.
- Rapporte-lui aussi que les soldats soupçonnent le patriotisme et la fidélité de plusieurs généraux et que j’en suis emmasqué. Dès qu’ils aperçoivent un général ennemi, nos braves – les boulards ! –, cascayent dans les rangs et se le montrent en criant : Voilà le général Bourmont !7 et ouvrent le feu, malgré les ordres.
- Foutre à Bourmont, mon colonel ! réagit Jean-Baptiste. Sa trahison ne nous empêchera pas de vaincre.
- J’espère, capitaine, bien que la triste nouvelle nous ait sacrément foutu la pétouche8. »
Une fois la rasade de cognac qu’un officier lui proposait, Dumoulin se remit en selle. Il se fit répéter encore une fois l’itinéraire conseillé puis, après un salut, s’élança à travers un champ.
Après quelques trois cents mètres, Jean-Baptiste ralentit sa monture. Il venait de rejoindre une troupe sanguinolente et disparate. La main devant ses lèvres, le cavalier regarda à peine ces premiers blessés français, qui remontaient misérablement du front. Il aperçut juste avec un écœurement, un grenadier blessé au ventre, tenant ses entrailles dans le creux de ses mains. L’esprit fuyant, l’officier d’ordonnance accéléra sa course et lança sa monture en un galop régulier.
À mesure qu’il progressait, les impacts de l’artillerie anglaise se firent de plus en plus menaçants, la terre, lourde et noire, se soulevant de tous côtés. Quelque peu pétrifié par le bruit et le spectacle apocalyptique, Jean-Baptiste remarqua que plus un seul arbre n’était indemne. S’imaginant se protéger, il se pencha sur son coursier et maintint son allure rapide. La zone dangereuse, cauchemardesque, s’éloigna enfin. Après un ultime mouvement de tête vers ses arrières, l’ordonnance franchit la première ligne française. Dès le premier coup d’œil, il reconnut les divisions du général Foy et du baron Bachelu qui, en formation, attendaient les instructions. Après le passage de ce premier front, il prit la route de Charleroi où il croisa tôt une compagnie de sapeurs qui se dirigeait vers le nord. Des escadrons de cavaleries légères galopaient également dans toutes les directions. Au fur et à mesure, le capitaine Dumoulin réalisa qu’il était maintenant au cœur de l’armée française. Les hommes étaient à perte de vue, se chiffrant par centaines. Des étendards tricolores, surmontés de leurs aigles, surgissaient à distance régulière, marquant l’emplacement des unités. Des Vive l’Empereur ! se répétaient inlassablement. Le bruit du canon rappelait que des combats se déroulaient au loin. Pourtant, dans un curieux désordre, des hommes dormaient à même le sol, certains jouaient aux dés et d’autres mangeaient, insouciants du danger à venir. Jean-Baptiste vit que quelques-uns, plus anxieux sans doute, priaient au milieu de leurs compagnons d’armes.
Foutre aux bigots ! se marmonna-t-il amusé, car enfant athée de la Révolution.
Le capitaine Dumoulin arriva enfin près de l’Empereur. L’étatmajor s’était positionné sur la crête de la Belle Alliance9 distante de trois kilomètres du Mont-Saint-Jean où se retranchait l’armée anglaise. Sautant à terre, le Grenoblois remit sa dépêche à un aide de camp. À peine son bicorne retiré, il fut mandé près du maréchal Soult. Sûr de l’arrivée imminente du corps d’armée du comte Grouchy10, la grande offensive avait été décidée. Jean-Baptiste reçut l’ordre d’informer le 1er Corps de Drouet d’Erlon. Sans attendre, il rejoignit le comte et ses dix-sept mille fantassins. Il était treize heures trente.
Quinze heures dix.
« Dragon ! hurla Jean-Baptiste en tirant sur le mors de son cheval. Qui commande ici ?
- Le lieutenant-colonel Caron, mon capitaine, marmonna le cavalier.
- Où est-il ?
- Droit devant vous, près des couleurs. »
Au trot, puis au galop, le messager remonta l’escadron à l’arrêt, positionné en lisière d’une forêt dense, au pied d’un haut plateau.
« Capitaine Dumoulin, officier d’ordonnance de l’Empereur, s’écria celui-ci, le souffle court. Mes respects, mon colonel.
- Je vous écoute, capitaine Dumoulin.
- Voici l’ordre de rejoindre les cuirassiers Milhaut.
- Nous allons nous emparer de Mont-Saint-Jean, messieurs, dit Caron, lisant à voix haute la dépêche et s’adressant à ses officiers.
L’homme se dressa sur sa monture, réajusta son casque à cimier de cuivre et agita, par un mouvement de tête, sa longue crinière noire.
« Merci, capitaine », dit-il en se tournant vers Jean-Baptiste.
Les deux guerriers français se sourirent.
« Est-il vrai que le petit caporal est souffrant, reprit Caron en plissant les yeux, et que sur son observatoire, il a fait installer un lit de paille et une table ?
- Seulement pour ne pas être gêné par la boue occasionnée par les pluies de cette nuit, mon colonel, s’écria Jean-Baptiste. Je vous garantis que l’Empereur est jovial et sûr de la victoire.
- Vive l’Empereur ! hurla l’état-major.
- Des nouvelles de l’armée prussienne ? demanda Caron avec un mouvement des sourcils.
- Aucune, mon colonel. Ils ont dû détaler devant Grouchy… Foutre à ces maudits !
- Savez-vous, capitaine, que j’aime une Prussienne.
- Mes mots ne s’adressaient pas à elle, mon colonel… Je m’excuse.
- Il n’y a aucun mal, capitaine. Je réalise juste que je ne la reverrais sans doute plus.
- Sait-on jamais, colonel.
- Oui… Peut-être…
- Puis-je vous demander son prénom ?
- Elle s’appelle Helena.
- Joli prénom…
- Merci, capitaine. Tenez ! Voici une dépêche rendant compte à l’Empereur que j’ai bien reçu son ordre.
- Adieu mon colonel et bonne chance à vous, les dragons.
- Adieu capitaine.
- Vive l’Empereur ! hurla Jean-Baptiste en remontant l’escadron, au galop.
- Vive l’Empereur ! » répondirent en cœur les fiers cavaliers.
Le soleil commençait à disparaître à l’horizon. L’après-midi de ce 18 juin 1815 se terminait. Effectuant des missions chaque fois plus urgentes, le capitaine Dumoulin était abasourdi d’épuisement. Son cheval était couvert de sueur et de boue. Tout autour du cavalier et de sa bête, ce n’était que tragédie et désastre. Les crachats d’artillerie ne couvraient plus les centaines de râles des blessés. Une épaisse fumée de poudre planait depuis des heures, à un mètre d’un sol rouge de sang. Par trois fois, l’aide de camp impérial s’était rendu près du maréchal Ney. Pendant près de deux heures, le prince de la Moskova, à la tête de dix mille cavaliers, s’était brisé sur les carrés anglais.
Se dressant sur ses étriers, Jean-Baptiste s’immobilisa sur une levée de terrain et tenta de se repérer au milieu d’hommes montant à l’assaut, aux cris de « Vive l’Empereur ! » et « Point de quartier ! » Ultime course, le messager recherchait la cavalerie légère de Lefebvre-Desnouettes.
« Mordious ! » hurla-t-il soudain, subissant un écart de sa monture et entendant siffler des balles.
Le cheval se cabra et hennit. À l’aide des rênes et de la voix, le cavalier domina l’affolement de son animal, non sans une certaine frayeur.
« Doux, mon beau ! » lui murmura-t-il en caressant l’encolure de la bête.
Du sang coulait le long de la crinière. L’oreille droite était mutilée, juste à l’endroit de sa pointe. Jetant un coup d’œil derrière lui, le militaire français reconnut la ferme de la Haie-Sainte, bastion avancé du dispositif du duc de Wellington. Avec trouble, il réalisa qu’il venait d’être la cible privilégiée d’un régiment d’Hanovriens, leurs plombs touchant son bicorne et l’oreille de son cheval. Pfft ! La mort n’était pas passée loin, se dit-il en s’éloignant au trot, sans vraiment réaliser la véracité de ses propos. L’officier passa un talus, emprunta un chemin de traverse, puis se dirigea vers une colonne en mouvement, marchant au bruit du tambour. La garde entrerait-elle dans la bataille ? s’interrogea-t-il ébahi, apercevant les bonnets à poil de ces guerriers d’élite. L’ordonnance longea au galop les files de ces soldats aux traits bronzés et aux lèvres moustachues qui, l’arme au bras, avançaient de front, alignés et calmes comme en un jour de revue.
« Colonel Sauset ! s’écria Jean-Baptiste en reconnaissant l’homme près de l’aigle et des couleurs. L’Empereur vous envoie au combat ?
- Nous allons conquérir ce maudit plateau, capitaine, se réjouit l’imposant colonel en pointant son index vers la direction du Mont-Saint-Jean. La victoire est au bout.
- Mordious ! Voilà qui me comble de joie, fit l’autre en roulant des yeux d’allégresse. Là-haut, au milieu de toutes ces effroyables tueries, je n’avais plus aucune idée de l’issue de la bataille. Votre apparition dévoile que nous ne sommes plus loin de la gloire.
- Dame ! Ne jamais en douter, Dumoulin, ricana Sauset en s’éloignant au milieu de ses hommes. La Grande Armée est invincible…
- Vive l’Empereur ! hurla le Grenoblois.
- Vive l’Empereur ! » cria la garde en cheminant, le regard assuré et insolent.
Se dirigeant vers le nord-ouest, l’aide de camp conduisit sa monture sur une légère hauteur. Nous sommes donc victorieux, se réjouissait-il. L’Empereur est grand ! L’œil étincelant, Jean-Baptiste aperçut soudain, par-dessus une ligne de fantassins français revenant du front, une brigade de cavalerie en mouvement, qui sortait d’un épais brouillard fait de poussières et de fumées. Était-ce Lefebvre-Desnouettes ? se dit-il en s’élançant au-devant. Une grimace se dessina sur son visage. Emmenée par un étendard rouge écarlate, orné en son coin supérieur de l’Union Jack, la charge qui se présentait n’avait rien d’amicale.
« Mordious ! » s’écria Dumoulin en tirant désespérément sur le mors de son cheval.
Bousculée avec violence, l’infanterie impériale, située devant lui et composée en grande partie de blessés, céda rapidement. Dans un réflexe, le capitaine français mit en joue le dragon qui se précipitait face à lui, sabre au clair. L’impact de la balle désarçonna mortellement le Scot Grey11. Dans son élan, le cheval de ce dernier frôla la jambe de l’officier d’ordonnance, lui faisant perdre son bicorne et un de ses étriers. Dans la continuité de l’action, le Grenoblois para avec sa lame et son pistolet, une seconde agression d’une rare violence, le choc manquant de le désarçonner. Serrant les dents, Jean-Baptiste essaya de faire pivoter son coursier et s’écarta de ce nouvel ennemi. Autour de lui, la présence anglaise s’épaississait et les hurlements guerriers, d’une extrême sauvagerie, affolaient les chevaux entremêlés. Les grenadiers désorganisés étaient transpercés ou décalottés l’un après l’autre. Avec un mélange de rage et de désespoir, Dumoulin croisait maintenant le fer avec un déchaîné d’Écossais, mal rasé et au regard bleu. Tout en contrant une attaque à la face, puis une pointe au corps, l’officier impérial songea à son côté gauche dégarni. Inquiet, impuissant, il entraperçut du coin de l’œil l’approche rapide d’un nouveau dragon. Bloqué sur sa droite par son premier adversaire qui multipliait les assauts, Jean-Baptiste se sut perdu.
Mordious ! se murmura-t-il terrifié. La mort va me dévoiler sa terrible face.
Le sabre britannique le frappa plein crâne. Un voile noir passa devant ses yeux. Il eut la sensation que son corps se brisait en deux. Sur quoi, l’horizon bascula et le capitaine français glissa le long de son cheval, avant de s’écraser désarticulé, au milieu d’un parterre de cadavres mutilés et rouges de sang.
1 La ferme du Gros Caillou : cette ferme, le long de la chaussée de Charleroi, fut l’endroit où Napoléon installa son quartier général, le 17 juin 1815. Il y passa la nuit et y réunit son état-major le matin du 18 juin pour donner ses ordres de bataille.
2 La ferme d’Hougoumont : le duc de Wellington attachait une importance particulière à la protection de son flanc droit et ses lignes de communication. Il avait donc renforcé le bastion avancé du domaine d’Hougoumont et confié la défense de ses bâtiments à des détachements de ses meilleures troupes. Ce fut par une offensive contre Hougoumont que débuta l’assaut français vers 11 h 30. Le château-ferme d’Hougoumont fut, toute la journée, le théâtre de violents combats. Ils y fixèrent près de dix mille soldats français, sans que ceux-ci ne réussissent à s’emparer d’aucun des bâtiments.
3 Évadé de l’île d’Elbe, Napoléon arrive à Paris le 20 mars 1815. L’armée qu’il découvre présente à peine un effectif de 175 000 hommes. En moins de deux mois, elle est portée à 375 000 combattants (les 200 000 nouveaux soldats se décomposent principalement ainsi : 20 000 enrôlés volontaires ; 80 000 anciens militaires rappelés sous les drapeaux ; 25 000 vieux soldats entrés dans les cadres des bataillons de garde nationale mobile ; 30 000 militaires retraités ; 12 000 soldats étrangers restés ou accourus en France). Le 16 juin 1815, l’Empereur marche donc sur Bruxelles ; l’armée impériale qui allait combattre à Waterloo renfermait pour plus de sa moitié des hommes qui n’avait jamais vu le feu.
4 Le petit caporal : Pendant la première campagne d’Italie de Bonaparte, au soir de Lodi (1796), ce furent les fantassins vétérans, qui, impressionnés par le courage et le cran que Napoléon avait fait preuve, lui décernèrent, à lui l’artilleur, le grade typiquement infanterie de caporal. C’est de ce jour qu’est resté à Napoléon Bonaparte le surnom de « petit caporal ».
5 Les guards britanniques : en 1815, comportaient trois régiments d’infanterie, les Foot Guards. Le 1er, après Waterloo, allait porter le nom de Grenadier Guards, le 2e est connu sous le nom de Coldstream Guards, et le 3e, sous celui de Scots Guards.
6 Jérôme Bonaparte 1784-1860, jeune frère de Napoléon, avait été fait roi de Westphalie en 1807 grâce à la politique impériale. Il a abandonné son royaume le 26 octobre 1813 après le désastre français de Leipzig.
7 Le général Bourmont ; le 15 juin au matin, cet officier impérial d’origine noble se porta en avant de sa division pour reconnaître la route. Après avoir marché l’espace d’une demi-lieue, il congédia son escorte de six chasseurs à cheval sous un prétexte futile, mit ensuite sa monture au galop et passa à l’ennemi. Cette désertion, accomplie au milieu du mouvement d’une armée en pleine marche pour surprendre l’ennemi, devait exercer une grande influence sur toute cette campagne. Les Prussiens, au lieu de connaître dans la nuit du 15 au 16, après l’attaque de Charleroi, l’entrée des Français dans leurs cantonnements, se trouvèrent avertis dès le 15 au matin.
8 Caguade (entreprise qui a échoué) ; Emmasquer (être décontenancé, déçu) ; Boulard (forte tête, généralement utilisé pour les enfants capricieux, qui n’en font qu’à leur tête) ; Cascayer (parler ouvertement) ; Pétouche (forte peur).
9 C’est sur cette crête, en arc de cercle, dont le centre est situé à douze cents mètres au sud du Mont-Saint-Jean, que Napoléon disposa ses troupes pour la bataille de Waterloo.
10 L’annonce aux troupes impériales de l’arrivée imminente d’Emmanuel de Grouchy et de ses trente-deux mille Français fut une erreur ; il s’agissait en fait de l’armée prussienne du maréchal Blücher (d’environ cent vingt-cinq mille hommes).
11 Ce régiment s’appelle en fait le « 2e Royal North British Dragoons ». Le nom de Scots Greys lui vient de la couleur grise de la robe des chevaux que montent les cavaliers écossais.
Chapitre 1
Paris, le 3 juin 1820.
Percevant au loin le chant continu des oiseaux, Antoine Lamy ouvrit une paupière, puis deux. Après avoir repoussé avec nonchalance le drap blanc qui couvrait ses épaules, il demeura quelques instants allongé, l’œil vague, désorienté. Dame ! Il fait jour, réalisa-t-il enfin, la figure rougeâtre et bouffie de sommeil. Le jeune homme, vingt ans à peine, bâilla à se décrocher la mâchoire, avant de jeter un coup d’œil sur le cadran de son horloge. Il était juste cinq heures. Faut se lever, marmonna le garçon ébouriffé en grimaçant de fatigue.
Avec des gestes lents, il quitta la paillasse de son lit de bois puis, au milieu de sa chambre, s’étira de tout son long. Mmm, aujourd’hui est un grand jour pour la liberté, se réjouit-il, retrouvant ses esprits. Écartant le rideau, puis contemplant à travers ses carreaux les toits de la capitale, Lamy respira profondément et sourit. En cette belle matinée printanière, il se sentait déjà surexcité, prêt à se déchaîner sur les boulevards. Vive la Charte ! cria-t-il avec joie, le cri de guerre à la mode.
À quoi, sa toilette fut sommaire. Le personnage se coiffa, revêtit sa chemise et son pantalon de toile, puis, assis sur le bord de la fenêtre ouverte, mangea l’unique tranche de pain qu’il lui restait d’une miche achetée trois jours auparavant et un morceau de fromage. D’un trait, il but un gobelet d’eau et se redressa, songeant qu’il était l’heure de partir, après un coup d’œil sur les aiguilles de l’horloge. Tout en sifflotant, l’étudiant en philosophie se chaussa de ses souliers de cuir, puis descendit les quatre étages de l’immeuble qui abritait sa petite chambre, une mansarde qu’il louait depuis un an à peine. Au dehors, la rue de l’Université était animée, commerçante et bruyante. Sans hésiter, le jeune homme se dirigea sur sa droite, vers le cœur de Paris.
Café des bouquinistes, j’y suis, murmura-t-il essoufflé, après une course d’un bon quart d’heure, tandis que ses yeux contemplaient l’enseigne, usée par les années et les intempéries.
Sur ce, Antoine poussa la porte de l’auberge. La salle était pleine. À peine sur le seuil, les odeurs de café, de lards grillés et de tabac l’assaillirent. Un court instant, l’étudiant ne distingua pas grand-chose du fait de la différence de clarté.
« Lamy ! Lamy ! »
Par deux fois, malgré le brouhaha ambiant, Antoine entendit son nom. Balayant du regard l’assemblée, il reconnut Jean-Baptiste Dumoulin, élégamment vêtu d’une redingote cintrée avec une haute cravate bleu, qui, attablé près d’une fenêtre, lui faisait signe de le rejoindre. L’ex-officier d’ordonnance n’était pas seul. Un individu distingué, aux cheveux châtains et de taille moyenne, se tenait près de lui et lui glissait quelques propos à l’oreille. Sur quoi, ce bourgeois se redressa pour se retirer, après avoir brièvement salué l’étudiant qui les avait rejoints. Antoine lui répondit d’un hochement de la tête et l’observa disparaître vers l’extérieur, se demandant en soliloque qui était-il.
« Approche, mon gaillard, lui dit alors Jean-Baptiste avec un geste empressé. Assieds-toi en face de moi et bois ce café. Je viens juste de le demander. »
Sans un sou en poche, Lamy accepta avec plaisir. Rare était les fois où il se permettait le luxe de se commander une demi-tasse dans un estaminet à la mode. Le regardant boire avec un fin sourire, le capitaine Dumoulin laissa passer quelques secondes puis, après un coup d’œil pour se rassurer de l’absence d’oreilles indiscrètes, prit la parole.
« Alors ? demanda-t-il à mi-voix. Qu’as-tu à m’apprendre ? Quelle est la situation ? Tes amis sont-ils prêts ? Seront-ils assez nombreux cet après-midi ? »
Tout en finissant son café, Antoine souriait de discerner une inquiétude au fond du regard de son acolyte.
« Tu diras à nos chers députés, chuchota-t-il après un court silence, que la jeunesse étudiante de Paris est à leurs côtés. Hier, devant la Chambre, nous n’étions peut-être qu’une centaine mais, aujourd’hui, la faculté de médecine et celle de droit seront là. La loi du double vote12 ne passera jamais, nous nous le sommes promis. (Il serra les poings devant lui.) Nous excluons radicalement, continuaitil avec flamme, que nos institutions, nos droits, notre avenir soient livrés à une oligarchie formée par les douze mille propriétaires les plus imposés du royaume. Vive la liberté ! » conclut-il en levant fièrement son menton.
Les yeux pétillants d’enthousiasme, Jean-Baptiste laissa échapper un éclat de rire, avant d’exposer à son tour ses dernières nouvelles :
« Mordious ! Tout se joue cet après-midi. Aux alentours de quatorze heures, Lafayette13 doit prononcer à la tribune de la Chambre un vigoureux discours au nom de la liberté, attaquant, visant les contre-révolutionnaires. Nous savons que ces chiens d’ultras ont besoin des voix des députés du centre pour faire adopter cette damnée loi qui condamnerait tous nos espoirs. D’après nos informateurs, beaucoup d’élus parmi les doctrinaires et les constitutionnels sont toujours indécis. En coulisse, nos alliés autour de Voyer d’Argenson14 ou Laffitte négocient leur ralliement, mais ils ont besoin de la pression populaire. Voilà notre rôle. Aujourd’hui, il nous faut enflammer les rues avoisinantes du Palais Bourbon. Créer le désordre ! »
Droit sur sa chaise, Jean-Baptiste se tût, vérifiant une nouvelle fois les visages voisins. Rassuré, il revint près de l’oreille amie.
« Nous avons été prévenus, poursuivit-il à voix basse, que la garde royale est mobilisée. L’ami que tu as aperçu près de moi vient de m’annoncer que les plus fanatiques d’entre eux se glisseront en civil parmi la foule et nous créeront des ennuis. Si hier, les gardes du corps du roi ne se sont contentés que de nous provoquer verbalement, je pense qu’aujourd’hui des affrontements sont envisageables. Il faut que nous soyons vigilants. En revanche, les légions15 ne bougeront pas. Hier soir, après t’avoir quitté, j’ai visité le colonel Fabvier. Tu sais qu’il est Lorrain. Malgré sa mise en retraite, il contrôle parfaitement les officiers de la légion de la Meurthe. Ce sont des anciens braves. Ils n’interviendront pas contre nous, même s’ils en recevaient l’ordre. »
Les yeux d’Antoine luisirent devant ces nouvelles rassurantes et sa flamme révolutionnaire lui chauffa d’autant plus puissamment le cœur. La liberté sera au bout de notre chemin, se dit-il convaincu. Le visage souriant, heureux, il reprit la parole.
« Hier soir, annonça-t-il, j’ai rencontré un étudiant en droit du nom de Nicolas Joubert. Le bonhomme méprise les Bourbons. Au cours de la soirée, ce Joubert m’a divulgué que, depuis deux ans, il a organisé au sein de sa faculté une société maçonnique, prénommée la loge des Amis de la Vérité. Nombreux, les membres de cette organisation secrète semblent bien organisés. Je pense qu’ils nous seront utiles. Je te les ferai connaître à la première occasion. »
Pianotant ses ongles sur la table, Jean-Baptiste jubilait, appréciant l’information. Se redressant quelque peu, il souffla joyeusement :
« Je le sens, nous allons vaincre ! Dehors le Bourbon ! »
Dans un même élan, euphoriques, les deux hommes tapèrent le dessus de table avec leurs paumes.
« Pour l’Empereur ! dit l’officier impérial à mi-voix.
- Non ! Pour la liberté ! rétorqua Antoine avec un mouvement de menton.
- Oh ! Si tu veux, jeune ami, mais cela veut dire foutrement la même chose. »
Un sourire s’échangea, puis les intrigants se levèrent, sortirent de l’auberge et se dirent l’adieu, avant de se séparer, chacun vers une direction différente.
Le capitaine Dumoulin savait que son compatriote Joseph Rey l’attendait dans son propre appartement. L’avocat grenoblois, à l’arrivée de l’étudiant en philosophie Antoine Lamy, s’était retiré du Café des bouquinistes par prudence et discrétion. Pourtant, l’homme de loi avait encore quelques informations à transmettre à l’ex-officier d’ordonnance.
Les politiques sont inquiets, pensa Jean-Baptiste un brin amusé.
Il accéléra son allure. Le sieur et capitaine Dumoulin habitait au n° 9 de la rue du Sentier. Son logement, au sein d’un bâtiment cossu, était proche de la rue Feydeau et plus précisément de la Bourse, lieu très familier du Grenoblois, ces deux dernières années.
À grandes enjambées, Jean-Baptiste arrivait près de son hall d’entrée, lorsqu’il aperçut, de l’autre côté de la rue, une jeune et jolie femme blonde, vêtue d’une robe bleue fermée dans le dos et terminée par de petits volants brodés, qui lui souriait d’une manière libertine. L’homme avait déjà remarqué cette fine silhouette depuis plusieurs jours, surtout sa manière sans gêne de le regarder. Les traits sévères, il la dévisagea et il lui fallut une poignée de secondes pour s’arracher à son regard azur. À quoi, il l’accosta d’un ton qui se voulait agressif :
« Tu es encore là, l’aguicheuse ! Va donc gagner ton pain ailleurs ou tu vas bientôt connaître l’épaisseur de mes bottes.
- Doux, mon bon prince, répondit la courtisane en s’inclinant avec grâce. La Marie est quelqu’un de bien et de tendre. Pour quelques francs, tu sais… »
Jean-Baptiste éclata de rire.
« Mordious ! s’écria-t-il. De si bonne heure, tu ne manques pas d’appétit, la coureuse. Sache, tout d’abord, que le bonhomme est plutôt du genre animal le soir, si tu me comprends bien. Et apprends, pour ton bon plaisir, la mademoiselle Marie, que je préfère – sans te blesser aucunement – les rondeurs. Et que caches-tu sous tes dessous affriolants si ce n’est une maigreur maladive. Allez, va-t-en où je te cogne le derrière ! »
Avec un regard devenu dédaigneux et les mains posées fièrement sur sa taille, Marie commença avec élégance un repli prudent, pendant que, d’une voix douce, charmeuse, elle murmurait :
« À un de ces soirs, mon bon seigneur, lors d’une de vos envies animales ! »
À cela, Jean-Baptiste ricana devant tant d’arrogance, puis pénétra dans le hall de sa résidence. Tout en montant les escaliers, songeant encore à la donzelle, il se surprit à s’imaginer pris entre ses cuisses. Foutue catin, soliloqua-t-il amusé. Voilà que je ressentirais presque de l’attirance pour ta charmante personne… »
Les mains derrière la nuque, Joseph Rey était allongé sur le couvre-lit brodé en relief de son hôte, une literie fort confortable, un grand lit de style Empire dit retour d’Égypte, en acajou. L’intrus réfléchissait, mais depuis quelques secondes, son regard s’attardait en hauteur, sur les jolis bustes d’Égyptienne en bronze doré et finement ciselé, placés en tête et en bout de lit.
« Belle qualité et signe d’aisance », conclut-il amusé.
Sur ce, percevant le bruit lointain d’une serrure, puis des pas sur le plancher, l’homme, âgé d’environ quarante ans et aux cheveux châtains, se leva d’un bond et se dirigea sans tarder vers le salon du logis.
« Ce n’est que moi, annonça le capitaine Dumoulin, tandis qu’il posait son haut-de-forme sur une table basse.
- Je m’étais réfugié dans ta chambre et je me demandais ce que tu faisais, susurra l’avocat, affichant une pointe d’impatience. Sais-tu que le temps presse ? Nous sommes en train de perdre tous nos espoirs.
- Mordious ! C’était il y a cinq ans, pays, que nous avons gaspillé nos chances, répondit l’autre avec sarcasme. Une seule personne pouvait amener la paix dans le pays et tu la connais !
- Arrête, Jean-Baptiste, réagit Rey agacé. Je respecte ton attachement, je pourrais même dire ton idolâtrie, pour Bonaparte, mais je ne comprends toujours pas cette obstination que tu as à le regretter. Je t’avoue qu’en 1815, lorsque tu as pris son service, je t’ai trouvé un peu… comment dire… un peu féodal. Voilà, c’est un terme qui convient bien. Tu as été… tiens, comme les antrustions des rois mérovingiens, comme ces guerriers fanatiques qui suivaient sans se poser de questions leur chef de guerre. Aujourd’hui, malgré les souffrances que tu as vécues, je te le dis sincèrement, la perte de la bataille de Waterloo a été un grand bonheur pour la liberté. Tu te rappelles ce que j’ai notifié à ton cher Empereur lorsqu’il est arrivé dans notre ville natale ? Je lui ai écrit que la France l’aimait comme un grand homme, l’admirait comme un savant général, mais…
- Mais ne voulait plus du dictateur qui, en créant une nouvelle noblesse, avait cherché à rétablir tous les abus presque oubliés. Tu te répètes, même tu radotes, mon cher Joseph, s’énerva Dumoulin, avant de s’approcher de son ami et le fixer dans les yeux. D’accord pour certains points discutables et encore. Mordious ! Je suis plutôt persuadé que tu te trompes joliment. Aujourd’hui, où en sommesnous ? L’Empire est terminé et les Bourbons sont revenus, plus méprisables que jamais. L’œuvre de la Révolution est, chaque jour qui passe, effacée avec plus de mépris. La censure sur la presse a été rétablie. La liberté individuelle n’est plus respectée. Et ce 3 juin 1820, le gouvernement cherche à imposer le vote d’une loi électorale pour limiter la progression des indépendants16. Alors je te le dis, avec ces infâmes Bourbons, il n’y a rien à espérer. La Charte17 est une facétie. L’idée d’une constitution accordée par un Bourbon n’est qu’une chimère. Depuis cinq années, nous vivons dans la trahison. Je te connais depuis toujours, Joseph. Je te sais libéral. Tu aspires à une véritable monarchie constitutionnelle, et bien moi-même, je t’approuve. La Charte, utilisée dans sa définition première, ne peut être que le pilier de la liberté. Mais ce qu’il faut, c’est chasser Louis XVIII et son insolente famille, puis installer une autre dynastie. Et la seule légitime, tu le sais bien, c’est celle de Bonaparte. L’Empereur a abdiqué pour son fils. Alors, chassons les Bourbons, ramenons le roi de Rome de sa prison de Vienne et établissons un vrai régime constitutionnel, avec comme monarque Napoléon II.
- Peut-être est-ce là la solution, dit Rey en hochant la tête, l’air pensif, mais aujourd’hui, essayons de sauver ce qui peut l’être. Si nous réussissons à faire échouer le projet de cette loi honteuse pour notre liberté, alors, par le biais de nos députés, nous conquerrons légitimement le pouvoir. Et là, l’utilisation de la Charte sera bonne. Le Roi ne sera plus qu’un pantin d’apparence, et l’espoir d’une plus grande ou d’une véritable liberté sera permis. Si, ce soir, nous avons échoué, alors nous penserons différemment.
- À quoi donc ?
- Une autre solution devra naître. Songeons par exemple à l’idée que nous avons eue, toi et moi, il y a quelques mois, de nous emparer des forts de Briançon et d’appeler à la révolte le Piémont et la Savoie18. Cette idée trop vite abandonnée n’était peut-être pas si folle que ça. De toute façon, nous nous battrons. Nous lutterons. Je te le promets ! Cela, te convient-il, pays ?
- Mordious ! Tu sais très bien que je t’écouterai avant toute chose et que tu pourras compter sur moi, répondit l’officier avec affection. Allez, cessons ces chamailleries, je vais t’exposer mon plan pour cet après-midi et ensuite tu me diras ton ressenti. »
Là-dessus, les deux Grenoblois s’attablèrent au milieu de la pièce puis, dans un léger murmure, retracèrent avec soin leurs emplois du temps à venir.
Treize heures sonnaient dans tout Paris et Jean-Baptiste se dirigeait vers les alentours du Palais-Bourbon. La foule était compacte. Avec satisfaction, l’ancien officier songeait qu’Antoine Lamy, l’étudiant en philosophie, ne lui avait pas menti. Toute la jeunesse estudiantine semblait réunie dans ce quartier excentré de la capitale du royaume. L’ambiance y était plutôt bon enfant. Le duc de Richelieu, chef du gouvernement, détenait l’honneur d’être le sujet de discussion favori. Tendant l’oreille, le capitaine Dumoulin écoutait avec délice les jolis noms d’oiseaux qui se diffusaient à son encontre. En voilà un qui en prend pour son grade ! se disait-il ravi.
Comme convenu, Jean-Baptiste devait retrouver Lamy au Café des poètes, un estaminet qui leur était familier.
Une multitude de futurs diplômés s’animait en dessous de l’enseigne. L’intérieur de la taverne était aussi fort peuplé. Il y avait grand remue-ménage. La lecture de journaux et la confection de tracts occupaient la majorité de la clientèle. Après une courte hésitation, l’ancien officier se faufila avec peine au milieu d’une atmosphère étouffante. Apercevant le nouvel arrivant, Antoine quitta d’un bond le banc où il était installé et le héla avec excitation :
« Ah ! Tu arrives à point, Jean-Baptiste. Viens que je te présente mes amis, les fiers étudiants de la loge des Amis de la Vérité. »
Se laissant entraîner vers le centre de la salle, le Grenoblois découvrit une trentaine de visages presque imberbes qui l’observait avec des yeux méfiants et interrogateurs. Il resta un instant immobile, ne sachant que faire, puis, dans un réflexe impromptu, se saisit d’un gobelet d’étain une table et le leva au-dessus de sa tête.
« Buvons à la liberté, citoyens ! À la liberté ! » s’écria-t-il d’une voix chaude.
L’écho fut immédiat. La phrase fut répétée en bloc par des bouches enthousiastes. Sur quoi, les portes et fenêtres du Café des poètes s’ouvrirent devant ce courant d’indépendance. La rue, dans un effet boule de neige, prit à son tour le relais et le tumulte devint général. Quelques-uns crièrent « Aux armes ! », d’autres chantèrent des airs révolutionnaires. Surpris par cet effet inattendu et par l’agitation qui en découlaient, Dumoulin et ses acolytes se sentirent enivrés par l’appel à l’insurrection. Certains tombèrent dans les bras l’un de l’autre. Témoin silencieux, Jean-Baptiste savourait, lorsqu’un étudiant aux cheveux mi-longs flavescents se hissa d’un bond sur une table.
« Mes amis ! Mes frères ! Chers citoyens, clama-t-il exalté, les yeux énormes. Saint-Just écrivait, il y a vingt-cinq ans, que le bonheur était une idée neuve en Europe. Nous voyons aujourd’hui que le chemin à réaliser est encore long et que la liberté reste à conquérir. Nous rêvons tous de vivre dans une nation dirigée par un gouvernement juste, vertueux et fondé sur l’assentiment du peuple. Or, vous le savez, vous le voyez, ce n’est guère le cas. Chaque jour, on bafoue un peu plus la Charte et notre liberté. Il est donc grand temps d’agir. Souvenez-vous, le grand Danton clamait en 1792, qu’il fallait de l’audace, encore de l’audace et toujours de l’audace. Citoyens, voilà l’attitude à adopter ! Le Roi veut nous imposer une loi de vote que nous ne voulons pas. Refusons cette tentative d’un retour à l’absolutisme ! Rassemblons-nous autour du Palais-Bourbon et imposons notre voix. Imposons le cri du peuple ! Imposons le respect de la Charte ! Vive la Charte !
- Vive la Charte ! hurla l’assistance, fanatisée.
- Il s’agit de Nicolas Joubert, celui dont je t’ai parlé ce matin, dit Lamy à l’oreille de Dumoulin qui grimpa à son tour sur une chaise.
- Il nous faut un drapeau tricolore, s’écria-t-il. Messieurs, le drapeau tricolore !
- Oui, bien sûr, s’exclama à son tour Antoine. Confectionnons-nous des drapeaux tricolores. Mes frères, c’est le symbole de notre liberté. Chassons le drapeau blanc, l’odieux étendard de la défaite ! »
Là-dessus, le vacarme devint impressionnant. Chacun hurlait son avis et son envie de vivre. De nombreuses mains martelaient les dessus de tables. Avec frénésie, Jean-Baptiste passa son bras autour du cou de l’étudiant en philosophie.
« Mordious ! lui dit-il avec un rire joyeux. Nous vivons là une nouvelle révolution. N’est-ce pas merveilleux ? C’est au-delà de toutes nos espérances. Ce samedi 3 juin 1820 deviendra peut-être un grand jour. Viens, mon ami, sortons. »
La foule de cette jeunesse enthousiaste se précipita dans un même élan vers l’extérieur. Noyés dans la multitude, Dumoulin et Lamy marchaient côte à côte sur le pavé parisien, la tête en feu. Les cris de « Vive la Charte ! » se répétaient, résonnaient tout autour d’eux, créant un tumulte impressionnant.
« Comment s’organiser maintenant ? questionna l’étudiant en fixant son compagnon.
- Il nous faut rejoindre les autres groupes de manifestants et faire ce qui était prévu, hurla Jean-Baptiste pour couvrir le son ambiant. Les évènements se jouent en plusieurs endroits. Aujourd’hui, notre rôle consiste à faire le plus de bruit possible. Crions simplement à tue-tête des « Vive la Charte ! Vive la liberté ! ». De toute façon, nous ne sommes pas armés et guère organisés ; donc notre mode d’action est limité. Dans les coulisses du parlement, nos alliés politiques négocient ferme. Si la loi du double vote est refusée, nous aurons gagné et, ce soir, les rues seront en fête. En revanche, si le contraire se produit, il nous faut pour insurger Paris que nos députés nous rejoignent. Sans la présence de chefs représentatifs, nous ne pouvons pas exister. »
Soudain il se tût, car la masse humaine devant eux sembla s’arrêter, gênée par quelque chose d’inquiétant, tandis qu’un grognement de mécontentement prenait de l’importance.
« Que se passe-t-il ? cria Antoine, sautillant sur la pointe des pieds.
- La garde royale nous empêche de passer », répondit une voix pleine de colère.
D’un bond, Jean-Baptiste se hissa sur le bord d’une fenêtre d’un des immeubles de la rue de Verneuil pour apercevoir au-dessus des multiples têtes, les uniformes rouges et les shakos noirs d’un régiment d’infanterie royale. Alignés sur trois rangs, baïonnette au canon et arme pointée sur la foule, ces militaires lui apparurent fort menaçants.
Foutre aux chouans ! se marmonna-t-il, connaissant leur inquiétante mentalité.19 De vrais fanatiques, ces cuistres-là, ajouta-til, se parlant toujours à lui-même.
D’un saut, il revint près de Lamy.
« Ils ne nous laisseront jamais le passage, dit-il avec irritation. Ils veulent empêcher que les manifestants puissent se rassembler devant la Chambre et… »
Les sourcils froncés, Jean-Baptiste cessa de parler, repérant que certains étudiants lançaient des projectiles sur la troupe.
« Bourreaux du peuple ! Traîtres ! » criait-on avec rage.
La réaction fut immédiate. Une des trois rangées des gardes royaux, suite à un ordre court, envoya une salve nourrie en direction du ciel. L’avertissement bruyant fut efficace. Dans un désordre complet, les quelques centaines de jeunes gens présents amorcèrent une course de repli le long de la rue étroite où planait dorénavant un épais nuage de poudre à fusil. Déconcerté, puis bousculé par un garçon pansu, Lamy s’écroula sur le pavé. Dans un réflexe protecteur, Dumoulin le releva, avant de l’inviter à suivre le mouvement général. Pourtant, Jean-Baptiste retint soudain son acolyte par la chemise, l’emmenant à l’abri dans un recoin d’un hall d’entrée.
« Regarde là-bas, s’exclama-t-il en pointant du doigt des manifestants apeurés et grimaçants, certains avec une tête ensanglantée. Ils remontent à contre-courant vers la garde royale. Ils fuient ! Il doit se passer quelque-chose au bout de la rue. »
Le cou tendu à l’extrême, Jean-Baptiste comprit vite la situation à la vue de dizaines d’individus, vêtus de longs manteaux sombres, coiffés de chapeaux haut-de-forme et munis de solides cannes, qui surgissaient des ruelles avoisinantes, telle une horde sauvage. Avec une extrême agressivité, ils tombaient à coups de bâtons ferrés sur les étudiants libéraux. La jeunesse, si téméraire il y a peu, cédait à la panique. Le sauve-qui-peut était général.
À ce moment, Jean-Baptiste se souvint que Joseph Rey, son compatriote, l’avait mis en garde de la présence d’officiers royaux en civil parmi l’attroupement.
Voilà donc qu’apparaissait au grand jour le vilain plan de défense de Richelieu, se dit-il en ébauchant un sourire qui mourut presque aussitôt. Éviter l’affrontement direct avec l’armée mais créer de multiples bastonnades pour désorganiser ou empêcher le grand rassemblement.
Antoine le secoua par le bras, le sortant de sa torpeur.
« Aïe ! Ils viennent sur nous, l’alarmait-il, la figure déformée par la peur. Faut déguerpir ! »
Déjà, une brute épaisse, la canne haute et au cri de « Vive le roi ! », bondissait sur eux. Poussant un étrange mugissement, l’étudiant se jeta en arrière pour tomber sur son postérieur. À l’aide d’une ruade improvisée, il se redressa sur ses jambes et s’élança en une course rapide et irréfléchie. De son côté, Jean-Baptiste évita la première cognée qui lui était destinée en se précipitant à plat ventre sur le pavé. Il songea à son tour à un galop volontaire mais ne put esquiver un coup de bâton sur le bas du dos. Le capitaine Dumoulin laissa échapper un juron, avant de prendre à son tour la poudre d’escampette.
Deux heures plus tard.
Caché dans une impasse sombre et mal odorante, Jean-Baptiste se laissait aller à quelques réflexions. En vain, l’homme avait essayé de quitter ce funeste quartier, mais les autorités y avaient installé des barrages filtrants et inspectaient tous les individus découverts. Son passé d’ancien des Cent-Jours20 lui attirant sans doute des désagréments, le capitaine Dumoulin s’était voulu prudent, refusant le moindre contrôle d’identité et préférant se terrer dans l’ombre.
Mordious ! Les forces de l’ordre étaient bien organisées, se marmonna-t-il dépité. Pfft ! Incontestable défaite. Ces maudits gardes avaient bien quadrillé les rues et joliment empêché leur grand rassemblement devant la Chambre. Ah, les canailles ! ajouta-t-il en crachant de rage sur le pavé.
Là-dessus, Jean-Baptiste grimaça, observant que la jeunesse des manifestants s’était révélée être une belle faiblesse. Trop vite la panique avait été générale, malgré la présence de plusieurs milliers d’étudiants. Des bagarres avaient bien éclaté un peu partout, principalement sur le pont Louis XVI et le long des quais des Tuileries et d’Orsay, mais l’avantage était resté aux agents royaux. Lors de son repli prudent, Jean-Baptiste avait d’ailleurs été témoin de scènes plus ou moins insolites, comme des étudiants, contraints par la force, qui criaient à pleins poumons des « Vive le Roi ! » et des « À bas la Charte ! ».
Peut-être aurait-il fallu aussi mobiliser les ouvriers et les boutiquiers ? se murmura Dumoulin songeur, puis il laissa échapper un soupir désabusé, avant de quitter son refuge improvisé. À droite et à gauche de la rue, le calme régnait. Pas une âme qui vive ! Plus haut, le barrage policier avait disparu. Le cœur battant la chamade, le fugitif avança avec prudence. À peine avait-il franchi un premier croisement qu’il y eut des bruits de pas d’abord lointains, puis d’un coup tout proches. Après s’être glissé dans un recoin, Jean-Baptiste vit surgir cinq jeunes gens essoufflés et grimaçants, reconnaissant en eux des étudiants. Sans hésiter, il les interpella à mi-voix :
« Messieurs, où en est la situation ?
- Ils ont tué un des nôtres ! s’écria rageusement le premier, les yeux humides.
- Assassiné, tu veux dire, rétorqua un deuxième, non moins ému.
- Soyez plus précis, je vous en prie, réagit le capitaine Dumoulin avec un brin d’autorité. Pourchassé, je n’ai pu quitter ces ruelles de tout l’après-midi. Tous les amis qui m’accompagnaient se sont éparpillés dans la nature. En un mot, je ne suis plus au courant de rien. »
À quoi, le plus grand des étudiants prit la parole.
« Notre mouvement a été un échec, monsieur, dit-il, le regard vague. Les arrestations se comptent par dizaines. Et le pire vient de se passer. Il y a eu un rassemblement sur la place du Carrousel. Une compagnie de la garde royale était présente. L’agitation était alors quelconque. Pourtant un des nôtres a été saisi par une patrouille. Nous avons réussi à l’arracher de leurs mains et à fuir. Mais un garde royal a mis en joue un étudiant en droit et l’a froidement abattu d’une balle dans le dos. Notre frère est mort quelques instants plus tard dans nos bras. Nous le connaissions. Il s’appelait Nicolas Lallemand. L’armée a aussitôt protégé le coupable et les heurts ont recommencé. Nous demandions justice. Des forces de l’ordre armées de canne cloutée se sont acharnées sur nous et sur toute personne qui osait rester sur place. Voilà, je vous ai résumé la triste situation. Le bruit court également que la loi du double vote a été votée. Le bilan est terrible. Nous avons échoué et un innocent est mort, assassiné par le pouvoir royal. »
Jean-Baptiste hocha la tête. L’euphorie de la mi-journée lui semblait bien loin. Au contraire, une profonde désillusion l’envahit. La liberté avait été souillée, songea-t-il découragé. Un tyran avait fait couler le sang de son peuple ! Sa gorge se noua amèrement et il lui sembla impossible, l’espace d’un instant, d’émettre le moindre son. Prenant le pas du groupe des manifestants qui se dirigeait vers la Seine, l’ancien officier sentit la haine se développer irrémédiablement au fond de son âme. Le maudit Bourbon chutera un jour, se dit-il avec violence, les yeux mi-clos, il s’en fit le serment.
L’homme rouvrit en grand les paupières. Une nouvelle lueur brillait dans son regard. Il sourit. Était-ce son imagination ou n’y avait-il pas dans le ciel azur, devant ses pupilles humidifiées de rage, un immense drapeau tricolore qui flottait avec majesté ? Une vision prémonitoire, se murmura-t-il rayonnant. Jean-Baptiste poussa un grognement à peine perceptible puis, après un dernier adieu, quitta les étudiants aux épaules lourdes et prit la direction de la rue des Grands Augustins. Il se rendait chez son ami, l’avocat Joseph Rey.
12 La loi du double vote : Après les élections de 1819, la démonstration était faite que la classe moyenne votait en majorité contre la droite, mais aussi contre le centre. Par le jeu des élections, on apercevait le moment où très légalement les ennemis de la dynastie, les libéraux de gauche obtiendraient la majorité à la Chambre des députés. Aux yeux des ultraroyalistes, mais également à ceux des doctrinaires et des constitutionnels, il apparut impératif de modifier la loi électorale. La classe des électeurs de trois à cinq cents francs devait être neutralisée. Un projet dit du double vote est proposé à la Chambre : aux 258 députés existants, élus par les censitaires payant au moins 300 francs, mais désormais au niveau de l’arrondissement, s’ajouteraient 172 députés supplémentaires. Ils seraient choisis par un collège de département constitué du quart le plus imposé. Ainsi les plus riches voteraient-ils deux fois : d’abord comme tous les électeurs dans un collège d’arrondissement, plus favorable aux influences des grands propriétaires locaux ; puis, privilège des grandes fortunes, pour désigner entre eux le complément.
13