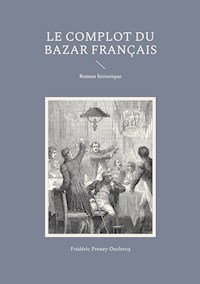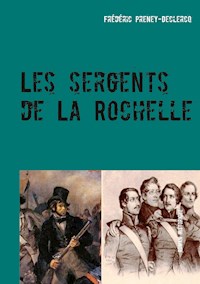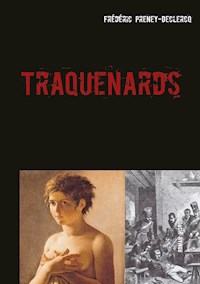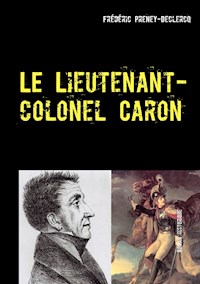
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Les enquêtes de l'inspecteur Eugène Chenard et les aventures du capitaine Jean-Baptiste Dumoulin, ex-officier d'ordonnance de Bonaparte
- Sprache: Französisch
Un colonel impérial assassiné dans une auberge parisienne. Son secrétaire particulier, originaire de Basse-Terre, agréable et brillant, mais empli de mystère. Un officier à la retraite, le lieutenant-colonel Caron, manigançant autour de la prison de Colmar où sont enfermés les conjurés du complot de Belfort. Un ex-officier d'ordonnance, Jean-Baptiste Dumoulin, enfilant le costume de Mentor auprès de l'un des bâtards de Napoléon, Charles Léon, âgé de seize ans, avec le rêve d'une destinée à la hauteur de son illustre sang. Louise, une orpheline arrachée à une compagnie de voleurs du Quartier latin et confiée à l'éducation sévère d'un couvent. Les préoccupations ne manquent guère pour Eugène Chenard, inspecteur de police, rue de Jérusalem. Surtout qu'après sept ans de règne, Louis XVIII est toujours malmené, à la Chambre des députés et au dehors par le parti libéral et son guide naturel, le général Lafayette, le vieil étendard de 1789. Mais ce roi mal-aimé parait surtout menacé par la Charbonnerie, cette armée de l'ombre à l'effectif infini et aux pensées régicides. La France, serait-elle à deux doigts de vivre une nouvelle révolution ? Le rebondissement de multiples situations, le foisonnement de personnages où se détachent d'attrayants portraits, la présence permanente de l'Histoire, font de "Le lieutenant-colonel Caron" un grand roman d'aventure et d'amour, mais aussi une belle leçon de la période de la Restauration (1815-1830).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 933
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture :
Portrait du lieutenant-colonel Caron dessiné lors de son procès devant la Cour des pairs (affaire du 19 août 1820, dite du Bazar français) [AN – estampe].
Cuirassier blessé quittant le feu de Théodore Géricault (1814).
Du même auteur
Le Complot du Bazar français
Première partie – Juin 1820
(Les Éditions du Net – ISBN : 978 2 312 06568 7)
Le Complot du Bazar français
Deuxième partie – Août 1820
(Les Éditions du Net – ISBN : 978 2 312 06586 1)
Le Charbonnier
Première partie – Le roi de Rome
(Les Éditions du Net – ISBN : 978 2 312 06569 4)
Le Charbonnier
Deuxième partie – Le général Berton
(Les Éditions du Net – ISBN : 978 2 312 06596 0)
À Morgan qui supporte depuis des années mes rêveries et
mes innombrables séances d’écriture.
À mes enfants, mes rayons de soleil.
Merci à vous quatre pour votre patience et vos encouragements.
À Véronique Nicolaï pour sa précieuse lecture correctrice
et sa grande connaissance orthographique.
Quel talent !
Reconnaissance et amitié.
À Maud Peyraud, lectrice des premières heures et amie fidèle. Merci pour ton
inestimable travail, ton avis et tes encouragements. Affection sincère.
À Erwan Le Pape, mon beau-frère,
qui s’est mué en correcteur œuvrant même en Arizona,
sur la Route 66, un manuscrit dans son sac
Vieille et profonde amitié.
Sans oublier Céline Esperandieu et Sophie Larger
et leurs crayons rouges qui m’accompagnent depuis des années.
Gratitude et affection.
Et tous les autres qui, chacun à leur manière, ont amené leur pierre à l’édifice,
Denis Mills et ses bons commentaires matinaux,
Thierry Kerdreac’h, grâce à qui Gil Aucante m’a offert de son temps pour lire mes
premières ébauches,
Christophe Morisseau sans qui le chapitre situé autour de l’Hôtel des Invalides
n’existerait pas,
Maurice Paquet et son beau-frère Joël Bitaudeau,
lecteurs de quelques centaines de pages.
Je n’oublie pas bien sûr les fans de mes premiers livres
qui m’ont régulièrement encouragé et
qui ont aussi manifesté leur impatience
à lire la suite des aventures de Marie, la courtisane,
de Jean-Baptiste Dumoulin, le Bonapartiste
ou de l’inspecteur de police Eugène Chenard
(je pense entre autres à ce sympathique chauffeur de taxi rencontré deux fois à
quelques années d’intervalle).
Si ce roman historique possède quelques qualités, cela leur revient.
Sans eux, le résultat serait moins bon.
À tous grand merci.
Personnages du roman
Les officiers français au passé impérial :
Belle-Rose :
âgé d’environ 35 ans, ancien lieutenant des
Marie-Louise
de 1814, dont il porte toujours la célèbre capote grise. Il devenu l’homme à tout faire du capitaine Jean-Baptiste Dumoulin.
Barbier-Dufay
: âgé de 52 ans, colonel mis à la retraite par ordonnance du 10 juillet 1816. Farouche bonapartiste, il n’hésita pas sous la Restauration à se battre en duel à plusieurs reprises contre des royalistes. C’est ainsi qu’en 1817, il tua en duel Saint-Morys et qu’en 1820, il blessa gravement le général de Montélégier.
Caron Augustin-Joseph
: âgé de 48 ans, lieutenant-colonel de dragon en retraite. Officier de la légion d'honneur, il a été compromis dans la conspiration du 19 août 1820, dite du Bazar français. Acquitté, mais mis en réforme sans traitement, il s’est retiré à Colmar.
Dentzel Jean-Chrétien Louis
: âgé de 36 ans, lieutenant-colonel de cavalerie en non-activité. Acquitté par la cour des Pairs, suite à la conspiration du Bazar français, mais depuis sévèrement surveillé par l’administration policière, il éprouve une antipathie réciproque envers le capitaine Jean-Baptiste Dumoulin, pourtant frère d’armes et allié politique.
Démoncourt Général Paul
: 51 ans, est un général français de la Révolution et de l’Empire. Au retour de l'île d'Elbe, il a soutenu avec succès le second blocus de Neuf-Brisach. Le nouveau pouvoir le mit à la retraite le 26 septembre 1821. Il s’est retiré près de Colmar. Ami du lieutenant-colonel Caron.
Dumoulin Jean-Baptiste
: 36 ans en 1822, officier d’ordonnance de Napoléon, rentier, demeurant à Paris. Fils d’un riche gantier de Grenoble, il s’est désintéressé en 1814 de l’entreprise familiale pour devenir un agent actif du retour de Napoléon exilé à l’île d’Elbe. Le 5 mars 1815, il organisa la chute de Grenoble. Napoléon en fit son officier d’ordonnance. Promu capitaine, Dumoulin fut blessé à Waterloo et capturé par les Anglais.
Dublar César-Brutus
: âge inconnu, sous-lieutenant démissionnaire et employé au Bazar français du colonel Sauset. Emprisonné pour sa participation au complot de Belfort, auprès du colonel Pailhès, dont il s’était constitué aide de camp.
Fabvier Charles-Nicolas
: baron impérial, âgé de 38 ans, négociant patenté et colonel en non-activité, demeurant à Paris, il est le type même du héros de la seconde génération des armées napoléoniennes et est devenu l’une des figures en vue du parti libéral, ami du général Lafayette.
Léon Charles
: âgé de 16 ans, fils bâtard de l’Empereur. Il fut le fruit d’une amourette sans importance de Napoléon avec Éléonore Denuelle, lectrice de Caroline Bonaparte. Napoléon montra de l’attachement pour ce fils aîné. L’un des articles du Testament impérial ajouta une somme de trois-cent mille francs au capital déjà placé au nom du jeune Léon.
Pailhès Antoine
: 43 ans. Baron impérial et colonel, mis en non-activité à la chute de Napoléon. Accusé d’être coupable de non révélation de la conspiration de Belfort et enfermé dans la prison de Colmar. Ami du lieutenant-colonel Caron.
Roger Frédéric-Dieudonné :
environ 40 ans
,
lieutenant à la retraite, ancien officier de corps francs et écuyer tenant un manège à Colmar.
Sauset Louis-Antoine
: baron impérial, 49 ans, colonel de la garde impérial et administrateur du Bazar français – une galerie marchande couverte par une verrière (une innovation pour l’époque) –, rue Cadet, n°11. Impliqué dans la conspiration du 19 août 1820, il a été acquitté par la Cour des pairs.
Les héroïnes du roman :
Augustine (La Renarde)
: 18 ans. Au service de Marie de Monlivo qui l’a arrachée de sa vie dissolue à Saumur.
Helena Caron
: 27 ans, originaire de Prusse et femme du lieutenant-colonel Caron, vivant à Colmar.
Louise
: fillette d’environ 8 ans, orpheline de Paris recueillie par l’inspecteur Eugène Chenard.
Marie de Monlivo
: âgée d’une vingtaine d’année, veuve du général de Monlivo mort dans un incendie à Saumur dont elle a hérité la fortune. Ancienne courtisane et ancienne maîtresse du capitaine Dumoulin qu’elle a rencontré en 1820 et dont elle a eu un enfant, Louisette, après leur séparation.
La baronne Pailhès
: mariée au colonel du même nom. Investie dans la cause de son époux, elle tente de trouver des alliés pour qu’il retrouve la liberté. C’est elle qui entraîne le lieutenant-colonel Caron dans la conspiration de Colmar.
Comtesse de Tantale
: âgée d’une trentaine d’années ; agent de la duchesse de Berry et maîtresse du capitaine Dumoulin qu’elle espionne à son insu.
Les membres de la police royale :
Eugène Chenard
: âgé d’environ 30 ans, inspecteur de police à la préfecture de police de Paris, rue de Jérusalem.
Achille Fleischmann
: Âgé d’une vingtaine d’années. Mulâtre originaire de Guadeloupe. Employé particulier du colonel à la retraite Ferier, puis, après l’assassinat de ce dernier, secrétaire de police à la préfecture de police, rue de Jérusalem, auprès de l’inspecteur Chenard.
Graville
,
Pierre Brinon
et
La Fouine
: auxiliaires de police auprès de l’inspecteur Eugène Chenard.
Thomas Rivière
: la quarantaine environ, archiviste de la préfecture de police.
Vidocq
: âgé de 47 ans en 1822, ancien bagnard devenu chef de la Sureté.
Les personnages politiques :
Le poète Béranger
(
Pierre-Jean de Béranger)
: 42 ans, chansonnier prolifique qui remporta un énorme succès à son époque.
La duchesse de Berry
: 24 ans. Veuve et mère du duc de Bordeaux, l’héritier de la couronne. L’homme de la famille royale, a-t-on écrit à l’époque. Par son intelligence et sa finesse, elle égaya la cour de la Restauration.
Benjamin Constant
: 55 ans, écrivain et homme politique, député libéral.
Maréchal Louis Davout
: 52 ans, chef des armées invaincu sous l’Empire. Bien que disgracié au moment de la Seconde Restauration, il put entrer à la Chambre des pairs en 1819, grâce à ses prises de position non ambiguës en faveur des Bourbons.
Le général Georges Lafayette
: 65 ans, général et député de la Sarthe, l’ancien marquis Gilbert du Motier de La Fayette, le « Héros des deux mondes », « l’homme de 1789 », l’inusable politicien, perpétuel étendard des mouvements antiroyalistes sous la Restauration.
Georges-Washington Lafayette
: 43 ans, fils du général Lafayette, militaire et homme politique français.
Jacques Laffitte
: 55 ans, banquier et homme politique. Député de Paris.
Louis XVIII
: 67 ans, Roi de France depuis la fin de l’Empire et son retour d’exil, frère puîné de Louis XVI, guillotiné sous la Révolution.
Jacques Manuel
: 47 ans, avocat et homme politique libéral français. Grand orateur, ses opinions lui valurent beaucoup d'ennemis parmi les députés ultras.
Talleyrand (Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord)
: 68 ans ; le
Diable boiteux
. Pendant une cinquantaine d’années, l’ancien évêque et ministre impérial fut l’un des principaux personnages de la vie politique française.
Sommaire
Prologue
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Chapitre 25
Chapitre 26
Chapitre 27
Chapitre 28
Chapitre 29
Chapitre 30
Chapitre 31
Chapitre 32
Chapitre 33
Chapitre 34
Chapitre 35
Chapitre 36
Chapitre 37
Chapitre 38
Chapitre 39
Chapitre 40
Chapitre 41
Chapitre 42
Chapitre 43
Chapitre 44
Chapitre 45
Chapitre 46
Chapitre 47
Chapitre 48
Chapitre 49
Chapitre 50
Chapitre 51
Chapitre 52
Chapitre 53
Chapitre 54
Chapitre 55
Chapitre 56
Chapitre 57
Chapitre 58
Chapitre 59
Chapitre 60
Chapitre 61
Chapitre 62
Chapitre 63
Chapitre 64
Chapitre 65
Chapitre 66
Chapitre 67
Chapitre 68
Chapitre 69
Chapitre 70
Chapitre 71
Chapitre 72
Chapitre 73
Chapitre 74
Chapitre 75
Chapitre 76
Chapitre 77
Chapitre 78
Prologue
Le 6 février 1822, Colmar
Après avoir parcouru un quartier étroit et encombré de cavaliers et de voitures en roulant sur une chaussée négligée et parfois boueuse, un fiacre s’immobilisa devant une maison aux fenêtres en baie et aux étages surplombants, légèrement en retrait d'une place pavée où débouchaient trois venelles commerçantes et colorées, animées par une foule bruyante et discontinue.
Le cocher cria quelque chose et une femme d’une quarantaine d’années – élégante personne, cheveux longs et châtains – descendit de la voiture. Après une hésitation et un regard alentour, elle s’approcha de la porte d'entrée où sa main gantée fit sonner la cloche en cuivre. Effet immédiat, une domestique en habit sombre se présenta à elle, l’œil examinateur.
« Est-ce ici la demeure du colonel Augustin Caron ? demanda sans préambule la dame. Dites-lui que la baronne Pailhès désire être reçue », ajouta-t-elle avec une pointe d'autorité, après le signe de tête de l'employée de maison.
La visiteuse fut introduite dans un salon où un feu vif brûlait dans la cheminée, chauffant agréablement la pièce, après le froid mordant du dehors. Une fois seule, madame Pailhès s’installa dans un fauteuil, notant que la maison était fort silencieuse, presque triste. Mon imagination sans doute, se dit-elle en respirant profondément. Faute à mon humeur morose, ajouta-t-elle en pinçant ses lèvres.
« Mes hommages, chère baronne, entendit-elle d’une voix grave, et, d’un mouvement rapide, elle se releva pour découvrir un homme un peu plus âgé qu'elle, le corps fin, vêtu d’un frac avec haut col pointu, pantalons longs et chaussures basses, des cheveux courts et grisonnants, un nez légèrement aquilin et un anneau d'or à l'oreille gauche.
- Mon cher colonel Caron, s'écria la femme, avant de se taire, rubiconde, car elle venait d'apercevoir le crêpe noir autour de son bras gauche.
- Notre petite fille, réagit l'officier imperturbable, quoique ses yeux étaient devenus ternes. Ingrid Clémence Caron, continua-t-il d'un ton plus bas. Une petite fleur de deux ans. La scarlatine... foudroyante.
- Oh ! Je suis désolée… Mon Dieu ! Vraiment désolée… Quel drame ! Si j’avais su…
- Sa mère est inconsolable.
- Pauvre mère…pauvre madame Caron…
- Nous venions juste de récupérer notre fils, continuait l’homme dans un murmure, le visage d’une effrayante pâleur. Nous étions enfin réunis… tous les quatre…
- Dieu du Ciel ! J'ignorais que vous aviez un fils, colonel, dit la baronne, s’accrochant à ce sujet de discussion, car l’apparence de son hôte la bouleversait. Mon mari ne m'en avait jamais parlé. Vous-même, lors de notre première rencontre, ajouta-t-elle avec un mouvement de sourcils, interrogateur.
- Quelquefois il est difficile de parler des histoires qui déchirent les familles, madame, dit Caron avec un sourire sans joie, tandis que d'un geste machinal de la main, il effaçait la larme qui menaçait de couler le long de sa joue. Alfred – c'est son prénom – est né avant notre mariage, poursuivit-il après une inspiration, en 1812, un enfant du pécher vous diraient les jésuites. Enfin pour vous résumer cette petite histoire, il était toujours en Prusse, chez ses grands-parents qui refusaient le moindre contact avec nous, depuis que j'avais enlevé leur fille, ma femme… En 1817, choix cruel, je n’avais pu emmener les deux.
- Je comprends, cher ami, murmura la baronne pleine d’affection. Mais laissons cela, voulez-vous ? dit-elle en effectuant un pas vers la porte. Veuillez m’excuser de vous avoir dérangé. Je vais dès à présent vous quitter, je ne peux que vous laisser paisiblement pleurer votre petite Ingrid, cet ange...
- Non, restez, madame, réagit l'homme. Dites-moi plutôt ce que vous vouliez de moi ? Pourquoi votre visite ?
- C'est sans importance, colonel… vraiment. Je suis confuse de vous avoir dérangé.
- Est-ce en rapport avec votre mari, le colonel Pailhès, mon vieil ami ? insista Caron avec un signe d'interrogation.
- Oui, mais je me refuse à vous embarrasser avec mes problèmes, dit la dame, les sourcils froncés. Votre situation, votre drame... je n’en ai pas le droit.
- Je n'ignore pas sa malheureuse tentative, madame, annonçait l'officier, entrant dans le vif du sujet. Saviez-vous qu'il m'avait demandé d'être à ses côtés à Belfort ? De le rejoindre avec le général Dermoncourt.
- Ah, je l’ignorais...
- Cela a été un crève-cœur de lui refuser mon concours, madame, croyez-moi. Mais, c’était à cet instant que nous récupérions enfin notre fils Alfred. Ma tendre épouse ne m'aurait pas compris si j'avais refusé de me rendre en Prusse à ses côtés. Des mois que nous nous débattions avec ses parents. Oui ! Vraiment ! Helena n’aurait pas compris, répéta-t-il, le regard fixe.
- Remerciez ce contretemps, car votre présence n'aurait pas empêché l'échec, et vraisemblablement votre arrestation.
- Nul ne le saura, mais sans doute...
- Aujourd'hui, mon époux risque l'échafaud, s’écria la dame avec des yeux fiévreux où perçait un mélange de haine et de peur. Je cherche tous les moyens possibles pour l'aider, pour le sauver.
- Vous avez frappé à la bonne porte, madame, réagit le lieutenant-colonel Caron, lui prenant la main. Venez, installons-nous près de la cheminée. Brossez-moi un portrait de la situation. Parlez-moi de votre idée et nous verrons ce que nous pourrons envisager. Ne l’oubliez pas, le colonel Pailhès est un vieil ami. »
-
Sept jours plus tard, le 14 février 1822, ville de Chavelot, à une lieue d’Épinal.
« …Soixante-huit dragons exactement, racontait à voix basse un homme vêtu en bourgeois, cheveux gris, attablé dans une auberge sombre, face à un quidam à la chevelure rare et front rond, la moustache du brave, habillé d'une longue redingote claire. Oui, je commandais à seulement soixante-huit dragons, répéta le premier, après avoir avalé une gorgée de bière, j'étais à cette époque chef d'escadron. Depuis deux bonnes heures, nous traversions une satanée plaine aride, cherchant à rejoindre le régiment. Une fichue situation, surtout lorsque, positionnés sur une hauteur, nous sont apparus ces chiens d'Hispaniques. Je me souviens de la date, le 31 mars 1813. En face, il y avait bien trois escadrons qui nous attendaient en colonne serrée, piaffant d’impatience, avec à leurs côtés, quelques-uns de leurs moines dégénérés et ventripotents. Oh ! Mon sang n’a fait qu’un tour. J'ai mis sabre au clair, et j'ai tourné mon cheval vers mes hommes. Vive la Nation ! leur ai-je simplement dit, et, sans plus attendre, j'ai chargé l'ennemi. Comme un seul homme, aux cris de Vive l'Empereur ! Vive la Nation ! mes braves m'ont suivi, sans exception. Ah ! Quelle charge, mon cher Roger ! Quelle charge ! J’entends encore sous mon crâne le martèlement des sabots de nos chevaux sur le sol. Tout s’est mis à trembler, le moindre brin d’herbe. Ah ! Quelle surprise pour ces jean-foutre d’en face qui pensaient nous voir fuir ventre à terre. Nous les avons culbutés, sabrés, massacrés. Nous leur avons bien tué quarante hommes et mis soixante hors de combat, dont plusieurs haut-gradés. Le premier que j’ai abordé, je l’ai attaqué d’un vigoureux coup de revers, alors qu’il voulait me larder le flanc droit. Le tranchant de mon sabre frappant sur ses dents noircies et passant entre ses mâchoires au moment où il criait pour s’animer, lui a fendu la bouche et les joues jusqu’aux oreilles. Ah, oui ! Quelle victoire ! Les survivants – ces couards ! – se sont débandés dans toutes les directions, abandonnant bêtes, curés, armes et matériels. Et c'est pour cette affaire que j'ai reçu la légion d'honneur.1
- Vive l'Empereur, mon colonel ! » s’écria l'auditeur en levant haut un verre de vin, le dénommé Roger, plus exactement Frédéric-Dieudonné Roger.
L’officier impérial aux yeux gris vert qui venait de raconter son fait d'arme – le lieutenant-colonel Augustin-Joseph Caron – hocha la tête avec un rictus sur les lèvres, puis instinctivement jeta un coup d'œil par dessus l'épaule de son compagnon, sur une pendule à trois cadrans en marbre blanc et bronze doré, posée sur la cheminée de la salle.
« Neuf heures vingt-cinq, annonça-t-il tout haut. Il est bientôt l'heure.
- Croyez-vous que votre judas de « de l'Etang » soit déjà là, mon colonel ? demanda Roger en grimaçant un sourire, l’espérant, car depuis qu’il connaissait l’officier supérieur, encore plus depuis que celui-ci avait placé son cheval en pension dans son manège à Colmar, il avait maintes fois entendu de sa bouche le souhait effréné de cette rencontre.
- Je ne le crois pas assez fat pour ne pas venir, lieutenant. (Caron tapota l'aile de son nez). Cela se devine. Depuis l'affaire du Bazar français, nous nous haïssons suffisamment pour ne pas rater ce merveilleux rendez-vous. Nous n’en avons que trop rêvé.
- Vous avez raison, mon colonel, fit l'autre en se raidissant d'un coup. Regardez dehors ces deux cavaliers qui arrivent de Charmes, celui de droite, c'est bien lui, non ? Ce maudit bâtard ? »
Après s’être levé avec des gestes lents, le lieutenant-colonel Caron opina de la tête. Ah ! Son obsession première se réalisait enfin ! Il allait pouvoir sabrer ce fils de chien, ce maudit témoin à charge qui lui avait fait subir des mois de captivité, cette grande gueule, cause de sa mise en réforme sans traitement, malgré ses presque vingt-cinq ans sous les armes. Ce maudit judas ! Oui, il allait enfin payer, il allait lui trancher sa gorge, le saigner comme un pourceau. Il allait laver l'affront, lui faire payer leur échec. Oui ! Tuer cette charogne de royaliste !
« Sortons à la rencontre de ces messieurs, dit Caron avec un mouvement de tête, le regard gris et tranquille, gardant ses injures pour lui-même. Mais rejoignons d’abord nos chevaux et nos armements, puis nous ferons la jonction.
- À vos ordres, mon colonel, s’écria Roger dont la voix tremblait d’excitation. À vos ordres, répéta-t-il, l’air presque dément. Et foutredieu ! Faites comme Barbier-Dufay2 vient de faire à Paris, clouez-nous ce misérable fat sur le sol. »
1 Dossier légion d’honneur du lieutenant-colonel Augustin Caron, archives nationales.
2 Le colonel Barbier-Dufay, avait été cité comme témoin au procès des conspirateurs du Bazar français et condamné pour diffamation envers le général vicomte de Montélégier ; il provoqua en duel celui-ci dès sa libération et le blessa grièvement, faits rapportés dans les journaux de l’époque.
Chapitre 1
1er mars 1822 ; Paris, préfecture de police
Après s’être assis à son bureau, rue de Jérusalem, l’inspecteur de police Eugène Chenard – individu élancé aux cheveux blonds, fine moustache et favoris, la trentaine – respira profondément, avant de prendre connaissance du double d’un pli arrivé de la Préfecture des Vosges et adressé à son Excellence le ministre de l'Intérieur : Monseigneur, le 14 de ce mois, le sieur Augustin Joseph Caron, colonel en retraite, jugé et acquitté l'année dernière par notre Cour des pairs, est venu coucher à Épinal dans l'auberge où il avait été arrêté le 16 août 1820. Le lendemain matin, j'ai appris que monsieur l'Etang, lieutenant-colonel du régiment de dragons en garnison à Lunéville, et témoin à charge contre le sieur Caron avait couché la nuit du 14 au 15 dans une auberge de Charmes, petite ville à 6 lieues d'Épinal. Cette coïncidence d'arrivée à Épinal du sieur Caron et du sieur l'Etang me donna lieu de penser qu'un rendez-vous avait été donné pour se battre en duel. Messieurs Caron et l'Etang s'étaient en effet donné rendez-vous à Chavelot, village situé à une lieue d'Épinal sur la grande route. Sur mon ordre, des gendarmes se trouvèrent au lieu du rendez-vous au moment où les deux adversaires, le sabre à la main, étaient prêts à se battre. Messieurs Caron et l'Etang furent obligés de se séparer et de quitter les lieux le plus rapidement possible, chacun dans une direction opposée.3
Un sourire se dessina sur les lèvres de Chenard.
« Le lieutenant-colonel Caron, le sot, l’incroyable sot, se dit-il asticoté. Encore une preuve de sa culpabilité ! Mais surtout une nouvelle et belle preuve de l'incapacité des pairs de juger les accusés du complot d’août 1820, susurra-t-il, le regard noir. Tous félons, mais tous acquittés, alors que nul doute, l’inculpé Caron et les autres avaient dangereusement conspiré. Enfin un loup reste un loup, conclut l’homme, un rictus sur la bouche. Nul ne doute qu’un jour, lui et les autres tomberont dans le creux de ma main. »
Sur ce, l'inspecteur leva la tête, distrait par un huissier qui venait d'entrer dans la pièce.
« Le sieur D’Eslon est arrivé, chuchota ce dernier avec prévenance.
- Ah, oui ! L’affaire Ferier, songea tout haut Chenard en pinçant ses lèvres. Introduisez-le, continua-t-il en ouvrant un dossier sur sa droite. Pendant ce temps, trouvez-moi tout ce que nous avons sur un dénommé Caron Augustin Joseph, lieutenant-colonel à la retraite et napoléonide notoire, résidant à Colmar, je crois…oui, c’est cela, à Colmar.
- Bien, monsieur l'inspecteur. »
-
« Monsieur César Philibert D’Eslon, chef d’escadron à la retraite, je présume ?
- C'est cela même, monsieur... monsieur ? demandait le personnage – épaisse moustache et cheveux courts et roux –, après s’être assis avec défiance face au bureau de son hôte.
- Inspecteur Eugène Chenard, répondit celui-ci d’un ton égayé.
- Et que me vaut cette convocation ?
- Connaissiez-vous le colonel Ferier Jean Henri né le 18 février 1771 ?
- Ferier… Hum ! Quelle surprise. Un bien vieux nom. Bien sûr… Oui, j'ai servi en Espagne sous ses ordres.
- Quel genre d'homme était-il ? Quel genre d'officier ?
- Vous voulez vraiment le savoir, monsieur ? questionna le dénommé D’Eslon avec un air étrange, presque amusé, et il s’agita sur son siège, nerveux.
- Absolument. Quelque chose vous dérange ?
- Je n'aurai aucun scrupule à vous dire la vérité.
- Je ne cherche que la vérité, monsieur, dit Chenard avec hauteur, les yeux arrêtés. Voilà le pourquoi de votre présence ici, insista-t-il en appuyant sur chaque syllabe. Et ne me faites pas perdre mon temps, sinon… menaça-t-il, après un silence.
- Très bien, fit l’autre, mi-impressionné, mi-étonné, avant d’être indisposé par une soudaine quinte de toux. Alors voilà un exemple, reprit-il après quelques secondes, qui vous dira quel genre de créature était le colonel Ferier, personnage que je ne prisais guère. Un jour de mai ou juin 1807, je ne sais plus, quelques paysans espagnols s'étaient prétentieusement opposés en avant du pont d’Albarracin, à notre avant-garde. Ils ont été sabrés en un instant et – effet immédiat – le village d’Albarracin fut mis à sac, les maisons rasées, la population, hommes, femmes, enfants, massacrée dans un horrible bain de sang. L'armée avait obéi aux ordres de Ferier.
- Je vois, fit Chenard sans sourciller, droit sur son siège.
- Un autre jour, avec notre régiment, poursuivait D’Eslon, tout à ses souvenirs, il fit de l’église de Santa-Cruz un lieu de prostitution où furent victimes de sa passion et de celle de la majorité de sa soldatesque une foule de religieuses, sans qu'on respectât même les plus vieilles…
- Hum, hum, continuez…
- Peu de temps avant notre retour d’Espagne, je me rappelle qu'il y avait un tapin avec un nom alsacien dans le régiment. Ce mioche s'était amouraché d'une petiote trouvée sur le bord d'un chemin, un joli brin de fille d’une douzaine d’année. Ils ne se quittaient plus. Le grand Amour, quoi ! On en riait à la veillée. Ils étaient vraiment attendrissants, magnifiques. Un jour, que la jouvencelle était seule, le colonel l’a mandée sous sa tente pour aussitôt l’outrager, et, comme la malheureuse s’est défendue, il lui a donnée un méchant coup de poing ; elle en est morte le lendemain.
- Et le tapin ?
- Le tapin ? Euh... Je ne sais plus… Que vouliez-vous qu'il fasse ? Il avait onze-douze ans. Je crois qu'il a disparu…oui, c'est cela, je me rappelle maintenant. Après qu'il eut découvert le drame, il a déserté, surtout que l’on a su à rebours que c’était Ferier qui l’avait envoyé je ne sais où au moment du viol, pour que la petite soit seule.
- Poursuivez.
- Je pourrai continuer pendant des heures, dit le témoin, après avoir été gêné par une deuxième quinte de toux, tellement il existe d'exemples de gestes odieux du colonel Ferier. J'en ai volontairement oublié d'ailleurs, sinon je serais continuellement écœuré, écœuré du monde des hommes. Je veux néanmoins préciser que j’ai toujours connu le colonel Ferier d'un caractère extrêmement violent et emporté. Quoique dans le corps, on n’ait jamais rien eu à lui reprocher sous les rapports de la bravoure lors des combats contre l'ennemi. Il valait mieux l'avoir à ses côtés que contre vous, croyez-moi. Mais puis-je vous demander pourquoi tous ces renseignements ?
- Une enquête sur un homicide.
- Ah ? Et le colonel Ferier y serait mêlé ?
- Plutôt, monsieur le chef d’escadron D'Eslon, fit Chenard avec un sourire sans joie, le dénommé Jean Henri Ferier a été retrouvé avant-hier dans une bien fâcheuse posture.
- C'est-à-dire ?
- Allongé sur un lit dans une chambre d’auberge, entièrement nu, avec la verge tranchée et fourrée dans sa bouche...
- Hou ! Quelle abomination ! On se croirait de retour en Espagne, dans ce pays de fanatiques.
- Ce n'est pas fini, monsieur, un objet en bois, fin, était planté dans sa poitrine, plus particulièrement lui traversait le cœur...
- Le cœur ?
- Vous avez bien saisi.
- Ah ! Plutôt abjecte cette histoire. Qui ? Qui a été capable d’un tel geste ?
- J'enquête, monsieur, j'interroge, je rassemble.
- Mais pourquoi moi ?
- Pour arriver au meurtrier, j'apprends d'abord à connaître la victime. Grâce à vous, ne viens-je pas d'ouvrir une liste de suspects ? Le tapin par exemple…ou bien un paysan espagnol, survivant du massacre d’Albarracin…ou encore l'une des sœurs outragées du couvent de Santa-Cruz…ou peut-être un bâtard né de ces viols...
- La liste serait trop longue, monsieur, si vous enquêtiez sur le passé criminel de Ferier, les exemples de ses exactions seraient innombrables. C'était une bête, un monstre. Il achevait les blessés ennemis en riant à pleines dents, faisait pendre haut et court tous les moines espagnols qu’il pouvait attraper. Mes paroles vont peut-être vous heurter, mais ce qui lui est arrivé, il ne l'a pas volé. Je me répète, mais c'était un monstre.
- Oui, mais il y a eu meurtre.
- Son meurtrier m'apparaît plus comme un justicier ; abandonnez votre enquête, monsieur, c'est, je pense, un bon conseil...
- Dura lex sed lex, monsieur, dit Chenard en fixant son vis-à-vis. Alors gardez vos conseils pour un autre ! Dites-moi plutôt ce que vous faisiez dans la soirée d'avant-hier.
- Vous me soupçonnez ?
- J'attends votre réponse.
- Bien, monsieur, marmonna D’Eslon en luttant contre une nouvelle envie de tousser. Donnez-moi une feuille blanche où je vous écrirai trois noms de compagnons qui vous confirmeront que j’étais en leur compagnie dans un lieu public, où sans aucun doute plus d’un individu nous aura remarqués…
- Au revoir, monsieur, coupa l’inspecteur avec un mouvement de tête. L’huissier, derrière la porte, notera ces informations que je vérifierai personnellement, soyez-en convaincu. »
À nouveau seul, Eugène Chenard se demanda s’il avait eu raison de taire à son visiteur poitrinaire qu’il avait trouvé son nom et adresse marqués sur un bout de papier volant, au domicile de la victime. Il se gratta la tête, puis, son esprit ayant envisagé diverses possibilités, il passa à autre chose et ouvrit le dossier d’archives, remis par un secrétaire, lors de la sortie du suspect D’Eslon.
Première page datée du 17 août 1820, un réquisitoire du procureur du roi d'Épinal.4
Je vous informe qu’hier, était-il écrit d’une calligraphie fine, le lieutenant-colonel Caron en retraite se serait présenté au domicile de monsieur de l'Etang, chef d'escadron au régiment de dragon de la Seine en garnison à Épinal, et que l'ayant abordé, il lui aurait annoncé que le Sieur Cazot, officier en retraite lui avait fait part que le sieur de l'Etang auquel il parlait, était un officier sur lequel on pouvait compter dans le cas d'une défection de l'armée et ajoutant que s'il voulait garder le silence, il lui nommerait les personnes qui se trouvaient à la tête du mouvement. Mais, ayant aperçu l'indignation qui se dessinait sur sa figure, il a ralenti son discours, et lui a demandé le secret. (Autre lettre de monsieur le procureur général de Colmar en date du 19 août 1820).5Le colonel Caron n'est ici que depuis un an, il y a été six mois en demi-solde et depuis six mois il a sa retraite de 2000 francs, plus 500 francs comme officier de la Légion d'honneur, il a tenu à Colmar une conduite sage et prudente. Le colonel Caron est instruit, homme de mérite et de valeur, il ne paraît pas avoir de patrimoine ; il a épousé la fille du directeur général des forêts de Prusse qu'il a enlevée, il est sans correspondance avec la famille de sa femme. (Nouveau courrier du procureur du roi près le tribunal à son Excellence monsieur le Garde des Sceaux en date du 31 août 1820).6Actif, adroit, ambitieux, audacieux et mécontent, Caron a tout ce qu'il faut pour en faire un agent d'un parti : il ne paraît tenir à la société par aucun lieu de famille ni de fortune. On m'assure qu'il est marié, qu'il a cinq enfants, qu'il a abandonné sa première femme pour enlever la fille du directeur des forêts en Prusse, une dénommée Johana Helena Bartel, dont il a un enfant et avec lesquels il vit. Le sieur Caron voit peu de monde à Colmar. Il va assez fréquemment chez le général Dermoncourt à deux lieues de la ville.
Sa lecture achevée, Chenard fixa la chaise devant son bureau, l’esprit contrarié, car la pensée que ce dénommé Caron ait pu échapper à une condamnation dans le procès de la conspiration du 19 août 1820 l’irritait toujours. Nul doute en effet que ce séide de Bonaparte avait conspiré et conspirait encore. Comme tous les brigands de la Loire7, il cachait mal ses opinions bonapartistes, au contraire presque, il les manifestait en tous lieux et à toute occasion, ne rêvant que de sortir son sabre du fourreau pour répandre désordre et confusion. Il était donc grand temps de s’occuper de ce dangereux individu, se dit le policier avec conviction. Mais comment et quand ? L’homme se pressurait en vain le cerveau sur ces questions, lorsque l’huissier ouvrit à nouveau sa porte.
« Il est presque midi, monsieur, avisa ce dernier avec un hochement de tête. L’heure de se rendre à la salle de permanence. Vous savez : recevoir les ordres du préfet.
- Je sais, fit le policier avec un signe de la main, puis, après s’être emparé de son haut-de-forme et de sa lourde canne, il se leva d’un bond. Allons-y, annonça-t-il en se dirigeant vers le lieu du rendez-vous, une salle tout en arcades. Allons écouter ces foutus céleris qui nous commandent ! »
-
Une heure plus tard.
« Alors, inspecteur, l’affaire Ferier ? demandait à mi-voix un individu ventripotent, cheveux gris et taille moyenne, au milieu d’une vaste salle carrelée, parmi une cinquantaine de personnes éparses, dont le préfet qui venait de conclure sa harangue coutumière.
- Je progresse, monsieur l’officier de paix, répondit Chenard d’un ton monocorde. Je progresse…
- Progressez vite, inspecteur, s’impatienta l’autre, après un geste de mauvaise humeur, monsieur le Préfet désire que l’enquête aboutisse très rapidement. Il s’agace, il ne veut pas que les libéraux s’emparent de l’affaire, et surtout que le général Foy nous sorte à la tribune un de ses discours dont il a le secret, réclamant justice pour ce bandit de la Loire écorché vif comme un eunuque dans un bordel miteux. Avez-vous au moins une piste sérieuse ?
- Peut-être…
- Vous m’exaspérez, Chenard, il faut toujours vous tirer les vers du nez. Quelle piste, foutredieu ?
- Suite à un interrogatoire, je recherche un ancien tapin qui aurait souffert du comportement du colonel Ferier.
- Un tambour ? D’où vous vient cette idée biscornue ?
- Savez-vous quel était l'objet planté dans le cœur de la victime ?
- Je vous écoute !
- Une fine baguette d'ébène, une baguette de tambour…
- Ah ! Quelle affaire sordide, coupa l'officier de paix en laissant échapper un mouvement d'impatience, l'air écœuré. Une baguette de tambour enfoncée dans la poitrine ! Un crime signé ? Drôle d'idée… Et vous voulez que j'aille rapporter ça à monsieur le Préfet ? Enfin, je vous fais confiance, cherchez ce tambour, mais dépêchez-vous, bon-sang ! Dépêchez-vous ! Et je veux un rapport quotidien, Chenard, quo – ti – dien. M'avez-vous bien compris ?
- Justice sera rendue, monsieur l'officier de paix, justice sera rendue.
- Oh ! Avec vous, je n'en ai aucun doute.
- Je puis vous laisser maintenant, dit Chenard en amorçant un pas en arrière.
- Non, autre chose. La Congrégation vous a à la bonne, le père Ronsin veut vous revoir. Ordre du Préfet bien-sûr.
- Pourquoi pas ? fit le policier avec un sourire, et, après un semblant de révérence, le personnage quitta la vaste salle de permanence de la préfecture, pour s’en retourner vers son bureau, l’esprit en action, comme toujours, concentré, luttant inlassablement contre le crime.
3 Archives Nationales, série F7 6676.
4 Archives Nationales, série CC 521 pièce 7.
5 Archives Nationales, série F7 6676.
6 Idem, série F7 6676.
7 Après la défaite de Waterloo, les restes encore nombreux de l’armée impériale se retirèrent derrière la Loire. Dissoute en août 1815, cette armée fut lentement renvoyer dans ses foyers. Ces soldats restés fidèles à l’Empereur furent appelés « brigands de la Loire » par les royalistes pour ternir leur image. Ce serait l’inverse de l’expression utilisée sous la Révolution par les républicains contre les « brigands de la Vendée » qui soutenaient Louis XVI et Marie-Antoinette, puis l’enfant du Temple.
Chapitre 2
Village de Maisons, proche de Paris, printemps 1822
« Tudieu ! Sacrée bâtisse, mon capitaine », dit un quidam aux cheveux noirs mi-longs, élégamment vêtu, le corps sec, un visage agréable, quoique découpé du front au coin de la bouche par une cicatrice.
Dressé sur ses étriers, devant la grille d’un parc fleuri, ce cavalier observait un château style renaissance, dont le corps central était encadré d’ailes à pierres blanches qui se terminaient par deux pavillons carrés symétriques.
« L’ancien castel de Lannes, aujourd’hui celui du député Laffitte, répondait Jean-Baptiste Dumoulin, tirant sur le mors de son cheval, à côté du balafré qui venait de se rasseoir sur sa selle.
- À voir tous ces fiacres devant l’entrée, y’a du monde d’invité, continuait celui-ci en caressant l’encolure humide de sa monture, une jument isabelle robuste et fringante.
- Tu vas découvrir un sacré pékin8 en la personne de Laffitte, mon cher Belle-Rose. Le bonhomme est riche à millions et le fait joliment savoir. Je ne compte plus les fêtes auxquelles j’ai participé, ici à Maisons, fêtes toutes aussi somptueuses les unes que les autres.
- Signe de faiblesse, mon capitaine !
- Que dis-tu ? s’étonna l’autre, fronçant les sourcils. Pourquoi faiblesse ?
- Signe d’un parvenu qui veut faire oublier d’où il vient.
- Mordious ! fit Dumoulin avec un franc éclat de rire. Tu n’es pas le seul à me le dire ; j’ai déjà entendu dire au moins quatre à cinq fois que mon bon Laffitte était un parvenu, un coucou dans le nid Perrégaux9. Enfin je t’assure que le gaillard est sympathique, quoiqu’un peu trop orléaniste à mon goût, dommage ; mais il faut reconnaître que le banquier a grandement payé de sa bourse pour notre cause.
- Audaces fortuna juvat10, commenta le dénommé Belle-Rose en ricanant. Oh ! Oh ! J’entends midi qui sonne au loin, ajouta-t-il en faisant avancer sa jument. Sans vous commander, entrons de suite dans la demeure de notre regretté Achille11 pour que je puisse découvrir ce sieur Laffitte qui a eu raison de nous convier, car je meurs de faim. Tarde venientibus ossa12.
- Vive le glorieux Lannes et vive l’Empereur ! » murmura Jean-Baptiste, avant de donner à son tour un léger mouvement d’éperons.
Leurs chevaux aux pas, les deux cavaliers franchirent les grilles ouvertes pour entrer dans le parc du château de Maisons. Tandis qu'il observait sommairement le personnel du banquier Laffitte qui accourait pour les accueillir, le capitaine Dumoulin se mâchonna l'intérieur des joues, car – effet inattendu – il se sentait d'un coup empli de sentiments et d'impressions contradictoires, c'est-à-dire heureux de revoir la société libérale et son contraire.
Libéré depuis deux jours de la prison de la Conciergerie, après une condamnation ferme suite à sa participation à l’affaire des Petits-Pères13, l’homme allait rencontrer des compagnons de luttes qu'il n’avait plus revus depuis l’échec de la conspiration de l’Est. Des complices qui n’avaient alors guère prisé son attitude à Belfort, car Jean-Baptiste était arrivé fort tard, bien après les évènements insurrectionnels. Tous ignoraient son duel avec le traître Bérard, farouche passe d’armes qui lui avait coûté une blessure à la cuisse et trois jours de fortes fièvres, obscures et délirantes14. Comment donc se passeraient les retrouvailles, après une si longue absence ? Qui d’ailleurs allait-il revoir, car beaucoup de charbonniers avaient fui le territoire sacré, suite à la répression policière due aux conjurations ratées de Belfort, Strasbourg ou Saumur.
Là-dessus, il sentit son ventre se tortiller, état désagréable qui confirmait qu’il n'aimait pas les situations fausses, nées d'incompréhensions ou de mauvais racontars. Foutu merdier ! jura-t-il en respirant profondément. Les paupières baissées, il laissa son esprit balayer le temps. Certes, juste avant sa condamnation de six semaines à la Conciergerie, il avait traversé une mauvaise passe, fait de mauvais choix – son duel avec le chef de bataillon Bérard, son démêlé musclé avec le lieutenant-colonel Dentzel ou encore la confiance aveugle placée en Berton – mais il avait été surtout desservi par la malchance. Ah ! Cruelle période, fulmina-t-il, car dorénavant il avait conscience qu’il était mésestimé par ses compagnons de lutte, alors qu’il n’avait qu’une parole, qu’il était un homme droit et fidèle, un brave. À cette pensée, l'officier eut un mouvement d'humeur. Ah ! Chienlit que ces trois derniers mois ! jura-t-il, le menton levé, cherchant à se ragaillardir. Il était à nouveau libre. Il était opérationnel ! À lui de s'imposer, à lui surtout de travailler encore et toujours à la chute des Bourbons et au retour du roi de Rome, le fils du grand homme. Rien ne devait le faire sortir de cette route. Sauf Marie peut-être, s’avoua-t-il, dévié de sa pensée première, aussitôt malheureux, le cœur empoigné. Marie, l'être qu'il désirait le plus au monde, la femme qu'il aimait, son amante une nouvelle fois disparue. La mère de sa fille. Que de questions sans réponse. Où était-elle aujourd’hui ? Était-elle tombée dans l’affreux piège de la comtesse de Tantale, cette terrible courtisane, cette louve ? Avait-elle cru à son abominable lettre ? Ce ridicule écrit ? Non, impossible !
Sur quoi, l’homme joignit les mains, comme s’il allait implorer Dieu de lui venir en aide.
Mais pourquoi ce nouveau départ ? Cette disparition ? Pourquoi avoir abandonné sa demeure de Saumur ? Pourquoi ce silence ? Pas une lettre de sa part depuis leur dernière rencontre. Son adresse était toujours la même, rue du Sentier, elle y avait vécu. Des moments merveilleux… Jean-Baptiste fronça les sourcils, désespéré ; au fond de son âme, il avait un mauvais pressentiment : Marie était perdue, définitivement perdue. Foutre, non ! se promit-il en autodéfense, l’esprit colérique, après une poignée de secondes d'hébétude. Cette femme était sienne ; sa Marie, cette rose rouge, superbe, au milieu d'un champ de blé. Oui ! Il la retrouverait ! Dût-il renverser des montagnes ! Dût-il traverser un océan ! Il la retrouvera !
« Capitaine, avez-vous nos cartons d'invités ? demanda Belle-Rose, après avoir discutaillé du haut de sa jument avec un majordome en livrée qui l’avait abordé, près du perron.
- Bien sûr, ici ! tressaillit Jean-Baptiste sur sa selle, et, d’un mouvement souple, l'officier descendit de sa monture pour annoncer d'un ton ferme leurs titres respectifs : le capitaine Dumoulin, ex-officier d'ordonnance de l'Empereur, et son secrétaire, Louis Belle-Rose.
Puis, presque sans un regard, après avoir présenté au maître d'hôtel en uniforme une invitation reliée par un ruban mauve, sortie de l'intérieur de sa redingote claire, il cédait les rênes de son cheval noir à un garçon d'écurie, aussitôt imité par son compagnon de route.
-
Une demi-heure plus tard, rafraîchis et parfumés, Jean-Baptiste et Belle-Rose piétinaient à l’intérieur du château de Maisons, au milieu de la galerie du premier étage, parmi maints invités qui se saluaient de brefs mouvements de têtes. Au fond de la salle, un orchestre d'une douzaine de musiciens, vêtus de couleurs criardes, jouait un air classique, vif et gai. Curieux et affamés, les visiteurs s'avançaient vers un buffet somptueux, nappé de blanc, qui proposait des plats variés et une extraordinaire pyramide de fruits exotiques. Sur la gauche, une équipe de serviteurs avec perruque blanche et costume d'or, debout ou accroupis devant des vasques emplies de glace, débouchaient des bouteilles de champagne ou de vins liquoreux, tandis que d'autres présentaient sur des plateaux d'argent, flûtes et verres aux convives qui s'entassaient autour d’eux.
« Une coupe, mon capitaine ? » demanda Belle-Rose, qui, sans attendre la réponse, partit remplir sa mission désaltérante.
Jean-Baptiste le regarda s'éloigner, avant d’observer l'assistance colorée qui l’entourait, criante et riante. Il n’y voyait que des visages inconnus. Demi-surprise, il n’y avait aucune trace d'un Fabvier et d'un Dentzel, ses compagnons de lutte, ou bien encore d'un Lafayette et d’un Voyer d'Argenson, les ténors du parti des indépendants. Signalons que ce jour-là, il y avait grand monde dans cette longue galerie qui conduisait vers ce qui avait été la chambre royale du château de Maisons.
Soudain, l’ancien officier repéra sur sa droite un cercle de jeunes hommes élégants, les gestes un brin stupides qui enveloppait une déité brune, coiffée court à la Titus, en robe de soie bleue embellie de dentelles, qui menait la danse, joyeuse et engageante. Indiscret, Dumoulin avança de quelques pas, tendant le cou, avant de tressauter, car il venait de reconnaître la comtesse de Tantale, son ancienne maîtresse.
« Mordious ! Elle ! Elle ici ? Vivante ! » se parla-t-il, les yeux arrondis, et un frisson désagréable lui parcourut le dos.
Dans un réflexe, il fit un pas en arrière, cherchant à fuir, à se cacher derrière quelques larges épaules qui l’entouraient, à ne surtout pas se faire voir de cette « terrible » femme qu’il jugeait capable de tout, séduisante et dangereuse. Les tempes battantes, il eut alors l’idée de quitter la réception et galoper jusqu’à Paris, disparaître, pour se protéger d’un hypothétique face-à-face qui d’avance le terrifiait.
Ah ! Pourquoi n’ai-je pas imaginé qu’elle pourrait être ici ? songea-t-il dans un mélange de fureur et d’anxiété. Mordious ! Quel sot ! N’était-ce pas ici où nous nous étions rencontrés, ici où elle m’avait piégé en m’offrant sa croupe ? Ici où elle espionne son monde ?
En une fraction de seconde, Jean-Baptiste revit cette soirée où il avait sombré dans les bras de la terrifiante Messaline, l’agent de la duchesse de Berry, et les conséquences qui avaient suivi, la faillite de l’enlèvement du roi de Rome, la trahison de Camille, sa vieille gouvernante, et surtout l'invraisemblable scénario qui avait abîmé ses retrouvailles avec Marie, brisé leur vie nouvelle.
Je devrais la tuer, se dit-il en serrant le poing de rage, l’œil fixé sur l'arrière du crâne de son ex-maîtresse qu'il apercevait épisodiquement, mais il se relâcha, conscient que quelque chose en lui l’en empêcherait, quelque chose qu’il ne s’expliquait pas ou qu’il refusait de voir, comme un reste d’affection pour cette femme qu’il avait serrée dans ses bras, qu’il avait désirée.
« Pfft ! Capitaine, vous en faites une tête, dit Belle-Rose de retour, et il lui tendit en vain une coupe de champagne. C’est la présence de votre marquise qui vous fait cet effet-là ? ajouta-t-il avec un sourire affable.
- Tu l’as reconnue ? réagit Dumoulin, le regard sombre. Abruti ! jura-t-il. Tu savais…qu’elle était là ? Tu l’avais vue, et tu ne m’as pas prévenu ?
- Dès que je suis entré dans la pièce, mon capitaine, fit l'autre en hochant la tête avec un air idiot. Mais… C’est que… Que vous dire ? Tenere lupum auribus15 ! Enfin j’savais bien que vous alliez l’apercevoir à un moment de la soirée.
- Tu m’agaces avec tes foutus locutions de jésuite », susurra Jean-Baptiste avec un geste d’humeur, car il cherchait un défouloir.
Puis, sans prévenir, il abandonna son comparse et s’éloigna à l’opposé de la salle, vers une fenêtre, se glissant entre les invités, les yeux mi-clos, où il parut rassembler ses idées. Ah ! La Comtesse ici ! se répétait-il hagard. Comment faire ? Que faire ? L’affronter, ne plus attendre, ce serait la solution. Si je cherche à l’éviter toute la soirée, je vais devenir fou… Mordious ! Elle est toujours aussi belle… Je n’arrive même plus à la haïr, cette vipère. Ainsi elle a survécu à sa blessure.16 C’est bien, c’est mieux… Dire qu’elle m’a sauvé la mise avec son église des Petits-Pères. Où serais-je aujourd’hui ? En fuite, à l’étranger sûrement… Enfin il ne faut pas que j’oublie qu’elle a brisé le cœur et l’âme de Marie. Et ça, elle devra payer, elle devra me le payer. Vengeance ! Oui, vengeance ! Terrible vengeance !
Jean-Baptiste se figea, bouche bée. Depuis l’opposé de la vaste salle, deux yeux noirs l’observaient à travers la multitude, deux prunelles brillantes et emplies de passion. Instinctivement, avant la moindre pensée, le capitaine Dumoulin sourit en guise de réponse, presque fier, avant d’effectuer un semblant de révérence. Foutre ! Et re-foutre ! se reprenait-il aussitôt mi-effrayé, mi-furieux, un seul regard de cette garce, et voilà que je lui offre un visage avenant et conquis.
Et sa respiration devint vive, car, sans atermoiement, abandonnant sa cour de jeunes galants incrédules, la comtesse de Tantale traversait avec élégance la piste de danse pour rejoindre Jean-Baptiste, les joues d’un coup écarlates.
« Bonjour, mon amour, lui dit-elle, à peine auprès de lui, charmeuse, avec un œil toujours luisant qui cachait à peine un bonheur intérieur.
- Comtesse, fit l’officier avec un mouvement de tête, tandis que lucide, il sentait qu’il perdait déjà pied devant cette beauté presque parfaite.
- Mon Dieu ! J’attendais ce moment depuis ce matin, ajoutait-elle d’un timbre enjoué, presque chantant. Depuis que l’on m’a confirmé votre libération...
- Vous m’espionniez encore et toujours, répondit le capitaine Dumoulin avec un sourire sans joie, et, victime de leurs souvenirs communs, travaillé par une voix intérieure, il se dit en soliloque qu’il ne prisait pas la scène qu’il était en train de vivre, parce qu’il craignait le moindre avenir au côté de cette femme superbe, digne descendante d’une Marion de Lorme ou d’une Ninon de Lenclos.
- Je veille sur l’amour de ma vie, dit la Comtesse, lui offrant un regard empli de tendresse.
- Mordious ! Cessez ce jeu, je vous prie, madame, réagit l’homme avec un mouvement de recul. Oubliez-vous ce que nous avons vécu ? Ce que vous m’avez fait ?
- Taisez-vous et donnez-moi plutôt votre bras, cher Jean-Baptiste, chuchota-t-elle en s’emparant de sa main, après un geste moqueur. Et allons de ce pas remercier notre hôte, il a si galamment répondu à ma demande. Je crois qu’il est dans le salon Hercule.
- Votre demande ? interrogea l’officier, le front barré par une ride, tandis que le couple se faufilait à travers une foule d’invités de plus en plus nombreuse, toujours aussi gaie et bruyante.
- De vous avoir convié ce soir ici-même, mon amour, répondit la dame avec malice. Pour que je vous revois enfin…
- Ainsi c’est vous qui... ?
- Apprenez que l’on vous avait un peu oublié, grand bêta, ironisa-t-elle. Le tort ne vient que de vous même, ajouta-t-elle avec un signe réprobateur.
- Vous ! Pourquoi n’y ai-je pas pensé ? grommela-t-il, le regard perdu vers le plafond, se souvenant en aparté de sa surprise lorsqu’il avait reçu l'invitation du banquier Laffitte, le lendemain de sa libération de la Conciergerie. Je suis un niais, je suis un crétin, marmonna-t-il à mi-voix, cherchant un qualificatif précis à son encontre.
- Un romantique, mon amour, dit la comtesse de Tantale avec affection.
- Cessez, je vous prie, de me parler comme vous le faites, réagit-il, un brin agressif. Nous ne sommes plus rien l’un pour l'autre, nous...
- Croyez-vous que les choses soient si simples, monsieur ? coupa la jeune femme soudain effrayante de noirceur, s’écartant quelque peu de son compagnon. Non, lui précisa-t-elle lentement, appuyant sur chaque syllabe, je vous ai offert mes faveurs. Votre vie en a été à jamais changée. Ne l’oubliez jamais ! Jamais !
- Vous m’effrayez une nouvelle fois, avoua l’homme qui sentait s’accélérer le battement de son pouls, et il essaya de se libérer de son ancienne amante, mais la main de celle-ci se serra un peu plus fort sur son avant-bras, l’emprisonnant.
- Vous pensez toujours à l’autre, n'est-ce pas ? lui demanda-t-elle sèchement.
- L’autre ? fit-il, le regard mauvais. Elle a un nom ! Marie. Bien sûr, madame ! Elle est mon...
- Chut ! Pas un mot de plus, cher amour, coupa la dame d’un ton étrange, tendant ses fines narines, geste infime, mais qui l’embellit d’avantage. Ne ternissez pas nos retrouvailles, je vous en prie, dit-elle d’une voix tremblotante, malgré elle. J’en étais si heureuse…
- Je ne peux vous refuser ce service, madame, chuchota l'homme presque attendri, convaincu dorénavant qu’une nouvelle querelle entre eux deux serait superflue. Et je vous dois ma liberté d'aujourd'hui, dit-il reconnaissant, songeant au stratagème de l’église des Petits-Pères qui avait évité que l’on soupçonnât sa participation à l’insurrection du général Berton.17
- Savez-vous, continuait-t-elle en l’entraînant à gauche, vers un salon ouvert, que j’étais excitée comme pour un premier rendez-vous à l’idée de vous revoir aujourd’hui ? Mon Dieu ! Que m’avez-vous fait ? ajouta-t-elle, lui jetant un regard passionné.
- Vous ne m’étonnez guère, madame, répondit insolemment Jean-Baptiste avec un léger sourire. Cette beauté m’aime toujours à la folie, pensa-t-il, impudent et fier.
- N’êtes-vous donc pas heureux de me revoir ?
- J'avoue que je suis satisfait de vous savoir en vie, après cette vilaine blessure.
- Enfin vous m’avouez que vous vous êtes inquiété.
- Bien sûr...
- Ainsi donc vous m’aimez, souffla-t-elle en secouant la tête d’un air de béatitude.
- Cessez ceci, madame ! réagit-il, simulant l'agacement.
- Vous souvenez vous de notre première rencontre ? continuait la Comtesse, le regard droit, perdue dans ses souvenirs.
- Comment voulez-vous que je puisse oublier ce jour-là, cette nuit...
- Cela a été un merveilleux moment, persista la jeune femme. Là-haut, dit-elle avec un geste du menton. Notre chambre… Elle doit être inoccupée. Croyez-vous que nous pourrions ?
- Nous pourrions ? fit Jean-Baptiste avec surprise. Quoi ? Vous seriez prête à... Non ? Je ne puis vous croire ! Après tout ce qui s'est passé entre nous ! Après tant d’animosité, de lutte...
- Nous pourrions juste y jeter un coup d'œil, dit-elle, le ton cassant. Un simple pèlerinage. Mais à quoi avez-vous pensé ? ajouta-t-elle, jouant l’étonnement. À m’honorer peut-être ? Oh ! Oh ! Oh ! Pour cela mon ami, il vous faudra de la patience et beaucoup de talent, trop peut-être ! Monsieur, je vous dois des rivières de larmes.
- Je ne vous crois pas.
- Vous ai-je jamais menti ?
- Vous m’avez trahi.
- Vous, vous m’avez trahie ! accusa la dame avec violence. Vous m’avez conquise, mentie, puis trompée. Je vous aimais. Vous m’avez humiliée ! Vous m’avez caché, puis imposé une rivale.
- Votre vengeance, madame, dit l’officier en serrant les dents, a été d'une bassesse…
- Je vous aimais, je vous aime, alors pour vous garder rien qu'à moi, j’ai dû la vaincre. C’est l’histoire de la vie, mon cher. Vaincs, si tu ne veux pas être vaincu.
- Triste personne !
- Vous, vous êtes une triste personne, mon amour ! Si vous aimiez tant cette madame de Monlivo, pourquoi vous êtes-vous glissé entre mes cuisses ? Et pas qu’une fois, je vous le rappelle. Est-ce donc cela aimer pour vous ? Répondez-moi, je vous prie, gentil petit étalon !
- Mordious ! Vous êtes abominable, jura Jean-Baptiste en faisant un grand effort pour parler avec calme.
- La vérité vous blesse, n'est-ce pas ?
- Bien sûr, madame.
- Vous avouez ? Je confesse que j’en suis surprise, sourit la dame. Ainsi votre conscience vous torture ?
- Clôturons ce sujet, je vous en conjure, nous en avons que trop parlé, annonça le capitaine Dumoulin, moitié lassé, moitié fâché. Profitons plutôt de cette réception pour nous amuser. Notre débat n’apportera plus rien, ne croyez-vous pas ?
- Bien sûr, et que souhaitez-vous, mon grand et tendre amour ?
- C’est-à-dire ?
- Que je reste avec vous ou que je retourne vers mon sérail de jeunes galants qui là-bas piaffe d’impatience ?
- Vous êtes trop belle pour ces pauvres damoiseaux. Je vous prie – que dis-je ? – je vous implore de rester avec moi.
- Vous m’aimez, monsieur ! s’écria la Comtesse, l’air triomphant. J’en suis certaine maintenant, d’ailleurs en ai-je un jour douté ?
- Non, madame, je ne vous aime point. Et vous ne le savez que trop bien.
- Si, monsieur, vous m'aimez, vous verrez, bientôt vous me supplierez, vous ramperez devant moi, malade et malheureux, mais je vous l'ai dit, il vous faudra beaucoup de talent, trop sans doute pour me reconquérir.
- Vous me distrayez, fit l’homme avec un mouvement d’épaules.
- J'embellis votre vie précaire de Bonapartiste, renchérit-elle pince sans rire.
- Bien sûr, pauvre petite espionne royaliste, rétorqua Jean-Baptiste persifleur. Allez, ajouta-t-il en l’entraînant affectueusement, rejoignons notre bon ami Laffitte pour le remercier d'avoir provoqué nos retrouvailles. Je l’aperçois là-bas, au milieu de ce groupe d’invités… »
8 Depuis l’Empire, les militaires appelaient les civils des « Pékins ».
9 Jacques Laffitte (1767-1844) ; banquier et homme politique ; il est né à Bayonne dans les Pyrénées atlantique, il était issu d’une famille modeste et nombreuse (10 enfants). Son père, Pierre Laffitte était maître charpentier. Après de courtes études, le jeune Jacques Laffitte entra chez le banquier Jean Frédéric Pérégaux (1788) qui lui manifesta très vite une grande confiance (à ses côtés, Laffitte faisait preuve de remarquables qualités et manifestait de réelles aptitudes pour le métier de la banque ; il connut, grâce à cela, une ascension rapide.) En 1809, il devint Régent de la Banque de France prenant la place du sieur Pérégaux après le décès de celui-ci. Le 6 avril 1814, il était nommé Gouverneur de la Banque de France. En 1816, il fut élu député de la Seine. En 1820, sa fortune était évaluée à vingt-cinq millions de francs.
10 La fortune favorise les audacieux.
11 Le maréchal Lannes dont la bravoure était reconnue de tous était « l’Achille de la Grande Armée » ou encore le « Rolland de l’Armée d’Italie » (mort à la bataille d’Essling, le 23 mai 1809).
12 Ceux qui viennent tard à table ne trouvent plus que des os.
13 Affaire des Petits Pères : pendant le carême de 1822, des missionnaires jugèrent bon d’accompagner leurs prédications, à l’église des Petits Pères, de cantiques chantés sur des airs d’opéra comique. Tout Paris accourut à ces sermons originaux. Et, le 27 février, il s’ensuivit une bagarre où les cris de « à bas les missions, à bas les missionnaires » ne purent être couverts que par la charge de cavalerie qui dissipa les attroupements. Le capitaine Dumoulin fut naturellement au nombre des braillards… « Deux artisans du retour de l’île d’Elbe, le chirurgien Emery et le gantier Dumoulin » d’Albert Espitalier (page 48).
14 « Le Charbonnier – Deuxième partie – Le général Berton » de Frédéric Preney-Declercq.
15 Tenere lupum auribus ; tenir le loup par les oreilles, expression qui signifie « se trouver dans l’embarras ».
16 « Le Charbonnier – Deuxième partie – Le général Berton » de Frédéric Preney-Declercq.
17 « Le Charbonnier – Deuxième partie – Le général Berton » de Frédéric Preney-Declercq
Chapitre 3
Château de Maisons, quelques minutes plus tard
« Ah que oui, si je me souviens de cet entretien ! s’écriait le banquier Jacques Laffitte avec un geste théâtral, homme d’une cinquantaine d'années, cheveux châtains grisonnant, vêtu d'un habit gris, gilet de velours rouge et pantalon noir à sous-pieds. Comment pourrait-on d'ailleurs oublier une conversation avec l’Empereur, avec ce grand personnage qui nous a tant marqués.
- S'il vous plaît, racontez-nous, demanda avec excitation une dame au milieu d'un cercle de convives, autour du maître des lieux. Que vous a-t-il dit ? Dites-nous, je vous en prie…
- Oui, racontez-nous, renchérissait la comtesse de Tantale au bras de Jean-Baptiste.
- Vos désirs sont des ordres, mesdames, dit le sieur Laffitte avec une légère révérence. Voilà ! Je m'étais rendu à Malmaison, huit jours après Waterloo, glorieuse, mais triste bataille, à huit heures du soir par invitation du grand maréchal du Palais. Je me souviens que la pompe impériale existait encore à l’extérieur ; alors que tout, au-dedans, annonçait le trouble, la douleur, l'abattement. Après avoir annoncé à monsieur de Montholon, chambellan de service, que j'étais mandé par l’Empereur, les deux battants de la porte de sa bibliothèque se sont ouverts, et Napoléon, calme et tranquille, sans la moindre altération sur sa belle figure m’est apparu et m'a dit en souriant : Monsieur Laffitte, comment ça va-t-il ? Et après quelques secondes, l'air toujours serein, il a ajouté : pouvez-vous me procurer un vaisseau pour me sauver en Amérique ? À ces mots, je vous l'avoue, mesdames, un froid mortel m'a traversé le corps et je fus longtemps sans pouvoir lui répondre. Le vainqueur d'Iéna, d'Austerlitz, de Marengo, celui chez qui tous les souverains faisaient naguère antichambre, le maître du monde presque entier, voir ce colosse par terre, chercher à se sauver sur un vaisseau et fuir en Amérique ! Oui, Sire, je vous le procurerai, dût-il m'en coûter la vie ! lui ai-je enfin annoncé, me reprenant. Napoléon s'est approché de son secrétaire, en a retiré un paquet de billets de banque, et m’a dit : Tenez, voici huit cent mille francs, je vous enverrai cette nuit dans un fourgon trois millions en or. Monsieur de Lavalette et le prince Eugène vous feront remettre douze cent mille francs ; je fais remettre de plus dans votre calèche mon médailler, c'est tout ce qui me reste. Vous me garderez ça. Je me suis approché à mon tour de son bureau, je me suis assis sur son fauteuil, j’ai pris du papier et j'allais écrire, lorsque, me retenant le bras, l’Empereur m’a dit : Qu'allez-vous faire ? Vous donner une reconnaissance, lui ai-je répondu.
« - Je n'en ai pas besoin.
« - Je puis mourir, ai-je insisté avec effroi, je dois garder le secret ; cette somme n'étant pas écrite sur mes livres, il vous faut un titre.
« - Et si je suis arrêté en route ? Je puis vous compromettre.
« - Quand je rends service, je ne calcule pas le danger.
« - N'importe ! Je dois le calculer pour vous, je n'en veux pas.
Une somme aussi considérable, confiée sans titre ! J’étais bouleversé, je vous l’avoue ! Les débris de sa fortune, le pain de son exil ! Ah ! Je n'ai jamais reçu de témoignage de confiance aussi glorieux, ni qui m'ait autant touché. Il a ajouté : Vous n'avez jamais été chaud partisan de mon système de gouvernement, monsieur Laffitte ; mais, je vous connais, vous êtes un galant homme.
« - L'indépendance nationale, d'abord, Sire, lui ai-je répondis ; mais la liberté ensuite, le pays ne rétrograde pas.
« - Bah ! Bah ! a fait l'Empereur, acceptant le débat. Votre gouvernement représentatif, manie anglaise que tout cela ; il faut pour gouverner la France, des mains de fer et des gants de velours