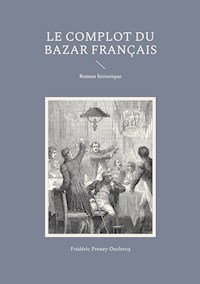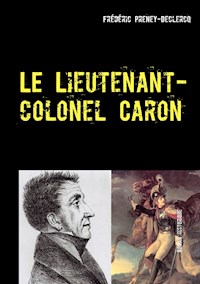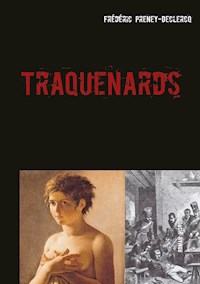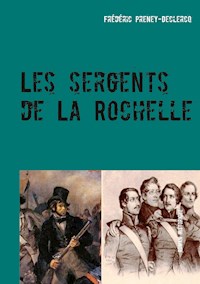
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Les enquêtes de l'inspecteur Eugène Chenard et les aventures du capitaine Jean-Baptiste Dumoulin, ex-officier d'ordonnance de Bonaparte.
- Sprache: Französisch
La guerre larvée que se livrent depuis des mois le gouvernement des Bourbons et la Charbonnerie semble parvenir à son terme. Comme lors de la Terreur blanche de 1815, les sentences de mort se succèdent et poussent les chefs de la société secrète dans leurs derniers retranchements. Choisi par la Haute-Vente, Jean-Baptiste Dumoulin, ex-officier d'ordonnance de Bonaparte, tente de secourir les quatre sergents appréhendés à La Rochelle et condamnés à être guillotinés, place de Grève. Son amante, Marie de Monlivo, restée à Colmar après l'arrestation du lieutenant-colonel Caron, consacre tous ses moyens et toute son énergie à la survie de la famille du rebelle, en espérant le retour de son bien-aimé. Libérés de l'enquête des crimes signés d'une baguette de tambour, l'inspecteur de police Eugène Chenard et son équipe traquent sans répit les conspirateurs et factieux qui ne rêvent que d'un retour à la Révolution et à l'Empire. Le rebondissement de nombreuses situations, le rythme soutenu, la présence permanente de l'Histoire, font de ce roman un grand livre d'aventure et de suspens. Frédéric Preney-Declercq conclut ici merveilleusement sa trilogie commencée avec "Le lieutenant-colonel Caron" et "Traquenards". Un roman historique solide, fort documenté et agréablement écrit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 921
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur
Le Complot du Bazar français
Première partie – Juin 1820
(Les Éditions du Net – ISBN : 978 2 312 06568 7)
Le Complot du Bazar français
Deuxième partie – Août 1820
(Les Éditions du Net – ISBN : 978 2 312 06586 1)
Le Charbonnier
Première partie – Le roi de Rome
(Les Éditions du Net – ISBN : 978 2 312 06569 4)
Le Charbonnier
Deuxième partie – Le général Berton
(Les Éditions du Net – ISBN : 978 2 312 06596 0)
Le lieutenant-colonel Caron
Colmar – 1822
(Books on Demand – ISBN : 978 2 322 03799 5)
Traquenards
Paris et Colmar – 1822
(Books on Demand – ISBN : 978 2 322 03486 4)
À Morgan qui supporte depuis des années mes rêveries et
mes innombrables séances d’écriture.
À mes enfants, mes rayons de soleil.
Merci à vous quatre pour votre patience et vos encouragements.
À Véronique Nicolaï pour sa précieuse lecture correctrice
et sa grande connaissance orthographique.
Quel talent !
Reconnaissance et amitié.
À Maud, lectrice des premières heures et amie fidèle. Merci pour ton travail et tes
encouragements. Affection sincère.
À Erwan Le Pape, mon beau-frère,
qui s’est mué en correcteur œuvrant même en Arizona,
sur la Route 66, un manuscrit dans son sac
Profonde amitié.
Un grand merci aussi à Dominique Sollin
sans qui les chapitres situés au milieu de la forêt de Compiègne n’existeraient pas
Sans oublier mes deux lectrices adorées Céline et Sophie
et leur implacable crayon rouge.
Gratitude et attachement.
Je n’oublie pas bien sûr les lecteurs de mes premiers livres
qui m’ont régulièrement encouragé et
qui ont aussi manifesté leur impatience
à lire la suite des aventures de Marie, la courtisane,
de Jean-Baptiste Dumoulin, le Bonapartiste
ou de l’inspecteur de police Eugène Chenard.
Si ce livre possède quelques qualités, cela leur revient.
Sans eux, le résultat serait bien moins bon.
À tous grand merci.
Personnages du roman
Les officiers français au passé impérial :
Belle-Rose : âgé d’environ 35 ans, ancien lieutenant des
Marie-Louise
de 1814, dont il porte toujours la célèbre capote grise. Il devenu l’homme à tout faire du capitaine Jean-Baptiste Dumoulin.
Barbier-Dufay : âgé de 52 ans, colonel mis à la retraite par ordonnance du 10 juillet 1816. Farouche bonapartiste, il n’hésita pas sous la Restauration à se battre en duel à plusieurs reprises contre des royalistes. C’est ainsi qu’en 1817, il tua en duel Saint-Morys et qu’en 1820, il blessa gravement le général de Montélégier.
Caron Augustin-Joseph : âgé de 48 ans, lieutenant-colonel de dragon en retraite. Officier de la légion d'honneur, il a été compromis dans la conspiration du 19 août 1820, dite du Bazar français. Acquitté, mais mis en réforme sans traitement, il s’est retiré à Colmar.
Dentzel Jean-Chrétien Louis : âgé de 36 ans, lieutenant-colonel de cavalerie en non-activité. Acquitté par la cour des Pairs, suite à la conspiration du Bazar français, mais depuis sévèrement surveillé par l’administration policière, il éprouve une antipathie réciproque envers le capitaine Jean-Baptiste Dumoulin, pourtant frère d’armes et allié politique.
Démoncourt Général Paul : 51 ans, est un général français de la Révolution et de l’Empire. Au retour de l'île d'Elbe, il a soutenu avec succès le second blocus de Neuf-Brisach. Le nouveau pouvoir le mit à la retraite le 26 septembre 1821. Il s’est retiré près de Colmar. Ami du lieutenant-colonel Caron.
Dumoulin Jean-Baptiste : 36 ans en 1822, officier d’ordonnance de Napoléon, rentier, demeurant à Paris. Fils d’un riche gantier de Grenoble, il s’est désintéressé en 1814 de l’entreprise familiale pour devenir un agent actif du retour de Napoléon exilé à l’île d’Elbe. Le 5 mars 1815, il organisa la chute de Grenoble. Napoléon en fit son officier d’ordonnance. Promu capitaine, Dumoulin fut blessé à Waterloo et capturé par les Anglais.
Dublar César-Brutus : âge inconnu, sous-lieutenant démissionnaire et employé au Bazar français du colonel Sauset. Emprisonné pour sa participation au complot de Belfort, auprès du colonel Pailhès, dont il s’était constitué aide de camp.
Fabvier Charles-Nicolas : baron impérial, âgé de 38 ans, négociant patenté et colonel en non-activité, demeurant à Paris, il est le type même du héros de la seconde génération des armées napoléoniennes et est devenu l’une des figures en vue du parti libéral, ami du général Lafayette.
Léon Charles : âgé de 16 ans, fils bâtard de l’Empereur. Il fut le fruit d’une amourette sans importance de Napoléon avec Éléonore Denuelle, lectrice de Caroline Bonaparte. Napoléon montra de l’attachement pour ce fils aîné. L’un des articles du Testament impérial ajouta une somme de trois-cent mille francs au capital déjà placé au nom du jeune Léon.
Pailhès Antoine : 43 ans. Baron impérial et colonel, mis en non-activité à la chute de Napoléon. Accusé d’être coupable de non révélation de la conspiration de Belfort et enfermé dans la prison de Colmar. Ami du lieutenant-colonel Caron.
Roger Frédéric-Dieudonné : environ 40 ans, lieutenant à la retraite, ancien officier de corps francs et écuyer tenant un manège à Colmar.
Sauset Louis-Antoine : baron impérial, 49 ans, colonel de la garde impérial et administrateur du Bazar français – une galerie marchande couverte par une verrière (une innovation pour l’époque) –, rue Cadet, n°11. Impliqué dans la conspiration du 19 août 1820, il a été acquitté par la Cour des pairs.
Les héroïnes du roman :
Augustine (
La Renarde
) : 18 ans. Au service de Marie de Monlivo qui l’a arrachée de sa vie dissolue à Saumur.
Helena Caron : 27 ans, originaire de Prusse et femme du lieutenantcolonel Caron, vivant à Colmar.
Louise : fillette d’environ 8 ans, orpheline de Paris recueillie par l’inspecteur Eugène Chenard.
Marie de Monlivo : âgée d’une vingtaine d’année, veuve du général de Monlivo mort dans un incendie à Saumur dont elle a hérité la fortune. Ancienne courtisane et ancienne maîtresse du capitaine Dumoulin qu’elle a rencontré en 1820 et dont elle a eu un enfant, Louisette, après leur séparation.
La baronne Pailhès : mariée au colonel du même nom. Investie dans la cause de son époux, elle tente de trouver des alliés pour qu’il retrouve la liberté. C’est elle qui entraîne le lieutenant-colonel Caron dans la conspiration de Colmar.
Comtesse de Tantale : âgée d’une trentaine d’années ; agent de la duchesse de Berry et maîtresse du capitaine Dumoulin qu’elle espionne à son insu.
Les membres de la police royale :
Eugène Chenard : âgé d’environ 30 ans, inspecteur de police à la préfecture de police de Paris, rue de Jérusalem.
Achille Fleischmann : Âgé d’une vingtaine d’années. Mulâtre originaire de Guadeloupe. Employé particulier du colonel à la retraite Ferier, puis, après l’assassinat de ce dernier, secrétaire de police à la préfecture de police, rue de Jérusalem, auprès de l’inspecteur Chenard.
Graville, Pierre Brinon et
La Fouine
: auxiliaires de police auprès de l’inspecteur Eugène Chenard.
Alexandre Gauthier de Laverderie : 29 ans, officier de la garde royale entraîné dans le complot du Bazar français et condamné à cinq ans d’emprisonnement. En décembre 1822, il s’est évadé de la prison de Sainte-Pélagie. En fuite. Il devient l’homme de main de la Comtesse de Tantale.
Thomas Rivière : la quarantaine environ, archiviste de la préfecture de police.
Vidocq : âgé de 47 ans en 1822, ancien bagnard devenu chef de la Sureté.
Les personnages politiques :
Le poète Béranger (Pierre-Jean de Béranger) : 42 ans, chansonnier prolifique qui remporta un énorme succès à son époque.
La duchesse de Berry : 24 ans. Veuve et mère du duc de Bordeaux, l’héritier de la couronne. L’homme de la famille royale, a-t-on écrit à l’époque. Par son intelligence et sa finesse, elle égaya la cour de la Restauration.
Benjamin Constant : 55 ans, écrivain et homme politique, député libéral.
Maréchal Louis Davout : 52 ans, chef des armées invaincu sous l’Empire. Bien que disgracié au moment de la Seconde Restauration, il put entrer à la Chambre des pairs en 1819, grâce à ses prises de position non ambiguës en faveur des Bourbons.
Le général Georges Lafayette : 65 ans, général et député de la Sarthe, l’ancien marquis Gilbert du Motier de La Fayette, le « Héros des deux mondes », « l’homme de 1789 », l’inusable politicien, perpétuel étendard des mouvements antiroyalistes sous la Restauration.
Georges-Washington Lafayette : 43 ans, fils du général Lafayette, militaire et homme politique français.
Jacques Laffitte : 55 ans, banquier et homme politique. Député de Paris.
Louis XVIII : 67 ans, Roi de France depuis la fin de l’Empire et son retour d’exil, frère puîné de Louis XVI.
Jacques Manuel : 47 ans, avocat et homme politique libéral français. Grand orateur, ses opinions lui valurent beaucoup d'ennemis parmi les députés ultras.
Talleyrand (Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord) : 68 ans ; le
Diable boiteux
. Pendant une cinquantaine d’années, l’ancien évêque et ministre impérial fut l’un des principaux personnages de la vie politique française.
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Chapitre 25
Chapitre 26
Chapitre 27
Chapitre 28
Chapitre 29
Chapitre 30
Chapitre 31
Chapitre 32
Chapitre 33
Chapitre 34
Chapitre 35
Chapitre 36
Chapitre 37
Chapitre 38
Chapitre 39
Chapitre 40
Chapitre 41
Chapitre 42
Chapitre 43
Chapitre 45
Chapitre 46
Chapitre 47
Chapitre 48
Chapitre 49
Chapitre 50
Chapitre 51
Chapitre 52
Chapitre 53
Chapitre 54
Chapitre 55
Chapitre 56
Chapitre 57
Chapitre 58
Chapitre 59
Chapitre 60
Chapitre 61
Chapitre 62
Chapitre 63
Chapitre 64
Chapitre 65
Chapitre 66
Chapitre 67
Chapitre 68
Chapitre 69
Chapitre 70
Chapitre 71
Chapitre 72
Chapitre 73
Chapitre 74
Chapitre 75
Chapitre 76
Chapitre 77
Chapitre 78
Chapitre 79
Chapitre 80
Chapitre 81
Chapitre 82
Chapitre 83
Chapitre 84
Chapitre 85
Chapitre 86
Chapitre 87
Épilogue
Chapitre 1
Colmar, prison d’Helena Caron
« Que se passe-t-il, monsieur ? Reviendriez-vous sur notre accord ? demanda avec rudesse madame de Monlivo après avoir été conduite dans un vaste bureau au mobilier défraîchi dont le propriétaire – le directeur de prison – l’attendait, assis dans un fauteuil en velours rouge et usé. Prenez garde ! souffla-t-elle, le tout accompagné d’une œillade sombre, après avoir gonflé sa poitrine afin de paraître plus menaçante.
- Ravi de vous recevoir dans mon humble lieu de travail, chère madame, répondit l’homme en se levant, jovial, avant de chasser d’un geste de la main le sous-officier de garde qui avait conduit la visiteuse jusqu’à lui suivant ses instructions. N’ayez crainte, poursuivait-il avec un sourire sans éclat, il ne s’agit que d’une rencontre de courtoisie. N’avez-vous pas visité la dénommée Helena Caron à chaque fois que vous l’aviez souhaité sans rencontrer la moindre difficulté ?
- Si en effet ; et nous vous en remercions.
- Nous ou vous ?
- Nous, ricana Marie avec un mouvement vif de la main, car je n’ose croire, monsieur, que vous ayez oublié qui je représente.
- Bien sûr, madame, la terrifiante et mystérieuse Charbonnerie !
- Je trouve votre ton bien sarcastique, réagit madame de Monlivo avec hauteur. Prenez garde à vous ! Même si rien ne me force à vous confier cette nouvelle, attendez-vous à de terribles agitations dans le royaume avec les conséquences que vous pouvez imaginer. Malheur à celui qui n’aurait pas bien placé ses pions.
- L’hydre puissante, continuait l’homme âgé de la quarantaine, la figure agréable avec des cheveux grisonnants et une longue barbe à deux pointes, tandis qu’il effectuait quelques pas autour de la dame en affichant un air étrange. Qu’une tête soit coupée, et aussitôt une autre repoussera ! Est-ce cela que vous m’avez dit le jour où votre grossier homme de main m’a insolemment blessé le visage.
- Un simple coup sur votre nez, monsieur, et vous n’en portez ce jour aucune trace, railla Marie en essayant de se montrer hautaine, alors qu’une inquiétude commençait à lui glacer le sang, car elle devinait qu’un piège ou quelque chose de ce genre se mettait en place. Je l’ai vu moins bienveillant, méfiez-vous de la prochaine fois. Il pourrait être plus véloce, pour ne pas dire cruel.
- Parti !
- Pardon ?
- Si, si ! Parti. Ce vilain balafré a quitté Colmar depuis deux jours. Je suis informé : vous êtes seule, madame ! Avec une employée et deux enfants.
- Il n’en est rien, monsieur !
- Croyez-vous également que j’ignore où vous êtes hébergée ? L’hôtellerie « Des Six Montagnes Noires » et parfois rue de l’Imprimerie, dans la maison des Caron ! Vous rechercher a été un jeu d’enfant.
- Je ne me cache pas, monsieur ! dit-elle d’un ton sec. Seules les personnes en danger se cachent ! À quoi songez-vous ?
- À votre rôle, plutôt à cette terrifiante Charbonnerie qui vous envoie visiter cette Helena Caron, femme d’un conjuré à l’action grotesque. J’essaie de comprendre. Confitures, pots de miel, savons, linges propres, couvertures, papiers à lettre, pâtisseries et j’en passe, voilà tout ce que vous avez apporté à la détenue.
- Nous veillons au bien-être de nos membres emprisonnés.
- Vous veillez au bien-être de votre amie ou parente ! N’est-ce pas plutôt simplement cela, madame ?
- Vous pensez trop, monsieur. Prenez garde à vous ! Je vous aurai prévenu. Vous ne serez plus en sécurité nulle part !
- Je ne vous crois plus. J’avoue dans un premier temps avoir été impressionné par votre petite mise en scène – je me suis cru réellement menacé ! – mais à présent je ne vous crois plus. Votre ruse a été bien pensée. Nonobstant qu’importe tout cela. Je ne songe pas à rompre notre accord et vous pourrez, malgré le souhait contraire et ferme de monsieur le Préfet, continuer à adoucir la captivité de la dame Caron ; mais, ajouta-t-il en montant le ton de sa voix, n’aurais-je pas le droit de solliciter un dédommagement ? J’ai pris et je prends de grands risques à vous autoriser à entrer dans la prison. Imaginez si le préfet avait vent de mon laxisme ! Je pourrais dire adieu à ma carrière, pire je pourrais moi-même connaître les affres d’un emprisonnement.
- Que voulez-vous ? coupa Marie avec violence. Une somme d’argent ? Combien ?
- Non, madame, pas d’argent, je ne suis pas un voleur…
- Parlez ! Je vous écoute.
- De ma fenêtre, je vous ai observée chaque fois que vous êtes venue, gentille madame ; vous êtes élégante, gracieuse. Vos toilettes sont d’un goût exquis et variées. Si j’osais, je vous dirais que votre cicatrice sur votre jolie figure vous rend plus envoûtante, plus mystérieuse. Je vous l’avoue : vous êtes fort attirante ! Je ne suis pas insensible à vos charmes.
- Dieu du ciel ! Quel est donc ce langage, monsieur ? Je vous sens venir ! Prenez garde !
- Souhaitez-vous toujours visiter ma prisonnière ?
- Un chantage ? Est-ce cela que je dois comprendre ?
- Appelez cela comme vous le voulez, je vous demande juste une simple compensation des passe-droits que je vous accorde !
- Jamais ! À qui croyez-vous vous adresser ? À une soubrette sans défense – pire ! – à une putain d’une ruelle sombre de votre quartier ?
- Vous avez le choix, belle dame, ricana l’individu avec un mouvement de tête qui se voulait élégant, je n’ai jamais forcé personne, mais ne venez plus ensuite me supplier la moindre autorisation pour vous occuper de la dénommée Caron. Une fort jolie prisonnière d’ailleurs, certes plus âgée que vous, mais...
- Mais quoi, monsieur ? s’écria Marie en se retenant de malmener l’insolent, les poings serrés et l’œil empli de haine.
- Ce regard bleu-noir vous va à ravir, madame, sourit-il avec un gracieux hochement de tête. Vous vous refusez à moi, reprit-il en se caressant sa barbe, après un silence, vous en avez le droit, mais imaginez dans quel état vous me laissez ? Or, on ne peut rien contre la nature, vous ne pouvez l’ignorer. Votre parente devra se montrer plus docile. Aura-t-elle le choix d’ailleurs, seule entre quatre murs et moi, douloureusement en mal d’amour, tel le cerf en rut qui malgré lui éventre la biche qui lui résiste.
- Misérable personnage ! Vous me donnez la nausée !
- Une fois, madame ; une juste compensation qui pourrait être un instant agréable pour nous deux.
- (…)
- Vous ne dites plus rien ?
- (…)
- Madame, un simple moment de plaisir en récompense de ma complicité.
- Vous ne me laissez que peu de choix, susurra enfin la jeune femme qui avait réfléchi, le regard fixe, sachant, comprenant avec effroi que son refus risquait de les plonger dans une situation très difficile, particulièrement Helena, dont l’emprisonnement ne semblait préoccuper que peu de gens, tandis qu’elle-même, à Colmar, ne pouvait compter que sur ses propres forces sans allié aucun, forces limitées par conséquent.
- Vous voyez donc, dit l’homme d’un air jubilatoire, que vous avez tout intérêt à vous laisser faire, pour le bien-être de tout le monde. Avouez que je ne suis pas repoussant ? L’on me dit élégant. »
Marie ne répondit pas et lorsqu’il se rapprocha d’elle, la mine victorieuse, elle ne bougea pas, se sachant vaincue. Sans hâte, avec une tranquillité insolente, il lui releva sa longue jupe et son jupon de soie, et elle sentit ses mains longues et tièdes lui caresser complaisamment les reins.
« Hum ! Charmante, madame, vous êtes charmante, fit-il à mi-voix. Un régal sans pareil. Ah ! J’en rêvais depuis des jours ! À ma grande surprise, je crois bien que je suis épris de vous. »
Les lèvres pincées, Marie était hors d’elle d’humiliation, de rage, mais aussi de peur, car elle se savait sans défense. De quoi pouvait être capable l’odieux personnage en cas de refus ? Ne paraissait-il pas dangereusement décidé ? Jamais elle n’aurait dû croire en une terreur durable de sa part ! Jamais elle n’aurait dû accepter d’être conduite à son bureau, alors que son instinct lui avait dicté le contraire. Mon Dieu ! Sur ce coup-là, elle avait été stupide de se jeter dans un tel traquenard, puéril et grossier ! Elle eut l’envie forte de se gifler, tandis que ses mains tremblaient de colère. Et maintenant, pouvait-elle croire qu’avec une simple partie de jambes en l’air, elle réussirait à satisfaire ce chien en rut ?
Dans son esprit affolé, cherchant une réponse, des pensées disparates et désagréables tourbillonnèrent : la situation misérable d’Helena Caron et son besoin d’aide dont elle sentait qu’elle pourrait difficilement se passer, comme un besoin vital, l’absence de Jean-Baptiste et son manque insultant de nouvelles alors qu’elle avait tant besoin de lui, de sa présence virile et rassurante, de sa force – l’avait-elle définitivement perdu ? –, Louisette, sa fille, sa principale raison de vivre qui ne pourrait survivre sans une mère libre et solide à ses côtés. Une évidence se dessina graduellement dans sa conscience, elle n’avait pas le choix, elle devait céder. Ses yeux gris-bleu fixèrent quelques secondes le regard luisant de son agresseur qui lui caressait toujours le bas du dos. Et n’avait-elle pas été courtisane, avant d’être la respectable madame de Monlivo ? N’en avait-elle pas vu d’autres ? N’avait-elle pas vécu des situations plus inconfortables et avec des êtres moins délicats que celui-ci.
Néanmoins ce contact la révulsait. En un ultime réflexe, elle se tordit, essayant d’échapper à l’étreinte. Mais sûr de sa victoire et de sa position dominante, le directeur de prison défit d’un geste vif la boucle de sa ceinture afin d’ouvrir son pantalon et pressa la dame avec fermeté, jusqu’à l’allonger sur son bureau. Marie voulut crier mais aucun son ne sortit de sa gorge. Paralysée par les idées angoissantes sur l’avenir de ses proches, par la peur surtout de condamner à l’humiliation sa chère Helena, elle céda et se laissa prendre sans plus de résistance. Tout en la pénétrant, comme s’il avait atteint son Graal, l’homme gémit de satisfaction, avant d’accomplir le roulement de reins le plus vieux du monde. Réalisant à peine ce qui lui arrivait, il sembla à Marie qu’elle retrouvait ses habitudes oubliées d’hétaïre parisienne et, lasse, elle s’abandonna aux bras masculins qui la broyaient, se demandant juste quand la hideuse contrainte allait prendre fin. Dans un réflexe, elle se concentra et rêva à Louisette, le soleil de sa vie. Soudain le directeur de prison ouvrit grand la bouche et laissa échapper une longue clameur de plaisir.
À peine se furent-ils séparés que Marie se sentit envahie d’abord d’une honte affreuse, suivie d’une rage terrible. Elle pensa à Jean-Baptiste et ressentit presque de la colère contre son amant, comme si elle cherchait un responsable à sa sordide mésaventure. Après s’être relevée et avoir réajusté ses habits, elle se retint de ne pas plonger son visage dans ses mains. Silencieux, encore haletant, presque sans un regard, le directeur de prison remettait son pantalon.
« Je vais maintenant vous conduire à la cellule de votre amie, dit-il brusquement ; mais surtout silence, les gardes doivent être là ! »
Comme Marie ne bougeait pas, il lui prit le bras et la poussa vers la porte. Elle se dégagea, mais le suivit sans un mot. L’outrage subi continuait à la brûler comme un fer rouge. Elle regarda la nuque et le dos de son agresseur qui marchait devant elle et espéra de toute son âme qu’un jour la vie lui offrirait l’opportunité de se venger.
-
« Ma chère amie, te voilà enfin ! s’écria Helena Caron avec son joli accent prussien, prenant avec affection les mains de sa visiteuse, après que la porte de sa cellule se fut refermée d’un bruit sec. Mein Gott ! J’étais inquiète, je ne comprenais rien. Le garde m’avait apporté ton panier, mais ensuite pas de nouvelle de toi. C’était inexplicable.
- Oh ! Je m’en excuse ma bonne amie, répondit Marie avec un sourire forcé sur ses lèvres qu’elle souhaita gai, difficile effort tant elle sentait les larmes prêtes à couler de ses cils, après le viol qu’elle venait de subir. Le directeur de cette respectable (dit d’un ton caustique) prison a souhaité me recevoir, murmura-t-elle, après une profonde inspiration. Des questions administratives…
- Des questions administratives ? s’étonna la prisonnière. Qu’est-ce que cela signifie ?
- Oui, je te gâte trop, ma chère Helena. D’après le règlement, je n’aurais pas le droit de t’amener autant de nourriture. J’en ai été grondé.
- Ce directeur est un imbécile !
- Tu as raison ! Un fieffé imbécile, un âne, s’écria Marie avec agressivité, avant un éclat de rire sans joie, libérant ainsi un trop plein d’émotion.
- Ja ! Un âne. Oh ! Que tu m’amuses à crier comme cela, sourit madame Caron avec un regard étonné sur son amie. Toi, toujours si calme.
- T’avoir fait attendre m’a énervée !
- Tu as raison, crie ! De toute façon, qui s’intéresse à nous, à moi ? Je me couperais les veines, que l’on me retrouverait morte et froide.
- Sainte-Marie, mère de Dieu ! réagit la visiteuse avec un air effrayant. Pourquoi dis-tu ces choses qui me font peur ? Helena, jure-moi, tu me jures que tu ne penses pas à…à…
- À me tuer ? Hélas, si, ma tendre amie, je te l’avoue. Mon désespoir est si grand.
- Tu ne me ferais pas une chose pareille ! À ton fils ! Ce serait effroyable ! À moi ! Jure-le-moi ! Je t’en supplie !
- Parce qu’il y a Alfred, parce qu’il y a toi, j’ai la force de ne pas céder à cette funeste tentation. Que Dieu m’en soit témoin.
- Non, Helena ! Jamais ! Tu me le promets ! insistait Marie avec un mélange de chagrin et de rage, songeant à l’odieux sacrifice qu’elle avait consenti à faire pour le bien-être de son amie.
- Oui, je te le promets, murmura l’autre, la tête et les épaules affaissées, paraissant porter toute la misère du monde.
- Mon Dieu ! Quelle journée, gémit la seconde en serrant Helena contre elle.
- Je suis désolée, désolée de te donner tant d’inquiétude. Ah ! Si seulement mon mari n’avait pas voulu effectuer toutes ces folies dont il est accusé… Nous serions si tranquilles.
- As-tu eu des nouvelles ?
- Des nouvelles ? ricana la femme de l’officier en s’écartant. Mais je suis toujours cloîtrée ici sans que l’on daigne se préoccuper de moi. Rien n’a changé depuis ta dernière visite. Une torture ! Et toi, qu’as-tu à m’apprendre ?
- Toujours peu de choses, ma pauvre amie. Depuis le 30 août, il est dit partout que le lieutenant-colonel Caron et le sieur Roger ont été conduits d’ici à Strasbourg sous l’escorte de la gendarmerie. Ils auraient été sur-lechamp enfermés à la prison militaire.1 Certains parlent de Finkmatt-caserne, d’autres de la prison des Ponts-couverts…
- Augustin serait à Strasbourg…
- Oui.
- Et qu’entends-tu d’autre ?
- Beaucoup trop de choses ; il se dit tout et n’importe quoi.
- Rapporte-moi le pire ! Que risque selon les plus pessimistes mon mari à son procès ?
- Ce sont des bêtises ; nul ne le sait. Aie confiance en ceux qui s’activent pour lui, même s’ils paraissent peu nombreux.
- S’il te plaît, que disent les rumeurs, que souhaite la majorité ?
- Tu le sais ou tu t’en doutes : la dégradation, puis le peloton. »
Madame la colonelle Caron se sentît blêmir, et une nausée lui monta à la gorge.
« Pourquoi m’as-tu forcée à te dire ces bêtises ? s’emporta Marie en la voyant défaillir. Te voilà blanche comme la mort ! Viens, assis-toi ici.
- Mein Gott ! Marie ! sanglota l’autre. Crois-tu que cette vilaine histoire finira un jour ?
- Helena, je t’en prie ! Ayons confiance en l’avenir ! Gardons espoir, sinon nous ne tiendrons pas ! Nos enfants ont besoin de nos forces. Je t’en prie, si tu baisses les bras, je m’effondrai à mon tour.
- Non, Marie, pas toi ! Excuse-moi ! Aujourd’hui, je suis stupide et faible ; je n’en ai pas le droit. Je te promets que cela n’arrivera plus.
- Prions le Ciel qu’il nous vienne en aide.
- Oui, c’est cela, prions. Peut-être qu’à toutes les deux, nos prières ont plus de chances d’être entendues.
- C’est cela, Helena. Ayons confiance en l’avenir ! Bientôt tu seras libre. Je te le promets ! »
Le regard fixe, la malheureuse prisonnière avait écouté la promesse de son amie, le cœur glacé malgré ses efforts, car elle était incapable de ranimer en elle l’espérance.
1 Journal de Paris et des Départements, Politique, Commercial et Littéraire N° 242.
Chapitre 2
Paris, préfecture de police, rue de Jérusalem
Assis, les bras croisés sur son bureau, l’inspecteur Eugène Chenard ne quittait pas des yeux Achille Fleischmann, assis devant lui, la tête penchée sur un corps voûté et sans force. Les pleurs et les soubresauts de ce dernier lui déchiraient le cœur.
« Oh ! Mon Dieu ! Ce n’est pas possible, ce n’est pas vrai ! répétait le secrétaire de police entre chaque respiration remplie de sanglots. Morts ! Morts, tous les quatre ? Oh ! Ce n’est pas possible ! Non, ce n’est pas possible, reprit-il, après un regard dément qui se fixa sur le visage calme de son supérieur. Mon Dieu ! C’étaient mes pères, ma famille, mes amis, depuis que je suis tout petit… Non ! Ce n’est pas possible ! Je leur dois ce que je suis… Morts ? En êtes-vous vraiment certain ? Comment cela a-t-il pu arriver ? Morts, êtes-vous vraiment certain de ce que vous me dites ?
- Oui, aucun doute ; et ils se sont accusés des crimes que vous connaissez, celui de Ferier, puis des autres, tous, unanimement. Ils l’ont hurlé en cœur ; enfin, après quelques coups de feu défensifs, ils se sont suicidés d’une manière plutôt efficace en copiant la tragédie de Matouba.
- Matouba ? Vous voulez dire qu’ils ont…qu’ils ont, marmonna le jeune homme d’une voix tremblotante. Non ! Pas cela ! Ne me dites pas qu’ils se sont fait exploser comme…comme Louis Delgrès et ses compagnons ? Estce bien cela que vous voulez m’annoncer, me faire comprendre, monsieur l’inspecteur ? Mon Dieu ! Que se passe-t-il ? Je dois vivre un cauchemar !
- Oui, dans leur sucrerie. J’avoue que ce fut une explosion réussie. J’ai été projeté sur le sol. Ensuite ça a été une sacrée fournaise. Il ne reste presque plus rien de ce que fut la sucrerie insolemment nommée « Au revenant ».
- Mais pourquoi ? Pourquoi ?
- Pourquoi ? réagit sans joie le policier, mais parce qu’ils voulaient vivre libres ou mourir. À moins que vous n’ayez une autre explication ?
- Une autre explication ? Non, gémit Fleischmann, se pliant en deux sur sa chaise, le visage en sueur et les yeux égarés, avant d’appuyer son front dans les paumes de ses mains ouvertes.
À nouveau, le secrétaire de police pleura comme jamais. Ses sanglots aigus et douloureux envahirent le bureau, soulevant des échos d’une grande et lugubre désolation. Après un soupir retenu, Chenard se leva pour se diriger vers la fenêtre qu’il ouvrit en grand. L’homme trouvait l’instant déplaisant. Il ne parvenait pas à se défaire d’un sentiment de malaise auquel venait se mêler un certain agacement. Qu’allait-il décider maintenant ? Libérer sans suite son adjoint, comme l’officier de paix le lui avait demandé ? L’idée était agréable, car il ne niait plus l’attachement qu’il éprouvait vis-à-vis de cet être empli de qualités. Il prisait leur collaboration énergique et désirait la poursuivre ; sauf que trop de questions concernant le crime de Ferier restaient sans réponses. De fait, et il se connaissait, jamais son esprit n’arriverait à clôturer l’enquête des assassinats signés d’une baguette de tambour. Jamais ne s’en iraient les soupçons de son crâne. À moins que Fleischmann ne déliât enfin sa langue, car il était persuadé qu’il savait une partie des nœuds de ses crimes. Innocent sans doute, mais complice au moins de celui de Ferier, il en était presque persuadé et cela le contrariait. Devait-il une énième fois l’interroger, mais cette fois-ci en employant des manières fortes ? Non, car ensuite tout serait terminé entre eux, plus de collaboration, plus de respect. Crispé, le policier soupira, empli d’indécision, bien qu’il eût intimement espoir qu’un jour il réussirait à établir un rapport entre deux points inexpliqués, le pourquoi de l’embauche du secrétaire chez Ferier et le meurtre de ce dernier. L’homme jeta un ultime regard vers l’extérieur, avant de retourner s’asseoir. Le détenu sanglotait toujours.
« Que comptez-vous faire dorénavant ? demanda Chenard.
- Faire ? Moi ? réagit l’autre en essuyant les larmes qui inondaient ses joues, après un sursaut.
- (…)
- Que voulez-vous de moi ? reprit-il avec une œillade désordonnée. Que puis-je faire ? J’aimerais me rendre à Charenton. C’est la seule idée qui me vient à l’esprit. Prier pour leurs âmes… Essayer de comprendre.
- Faites !
- Je suis libre ?
- N’avons-nous pas les aveux des assassins ?
- Eux, des assassins ! Ce n’est pas possible, non, ce n’est pas possible ! C’est un cauchemar…
- Personne ne les a obligés à s’accuser de ces odieux crimes. Ils ont avoué ; ce sont les assassins. Vous n’y pourrez plus rien maintenant.
- Je ne comprends pas…
- Et maintenant qu’ils ont quitté ce monde, dit l’inspecteur de police en se penchant vers son acolyte, est-ce bien encore nécessaire de les protéger ? Peut-être pourriez-vous vous confier, m’avouer quelques vérités ?
- Quoi, monsieur ? réagit Achille avec une pointe de colère. Je vous ai déjà tout dit : je ne suis pas l’assassin de Ferier et je vous jure que je suis effondré, paniqué, tétanisé d’apprendre que des hommes qui ont partagé ma vie, qui m’ont éduqué, soigné, soient les auteurs des crimes abjects qui ont sévi ces dernières semaines, pire, qu’ils s’en soient accusés avant de se donner la mort. Je n’arrive pas à comprendre le moindre mot de cette affaire. Ces hommes étaient des braves, des soldats bien sûr qui avaient un passé de guerre, mais ils étaient admirables, fidèles, compréhensifs, savants ; je n’aurais pas rêvé mieux comme mentors. Et de les imaginer assassiner Ferier, assassiner des inconnus sans raison, cela va au-delà de ma compréhension ! Je ne comprends pas ! Je doute même de leur culpabilité !
- Assassiner sans raison ? réagit Chenard, s’étirant et croisant ses mains derrière sa nuque. Et si justement, il y avait une raison.
- Une raison ? Mais laquelle ?
- Vous peut-être ?
- Moi ? À quoi songez-vous ? À un héritage ? Mais il n’y en aura pas ! Ne m’avez-vous pas dit que tout était parti en fumée ?
- Quelque chose que vous ne m’avez pas dit.
- Rien qui ne soit lié à tous ces crimes ! Mais à quoi songez-vous, monsieur l’inspecteur ? Me croyez-vous donc toujours coupable ? »
Se redressant sur son fauteuil, Eugène Chenard se pinça les lèvres ; son instinct lui souffla de laisser tomber. Il n’avait plus de temps à perdre. Il devait faire fi de ses sentiments et continuer d’avancer. De toute façon, ce suspect resterait à portée de main de la justice. Qui sait un jour ? Une confidence, un éclair, comme une clef qui ouvrirait une porte oubliée. Le policier savait que la vérité ressortait toujours, même s’il fallait être patient. Un jour, il comprendrait le nœud de ces crimes.
« Fleischmann, vous êtes libre. Si vous le souhaitez et cela me conviendrait, vous pouvez reprendre votre poste de secrétaire de police à la préfecture. Vous pouvez prendre quelques jours de repos avant de vous décider.
- (…)
- Vous ne dites rien ?
- Vous savez que ce serait mon vœu le plus cher, dit le jeune homme, tandis qu’il essuyait les larmes qui continuaient à couler le long de ses joues.
- Parfait ! Les dossiers en cours vous attendent !
- Je peux auparavant me rendre à Charenton ?
- Un fiacre vous attend en bas. Je lui ai donné l’ordre de vous y conduire.
- Merci, monsieur. Comme à votre habitude, je vois que vous aviez tout
anticipé.
- Dans le hall, il y a aussi un chien qui attend. Ce serait bien que vous alliez le calmer. La bête est brusque et bruyante.
- Un chien ?
- Celui de la sucrerie. Aussi curieux que cela puisse vous paraître, vos mentors ont voulu l’épargner. Ils me l’ont confié quelques minutes avant l’explosion.
- Ulm ! Ce brave Ulm ! réagit-il avec le regard brillant d’un enfant heureux.
- Ulm ?
- C’est son nom. En souvenir de cette victoire sans doute. Je sais qu’il leur rappelait un chien de leur régiment qu’ils avaient là-bas et qui avait été tué lors d’une canonnade.
- Très bien, fit l’inspecteur de police avec un mouvement de la main qui signifiait la fin de l’entretien, occupez-vous d’Ulm, puis rendez-vous à Charenton où d’ailleurs vous retrouverez chevaux et autres bestiaux groupés dans un enclos, car eux aussi, vos protecteurs ont fait en sorte de les épargner. Arrangez-vous avec un fermier du coin pour les lui vendre. Gardez peut-être un cheval pour vous. À vous de voir. Ensuite vous reviendrez prendre vos instructions. Je compte sur vous. Gardez toujours à l’esprit que vous êtes secrétaire de police, à la préfecture de Paris. »
Chapitre 3
Couvent des filles de la Providence, rue de l’Arbalète, Paris
« Que me dites-vous ! Aurais-je bien entendu ce que vous avez marmonné entre vos dents ?
- Je ne marmonne pas, mon fils ! s’offusqua la mère supérieure qui serrait nerveusement la croix en buis qui pendait à son cou. Oui, vous avez bien entendu : elle a disparu, elle nous a menti, elle nous a trompées, elle s’est sauvée…malgré tous nos soins, malgré tout notre amour…
- Écoute-moi bien, l’abbesse, réagit le policier avec les yeux d’un dément. Tu ne vas pas me mener en bateau très longtemps. Que s’est-il passé ? Comment est-ce possible ? Où est Louise ? Parle !
- Mon fils, je suis la mère supérieure de ce couvent ! Je vous prie de ne nullement me tutoyer. Je peux comprendre que cette nouvelle vous affole et vous cause une grande peine…
- Quand ?
- Quand quoi, mon fils ?
- Je te conseille d’être plus éveillée et de répondre à mes questions. Depuis combien de jours a-t-elle quitté le couvent ?
- Une semaine.
- Une semaine ? répéta Chenard, les nerfs à vif, se contenant de tout renverser dans la pièce – chaises, table, pupitre – jusqu’à l’envie furieuse de secouer la femme au corps sec devant lui avec ce visage qu’il découvrait retors, après des semaines de bons conciliabules.
- Doux Jésus ! Vous m’apparaissez bien sinistre, mon fils, murmura la religieuse, après un demi pas en arrière, comme si un pressentiment la mettait en garde sur les risques encourus. Chaque jour, je prie le Seigneur de l’aider à revenir, ajouta-t-elle d’une voix presque inaudible.
- Quelqu’un l’a-t-elle aidée ? demanda le policier, cherchant déjà des pistes.
- Non ; elle a fui par l’entrée des cuisines, lors d’une réception de petits pains. Elle s’est faufilée derrière le dos de notre sœur responsable des fourneaux.
- Avez-vous interrogé ses camarades de lit ou d’études ? poursuivit-il en repassant au vouvoiement, ce qui détendit la mère supérieure.
- Elle ne s’est confiée à personne, si c’est ce à quoi vous pensez, mon fils. J’ai moi-même questionné toutes mes filles. Nulle parmi nous ne sait où elle a pu se rendre.
- Avez-vous une explication à son geste ?
- Aucune. Elle était toujours brillante, elle chantait si bien. Elle nous manque à toutes…
- Ses affaires ?
- Tout est ici. Elle a fui sans rien emporter.
- Faites-moi tout porter rue de Jérusalem.
- Si c’est ce que vous souhaitez…
- Qu’il ne manque rien !
- Est-ce votre colère qui vous fait émettre cette bien vilaine hypothèse, mon fils ? Jamais le péché de vol ne sera commis dans notre…
- Qu’il ne lui arrive rien, l’abbesse ! s’emporta à nouveau le policier en se redressant. Que je la retrouve vite ! Ou, foi de Chenard, tu en répondras devant moi, menaça-t-il en repassant au tutoiement, avec, à nouveau, ce regard empli de violence qui terrifia la religieuse dont les lèvres se mirent à trembler.
- Mon Dieu, souffla-t-elle, l’air défigurée, reculant maladroitement vers la porte.
- Je t’avais confié cette enfant et tu n’as pas été capable de veiller sur elle ! poursuivit-il d’un ton glaçant. Et cela, malgré ma générosité ! Ma rage est terrible à ton encontre. L’idée que Louise soit dorénavant seule et en danger me rend fou. Prie ton Dieu qu’il ne lui arrive rien ! »
Sur ces mots, l’homme pivota sur ses talons et quitta les lieux avec une volonté d’agir vite, bousculant tout ce qu’il y avait devant lui – tabouret, pupitre, cadre sur le mur et porte qu’il claqua avec violence –, négligeant surtout la patronne des lieux qui se signait et se re-signait dans un coin de la pièce, épouvantée qu’elle était par les terribles menaces crachées à son visage.
Une semaine ! fulmina Chenard en traversant un jardin fermé, avant d’accélérer vers l’accueil du couvent. Une semaine. Foutre ! C’est long ; où peut-elle être allée ? Ah ! J’aurais dû prêter plus sérieusement attention à ses paroles. Elle a osé fuir ! Louise… Quelle inconscience dans ta petite tête ! Toutes ces enquêtes en cours m’ont pris tout mon temps. Je t’ai délaissée involontairement. Pardieu ! J’aurais crû qu’elle se ferait à sa vie de novice. Elle y était si brillante ! Ne se passionnait-elle pas pour tout ce qu’elle apprenait. Grande erreur de ma part ! Mauvais jugement ! Son besoin de liberté était donc si grand. Pas vu le coup venir. Quel caractère ! Fuir au hasard sans port d’attache. Hou ! Ça me fait foutrement peur ! Où pourrait-elle être accueillie ? Cette vilaine bande avec laquelle elle trainait ? Retrouver le dossier de cette arsouille qui l’avait entraînée vers le vol et la mendicité. Quel était son nom déjà ? Ah ! Comment déjà ? Je l’ai sur le bout de la langue… Oui, je me souviens : Sainte-Nitouche. Est-il toujours sous les verrous ? De suite se renseigner. Empêcher Louise de tomber à nouveau sous son influence. Ah ! Elle peut dire qu’elle me complique l’existence, cette jolie demoiselle. Me voilà tremblant comme une feuille. Tant de chose à faire ! La retrouver vite ! La sauver ! Ah ! Elle va m’entendre ! Pourrait-elle aussi avoir l’idée de retourner chez cet intrigant de Dumoulin ? se dit-il dans un sursaut, alors qu’il était arrivé au milieu de la rue de l’Arbalète. Ce serait le comble. Non, je ne le crois pas. Mais tout est possible avec cette entêtée de gamine. Vite remettre la main dessus ! L’arracher à toutes ces influences néfastes ! Ah ! Jamais je n’aurais dû m’occuper de cette vilaine graine... Ah ! Qu’il ne lui arrive rien ! J’en tremble, malgré moi ! Vite, la retrouver ! Elle n’a guère pu se rendre loin, la chipie… Oui, agir ! Agir vite !
Chapitre 4
Les environs de Paris, septembre 1822
La fin de matinée de cette journée de septembre était claire, une matinée fraîche et piquante, idéale pour une balade à cheval. Côte-à-côte, Jean-Baptiste Dumoulin et Charles Léon, chacun dans une tenue d’équitation à la mode avec des bottes soigneusement cirées, chevauchaient depuis l’aube sur la route menant de Paris à Fontainebleau, en direction de Savigny-sur-Orge, plus précisément de son château, demeure seigneuriale qui appartenait au maréchal Davout, duc d’Auerstaedt, prince d’Eckmühl et pair de France.
La route était agréable car peu poussiéreuse et pavée par tronçons. Coincée entre des collines verdoyantes ou arborées, elle traversait de nombreux hameaux et bourgs avec leurs potagers, leurs vergers ou leurs champs agraires qui se suivaient presque sans interruption depuis Paris. Parfois un castel, protégé par des grilles au bout de courtes allées, dominait le paysage.
Droit sur sa selle, Jean-Baptiste prisait l’exercice équestre qu’il se reprochait de ne pas pratiquer assez depuis son installation dans la capitale, faute de temps.
Excellent cavalier, l’ancien officier d’ordonnance dirigeait avec brio sa monture – un Holstein robe sombre – et imposait – avec l’idée d’une formation soldatesque – une cadence soutenue au jeune bâtard impérial qui, s’accrochant sans rien dire sur la selle de son pur-sang anglais aux poils courts, serrait les dents, surtout lorsque la séquence au trot semblait s’éterniser, car le garçon était peu coutumier de la pratique d’une longue chevauchée de cette nature.
« En tant qu’ordonnance, hurla soudain dans un rôle de mentor le capitaine Dumoulin avec un sourire, j’entraînais presque chaque jour mon cheval à effectuer sept lieues2 au grand galop et je continue le plus souvent que je peux, dans le but d’être prêt le jour où les tocsins appelleront à la révolte.
- Pour…pourquoi sept…sept lieues ? demanda le jeune homme entre deux secousses.
- Pourquoi sept lieues ? ricana l’officier en se dressant sur ses étriers, avant de respirer à pleins poumons. Mordious ! Sache que les services de ton père s’organisaient en campagne pour qu’un relais soit disposé tous les six ou sept lieues sur la route de Paris. Chargés de plis, les messagers impériaux pouvaient ainsi galoper à brides abattues en toute confiance et changer de monture à chaque poste qu’ils rencontraient, cela quatre fois jusqu’au coucher du soleil, et parcourir ainsi vingt-huit lieues par jour. La rapidité a été l’une des forces de l’Empereur. Ne pas oublier bien sûr d’étudier les cartes avant même d’aller sur le terrain concerné. Cela donne un sérieux avantage. C’était une exigence constante du grand homme !
- Ah ! Mon père était un génie ! Il pensait à tout !
- Vive l’Empereur !
- Oui, capitaine, vive l’Empereur, mon père, que je regrette chaque jour de ne pas avoir connu plus longtemps !
- Réalise que tu vas rencontrer l’un de ses meilleurs compagnons ! annonça Jean-Baptiste avec un mouvement de sourcils, tandis que les deux cavaliers avaient adopté une allure au pas. Il pourra te parler de maints souvenirs le concernant, des souvenirs personnels que tu priseras. Davout l’a suivi de l’Égypte jusqu’aux Cent-Jours. Il est le vainqueur du maréchal de Brunswick blessé à mort à la bataille d’Auerstedt.
- Davout, dit le garçon avec un mouvement du menton, semblant réfléchir.
- Oui, mon garçon, le seul maréchal à être invaincu à la tête de son corps d’armée qu’il tenait d’une main de fer, mais qui néanmoins lui vouait un culte absolu.
- Et à Waterloo ?
- Davout n’y était malheureusement pas, il était à Paris ; il était le ministre de la guerre.
- Dommage ! Et qu’allons-nous faire chez lui ? Pourquoi m’y conduisezvous ?
- Consolider tes connaissances, mon jeune ami. Tu dois former autour de toi un cercle de fidèles en vue de la fin du Bourbon et pourquoi pas, en vue d’une destinée que je devine grande. L’on doit te connaître.
- Que vais-je lui dire ?
- Ne sois donc pas effarouché !
- Sacredieu ! Je ne le suis pas, capitaine !
- Non, juste un peu, sourit Jean-Baptiste. Tu m’as l’air fort préoccupé depuis que je te parle de Davout.
- C’est parce que je songeais à ma mère, je m’interrogeais sur ce qu’elle me répondra quand je lui écrirai que j’ai visité le duc d’Auerstaedt. Peut-être l’a-t-elle connu ? Que pense-t-il d’elle ? Je n’aimerais pas sentir qu’il a mauvaise opinion d’elle.
- Ouais, ouais, ta mère, marmonna l’officier exaspéré, mais ne le montrant pas. Aurais-tu encore reçu des lettres de sa part ?
- Presque chaque jour maintenant ! C’est extraordinaire, n’est-ce pas ?
- Sans doute…
- Ma mère, il faut que je la vois, capitaine.
- Annoncerait-elle sa venue à Paris, la chère maman (dit d’un ton plus bas) ?
- Non, pas encore ; mais peut-être me réserve-t-elle une surprise de la sorte. Chaque fois que je vois une voiture étrangère dans les rues de Paris, mon cœur se met à tambouriner dans ma poitrine. Serait-ce ma mère qui me cherche ?
- Je te le souhaite, mon garçon, mentit le premier avec effort, après s’être raisonné en se disant que cette affaire ne le concernait pas. Si elle t’aime, il est évident qu’un jour prochain elle apparaîtra devant toi. Douce et aimante ! - Vous le croyez vraiment ? Ah ! Comme j’en rêve chaque nuit !
- Bien sûr, mais nous en reparlerons après, coupa Jean-Baptiste en tirant sur les brides de sa monture. Car le bourg qui se présente à nous, dit-il, les yeux plissés, est Savigny et j’en déduis que le castel de Davout ne doit pas être loin. Tâchons de paraître présentables, car je t’avoue qu’une autre préoccupation, en plus de ta présentation, motive notre visite. Un frère d’armes est en mauvaise situation à Colmar ; je recherche des alliés de poids pour plaider sa cause auprès du Roi. Et la position de pair de France de Davout m’intéresse. Il a du caractère. Je n’oublie pas qu’il a témoigné courageusement seul contre tous en faveur de Ney, lors de son funeste procès.3 Mais auparavant, calmons nos estomacs qui crient famine. Midi approche. Notre petit déjeuner me semble joliment loin et cette auberge làbas, près de la place du village, me paraît fort sympathique. Nous demanderons ensuite le chemin jusqu’à Davout. »
Presque simultanément, les deux cavaliers mirent pied à terre et, leurs chevaux tenus par le mors, ils se dirigèrent vers une enseigne imposante qui brandissait trois cuillères de fer forgé au-dessus de la tête des badauds. Après avoir confié leurs bêtes à un palefrenier sans âge qui avait jailli de l’écurie et descendu quelques marches, ils se retrouvèrent dans l’atmosphère épaissie du tabac d’une dizaine de clients et du relent des sauces préparées en vue du service de milieu de journée. Au fond de la salle, une porte ouverte laissait voir la cuisine où, devant les feux rougeoyants, tournaient des broches bien garnies de volailles.
Après avoir choisi une table ronde près d’une fenêtre, Jean-Baptiste commanda du vin à une soubrette qui passait près d’eux, chargée d’un plateau.
« Tiens voilà le cavalier que j’apercevais parfois derrière nous, depuis Paris, reprit l’officier en écartant le rideau ; ce pékin n’a jamais réussi à nous rattraper. Je me demande qui c’est ?
- Peut-être que lui aussi rend visite à Davout ?
- Cela n’arrangerait pas nos affaires, mon garçon. Nous avons besoin d’être seuls avec le maréchal. J’ignore comment il nous accueillera, car je le connais à peine, l’ayant vu une fois chez ce diable boiteux de Talleyrand…
- Eh, capitaine, regardez. C’est le policier nègre, coupa Léon en approchant son nez contre la vitre. Oui, c’est lui ! Que fait-il ici ? Du haut de sa selle, on jurerait qu’il questionne le garçon d'écurie qui nous a pris nos chevaux. À croire qu’ils parlent de nous. Ce couillon montre l’auberge du doigt.
- Mordious ! réagit Dumoulin, une barre sur le front, reculant pour ne pas se faire voir, imité par son acolyte. Cet Égyptien de malheur nous suivrait donc ? Que cela signifie-t-il donc ? Serions-nous surveillés sans le savoir ? Mauvaise nouvelle que cela…
- Oh ! Oh ! Il descend de son cheval ; et, regardez donc, ce grand chien noir qui rode autour de lui, cette bête semble être à lui !
- Ouais, une bougrerie de molosse. Jamais prisé ce genre d’animal. J’ignorais que la rousse était équipée de ça.
- Que fait-il ? On dirait qu’il s’en va de l’autre côté.
- Pas vraiment, réfléchit Jean-Baptiste en regardant l’établissement situé en face. Évident que ce jean-foutre part se dissimuler de l’autre côté, dans l’hostellerie à la triste façade ou alors chez le maréchal-ferrant, juste à côté.
- Qu’y fera-t-il ?
- Mordious ! Comprends que nous sommes surveillés et cela probablement depuis un certain temps. Sans doute que dans les rues de Paris nous n’avons rien vu, mais hors des murs de la capitale, les choses ne sont plus les mêmes, car se cacher devient moins facile. Ce matin, j’aurais dû prêter plus attention à ce cavalier qui suivait curieusement la même route que nous. Enfin le judas vient d’être démasqué, car la chance est de notre côté. Assis au bord de cette fenêtre, nous avons pu l’apercevoir. Dire que j’ai été à deux doigts de choisir une table au fond de la salle…
- Qu’allons-nous faire, capitaine ? s’affola le bâtard dans un murmure. Toujours rendre visite à Davout ? Retourner à Paris ?
- Contrariant que cette idée d’être suivis », marmonna l’adulte après un silence, balançant entre étonnement et irritation, tandis qu’on leur avait apporté un pichet de vin.
L’espace d’une poignée de secondes, l’officier songea à ses projets en cours, à l’évasion des sergents de la Rochelle avec la corruption du concierge de la Conciergerie, à l’organisation de la fuite des prisonniers vers l’Angleterre, puis à sa volonté de retourner à Colmar pour aider Caron à s’échapper du piège dans lequel il s’était empêtré et surtout de retrouver Marie et Louisette, son amante et leur fille, les soleils de sa vie. L’idée d’être entravé dans ses mouvements l’irrita au plus haut point. Était-il observé depuis longtemps ? Sans doute ; et il aurait dû y songer avec son passé de conspirateur. Le colonel Fabvier ne l’était-il pas depuis des mois ? Sûrement était-ce un ordre de ce fourbe de Chenard. Que faire ? Rester maître de ses nerfs ! Ne pas s’en alarmer plus que cela et poursuivre son idée de visiter le maréchal Davout, car ne s’agissait-il pas au demeurant que d’une simple visite de courtoisie !
« Fi donc de ce cogne ! annonça-t-il avec un ricanement, interpellant son compagnon qui ne l’avait pas quitté des yeux. Que le Nègre nous suive donc et qu’il perde son temps à nous lorgner ! Nous le baladerons et il se fatiguera bien assez vite. Passons plutôt à autre chose et commandons la spécialité de la maison ; mangeons de bon appétit ! Ensuite nous irons sonner à la grille du duc d’Auerstaedt.
- Qu’est-ce que vous lui voulez au maréchal ? demanda une voix rauque et cassée, à quelques pas de leur table, les surprenant.
- Il me semble que ce ne sont pas vos affaires, le bonhomme, réagit le capitaine Dumoulin, après un coup d’œil sur un large gaillard en chemise, la cinquantaine, une épaisse barre grisonnante au dessus de ses lèvres épaisses, les cheveux blancs et courts, assis devant un guéridon, la main gauche mutilée à laquelle il manquait les trois doigts du milieu, serrée autour d’une chope de bière.
- Oh – Oh ! Ne soyez donc pas ainsi plein de certitudes, l’étranger, ricana le personnage en se levant et en rejoignant la table du duo. Au château, devant la grille, lorsque vous sonnerez la cloche, y’a de grandes chances que ce soit ma lourde carcasse qui vous accueille au portail.
- La chance est avec nous alors, réagit Jean-Baptiste avec un sourire, car il devinait la vieille moustache dans leur interlocuteur et surtout un fidèle dévoué corps et âme au maréchal Davout. Capitaine Dumoulin, officier d’ordonnance de l’Empereur, et à mes côtés, le sieur Charles Léon.
- Un joli monsieur qui me rappelle la figure, le profil surtout, d’un jeune officier d’artillerie que j’ai rencontré en Italie et que j’ai ensuite suivi dans toutes les capitales du monde.
- Mon père ! ne put s’empêcher de s’écrier le bâtard impérial d’une voix emplie de fierté, se redressant sur sa chaise, les yeux brillants.
- C’est donc lui le petit Polonais.4
- Non, le fils d’Éléonore Denuelle de la Plaigne, murmura Jean-Baptiste.
- Pas été averti de celui-là, ricana le vétéran. Mais foutredieu, difficile de contester son origine. Son joli minois parle pour lui.
- Et nous, à qui avons-nous l’honneur ?
- Sergent Molitor, vingt-cinq ans de campagne, dont vingt à côté de Davout dans le 3e corps. J’ai l’honneur de dire que j’étais à Auerstaedt !
- Un brave, dit Dumoulin avec un air admiratif. Trois chopes s’il vous plaît, hurla-t-il à la soubrette de l’auberge qui repassait par là. Et avec trois plats du jour !
- Racontez-moi, demanda le jeune Bonaparte en fixant leur invité. Qu’estce que cette bataille dont je connais le nom mais pas les détails ?
- Vu votre âge, petit monsieur, vous étiez alors contre le sein de votre nourrice ou près de l’être, raconta le vieux sous-officier en arquant les sourcils ; ce fut là une bien longue et dure journée, mais un jour de gloire pour la France5. Vingt-huit mille Français contre soixante mille Prussiens commandés par du duc de Brunswick en personne, l’auteur du fameux manifeste de 1792 si tu l’ignores.6 Une victoire raide et héroïque au terme de laquelle l’armée prussienne cessa d’exister et où ce Brunswick de malheur trouva la mort. Le 3e corps a souffert au delà de ce que l’on pourrait imaginer, mais n’y a pas perdu un seul de ses drapeaux. Ah ! Foutrerie ! Quelle journée de feu, de sang et d’acier ! Pas un p’tain d’endroit pour se reposer, même quelques secondes ! Certaines nuits, j’en cauchemarde encore ! Une pluie de plomb et de métal ! Là-bas j’ai vu le bicorne du maréchal être troué et emporté par un obus devant moi.7 Il n’a pas sourcillé ! Avec quelle bravoure et quelle insouciance il passait de carré en carré dans
l’intervalle des folles et terribles charges prussiennes. Ah ! Un homme fait de fer que le Davout ! Un vrai chef !
- À l’image de son 3e corps, dont l’Empereur était fier, sourit Jean-Baptiste.
- Le 3e corps ? demanda Léon, toujours plus avide de connaissance impériale.
- Le 3e corps, jeune monsieur, répondit le sergent Molitor avec de la fierté dans la voix, se redressant sur son tabouret, était celui où l’on mangeait le mieux et où l’on fusillait le plus.
- Où l’on fusillait le plus ? Que me racontez-vous, monsieur ?
- Ah ! Morbleu que oui ! Et presque chaque semaine, ricana-t-il, avant de vider d’un seul coup sa première chope, car une demoiselle en tablier gris venait d’apporter les suivantes. Un seul mot d’ordre dans le 3e, mon garçon. La discipline et l’ordre ! s’écria-t-il avec une profonde fierté dans le regard, tandis qu’il s’écartait à nouveau devant l’arrivée de trois assiettes garnies d’une demi-volaille grillée et d’un gratin de carottes et de châtaignes. Non, pas d’autres chemins. Espions, déserteurs, pillards, assassins, colporteurs de libelles anti-français, incendiaires étaient jugés sans appel et punis aussitôt au coin du champ, précisa-t-il avec un sourire amusé avant d’avaler une pleine fourchette de blanc de poulet.
- Mon Dieu ! murmura Léon en l’imitant.
- Du soldat français bagarreur et discuteur de la Révolution, poursuivait le vétéran avec exaltation, postillonnant sans gêne sous les yeux étonnés de ses deux convives, le maréchal a toujours voulu faire un soldat dont le métier et le sang-froid l’emportaient sur toute autre considération. Tel a toujours été son but durant sa carrière qui, je peux le dire, fut glorieuse. Pain, instruction et discipline, tels étaient les moyens d’y parvenir. Et ses pensées ont fait ses preuves. Je peux en parler, car j’ai appris à lire à ses côtés. Le maréchal a foutrement raison : un soldat instruit cesse d’être un soudard. Chaque jour et durant tout l’Empire, nous l’entendions dire que le 3e corps devait faire honneur à la France. C’était une idée fixe. De là, les cours d’orthographe, d’instruction civique et de calculs donnés à la troupe par les officiers les plus instruits. Tu peux le graver sous ton crâne : Davout est un brave !
- Merci, monsieur, pour le portrait flatteur de ce compagnon de mon père, réagit Léon. Qui n’aurait pas envie de le rencontrer après cela ?
- Surtout, jeune homme, que le maréchal, réputé à tort d’être difficile à vivre, a toujours été du petit nombre de ceux qui, en campagne, ont admis leurs officiers à leurs repas, alors que d’autres, comme Ney par exemple, conservait ses distances même au bivouac. Il y avait toujours une place à sa table pour l’officier venu porter des dépêches. Je peux en témoigner. Néanmoins, ajouta-t-il après un court silence, même si cela fut toujours le cas ces dernières années ici en son château, aujourd’hui les temps ont changé et cela me fend l’âme…
- Que voulez-vous nous dire ? intervint Jean-Baptiste avec un mouvement de sourcils.
- L’avez-vous récemment vu, capitaine ?
- À Paris, il y a peu de mois.
- À son dernier séjour alors. Je dois vous confier que depuis tout Savignysur-Orge s’inquiète.
- Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Est-il souffrant ? A-t-il été blessé ?
- Je ne peux vous cacher que le maréchal Davout est malade ; il tousse énormément et, de ce que je sais du médecin du village, sa poitrine montre de bien mauvais symptômes. Mais le pire est la terrible perte de sa fille préférée et adorée, morte en couches. Cela fait un an et je vois bien que cela le tue à petit feu et je ne suis pas le seul à le penser.8 Y’a des jours où sa figure me fait peur. Une couleur grise…
- Mordious ! Nous qui venions le visiter, dit le capitaine Dumoulin d’un ton contrarié, car il voyait venir l’échec de son excursion du jour et de son point dominant : trouver des personnes de marque pour secourir le lieutenantcolonel Caron emprisonné à Colmar.
- Oooh ! Pas vraiment l’heure. Ces jours-ci, le maréchal est foutrement morose, grimaçait l’autre, agitant sa main mutilée, à peine s’occupe-t-il de ses vignes et de ses mémoires…
- Pensez-vous que nous pourrions néanmoins le voir... ?
- Je ne sais pas, capitaine ; qu’est-ce que vous lui vouliez ?
- Peu de choses ; simplement répondre à son souhait de nous recevoir.
- Ma foi, on peut tenter. Souvent l’après-midi, il aime se promener au bord de la d’Orge.9 J’irai lui apporter votre carte de visite. Mais avant, capitaine, s’écria le bonhomme avec un fort bruit de bouche, terminons cette excellente cuisine. Nous avons tout le temps, midi vient à peine de sonner au clocher et j’ai grand appétit. Pas vous ? Ah ! Je remercie la Providence qui m’a fait vous rencontrer !
- Bien sûr, marmonna Jean-Baptiste, après une œillade sur ses comparses qui mangeaient de bon cœur, et il se dit que la journée tournait à l’aigredoux, après une chevauchée plaisante qui faussement lui avait fait croire à tout autre chose. Sacredieu ! Encore un méchant revers dans la recherche d’alliés de poids pour la cause de Caron, songea-t-il irrité. Lafayette, Fabvier, Sauset, la duchesse de Berry et maintenant sans doute Davout en qui il fondait un grand espoir de soutien. Les jours passaient et Caron apparaissait de plus en plus seul, seul face au parti ultra qui réclamait chaque jour son sang dans ses journaux. Restait Talleyrand, mais qui pouvait croire en ce personnage qui sentait l’intrigue et les fausses promesses ? Enfin parfois la vie réservait des surprises...
Tandis qu’il portait une chope de bière à ses lèvres, les pensées de l’officier dérivèrent sur la découverte de l’étroite surveillance exercée sur eux par la police royale, ce qui n’arrangea guère sa nouvelle humeur. Mordious ! Rien de bon à cette mi-journée, s’agaça-t-il, après une énième œillade sur ses compagnons qui semblaient se régaler, avant de se dire que chaque problème se devait d’être réglé indépendamment l’un de l’autre et que pour l’instant, il resterait concentré sur la visite au maréchal Davout en attente de conclusion.
Là-dessus, Jean-Baptiste goûta la volaille servie dans son assiette fumante et la trouva fort délicieuse, ce qui le divertit à son tour.
2 Environ 28 kilomètres.
3 Une mesure d’exil fut prononcée contre le maréchal Davout le 27 décembre 1815, suite à son témoignage courageux et solitaire en faveur de Ney, lors du procès de ce dernier au palais du Luxembourg devant la Cour des pairs qui le condamna à mort et fusillé le 07 décembre.
4 Le comte Walewski, fils illégitime de Napoléon Bonaparte et de la comtesse Walewska, né en 1810.
5 La bataille d’Auerstaedt eut lieu le 14 octobre 1806 ; Charles Léon naît le 13 décembre de cette même année.
6 Le texte, dit manifeste de Brunswick, publié le 25 juillet 1792 à Coblence, menaçait de livrer Paris « à une exécution militaire s’il était fait la moindre violence, le moindre outrage à Louis XVI et à Marie-Antoinette ». Connu à Paris le 1er août, ce texte, très mal accueilli par l’Assemblée et les Parisiens, met le feu aux poudres et ne fait qu’accélérer la chute de la royauté (10 août). Brunswick est vaincu à Valmy le 20 septembre. Il reprend du service contre les armées de Napoléon en 1806 ; il est blessé gravement aux yeux à la bataille d’Auerstaedt et meurt peu après.
7