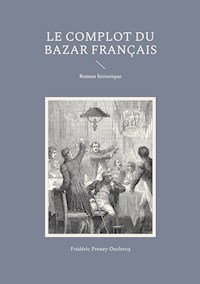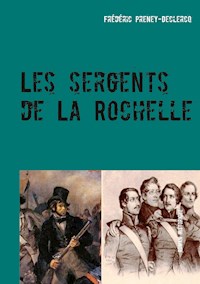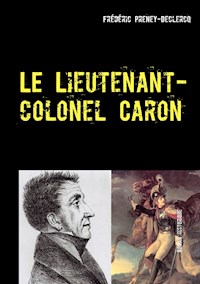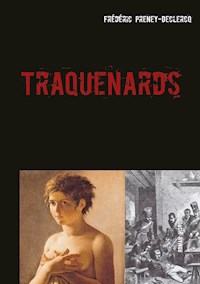
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Les enquêtes de l'inspecteur Eugène Chenard et les aventures du capitaine Dumoulin, ex-officier d'ordonnance de Bonaparte
- Sprache: Französisch
En cet été 1822, qui pourrait entraver l'action du lieutenant-colonel Caron ? A la tête de régiments français disposés à faire le demi-tour et à déployer les trois couleurs, l'officier à la retraite s'apprête à s'emparer de Colmar et à délivrer de la prison ses frères d'armes arrêtés l'année précédente. Dans la foulée, pourquoi ne pas rêver d'embraser le pays et de chasser Louis XVIII ? Caché sous le déguisement d'un félon, l'inspecteur Chenard oeuvre pour protéger le royaume. Un traquenard a été mis en place, mais la partie d'échecs entre le rebelle et le pouvoir s'annonce serrée, surtout que des renforts en la personne de Marie de Monlivo, membre des chevaliers de la liberté, société secrète de l'Ouest, et de Jean-Baptiste Dumoulin, ex-officier d'ordonnance de Bonaparte, pourraient inverser la tendance. Paris n'est pas à la traîne dans les préoccupations du policier et de son équipe. Un ou des meurtriers y sèment toujours des cadavres, crimes signés d'une baguette de tambour. Sous l'action de la Charbonnerie, s'y fomente aussi un projet d'évasion de jeunes sergents appréhendés à La Rochelle que le parti royal souhaite durement punir. Rien ne manque dans le roman de Frédéric Preney-Declercq : l'aventure, le suspens, l'amour, tout cela à un rythme soutenu. A la base surtout, une documentation irréprochable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 937
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture :
Jeune fille en buste de Pierre-Narcisse Guérin, (1794) – musée du Louvre.
Arrestation du lieutenant-colonel Caron ; gravure de l’époque dans [Histoire populaire contemporaine de la France T1 illustré de 303 vignettes – page
→
].
Du même auteur
Le Complot du Bazar français
Première partie – Juin 1820
(Les Éditions du Net – ISBN : 978 2 312 06568 7)
Le Complot du Bazar français
Deuxième partie – Août 1820
(Les Éditions du Net – ISBN : 978 2 312 06586 1)
Le Charbonnier
Première partie – Le roi de Rome
(Les Éditions du Net – ISBN : 978 2 312 06569 4)
Le Charbonnier
Deuxième partie – Le général Berton
(Les Éditions du Net – ISBN : 978 2 312 06596 0)
Le lieutenant-colonel Caron
Colmar – 1822
(Books on Demand – ISBN : 978 2 322 03799 5)
À Morgan qui supporte depuis des années mes rêveries et mes innombrables séances d’écriture. À mes enfants, mes rayons de soleil. Merci à vous quatre pour votre patience et vos encouragements.
À Véronique Nicolaï pour sa précieuse lecture correctrice et sa grande connaissance orthographique. Quel talent ! Reconnaissance et amitié.
À Maud Peyraud, lectrice des premières heures et amie fidèle. Merci pour ton inestimable travail, ton avis et tes encouragements. Affection sincère.
À Erwan Le Pape, mon beau-frère, qui s’est mué en correcteur œuvrant même en Arizona, sur la Route 66, un manuscrit dans son sac Vieille et profonde amitié.
Sans oublier Céline Esperandieu et Sophie Larger et leurs crayons rouges qui m’accompagnent depuis des années. Gratitude et affection.
Un traquenard (nom languedocien) est un piège dont on se sert pour capturer les animaux nuisibles.
Personnages du roman
Les officiers français au passé impérial :
Belle-Rose :
âgé d’environ 35 ans, ancien lieutenant des
Marie-Louise
de 1814, dont il porte toujours la célèbre capote grise. Il devenu l’homme à tout faire du capitaine Jean-Baptiste Dumoulin.
Barbier-Dufay
: âgé de 52 ans, colonel mis à la retraite par ordonnance du 10 juillet 1816. Farouche bonapartiste, il n’hésita pas sous la Restauration à se battre en duel à plusieurs reprises contre des royalistes. C’est ainsi qu’en 1817, il tua en duel Saint-Morys et qu’en 1820, il blessa gravement le général de Montélégier.
Caron Augustin-Joseph
: âgé de 48 ans, lieutenant-colonel de dragon en retraite. Officier de la légion d'honneur, il a été compromis dans la conspiration du 19 août 1820, dite du Bazar français. Acquitté, mais mis en réforme sans traitement, il s’est retiré à Colmar.
Dentzel Jean-Chrétien Louis
: âgé de 36 ans, lieutenant-colonel de cavalerie en non-activité. Acquitté par la cour des Pairs, suite à la conspiration du Bazar français, mais depuis sévèrement surveillé par l’administration policière, il éprouve une antipathie réciproque envers le capitaine Jean-Baptiste Dumoulin, pourtant frère d’armes et allié politique.
Démoncourt Général Paul
: 51 ans, est un général français de la Révolution et de l’Empire. Au retour de l'île d'Elbe, il a soutenu avec succès le second blocus de Neuf-Brisach. Le nouveau pouvoir le mit à la retraite le 26 septembre 1821. Il s’est retiré près de Colmar. Ami du lieutenant-colonel Caron.
Dumoulin Jean-Baptiste
: 36 ans en 1822, officier d’ordonnance de Napoléon, rentier, demeurant à Paris. Fils d’un riche gantier de Grenoble, il s’est désintéressé en 1814 de l’entreprise familiale pour devenir un agent actif du retour de Napoléon exilé à l’île d’Elbe. Le 5 mars 1815, il organisa la chute de Grenoble. Napoléon en fit son officier d’ordonnance. Promu capitaine, Dumoulin fut blessé à Waterloo et capturé par les Anglais.
Dublar César-Brutus
: âge inconnu, sous-lieutenant démissionnaire et employé au Bazar français du colonel Sauset. Emprisonné pour sa participation au complot de Belfort, auprès du colonel Pailhès, dont il s’était constitué aide de camp.
Fabvier Charles-Nicolas
: baron impérial, âgé de 38 ans, négociant patenté et colonel en non-activité, demeurant à Paris, il est le type même du héros de la seconde génération des armées napoléoniennes et est devenu l’une des figures en vue du parti libéral, ami du général Lafayette.
Léon Charles
: âgé de 16 ans, fils bâtard de l’Empereur. Il fut le fruit d’une amourette sans importance de Napoléon avec Éléonore Denuelle, lectrice de Caroline Bonaparte. Napoléon montra de l’attachement pour ce fils aîné. L’un des articles du Testament impérial ajouta une somme de trois-cent mille francs au capital déjà placé au nom du jeune Léon.
Pailhès Antoine
: 43 ans. Baron impérial et colonel, mis en non-activité à la chute de Napoléon. Accusé d’être coupable de non révélation de la conspiration de Belfort et enfermé dans la prison de Colmar. Ami du lieutenant-colonel Caron.
Roger Frédéric-Dieudonné :
environ 40 ans
,
lieutenant à la retraite, ancien officier de corps francs et écuyer tenant un manège à Colmar.
Sauset Louis-Antoine
: baron impérial, 49 ans, colonel de la garde impérial et administrateur du Bazar français – une galerie marchande couverte par une verrière (une innovation pour l’époque) –, rue Cadet, n°11. Impliqué dans la conspiration du 19 août 1820, il a été acquitté par la Cour des pairs.
Les héroïnes du roman :
Augustine (La Renarde)
: 18 ans. Au service de Marie de Monlivo qui l’a arrachée de sa vie dissolue à Saumur.
Helena Caron
: 27 ans, originaire de Prusse et femme du lieutenant-colonel Caron, vivant à Colmar.
Louise
: fillette d’environ 8 ans, orpheline de Paris recueillie par l’inspecteur Eugène Chenard.
Marie de Monlivo
: âgée d’une vingtaine d’année, veuve du général de Monlivo mort dans un incendie à Saumur dont elle a hérité la fortune. Ancienne courtisane et ancienne maîtresse du capitaine Dumoulin qu’elle a rencontré en 1820 et dont elle a eu un enfant, Louisette, après leur séparation.
La baronne Pailhès
: mariée au colonel du même nom. Investie dans la cause de son époux, elle tente de trouver des alliés pour qu’il retrouve la liberté. C’est elle qui entraîne le lieutenant-colonel Caron dans la conspiration de Colmar.
Comtesse de Tantale
: âgée d’une trentaine d’années ; agent de la duchesse de Berry et maîtresse du capitaine Dumoulin qu’elle espionne à son insu.
Les membres de la police royale :
Eugène Chenard
: âgé d’environ 30 ans, inspecteur de police à la préfecture de police de Paris, rue de Jérusalem.
Achille Fleischmann
: Âgé d’une vingtaine d’années. Mulâtre originaire de Guadeloupe. Employé particulier du colonel à la retraite Ferier, puis, après l’assassinat de ce dernier, secrétaire de police à la préfecture de police, rue de Jérusalem, auprès de l’inspecteur Chenard.
Graville
,
Pierre Brinon
et
La Fouine
: auxiliaires de police auprès de l’inspecteur Eugène Chenard.
Alexandre Gauthier de Laverderie
: 29 ans, officier de la garde royale entraîné dans le complot du Bazar français et condamné à cinq ans d’emprisonnement. En décembre 1822, il s’est évadé de la prison de Sainte-Pélagie. En fuite. Il devient l’homme de main de la Comtesse de Tantale.
Thomas Rivière
: la quarantaine environ, archiviste de la préfecture de police.
Vidocq
: âgé de 47 ans en 1822, ancien bagnard devenu chef de la Sureté.
Les personnages politiques :
Le poète Béranger
(
Pierre-Jean de Béranger)
: 42 ans, chansonnier prolifique qui remporta un énorme succès à son époque.
La duchesse de Berry
: 24 ans. Veuve et mère du duc de Bordeaux, l’héritier de la couronne. L’homme de la famille royale, a-t-on écrit à l’époque. Par son intelligence et sa finesse, elle égaya la cour de la Restauration.
Benjamin Constant
: 55 ans, écrivain et homme politique, député libéral.
Maréchal Louis Davout
: 52 ans, chef des armées invaincu sous l’Empire. Bien que disgracié au moment de la Seconde Restauration, il put entrer à la Chambre des pairs en 1819, grâce à ses prises de position non ambiguës en faveur des Bourbons.
Le général Georges Lafayette
: 65 ans, général et député de la Sarthe, l’ancien marquis Gilbert du Motier de La Fayette, le « Héros des deux mondes », « l’homme de 1789 », l’inusable politicien, perpétuel étendard des mouvements antiroyalistes sous la Restauration.
Georges-Washington Lafayette
: 43 ans, fils du marquis et général Lafayette, militaire et homme politique français.
Jacques Laffitte
: 55 ans, banquier et homme politique. Député de Paris.
Louis XVIII
: 67 ans, Roi de France depuis la fin de l’Empire et son retour d’exil, frère puîné de Louis XVI.
Jacques Manuel
: 47 ans, avocat et homme politique libéral français. Grand orateur, ses opinions lui valurent beaucoup d'ennemis parmi les députés ultras.
Talleyrand (Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord)
: 68 ans ; le
Diable boiteux
. Pendant une cinquantaine d’années, l’ancien évêque et ministre impérial fut l’un des principaux personnages de la vie politique française.
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Chapitre 25
Chapitre 26
Chapitre 27
Chapitre 28
Chapitre 29
Chapitre 30
Chapitre 31
Chapitre 32
Chapitre 33
Chapitre 34
Chapitre 35
Chapitre 36
Chapitre 37
Chapitre 38
Chapitre 39
Chapitre 40
Chapitre 41
Chapitre 42
Chapitre 43
Chapitre 44
Chapitre 45
Chapitre 46
Chapitre 47
Chapitre 48
Chapitre 49
Chapitre 50
Chapitre 51
Chapitre 52
Chapitre 53
Chapitre 54
Chapitre 55
Chapitre 56
Chapitre 57
Chapitre 58
Chapitre 59
Chapitre 60
Chapitre 61
Chapitre 62
Chapitre 63
Chapitre 64
Chapitre 65
Chapitre 66
Chapitre 67
Chapitre 68
Chapitre 69
Chapitre 70
Chapitre 71
Chapitre 72
Chapitre 73
Chapitre 74
Chapitre 75
Chapitre 76
Chapitre 77
Chapitre 78
Chapitre 79
Chapitre 80
Chapitre 81
Chapitre 82
Chapitre 83
Chapitre 84
Chapitre 85
Chapitre 86
Chapitre 87
Chapitre 88
Chapitre 89
Chapitre 90
Chapitre 91
À paraître
Bibliographie
Chapitre 1
Colmar, hôtel « Des Six Montagnes Noires, le 1er juillet 1822
Immobile sur le seuil de sa chambre, Jean-Baptiste observait Augustine et Belle-Rose. Avec un plaisir évident, le duo jouait à un genre « d’attrape-moi si tu peux ! » aux règles assez floues avec Louisette qui, du haut de ses quinze mois, ne se faisait guère prier, courant de bras en bras, hurlant ou riant aux éclats au centre de la pièce, s’écroulant sur le tapis et se relevant pour repartir de plus belle.
« C’est mon sang, mon enfant, ma fille », se disait l’officier en ne la quittant pas du regard, cherchant à se troubler, à sentir battre son cœur paternel, hésitant lui-même à entrer dans le jeu enfantin, effort vain car quelque chose semblait l’en empêcher.
Aussitôt libérée des griffes du geôlier, Marie avait naturellement mis la fillette dans les bras de son père qui l’avait pressée contre sa poitrine, l’embrassant avec tendresse sur le front et sur les joues, sentant, découvrant l’odeur de sa peau. Mais Louisette s’était affolée et avait réclamé à grands cris sa mère, cherchant même à s’arracher de ces mains inconnues qui la tenaient maladroitement. Malgré la contrariété de la mère qui avait tenté d’insister, de rassurer l’enfant, l’homme n’avait pas été froissé, la réaction infantile lui paraissant naturelle – que signifiait sa personne pour ce petit être ? – ; et puis lui-même ne s’était-il pas senti à cet instant embarrassé, gêné, bien qu’en aparté, il se fût répété que cette magnifique demoiselle à la chevelure dorée identique à celle de sa maman était sa fille, le fruit de son amour avec la femme qu’il adorait ? Curieusement, et cela l’avait d’abord surpris, avant de le rendre amer, il s’était découvert comme étranger à son rôle de père, incapable de réagir, de faire face, malgré des efforts sincères. Avec effroi, tout le long de cette première journée, il lui avait semblé que la fillette le laissait indifférent, qu’elle lui faisait même presque peur. Pourtant il aimait les enfants. Ne s’occupait-il pas du jeune Charles Léon, depuis plusieurs semaines ? N’avait-il pas, l’année précédente et durant quelques mois, élevé, éduqué la petite préférée de Marie après leur séparation et sa disparition, cette fille de concierge dénommée elle-même Louise, dont la courtisane s’était attachée, lorsqu’elle vivait à Paris ?
Cette dernière pensée l’affola, car depuis il ignorait ce qu’était devenu cet enfant d’environ huit ans qui avait préféré traîner avec tous les garnements du quartier, plutôt que d’obéir au tuteur qui l’avait recueilli, jusqu’à fuguer sans ne plus donner signe de vie. Il était facile d’imaginer que Marie, qui n’ignorait pas que son ancien amant avait recueilli sa protégée, ne comprendrait pas cette absence inexpliquée, cette question sans réponse. Jean-Baptiste pinça ses lèvres de dépit. Marie, souffla-t-il dans un réflexe, se concentrant sur elle et réalisant qu’il lui suffisait de songer à elle pour se la représenter tout entière, magnifique, attirante...
En fait, il comprit soudain l’origine de son mal-être, voire peut-être de son indifférence paternelle : cela provenait d’elle, de Marie, de son soleil ! Il réalisait que depuis leurs retrouvailles, depuis la fin du duel avec son ravisseur, ils ne s’étaient regardés que succinctement et n’avaient échangé que des banalités. Autour d’eux – effet gênant – il y avait bien sûr La Renarde, Belle-Rose et Louisette, tout un petit monde qui les empêchait de se retrouver en tête à tête, alors qu’ils avaient tant de choses à se dire, tant de choses à s’expliquer depuis les évènements qui les avaient séparés, suite à l’échec de l’insurrection de Saumur.
Après la libération de Marie et de leur fillette, ils avaient fui la ville de Colmar avec armes, bagages et chevaux pour se réfugier dans un relais mi-ferme mi-auberge auberge, près de Brisach. La première journée avait surtout été monopolisée par La Renarde – une incroyable euphorie – qui couva de caresses et de paroles sa bienfaitrice et Louisette, Marie abusant de la situation, plutôt l’utilisant, car elle avait maintenu Jean-Baptiste à une certaine distance, ne lui jetant que des œillades furtives tandis qu’elle choyait sa dame de compagnie.
Après une nuit agitée et mauvaise, dans une chambre commune en compagnie de puces et punaises « sous-alimentées », le deuxième jour fut consacré au choix de la nouvelle destination, les hommes proposant de partir pour Paris et les dames exigeant de revenir à Colmar, car elles souhaitaient – Marie en tête – venir au secours de la famille Caron, malgré les dangers de la présence de l’inspecteur Chenard. Avec une autorité marquée, surprenante pour qui, tel le capitaine Dumoulin, avait connu la frêle courtisane qui œuvrait à Paris deux ans auparavant, madame de Monlivo avait imposé son point de vue, affirmant qu’elle avait été victime d’un enlèvement et non d’une arrestation, qu’ils ne risquaient rien s’ils restaient discrets, et surtout – centre du débat – que le lieutenant-colonel Caron avait besoin d’eux.
Arrivés clandestinement aux faubourgs de la ville à la fin de l’après-midi, ils s’étaient aussitôt rendus à l’hôtel « Des Six Montagnes Noires » où, bien accueillies, les dames avaient retrouvé leurs affaires et leur appartement, avant de réserver une chambre disponible pour leurs compagnons masculins. Après un passage apprécié dans les luxueuses salles de toilette, puis un repas pris au restaurant, la petite communauté ne s’était pas fait prier pour se réfugier tôt au fond des lits moelleux pour un sommeil réparateur, car la cavalcade des derniers jours et la mauvaise nuit de la veille avaient fatigué les corps et les esprits.
Huit heures trente tinta à l’horloge posée sur le rebord de la cheminée, un son clair qui perça en dépit des cris de Louisette qui s’échappait des bras joueurs de Belle-Rose. Après un coup d’œil sur le cadran, Jean-Baptiste quitta la chambre pour se diriger à pas lents vers celle de Marie. Après le passage du couloir sombre de l’étage, il s’immobilisa devant la porte close, le cœur battant fort, comme lors d’un premier rendez-vous, osant à peine respirer.
Que voulait-il ? Que cherchait-il ?
Après une rapide réflexion, il n’en sut rien, pensant avec agacement qu’il ne prisait guère la situation, sa vie amoureuse ne lui causant que d’éternels soucis. À l’annonce de la captivité de Marie et de sa fille, il avait écouté son cœur, fonçant brides abattues pour leur venir en aide, pour les sauver. Maintenant qu’elles étaient libérées, qu’il les avait enfin retrouvées, à sa grande surprise, il éprouvait de désagréables états d’âme souhaitant presque repartir pour Paris où ses affaires l’attendaient, se rappelant furtivement que quelqu’un, il ne savait plus qui, lui avait dit avec justesse qu’en amour la plus grande victoire, c’était la fuite.
Oui, fuir, retrouver le calme de Paris !
De fil en aiguille, il pensa à Léon qui devait se demander où était passé son maître d’arme et mentor, il songea ensuite, ce qui eut pour effet de lui serrer le ventre, à la comtesse de Tantale dont il était redevenu l’amant et qui elle aussi devait fulminer contre sa mystérieuse disparition.
Mordious ! Grande stupidité que cela, se dit-il en sentant une vague de sang lui monter aux joues, car il rageait contre sa propre faiblesse de toujours se précipiter contre le ventre de cette garce, à l’assaut de son mont de Vénus par lequel il semblait envouté.
Cherchant à remettre de l’ordre dans son esprit, son regard fixa devant lui la poignée cuivrée de la porte. Marie, souffla-t-il, un sourire naissant sur les lèvres, faisant défiler son image rayonnante et leurs souvenirs communs. Jamais il ne s’était senti aussi bien lorsque, rue du Sentier, ils vivaient ensemble. Oh ! Un joli petit couple ! Quel bonheur alors, lorsque, rentrant de la Bourse ou de ses réunions au Bazar français, il la retrouvait dans leur appartement où ils passaient leur temps à se taquiner, à se câliner, à s’aimer… Ah ! Marie, sa chère Marie, elle n’était que douceur, tendresse, avec un feu intérieur qui couvait et qui s’embrasait dans le secret de l’alcôve. Une sainte furie ! Une déesse ! Marie, répéta l’homme, je t’aimais comme jamais je n’avais aimé auparavant.
En ces temps là, il se souvint qu’il avait voulu être son Lancelot, son Tristan, ce héros de légende venu d’un pays lointain rien que pour elle.
Mordious ! Je l’aime toujours, s’avoua-t-il, le cœur battant fort.
D’une réflexion à une autre, l’homme fulmina contre l’organisation du complot du Bazar français, cause de leur rupture, de ce déchirement, de cette débâcle incompréhensible, de ce paradis perdu !
Et tant de chose avait changé depuis ! Marie surtout, médita-t-il en la revoyant presque méconnaissable à Saumur, lors de leurs retrouvailles, mère, mariée et encore plus superbe et désirable, mais en même temps si différente avec ses nouvelles manières, son instruction, sa position haute dans la société, son nouveau nom, la confiance en elle-même qu’elle dégageait. Aujourd’hui encore, elle confirmait et montrait une autorité qu’il n’aurait guère imaginée chez elle. Comme une parenthèse, Jean-Baptiste eut soudain une pensée pour son ami d’enfance, l’avocat Joseph Rey1, qui ne cessait de défendre cette théorie que l’éducation avait cette heureuse propriété de faire éclore et grandir les germes de nos facultés, de nos penchants, de notre caractère.
Peut-être, vieux frère, avais-tu raison, se marmonna l’officier avec une moue dessinée sur les lèvres. Un effet de la naissance de notre fille aussi ? ajouta-t-il, avant de se décider à frapper à la porte de la chambre, fatigué par ses propres réflexions, résolu à affronter son destin.
Un « entrez ! » engageant se fit entendre, le surprenant. Sur son visage pâle et nerveux, un muscle de la joue droite frissonna. Il respira profondément, puis pénétra dans la chambre.
En beauté dans une longue jupe bleue d’amazone et un corsage échancré de dentelle, madame de Monlivo se coiffait devant le miroir de sa table de toilette. Utilisant les reflets de la glace, les anciens amants se regardèrent, yeux dans les yeux, l’homme admirant les traits de son visage d’une extrême délicatesse, en dépit de sa cicatrice côté droit qui descendait du sourcil à la pommette en ceinturant l’œil, sans l’enlaidir un seul instant.
« Je t’attendais, annonça Marie, après avoir posé ses coudes sur les accoudoirs de son fauteuil, ce qui saisit Jean-Baptiste qui sentit rougir ses pommettes.
- Deux jours que je rêvais à ce tête-à-tête, murmura-t-il avec un tremblement dans la voix, après s’être raclé la gorge.
- Tu nous as sauvé la vie, jamais je ne l’oublierai, dit-elle en se retournant pour le regarder avec une profonde reconnaissance de ses yeux d’un bleu céleste. Augustine m’a raconté, poursuivit-elle en portant une main sur son cœur, que tu n’as pas hésité une seule seconde à quitter Paris.
- J’irais au bout du monde pour toi ! Plus même, en enfer !
- N’en fais pas trop, réagit-elle d’un ton sec. Je n’oublie pas les blessures que je te dois, précisa-t-elle, après un court silence, le visage transformé, son âme ayant brusquement subi un déferlement de vagues emplies de mauvais souvenirs.
- Parlons-en, veux-tu ? répliqua-t-il nerveux, saisissant là l’occasion qu’il espérait, entrant dans le vif du sujet, au cœur de leur histoire. Lors de la tentative de Berton, annonça-t-il d’un débit rapide, ne la laissant pas répondre, j’étais là et je suis venu à Saumur, chez toi, mais tu n’y étais plus, tu avais disparu…
- Je ne te crois pas, fit-elle en se levant avec un regard bleu sombre, le fixant avec un visage où couvait un début de colère. En revanche, au cas où tu l’ignorerais, j’ai bien reçu ta lettre !
- Cette lettre, ricana-t-il, mal à l’aise, tandis qu’il regardait le plafond après un petit pas en arrière pour éviter l’œil noir d’orage qui ne le quittait plus et songeant en aparté à la comtesse de Tantale et à son imagination macabre, à tout le mal qu’elle avait réussi à leur faire. Je sais, reprit-il, après une courte inspiration, que tu ne vas pas me croire, mais je te demande de m’écouter. Cette lettre ne t’était pas destinée, je te le jure sur tout ce que tu veux, sur mon honneur, ma vie. Elle était bien de ma main, mais…elle n’est d’ailleurs même pas de moi ! Jamais je ne serais capable d’écrire comme cela ! s’écria-t-il, marquant une parenthèse.2 Ah ! Comment te dire, c’est la femme à qui elle était destinée qui un jour m’a demandé de la lui écrire. Elle me l’a dictée. Croyant atténuer sa peine, j’ai eu la faiblesse de lui écrire, d’obéir à son vœu, quoique je jugeais le geste ridicule, mais…mais, à cet instant, elle pleurait…et je…j’avais… Ah ! enragea-t-il en serrant les poings, difficile à croire tout ce que j’essaie de te raconter, mais je te le jure ! Je te le jure sur ma vie ! Cette…cette gar… Enfin, elle a manigancé quelque chose d’inimaginable, un scénario gros comme un… un… Elle m’a piégé, trompé, alors que je voulais la quitter. Crois-moi, il n’y a pas un mot de vrai dans tout ce qu’elle a pu te raconter, car je sais qu’elle est venue te voir, que vous vous êtes battues, qu’elle a été blessée...
- Qui était-elle pour toi ? demanda Marie d’une voix de poitrine qu’elle ne se connaissait pas, signe d’une agitation intérieure, peut-être la nouvelle d’apprendre que la Comtesse de Tantale était vivante, qu’elle avait survécu au coup de couteau de La Renarde, espoir déçu, car la mort de sa rivale aurait rendu les choses plus simples, même si l’on était loin des pensées chrétiennes qui habitaient généralement son esprit.
- Je te l’avoue, souffla Jean-Baptiste avec un tremblement dans la phrase, tandis qu’il affrontait maladroitement le regard rivé sur lui, elle a été ma maîtresse. Après que nous nous fumes séparés, que nous nous fumes perdus, je l’ai rencontrée chez le banquier Laffitte et…
- Donc elle a dit certaines choses de vrai.
- Quoi ?
- Tu le sais parfaitement…
- Qu’elle m’aime ? Est-ce bien cela à quoi tu penses ?
- Entre autres choses.
- Sans doute…
- Elle est belle.
- Pourquoi me dis-tu ça ?
- Je dirais faux ?
- Non…
- Où est-elle en ce moment ?
- Pourquoi cette question ? Que veux-tu savoir ? Je me moque bien d’elle !
- Réponds-moi.
- À Paris.
- Tu la vois toujours ?
- Mordious ! Je la rencontre parfois dans le monde, mais cesse donc ces questions sans intérêt, réagit l’homme avec un sourire douloureux, fronçant les sourcils, embarrassé, craignant de dire la vérité, d’avouer qu’il fréquentait encore son lit. Veux-tu savoir si elle est toujours ma maitresse, si je partage ma vie avec elle ? Est-ce bien cela ? Eh bien, je te dis non ! annonça-t-il, la main sur le cœur, se jurant en aparté de ne plus jamais approcher la comtesse de Tantale, qu’à cette seconde, il lui disait la vérité, l’absolue vérité. Jamais plus il ne la toucherait !
- Je connais les hommes, murmura Marie, baissant la tête, j’ai vu que cette femme t’aimait, qu’elle n’abandonnera jamais. Sais-tu qu’elle m’a dit qu’elle était ta femme ? dit-elle en se redressant quelque peu, avec un regard triste.
- Ma femme ?
- Oui, ta femme devant Dieu, répondit-elle en se disant à part elle qu’il existerait peu de femmes au monde qui ne rêveraient pas d’être l’Omphale de ce bel Hercule qui se tenait devant elle, de son Jean-Baptiste, de cet homme si élégant, avec sa taille fine, ses yeux vifs et noirs, ses sourcils et ses cheveux bruns soyeux, avec son teint légèrement mat, sa belle figure, bref toute cette personne qui, exhalant comme un charme physique, mettait – si aisément et inconsciemment – les cœurs féminins en joie et les emportait irrésistiblement vers lui, elle la première.
- Une fabulatrice ! poursuivait-il avec un geste énervé de la main.
- Qu’importe au fond, sans doute beaucoup à sa place auraient agi de même…juste pour te garder.
- Que me racontes-tu ?
- Rien de bien important, annonça Marie à mi-voix, tandis qu’elle réalisait combien il serait dorénavant difficile d’aimer Jean-Baptiste, pourtant le père de sa fille, l’amant idéal, l’homme, l’unique qui avait fait battre son cœur comme jamais, et, malgré ses rêves, malgré ses espoirs les plus fous, bien qu’il vînt de les libérer des mains d’un fou, de les sauver, prouvant là son profond attachement, elle appréhenda d’un coup l’avenir avec lui, consciente de quel pouvoir possédait son ancien amant de la faire souffrir, voire de la briser. Oui, se dit-elle, convaincue d’être dans le vrai, leur histoire était terminée, il ne devait être plus qu’un étranger pour elle, oui, un simple étranger, car elle devait se protéger, protéger leur enfant. Lorsque nous nous sommes retrouvés à Saumur, demanda-t-elle d’une voix neutre, après s’être redressée, était-elle ton amante ?
- Oui, avoua-t-il, après une hésitation, s’effrayant de voir une colère sourde paraître sur ce visage aimé, la défigurant.
- Tu m’as menti alors ? susurra-t-elle. Pourquoi ? Moi-même, j’étais mariée…
- Je ne t’ai rien dit, c’est vrai et je le regrette, mais n’oublie pas que nous nous étions perdus de vue, que nos retrouvailles étaient plus qu’inattendues. Il y a eu l’effet de surprise, un mauvais réflexe, puis que...que…
- Que nous étions devenus des étrangers, souffla-t-elle avec un faible sourire et le regard perdu. Et peut-être que ton choix était fait ?
- Non !
- Si…
- Mordious ! Je n’aime guère notre saloperie de discussion, jura-t-il dans une réaction de colère, intérieurement affolé de l’issue du débat qu’il imaginait de plus en plus catastrophique avec la perte de son amante, leur adieu définitif, alors qu’il sentait qu’il ne pourrait plus se passer de la voir, de l’entendre, de vivre auprès d’elle, que sans tout cela – il en était convaincu ! – la vie n’aurait plus pour lui aucun sens, aucune saveur.
- Que souhaites-tu ? » réclama-t-elle d’une voix sans force, la main serrée contre sa poitrine, songeant avec une ironie amère qu’il y avait une heure à peine – sotte qu’elle était ! – elle s’était sentie pleine de confiance, presque étourdie, après une nuit reposante et réparatrice. Il, « lui, son unique et seul amour », était revenu ! Il était auprès d’elle ! »
Et elle avait délicieusement rêvé à lui, imaginant son visage qui se pencherait vers le sien, après une si longue attente, et qui l’embrasserait à nouveau avec fougue et passion, imaginant ses mains qui la prendraient contre lui, oubliant tout le reste, voyant le monde plein d’amour, la vie pleine d’espoir.
- Crois-tu vraiment que l’un a trahi l’autre ? s’agaça l’officier. N’avons-nous pas été plutôt victimes des aléas de la vie ? D’un manque de chance ?
- M’as-tu un jour aimée ? demanda-t-elle d’une voix glaciale.
- As-tu besoin d’une réponse ? rétorqua-t-il, l’âme blessée, et, devant tant d’incompréhension, il sentit en lui une vive colère qui lui souleva les côtes et qui battit à grands coups de marteau dans ses tempes. Je peux comprendre que tu aies été malheureuse, annonça-t-il avec un mélange de rage et d’amertume, mais il me semble que ton chagrin, ton courroux, ta rancœur t’empêchent de voir beaucoup de choses sous leur vrai jour. Je n’ai jamais voulu te perdre ! Je n’ai voulu que notre bonheur, que ton bonheur !
- Mais tu m’as perdue…
- J’ai été misérable et je m’en veux encore ! Jamais je n’aurais dû te laisser partir et nous n’aurions jamais dû nous laisser emporter par notre fureur, nous parler comme nous l’avons fait…
- Avec nos caractères, je crois que les choses se reproduiraient de la même manière, livra la dame, comme une évidence, d’un ton conciliant qui dévoilait une accalmie dans sa pensée, avant de lui sourire avec un semblant de tendresse ; puis, parce qu’elle souhaitait marquer une pause dans ce face-à-face douloureux, auquel elle ne savait plus quelle conclusion donner, elle alla s’asseoir à une table ronde en acajou au milieu de la chambre. J’aimerais boire », dit-elle en montrant du regard une carafe posée sur sa table de nuit à Jean-Baptiste qui ne la quittait pas des yeux, incrédule.
Dans un silence particulier où chacun s’observait du coin de l’œil, l’officier s’empara du plateau et vint rejoindre madame de Monlivo, qui d’un signe de main, l’invita à occuper la chaise en velours vert et or à côté d’elle. Après réflexion, il s’y assit avec une pointe de lassitude, fit glisser un verre vide devant elle, avant de le remplir d’eau fraîche. Dans ce mouvement, son coude frôla involontairement le sein de la jeune femme, ce qui le troubla. Nerveux, il voulut capter le regard de Marie, mais elle ne bougea pas, se contentant, une fois servie, de boire une gorgée, les yeux fixes devant elle. Profitant de cette attitude, Jean-Baptiste l’observa. Elle avait changé, ses traits s’étaient durcis. Elle avait en fait perdu le côté enfantin et charmant qui lui restait lorsqu’ils s’étaient rencontrés, l’été 1820, mais ce détail l’embellissait d’avantage, sa beauté s’étant seulement mûrie, achevée, ce qui la rendait toujours plus désirable. Poussé par ce feu intérieur qui croissait, il eut la tentation de l’enlacer, de l’embrasser dans le cou, mais sut que ce geste serait folie et qu’il s’exposerait à une scène qui provoquerait sans doute une cassure irréversible. Il tressaillit. La cuisse de Marie s’appuyait à la sienne, plutôt la frôlait, comme une subtile caresse. Ne sachant qu’en penser, Jean-Baptiste n’osa plus bouger, respirant à peine, d’autant plus qu’il lui semblait même que la pression se faisait plus intense. Sans se risquer à regarder son ancienne amante de crainte qu’elle ne s’interrompît, il joignit les mains en prière et posa ses poignets sur le rebord de la table afin qu’elle ne remarqua pas qu’il tremblait d’émotion. À son tour, la jeune femme en profita pour contempler le profil de son compagnon, se gavant de sa belle figure, de cet indiscutable charme qui l’avait perdue. Du bout de ses doigts, l’imagination agitée, elle arrangea ses cheveux, avant de s’interrompre, dubitative. Cherchait-elle à se faire plus coquette ? Pour qui ? Pour Jean-Baptiste ? Qu’est-ce qui lui prenait ? Ne devait-elle donc pas le rejeter de toutes ses forces ? Tandis qu’elle le regardait toujours du coin de l’œil, des flots de pensées amères tourbillonnèrent dans sa tête. Cet homme qu’elle adorait toujours, cet homme dont elle attendait sans doute un mot pour se jeter à ses genoux, cet homme ne l’avait-il pas trahie ? Elle se gourmanda ; elle n’arriverait jamais à se séparer de cette propension à se perdre dans d’éternelles réflexions contraires qui ne lui apportaient que peu de chose, surtout qu’elle sentait que son corps la trahissait. Si proche de Jean-Baptiste, il retrouvait la mémoire, s’échauffant. Et elle fulmina contre ce sein qui s’était durci au simple contact de son coude ou contre cette cuisse qui ne pouvait s’empêcher d’effleurer celle son ancien amant. Dans un réflexe d’autodéfense, son esprit chercha un motif qui empêcherait ses sens de la livrer, d’affaiblir sa volonté.
« Où est Louise ? demanda-t-elle à mi-voix.
- Je ne sais pas, répondit l’officier du même ton, après s’être dit, le cœur serré, sans espoir, que la fin de leur histoire était proche. Je sais que tu l’adorais, poursuivit-il, souhaitant crever cet abcès qui couvait depuis trop longtemps. J’ai tout fait pour lui proposer une vie confortable, pour l’élever, mais elle n’était pas d’un caractère facile, cette petite fleur, et préférait souvent s’échapper pour traîner dans les rues de Paris avec des vauriens de son âge.3 Une attraction naturelle. Un jour, elle n’est pas revenue. Je t’avoue que j’en ai été mortifié, car que tu le croies ou non, je l’aimais cet enfant.
- Tu as sans doute fait ce que tu as pu, parla Marie, surprenant l’homme qui sourcilla.
- Et tu ne m’en rends pas responsable ?
- En aurais-je le droit ? Tu l’as recueillie, alors que tu n’étais pas son père ; tu l’as fait en souvenir de moi, mais ton geste fut admirable, plein de bonté. Néanmoins elle est partie ; un jour, j’espère qu’elle nous l’expliquera, car je la retrouverai.
- Je…je suis surpris par ce que tu me dis…
- Croyais-tu que j’allais te maudire pour l’avoir une nouvelle fois perdue ? demanda-t-elle avec un demi-sourire.
- Oui.
- Hier peut-être, mais aujourd’hui, je n’en ai plus envie », murmura-t-elle, tandis que l’officier sentit la main de la jeune femme qui venait de saisir la sienne.
Elle la serra tendrement, d’un mouvement simple, sans équivoque, comme pour le remercier d’une multitude de choses, comme peut-être pour renouer une ancienne complicité qu’elle sentait renaître. Même s’il en était ému et si une chaleur soudaine empourprait ses joues, Jean-Baptiste ne remua pas un cil, n’osant plus la regarder de crainte qu’elle n’interrompît son geste.
« Qu’allons-nous devenir ? lui demanda-t-elle dans un souffle.
- Je t’aime, Marie.
- Non, plus jamais cela, réagit-elle agressive, le lâchant brusquement, avant de se reprendre. Non, plus jamais, répéta-t-elle d’un ton plus rapide, avant de se lever avec l’attitude d’un être affolé, une main devant ses lèvres.
- Je ne te mens pas, je t’aime, insista Jean-Baptiste en la rejoignant.
- Tu ne me toucheras plus jamais, annonça-t-elle en oscillant de la tête, les muscles tendus, tandis que sa main lui faisait signe de reculer. J’ai trop souffert ! avoua-t-elle, l’œil humide. Je ne veux plus de tout cela ! Et qui me dit que tu ne me mens pas, que tu ne m’as pas raconté n’importe quoi, que cette horrible femme ne disait pas vrai ?
- Tu sais que je ne t’ai pas menti.
- Tu ne me toucheras plus jamais ! Je ne veux plus de tout cela ! Je veux rester seule ! Loin de tout amour !
- Crois-tu que c’est la bonne solution ? demanda-t-il, après un pas en avant, et, dans un réflexe affectueux, il la prit par les épaules, avant de la serrer contre lui, convaincu que ni l’un ni l’autre ne pourraient résister plus longtemps aux exigences de leurs corps, qu’ils s’aimaient, parce que cela était gravé dans la pierre, dans leurs cœurs, un sentiment ineffaçable.
Le front contre sa poitrine, Marie se laissa faire et ne bougea plus, malgré une respiration vive. Agité, ému, Jean-Baptiste frissonna, avant d’oser glisser une main impatiente sous ses habits et de retrouver un sein toujours familier, malgré le temps écoulé. Excité, il le caressa délicatement jusqu'à ce que la pointe devînt dure. La dame gémit doucement, avant de réagir, effectuant un geste rapide qui surprit l’homme, car il sentit sur son cou une lame acérée qu’elle avait fait jaillir d’un endroit secret de sa robe.
« Mordious ! Qu’est-ce ? Tu portais une arme ? dit-il d’une voix aigre, perplexe, et il arrêta de bouger, essayant de comprendre le comportement de son ancienne amante, n’osant croire qu’elle s’était méfiée de lui et qu’elle pourrait maintenant le blesser, le tuer peut-être.
De son côté, l’incrédulité rida vite le front de Marie. Qu’était-elle en train de faire ? Mon Dieu, ce que la situation était devenue grotesque ! Poussée par ses souvenirs, par une blessure d’âme jamais cicatrisée, voire par le relent de haine qu’elle avait dû éprouver, elle avait eu un réflexe effroyable alors qu’elle ne rêvait que de retrouver la peau douce et chaude de cet amant perdu. La rage amena les larmes aux yeux de la jeune femme. Que pouvait-elle faire maintenant ? Comment pouvait-elle s’en sortir ? De quoi surtout avait-elle envie ?
Une lueur brilla au fond de son regard azur. Soudain elle sut. Oui ! Maintenant elle savait ! Tout en maintenant la pression de la lame, elle déboutonna d’un coup sec la chemise de Jean-Baptiste pour permettre à ses lèvres avides et tremblantes, puis à sa langue de parcourir fiévreusement son torse, y laissant une trace humide et douce. Malgré un cœur qui tambourinait contre ses côtes, l’amant resta confondu et silencieux.
« Tu ne me toucheras plus, répéta-elle d’un ton ferme, lui jetant une œillade mauvaise, avant d’accentuer le poids de son arme pour le faire reculer à petits pas, jusqu’à son lit.
Jean-Baptiste se laissa tomber dessus, sans résistance, espérant, rêvant plutôt à la scène qui se devinait dans l’éclat azur des yeux de Marie. Sans tarder, avec une lenteur calculée, elle se hissa sur son corps, après lui avoir fait comprendre d’un mouvement de couteau d’ouvrir ceinture et pantalon, volonté qu’il accomplit avec des gestes vifs, mais contenus, se dévoilant entièrement et lui révélant ses dispositions, tandis qu’elle-même retroussait sa robe, impatiente. À peine un dernier regard et, palpitante, elle se positionnait sur le bas-ventre de son amant qui gémit, avant de se contenir de crainte d’un retour en arrière. Les paupières mi-closes, la dame sourit et laissa apparaitre l’éclat vif de ses dents blanches. Elle replaça la lame de son couteau sur la gorge de son partenaire, puis se mit à remuer doucement, imposant son rythme. Excité par le froid du métal sur sa peau, Jean-Baptiste respirait à peine, s'efforçant à la plus complète immobilité. Le fixant droit dans les yeux, Marie haletait de plus en plus.
« Je ne veux plus que tu me touches ! », lui répéta-t-elle.
- Oui, souffla-t-il.
Les mouvements souples des hanches de Marie s'accélérèrent. Abandonné, le couteau glissa sur le drap. Dans un réflexe, les mains humides des amants se saisirent pour ne plus se lâcher. Leurs lèvres se joignirent à leur tour. Graduellement les gestes gagnèrent en force. Et d’un coup, comme attendu, un long et doux gémissement s'échappa de la gorge de Marie, la rendant un peu plus superbe, tandis que Jean-Baptiste se cambra dans un brusque et ultime sursaut, serrant la mâchoire de plaisir, ridant son front et le contour de ses yeux. Suivi un soupir où la jeune femme s'abattit sur l’homme, plaçant son visage au creux de son épaule.
« Je t’aime… » chuchota Jean-Baptiste, avant qu’une main ne se plaquât sur sa bouche, le contraignant au silence.
1 Joseph Rey, fils d’un négociant de Grenoble, est né en 1779. Après la Révolution, il fit ses études à Paris et devint avocat. Sa carrière de magistrat débuta à Plaisance en 1807. Sous la première Restauration, il fut nommé président du tribunal de première instance à Rumilly dans le département du Mont-Blanc. Le retour de Napoléon lui fit écrire son « Adresse à l’Empereur », un discours de cinquante lignes qui fut imprimé en deux heures et à vingt mille exemplaires et que tous les Grenoblois ont pu répéter à Bonaparte lors de son entrée dans leur ville. Joseph Rey osait dire à l’Empereur que : « La France l’aimait comme un grand homme, l’admirait comme un savant général, mais ne voulait plus du dictateur qui, en créant une nouvelle noblesse, avait cherché à rétablir tous les abus presque oubliés ».
Après les Cent-Jours, il fonda à Grenoble une société secrète L’Union. Ce fut une des premières organisations secrètes libérales de la Restauration. Trait essentiel, L’Union ne possédait pas les caractères d’un groupe de conspirateurs constitué en vue d’une action violente. Il s’agissait d’une organisation d’élite qui avait pour objectif de propager les principes libéraux et de créer une force agissant légalement mais qui s’opposait au Gouvernement et à sa politique de « compressions » du pouvoir. L’action concrète de L’Union se résuma à une influence sur la presse, la tribune législative, le barreau ou l’instruction publique. De hautes personnalités en furent membres, Lafayette, Voyer d’Argenson, Dupont de l’Eure, Corcelles père, le général Tarayre, l’avocat Mérilhou, Victor Cousin…
Les évènements politiques de l’année 1820 précipitèrent Joseph Rey dans la préparation du complot du 19 août 1820. Son ami d’enfance Jean-Baptiste Dumoulin en fut vraisemblablement le lien.
2 « Le Charbonnier – Deuxième partie – Le général Berton » de Frédéric Preney-Declercq.
3 « Le Charbonnier – Deuxième partie – Le général Berton » de Frédéric Preney-Declercq.
Chapitre 2
Colmar, 1er juillet 1822, quelques heures auparavant
Le jour se levait à peine. La main d’Helena Caron, fine et blanche, écarta le rideau brodé de la fenêtre du salon. Ses traits tirés trahissaient une nuit courte et mauvaise. Après un léger bâillement, la dame jeta un coup d’œil dans son jardin fleuri où l’on entendait déjà les gazouillis et les roucoulades des oiseaux. Elle sourit de ce plaisir simple avant de se retourner vers son époux qui, au milieu de la pièce, enfilait sa veste, prêt à sortir.
« Prends bien garde à toi, Augustin, lui souffla-t-elle en réajustant sa cravate noire, après l’avoir rejoint.
- Oh ! Rien d’alarmant, mon doux bonheur, répondit-il d’un ton badin qui se voulait rassurant, tandis qu’il se laissait faire, le menton haut. Que te dire ? Ce n’est qu’un dernier rendez-vous, bien à l’abri dans la forêt, loin d’hypothétiques judas. Tu peux aller te recoucher, il est tôt…
- Françoise4 t’a-t-elle dit que deux soldats en vestes bleues et pantalons rouges sont venus te demander hier ?
- Oui, elle m’en a fait part, mais j’ignore qui étaient ces gaillards. Étrange d’ailleurs… Sans doute, le sergent Magnien avec un comparse de son régiment. Je l’avais prié de me porter une trentaine de boutons ronds pour mettre sur mon uniforme en remplacement de ceux à l’empreinte de la fleur de lys. Enfin, si cela était le motif, curieux qu’ils n’aient pas laissé un paquet.
- Fais vraiment attention à toi, méfie-toi de tout le monde, dit Helena, nerveuse. Fuis au moindre soupçon !
- Penserais-tu, mon amour, que j’aurais fait une faute d’accepter ce commandement d’insurgés ? demanda-t-il d’une voix teintée d’ironie, bien que son cœur sautât entre ses côtes car l’épouse venait de raviver le feu de ses propres craintes.
- Je ne sais plus, je ne sais pas, gémit-elle, avant de l’enlacer étroitement. J’ai peur depuis que je sais ce que tu tentes. À la pensée des risques que tu prends, je tremble et je me sens comme une vieille femme apeurée, dont la seule ressource serait les larmes, car impuissante à t’aider…
- Mon amour, je comprends tes craintes, souffla-t-il en la serrant un peu plus fort, dissimulant un air mortifié. Le doute est naturel, reprit-t-il, après avoir pris le visage aimé entre ses mains, et il n’y a que les sots qui ne le subissent jamais. Moi-même, je t’avoue que parfois je me sens las de cette aventure. Mais aujourd’hui, après mures réflexions, la chose est figée, j’en suis convaincu, et c’en serait une plus grande faute d’en revenir. J’ai d’ailleurs donné ma parole à tous, j’ai engagé mon honneur. Oui, dit-il avec fermeté, répétant les paroles du capitaine Duclos, le vin est tiré ; il faut boire le calice jusqu’à la lie. Vaincre ou mourir ! Et nous vaincrons ! Crois-moi ! Fais-moi confiance.
- Ja ! Je lutterai à tes côtés, je suis avec toi et je sais que tu as raison, murmura-t-elle, s’efforçant de lui apporter de la confiance. N’écoute plus mes états d’âme de vieille femme, ajouta-t-elle avec un rire sans joie. Je suis sotte ! Depuis que nous vivons ensemble, ne m’as-tu pas assez répété qu’il ne fallait jamais se faire du mauvais sang pour des broutilles ?
- Tu n’es pas sotte et je t’aime, madame Caron. À tes côtés, je n’ai connu qu’un bonheur sans nuage. Tu es mon soleil, mon étendard, tu es mon plus parfait, mon plus fidèle compagnon, tu es ma vie. Je triompherai pour toi et notre fils.
- Doux Jésus, si tu pouvais imaginer comme mon cœur est rempli de toi et par conséquent, comment et combien je tremble pour toi…
- Songe que je le sais, lui dit-il, les yeux brillants d’émotion, et il l’embrassa sur le front, avant de sentir un frisson d’angoisse le parcourir comme une fièvre, car, malgré lui, il venait d’imaginer son possible échec. Je triompherai pour nous deux ! » annonça-t-il avec force en se redressant avec un air déterminé, farouche.
Mais en dépit du message qu’il tentait de faire passer, il vit les lèvres de sa femme trembler et les larmes couler de ses grands yeux noirs. Tandis qu’un poids écrasait, maltraitait son âme agitée, l’homme la serra à nouveau contre sa poitrine, avec le souhait fort de la rassurer. Il voulut parler, lui répéter que tout irait bien, mais plus aucun son ne voulait sortir de sa gorge. Avec dérision, l’officier songea qu’autrefois, il était connu à l’armée pour ses brillants discours d’avant-bataille, où chaque fois et sans effort, des mots justes se pressaient à ses lèvres, abondants, plus prompts que sa pensée, des propos qui emballaient ses cuirassiers, même les plus novices, faisant fuir leur peur de la mort et emplissant leur cerveau d’une excitation terrible, presque fanatique. Foutredieu ! Où était donc passé ce don qu’il avait cru inné ? jura-t-il à part lui, tandis qu’il sentait ses muscles se contracter.
« Mon cœur, je t’en prie, supplia-t-il d’une voix tremblotante, avouant là sa propre détresse.
- Allez faire votre devoir, colonel, dit-elle en se redressant d’un coup, le vouvoyant, avant de le pousser avec autorité vers l’extérieur, après que leurs regards, chargés de sentiments, se furent fixés l’un l’autre, l’espace d’une seconde.
L’esprit en désordre, car le lieutenant-colonel Caron avait lu sur le visage de sa femme la lutte qu’elle livrait à elle-même, il obéit et referma la porte sans se retourner.
L’air frais du matin le saisit. Après deux pas, il s’arrêta, respira à pleins poumons et promena à la ronde son regard, espérant s’éclaircir les idées. Le sort en est jeté ! se murmura-t-il, la pâleur aux lèvres et les dents serrées, avant de reprendre son chemin, non sans une dernière hésitation.
De son côté, l’œil fixé sur la serrure, la dame eut un tremblement de tous ses membres, car une affreuse pensée venait de lui glacer les sangs. Dans un réflexe, sa main saisit la poignée de cuivre, avant de s’arrêter. Et s’il ne revenait plus vivant ? Si elle ne le revoyait plus jamais ! Et elle sentit ses yeux se voiler et ses tempes battirent violemment. Il lui sembla même que le sol bougea sous ses pieds. Elle eut envie de courir après lui, de s’accrocher à son cheval dont elle venait d’entendre le martèlement des sabots sur le pavé, de le forcer à tout abandonner. Ja ! Elle lui hurlerait qu’ils étaient heureux comme ils étaient, qu’il ne fallait plus tenter le sort, risquer sa vie, leur bonheur, qu’il était père et qu’il avait un enfant à élever, un fils dont ils étaient si fiers, de lui expliquer en fait que tout était bien simple, oui, simple, que leur histoire était belle et qu’ils devaient se trouver heureux et contents, oui, heureux et contents…
Elle renifla et lâcha d’un coup la poignée. Puis se redressant de tout son long, elle repoussa avec vigueur toutes ses pensées décousues, avant de sécher ses larmes et de chercher à calmer les battements désordonnés de son cœur.
Plus tard, plus tard, se dit-elle alors en se dirigeant vers le salon, oui, à son retour, car Augustin reviendra. D’abord, retrouver mon calme, oui, mon calme…
-
Sur la route de Brisach, parvenu au croisement de la vieille croix de pierre d’où partait un sentier menant à la forêt qui ceinturait Colmar, Augustin Caron tira sur le mors, avant de se pencher pour flatter l’encolure de son cheval – un magnifique courte-queue noir – qui répondit par un hennissement étouffé, avant de s’ébrouer quelque peu. À l’arrêt devant le calvaire, l’officier se dressa sur sa selle et fit un tour d’horizon, avant de regarder sa montre à gousset. Sept heures dix minutes ! Foutrement en avance ! jura-t-il sans ciller, avant de respirer à pleins poumons.
Sa main se porta sur sa poitrine. Son cœur battait fort contre ses côtes. Helena, songea-t-il d’un air chagrin, car il réalisait que sa femme n’avait pas quitté ses pensées une seule seconde depuis son départ. Comment pourrais-je oublier ce qui fait ma vie ?
Le visage de l’être aimé se dessina dans sa pensée. La voir, l’entendre, vivre auprès d’elle, la vie n’avait pas pour lui d’autre sens, et cela depuis longtemps, si longtemps. Helena était sa religion, son culte. N’avait-il pas traversé la Prusse pour elle ? Il l’avait enlevée aux siens, après lui avoir juré de l’aimer toujours, d’assurer son bonheur, de la protéger... Avait-il respecté sa promesse ?
Reprenant un à un les souvenirs de leur vie, il revit tous les gestes, toutes les paroles, toutes les attitudes d’Helena, sa beauté naturelle, sa silhouette, sa chevelure douce, son léger accent germanique, son esprit fin, sa joie quotidienne.
Pardieu ! songea-t-il béat, tandis que ses yeux se perdaient dans le ciel. Une merveille ! Oui ! Quelle femme admirable ! La mienne ! Mon amour, mon astre… Et cela n’était pas fini, cela ne faisait que commencer !
Plein de ces observations, Caron gloussa quelque peu, car son cœur se pâmait littéralement aux visions d’avenir qui prenaient corps dans son imagination, à tous les chemins heureux qu’ils sillonneraient encore, à tous les plaisirs qu’ils éprouveraient toujours, l’un contre l’autre. S’aimer à la folie ! Car ils étaient encore assez jeunes ! La quarantaine ! Oui, vivre pour eux-mêmes, rien que pour eux-mêmes, ne plus se quitter, voyager, visiter, s’aimer sur des terres inconnues !
Et d’un coup – effet contrariant – l’officier en vint à songer au pourquoi de sa sortie équestre. L’évasion de Pailhès, les escadrons à soudoyer, l’heure de la bataille toute proche, la prise de Colmar. N’était-ce pas tout ce qu’il avait souhaité ? Tout en caressant l’encolure de sa monture qui battait le sol d’un pied nerveux, Caron eut un sourire contrit. Pourquoi ressentait-il cette sorte de désespoir ? La veille encore, n’était-il pas persuadé de la réussite de son projet ? Helena ? Était-ce donc les craintes, les peurs de sa femme adorée qui lui ramollissaient l’âme ? Un peu sans doute, mais il réalisait que lui-même percevait depuis longtemps de l’appréhension, que beaucoup de détails le dérangeaient. Pourquoi déjà, lui, soi-disant l’âme du complot, avait-il la sourde impression de ne rien contrôler, d’être parfois porté par un mouvement collégial ? Pourquoi ce rêve étrange, la nuit, plutôt cette certitude inexplicable, fugace, que ce qu’il commandait lui était soufflé par un autre ? Songeant aux semaines passées, il vit la première visite de la baronne Pailhès avec la volonté de sauver son époux inculpé dans l’affaire de Belfort, son appel à l’aide, et s’interrogea comment, d’une simple évasion, il en était venu à organiser, plutôt à participer à un pronunciamiento à la Riego ? Que s’était-il passé ? De simples rencontres, d’abord le sergent Delzaive présenté par Roger, puis les venues de Gérard, Thiers, les sous-officiers de chasseurs, le sergent Magnien, ensuite le capitaine Duclos, un brave…en fait, un enchaînement de rencontres, un pur hasard, des idées communes, proches, vraies, des destins qui s’étaient croisés et une voie impériale qui s’était dessinée avec le dessein fou de renverser le Bourbon.
Pardieu ! s’écria-t-il, tandis que sa monture tendait l’oreille, surprise par le juron de son cavalier. Que m’arrive-t-il donc ? Foutre ! Et refoutre ! Que suis-je en train de faire ? De décider ? D’entreprendre ? Est-ce folie ?
Là-dessus, un violent combat se livra dans son esprit. Durant de longues secondes, l’officier maugréa, pesta, marmonna tout bas, incrédule de son état, finissant par se fixer sur cette vague impression, cette sensation désagréable, presque la certitude d’avoir déjà vécu la même chose, d’une manière ou d’une autre et d’en prendre garde. La trahison de ce chien de « de l’Etang », est-ce cela ? se dit-il, revivant son emprisonnement et son passage devant la Cour des pairs.5 D’un geste fébrile, il fouilla son col pour s’emparer d’un médaillon suspendu à son cou qu’il embrassa religieusement.
Helena, oui, ma Helena. Comment, ai-je pu tarder à prendre une telle décision ! C’est toi que je choisis. Bien sûr ! C’est ta vie que je dois protéger. Tes craintes te donnent raison. D’ailleurs, tu m’éveilles et je le sais depuis le début, pauvre imbécile que je suis : je n’aime guère la façon dont se présente cette affaire ! Oui, tu as raison de craindre quelque chose de funeste ! Je me refusais à le dire, à le croire, mais je me sens seul dans ce tumulte, dépendant de gens que je ne connais pas ! La raison, la méfiance, mon instinct me dit d’annuler ce projet trop dangereux pour moi et ma famille, pour mes amis aussi, pour Pailhès et Dublar ! Oui ! Je me refuse à causer leur perte ! J’en ai le devoir !
Caron en était là de ses réflexions lorsqu’il crut percevoir un hennissement lointain, suivi d’un son de voix étouffé. Instinctivement il eut la déplaisante sensation que des yeux invisibles le fixaient quelque part. Tournant la tête, il embrassa les alentours d’un coup d’œil. Personne. D’un coup de talons, il fit faire à son destrier le tour de la vieille croix de pierre, tout en scrutant le moindre relief, debout sur ses étriers. Rien non plus. Il lança son cheval droit devant, vers l’orée de la forêt, avant de s’immobiliser et d’observer l’épaisse végétation. Tout paraissait tranquille. L’officier se rassit sur sa selle et se dit que son imagination lui avait joué un tour. Il chercha sa montre dans la poche de son gilet. Sept heures trente cinq ! L’heure du rendez-vous était proche. Quelle était sa décision ?
Pour la première fois depuis longtemps, en fait depuis sa campagne espagnole, Caron eut dans les veines un froid que donnait un péril inconnu, mais que l’on sait dangereux, proche et réel. Par effet d’idées, il se souvint de cette mauvaise impression d’isolement en Espagne, sur cette terre hostile et meurtrière. Un véritable enfer !
Pardieu ! jura-t-il en tressaillant, se ressaisissant, je n’en suis plus là à craindre le piège fatal de ces chiens de manolos, dans ce foutu pays qui était le cul du monde !
Il ricana de son humeur déconcertante, avant de se répéter que sa décision était prise et qu’il avait raison d’abandonner ce projet insurrectionnel. Son cheval fit quelques pas vers des feuilles tendres à sa hauteur. Comment allaient réagir ses complices ? s’inquiéta-t-il en tendant ses brides. Pourraient-ils comprendre ? Devait-il craindre leur violence ? Devait-il plutôt fuir ? Fuir ! Non, ce n’était guère dans ses habitudes. Il irait face à ses complices. Il lui suffirait de se montrer habile, beau parleur et meneur d’hommes pour leur faire abandonner ou remettre à plus tard un projet trop incertain.
Refusant de se tordre l’esprit un peu plus, le lieutenant-colonel Caron donna un coup de talon dans les flancs de son cheval et s’engouffra dans la profondeur de la forêt. Oui ! Sa décision était prise ! Ferme et définitive ! Quels que soient les états d’âme de certains, l’insurrection ne se ferait pas !
4 Françoise Girardin, jeune fille qui était employée dans la maison occupée par la famille Caron. « Procès d’Augustin-Joseph Caron, lieutenant-colonel en retraite ; traduit devant le 1er Conseil de Guerre Permanent – Jean-Henri Heitz, imprimeur-libraire ; audience du 21 septembre 1822, témoin Girardin (Françoise), jeune fille servant dans la maison occupée à Colmar par l’accusé Caron. »
5 « Le Complot du Bazar français – Deuxième partie – Août 1820 » de Frédéric Preney-Declercq.
Chapitre 3
Forêt des alentours de Colmar, 1er juillet 1822
Tandis que le cheval du lieutenant-colonel Caron avançait le long d’un sentier serpentant entre des arbres moussus et des halliers fleuris vers le lieu discret où l’attendaient ses faux complices insurrectionnels, deux ombres sortirent d’un abri végétal – hommes aux visages graves qui dardaient sur le cavalier un regard sombre et affairé –.
« Foutre ! J’ai bien cru qu’il allait faire demi-tour, parla le plus avancé des deux, un individu sans âge, avec un profil de carpe sur un long corps sec, vêtu d’un uniforme de chasseur, avant de ricaner, signalant là un signe de nervosité, la fin d’une inquiétude.
- Ouais, j’avoue que moi aussi, dit l’autre d’un ton neutre, bel homme, la trentaine, barbe courte et chevelure blonde, en tenue d’officier, ses yeux bleus toujours fixés vers le passage où avait disparu le dénommé Caron. Mais peut-être aurait-il dû, ajouta-t-il dans un murmure, se parlant à lui-même.
- Morbleu ! Que dites-vous ? s’étonna l’acolyte d’un ton frisant l’insolence.
- Rien, répondit le second sans ciller, encaissant calmement l’agressivité verbale de son subordonné.
- Oh ! Oh ! Oh ! (sur trois notes) Douteriez-vous de notre glorieuse mission, monsieur Duclos ? poursuivait le premier, tandis qu’une joie enfantine allumait son regard, car il prisait enfin de pouvoir rabaisser le caquet de ce prétentieux que lui avait imposé la Préfecture, un être hautain et arrogant, probablement un méprisable pékin qui n’avait auparavant jamais porté l’uniforme, un impertinent surtout qui ne s’adressait à Thiers, à Magnien ou à lui-même que comme à de vulgaires subalternes, écoutant leurs rapports, mais jamais leurs avis. Un satané connard ! jura-t-il, mais si bas que nul n’aurait pu l’entendre.
- Appelez-moi capitaine, maréchal des logis Gérard. Dois-je vous rappeler que nous sommes en mission ? dit l’inspecteur Chenard d’un ton froid, après avoir récupéré son regard perdu vers la forêt et l’avoir reporté lentement sur son vis-à-vis, un regard supérieur où brillait une lueur sauvage, un brin inquiétante.
- Bien…bien sûr, mâchonna le sous-officier, saisi et impressionné malgré lui, sentant rougir ses pommettes. Excusez-moi, mon capitaine…
- Parfait, dit le policier, après un sourire qui se limita aux lèvres, juste une simple mimique mécanique et professionnelle. Donc, reprit-il, vous étiez en train de me dire avant l’arrivée de Caron que avez reçu l’ordre de placer dans un taillis proche du lieu du rendez-vous des hommes prêts à s’emparer de lui ?
- Oui, ce matin ! C’est notre colonel qui nous a donné comme instruction d’opérer à l’arrestation de Caron au cas où ce bandit n’exécuterait pas sa promesse de nous donner de l’argent ou paraitrait éloigner le jour de sa conjuration !
- Vous n’en ferez rien !
- Pardon ?
- Vous m’avez compris !
- C’est un ordre de notre colonel !
- J’en prends note, mais vous n’en ferez rien, reprit Chenard d’une voix lourde en observant Gérard avec un regain d’intérêt, si bien que, surpris et mal à l’aise, le sous-officier frissonna, car il eut la désagréable impression que le soi-disant capitaine Duclos cherchait à graver un peu plus les traits de son visage dans sa mémoire, comme pour lui préparer un évènement futur, désagréable en ce qui le concernait.
- Bi…bien, bafouilla-t-il.
- Admirable, répéta Duclos avec un nouveau sourire mécanique. À cheval à présent, ajouta-t-il en pivotant sur ses talons. Rejoignons Thiers et Magnien qui doivent nous attendre avec Caron. Et faisons mine d’arriver prestement de Colmar.
- À vos ordres, capitaine.
-
« Les voilà, mon colonel ! dit un homme sans âge, vêtu en uniforme de chasseur, avec une épaisse moustache, s’adressant à Caron en train d’attacher son cheval à un arbre.
- Où donc ? murmura l’officier supérieur dans un réflexe, alors qu’il affichait un regard terne et une pâleur inaccoutumée. Ah ! Oui, je les vois, fit-il d’une voix sans force, après un pas sur le côté, avant d’observer à travers la densité de la forêt deux cavaliers qui avançaient en file indienne. Parfait, nous voilà au complet, ajouta-t-il avec un rictus forcé sur les lèvres.
- Bonjour, colonel, s’écria gaiement Gérard, tandis qu’il se laissait glisser le long de sa selle.
- Colonel », dit de son côté Chenard toujours sur sa monture, après un signe de main porté à son front.