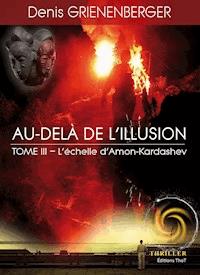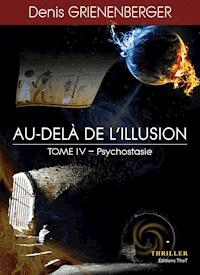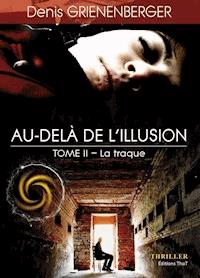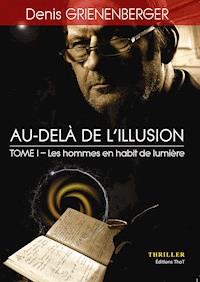Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions ThoT
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Que se passe-t-il lorsqu'un pirate, à l'aide de son implant, tente d'atteindre le système informatique central du Vatican ?
À minuit moins six exactement, le pirate se faufila dans le système informatique central du Vatican. Après quatre jours de bataille, il espérait enfin être venu à bout de la multitude de barrières de sécurité. Pourtant, son implant et ses écrans ne lui renvoyèrent qu’un vide oppressant. Comme un néant abyssal et infranchissable. Soudain, une présence se manifesta. Un signal résonna dans son crâne, se transforma en un grondement grave. Un sentiment de panique, suivi d’une douleur lancinante, se répandit dans son cerveau.
Tout au fond de lui, une étincelle lui ordonnait de se déconnecter immédiatement. Mais son cerveau était déjà envahi et dominé. Le pirate eut un dernier geste réflexe en direction de son ordinateur portable, mais ne réussit pas à l’atteindre. Son cerveau fut brûlé. Son cœur lâcha instantanément.
Avec cette nouvelle affaire, le commandant Pierre Schaffner et le lieutenant Miguel Pinarci se retrouvent encore une fois confrontés à des événements à la limite du surnaturel : qui, et surtout comment ont été mises à mort les victimes qui parsèment leur enquête ? Peut-on mourir de peur ?
Les deux policiers devront se rendre jusqu’aux frontières de la folie pour le comprendre. Marilyn, la nièce de Schaffner, son ami Max, et Thibault, son frère autiste, seront entraînés avec eux dans un univers où se côtoient hypnose, piratage informatique, manuscrits d’alchimie et solides de Platon.
Hypnose, piratage informatique, manuscrits d’alchimie, ou encore solides de Platon, le commandant Pierre Schaffner et le lieutenant Miguel Pinarci devront à nouveau mettre à jour les mystères qui entourent ces événements à la limite du surnaturel dans ce thriller palpitant.
EXTRAIT
Quatre jours qu’il se battait, hacker émérite, craint par le CCC, le très réputé
Chaos Computer Club allemand. À chaque fois qu’il avait cru avoir franchi la dernière barrière, une nouvelle s’était présentée à lui. Il s’était heurté à des obstacles intelligents à la rapidité d’action inhumaine. Lui-même avait envoyé des centaines de milliers de requêtes à la seconde, par le biais de serveurs répartis aux quatre coins de la planète. Les réponses étaient du même ordre, mais elles variaient de façon intelligente, comme si le programme cherchait à analyser et à connaître son impétrant.
Son implant intra-auriculaire lui faisait mal. Défaut de fabrication ou surchauffe ? Il figurait parmi les premiers pirates à détourner l’implant externe, et à se faire greffer la fameuse puce directement sur les nerfs auditifs. Depuis, des centaines, bientôt des milliers de personnes étaient ainsi « connectées ». À minuit moins onze, il espérait être arrivé au bout de quatre jours de bataille. Son implant et ses écrans ne restituèrent qu’un vide au parfum angoissant. Comme un néant immense, mais pourtant limité, infranchissable.
Soudain, un signal, une présence se manifesta. Cela résonna dans son crâne, comme un grondement grave, de plus en plus fort… Une angoisse indescriptible l’envahit. Une terreur, mêlée à une douleur lancinante, pénétra son cerveau. Il se mit à haleter de façon incontrôlable. Sa conscience se rétrécit, comme celle d’un alpiniste en manque d’oxygène dans la zone de mort. Tout au fond de lui, une étincelle lui ordonna de se déconnecter, mais son cerveau était envahi et dominé. Il fut comme écorché, mis à nu. Il eut un dernier geste réflexe en direction de son portable, mais ne put l’atteindre. Chaque nerf de son corps brûla. Une terreur et une souffrance indescriptibles lui détruisirent le cerveau. Son cœur lâcha…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Présentation de l'auteur
Originaire d’un petit village d’Alsace, Denis Grienenberger, informaticien pour le compte d’un grand groupe pharmaceutique suisse, est fasciné par les mondes parallèles. Ce passionné de technologie, de musique et de sports de plein air, nous plonge, après sa tétralogie Au-delà de l’illusion, dans un thriller au suspens redoutable, mêlant assassinats énigmatiques, nouvelles technologies et géométrie antique.
Remerciements
Je tiens à remercier mes fidèles lecteurs-harceleurs qui aimeraient me voir produire plusieurs romans par an (il ne tient qu’à vous de me rendre suffisamment célèbre pour que je puisse faire de l’écriture un travail à plein temps !)
Un grand merci à toute l’équipe de ThoT : Pauline, Élodie, Guillaume, Christiane, Jacques pour vos excellents conseils et votre disponibilité !
Un immense merci à ma petite famille qui a dû apprendre à composer avec la passion du mari, du papa, et à supporter ses absences dans son bureau ou lors des multiples salons et foires aux livres.
Denis Grienenberger, juin 2016.
Il n’y a rien de plus émouvant dans une vie d’homme que la découverte fortuite de la perversion à laquelle il est voué. Oui, car la perversion, c’est la beauté du mal.
Michel Tournier, Le Roi des Aulnes.
En menant une existence relâchée, les hommes sont personnellement responsables d’être devenus eux-mêmes relâchés ou d’être devenus injustes ou intempérants, dans le premier cas par leur mauvaise conduite, dans le second en passant leur vie à boire ou à commettre des excès analogues : en effet, c’est par l’exercice des actions particulières qu’ils acquièrent un caractère du même genre qu’elles. On peut s’en rendre compte en observant ceux qui s’entraînent en vue d’une compétition ou d’une activité quelconque : tout leur temps se passe en exercices. Aussi, se refuser à reconnaître que c’est à l’exercice de telles actions particulières que sont dues les dispositions de notre caractère est le fait d’un esprit singulièrement étroit. En outre, il est absurde de supposer que l’homme qui commet des actes d’injustice ou d’intempérance ne souhaite pas être injuste ou intempérant ; et si, sans avoir l’ignorance pour excuse, on accomplit des actions qui auront pour conséquence de nous rendre injuste, c’est volontairement qu’on sera injuste. Il ne s’ensuit pas cependant qu’un simple souhait suffira pour cesser d’être injuste et pour être juste, pas plus que ce n’est ainsi que le malade peut recouvrer la santé, quoiqu’il puisse arriver qu’il soit malade volontairement en menant une vie intempérante et en désobéissant à ses médecins : c’est au début qu’il lui était alors possible de ne pas être malade, mais une fois qu’il s’est laissé aller, cela ne lui est plus possible, de même que si vous avez lâché une pierre vous n’êtes plus capable de la rattraper. Pourtant il dépendait de vous de la jeter et de la lancer, car le principe de votre acte était en vous. Ainsi en est-il pour l’homme injuste ou intempérant : au début il leur était possible de ne pas devenir tels, et c’est ce qui fait qu’ils le sont volontairement ; et maintenant qu’ils le sont devenus, il ne leur est plus possible de ne pas l’être.
Aristote, Éthique à Nicomaque.
Avant-Propos
Avant de vous laisser plonger dans la confrontation du commandant Schaffner avec le Mal, je me dois de vous donner quelques pistes pour situer l’époque et la scène.
L’histoire de ce roman débute fin 2015… Le présent pour moi, au moment de démarrer la rédaction de cette nouvelle histoire qui germa dans mon esprit comme une plante qui cherchait impitoyablement la sortie vers la lumière. Je tentais de retenir certaines branches, d’en favoriser d’autres, mais l’histoire finit par reprendre rapidement le dessus. J’avais encore des domaines à explorer qui n’étaient pas achevés dans mes précédents romans, la tétralogie d’Au-delà de l’illusion.
Je tiens à vous rassurer d’emblée, il ne faut pas avoir lu cette série avant de se lancer dans Le Diable dans la boîte. L’action de mon premier roman en quatre tomes se déroule de 2005 à 2049. Entre le tome III et le tome IV, j’entraîne le lecteur dans un saut d’une quarantaine d’années dans l’avenir. C’est en 2009 que démarrent, avec quelques flash-back, les faits inexplicables auxquels sont confrontés le commandant Schaffner et le lieutenant Pinarci qui vivaient sous ma plume dans les trois premiers tomes.
Lorsque j’ai apposé le dernier mot de ma tétralogie, je pensais devoir dire adieu à mes personnages et j’ai eu plusieurs mois de passage à vide, durant lesquels j’ai dû en faire le deuil. J’avais depuis bien longtemps l’intrigue du Diable dans la boîte en tête, mais tant que la tétralogie n’était pas bouclée, je me contentais de quelques annotations. Lorsque, en même temps que la rentrée littéraire et la sortie du dernier tome d’Au-delà de l’illusion, je démarrais la rédaction de mon nouveau roman, je constatais que j’avais bien du mal à fignoler certains personnages. Je dus me rendre à l’évidence, l’époque s’y prêtait : l’action s’intercalait chronologiquement entre le tome III et le tome IV de ma précédente série ; j’avais l’occasion d’explorer une nouvelle branche de mon univers imaginaire (pourtant très ancré dans le réel), en compagnie de quelques-uns de mes héros, présents dans l’histoire entre ces deux tomes.
Je vous promets de m’être efforcé, tout au long de la rédaction de cette histoire, de bien scinder les deux romans, que vous pourrez lire de façon indépendante. Les deux histoires se complètent, mais se développent chacune de leur côté.
À l’heure où j’écris ces lignes, je sais que je vais reprendre au moins deux de mes anciens personnages, mais qui sait, peut-être que certains autres viendront se glisser entre ces pages. Je vous en laisse la surprise… Les amateurs de ma précédente série y verront certainement quelques clins d’œil, et pour ceux qui auront commencé par ce livre, ce sera éventuellement une invitation à explorer plus tard les dimensions vertigineuses d’Au-delà de l’illusion.
Quant aux allusions à cette série parallèle sur laquelle s’est greffé ce roman, je m’efforcerai également d’en dévoiler suffisamment pour vous permettre de ne pas être surpris par ce que vont vivre mes personnages, en en même temps d’éviter de spolier le roman.
Vous l’aurez compris, ce leitmotiv, un rappel du mythe de la caverne de Platon, occupe mes pensées depuis bien des années et va trouver une fois de plus une illustration romancée. Suivez-moi ! Laissez-vous emporter…
Février 2016.
Faim
La conscience avait faim, et ne savait pas de quoi elle était faite. Elle était prisonnière, emmurée, et pourtant, d’autres consciences semblaient attirées par elle.
La même faim les animait. Une envie de destruction, de souffrance, de peur, mais pas de mort. La mort mettrait fin à tout le lent processus, surtout pas ! La peur était la nourriture de laquelle se repaissait la conscience maléfique.
Parfois, elle parvenait à s’échapper un peu de sa prison, mais dès qu’elle s’éloignait, elle s’affaiblissait, et n’avait d’autre choix que de revenir en arrière.
Quand sa faim était trop forte, elle sacrifiait une de ces consciences, qui était venue à sa rencontre.
Prologue
« Le pirate se faufila dans le système informatique central du Vatican à minuit moins six. »
Quatre jours qu’il se battait, hacker émérite, craint par le CCC, le très réputé Chaos Computer Club allemand. À chaque fois qu’il avait cru avoir franchi la dernière barrière, une nouvelle s’était présentée à lui. Il s’était heurté à des obstacles intelligents à la rapidité d’action inhumaine. Lui-même avait envoyé des centaines de milliers de requêtes à la seconde, par le biais de serveurs répartis aux quatre coins de la planète. Les réponses étaient du même ordre, mais elles variaient de façon intelligente, comme si le programme cherchait à analyser et à connaître son impétrant.
Son implant intra-auriculaire lui faisait mal. Défaut de fabrication ou surchauffe ? Il figurait parmi les premiers pirates à détourner l’implant externe, et à se faire greffer la fameuse puce directement sur les nerfs auditifs. Depuis, des centaines, bientôt des milliers de personnes étaient ainsi « connectées ».
À minuit moins onze, il espérait être arrivé au bout de quatre jours de bataille. Son implant et ses écrans ne restituèrent qu’un vide au parfum angoissant. Comme un néant immense, mais pourtant limité, infranchissable.
Soudain, un signal, une présence se manifesta. Cela résonna dans son crâne, comme un grondement grave, de plus en plus fort… Une angoisse indescriptible l’envahit. Une terreur, mêlée à une douleur lancinante, pénétra son cerveau. Il se mit à haleter de façon incontrôlable. Sa conscience se rétrécit, comme celle d’un alpiniste en manque d’oxygène dans la zone de mort. Tout au fond de lui, une étincelle lui ordonna de se déconnecter, mais son cerveau était envahi et dominé. Il fut comme écorché, mis à nu. Il eut un dernier geste réflexe en direction de son portable, mais ne put l’atteindre. Chaque nerf de son corps brûla. Une terreur et une souffrance indescriptibles lui détruisirent le cerveau. Son cœur lâcha…
Des solides aux propriétés uniques
Athènes, 370 av. J.-C.
Platon travaillait depuis des semaines à la représentation de ses objets élémentaux.
Alors qu’il passait sous le fronton de son Académie, sur lequel était gravée la devise : « Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre », il ne prit même pas la peine de saluer les étudiants qui passaient son chemin. Ils avaient l’habitude de l’état d’esprit du Maître. Lorsqu’il était perdu dans un problème, ce qui lui arrivait fréquemment, il semblait se déplacer entre deux mondes. Son corps était présent, mais son âme flottait ailleurs, dans un univers fait d’abstractions et de concepts.
Ce qui préoccupait Platon était ses solides. Aristote, son disciple, et lui y travaillaient depuis des années. La terre, l’eau, le feu et l’air avaient trouvé leur représentation.
Il avait commencé bien des années plus tôt par assembler quatre triangles pour former le tétraèdre. Figure qui le fascinait depuis lors. Sa perfection, sa solidité, sa symétrie, tout était équilibré. Sa forme pointue rappelait le poignard, et par association, la morsure du feu.
Le cube était son successeur naturel : composé de six faces, à quatre côtés, il représentait la stabilité par définition. Posé, il gardait un équilibre parfait.
En reprenant le triangle, il constitua l’octaèdre, composé de huit faces triangulaires : contrairement au feu avec ses sommets très pointus, ce dernier avec ses faces douces se rapprochant de la sphère était associé à l’air.
Toujours avec le triangle comme forme figure géométrique de base, il obtint l’icosaèdre composé de vingt faces ; celui-ci, encore plus proche de la forme parfaite, la sphère, était presque insaisissable, tant ses faces étaient planes. Il l’associa tout naturellement à l’eau.
Tous avaient les propriétés suivantes : toutes les faces étaient des polygones réguliers convexes isométriques, c’est-à-dire superposables ; aucune des faces ne se croise, chaque sommet (en pointe) est rejoint par le même nombre de faces.
Le cinquième et dernier élément qui adhérait à ces propriétés toutes simples l’intriguait au plus haut point : le dodécaèdre était composé de douze faces pentagonales. Il le nomma « le dieu utilisé pour arranger les constellations dans tout le ciel ». L’élément était parfait, comme les autres, mais pourtant ses faces à cinq sommets le dérangeaient. C’était celui qui était le plus proche de la sphère.
Pour Platon, il était une représentation de cet élément indicible qu’Aristote avait évoquée, lors d’un récent échange : l’aithêr (aether en latin, « éther » en français). Pour son élève, l’univers était fait de cet élément, et il était consubstantiel à tous les autres : il les contenait tous.
Platon était à la fois fasciné et mal à l’aise. Comme si cet élément qui contenait tout était par définition bénéfique, mais également maléfique, l’un n’allant pas sans l’autre.
Il avait longuement fignolé la sculpture en terre cuite du dodécaèdre. Et alors qu’il représentait l’objet sur une tablette en cire sous plusieurs aspects, comme s’il était transparent, il fut soudain pris de vertiges. Comme attiré par la forme, il se sentit aspiré vers l’intérieur de sa petite gravure. Le malaise s’intensifia ; il perdit conscience et fit glisser la pièce de lin sur laquelle étaient posés les cinq solides en terre cuite. Ils éclatèrent tous en d’innombrables éclats lorsqu’ils percutèrent le sol. Attirés par le bruit, des élèves trouvèrent le maître inconscient, à terre, à côté de ses figures géométriques détruites.
Une entrée au lycée bien difficile
Mulhouse, septembre 2015
« Envoi »… Marilyn venait d’envoyer un énième SMS à son amie Marion qui, tout comme elle, angoissait de se retrouver au lycée. L’entrée en seconde, croiser des « grands », presque adultes alors qu’elle sortait juste de l’enfance, repasser du stade de « grande » à celui de « petite »… À cela s’ajouta la peur du bizutage, même s’il était officiellement interdit. Elle avait ruminé toutes ces craintes une bonne partie de la nuit et n’avait presque pas dormi.
Sa mère n’avait pas insisté lorsqu’elle avait grogné « pas faim » en réponse à sa question concernant le petit déjeuner. Elle comprenait que pour la jeune fille, le saut dans l’inconnu pouvait lui bloquer l’appétit.
— À quelle heure est ton bus ? demanda Marie, sa mère, sans doute autant angoissée que sa fille, bien qu’elle fût déjà passée par les mêmes questions quelques années auparavant, lorsque l’aîné avait fait son entrée au lycée, sauf que ce dernier avait eu trois ans d’avance sur ses semblables, et ce malgré un handicap assez lourd : un autisme qui avait bouleversé la vie de toute la famille.
— Maman, tu me l’as déjà demandé hier, sept heures vingt, j’ai encore un quart d’heure. J’ai le temps. Je ne suis pas pressée d’attendre sous la pluie.
À l’extérieur, la météo semblait être de la même humeur que les écoliers : maussade. Tout l’été avait été chaud et orageux. Le climat avait très nettement évolué lors de ces cinq dernières années. Plus personne ne pouvait nier la réalité du réchauffement.
Sa mère soupira en rangeant les corn flakes que sa fille ne toucherait même pas.
— Tu veux un jus d’orange au moins ?
— OK, d’accord, merci.
Elle accepta plus pour faire plaisir à sa mère que par envie. Elle vida le verre, le regard dans le vague vers le grand châtaigner du parc. Leur appartement jouissait d’une situation exceptionnelle en plein centre, dans une rue pas trop passante, la rue Engel, qui longe le parc Steinbach : un hectare de verdure en plein cœur de la ville. L’arbre majestueux faisait partie de son décor depuis toujours. Elle avait grandi dans leur cinq-pièces en duplex, et le châtaignier avait été en premier plan de la vue qu’on avait sur le monde extérieur à travers les fenêtres de la façade sud-est de l’appartement.
Elle s’empara de sa veste à capuche, jeta son sac Eastpack sur son épaule, fit claquer un baiser sur la joue de sa mère et dévala les cinq étages du vieil immeuble en pierres de taille. Elle en avait pour dix minutes à pied et encore autant en bus pour rejoindre le lycée technique Louis Armand.
Un vertige vieux de deux millénaires
Athènes, 370 av. J.-C.
Plusieurs visages barbus et soucieux étaient penchés sur Platon. Aristote interrogea son maître.
— Maître, maître ! Enfin vous reprenez conscience. Comment allez-vous ?
— Mieux… Que s’est-il passé ? Mais le soleil est presque couché ?
Platon tenta de se redresser, mais un vertige le saisit immédiatement, et il se laissa retomber sur le lit.
— Ne forcez pas ! Nous vous avons rafraîchi tout l’après-midi, mais vous êtes resté inconscient malgré nos appels.
Platon insista et se redressa encore une fois. Tout lui revenait soudain.
— Mes solides ! Le dodécaèdre… Il est infini.
— Maître ?
— Je, ne sais…
Platon essaya de reprendre ses esprits, et de clarifier ce qui lui avait fait perdre connaissance.
— Aristote, cherche-moi un verre d’eau citronnée, et rejoins-moi avec une tablette de cire. Ramène-moi la mienne et mes objets.
— Maître, vous ne pensez pas que vous devriez vous reposer ?
— J’ai dormi tout l’après-midi. Quelle perte de temps ! Non, il me faut saisir mes réflexions avant qu’elles ne s’envolent !
Platon accordait une grande importance à l’inspiration et sa théorie des idées venait d’être confortée par cette expérience magique. Ses solides existaient dans un univers distinct du monde, qui était le seul véritablement réel. Et ces objets tiraient leur force de leur universalité. Sa plus grande crainte était que comme dans un songe, ses souvenirs s’envolent et qu’il n’en subsiste qu’une impression lointaine.
— Le monde qui nous entoure est illusion, Aristote.
— Oui, Maître, nous, tous vos élèves, en sommes convaincus.
— Je sais, je sais, coupa-t-il avec une certaine impatience, mais ces objets géométriques sont parfaits et réels. Nous n’en percevons qu’une représentation géométrique, mais ils sont bien plus. Aristote, le dodécaèdre m’a aspiré, comme un puits sans fond !
— Maître, vous avez perdu connaissance. Peut-être la soif, ou la fatigue. Il fait très chaud depuis plusieurs jours. Et vous, tout comme nombre d’entre nous, avez tendance à négliger les besoins de votre corps lorsque vos études vous captivent.
— Non Aristote, ce n’est pas cela, cet objet a des propriétés particulières. La géométrie est la clef ! La perfection des proportions ouvre des portes, des passages ! La force qu’exercent ces formes sur l’homme est potentiellement infinie. Et c’est l’observateur qui lui donne son sens… L’homme ne peut pas vouloir le mal ! s’exclama-t-il dans un gémissement désespéré.
Les yeux de Platon roulèrent. Il fut à nouveau pris de vertiges. Des maux de tête violents le clouèrent au lit plusieurs jours durant. Des rêves très perturbés et fort complexes rendirent ses pensées encore plus confuses.
Un drôle de petit groupe
Mulhouse , lycée LLA, septembre 2015
— Putain, je suis crevée ! s’exclama Marilyn. Il est incroyable de type !
— Ouais, jamais vu ça, un dictateur, mais génial. T’as vu ça comme il a maté Valentin. Et le mec i’ fait une tête de plus que lui !
— Je suis encore sous le choc ! Tu crois que tous nos profs seront comme lui ? Ils vont nous essorer !
— Rêve pas, dit Marion avec une moue désabusée, en montrant son téléphone. Quel connard… un échappé de la préhistoire… et crade, en plus il pue ! lisait-elle sur le smartphone de son amie.
Elle chattait avec une autre de leurs anciennes amies du collège, qui commentait son premier cours de la matinée avec un autre prof. Ce dernier n’avait visiblement pas la même pédagogie expéditive et efficace que leur prof de maths.
Le vieux bonhomme aux portes de la retraite, tout petit, voûté, très énergique, leur avait énoncé ses règles de fonctionnement en quelques minutes et avait démarré sur les chapeaux de roues un résumé sur la trigonométrie qu’ils auraient dû apprendre en troisième, au collège. Les quelques vagues soupirs à l’idée de reprendre la matière tant détestée et incomprise de l’année passée, furent vite étouffés dans l’œuf par le regard d’acier, cerclé de petites lunettes rondes, du vieil enseignant.
En deux heures d’un cours d’une clarté et d’une intensité sans concession, il avait résumé, à l’intention des vingt-huit élèves de seconde, tout le programme de trigonométrie du collège. Sans cesse, il avait guetté les réactions, exigeant la participation de chacun, interrogeant les plus inattentifs, y compris le rétif Valentin, qui en était à son second redoublement et qui la jouait rebelle du haut de son mètre quatre-vingt-dix.
Monsieur Miesch l’avait simplement fixé de son regard d’acier, et Valentin avait abdiqué au bout de quelques secondes pour balbutier une réponse à la question posée. À l’issue des deux heures, ils étaient tous lessivés. La pause de midi était plus que bienvenue !
La cloche avait sonné, et chacun avait attendu que Monsieur Miesch les autorise à quitter la salle. Hors de question de ranger ses affaires avant l’heure ! C’était le prof le plus sévère que Marilyn avait eu dans toute sa scolarité. Au collège, son prof d’anglais lui avait fait une très forte impression, mais ce n’était rien par rapport au profond respect teinté de crainte que Monsieur Miesch lui avait inspiré dès la première heure. Elle n’avait jamais éprouvé ceci en face d’un enseignant.
La sortir du cocon du collège, après neuf années de scolarité passée dans le même petit établissement, pour soudainement la plonger dans l’environnement d’un grand lycée, était un choc.
Après le repas de midi, vite expédié, elle retraversa le bâtiment austère dont le couloir du rez-de-chaussée donnait sur un vaste préau aux murs couverts de tags. Sur un escalier d’une vingtaine de mètres de largeur, montant vers le terrain de basket, des dizaines d’élèves étaient assis. Nombreux étaient ceux qui fumaient.
Un peu plus haut sur la gauche, un petit groupe était installé dans l’herbe, autour d’un lycéen plus mûr que la moyenne, arborant une barbichette et un chèche noir et blanc démodé. Il était en train de s’enfiler un sandwich de la taille d’une baguette entière tout en discutant de façon animée avec les gens autour de lui. Il y avait quelque chose de magnétique dans son regard, même si son aspect répugnait un peu Marilyn. Il déchirait son sandwich à grosses bouchées et se mettait des miettes partout. Sa barbe de deux semaines en était parsemée.
Un gars plus réservé, au regard perçant, éveilla son intérêt. Il faisait partie du groupe, mais tout en ayant l’air un peu absent. Un rêveur, yeux très sombres, chevelure abondante. Elle le trouvait attirant.
Marion donna un coup de coude à sa copine, lui montrant bien qu’elle avait repéré l’objet de son attention.
Destructeur mental
Paris, années quatre-vingt-dix
« Graver ». Il lança la sauvegarde sur CD de la vidéo sanglante. Une de plus dans sa terrifiante collection.
La terreur inscrite sur le visage de l’enfant était parfaitement éclairée et bien filmée, c’est précisément ce qui était vendeur. Il allait tirer plusieurs dizaines de milliers de francs de sa production.
Depuis longtemps, c’était la peur qu’il recherchait dans le regard de ses victimes. Quand elles supplient que l’on mette fin à leur supplice, il est déjà trop tard. Lorsque cet abandon, cette résignation se manifeste, sa proie ne l’intéresse plus. Parfois, il parvenait à faire renaître cette étincelle maléfique de terreur pure alimentée par l’instinct primaire de survie, en étalant l’exécution sur plusieurs jours. Mais rien ne dépassait la peur initiale de l’inconnu ni la surprise de voir un bourreau-démon.
Son coup de génie avait été de mettre en scène deux victimes : la victime réelle, et un enfant spectateur à qui il laissait penser qu’il serait la proie suivante. Mais la vraie victime à ses yeux était l’esprit de celle qui survivait, et non pas le corps assassiné à ses côtés.
Lukas Desmons avait travaillé dans le porno sado-maso, comme cameraman et comme réalisateur. La demande pour du « hard » ne cessait de croître. Le grand changement s’était produit avec l’arrivée du numérique vers la fin des années quatre-vingt-dix. Le porno avait très vite pris la tête de tout le trafic internet et ça n’avait pas changé dans les années qui avaient suivi. La facilité de transfert et de contact avait fait exploser cette industrie.
Le fric était dans la douleur, la vraie. Ses films avaient dérivé tout doucement vers le « snuff », d’abord passif, puis de plus en plus actif et violent. Jusqu’à ce qu’il mette lui-même en scène des actes de torture réels, et pour finir, de mise à mort. L’arrivée d’internet lui avait donné les moyens de ses ambitions. Il avait multiplié les sites, se spécialisant dans différents domaines de la sexualité et de la violence. De nombreux messages rassurants, volontairement cachés en bas de page, en caractères minuscules, le protégeaient plus ou moins des attaques légales : « scènes de films, fictives »… « Aucune torture infligée »… Tel était le message officiel. Mais tout observateur attentif ne pouvait qu’éprouver une sensation de profond malaise. Tout avait l’air réel.
Mais il n’aurait pas pensé que les sommes considérables qu’il tirerait de ses crimes aux mises en scène monstrueuses lui apporteraient autre chose que l’argent. Sa descente aux enfers l’avait rendu riche, mais de plus en plus insatisfait. Était-ce le pouvoir qu’il en tirait, toujours plus grand ? Le besoin de faire souffrir et de toucher aux racines du mal se faisait toujours plus intense en lui.
Un virage avait été atteint lorsqu’il avait rencontré le chef d’une secte sataniste, qui lui avait demandé de mettre les rituels sacrificiels en scène. Or tout comme lui, ce dernier détruisait psychiquement une seconde victime en lui imposant d’être spectatrice des mises à mort. Il avait trouvé une âme sœur, dans sa quête de destruction !
Il avait croisé le type dans une rue de Bâle. La rencontre fut des plus étranges. L’habituelle foule dense se déplaçait, lors de la pause de midi, sur la place du marché de la ville suisse-allemande. Lui-même avait comme d’habitude cherché un sandwich dans une des nombreuses boulangeries qui nourrissaient toute la population de la ville frontalière qui employait des travailleurs de France, d’Allemagne et de Suisse, des dizaines de kilomètres aux alentours.
Alors qu’il avançait dans la foule, il aperçut soudain, au bout du trottoir, un type très grand qui dominait d’une tête la plupart des passants. Il dépassait largement les deux mètres. Mais chose étrange, il semblait se faufiler entre les gens, comme s’il était invisible. Tout le monde s’écartait, le laissait passer, mais sans le regarder. Il était pourtant très impressionnant, très grand, tout de noir vêtu, de longs cheveux noirs, les yeux soulignés à l’eye-liner, et un teint très pâle. Normalement, il aurait dû attirer l’attention, ou provoquer un détournement systématique des regards, mais au lieu de cela, il franchissait le flot de la foule, comme l’étrave d’un navire, sans qu’on le remarque.
Il s’était avancé tout droit vers Lukas qui l’avait fixé sans retenue. Il ferait sensation dans une de mes vidéos ! avait-il pensé.
Le type le dépassa, et alors qu’il était à sa hauteur, il murmura d’une voix rocailleuse : « Je suis le Serviteur, suis-moi ! »
La rencontre avait donné un sens à sa vie. Il avait toujours nourri la certitude qu’il se ferait prendre un jour et qu’il finirait sa vie en prison. Mais après avoir rencontré ce messager du diable, son « serviteur », comme il se nommait lui-même, sa vie avait soudain pris un tournant nouveau. Une force s’était développée, il ne se ferait pas – jamais ! – prendre et il vivrait sa passion destructrice à fond.
Max…
Mulhouse, octobre 2015
Un grand fracas retentit dans le couloir du lycée Louis Armand.
Marilyn sursauta, et retint un cri. Un silence soudain s’était fait aussitôt suivre par des chuchotements.
— Qu’est-ce qui s’est passé ? demanda Marion, l’amie de Marilyn.
— Aucune idée, ça vient du bout du couloir, non ? Allons voir.
— Et si c’était une bombe ?
Marilyn regarda son amie en se demandant si elle était sérieuse…
— Marion, tu ne crois pas que tout le monde serait en train de crier et qu’on serait enfumées par le feu s’il y avait eu une explosion ?
— Une petite bombe ? dit-elle sur le ton de la plaisanterie, réalisant la bêtise qu’elle venait de proférer.
Elles avancèrent dans le couloir. La sonnerie du cours suivant avait retenti et les élèves entraient dans leur classe, sauf devant l’entrée de l’avant-dernière salle à gauche, où un petit attroupement s’était formé. Elles s’en approchèrent et virent leur prof de maths, monsieur Miesch, discutant avec un intendant.
La porte de la salle était par terre, arrachée de ses gonds.
— Max Eisele, Boris Chevresson ! Rangez-moi ça contre le mur, ordonna-t-il au beau garçon que Marilyn avait repéré depuis plusieurs jours, ainsi qu’à un autre.
Les deux lycéens soulevèrent la porte de la salle et la posèrent sur le côté.
— Mais monsieur Miesch, il fallait m’appeler ! gémit l’intendant qui venait d’arriver sur place, alerté par le fracas.
— Pas le temps ! J’ai un cours à faire. Bonne journée ! aboya monsieur Miesch.
Et il planta le gars au milieu de l’attroupement pour rejoindre le tableau et donner son cours. Marilyn l’entendit encore tonner ses ordres, devenus classiques en quelques semaines à peine : « Mur, fenêtre, cahier, craie, éponge ». Ce qui se traduisait par : « Que la moitié de la classe se place côté mur, l’autre moitié côté fenêtre, mini-contrôle de début de cours, pour obliger les élèves à réviser leur leçon avant ». Cahier d’appel, craie, éponge, étaient ce qu’il exigeait de voir sur son bureau, sans quoi il ne donnait pas son cours.
Le programme scolaire était important, mais aux yeux du prof de maths, la discipline passait avant tout, et si un des éléments manquait, il quittait les lieux, plantant la classe qui serait très vite tiraillée entre la joie de ne pas avoir cours et la culpabilité d’avoir perdu deux heures de précieux enseignement. En moyenne, cela arrivait une fois par année scolaire et par classe. La poigne de fer de monsieur Miesch et sa droiture laissaient une empreinte indélébile dans les esprits des lycéens.
— Il a fait quoi ? s’exclama Marilyn un peu trop fort en se dirigeant vers sa classe accompagnée, par quelques élèves qui avaient assisté à l’événement, laissant les éclats de voix de monsieur Miesch diminuer au fond du couloir.
— Il a fait enfoncer la porte ! Quelqu’un avait mis du chewing-gum sur la serrure. monsieur Miesch ne voulait pas attendre que l’intendant vienne réparer. Il a demandé à Schmitt, le plus costaud de la classe, d’enfoncer la porte.
— Le blond ?
— Oui, le bodybuildé, le nazi.
Le type en question était inquiétant il mesurait une tête de plus que les deux jeunes filles, qui n’étaient pourtant pas parmi les plus petites. Il arborait toujours une coupe blonde, à ras, parfaite, ne quittait jamais ses rangers noires, parfaitement cirées, son pantalon et son T-shirt kaki. Une caricature de militaire, regard bleu ciel froid et muscles inclus.
— Vraiment intelligent, murmura Marilyn, qui avait eu la satisfaction d’apprendre le nom du jeune homme qui la fascinait, de la bouche du prof de maths : Max Eisele.
— Qui est-ce qui est intelligent ? demanda Marion.
— Le prof ! D’un simple ordre, il a mis la brute de service dans sa poche. T’imagines à quel point Schmitt a dû être satisfait de pouvoir faire une démonstration de force, devant toute la classe et les autres dans le couloir ? Et en même temps, il a eu la bénédiction du prof. Il ne va plus l’emmerder de toute l’année, crois-moi.
— Ah oui, effectivement vu comme ça, ce n’est pas bête !
Elles rejoignirent avec un peu de retard leur cours d’histoire-géo, qui ne laissa qu’une très vague impression à Marilyn, dont les pensées tournaient en boucle autour du prénom et du nom de celui qu’elle convoitait. Max, Max Eisele.
Un démarrage très lent
Mulhouse, octobre 2015
Marilyn avait croisé Max, toujours très réservé, à plusieurs reprises, et à chaque fois le même coup au cœur, et cette sensation grisante de vertige. La dernière fois, c’était à la cantine. Ils ne s’étaient pas quittés des yeux. Pourtant aucun des deux ne fit le geste de se lever pour rejoindre l’autre. Marion ne cessait de harceler son amie en lui disant : « Mais vas-y ! Il te dévore des yeux ! Il n’attend que ça ! » Mais elle entendait à peine les injonctions de Marion ; son esprit était déconnecté. Elle était plongée dans le regard de Max, dont elle avait appris le prénom lors de l’épisode de la porte enfoncée sur ordre du prof de maths.
Ils avaient fini par se parler au bout de quelques semaines d’hésitations mutuelles. Ils s’étaient bien trouvés, et leur timidité n’avait pas facilité leur rapprochement. Max avait un comportement assez paradoxal. Il n’avait pas encore osé embrasser Marilyn, mais souhaitait déjà l’inviter à une soirée auprès d’un groupe d’amis qu’il voulait lui présenter.
Cela donnait un peu à Marilyn l’impression qu’il cherchait une approbation à leur relation naissante. Mais elle chassa cette étrange pensée. L’essentiel était qu’elle puisse passer du temps avec le charmant jeune homme.
Le campus était attenant au lycée et ils s’étaient donné rendez-vous au « restaurant U ». Max y était attablé devant un thé.
— Salut, tu vas bien ?
Max se leva pour faire la bise à Marilyn. Elle savoura le contact picotant de sa barbe naissante contre sa joue.
— Salut, oui, merci et toi ?
— Impec’, je suis content que tu n’aies pas changé d’avis, tu veux que j’aille te chercher quelque chose au bar ?
— Euh, oui, j’ai mangé sur le pouce, et un café serait sympa.
— Oui, pas de problèmes.J’ai promis à Anthony d’aller le chercher après son cours de karaté. Mais on a encore le temps.
Ils étaient en avance. Ils dégustèrent leur boisson en silence, se lançant régulièrement de petits regards en coin, gênés, accompagnés de sourires discrets.
Ils rejoignirent la voiture de Max, une vieille Volkswagen Polo couleur lie-de-vin avec près de deux cent mille kilomètres au compteur, mais qui démarrait encore assez bien et ne craquait pas trop quand il passait les vitesses. Marilyn s’installa derrière Max. En tant que fille et « petite », elle laissa tout naturellement la place avant aux garçons, la plupart du temps plus grands qu’elle. Elle était proche de lui comme jamais. Sauf quand elle lui fit brièvement la bise pour le saluer.
— On attend qui ? dit-elle pour rompre le silence, alors qu’il lui avait déjà dit au restau U qui ils allaient chercher.
— Anthony, le gars tout mince aux cheveux bouclés.Tu l’as certainement vu quand on se retrouve sur les marches dans la cour du lycée.
— Ah oui, je vois, celui qui a un œil qui s’écarte un peu ?
— Oui, c’est lui, mais on est un peu en avance, remarqua-t-il en regardant sa montre. Je lui avais dit dix-neuf heures trente. On a encore quinze minutes. Je crois que son cours de karaté finit à dix-neuf heures, mais le temps qu’il revienne du gymnase et qu’il prenne sa douche, je ne pense pas qu’il soit déjà prêt ni que ce soit la peine d’aller le chercher. Je peux lui envoyer un SMS…
— On n’est pas pressés, ne le stresse pas, si tu as dit dix-neuf heures trente, moi je peux attendre.
— Tu as raison. Je trouve ça tellement agréable d’être dans cette boîte transparente, alors que dehors le vent et la pluie se déchaînent.
Les feuilles volaient, il ne neigeait pas, les températures étaient nettement au-dessus de la normale saisonnière. La côte est des États-Unis venait de subir la pire tempête de neige de leur histoire, avec des précipitations cumulées sur deux jours de plus d’un mètre de neige à New York et Washington. Alors qu’eux avaient droit à un temps typiquement automnal, avec des alternances de journées fortement pluvieuses, et d’autres ensoleillées dignes d’un été indien.
L’imagination et le cœur de Marilyn s’emballèrent. Elle avait encore un quart d’heure…
Soudain, elle fut prise d’une envie irrépressible de toucher Max. Elle tenta de résister, craignant un rejet, ou pire, d’apprendre qu’il avait une amie, mais c’était comme un vertige. Sa main qui devenait autonome, s’avança vers la nuque de Max. Il tressaillit et au lieu de se retourner, il releva sa tête pour appuyer sa nuque davantage contre la main de Marilyn, qui le caressait et le massait.
Elle n’y tint plus : elle l’embrassa dans le cou, il se tourna et ils échangèrent un long baiser. Ses lèvres étaient douces ; il avait un léger goût de menthe. Cette fois-ci, c’est lui qui prit l’initiative. Il se retourna tant bien que mal, prit le visage de Marilyn entre ses mains, et l’embrassa plus passionnément. Elle avait les joues en feu ; leur respiration à tous les deux s’était accélérée. Elle ferma les yeux et se laissa aller aux caresses et à la douceur de ses gestes. Ils étaient tous les deux dans une bulle, hors du temps.
Un discret « toc-toc » à la fenêtre les fit sursauter.
— Hum, vous voulez que je vous laisse ? ou que je vous donne les clefs de ma chambre ? plaisanta, à moitié, Anthony qui était ponctuel, au grand dam de Marilyn et de Max.
Marilyn ne recula pas dans son siège. Elle garda les mains sur sa nuque alors qu’il démarrait pour se rendre chez leur ami en ville. Le sourire d’Anthony et les petits regards en coin signifiaient simplement qu’il était content que son ami plutôt solitaire ait trouvé une copine.
Un savon pas totalement injustifié
A6 entre Auxerre et Avalon, décembre 2015
Le commandant Pierre Schaffner ne pouvait s’empêcher de se repasser mentalement en boucle l’étrange interrogatoire qu’il venait de subir de la part de son supérieur et ancien ami, Ristíc Predag. Leurs relations s’étaient considérablement dégradées lors de l’affaire non résolue, du moins officiellement, de la Mâchoire. Cette étrange aventure avait occupé tout un pan de sa carrière de 2006 à l’été 2009.
L’affaire avait pris une dimension qu’il n’aurait jamais soupçonnée. Elle avait même radicalement changé sa vie et sa perception du monde.
Son équipe et lui avaient été confrontés aux meurtres les plus abominables qu’il lui avait été donné de voir dans toute sa carrière : les victimes, presque exclusivement des femmes, dépecées vivantes, à l’aide d’une arme inconnue laissant une découpe sphérique parfaite, fantasme de tout anatomiste, et finalement violées. Ce n’était que la partie émergée de l’iceberg… Au fil de l’enquête, ils furent confrontés à une étonnante évolution du meurtrier. De violeur et tueur en série, il était devenu chasseur de kidnappeurs d’enfants, comme s’il avait trouvé une raison de vivre. Mais ce ne fut que le début de leurs surprises. Alors que l’étau de leurs investigations se resserrait autour de Michel Suliac, alias la Mâchoire, Schaffner fut mis en contact avec une société secrète, les gardiens du Dharma, qui lui demandèrent de ne plus pourchasser Suliac. Le risque était bien trop grand que sa hiérarchie et les Services secrets s’approprient les incroyables facultés dont le tueur disposait : la faculté de se téléporter et la capacité, avec son arme terrifiante, de découper et d’engloutir toute matière comme un mini-trou noir qu’il maniait à la façon d’une arme blanche à laquelle rien ne résistait.
La société secrète lui avait fait jurer de cesser de le pourchasser et en contrepartie, elle se chargerait de le faire disparaître. Schaffner finit par accepter le terrible marché, devant l’évidence : sa hiérarchie, ainsi que celle de son homologue des Services secrets, avait soudain manifesté un très – trop – fort intérêt pour les supposés pouvoirs de la Mâchoire.
Les dernières manifestations du tueur dataient du mois de mai 2009 : il avait eu le culot de se rendre dans les lieux mêmes de la PJ pour y photocopier une liste de criminels, kidnappeurs d’enfants. Il avait été vu sur les caméras de surveillance internes, et n’était en théorie jamais sorti des locaux. Il avait purement et simplement disparu.
Les gardiens du Dharma avaient assuré à Schaffner que son seul souci était à présent d’étouffer l’affaire. Lorsque les gardiens du Dharma leur donnèrent accès à un plan parallèle à la Terre, une sorte de dimension supplémentaire à laquelle on accédait par des « Portes », que les scientifiques auraient baptisé certainement « trous de ver », s’ils avaient eu la chance de les observer, Schaffner, ainsi que son allié le général Duparc des Services secrets, furent finalement convaincus qu’il leur fallait collaborer.
À plusieurs reprises, il s’était rendu dans cet endroit étrange, cet univers parallèle. À chaque fois avec une grande prudence, vu que l’accès se faisait par l’arrière d’une statue de Horus laissée presque à l’abandon dans un des couloirs de l’Institut d’art et d’archéologie, rue Michelet, à Paris. Tout comme le général Duparc, qui avait obtenu les clefs d’accès par les membres de la société secrète des gardiens du Dharma, il n’était retourné que très rarement dans ce monde parallèle. Tout d’abord parce que sa vie et son travail ne lui en laissaient pas beaucoup le temps, et puis parce que même si ce lieu magique était un endroit parfait pour méditer et se reposer, il était vide…
Or, justement, cet après-midi, son patron venait de lui passer un nouveau savon. Ses supérieurs voulaient mettre la main sur la Mâchoire ; ce n’était pas un souhait, mais un ordre.
L’enquête était en sommeil ! Plus de cinq années sans nouvelle victime ni nouvelle du tueur, mais l’ordre venait de tout en haut. Probablement un changement dans la direction, et quelqu’un qui s’était dit qu’il y avait quelque chose à creuser dans ce vieux dossier.
À lui de se démener pour le retrouver et l’arrêter… Lorsque, retournant à son bureau, il se trouva face à face avec deux types directement rattachés au ministre de l’Intérieur, fouillant ses documents, sa conviction de ne pas obéir à son supérieur fut définitivement scellée. Les deux fonctionnaires, avec l’arrogance de ceux qui se savent tout-puissants, avaient tranquillement poursuivi leur fouille et emporté tous les documents jugés intéressants, sous les yeux de Schaffner, furieux. Devant ses protestations, ils avaient rétorqué : « Commandant, nous pouvons vous assurer que vous avez tout intérêt à collaborer… »
C’est dans une rage noire qu’il avait quitté le 36. Il avait posé, quelques semaines plus tôt, des congés pour la semaine suivante, et sans hésiter, il avait envoyé un message à son binôme pour lui annoncer qu’il avançait ses vacances de quelques jours : « T’auras qu’à dire au boss que j’ai chopé la grippe et que j’ai avancé mes congés pour me soigner. »
Il avait quitté la capitale dans un état second, faisant totalement confiance aux indications de son GPS.
Manuscrits interdits
Abbaye de Saint-Martin du Canigou, octobre 1225
La première grosse tempête d’automne s’était abattue sur les monts des Pyrénées et empêchait les moines de quitter les murs de leur refuge de pierre tant les vents étaient violents.
Pierre V d’Espira descendit les marches qui menaient à la crypte de l’abbaye de Saint-Martin du Canigou. Le grondement de la tourmente y était à peine audible. Comme à l’accoutumée, il s’y rendait pour prier, mais également pour étudier. Un petit autel de pierre trônait au bout de la salle voûtée. Tout autour de la base, une bordure de pierre enchâssait le bloc sculpté. La pierre de droite se décalait quand un homme pesait de tout son poids avec le pied dessus. Un mécanisme soigneusement dissimulé relevait légèrement la pierre, la faisant pivoter. Le logement dévoilé dans le sol avait la profondeur d’un bras tendu, la largeur d’un bras et la longueur de l’autel, soit deux bras tendus. Plusieurs ouvrages soigneusement emballés dans des pochettes de cuir s’alignaient sur des planches, dans cette fente creusée à l’intérieur de la base rocheuse de la crypte.
Parmi les ouvrages interdits qui étaient secrètement dissimulés en ces lieux sacrés se trouvaient plusieurs œuvres d’Aristote, dont son Traité du ciel et plusieurs autres ouvrages faisant référence à des objets aux propriétés magiques.
Un coffret contenant un savoir qui ne devait pas être ouvert, ramené des croisades, attisait à chaque fois la curiosité de Pierre d’Espira, comme elle avait dû éveiller celle de ses deux prédécesseurs. Mais lorsque la charge lui avait été léguée par l’abbé Pierre IV, ce dernier lui jura que ses ancêtres et lui n’avaient jamais failli à leur mission : protéger le coffret, le transmettre, et ne jamais l’ouvrir. Ceux qui auraient le droit d’en faire usage dans les ans ou siècles à venir sauraient s’ils en étaient dignes ou pas et pourraient en apporter la preuve à leur gardien. Il fit jurer à Pierre d’Espira de respecter ce vœu aussi chèrement que ses propres vœux monastiques.
Quelques autres livres plus noirs, dont la détention avait été jugée nécessaire par ses prédécesseurs, assombrissaient la collection. Mais le bien se devait d’être armé pour combattre le mal, et il fallait donc le connaître.
Féru de mathématiques, Pierre d’Espira se replongea une fois encore dans les écrits d’Aristote. Les formes géométriques parfaites, tels le tétraèdre, le cube, et surtout le dodécaèdre, le fascinaient. Que ces figures fussent limitées au nombre de cinq avec leurs propriétés si simples le captivait et le dérangeait au plus haut point. Maintes fois il les avait dessinées, et avait toujours l’impression d’être en face de quelque chose d’invisible.
Il ne se contenta pas du dessin. Toute la semaine, il avait patiemment découpé trente baguettes de bois qu’il avait biseautées pour qu’en chaque sommet de la figure qu’il s’apprêtait à construire, trois baguettes se rencontrent. Il les avait en outre percées de façon à pouvoir les lier d’un fil en ces sommets. La première face de son objet magique serait un pentagone. Figure par définition suspecte pour l’Église chrétienne.
La mise en place de la première face fut aisée ; la base avec les baguettes qui se dressaient vers le haut faisait penser à un panier de la largeur de deux mains. La suite de l’assemblage fut un peu plus délicate. Plus de deux mains auraient été nécessaires. Mais il ne tenait pas à être vu des autres moines lors de ses études, surtout pas des plus jeunes novices dont la naïveté aurait très vite conduit à des ragots et des colportages.
Progressivement, il noua les faisceaux de trois baguettes qu’il avait préparées au préalable, entre elles. La figure grandissait. Et la tempête qui était pourtant à peine audible, lorsqu’il était descendu dans la crypte, avait redoublé de violence. Il fut distrait par quelques coups sourds. Il espérait que les lourdes plaques de pierres qui couvraient la toiture des bâtiments ne seraient pas abîmées.
Par deux fois, il dut couper un lien : dans le fouillis de baguettes, il s’était trompé de sommet en les assemblant. Il était sur le point de mettre en place le dernier pentagone sur le sommet, quand il eut soudain une sensation de vertige. La sphère posée sur le tissu écru qu’il avait étalé sur l’autel semblait grandir, et l’attirer. Il eut l’impression de tomber en avant. Pierre d’Espira inspira profondément et paracheva son assemblage, qui manquait encore de stabilité.
L’objet avait la taille d’un gros melon. La régularité de ses faces était presque surnaturelle. Mais la vision de Pierre d’Espira se troubla encore une fois. Il faillit laisser tomber sa création. Il mit cela sur le compte de la fatigue et rangea l’ouvrage d’Aristote, ainsi que son objet qui trouva une place dans la cache au pied de l’autel, en déplaçant quelques autres ouvrages.
Il remit tout en place, repoussa la pierre, et du plat de la main remit de la poussière et du sable sur les traces de déplacement de la pierre. La cache était invisible.
Une chambre à deux étages
Mulhouse, décembre 2015
Max était retourné chez lui vers une heure du matin sur un nuage, dans sa petite chambre d’étudiant. Il avait raccompagné Marilyn au pied de son immeuble. Ils s’étaient longtemps et tendrement embrassés. La sensation était totalement nouvelle pour les deux adolescents. Chacun avait déjà eu quelques expériences, mais tous deux sentaient que c’était différent.
Chaque baiser procurait à Max des frissons qui lui coulaient le long de la colonne vertébrale.
Marilyn avait chaud ! Elle brûlait ! Mais elle n’avait pas envie de sexe, du moins pas encore, juste de se coller à Max, de se fondre en lui. Son contact, sa peau, son odeur, le son de sa voix quand elle était collée à lui. Tout la faisait vibrer. Elle était amoureuse !
Ils se donnèrent un dernier long baiser, et Marilyn referma la lourde porte vitrée. Max rejoignit sa Volkswagen Polo, et remonta la rue de la Sinne, la rue de Zillisheim, prit à droite au rond-point la rue Gay Lussac, et arriva sur le boulevard Stoessel qui menait tout droit vers le stade et le campus universitaire. Au rond-point du stade, il s’engagea dans la rue de l’Illberg, où il logeait dans sa chambre d’étudiant, juste avant de passer la butte qui redescendait vers le lycée Louis Armand, où il était avec Marilyn.
Max était bien conscient et reconnaissant de la confiance que lui avaient accordé ses parents qui, de même que toute sa famille, habitaient Le Thillot dans les Vosges, en lui donnant si jeune la liberté d’avoir sa propre chambre d’étudiant alors qu’il n’était que lycéen. Il avait fait une tentative d’une nuit dans l’internat, et avait appelé ses parents dès le lendemain : « Je ne peux pas étudier dans ces conditions ! »
Ce qui l’avait le plus dérangé, c’était l’absence d’intimité et l’impossibilité d’emporter avec lui son synthé sur lequel il laissait courir ses doigts presque tous les jours. Il éprouvait un besoin quasi viscéral de faire de la musique. Son clavier n’avait pas le toucher d’un piano, et les week-ends, la première chose qu’il faisait après avoir embrassé ses parents était d’improviser quelques minutes sur le piano droit qu’ils avaient hérité de son grand-oncle quand il était gamin.
Avec un casque, le son de son synthé, couplé à un excellent émulateur sur son Mac, était très bon. Il manquait le côté vivant, irremplaçable d’un instrument acoustique dont les vibrations ne venaient pas de haut-parleurs, mais de partout ! Ce luxe était impensable en dortoir de lycée.
Max accrocha machinalement ses habits sur la patère de la salle de bains. Et se fit chauffer de l’eau dans la bouilloire de sa kitchenette. Il se doucha, tout à ses émotions ; le rush d’hormones le bouleversait. Il n’avait jamais éprouvé de sentiments aussi forts pour une fille. À chacune des caresses de Marilyn, il avait frissonné de tout son être. Quand elle l’avait embrassé, il avait savouré le parcours de ses lèvres sur sa bouche, sa joue, ses yeux, son front ; il en avait eu le vertige. Sa peau tout entière aspirait au contact avec la jeune fille.
Le bip signalant que l’eau était chaude avait retenti juste au moment où il tira le rideau de la douche. Max n’était pas du tout fan de spa et autres activités aquatiques ; la douche était pour lui quelque chose de nécessaire, mais il n’y prenait aucun plaisir, et ne s’y attardait jamais.
Sa petite chambre d’étudiant était ingénieusement agencée. Dans une vieille demeure 1900, aux plafonds à plus de quatre mètres de haut, la pièce de douze mètres carrés avait été transformée en un duplex de plus de vingt mètres carrés habitables par l’un des oncles de Max qui était menuisier. Lors d’un repas de famille, il avait parlé de sa chambre qui était plus haute que longue, et de la perte de place que ça représentait, sans compter l’impression d’écrasement qu’il y éprouvait. L’oncle de Max avait immédiatement réagi en lui demandant les mesures exactes de la pièce, et en quelques croquis, il lui avait proposé une transformation radicale en ajoutant une mezzanine posée sur quatre pilotis de bois, transformant ainsi la chambre en ingénieux petit appartement à deux niveaux.
La modeste cabine de douche-toilette, qui occupait à peine plus d’un mètre carré dans un coin, s’y prêtait parfaitement puisqu’elle avait été rajoutée sans que la cloison monte jusqu’au plafond. La mezzanine pouvait tout naturellement se poser dessus. Il disposait ainsi, au premier niveau de son « appartement », de sa petite salle d’eau, de sa kitchenette et d’une penderie, et à l’étage d’un vrai lit à deux places, de son bureau, une planche posée sur tréteaux pour ne pas bloquer la lumière de la fenêtre haute de près de trois mètres, dont il pouvait à présent ouvrir le vasistas, ce qui n’avait été possible auparavant qu’à l’aide d’une longue tige, difficile à manier.
Il eut à peine le temps de grimper à l’étage par l’échelle de meunier avec sa théière, que son smartphone vibra.
— Salut, on se voit demain ? Tu as cours quand ? écrivit Marilyn.
Il était ravi qu’elle réagisse aussi rapidement. Il lui aurait très certainement posté un message à peine installé.
— À la pause de dix heures et au repas de midi si tu veux ?
— Midi, ce sera plus tranquille, tu seras au premier ou au deuxième service ?
— Le premier, tu peux y être aussi ?
— Oui, je finis à temps.
— Marilyn, c’était magique…
— Oui Max, fais de beaux rêves !
— De toi, oui ! Dors bien, à demain.
— Je t’embrasse…
— Je t’embrasse !
Max était surpris de se retrouver dans le même état que lorsqu’ils s’étaient longuement embrassés un peu plus tôt dans la soirée. Il n’en revenait pas de l’effet que lui faisait la jeune fille, et un sourire indélébile s’était collé sur son visage. Il se sentait bien ! Euphorique, il se retenait de sauter de joie. Il se laissa tomber sur le lit et contempla l’échange de textos. Chaque réplique de Marilyn le faisait frissonner comme si elle était couchée à ses côtés, et qu’elle les murmurait dans le creux de son oreille.
Une nuit magique
Mulhouse, décembre 2015
Dans le brouhaha de la cantine, Max et Marilyn devaient se pencher en avant et hausser le ton pour se comprendre.
— T’as quel âge au fait ?
— J’ai eu dix-huit ans cet été, et mon permis, ajouta-t-il avec un sourire empreint de fierté…
— Et t’as donc redoublé ?
— Oui, la quatrième : un passage à vide, j’avais des crises de somnambulisme, je me réveillais en criant, découvrant mes parents inquiets à mes côtés, généralement dans le salon de notre maison.
— Ça, c’est pas cool. Et ça va mieux ?
— Oui, ça n’a duré qu’un an. Je crois que ça a coïncidé avec le décès de mon grand-père et de ma grand-mère. Sinon ça n’allait pas trop mal. Le problème est que c’était devenu assez fréquent, et que j’étais HS le lendemain, tout comme mes parents d’ailleurs. Parce que moi, je ne me souvenais pas de grand-chose, alors qu’eux, ils avaient un ado qui se mettait à hurler en plein milieu de la nuit. À force, ma mère a fini par m’avouer qu’elle craignait de s’endormir, tellement elle avait peur d’être tirée du sommeil par mes hurlements.
Marilyn était tellement absorbée par sa discussion avec Max qu’elle venait juste de comprendre qu’elle avait machinalement mangé des épinards, le légume qu’elle détestait par-dessus tout, surtout ceux de la cantine ! Elle fit une grimace de dégoût.
— Sont pas terribles, ces épinards, hein ?
— Euh, non pas du tout ! En fait je déteste ça !
Max, diplomate, ne releva pas. Elle avait presque vidé son assiette. Pour quelqu’un qui détestait ça, c’était plutôt bizarre.
— Est-ce que ça te tenterait de venir manger chez moi ce soir ?
— Dans ta chambre d’étudiant ? Tu as de quoi faire la cuisine ?
— Oui, même si je mange souvent au restau U, j’ai une kitchenette dans mon petit appart, tu verras.
Ils se quittèrent sur de longs baisers, chacun se dirigeant vers sa salle de classe respective.
L’après-midi se passa comme dans un rêve pour les deux adolescents, qui eurent chacun droit à quelques remarques de la part de leurs profs pour les ramener à la réalité.
Après son cours de sport, le dernier de la journée, Max fit un crochet par l’épicerie libanaise, non loin de son logement, pour y faire quelques courses. Il aimait bien expérimenter de nouvelles recettes.
Enfant, il adorait rester à la cuisine pour observer sa mère. Quand elle faisait des pâtisseries, le but était de tremper le doigt dans les pâtes et les mélanges sucrés, et quand elle cuisait du salé, il l’observait préparant les sauces. L’odeur des marinades de viande au vin blanc était sa madeleine de Proust à lui. Dès qu’il sentait quelque chose d’approchant, dans un restaurant, il était projeté dix ans en arrière dans la cuisine de ses parents. L’alchimie des sauces brunes passait juste après ; elles étaient trop chaudes pour y tremper le doigt, mais avec une petite cuillère, sa mère lui faisait toujours goûter. Et automatiquement, il en retint quelques techniques qu’il s’appliquait à remettre en œuvre ou à changer depuis qu’il avait son « duplex ».
Ce soir, ce serait sauce curry au poulet et lait de coco, accompagné de riz basmati.
Il comprit soudain qu’il n’avait pas pris la peine de demander à Marilyn ce qu’elle aimait. Une pointe d’inquiétude le traversa. Pourvu qu’il ne se retrouve pas avec la même mine de dégoût que lorsqu’elle avait fini ses épinards, qu’elle détestait. En tout cas elle n’était pas végétarienne, elle avait mangé sa viande à midi.
Il déballa ses légumes (quelques champignons, un chou blanc, une salade), mit la viande de poulet au frigo, que son oncle menuisier avait insisté pour positionner en hauteur, afin qu’il n’ait pas à se baisser à chaque fois qu’il y chercherait ses affaires. « Tu chercheras moins souvent tes casseroles que quelque chose dans le frigo. » Il avait parfaitement raison ; en outre, l’aménagement était très équilibré. Trois caisses en plastique transparent sur roulettes, rangées sous le plan de travail, contenaient les ustensiles les moins courants. Le frigo, ainsi que le four micro-onde, étaient à hauteur d’homme, l’un sous l’autre.
Tout était prêt. Il se demandait ce qu’elle buvait. Il avait quelques « Despé » au frigo. Il possédait aussi trois bouteilles de vin blanc ou rouge, mais il ne savait pas si elle buvait déjà du vin. Lui-même n’en ouvrait que rarement, avec certains de ses amis, mais la plupart se contentaient de bières, ou d’alcools nettement plus forts lors des soirées étudiantes.
Marilyn lui avait dit qu’elle le rejoindrait vers dix-huit heures trente. Elle voulait passer chez elle avant, pour déposer ses affaires et informer ses parents. Max se doucha rapidement, comme d’habitude, puis s’attaqua à la découpe de la viande en dés. Il hacha des échalotes, coupa le chou en lamelles, les champignons en quarts. Il les mettrait à la fin pour qu’ils restent croquants.
Un « ping » retentit derrière lui. Sur son portable s’affichait un message laconique d’Anthony :
— T’es libre ?
— Non pas ce soir, tapa Max de l’index de la main gauche pour ne pas salir son clavier.
— Tu sors ?
Max soupira ; il se lava les mains, pour dialoguer plus confortablement avec son ami.
— Non, mais je ne suis pas seul…
— Sérieux ? Le moine a trouvé la perle rare ?
— ;-P
S’ensuivirent encore quelques smileys, puis ils se quittèrent. Max ne répondrait plus aux messages ce soir : il ne voulait pas se laisser distraire.
Dix-sept heures quarante-cinq : il lui restait trois quarts d’heure pour finir le travail. Il mit le chou et les échalotes à revenir et ajouta un poivron jaune. Il fit fondre un bouillon de légumes dans un bol d’eau bouillante, et rajouta le tout dans la poêle avec la viande, les champignons et une boîte d’ananas. Il fit mijoter doucement. Il coupa un citron vert en deux, prépara une brique de crème fraîche et ouvrit la brique de lait de coco. Il ajouterait le tout à l’arrivée de Marilyn, ainsi que quelques épices.
« Putain, faut que j’arrête de baliser », murmura-t-il entre ses dents. Il ne cessait de se demander si elle aimerait, ou si elle avait une allergie alimentaire, ou simplement si elle était indifférente à la bonne cuisine…
La sonnerie retentit à dix-huit heures quarante : elle était plutôt ponctuelle. Il appuya sur le bouton d’ouverture de porte sur l’interphone. Une minute plus tard, elle frappait à la porte. Elle affichait un grand sourire.
— Salut, Max.
— Salut, Marilyn, entre.
Ils s’embrassèrent, longuement, langoureusement. Marilyn le titilla de sa langue.
— Tu ne veux pas te débarrasser de ta veste ? demanda Max.
— Non, euh… si ! Bien sûr ! répondit-elle en riant, aussi troublée que Max. Tiens, je t’ai amené quelque chose.
Elle lui tendit un sachet en papier.
— C’est quoi ?
— Un sac en papier !
— Cool ! J’aime beaucoup le papier, surtout le brun, répondit-il en entrant dans son jeu.
— Et en plus il est fourré !
— Ah, donc il faut que je regarde à l’intérieur ?
— T’es pas obligé, dit-elle en accrochant sa veste.