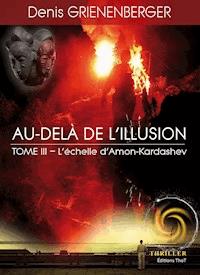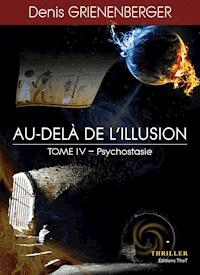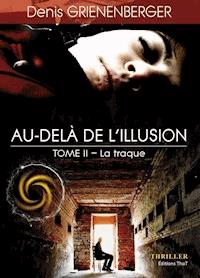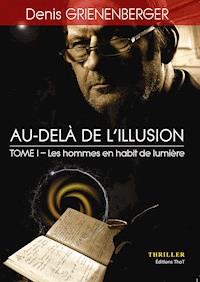
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions ThoT
- Kategorie: Krimi
- Serie: Au-delà de l'illusion
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Entre thriller, science-fiction et histoire, l’auteur mélange habilement les genres et nous entraine dans une quête saisissante !
La vie de Marc bascule le jour où il découvre, dans une librairie strasbourgeoise, un livre d’apparence fort anodine. Brusquement, il acquiert l’une des plus incroyables facultés dont un homme puisse rêver. Mais il n’est pas seul…
Marc est un homme sans histoires jusqu’à cette découverte incroyable : un petit livre lui procure les facultés d’un passe-muraille. Ce pouvoir va bouleverser le cours de son existence. Malheureusement, nous ne sommes pas dans la nouvelle de Marcel Aymé. D’abord, cette capacité a certaines limites. Mais il y a pire ! Il la partage avec un tueur en série, impitoyable et insaisissable, mieux connu dans la presse sous le nom de la Mâchoire. Leurs chemins vont se croiser et la frontière qui sépare l’illusion du réel se révélera bien plus ténue qu’il ne l’avait imaginé…
Très vite, le monde de la pègre et des services secrets se lance à la poursuite des deux passe-murailles pour s’approprier leurs facultés. Accompagné d’Emmanuelle, avec qui il partagera son savoir et ses nombreuses expériences de téléportation, Marc devra affronter une traque implacable.
Plongez dans le premier tome de cette saga où se mêlent enquête policière (pour public averti !), histoire contemporaine, nouvelles technologies, spiritualité et surnaturel.
EXTRAIT
Strasbourg, vendredi 2 décembre 2005
— Oui, ceux que j’ai déjà eu l’occasion de lire sont excellents ! assurait une jolie cliente à qui je donnais vingt-cinq ans, grande, brune, les cheveux très courts, habillée très simplement.
Elle me rappelait Cécile de France dans l’Auberge espagnole. Le vendeur de la librairie Poussière de livre – qui était plus moderne que poussiéreuse – discutait avec elle d’Éric-Emmanuel Schmitt, un de mes auteurs favoris. Je me disais que j’aurais pu intervenir et ajouter mon grain de sel… et accessoirement tenter ma chance auprès de la jolie brune. Mais bon, s’immiscer dans une discussion de but en blanc aurait semblé bizarre.
Je fantasmai, me disant que je pourrais la rattraper en sortant et lui adresser la parole sur ce thème, mais je savais au fond de moi que ce n’était pas « mon style ». Probablement une façon de trouver un prétexte à ma timidité…
Après avoir longuement rêvé et hésité à quitter la librairie pour la suivre, je replongeai dans les rayons avec un soupir résigné.
A PROPOS DE L’AUTEUR
Originaire d’un petit village d’Alsace,
Denis Grienenberger, informaticien pour le compte d’un grand groupe pharmaceutique suisse, est fasciné par les mondes parallèles. Ce passionné de technologie, de musique et de sports de plein air, continue dans sa lancée avec le deuxième volet des aventures de Marc et Emmanuelle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 466
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Présentation de l'auteur
Originaire d’un petit village d’Alsace, Denis Grienenberger, informaticien pour le compte d’un grand groupe pharmaceutique suisse, est fasciné par les mondes parallèles. Ce passionné de technologie, de musique et de sports de plein air nous livre ici un premier roman remarquable, un cocktail explosif où se mêlent enquête policière (pour public averti !), histoire contemporaine, nouvelles technologies, spiritualité et surnaturel.www.audeladelillusion.com
L’utilisation et l’existence des Portes des mondes doivent être soigneusement dissimulées au grand public.Codex des gardiens du dharma
« Ne crains pas », dit l’Histoire, levant un jour son masque de violence – et de sa main levée elle fait ce geste conciliant de la Divinité asiatique au plus fort de sa danse destructrice. « Ne crains pas, ni ne doute – car le doute est stérile et la crainte est servile. Écoute plutôt ce battement rythmique que ma main haute imprime, novatrice, à la grande phrase humaine en voie toujours de relation. Il n’est pas vrai que la vie puisse se renier elle-même. Il n’est rien de vivant qui de néant procède, ni de néant s’éprennent. Mais rien non plus ne garde forme ni mesure, sous l’incessant afflux de l’Être. La tragédie n’est pas dans la métamorphose elle-même. Le vrai drame du siècle est dans l’écart qu’on laisse croître entre l’homme temporel et l’homme intemporel. L’homme éclairé sur un versant va-t-il s’obscurcir sur l’autre ? Et sa maturation forcée, dans une communauté sans communion, ne sera-t-elle que fausse maturité ? »
Saint-John Perse, extrait de l’Allocution au banquet Nobel du 10 décembre 1960
Prologue Vernet-les-Bains, dimanche 17 avril 1718
Douze cavaliers, armés de leurs épées, montaient vers la tour surplombant la vallée du Cady, qui prend sa source dans le massif pyrénéen du Canigou. Ils étaient tous sombrement vêtus, une large capuche leur couvrant la tête. Le sentier était raide et les chevaux peinaient sur les éboulis, soulevant la poussière et faisant jaillir des étincelles avec leurs fers. Il était 5 heures du matin, les lueurs de l’aube commençaient à peine à pointer à l’est. La forêt dormait encore. Pas un bruit.
L’homme de tête fit un signe du bras sans se retourner et arrêta sa monture. Les autres l’imitèrent. D’un geste vers le sol, il signifia qu’ils allaient continuer à pied. Le chemin s’enfonçait à présent dans une partie de la forêt si dense qu’il devenait impossible de chevaucher entre les pins.
Ils ne se trouvaient plus qu’à une lieue de leur but : la tour de guet. Comme tout le territoire environnant, celle-ci dépendait de l’abbaye de Saint-Martin-du-Canigou depuis le début du millénaire. Le prieuré avait été fondé avant l’an mille par le comte Guifred de Confient ; l’un des cavaliers comptait parmi ses lointains descendants.
Ils débouchèrent sur une vaste clairière, la tour en son centre. Arrivé au pied du bâtiment, l’un des hommes se saisit d’une corde qu’il tendit entre deux arbres à hauteur de hanche. Ils y attachèrent leurs chevaux. Sans tarder, le groupe passa à l’arrière de l’imposant édifice ; leur guide frappa un coup bref, deux autres rapides, et enfin, après une pause plus longue, un dernier.
La porte métallique massive s’ouvrit de l’intérieur. Un homme vêtu de noir les fit entrer. Ils descendirent sur leur gauche l’escalier qui menait à une vaste salle voûtée, ronde, d’une quinzaine de mètres de diamètre, à peine éclairée par huit torches accrochées au mur. Au centre, en contrebas, une fosse elle aussi circulaire, creusée à même le sol, ressemblait à un bassin vide.
Ils étaient tous dans la force de l’âge : la quarantaine, forts et mûrs, des hommes décidés, habitués à commander. À leurs habits, on distinguait pourtant une différence d’origine : certains portaient des tenues très simples, mais propres, d’autres plus richement décorées, réalisées dans des étoffes rares. Pourtant, le groupe semblait harmonieux, malgré ces différences. Ces hommes avaient visiblement un but commun et se connaissaient.
Ils se dévêtirent totalement, ôtant jusqu’à leurs colliers et bijoux, pour mettre de grandes robes de toile claire, que l’homme qui les avait accueillis leur avait apportées. Ce dernier ramassa leurs habits et les monta au rez-de-chaussée.
En partant, il referma la lourde porte de chêne, bardée de ferrures anciennes, qui protégeait la cave, laissant les douze hommes seuls, dans le silence. À l’invitation muette de leur maître, qui leur montra la fosse, ils descendirent à l’intérieur du cercle. Seul le léger crépitement des torches troublait le profond silence.
Le meneur du groupe prit la parole :
— Mes frères, nous sommes réunis en ces lieux parce que vous avez tous gravi les échelons de notre société. Il est temps à présent de vous en révéler l’ultime étape, qui n’est qu’un commencement.
Le maître de cérémonie s’empara d’une corde, la déroula le long du muret en passant derrière chacun des onze hommes, et en noua les extrémités afin de fermer le cercle.
— Veuillez, je vous prie, vous recueillir.
Il resta silencieux un long moment ; puis il reprit la parole :
— Je vais à présent vous conduire à mes dirigeants. En effet, vous-mêmes êtes des maîtres dans ce monde, mais la récompense que vous avez si durement acquise, c’est de redevenir… des élèves.
Aucun d’eux ne répondit, mais leurs regards se croisaient et en disaient long sur leur perplexité. Quelle nouvelle épreuve leur réservait leur maître maçon ? Ils avaient franchi tous les degrés initiatiques au fil des ans ; ils se trouvaient au niveau ultime, le 33e, et leur maître leur annonçait qu’ils allaient redevenir des élèves !
Ce dernier fit quelques rapides gestes en avant. L’air se mit à vibrer comme si une chaleur intense avait envahi le cercle. Ils se regardèrent encore plus surpris, devinrent translucides et tous, ainsi que la corde qui les entourait, disparurent d’un petit bruit sec qui résonna dans la pièce vide, éclairée par les torches.
Sous la poussière Strasbourg, vendredi 2 décembre 2005
— Oui, ceux que j’ai déjà eu l’occasion de lire sont excellents ! assurait une jolie cliente à qui je donnais vingt-cinq ans, grande, brune, les cheveux très courts, habillée très simplement.
Elle me rappelait Cécile de France dans l’Auberge espagnole. Le vendeur de la librairie Poussière de livre – qui était plus moderne que poussiéreuse – discutait avec elle d’Éric-Emmanuel Schmitt, un de mes auteurs favoris. Je me disais que j’aurais pu intervenir et ajouter mon grain de sel… et accessoirement tenter ma chance auprès de la jolie brune. Mais bon, s’immiscer dans une discussion de but en blanc aurait semblé bizarre.
Je fantasmai, me disant que je pourrais la rattraper en sortant et lui adresser la parole sur ce thème, mais je savais au fond de moi que ce n’était pas « mon style ». Probablement une façon de trouver un prétexte à ma timidité…
Après avoir longuement rêvé et hésité à quitter la librairie pour la suivre, je replongeai dans les rayons avec un soupir résigné. Je n’étais vraiment pas d’un naturel spontané.
C’était un magnifique vendredi superbement ensoleillé, le 2 décembre 2005. J’avais choisi d’aller faire un peu de shopping au centre-ville de Strasbourg, après avoir réussi à quitter le bureau, peu après 16 heures. Je décidai de me rendre chez mon bouquiniste habituel, dans une ruelle adjacente à la cathédrale.
Tout le quartier, déjà décoré en vue des fêtes, se remplissait de touristes venus visiter le fameux marché de Noël. Je n’avais aucune chance de pouvoir me déplacer à vélo et devais le pousser dans la foule. Il n’y avait qu’au printemps et en automne que je pouvais circuler plus ou moins bien autour de la cathédrale.
Cela faisait quelques années que je me documentais sur l’ésotérisme, que je pratiquais en solitaire le yoga, la manipulation d’énergies à laquelle je ne croyais pas beaucoup au départ, mais dont j’étais à présent fermement convaincu.
À trente-cinq ans, autodidacte je pouvais dire que je savais obtenir quelques effets et sensations pour le moins inhabituels, et ce, sans aucune substance hallucinogène ! J’en parlais de temps en temps à quelques amis, mais cela n’allait pas beaucoup plus loin : mon côté introverti me poussait le plus souvent à garder mes impressions pour moi.
Sur un plan affectif, je n’étais pas un célibataire endurci, mais au bout de quelques ruptures, j’avais appris à ne pas « m’engager » trop vite. Ma dernière amie m’avait quitté six mois auparavant, et à part quelques relations occasionnelles (en ville c’est quand même beaucoup plus facile !) je n’avais personne dans ma vie.
Sur le plan professionnel, mon métier de contrôleur de gestion dans un grand groupe financier ne me permettait guère d’aborder des thèmes tels que l’ésotérisme, et j’avais de ce fait tracé une frontière entre mes vies spirituelle, professionnelle, familiale et privée.
Quant à mes passe-temps, je pratiquais beaucoup de sport : vélo de course (presque tous les week-ends) et montagne. Je faisais partie du Club alpin depuis mes 23 ans. Tous les étés, je gravissais plusieurs sommets en Suisse et dans les Alpes françaises, et faisais de même l’hiver en ski de randonnée.
Je m’apprêtais donc à passer en caisse et quitter la librairie (toujours avec le secret espoir de revoir la brune de tout à l’heure !), lorsque je remarquai ce petit fascicule coincé et légèrement plié dans une étagère bourrée à craquer. N’aimant pas voir un livre abîmé, je voulais simplement le remettre en place et, bien entendu, j’y jetai un rapide coup d’œil. La couverture était recouverte de papier kraft. Le scotch qui le maintenait avait jauni et son état contrastait avec les autres livres. Je l’ouvris et lus le titre : De l’autre côté de l’illusion.
Les premières sentences avertissaient le lecteur : « votre vie va changer », « vous n’imaginez pas l’impact qu’auront ces lignes sur votre destinée si vous prenez la décision de poursuivre votre lecture », etc. Pour couronner le tout, le livre mettait l’accent sur la responsabilité qu’aurait le lecteur en s’engageant plus avant. Je trouvais cette introduction bien étrange. Est-ce que le but était d’éveiller la curiosité ou de rebuter ? Si le prix n’avait pas été aussi bas (deux euros), je l’aurais probablement laissé sur l’étagère. Mais je le mis avec le reste de la pile des livres que j’allais acheter.
Je flânai encore un peu dans les rues, en quête de pain et de quelques provisions, et je rentrai chez moi, avec mon sac à dos lesté de livres, ajoutés à mon ordinateur portable et à un sachet en plastique qui menaçait à tout moment de se rompre.
L’appartement mansardé que j’habitais se situait au cinquième étage. La vue était magnifique, mais j’avais très vite appris à marcher lentement, pour ne pas arriver hors d’haleine au « sommet », comme lors de mes courses de haute montagne où le guide nous conseillait de ralentir, « pour ménager la monture et aller loin ». À chaque fois, je me promettais d’emmener un sac plus solide pour mes courses, et à chaque fois je l’oubliais, et j’étais obligé de passer le sachet d’une main à l’autre à mi-parcours, tant il me sciait les doigts. Mais dès que j’ouvrais l’antique porte en chêne de mon appartement au dernier étage de cette vieille maison à colombage du XVIe siècle, je me disais que je faisais partie des privilégiés de cette ville.
J’avais trouvé cet appartement sept ans auparavant. La propriétaire, une vieille dame de 84 ans à l’époque, Mme Steinmetz, m’en demandait un loyer dérisoire. J’avais compris dès le début qu’elle ne cherchait pas à gagner beaucoup d’argent, mais qu’elle était en quête d’une compagnie.
Nous avions sympathisé dès sa première visite, quelques semaines après mon emménagement dans ces lieux chargés d’histoire. Je me rappelle encore ma surprise lorsque je vis la vieille dame devant ma porte, un samedi après-midi. Elle avait pris le risque de grimper les cinq étages sans même savoir si j’étais chez moi ! Ce fut avec un sourire et un regard pétillant qu’elle me souhaita le bonjour et me proposa de partager quelques chocolats qu’elle venait d’acheter dans une confiserie.
Je réalisais qu’elle était encore en grande forme pour son âge et qu’elle faisait de longues promenades quotidiennes pour ne pas rester cloîtrée dans sa maison de retraite. Elle n’avait pas du tout le look d’une vieille dame. On lui donnait la soixantaine plutôt que ses 84 ans ! Elle s’habillait de façon moderne, en pantalon et chaussures de marche, toute menue, portant ses affaires dans un petit sac à dos Mammut.
C’était la première chose qui m’était venue à l’esprit pour engager la conversation : son sac à dos, d’une des meilleures marques de matériel de montagne, un fabricant suisse, bien entendu, que j’appréciais tout particulièrement.
J’appris qu’elle s’était mise à la randonnée et aux courses de haute montagne avec son mari, après la guerre. Celui-ci avait survécu au camp des Malgré-nous à Tambov (Russie) et à son retour, ils se mirent ensemble à explorer les montagnes suisses dont il avait eu un aperçu à la fin la guerre, lors de son long voyage depuis la Russie. Nous avions de nombreux sommets en commun à notre actif, à seulement quarante ou cinquante ans d’intervalle.
Lors de sa deuxième visite, un mois plus tard, elle me montra ses cartes topographiques des années cinquante. Elles étaient incroyables. Que ceux qui veulent encore nier le changement climatique se procurent ces vieilles cartes ! Sur les massifs montagneux des Alpes, on ne voyait que du blanc, dans les zones où actuellement la rocaille prédomine. Les glaciers recouvraient tout ! C’était impressionnant. Nombre de sommets, beaucoup plus faciles d’accès, étaient le but de simples randonnées glaciaires alors que maintenant, pour y parvenir il faut tout d’abord escalader les parois polies par les glaciers à présent fondus, et ensuite s’attaquer à des arêtes rocheuses rendues instables par le manque de glace.
Au bout d’un an, à raison d’une visite mensuelle, nous étions devenus de véritables amis. Je me disais même que j’aurais aimé trouver une telle âme sœur dans ma tranche d’âge. Je lui faisais d’ailleurs souvent le compliment, lui déclarant que j’étais né cinquante ans trop tard, ou elle cinquante ans trop tôt ! Elle me traitait de vil flatteur, et moi je protestais, bien entendu, de ma bonne foi.
L’année de ses 89 ans, en mai 2003, nous étions attablés au café Déclinaison chocolat bar (nos rencontres se faisaient toujours sous le signe du chocolat !), dans la rue du Fossé-des-Tailleurs, entre la place Gutenberg et la cathédrale. Elle n’hésita pas longtemps. Je sentis qu’elle avait quelque chose d’important à me dire. À peine la serveuse s’était-elle éloignée qu’elle m’apprit qu’elle avait un cancer du poumon, elle qui n’avait jamais fumé ! Elle m’informa rapidement de sa décision de ne pas se faire soigner et, d’après les médecins, elle en avait encore pour quelques mois, tout au plus jusqu’à la fin de l’année.
J’allais lui prodiguer quelques banalités rassurantes du style « vous êtes une force de la nature, vous allez tous nous enterrer », mais elle ne me laissa pas même ouvrir la bouche. D’un geste de la main, elle m’intima le silence, et me dit :
— Marc, je n’ai aucune intention de mourir à petit feu dans un hôpital. Je n’ai aucun goût pour la souffrance, je ne veux pas de chimio, ni d’opération, d’autant plus que mes chances de guérison sont très très faibles. Je n’ai pas d’enfants : mon mari et moi n’avons jamais pu en avoir. Je suis fille unique et je n’ai pas d’héritiers. Je vous demande donc de m’accompagner vendredi prochain chez le notaire, pour signer le testament que j’ai fait rédiger en votre faveur. Je vous lègue l’appartement que vous occupez, ainsi qu’un terrain avec une vieille ferme dans les Vosges, dans la région de Wasselonne.
Je restai silencieux. La première chose qui me vint à l’esprit fut que j’allais perdre une amie. Cette chère Mme Steinmetz (que j’appelais Nicole depuis quelques mois) allait disparaître de ma vie ! Mes propres grands-parents étaient partis alors que j’étais encore tout jeune, je n’en conservais donc qu’un vague souvenir. Nicole était devenue ma grand-mère et une amie. Et voilà qu’elle m’annonçait sa disparition prochaine !
Ce jour-là, nous ne parlâmes pas beaucoup. Je lui tenais une main, cette vieille main toute fine, qui resterait gravée dans mon esprit pour toujours, si fragile et si forte à la fois, couverte de taches de vieillesse. Elle disait que c’étaient ses taches de rousseur qui avaient migré dans ses mains. Nous buvions notre thé et dégustions nos chocolats dans le silence, et pourtant nos regards étaient pleins de chaleur. Aurait-elle eu quelques années de moins, je crois que j’aurais été vraiment amoureux d’elle.
Avant que je prenne congé d’elle, elle insista encore une fois :
— Marc, je vous en prie, faites-moi plaisir, dites-moi oui. Et venez signer les documents avec moi, vendredi.
Je la regardai longuement et lui soufflai simplement : « oui. »
Paradoxalement, ce fut elle qui me remercia. Un soulagement visible se lisait sur son visage, comme si elle avait accompli sa dernière tâche.
Je la raccompagnai un peu, mais comme à son habitude, elle ne voulait pas que j’aille avec elle jusqu’à sa maison de retraite, un demi-kilomètre plus loin. « Ce n’est pas un endroit pour les jeunes », disait-elle. Ce fut ainsi que Nicole me légua son appartement, et je passais du stade de locataire à celui de propriétaire sans dépenser un centime !
Elle me transmit également sa petite ferme dans les Vosges, qui se révéla être un magnifique édifice de pierre de 200 mètres carrés habitables, parfaitement entretenue par une famille du village de Wasselonne, Pierre et Élise Schmitt. J’appris par eux que Nicole y séjournait souvent l’été, mais les dix mois restants, la maison était vide, régulièrement nettoyée et aérée par ce couple de jeunes retraités. Leurs parents décédés étaient amis avec Nicole et son mari.
Elle me légua non seulement ces deux biens, mais également une somme rondelette, qui me permettrait de régler les taxes liées à la succession sans rien devoir mettre en vente.
Enfin, le fait ne plus payer le loyer me donnait la possibilité de prendre totalement en charge l’entretien de ma ferme des Vosges à Wangenbourg-Engenthal, surnommée « la Suisse d’Alsace ». L’habitation se nichait dans un écrin de verdure, à 905 mètres d’altitude, proche du Schneeberg (mont des Neiges), point culminant de la commune, du haut de ses 961 mètres.
J’étais comblé par ce dernier cadeau de Nicole. J’allais pouvoir passer mon temps en pleine nature, à me balader au milieu de ces vallons, de tous ces châteaux anciens, et de ces cascades bien utiles quand le soleil taperait trop fort. Elle m’avait offert ce petit coin de paradis à 40 kilomètres à peine de la ville où je travaillais.
Comme d’habitude, je mis l’ensemble des livres sur l’étagère des lectures programmées, dans mon salon. Ils constituaient ma « réserve ». J’en avais toujours au minimum une dizaine en cours, et suivant mes humeurs, mes envies et la qualité du livre, je finissais l’un avant l’autre, indépendamment du moment où j’en avais commencé la lecture.
Et comme je suis un grand lecteur, une fois lus, mes livres atterrissaient dans un carton, avant de rejoindre ceux de la cave (qui commençait à se faire bien petite !). Seuls les chefs-d’œuvre prenaient place sur une deuxième étagère : celle des « livres lus et à conseiller », cette fois-ci dans mon bureau.
Mon F4, rue du Puits, à cinq minutes à pied à l’ouest de la cathédrale, était tout en longueur, d’une belle surface, encore augmentée de nombreux placards et rangements situés sous les rampants.
Mon appartement se présentait ainsi : au nord, l’entrée ; puis la cuisine, en hêtre clair et en granit, aménagée de façon contemporaine, avec une petite table dans le prolongement du plan de travail où je prenais tous mes repas de célibataire ; ensuite, la salle à manger, où trônaient une chaîne NAD équipée de haut-parleurs B&W (acquisition que j’avais effectuée grâce à ma première prime professionnelle, dix ans plus tôt) et une vieille platine CD Marantz, un bijou de classe A, que j’avais trouvée d’occasion, le modèle neuf valait le prix d’une petite voiture ! Un fauteuil, un canapé-lit, une télé dont je ne me servais presque jamais, sauf pour regarder quelques DVD quand j’étais trop flemmard pour aller au cinéma. La déco pouvait sembler assez rudimentaire : seule une cloison restait disponible : j’y avais accroché des photos de montagne ramenées de mes différentes courses en Suisse. Au sol, un épais tapis blanc contrastait avec le vieux parquet en chêne sombre, de la même teinte que les massives poutres pluricentenaires apparentes. Dans les rampants, des livres, et encore des livres, ma passion.
De l’autre côté du couloir, mon bureau, dont une cloison était couverte d’étagères, elles aussi remplies de livres, un canapé pliable permettait d’en faire une chambre d’amis ; j’y avais installé un plan de travail sur tréteaux, encombré de papiers au milieu desquels émergeait un iMac 20’.
Au bout de l’appartement, ma chambre, toute sobre, une armoire à portes coulissantes en miroir, un lit, et en guise de tables de chevet, de simples cubes en bois, encombrés bien évidemment de livres.
Le souvenir de la dernière lettre de Nicole, qui m’avait été transmise par l’intermédiaire de son notaire, quelques jours après son décès, était encore très vif. Je l’avais reçue avec tous les documents officiels que je devais signer pour devenir définitivement propriétaire des lieux. Les formulaires étaient accompagnés d’une longue et émouvante missive.
Elle me déclarait en substance : « J’espère, mon cher Marc, que vous signerez ces papiers et que vous ferez bon usage de ces quelques biens qui me restaient sur cette Terre… », et pour finir elle me témoignait sa reconnaissance et me disait adieu : « Enfin, je vous remercie pour ces dernières années que nous avons passées ensemble. Je me permets d’écrire ensemble, car nos rencontres mensuelles ont été placées sous le signe d’une telle complicité et d’une telle richesse, qu’elles ont rempli le mois qui nous séparait de la rencontre suivante. C’est à un ami que je dis adieu, et qui sait, peut-être au revoir dans une autre vie ? »
J’avais pleuré tout l’après-midi, chez moi. Je passais de la crise de larmes au rire, je n’arrivais plus à contrôler mes émotions. Elle m’avait interdit d’aller la voir à l’hôpital, et je la soupçonnais d’avoir fait procéder à une euthanasie afin de couper court à trop de souffrance.
Batiste de Cambray Cantaing-sur-Escaut, jeudi 12 septembre 1275
Batiste chevauchait à toute allure à côté de son frère Pierre vers Cantaing-sur-Escaut, petit village situé à un peu plus d’une lieue au sud-ouest de Cambrai. Pierre était venu frapper à sa porte avant que ne retentît l’angélus, tôt le matin. Il avait enfourché son cheval avant l’aube pour ramener son frère au chevet de leur mère mourante. Elle avait voulu absolument lui parler avant de rendre son dernier soupir.
Les deux hommes dans la force de l’âge, 33 ans et 37 pour Batiste, se suivaient au grand galop. Le trajet leur prendrait moins d’une heure à allure soutenue, mais ils se concentraient sur le chemin trempé et rendu dangereux par la dernière averse. Ils n’avaient aucune envie de parler, plongés dans leurs pensées devant la gravité de la situation. Leur mère, si forte, elle qui avait toujours su les nourrir, les élever et les aimer, allait quitter ce monde : c’était encore inconcevable pour Batiste.
Elle avait atteint l’âge respectable de 72 ans, malgré sa dure vie de labeur dans les champs, et dans la cave de la maison, où elle filait du lin lorsque la fin de la saison des travaux extérieurs lui en laissait le loisir.
Son frère lui avait appris que cela faisait quelques semaines qu’elle s’arrêtait au milieu de ses occupations, pour presser sa main sur son bas-ventre. Un mal violent la rongeait de l’intérieur. Mais elle ne s’en était jamais plainte. À présent, après trois jours sans arriver à se lever et des nuits de fièvre violente, elle n’était plus que l’ombre d’elle-même. Les derniers sacrements lui avaient été octroyés la veille au soir, mais elle s’accrochait à la vie, car elle voulait revoir ses six enfants à son chevet avant de quitter ce monde.
Il était presque 8 heures lorsque les deux hommes, entourés d’un nuage de poussière, arrivèrent dans la cour de la ferme familiale, un peu à l’écart de la rue principale du tout petit hameau, sur la route qui menait à Noyelles-sur-Escaut.
De grands peupliers entouraient la ferme et la protégeaient du vent. La famille de Batiste, guère riche, possédait néanmoins une belle surface de terrain autour du village, et ils en avaient bien vécu. Leur père, décédé dix ans plus tôt, tué net par le coup de sabot d’un taureau un peu trop excité, avait travaillé dur pour eux dans cette ferme. Quatre des enfants y étaient restés, alors que Batiste et son frère étaient allés trouver du travail à la « ville » de Cambrai. Tous deux s’étaient établis dans le tissage du lin, et la qualité de leurs tissus avait commencé à faire leur renommée.
Les deux hommes furent accueillis par leur sœur aînée, Marie, alertée par les aboiements des chiens. Après une brève accolade empreinte de gravité, ils la suivirent, sans un mot, au premier étage de la maison, dans la chambre de la mourante.
À la demande de leur mère, les deux fenêtres d’angle de la pièce demeuraient grandes ouvertes, baignant l’espace de lumière, contre toute tradition : « Je veux mourir en plein jour, en voyant le soleil, entourée de mes enfants », avait-elle exigé la veille.
Il faisait déjà beau et chaud en ce 12 septembre 1275. Les récoltes étaient bonnes et le rouissage du lin tirait à sa fin. Le teillage allait pouvoir commencer : les tiges de lin seraient enfin séparées de la fibre. Puis viendrait le peignage, ou seconde transformation du lin : les faisceaux de fibre seraient divisés et parallélisés. C’étaient leurs parents qui leur avaient enseigné ces secrets de fabrication. Ceux qui étaient restés à la ferme continuaient la production, alors que Pierre et Batiste assuraient la transformation et la vente.
Leur mère avait convaincu le père de les envoyer en apprentissage à Cambrai, privant ainsi la ferme d’une précieuse main-d’œuvre, au début, mais favorisant par la suite un essor inespéré. Ils étaient passés du statut de simples producteurs à celui de mulquiniers : ceux qui produisaient les précieuses toiles de lin fin.
— Mère, dit Marie, en s’approchant doucement de la vieille dame alitée, tous vos enfants sont là, Pierre et Batiste également.
Les six héritiers entouraient à distance le lit de la mourante. Elle a l’air si fragile, si mince, si petite, se dit Batiste, se remémorant la femme forte, qui ne souffrait aucune désobéissance, mais qui récompensait sa progéniture d’un amour sans limites.
Elle ouvrit lentement les yeux et sourit faiblement en voyant ses six enfants réunis à son chevet.
— Pierre, Batiste, approchez-vous, dit-elle en leur tendant à chacun une main. Ma fin est proche, je le sens. J’ai lutté, mais le Seigneur va me rappeler auprès de lui. J’ai fait un rêve, cette nuit, où je voyais une lumière au bout d’un couloir sombre. Je sais que c’est là-bas que je vais bientôt me rendre. Mais avant, j’ai quelque chose à vous dire. Il s’agit d’un secret de fabrication du lin que je veux vous confier. Notre ferme est prospère et les corporations de mulquiniers de Cambrai vous ont acceptés en leur sein. À présent, il est temps pour vous de dépasser cela. Il y a plus de trente ans, votre père était descendu à la cave, portant un pot de terre rempli de braises. Il disait qu’il ne voulait pas me voir me ruiner la santé dans cette froideur humide. J’avais bien entendu répliqué que s’il se mettait à chauffer la pièce où je travaillais, la qualité du tissu que j’allais produire allait diminuer. Vous savez bien que la fibre devient plus cassante quand il fait chaud…
Elle haleta et reprit son souffle :
— Donnez-moi à boire.
Elle transpirait à présent de plus belle, le visage livide, les yeux enfoncés dans leurs orbites…
— Votre père apporta ensuite des galets qu’il avait placés dans le feu, et il les arrosa ; cela produisit une vapeur qui remplit rapidement le sous-sol. Je continuai à travailler dans une cave chaude, mais très humide, et à notre grande surprise, je pus filer un lin très fin, beaucoup plus fin que ce qui était possible jusque-là. La fibre devint plus souple mais pas cassante. De même, au tissage, je pus produire un linon beaucoup plus fin. Regardez dans le tiroir de l’armoire, dit-elle en montrant le meuble. Prenez la pièce de tissu qui se trouve tout en dessous de la pile de draps.
Ce fut Batiste qui sortit le morceau de tissu précieux, le déplia, émerveillé par sa qualité. Il était extrêmement fin, comme les feuilles d’or qu’utilisent les artisans pour dorer les statues des saints dans les églises, et pourtant étonnamment solide.
— Je vois que tu as compris l’importance de cette découverte. Cette pièce a une très grande valeur, et vous allez pouvoir en produire d’autres. Cela provoquera de la jalousie et de l’envie, mais vous maîtriserez tout cela. Adieu, mes enfants, dit-elle en écarquillant les yeux…
Son visage s’apaisa, exprimant un grand soulagement, et un léger sourire se figea pour l’éternité sur son visage ; au même instant, toute tension abandonna son corps, d’un coup : elle venait de quitter ce monde.
Un magnifique papillon orange et noir traversa la pièce, virevolta quelques instants au-dessus de la dépouille, et ressortit par l’autre fenêtre, semblant accompagner l’âme de la défunte.
Le frère cadet et la sœur cadette sanglotèrent ; tous ressentaient une grande tristesse. Marie ferma encore les yeux de sa mère et se mit à genoux à son chevet pour prier.
Les deux frères aînés quittèrent la chambre, Batiste tenant le lin précieux dans sa main. Les deux hommes s’assirent sur le banc à côté de la porte d’entrée, le regard dans le vide. Ils étaient à un tournant de leur vie, leur mère leur avait légué un trésor, ils allaient devoir s’en montrer dignes.
Des années plus tard, c’est sous le nom de « Batiste de Cambray » que furent produits ces linons (pièces de tissus) d’une finesse jusqu’alors inégalée. Cela fit la richesse de la famille de Batiste, et la renommée de ses étoffes traversa les siècles. Ses pièces de lin étaient d’une telle qualité qu’elles devinrent une monnaie d’échange détrônant même l’or au cours de certaines demandes de rançon…
Préparatifs Strasbourg, dimanche 16 avril 2006
Quelques mois après mon passage chez le bouquiniste, un dimanche soir, le 16 avril 2006, en piochant dans ma réserve de livres, je retrouvai fortuitement ce petit cahier, qui semblait vraiment insignifiant avec le papier kraft qui le recouvrait. Je revenais d’un après-midi sympa avec Hervé et Gaëlle, deux amis de longue date avec qui j’étais allé au musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg. Le bâtiment, très lumineux, tout de verre et de métal, m’avait beaucoup impressionné. Je l’avais observé souvent de l’extérieur, en particulier lors de sa construction en 1997-1998. Vu de l’intérieur, il était encore bien plus marquant. Le choix des œuvres était assez varié et très intéressant, mais l’architecture me captivait bien plus que l’exposition.
Nous avions fini l’après-midi dans l’Art café du même musée. Hervé et Gaëlle me proposèrent finalement de dîner chez eux, mais je les remerciai et déclinai l’invitation. Je voulais passer une soirée tranquille, avec un bon livre, et surtout ne pas me coucher trop tard. J’avais fait 160 kilomètres de vélo la veille, samedi, jusqu’au col du Bonhomme, dans les Vosges, et j’avais les jambes lourdes. J’avais besoin de repos. De plus, à la suite d’un après-midi ensoleillé et printanier, le temps s’était gâté. Le vent et la pluie balayaient à présent les rues de Strasbourg, dissuadant quiconque d’y déambuler.
Je me demandais encore ce qui avait bien pu me pousser à acheter ce livre. Je me disais que je n’avais plus l’âge de m’intéresser aux prétendus manuscrits contenant de fabuleux secrets, qu’on finit irrémédiablement par rencontrer chez tout bouquiniste, pour peu qu’on fouille un peu.
Je jetai malgré tout un coup d’œil. Je m’installai confortablement avec Wish you were here des Floyd en musique de fond, et m’ouvris un monbazillac : j’avais envie d’un blanc sucré. La bouteille que j’avais achetée dix ans plus tôt me tentait depuis longtemps. En égoïste, je décidai donc de déguster ce vin liquoreux que j’avais mis au frais dans un saladier rempli de glaçons. Tout en lisant le titre : De l’autre côté de l’illusion, je savourais la première gorgée : les arômes de miel, de fleur d’acacia et de pêche dominaient d’autres saveurs encore bien plus subtiles, que je ne pouvais nommer.
Je tournai la page et j’eus rapidement une sensation de vertige. La veille, j’avais un peu forcé sur mon vélo, certes, mais j’étais bizarrement nerveux et, au fur et à mesure de ma lecture, mon trouble augmentait, alors que je n’avais bu que deux gorgées de vin. Ma fatigue avait complètement disparu au profit d’une étrange excitation.
— Toi, commençait l’ouvrage…
— Que me veux-tu ? Qu’espères-tu trouver ici ?
Ces interpellations me mettaient mal à l’aise, comme si je n’avais pas le droit de lire ce livre.
— Je suis la Porte des portes, et si tu me fais confiance, le monde n’aura plus de secrets pour toi…
J’étais intrigué, attiré, et pourtant j’avais l’impression de jeter un coup d’œil interdit par le trou d’une serrure. Je continuai ma lecture, avec le secret espoir de tomber sur quelque chose de nouveau, aspiration si souvent déçue, mais ce ne serait pas le cas cette fois-ci.
— Le monde n’aura plus de secrets pour toi… Les lois que tu connais ne sont qu’un voile jeté sur la réalité ; les frontières et les distances ne sont que des pas à franchir.
Le livre se proposait d’abolir les lois fondamentales de la physique actuelle et de me donner un moyen de voyager à ma guise d’un lieu à l’autre de la planète ! Rien moins que cela !
L’ouvrage m’invitait à préparer mes clefs, c’est-à-dire des représentations personnelles d’une serrure et d’une clef, que je pouvais facilement recréer à n’importe quel endroit de la Terre. Ensuite, il suffisait de tracer quelques symboles à même le sol, à l’intérieur d’un cercle, dans lequel je me tiendrais debout. Il y avait une contrainte : il fallait créer une porte d’arrivée, et une de départ. Il était donc impossible d’atterrir à volonté en n’importe quel lieu : on ne pouvait qu’aboutir à une porte conçue au préalable, et dont il fallait avoir la clef : cela empêchait d’utiliser les portes créées par d’autres personnes, à moins d’en connaître les clefs. En revanche, il était possible, de n’importe où, de se rendre vers une porte existante.
Mais comment fonctionnaient ces portes ? D’après le livre, elles seraient là virtuellement et n’apparaîtraient (ou ne s’activeraient) qu’après l’accomplissement du rite, et le traçage de ses symboles et de ses signes sur le sol. Une fois franchies, elles disparaîtraient et se mettraient à nouveau au repos, en attente d’un prochain passage, comme une brève déchirure du voile de l’illusion qui nous entoure, qui se réparerait aussitôt après avoir été traversé. Ce premier chapitre s’arrêtait là, le reste était manquant.
Je me sentais terriblement intrigué, et j’avais bien envie d’essayer. La nuit était déjà bien avancée, il était presque une heure du matin ; le temps se calmait, à l’extérieur. Il y avait encore un peu de vent, mais plus de pluie contre les volets. Dans la quiétude nocturne, je me traitai d’idiot, me disant que j’aurais un mal fou à sortir du lit dans quelques heures pour aller travailler. Et malgré tout, j’engageai mes préparatifs pour passer de mon salon à ma chambre. Je me dis qu’il valait mieux être prudent, et se contenter d’un petit saut pour commencer. L’inconnu m’a toujours intrigué, mais jamais au point de me rendre intrépide !
Je pris un crayon et une feuille pour représenter la clef et la serrure. J’accomplis tout d’abord le rituel de création de la porte de départ et, au moment de tracer le dernier symbole par terre, il y eut comme une vibration dans l’air, très brève, comme si une surface aquatique ondulait devant moi. Le phénomène fut néanmoins tellement fugace que je me demandai si je n’avais pas rêvé. La montée d’adrénaline que je ressentis me donna la dernière pichenette de motivation, si tant est qu’il en fallût une !
J’obéis donc au même rituel dans ma chambre, et créai la deuxième porte, avec les mêmes clefs, sur lesquelles je me concentrai pendant le traçage des symboles. Et effectivement, le même phénomène se reproduisit, toujours très bref. Il ne me restait plus qu’à essayer de passer d’une porte à l’autre.
Je bus un verre d’eau froide d’un trait, fis quelques profondes inspirations à la fenêtre. Dans l’état d’excitation où je me trouvais, je ne pouvais en aucune façon m’endormir. Il me fallait aller jusqu’au bout de l’expérience…
Une soirée particulière Cologne (Allemagne), mardi 31 mai 1740
Karl Langbein était tailleur, il habitait au fond d’une impasse, dans la ville de Cologne en Allemagne. Sa maison comptait quatre étages et avait même une arrière-cour, pourvue de quelques arbres et d’un petit potager, chose assez rare en ville en 1740. Il l’avait héritée de son père, ancien tailleur également, qui lui-même avait suivi la lignée de son propre père.
Ce mardi soir du 31 mai 1740, il fêta avec sa femme Lise et ses deux enfants, Niklas, sept ans, et Jana, cinq ans, le couronnement de Friedrich II, suite au décès de son père Friedrich Ier. Friedrich II avait la réputation de vouloir se dévouer tout entier à son pays. Lise avait acheté une oie pour l’occasion, et tous s’étaient bien régalés.
Il était plus de 11 heures du soir, Karl passait une dernière fois en revue toutes les portes et fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage, lorsque soudain on frappa à l’entrée. Quatre coups brefs, assez discrets. Karl ne réagit pas tout de suite, se demandant vraiment qui pouvait bien vouloir lui rendre visite à cette heure-ci. À nouveau quatre coups brefs et modérés.
Il s’approcha de la porte, ouvrit la petite fenêtre protégée par une solide grille en fer et demanda :
— Qui est là ? Que voulez-vous ?
Il faisait noir et il ne distinguait qu’une vague silhouette encapuchonnée.
— Monsieur, vous êtes un tailleur de renom, dit l’inconnu en baissant la voix. Des brigands m’ont dépouillé de mes habits, ouvrez-moi, je vous en prie !
La demande paraissait complètement inattendue, et Karl était assez méfiant, les rues de Cologne n’étant pas particulièrement sûres, le soir.
— Monsieur, je vous en prie, je sais que vous avez vos entrées à la cour du roi Friedrich, vous êtes un homme de bien, et malgré le brigandage dont je fus victime, j’ai réussi à dissimuler de quoi vous régler. C’est en ayant vu la magnifique parure de lin que vous avez réalisée pour le berceau du fils de notre roi que j’ai appris votre nom.
Cette information, aucun voleur ne pouvait la détenir. Elle donna confiance à Karl. Il ouvrit donc à l’inconnu, rassuré de savoir qu’il avait ses entrées à la cour du roi.
À peine eut-il entrouvert la porte que l’autre se précipita à l’intérieur, lui prit les mains et les secoua vivement :
— Merci, monsieur Langbein, mille mercis de m’avoir ouvert !
L’homme était enveloppé d’une toile cirée noire, mais visiblement nu en dessous. Ce qui étonna aussi Karl était l’absence de blessure, il n’était même pas sale. Ses agresseurs avaient-ils été suffisamment persuasifs et indulgents pour pouvoir le dépouiller de la sorte ? Apparemment, oui.
— Que vous est-il arrivé, êtes-vous blessé ?
— Non, répondit-il, semblant lire dans les pensées de Karl, j’ai très vite compris que je n’avais aucun intérêt à résister à mes brigands. Je leur ai donné ce qu’ils voulaient, et je pense qu’à ma grande chance, ils ont été mis en fuite par une patrouille de soldats. J’ai choisi de me soustraire à leur vigilance, ne voulant pas commencer la soirée en prison, à tenter d’expliquer ma tenue pour le moins singulière ! Je vous en prie, je dois quitter la ville cette nuit, des affaires urgentes m’attendent et je ne veux pas vous déranger longuement, monsieur Langbein.
— Je vais voir ce que je peux vous trouver pour vous vêtir décemment, mais ne vous attendez pas à ce que cela vous aille comme un gant : vous êtes d’une stature assez imposante et je crains de ne pas disposer de vos mensurations exactes dans mon atelier.
— Je suis désolé, monsieur Langbein, mais ce que j’attends de vous, malgré l’heure tardive, c’est la réalisation d’un pantalon et d’une chemise.
— Pardon ? Écoutez, cher monsieur, je veux bien vous tirer de ce pétrin, mais si vous souhaitez passer commande, revenez demain en nos ateliers, nous prendrons vos mensurations, et je pense que d’ici une semaine, vous pourrez avoir vos effets, si vos demandes ne sont pas trop extraordinaires.
— Cher monsieur, je vous paierai, mais je me dois d’insister. J’ai une maladie qui ne se transmet pas, soyez rassuré, mais qui m’empêche de porter toute matière autre que le lin en contact avec mon épiderme. Même cette toile commence déjà à m’insupporter, et si je devais la laisser encore quelques heures contre ma peau, celle-ci se couvrirait de plaques rouges et se mettrait à suinter.
L’homme regardait Karl droit dans les yeux. Son regard était très clair, pénétrant, mais Karl ne ressentait aucune agressivité, au contraire, il captait plutôt de la chaleur. Il éprouvait finalement l’envie de lui venir en aide.
— Je vous en prie, voici tout ce qui me reste, prenez cette pépite, mais je vous supplie de me faire un habit de lin, dit-il en tendant au tailleur un morceau d’or de la taille d’un œuf de pigeon.
Karl n’était pas dans le besoin, mais la valeur de l’imposante pépite lui ôta l’envie d’argumenter. Il n’avait rien contre un petit supplément !
— Soit, je ne comprends pas l’urgence de votre demande, mais si tel est votre souhait, veuillez me suivre.
Et il le précéda dans son atelier.
— Attendez-moi là, je vous prie, je vais aller dire à mon épouse de ne pas s’inquiéter.
Karl laissa l’inconnu seul, le temps de monter au second étage et d’expliquer sommairement à sa femme qu’il avait une commande très urgente à honorer, qu’elle était très bien payée, en lui montrant la pépite ! Elle souhaita bonne nuit à son sauveur.
Karl descendit rejoindre son étrange client dans l’atelier. Celui-ci se trouvait dans une grande pièce au rez-de-chaussée, donnant directement sur le jardin. L’étranger avait déverrouillé la porte qui y débouchait et se tenait debout sur le seuil, tournant le dos à Karl. Il respirait profondément.
— Vous allez bien ? Voulez-vous boire quelque chose ? Du vin, du jus de pomme ? Il nous en reste un peu de notre dernier repas, ou simplement de l’eau ?
— Un peu de jus de pomme, s’il vous plaît, merci. J’avoue que je suis assez épuisé, la journée fut longue et pleine de rebondissements.
Karl ouvrit l’armoire et en sortit une carafe de jus de pomme qu’il déboucha, ainsi que deux gobelets en étain.
— Tenez, mais permettez que je verrouille cette porte, les nuits ne sont pas sûres, dans cette ville, et même si les jardins ne sont accessibles que depuis les maisons, il vaut mieux être prudent.
— Oui, excusez-moi, je n’ai pas réfléchi.
Karl détailla encore son « client » : il semblait très riche, ses mains étaient très soignées, ses ongles parfaitement propres et coupés ; il n’avait aucune cicatrice, sa peau était nette et assez claire. En vérité, tout dans ce personnage était étonnant, anachronique.
— Au fait, comment dois-je vous appeler, monsieur… ?
— Maïr.
— Mayer ?
— Non, Maïr, tout simplement.
Soit, pensa Karl, comprenant qu’il n’en saurait pas plus. Et il se mit au travail.
— Permettez que je prenne vos mensurations, dit Karl en se plaçant derrière l’inconnu avec son bâton de mesure. Je pense que votre pèlerine va nous gêner.
L’homme se débarrassa de la toile cirée qui faisait office de cape, en la jetant sur une chaise à sa droite, et se retrouva tout nu devant Karl.
— Euh, veuillez étendre les bras à l’horizontale, dit Karl, davantage gêné que son client.
Il commença à prendre les mesures de Maïr. Karl s’étonna de plus en plus du physique parfait de cet homme. Sa peau très lisse, très soignée ne présentait aucune trace de blessure, ni de maladie, ce qui était plutôt rare à l’époque, dans le monde où il vivait. Sa stature était assez imposante : plus de 1,85 mètre, assez mince, tout en muscles, aucun pli de graisse, ce que contredisait un peu son aspect soigné, signe de richesse.
— Quel type d’habit souhaitez-vous ?
— Des sous-vêtements, un simple pantalon et une chemise, mais en lin, je vous prie, ainsi qu’une ceinture de la même étoffe. Il faut que votre tissu soit pur. Et un manteau, le plus sobre que vous ayez, pour remplacer cette bâche, le temps de retourner chez moi. Ce dernier n’aura pas besoin d’être en lin.
— Un simple pantalon et une chemise ? Pardon, mais avec ce que vous me donnez, je peux… Non, je dois vous faire un habit complet !
— Non, non, je vous assure, je n’ai besoin que d’une tenue toute simple, en lin. Mais aucune pièce, pas même le fil que vous utiliserez pour assembler les éléments de tissu, ne devra être constituée d’autre chose que du lin.
— Soit. Vous avez de la chance, j’ai reçu du fil de lin en début de semaine dernière, sinon j’aurais été dans l’incapacité de réaliser votre souhait.
Karl sortit donc un rouleau de tissu de lin de ses étagères et s’empressa de découper et de coudre ensemble les différentes pièces nécessaires. Plus il s’affairait, plus sa curiosité augmentait. Son visiteur semblait soulagé et, affalé sur sa chaise, il contemplait Karl au travail, avec un regard vague et fatigué.
À chaque demande de ce dernier concernant la forme, il répondait invariablement :
— Faites comme vous le désirez, mais restez simple.
Deux heures plus tard, l’essentiel était réalisé. Karl demanda à Maïr d’essayer l’ensemble, qu’il passa rapidement. Il refusa toute retouche ou amélioration.
— Je vous assure, c’est parfait pour l’usage que j’en aurai. Encore infiniment merci ! Je vous souhaite une longue et heureuse vie, adieu !
Il revêtit le manteau que Karl lui tendait et s’engouffra dans la nuit, en adressant un dernier salut de la main au tailleur. Karl en resta quelque peu décontenancé et insatisfait. Il lui fallut quelques secondes pour se décider à enfiler lui aussi un manteau pour se lancer à la poursuite de Maïr.
Il sortit dans la ruelle sombre. Il distinguait encore, au loin, la silhouette de son client. Il se dépêcha, tout en essayant de rester aussi discret que possible. Maïr marchait très rapidement, à grandes enjambées, et semblait soudain déborder d’énergie. Il se dirigeait vers le nord de la ville, en direction de la cathédrale : Dom, en allemand.
Karl avait du mal à le suivre, il était en sueur, mais sa curiosité était à présent piquée au vif. De toute évidence, à chaque changement de direction, Maïr se rapprochait de l’imposant édifice. En une dizaine de minutes, ils furent arrivés. La nuit restait calme et silencieuse.
Sur la place devant le Dom, Karl marqua une pause pour ne pas se faire repérer par Maïr, qui mit le cap vers la façade est d’un pas toujours aussi décidé. Il sauta par-dessus un petit muret qui reliait les arcs-boutants extérieurs, et se dirigea vers l’arrière de la gigantesque cathédrale. Karl en profita pour traverser rapidement la place et longea le muret sans le franchir pour essayer de repérer Maïr de l’extérieur. Il l’aperçut, plus haut, sur le premier chemin de ronde, qui se dirigeait vers le fond. Il s’arrêta devant une toute petite tourelle, de laquelle dépassait une gargouille grotesque représentant un âne. Karl n’osa s’approcher, de peur de se faire repérer.
Il attendit et comme rien ne se passait, il décida de grimper pour voir ce qu’il en était. Il pourrait toujours prétexter vouloir venir en aide à celui qu’il filait. Karl se hissa jusqu’au chemin de ronde et s’approcha aussi discrètement qu’il put de la tourelle, fermement décidé à voir ce que son client y faisait.
Il n’était plus qu’à cinq mètres du bâtiment quand son manteau s’accrocha à la rambarde, produisant un petit frottement, suffisant pour alerter Maïr, qui jeta un coup d’œil et reconnut immédiatement son tailleur.
— Monsieur Langbein… Vous m’avez donc suivi.
Karl hésita.
— Oui… Avouez que votre comportement est des plus étranges !
— Soit, vous allez être en mesure de me rendre un dernier service en récupérant ce manteau, que je ne pourrais emporter avec moi.
Karl ne comprenait plus rien : mais que racontait donc Maïr ? Était-il fou ? Voulait-il se suicider ?
— Je conçois votre étonnement et je vous assure que dans quelques instants, vous le serez encore bien plus. Tenez, dit-il en lui tendant son manteau, et je vous prierai de rester à votre place, ne vous approchez de moi en aucun cas.
Karl prit la cape et demeura là, à cinq mètres de la tourelle. Maïr disparut soudain. Il entendit un frottement, comme si Maïr grattait ou traçait quelque dessin. Il crut même apercevoir son bras tenant quelque chose.
— Au revoir, monsieur Langbein, et merci ! lança Maïr.
Karl, pétrifié, vit une lueur blanchâtre se répandre de façon uniforme dans la tourelle. L’instant d’après, il y eut un bruit sec, comme une bouteille que l’on débouche et… tout fut à nouveau sombre. Karl appela Maïr, en vain. Aucune réponse…
Il n’osait plus bouger et sursauta lorsque le clocher sonna la demie de deux heures du matin. Il se risqua alors à s’avancer pour examiner la tourelle, mais dans la nuit, malgré la pleine lune, il ne voyait aucune marque sur le sol. Maïr avait disparu, sans laisser la moindre trace de son passage, à l’exception de son manteau, que Karl portait à présent sur son bras, et du petit bout de bois qu’il avait probablement utilisé pour tracer ou gratter quelque chose.
Il examina encore l’intérieur de la tour, les deux meurtrières pas plus larges que sa main ; il n’y avait aucun passage au sol ni au niveau du toit. S’agissait-il d’un sorcier ? Tout cela le dépassait, lui qui ne connaissait rien au surnaturel, lui qui allait régulièrement à la messe, venait de voir un homme se volatiliser presque sous ses yeux !
D’une main tremblante, il ramassa le petit bâton, s’attendant à trouver un objet extraordinaire, mais non, c’était un bout de bois tout simple, provenant apparemment d’une branche de sureau que Maïr avait dû arracher à quelque arbre entre la maison de Karl et la cathédrale.
Ce dernier s’accroupit encore pour examiner plus attentivement le sol. Il n’y avait vraiment aucun indice du passage de Maïr : s’il avait tracé quelque chose, tout avait disparu ! Profondément troublé, Karl retourna chez lui, emportant le manteau et le bout de bois. Sans ces deux éléments, il aurait pu douter d’avoir vu tout cela.
Arrivé chez lui, sa femme l’attendait, très inquiète.
— Où étais-tu ? La ville est dangereuse à cette heure de la nuit !
— J’ai suivi mon client… Il m’avait paru bizarre, et… (Karl se dit qu’il était inutile d’inquiéter son épouse) je pensais qu’il avait besoin d’aide, il me semblait faible, il est allé jusqu’à la cathédrale, et là j’ai perdu sa trace…
— Et pourquoi portes-tu ce manteau en plus du tien ? demanda-t-elle, sentant bien qu’il lui cachait quelque chose.
— Euh, ben justement, je l’ai retrouvé par terre devant la cathédrale, mais plus aucune trace de mon client. Je l’ai cherché, j’ai attendu sans succès. Je l’ai donc ramené. En fait, je me suis senti obligé de lui venir en aide, vu la somme démesurée avec laquelle il m’a payé pour un simple pantalon et une chemise ! ajouta Karl en montrant à nouveau à Lise l’imposante pépite d’or que Maïr lui avait remise.
— C’est incroyable !
— Oui, je crois que nous allons tout simplement oublier cette histoire. Cet homme est parti, il nous a payés, c’est tout. Demain, j’irai changer cette pépite en argent.
Première victime Saint-Sorlin-de-Vienne, dimanche 16 avril 2006
Sandrine Meyer gara son scooter dans la cour du petit pavillon qu’elle avait hérité de sa grand-mère, à Saint-Sorlin-de-Vienne, à quelques kilomètres à l’est de Vienne.
Elle avait eu 26 ans quelques mois auparavant et venait de fêter son anniversaire avec un peu de retard. Depuis son BTS en informatique, elle avait fait de nombreux petits boulots en CDD et venait juste d’achever la période d’essai de son premier CDI dans une entreprise qui l’avait embauchée en tant que développeuse Web. Elle aimait bien l’ambiance, il y avait cinq hommes et deux femmes dans son équipe et elle riait tous les jours. L’entreprise avait encore une taille humaine : pas plus de cinquante employés la faisaient tourner.
Sandrine était légèrement éméchée, mais pas au point de ne plus maîtriser son scooter. Les douze kilomètres sous la pluie et le froid l’avaient maintenue bien éveillée. Elle portait une épaisse veste imperméable et chaude, mais son pantalon était trempé. Elle avait hâte de prendre un bon bain réparateur.
Elle tourna la clef de la porte d’entrée. Elle venait de faire changer toutes les serrures de la maison, car trois mois auparavant, quelqu’un en avait forcé l’accès, avait fouillé son domicile, pour ne finalement voler que le peu d’argent qu’elle possédait : sa vieille télé et son antique magnétoscope VHS n’intéressaient plus personne.
Elle entra sans se douter de rien, tendit le bras pour allumer la lumière, mais quelque chose la saisit par-derrière effectuant une rapide pression à la naissance de sa mâchoire, avec une violence telle qu’elle en eut le souffle coupé. Ses jambes se dérobèrent, elle perdit connaissance.
Le cambrioleur la porta vers la cuisine.
Un géant aux pieds d’argile Haut-Buëch, lundi 17 avril 2006
Vers 2 heures du matin, dans le pays du Haut-Buëch, à l’ouest de Gap, ce lundi 17 avril 2006, Michel Suliac entra dans la cave voûtée de sa ferme. Il avait acheté et rénové son exploitation agricole en 1992, cela faisait donc déjà treize ans qu’il savourait le calme absolu qui régnait autour de son refuge. Il l’avait découvert par hasard lors d’une randonnée à VTT avec son amie de l’époque (une sportive invétérée) ; ils avaient fait une pause en plein cagnard, dans cette vieille ferme abandonnée. Il avait exploré la propriété et, devant l’état de délabrement et la végétation qui envahissait même le chemin d’accès au point de le rendre presque invisible, il se permit de forcer la porte pour visiter la ruine.