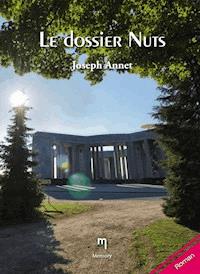
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Memory
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Course contre la montre et machination sans fin
Max Kevlar, détective privé, accepte d’aider Sarah Stilton à retrouver son père dont elle est sans nouvelle depuis deux jours. Le soir même, il découvre l’homme dans son fauteuil, un revolver à la main. Suicide, conclut la police. Assassinat, s’obstine la jeune femme, pour qui Kevlar décide de poursuivre l’enquête.
Une enquête menée à cent à l’heure qui projette Kevlar au cœur d’une machination infernale lors d’une incroyable course contre la montre pour faire éclater la vérité.
Un thriller saisissant, mené de main de maître, avec une chute aussi inattendue que terrible, le tout servi par la plume habile, incisive et précise de l’auteur, qui réussit la performance de faire « trembler » le lecteur jusqu’au bout !
Un roman policier dans la tradition du genre
EXTRAIT
A trente ans à peine, Esteban Pincho était l’un des faussaires les plus doués de sa génération. Né d’une mère trapéziste et d’un père orthophoniste croisé un soir de tournée en province, il était le fruit d’une furtive autant qu’improbable partie de jambes en l’air entre une gracieuse voltigeuse de vingt ans et un bourgeois besogneux de quarante. Ce que les gens du voyage appellent un accident de la route.
Pas facile de construire sa vie quand on la démarre accidenté. Esteban Pincho connut dès l’enfance la vie chaotique des artistes saltimbanques. Ballotté de ville en ville, il trouva dans le dessin l’échappatoire aux longues heures de transhumance et aux interminables attentes des fins de représentation. On le voyait partout un crayon à la main, se servant du premier support venu pour y laisser la trace de son passage.
A PROPOS DE L’AUTEUR
Né à Bastogne en 1970, Joseph Annet est romaniste de formation. Passionné de littérature et de films policiers, il crée dans
Le Dossier Nuts, son premier roman, le personnage de Max Kevlar, détective privé spécialisé dans la recherche d’œuvres d’art, qu’il embarque ici pour une toute autre aventure…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1
A trente ans à peine, Esteban Pincho était l’un des faussaires les plus doués de sa génération. Né d’une mère trapéziste et d’un père orthophoniste croisé un soir de tournée en province, il était le fruit d’une furtive autant qu’improbable partie de jambes en l’air entre une gracieuse voltigeuse de vingt ans et un bourgeois besogneux de quarante. Ce que les gens du voyage appellent un accident de la route.
Pas facile de construire sa vie quand on la démarre accidenté. Esteban Pincho connut dès l’enfance la vie chaotique des artistes saltimbanques. Ballotté de ville en ville, il trouva dans le dessin l’échappatoire aux longues heures de transhumance et aux interminables attentes des fins de représentation. On le voyait partout un crayon à la main, se servant du premier support venu pour y laisser la trace de son passage. A six ans, sa mère lui offrit son premier cahier de dessin, un ensemble de pinceaux et tubes de couleurs, et la troupe lui acheta L’Histoire de l’Art en images où il découvrit émerveillé les grands maîtres de la peinture. Esteban se mit alors à développer son talent en copiant les œuvres de ce qui était devenu son livre de chevet. A neuf ans, il demanda à occuper le stand de la chiromancienne décédée quelques semaines auparavant et y installa sa Galerie des Copies. Les soirs de spectacle, elle ne désemplissait pas. Ses toiles se vendaient comme des petits pains à des spectateurs ébahis devant un talent si précoce et exhortant au passage leur progéniture dénuée de la moindre fibre artistique à s’inspirer de l’exemple de ce jeune romanichel.
Esteban Pincho aurait pu mener ainsi une vie de bohême paisible et plutôt confortable. Mais, comme la carcasse attire les vautours, son succès attira la racaille. A chaque ville où la troupe se produisait, il finissait par se retrouver entouré d’une bande de petites frappes qui repéraient chez le jeune artiste aux poches pleines la poule idéale à plumer. Embarqué dans toutes sortes de virées nocturnes, la vie d’Esteban Pincho commença à emprunter les chemins de traverse qui l’amenèrent à fréquenter pour la première fois les postes de police. Usage et détention de drogues, troubles à l’ordre public, actes de vandalisme, le palmarès de l’artiste commençait à s’allonger. A seize ans, craignant qu’il ne tourne mal à force de fréquenter les caïds de toutes les villes de France, sa mère l’adressa à une parente éloignée qui vivait à Bruxelles. Un changement radical de milieu de vie le remettrait sur le droit chemin. L’adolescent fut inscrit en cinquième année dans une école secondaire qui proposait une filière artistique où il sembla trouver sa voie et une forme de sagesse à laquelle les mains de bûcheron de son aïeule n’étaient pas étrangères.
A dix-huit ans, Esteban Pincho choisit de poursuivre sa formation artistique et réussit le concours d’entrée à l’Ecole nationale des arts visuels de La Cambre. C’est sans doute à partir de là que la vie du jeune artiste se mit à nouveau à déraper. Outre son talent, le jeune hidalgo avait aussi développé un ego surdimensionné. Méprisant la médiocrité de ses camarades, bravant l’autorité de ses professeurs qui s’obstinaient à ne pas comprendre sa démarche artistique visionnaire, Esteban Pincho finit par se faire exclure de La Cambre et, du même coup, voir se fermer une à une les portes des galeries de la ville.
C’est à cette période qu’il rencontra Werner Bloomsky. Fils d’un restaurateur de peintures d’églises, cet escroc d’origine hongroise possédait une excellente connaissance du monde de l’art. Convaincu du talent de Pincho pour la copie, il lui fit miroiter la tenue d’une exposition de ses œuvres à Amsterdam pour l’amener à travailler pour lui. Et c’est ainsi qu’Esteban Pincho embrassa la profession de faussaire.
Bloomsky testa tout d’abord les aptitudes de sa jeune recrue sur des œuvres mineures, des petites commandes pour des collectionneurs ou des musées qui souhaitaient mettre à l’abri leur pièce originale et n’exposer qu’une copie. La pratique était courante et offrait à Bloomsky une activité tout à fait légale derrière laquelle il pouvait développer son trafic. L’homme était méticuleux. Il perfectionna peu à peu les techniques de contrefaçon de son faussaire et se dota d’une méthode de travail extrêmement rigoureuse. Les artistes à copier étaient choisis selon des critères précis. Les matériaux nécessaires étaient sélectionnés avec une extrême précaution. Il ne mettait sur le marché que des contrefaçons parfaites, à des moments précis qui rendaient leur apparition tout à fait plausible. Bloomsky alla même jusqu’à inventer les labels de provenance figurant sur les tableaux et à produire de fausses photographies d’époque qui montraient les œuvres chez leurs propriétaires. Mais le coup de maître de Bloomsky fut d’étudier dans les moindres détails le fonctionnement du marché de l’art pour profiter de ses dysfonctionnements. Il décida de choisir des artistes dont la cote n’était pas trop élevée et pour lesquels il n’y avait que peu de documentation. Sa période de prédilection portait sur l’entre deux-guerres, et sa spécialité, sur les artistes allemands et français. Dufy, Derain, Max Ernst, Fernand Leger, Othon Friesz, Max Pechstein ou Marie Laurencin furent parmi les plus imités. Car là fut le deuxième coup de génie de Bloomsky : il ne copiait pas d’œuvres existantes, il inventait des œuvres. Il épluchait tous les catalogues des galeries de l’époque pour y repérer des tableaux sans photographie, des œuvres qui ne figuraient pas dans les catalogues raisonnés des artistes, tous disparus depuis. Il choisissait ensuite un thème propre à l’artiste qu’il pouvait exploiter et se servait enfin de complices qui prétendaient avoir retrouvé ces tableaux dans la collection d’un grand-père ou d’une tante éloignée. Il ne restait plus qu’à mettre le tableau en vente. Pour cela, rien de plus facile. Il pouvait compter, pour la délivrance des certificats d’authenticité, sur quelques experts, directeurs de musées ou de galeries, d’autant plus avisés qu’ils touchaient au passage une coquette commission.
Esteban Pincho devint rapidement un faussaire brillant, au point que Bloomsky décida finalement de ne plus travailler qu’avec lui, tant la qualité de son travail rendait extrêmement faibles les risques que l’on détecte dans ses toiles l’œuvre d’un faussaire. Une fois son organisation bien rodée, Bloomsky passa à la vitesse supérieure. En quelques années, le duo écoula plusieurs dizaines de toiles. Et les euros se mirent à pleuvoir par millions. Château en Bavière, villa à Saint-Tropez, voitures de collections, Bloomsky mena un train de vie fastueux pendant près de dix ans. Et avec lui, Esteban Pincho, qui empochait une part plutôt rondelette du gâteau. Pour peu qu’il restât discret, il pouvait disposer à sa guise de cette fortune amassée en un temps record. Ce dont il ne se priva pas. Jouant les artistes inspirés, il écuma les palaces du monde entier, foula les dance floors des discothèques les plus sélectes de la planète, traînant derrière lui la même faune de courtisans douteux qu’au temps de son adolescence bohémienne.
Mais la roue de la fortune s’arrêta brutalement de tourner. L’organisation criminelle mise en place par Bloomsky, malgré toutes les précautions et le secret qui l’entourait, malgré la minutie suivie pour la sélection de chaque artiste, de chaque œuvre, de chaque élément des matériaux utilisés, malgré la complicité grassement rémunérée de ses intermédiaires, l’organisation de Bloomsky s’effondra. A cause d’un petit grain de sable. Un tout petit grain de sable. Un petit pigment blanc minuscule. Un pigment blanc qu’Heinrich Campendonk, artiste expressionniste allemand membre du Blaue Reiter, n’aurait pas pu utiliser dans Tableau rouge avec chevaux. Parce que ce pigment blanc n’existait simplement pas en 1914 ! Un tout petit grain de sable de deux millions huit cent mille euros. Un putain de pigment blanc sur un pinceau mal nettoyé qui foutait en l’air près de dix ans de travail !
Lorsque le trust maltais qui avait acquis le tableau découvrit la supercherie, à l’automne 2009, l’enquête remonta rapidement de la galerie parisienne Smolders qui avait diligenté la transaction, à l’expert Duclos qui avait délivré le certificat d’authenticité, et finalement, à Bloomsky dont l’ami de Bavière qui avait retrouvé le tableau dans le manoir familial s’avéra bien vite n’avoir jamais existé. L’œuvre était un faux et le château de cartes s’écroula.
Le scandale qui suivit dévoila les pratiques douteuses d’un marché de l’art vérolé dont Bloomsky avait intelligemment exploité les failles. Un procès éclair eut lieu en janvier 2010 au terme duquel, faute de n’avoir pu retrouver qu’une faible partie des faux mis sur le marché, le roi de l’arnaque et le prince des faussaires furent seulement condamnés à cinq ans de prison. On ne saura jamais combien de tableaux sont sortis de l’atelier d’Esteban Pincho et vendus à de crédules collectionneurs par Bloomsky. Ni combien de millions d’euros le duo a amassé sur des comptes bien à l’abri à Andorre, Singapour ou Monaco.
Pincho sortit de prison trois ans plus tard. Les enquêteurs espéraient bien qu’une fois dehors, il les mènerait tout droit vers d’autres de ses faux tableaux. Mais il se volatilisa du jour au lendemain. Laissant derrière lui en guise d’avertissement une copie parfaite de 100 years ago de Peter Doig. Les affaires allaient reprendre…
Mais Pincho avait retenu la leçon. Il vivrait désormais dans l’ombre de ses commanditaires. Les plus grands faussaires ne sont-ils pas ceux que l’on ne connait pas ? Être faussaire, c’est renoncer à la reconnaissance de son travail. L’anonymat lui conviendrait parfaitement. Sous une nouvelle apparence, il circulerait librement. L’argent qu’il avait conservé lui permettrait de payer ses moindres dépenses en liquide. Pas d’attache, pas de trace. Il resterait introuvable.
Ainsi pouvait-on s’imaginer la vie d’Esteban Pincho à la lecture des éléments que contenait son dossier Interpol.
2
Enfoncé dans son siège, Max Kevlar observait les trajectoires de l’eau qui ruisselait sur le pare-brise, donnant à la grande allée centrale de la rue Huart-Hamoir des allures d’aquarelle détrempée. La pluie n’avait cessé depuis le matin et la plaine de jeux envahie les soirs d’été par les enfants du quartier était ce soir complètement déserte.
Il déposa sur le siège passager le dossier Interpol de Pincho.
Le numéro quarante-huit. Au rez-de-chaussée, des ateliers et des bureaux organisés autour d’une large cour intérieure. Aux étages, des appartements. Sur l’une des plaques posées au-dessus des sonnettes figurait Arts & Antiques, la société d’import-export qui servait de couverture au trafic de Steemans. Esteban Pincho occupait un appartement au deuxième étage. C’est du moins ce que supposait Kevlar, car aucune photo récente ne lui permettait de l’identifier formellement.
Il y a quelques semaines, Dirk Steemans, un expert agréé auprès de plusieurs institutions aux Pays-Bas, avait approché la maison de vente Piet Burger. Les œuvres présentées étaient accompagnées de leurs certificats d’authenticité et de la liste de leurs propriétaires successifs. Les analyses ne révélèrent aucune anomalie et les experts conclurent à l’authenticité des œuvres. Une ruse destinée à gagner la confiance de la maison de vente qui découvrit la supercherie lorsque Steemans présenta La ville endormie de Paul Delvaux, une œuvre de 1938 réalisée par le peintre alors dans sa période surréaliste. Authentifiée dans un premier temps, le tableau fut ensuite recalé par l’expert de la Fondation Paul Delvaux. Il s’agissait d’une copie d’excellente facture que Steemans avait substituée à l’original après la première expertise. La maison de vente opta pour la discrétion et décida de mener sa propre enquête pour confondre Steemans et identifier son faussaire.
Il apparut très vite que Steemans avait une réputation sulfureuse. Son nom apparaissait dans plusieurs dossiers de trafic d’œuvres d’art aux Pays-Bas où certains galeristes continuaient cependant à lui accorder leur confiance. Steemans était un homme d’affaires peu scrupuleux, mais il ne touchait à aucun pinceau. Il s’entourait d’un ou plusieurs faussaires, selon les commandes qu’il recevait. Les analyses des techniques utilisées pour le Delvaux amenèrent la maison de vente à penser que la main extrêmement douée qui se cachait derrière cette copie pouvait être celle de Pincho. Kevlar entreprit de filer l’escroc et se retrouva rapidement au quarante-huit de la rue Huart-Hamoir qui abritait la société d’import-export de Steemans à Bruxelles. Après plusieurs filatures, il découvrit que Steemans rendait régulièrement visite à l’occupant de l’appartement du deuxième étage, un type d’une trentaine d’années qui sortait uniquement le soir pour se rendre en tram dans un bistrot du centre-ville, chaque soir différent.
Kevlar soupçonna l’homme d’être l’un des faussaires de Steemans. Et pourquoi pas Pincho ? L’apparence avait changé, certes. Mais il y avait quelque chose dans la démarche de ce type qui lui faisait penser au célèbre faussaire. Du moins, tel qu’il s’en souvenait dans les quelques reportages qu’il avait regardés à l’époque du procès. Pincho avait bien repris du service, pour le compte de Steemans cette fois. Peindre était comme une seconde nature. Et son talent s’exprimait dans l’imitation, pas dans la création. C’était plus fort que lui. C’était comme ça. Il n’en restait pas moins un maître dans son art.
Kevlar attendait que l’artiste quitte les lieux pour y trouver les preuves qui lui manquaient encore. La radio annonça vingt-deux heures. Les infos en bref. Les attaques israéliennes sur la bande de Gaza s’intensifiaient tandis que la communauté internationale se contentait d’appeler au calme. En Irak, les djihadistes de l’Etat islamique progressaient encore vers Bagdad et les Occidentaux estimaient à présent que Bachar El-Assad était leur meilleur allié dans la région, rétrogradant les massacres à l’arme chimique et les bombardements aux barils de TNT contre son peuple à un détail de l’histoire. Au Soudan du Sud, la famine tuait autant que la guerre civile dans l’indifférence internationale généralisée. La planète n’avait d’yeux que pour la Coupe du Monde de football. Du pain et des jeux… Le peuple se distrait et les puissants continuent leurs abjectes politiques. Tout ça lui donnait envie de vomir.
Kevlar éteignit et fouilla dans le vide poche. Un vieux paquet de cigarettes. Il pensait les avoir tous jetés. Coup d’œil sur la banquette arrière. Un sachet de cuberdons. Sa nouvelle addiction. Il enclencha le lecteur. Cannonball Adderley et Miles Davies, Autumn leaves. Parfaitement de circonstance. Et exactement ce qu’il lui fallait pour accompagner l’attente.
Il se mit à penser à Magritte dont il avait pisté en début d’année deux tableaux volés. Trois nus dans un intérieur et Moderne. Deux œuvres de 1923 acquises par un collectionneur éclairé alors que le peintre n’avait encore qu’une notoriété locale. L’homme avait acquis bien plus tard La Lectrice soumise qui restait pour lui la plus grande énigme de la peinture moderne. Que peut-elle donc lire qui lui glace ainsi les sangs ? Le collectionneur avait d’abord mené diverses recherches sur l’œuvre, sans parvenir à percer le secret de sa lecture. Las de ses recherches, il s’était mis à avancer ses propres hypothèses. Il avait fini par développer chacune sous la forme d’un récit littéraire de genre différent et avait publié ses Variations énigmatiques à compte d’auteur dont il gratifia Kevlar d’un exemplaire. Il se souvenait encore de l’hypothèse développée dans le genre fantastique. La lectrice, dont on ne connaissait que le nom, Adeline, empruntait un soir de novembre le chemin de halage qui la conduisait chaque jour de son travail à son domicile. Sur l’unique banc offrant une pause le long de la berge, elle aperçut un livre sans titre. Intriguée, elle le saisit et lit les premières lignes. Elle sent bien qu’elle ne devrait pas, mais elle continue à lire. Elle s’approche du réverbère pour en capter plus de lumière et tourne la page. Très vite, elle se rend compte que le personnage principal lui ressemble. Le trouble s’immisce soudain quand elle découvre certains détails des événements que traverse l’héroïne. Leur ressemblance est trop grande. Elle est parcourue d’un frisson. Elle sait qu’il ne faudrait pas. Il ne faudrait pas qu’elle continue. Mais c’est plus fort qu’elle. L’excitation la gagne. Elle parcourt les pages de plus en plus vite, frénétiquement. Trop de questions la submergent en même temps qu’elle poursuit sa lecture. Est-ce bien d’elle dont il s’agit ? Qui peut savoir cela ? Pourquoi l’écrire ? Elle doit savoir. Les réponses doivent forcément se trouver plus loin dans ces pages. Elle ne sent pas la brume qui commence à l’envelopper. Le froid qui lui tombe sur les épaules. Toute entière absorbée par sa lecture, elle est maintenant complètement absente. Entièrement soumise à son narrateur. Elle est soudain saisie d’effroi. Elle s’est écartée du livre, les yeux écarquillés, le teint blême. On ne voit pas ses muscles qui tremblent. Ses yeux ne bougent plus. Ils restent rivés à cette phrase : « Elle releva sa robe et pénétra dans l’eau pour s’y abandonner aux souvenirs des siens… ».
Kevlar regarda sa montre. Vingt-deux heures trente-cinq. La nuit avait enveloppé la ville. La lumière jaunâtre de l’éclairage public lui donnait le teint blême d’un mort en sursis.
Une lampe s’alluma dans le couloir d’entrée du quarante-huit. La porte s’ouvrit et un homme apparut sur le seuil. Pincho, songea Kevlar. Il éteignit, claqua la porte derrière lui et descendit la rue vers l’arrêt de tram situé devant la gare de Schaerbeek.
La voie était libre. Crocheter la serrure ne prit que quelques secondes. Kevlar s’immobilisa derrière la porte et actionna la lampe de poche de son téléphone portable. Le bruit d’une télévision remplissait l’appartement du premier étage. Un commentateur incrédule parlait d’humiliation pour la nation du football. Kevlar se trouva sur le palier du deuxième et quelques secondes plus tard, à l’intérieur de l’appartement. Face à lui, un couloir le traversait de part en part. Dans la première pièce qui donnait côté rue, une paillasse jetée à même le sol, des livres d’art, une pile de revues et quelques vêtements. L’atelier se trouvait dans la pièce suivante, un grand séjour avec la cuisine au fond, bordée par une étroite terrasse surplombant la cour intérieure. Des pots de couleurs jonchaient le sol et les tableaux adossés aux murs recouverts d’éclaboussures séchées s’enchevêtraient en amas désordonnés. Trois chevalets occupaient le milieu de la pièce. Sur une grande table rectangulaire s’amoncelaient pinceaux, tubes de couleurs, palettes, couteaux, blocs de dessin, papier kraft, pots d’apprêt et d’huiles siccatives, de pigments et de liants, de flacons de diluants. Pincho disposait de tout le matériel nécessaire.
Kevlar entreprit l’examen des toiles. Trois copies en cours d’exécution. Une seule était suffisamment avancée pour la reconnaître. Ensor, Pierrot et squelette à la toge jaune. L’original devait se trouver au Musée des Beaux-Arts de Gand. Steemans projetait-il de le voler en le remplaçant par cette copie ? Les toiles de formats variés adossées au mur du fond présentaient une certaine familiarité avec les œuvres que Pincho avait exposées jadis à Amsterdam. Kevlar sentit qu’il tenait un début de preuve. Il s’approcha pour inspecter les tableaux. Leur structure et leur matériau ne laissaient guère de place au doute. Chaque peinture de Pincho recouvrait une œuvre plus ancienne. Une œuvre originale, maquillée le temps d’un transport vers un riche collectionneur peu scrupuleux. Kevlar s’aida de son téléphone pour prendre des clichés de chacune d’elles. Il lui fallait à présent trouver des preuves du lien entre Pincho et Steemans. Il se dirigea vers la cuisine et inspecta les enveloppes et documents qui couvraient la table, mais n’y trouva aucune mention d’Arts & Antiques. Des clichés de peintures, des catalogues d’expositions, des articles de presse. Rien ne portait le nom de Pincho ou de Steemans.
Un bruit de clé dans la serrure l’immobilisa. La porte d’entrée s’ouvrit et des voix emplirent brusquement le couloir. Kevlar éteignit la lampe de poche et il passa subitement en mode survie. Son cerveau analysa en un éclair les options disponibles. Sortie couloir bloquée. Pas de cache dans la pièce. Une seule issue, la terrasse. Surtout ne pas faire de bruit, ne rien faire tomber. Ouvrir silencieusement la porte, la refermer. Kevlar se figea contre le mur lorsque la lumière jaillit dans l’atelier.
La discussion était animée. Une voix demanda sèchement où les toiles étaient planquées. Une voix plaintive, celle de Pincho sans doute, répondit qu’il n’en manquait qu’une seule, que tout pouvait s’expliquer et allait rentrer dans l’ordre. Une troisième voix insulta le faussaire et lui balança un coup violent qui le fit tomber sur la table. Le matériel s’éparpilla aux quatre coins de la pièce. La première voix reprit les invectives et cracha sur le faussaire qui n’avait à l’évidence pas compris les règles du jeu. On le payait pour repeindre des tableaux. Pas pour les voler. Il suppliait à présent, jurant que cela n’arriverait plus. La voix lui répondit qu’en effet, cela ne se reproduirait plus. Il y eu un silence, puis un long râle. La lampe s’éteignit et les pas quittèrent l’appartement.
Kevlar restait immobile, à l’écoute du moindre bruit dans l’atelier. Il supposait que le peintre récupérait des coups qu’il venait de prendre. Au bout de quelques minutes, il se risqua à rentrer dans l’atelier. L’obscurité l’empêchait de déceler la moindre présence. Il alluma sa lampe de poche et dirigea la lumière en un mouvement circulaire. Il aperçut d’abord les pieds. Il s’approcha et fit remonter le faisceau lumineux le long du corps. Recroquevillé comme un fœtus, le haut du corps baignait dans une flaque noirâtre. La gorge était entaillée de part en part. Une lame de professionnel. Un pinceau de grande taille y avait été enfoncé, comme pour symboliser le motif de cette condamnation à mort. Kevlar s’approcha du visage. Impossible de reconnaître avec certitude l’individu dans cette situation, mais sa physionomie et sa corpulence pouvaient correspondre à celle de Pincho.
Quelle ironie ! Finir en nature morte au beau milieu de ses œuvres… Kevlar vérifia soigneusement qu’il ne laissait aucune trace de son passage. Puis il quitta discrètement les lieux et réveilla son vieux break Volvo.
Les boulevards extérieurs étaient dégagés. Il emprunta la chaussée de Louvain pour se laisser glisser lentement jusqu’à la petite ceinture qu’il remonta jusqu’à la place Louise. L’avenue de la Toison d’Or grouillait encore d’une foule fêtarde ondulant d’une terrasse à l’autre.
L’image du pinceau dans la gorge du peintre le poursuivait. Steemans était certainement derrière cette exécution. Il aurait dû tenter de prendre les trois hommes en photo. Mais s’il avait été repéré, il n’avait aucune issue de secours. Son sort n’aurait guère été plus enviable que celui réservé à Pincho.
Il laissa le Palais de Justice derrière lui et bifurqua bientôt vers la place du Grand Sablon. Lorsqu’il entra chez Lola, la serveuse clôturait sa journée.
– La fête est finie ? lança Kevlar en entrant.
Nina leva la tête et écarta les mèches rousses qui lui cachaient le visage.
– Bonsoir Max, tu tombes à pic, j’allais descendre les vidanges !
– Encore ! C’est la deuxième fois cette semaine ! Il te reste quelque chose à manger, j’espère ?
– Effiloché de cabillaud, artichaut en parmentier, aux piments d’Espellete, le tout accompagné d’une petite salade. Cela convient-il à Monsieur ?
Kevlar s’empressa d’évacuer les casiers puis se jeta sur l’assiette déposée au coin du bar. Nina s’assit à ses côtés.
– Alors, Mike Hammer, combien de méchants hors d’état de nuire cette fois ?
– Même pas la mouche qui m’a emmerdé toute la soirée !
– Ils étaient trop couillons pour affronter la nuit…
– C’est sûrement ça. Tu n’aurais pas un peu de sel ?
– Qu’est-ce que c’était ? La traque d’infâmes trafiquants d’art ? Non, laisse-moi devinez, plutôt un plan cul…Un Don Juan que sa rombière veut punir ? Un Casanova bedonnant qui s’envoie en l’air avec sa secrétaire ?
– Je ne file pas que des mecs, tu sais…
– Allons, tu sais bien que ce sont toujours les hommes qui trompent leurs femmes… Mais tu n’as pas répondu…
– Tout juste ! Ma nouvelle spécialité. Max Kevlar, le roi du flagrant délit ! Cocus des deux sexes, un seul réflexe, pour sauver votre honneur conjugal, il faut flasher à poil !
– T’aurais dû te lancer dans la pub, Kevlar !
– Je vais me lancer dans mon lit, je n’en peux plus.
– Tu laisses ta porte ouverte ce soir ?
– J’ai pas trop la tête à ça, ma puce.
Kevlar lui posa un baiser sur le front et se dirigea vers la porte.
– Eh, Kevlar, j’allais oublier de te passer le message, l’interpella Nina avant qu’il ne franchisse la porte. Une jeune femme te cherchait tout à l’heure, Sliton ou Lipton, un truc comme ça. Je lui ai dit de revenir demain.
3
– Monsieur Maximilien, réveillez-vous ! Monsieur Maximilien, allez, debout !
Kevlar sentit une main fermement décidée à le sortir du sommeil. Il ouvrit un œil. Vêtue de son habituel tablier à fleurs, Rose-Marie affichait son air réprobateur. En pure perte, comme d’habitude. Elle détestait le trouver tout habillé dans le canapé.
– Quelle heure est-il ?
– Neuf heures. Je ne voudrais pas vous brusquer, mais votre courrier déborde de la boîte aux lettres. Je ne parviens pas à y rentrer celui du jour. Je vous ai tout apporté. Je crois qu’il y a la lettre que vous attendez.
Elle déposa le tas d’enveloppes sur la table de la cuisine.
– Et si j’en juge par l’état de votre frigidaire, je suppose que vous allez me demander de faire vos courses ce matin, n’est-ce pas ?
– Que ferais-je sans vous, Rose-Marie !
– Ah ! Monsieur Maximilien, soupira-t-elle, comment espérez-vous garder une femme dans votre vie si votre frigo est toujours vide !
– Je croyais que c’était à elle de le remplir…
Rose-Marie feignit de ne pas entendre et passa dans le salon. Elle remit les coussins du canapé en place, tout en continuant ses remontrances.
– Qui voudrait d’un homme qui dort tout habillé dans son canapé ?
– Peut-être devrais-je tenter ma chance chez les Inuits ?
– Cessez de plaisanter, Maximilien Kevlarovitch ! Vous allez finir tout seul, comme un vieux garçon.
– Il me restera vous, Rose-Marie…
Rose-Marie haussa les épaules et sortit.
Kevlar se servit une tasse de café et passa en revue la pile d’enveloppes. Il en sortit la lettre qu’il attendait. L’enveloppe blanc crème au grammage épais portait les armoiries et le drapeau de la Fédération de Russie. Cela faisait plus de quatre mois qu’il avait envoyé sa dernière requête auprès des autorités russes. On lui avait expliqué que les chances d’aboutir étaient très minces et qu’il leur était impossible de donner un délai de réponse. Kevlar palpa l’enveloppe. Elle lui sembla si légère. Elle ne devait certainement contenir qu’une seule feuille. Tant d’espoir et si peu de mots. Il se sentit pris d’une angoisse à l’idée que le contenu de cette lettre pouvait représenter la fin de ses tentatives de retrouver l’unique survivant de sa famille. Il n’était pas certain de vouloir en prendre connaissance à présent. Tant qu’il continuait à chercher, subsistait l’espoir d’un résultat positif et il pouvait tout imaginer. Il déposa la lettre sur la table et se lança dans la lecture du journal. La Coupe du Monde et le conflit entre Israël et la Palestine se partageaient la une : « Kolossale Mannschaft » contre « L’escalade de la violence ». Kevlar passa aux pages intérieures qu’il survola jusqu’à la rubrique des faits divers. La litanie quotidienne des infections sociales constituait son inépuisable fonds de commerce. Il repéra le cambriolage d’une villa de luxe. Voilà qui était prometteur. Avec un peu de chance, il y aurait des œuvres d’art dans le butin.
Les locaux de la police judicaire de Bruxelles étaient logés dans une tour du square Victoria Regina, comme une mise à l’écart du nouveau centre d’affaires qui avait poussé sur les ruines de l’ancien quartier de la gare du Nord. A chaque passage, son entrée laissait s’engouffrer le vent jusqu’au comptoir d’accueil où deux plantons tournaient en rond entre deux tasses de café.
– Durandal est là ? demanda Kevlar sans s’arrêter.
Le temps que la réponse arrive, Kevlar était au premier étage.
– Salut, Durandal, comment ça va ce matin ?
L’inspecteur principal François Durandal leva la tête de son dossier et déposa ses lunettes sur la table de travail. Ses cernes lourds et son air négligé témoignaient d’une nuit difficile.
– Kevlar ! Avec la tête des grands jours et la gentillesse dans la voix ! Toi, tu as quelque chose en tête ?
– Je ne peux plus prendre des nouvelles de mon inspecteur préféré sans qu’il me soupçonne d’être intéressé ?
– Allez, accouche, tu veux quoi ?
– Tu as entendu parler du cambriolage de l’avenue de Tervuren ?
– Je ne suis pas sur le coup, c’est Lanzman, mais on dit que c’est du travail bien fait. Des professionnels qui savaient ce qu’il fallait prendre. Il y en aurait pour plus d’un million.
– Ah, quand même ! Et vous avez une piste ?
– Regardez-moi ce détective avec ses gros sabots. Tu n’as tout de même pas dans l’idée de nous piquer l’affaire, Kevlar ?
– Mais qu’est-ce que tu racontes ? Si on ne peut même plus rendre service, où va-t-on ?
– Sors d’ici avant que je te file mon pied au cul !
– Allez, donne-moi l’info ! Les œuvres d’art, c’est ma spécialité, tu le sais, non ? On pourrait travailler ensemble ?
– C’est ça, prends-moi pour un con…
L’inspecteur regarda sa montre. L’entrevue était terminée et Kevlar se retrouva dans le couloir. Ça commençait mal. Il sortit son téléphone portable et composa le numéro du commissariat.
– Bonjour, ici les urgences de l’Hôpital Saint-Luc. Une madame Lanzman vient d’être admise suite à un accident de la circulation. Il nous faudrait son numéro de téléphone pour joindre l’un de ses proches, pourriez-vous regarder, s’il vous plaît ?
Kevlar attendit quelques instants et raccrocha lorsqu’il vit l’inspecteur Lanzman se précipiter hors de son bureau. Le dossier du cambriolage était grand ouvert sur la table de travail. Les photos des pièces visitées par les cambrioleurs montraient un intérieur digne d’une revue de décoration pour propriétaires fortunés. La liste des objets volés mentionnait une dizaine de tableaux et plusieurs bijoux de grande valeur. Une importante somme d’argent avait aussi été dérobée dans le coffre. Il nota l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire et sortit discrètement.
Il entra chez Lola vers treize heures. Un joyeux tintamarre polyglotte emplissait la salle. Les habitués occupaient les tables alignées le long de la banquette, laissant le comptoir aux touristes et clients de passage. Kevlar salua quelques connaissances avant de remarquer que sa table était occupée par une jeune femme. Il interrogea Nina du regard. La jeune femme l’attendait. Elle portait un chemisier blanc et un jeans bleu clair. Ses longs cheveux châtains noués dans la nuque dégageaient un cou délicat. Kevlar remarqua qu’elle ne portait aucun bijou. Pas même une montre. Elle affichait un air faussement détendu que trahissaient ses doigts qu’elle tortillait nerveusement.
– Bonjour mademoiselle, commença-t-il, vous attendez quelqu’un ?
– Bonjour. Oui, j’ai rendez-vous.
– Serait-ce indiscret de vous demander avec qui ?
– Euh, j’attends Monsieur Kevlar.
– Vous lui voulez quoi, à Monsieur Kevlar ?
La jeune femme marqua un temps d’arrêt et dévisagea son interlocuteur.
– En quoi cela vous regarde-t-il ?
– Je connais Monsieur Kevlar. Je sais qu’il n’aime pas être dérangé pour rien. Il a eu quelques mauvaises surprises par le passé et préfère rester prudent. Je crois savoir qu’en général, ses nouveaux clients lui sont toujours recommandés, vous comprenez ?
– Parfaitement. Et vous, vous êtes qui au juste, sa secrétaire ? C’est une amie qui m’envoie. Et je n’ai pas de temps à perdre non plus. Mon père a disparu. J’ai besoin d’aide pour le retrouver. Si ce n’est pas dans ses cordes ou si ça lui fait perdre son temps, ce n’est pas grave, je trouverai quelqu’un d’autre. Bonne journée.
– Elle s’était levée et allait quitter la table. Kevlar lui attrapa le bras.
– Ne partez pas. Je suis Max Kevlar. Veuillez excuser mes manières, simple précaution d’usage. Asseyez-vous, je vous en prie.
La jeune femme reprit sa place.
– Je m’appelle Sarah Stilton. C’est une amie, Eva Dumas, qui m’a donné votre nom. Elle dirige un bureau d’expertise en œuvres d’art.
– Je connais Eva, effectivement, reprit Kevlar sur un ton plus courtois. Racontez-moi ce qui vous arrive.
– Cela fait deux jours que je suis sans nouvelle de mon père. Je suis rentrée lundi matin d’un séjour à Londres. Mon père devait venir me chercher à la gare du Midi. Il n’est jamais venu. Je l’ai cherché partout, personne ne l’a vu depuis dimanche, personne ne sait où il est.
– Vous êtes allée voir la police ?
– Bien sûr, mais ils m’ont dit que c’était trop tôt pour lancer des recherches.
– Ils n’ont sans doute pas tort. Qu’est-ce qui vous fait croire qu’il n’est pas simplement parti se détendre quelque part ?
– Cela ne lui ressemble pas. Enfin, je veux dire pas comme ça. Pas sans prévenir. Pas en oubliant mon retour.
Kevlar dévisageait son interlocutrice tout en l’écoutant. Ses yeux vert pâle et sa peau laiteuse lui donnaient un air candide que renforçait sa jeunesse éclatante. Elle dégageait un mélange étrange de fragilité et de force intérieure. Il tenta mentalement d’estimer son âge. Plus de vingt ans, certainement. Mais elle ne devait pas en avoir trente.
– Je vois. Qu’attendez-vous de moi au juste ?
– J’ai peur qu’il lui soit arrivé quelque chose. La police ne peut rien me dire. Je me suis dit que quelqu’un comme vous pourrait m’aider. Alors, si vous pouviez vous renseigner, cela m’aiderait à le retrouver.
– Autant dire chercher une aiguille dans une botte de foin ! Bon, je vais voir ce que je peux faire.
Kevlar sortit son Moleskine, prit note de ses coordonnées et lui posa quelques questions nécessaires au lancement des recherches, sans réussir à se sentir réellement intéressé par cette histoire. Il fit un effort pour se montrer concentré et nota quelques détails sur les lieux fréquentés habituellement par le prétendu disparu. Il promit à sa cliente de la tenir informée, la salua et commanda son plat du jour. Il sortit de sa poche le bout de papier sur lequel il avait écrit le numéro de téléphone trouvé dans le dossier consulté dans le bureau de l’inspecteur Lanzman. A la troisième sonnerie, une voix sèche annonça le nom de l’interlocuteur.
– Bonjour Monsieur De Bandt, enchaîna Kevlar, permettez-moi de me présenter : Max Kevlar, détective privé spécialisé dans la recherche d’œuvres d’art. J’ai eu connaissance du cambriolage dont vous avez été victime la nuit dernière. Vous et moi connaissons la lenteur et la difficulté de travailler avec la police dans ce genre d’affaires délicates. Peut-être auriez-vous besoin de quelqu’un de plus diligent et discret pour mener certaines recherches ?
L’homme au bout du fil sembla hésiter un instant.
– Je comprends votre méfiance, reprit Kevlar. Le mieux ne serait-il pas de nous rencontrer ? Allo ?
Kevlar détestait qu’on lui raccroche au nez. Ça le mettait en rogne. Et manquer une affaire l’irritait davantage encore. Il avala son déjeuner et rentra chez lui.
Un concert de klaxons l’accueillit lorsqu’il s’engagea dans la rue Vautier qu’obstruait un véhicule de livraison immobilisé devant le musée des sciences naturelles. Il pressa le pas et s’engouffra sous le porche du numéro quarante-quatre, un bâtiment du dix-neuvième siècle qu’ornait une tourelle d’angle, appendice bourgeois d’une autre époque.
Kevlar occupait le premier étage qu’il avait transformé en loft et Rose-Marie un appartement du rez-de-chaussée. Ils restaient les deux derniers occupants de l’immeuble. Rose-Marie continuait à jouer la concierge dévouée et lui le locataire discret.
Elle ne s’était pas contentée de remplir son frigidaire mais avait procédé au nettoyage complet de l’appartement. Kevlar nota le mot fleur sur le pense-bête de la cuisine et s’installa à son bureau pour rédiger son rapport de filature de la veille. Il se demandait s’il n’aurait pas été préférable de parler du faussaire assassiné à Durandal. Il pouvait malgré tout avoir laissé ses empreintes sur les lieux, ou avoir été remarqué par un voisin durant sa planque. Mais son client ne souhaitait pas de publicité dans cette affaire qui prenait à présent une tournure bien différente. Et il lui aurait été délicat d’expliquer sa présence sur les lieux. Il envoya au directeur de la maison de vente un message lui expliquant à mots couverts l’issue de la filature et lui demanda ses intentions pour la suite.
Le visage de Sarah Stilton lui revint soudain à l’esprit. Il s’interrogeait sur le crédit à accorder au récit de cette jeune femme. Il décida de commencer par une visite au domicile du prétendu disparu, histoire de vérifier que l’oiseau n’était pas rentré au nid.





























