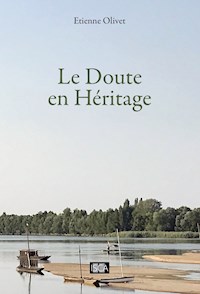
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Isca
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Les secrets de famille sont souvent les plus enfouis... Delphine est-elle prête à affronter les révélations qui l'attendent?
Un tiroir récalcitrant.Un mort dont on ne saurait parler.
Une ferme troglodyte à la réputation douteuse.
Un journal intime exhumé des dizaines d’années après les faits.
Delphine Violet découvre des vérités dérangeantes sur sa famille, celles qu’elle avait toujours voulu connaître sans que personne ne le lui permette.
Est-ce que Simone Haussuard lui a légué son secrétaire pour lui faire comprendre quel fut le drame de sa vie ? Ou bien pour lui instiller un doute sur son oncle «d’Amérique» ?
À travers la saga de familles angevines, le lecteur suivra Delphine dans son enquête sur la mort de Michel, le fils de Simone, l’héritier désigné de la fortune des Haussuard : suicide ou assassinat ?
Quand une mort suspecte se produit dans une famille fortunée, la méfiance s'éveille. Jetez-vous dans ce roman palpitant et découvrez la vérité.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né à Genève en 1942,
Etienne Olivet a entrepris des études d’architecture à l’EPUL avant d’obtenir une licence es Sciences commerciales à Genève. Après une carrière bancaire comme membre de direction, il se réalise dans l'écriture grâce aux ateliers de la Société de Lecture de Genève. Désormais retraité et grand-père, Etienne Olivet publie avec cet ouvrage, son premier roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Etienne Olivet
Le doute en héritage
Roman
© 2021, Etienne Olivet.
Reproduction et traduction, même partielles, interdites.Tous droits réservés pour tous les pays.
ISBN 978-2-940444-80-9
À Claudine, Corinne et Sylvie, les femmes de ma vie ; sans elles, ce livre n’aurait pas vu le jour.
Avertissement de l’auteur
Cet ouvrage est un roman. À ce titre, les protagonistes, les évènements et leur déroulement dans le temps et l’espace sont fictifs. Mais la vie étant ce qu’elle est, si d’aucuns d’entre vous pensent reconnaître des personnes ou des choses qu’ils ont vues, entendues ou vécues, soyez persuadés qu’il ne s’agit peut-être pas de coïncidences fortuites.
Prologue
1959
Le corps désarticulé de Michel Haussuard gisait sur le sol inégal de la cour d’une ferme troglodyte abandonnée des environs de Doué-la-Fontaine. Une patrouille de gendarmerie, intriguée par la présence incongrue d’une Ferrari rouge vif échouée le long d’un chemin vicinal et visible à des kilomètres à la ronde, le découvrit le mercredi 9 septembre 1959, tôt le matin. Elle nota aussi que la voiture était stationnée en bordure de la haie de buissons d’épineux qui protégeait le vide béant de la cour de la Vigneaudière. Les gendarmes connaissaient ces lieux qui n’avaient pas très bonne réputation, la nuit tombée. Personne n’était en vue. Le tour de l’enclos bordé de barbelés, aussi épars que rouillés, ne révéla aucune présence. Le soleil commençait à pénétrer dans l’abîme de la cour. Les pandores prirent leur courage à deux mains et s’engagèrent dans l’escalier taillé à même le tuffeau que ne fermait plus depuis longtemps un portail de fer démis de ses gonds. Les marches usées par le temps jusqu’à les presque effacer s’enfonçaient dans le sol en un couloir sombre et étroit. Seule la lumière au bas, reflétée de la cour, les engageait à entreprendre la périlleuse descente.
Arrivés au pied, ils furent accueillis à bras ouverts par un homme étalé sur un amoncellement de grosses pierres. Mais la position bizarre de la tête d’où un mince filet de sang avait coulé leur fit comprendre que l’individu ne pourrait plus les renseigner à propos de la Ferrari rouge. Leur chef, aussitôt alerté par radio, leur donna l’ordre de ne toucher à rien, de ne laisser approcher personne et il déclara qu’il informait immédiatement la police judiciaire d’Angers. Au-dessus d’eux, un ciel sans nuage soulignait le calme absolu de l’endroit. Seul le chant d’une alouette laissait entendre qu’il y avait un monde au-delà des parois surplombantes qui s’élevaient d’une dizaine de mètres au-dessus du cadavre. Des cavités creusées dans la roche tendre, fermées ici ou là par des fenêtres aux carreaux disparus, parfois murées, indiquaient que, jusqu’à une trentaine d’années en arrière, une famille de paysans avait habité là avec tout son train de ferme, et cela depuis des générations. Les gendarmes se sentirent oppressés par toute cette minéralité massive. Ils remontèrent.
Avec un soupir, ils s’installèrent pour attendre longtemps…
L’enquête ne révéla rien. La trace relevée par les chiens allait directement de la voiture à une ouverture où la haie était moins épaisse, quelques brindilles cassées correspondant aux épines restées plantées dans les vêtements du mort confirmaient la chute comme cause du décès. Rien n’indiquait l’intervention d’un tiers. Seule la divulgation de l’identité du défunt souleva des vagues de médisances dans les milieux d’affaires de la bourgeoisie d’Angers. Peu de jours après la macabre découverte, la nouvelle du dépôt de bilan de l’ancienne et réputée Maison Haussuard et Fils, Négociants en vins depuis 1847, entérinait les soupçons du juge d’instruction : Michel Haussuard s’était suicidé à 28 ans pour fuir la responsabilité d’une faillite dont il était le principal fautif. L’enquête fut close et le non-lieu prononcé.
I
Delphine
1993
Delphine Violet se retrouva les quatre fers en l’air avec, dans la main, un morceau de la clé du tiroir récalcitrant de son secrétaire. Celui du bas, là où elle empilait les anciennes compositions soumises à ses élèves et qu’elle ressortait quand deux ou trois générations de potaches avaient effacé le souvenir des épreuves passées. Toujours à quatre pattes, elle essaya de le faire glisser en enfilant les mains sous le meuble, mais un fond fixé au cadre inférieur empêchait de l’atteindre. Ce secrétaire Napoléon III était bien construit, il devait représenter le savoir-faire des artisans français de son époque, souligner la gloire de ce nouvel empire destiné à briller sur l’Europe des arts et de la science. Mais avec les années, ses glissières désormais renâclaient. « Une forme de rhumatisme, vu son âge… » avait souri intérieurement Delphine. Surchargé de délicates marqueteries florales incrustées dans un placage de palissandre, son style indéfini signait son temps. De fines baguettes d’ivoire soulignaient le tour de chacun de ses éléments, aussi Delphine n’osa pas débloquer le tiroir avec un outil, de peur d’esquinter ce délicat objet, dernier vestige de la splendeur de Gabrielle Haussuard. Son arrière-grand-mère l’avait acquis avec l’hôtel particulier qui lui servait d’écrin. La somptueuse demeure sise sur ce qui était alors le boulevard de Saumur, l’artère de prestige d’Angers au tournant du XXe siècle, avait été offerte par Gabrielle en cadeau de mariage à son mari, Henri Haussuard. À son tour, Delphine avait reçu le précieux meuble de sa grand-mère maternelle Simone, veuve d’Albert Haussuard, le fils de la fameuse Gabrielle.
Ne pouvant sortir le moignon de clé resté dans la serrure, Delphine enleva le tiroir immédiatement au-dessus et parvint à débloquer l’objet de ses désirs. Elle l’enleva complètement et le déposa sur la table de la cuisine pour pouvoir en démonter plus tard la fermeture. Son enfance au domaine du Château de Hautehaie, propriété de sa famille paternelle, lui avait appris à ne pas avoir peur d’un simple tournevis. Revenant dans son bureau, avec les documents qu’elle cherchait, Delphine s’arrêta. Un rayon de lumière pénétrait par les espaces ouverts dans la façade du meuble et éclairait ce qui lui parut être un amoncellement de carnets éparpillés sur le fond, ce fond qui l’avait empêchée d’atteindre le compartiment le plus bas du secrétaire. Se mettant à genoux, Delphine y plongea les mains et en sortit quelques-uns. C’étaient en effet, des cahiers bleus, de format écolier, assez épais. Chacun portait, au centre de la couverture, l’année à laquelle il se rapportait et, dans l’angle supérieur droit, un nom calligraphié d’une écriture appliquée : « Simone Meillac ». C’était le nom de jeune fille de sa grand-mère maternelle.
Delphine sortit tous les fascicules. Le déménagement du meuble, entre le logement de sa grand-mère et l’appartement où vivaient Delphine et son mari, avait certes perturbé l’ordonnance des piles, mais Delphine les reconstitua. Il y avait quarante-six cahiers, le premier daté de 1914, le dernier de 1959. Curieusement, sa grand-mère avait continué à intituler de son nom de jeune fille les cahiers postérieurs à son mariage avec Albert Haussuard, son grand-père. Elle en ouvrit un au hasard : la date des jours y était notée dans la marge. Parfois les entrées se suivaient, à d’autres moments, plusieurs jours pouvaient s’être écoulés entre deux dates. Le texte s’y rapportant, généralement disposé en un seul paragraphe plus ou moins long, était écrit de la même écriture d’écolière appliquée que sur la couverture. Elle y lut :
« 25 août 1948 – Albert levé de bon matin. Doit recevoir le lot de fûts de bordeaux retardé par les basses eaux de la Loire. La récolte de Château-Besnard est compromise par la grêle d’avant-hier. Nous l’avions payée d’avance. Il est parti soucieux. »
Delphine s’arrêta. Elle eut l’impression de pénétrer dans l’intimité de ses grands-parents. Certes, elle avait hérité de ce meuble par la volonté de sa grand-mère, mais se souvenait-elle seulement de l’existence cachée de ce qui était bien un journal ? Le dernier fascicule était daté de 1959 et depuis, trente et un ans s’étaient écoulés jusqu’à sa mort. Pourquoi ne l’avait-elle pas continué ?
Cette découverte plongea Delphine dans ses souvenirs. 1959 était l’année du décès de son oncle Michel, le frère cadet de sa mère, celui dont on ne parlait jamais, si ce n’est que par des allusions feutrées. Certes, elle s’en souvenait, n’avait-elle pas neuf ans l’année de sa mort ? Mais, pour elle à cette époque, il n’était qu’un jeune adulte, joyeux et blagueur qui venait de temps en temps chercher du vin au Domaine et l’emmener faire un tour, cheveux au vent, dans une de ses voitures de sport. Y aurait-il eu un rapport entre sa mort, la fin du journal de sa grand-mère et le silence entretenu depuis sur tout ce qui entourait la famille Haussuard ?
Delphine, plus tard, avait su que le départ de son oncle avait été tragique ; on avait mentionné rapidement « qu’il s’était enlevé la vie » et on avait passé à un autre sujet. Peut-être que ce drame avait justifié l’arrêt du journal ? Dernier porteur du nom Haussuard, la lignée s’était éteinte avec sa mort. Certes, il avait deux sœurs aînées, mariées et ayant eu des enfants (Delphine n’en était-elle pas une d’entre eux ?), mais il n’y avait plus de Haussuard en Anjou ou ailleurs dans le monde. Il ne restait même plus rien de la fameuse maison Haussuard.
Sic transit gloria mundi… se dit Delphine en souriant à son propre tic professionnel : n’était-elle pas professeur de latin et de grec ? Ces réflexions l’amenèrent à considérer sa propre vie.
Elle avait atteint la quarantaine, mère elle-même de trois enfants qui « poussaient » bien. Elle se plaisait à voir en Éric, son mari, un quatrième tant il était encore insouciant et jeune d’esprit. Non qu’il n’ait la tête sur les épaules quand il s’agissait de choses sérieuses, comme de l’administration des affaires familiales ou la gestion de son bureau d’architecte, mais bien par la créativité, la curiosité et l’ouverture avec lesquels il abordait son métier ou les aléas de la vie en général.
Delphine et lui s’étaient rencontrés à Paris, alors qu’elle « faisait » son école normale supérieure en vue d’une agrégation en lettres anciennes : les bals de l’École d’Arch’ étaient très courus… Éric Violet étant lui-même originaire d’Angers, ils s’étaient trouvés des affinités communes qui les aidaient à surmonter la solitude dans une grande métropole. Leurs études achevées et de retour dans leur cité natale, ils s’y marièrent. Delphine avait été immédiatement engagée comme professeur au lycée Joachim-du-Bellay de cette même ville. Le vénérable établissement, alors encore réservé aux filles, l’avait connue lycéenne et c’est là que, très probablement, elle terminerait sa carrière, chargée d’ans et de considération.
Delphine rit toute seule à cette idée : elle ne se voyait pas en retraitée, toute ridée et courbée sous le poids de ses cabas ! Elle se considérait encore dans sa pleine jeunesse. D’ailleurs, face à son miroir, elle se trouvait plutôt jolie avec ce qu’il fallait aux bons endroits, comme le prouvaient les caresses toujours enflammées d’Éric. De taille moyenne sans être petite, elle s’était laissé pousser les cheveux, marron aux reflets dorés, pour en faire une queue-de-cheval qui « l’allongeait », estimait-elle. Pour le quotidien, elle avait adopté le jean et souliers plats, sweaters ou des chemisiers colorés en été, pour paraître moins sévère vis-à-vis de ses élèves à qui elle enseignait des matières déjà suffisamment austères sans qu’elle y rajoutât un look rébarbatif.
Enfants, elle et son frère aîné de deux ans, Marc-Édouard, avaient grandi sans problème. De caractère calme et réfléchi, assidue sans être brillante, Delphine traversa sa scolarité en évitant tous les écueils. Rien ne la prédisposait à entreprendre l’étude des langues classiques mais, au lycée, elle avait pris goût au latin, puis au grec, fascinée par la souplesse créative de celui-ci et la concision si acérée de celui-là. Dans la vie courante, Delphine aimait à croire qu’elle appliquait à sa pensée les mêmes principes de raisonnement, car elle estimait qu’elle seule savait réfléchir aux besoins du quotidien. Éric, lui, voyait à plus long terme et sa réflexion, aussi sage fût-elle, tenait plus du rêve que de la réalité du moment présent. Mais Delphine était plus sujette au doute et elle attendait de son mari qu’il la conforte dans ses conclusions. Aussi recherchait-elle souvent son accord, son soutien. Elle le considérait comme un roc sur lequel elle pouvait prendre appui pour poursuivre la route.
Delphine se secoua ; elle s’était laissé entraîner à des rêveries qui ne lui étaient pas habituelles. Est-ce que ce journal si fortuitement découvert, porterait en lui quelque influence obscure ?
Elle décida d’en parler à sa mère, Julie, la fille aînée de Simone.L’heure était propice, elle prit le combiné mais le reposa aussitôt. Comment sa mère allait-elle réagir à la nouvelle de cette découverte ? Connaissait-elle seulement l’existence même de ce journal ? Elle qui semblait avoir banni de sa vie tout ce qui concernait les Haussuard, jusqu’à sa propre mère, voudrait-elle seulement entendre ce que Delphine allait lui dire ?
Julie Bonniot, née Haussuard, avait un caractère bien trempé avec, pour faire bon poids, une tendance marquée à « monter les tours » si elle était contrariée. « Une véritable “soupe-au-lait” », soupira Delphine. Mais il fallait en avoir le cœur net. Ce n’est donc pas sans une certaine appréhension que, reprenant le récepteur, elle composa le numéro. Ce fut Julie elle-même qui décrocha :
« Allô ! » aboya-t-elle d’un ton qui aurait fait croire à un non-averti qu’il l’avait sortie de son bain… Delphine, habituée, ne se laissa pas démonter :
« C’est moi, Delphine, tu vas bien ?
– J’entends bien que c’est toi et je vais bien aussi. Que me veux-tu ?
– Tu savais que Simou tenait un journal ? (Delphine avait trouvé, encore toute petite, ce diminutif alors qu’on lui suggérait d’appeler sa grand-mère Maminou, un nom qu’elle jugeait beaucoup trop long.)
– Oui, il me semble. Mais on ne l’a jamais retrouvé. Elle a dû le détruire. Pourquoi cette question ?
– Je l’ai déniché ! Caché dans un espace au-dessous du dernier tiroir du secrétaire, celui qui a toujours été si difficile à sortir. Il y a quarante-six gros cahiers. C’est toi qui devrais les avoir. Je te les apporte la prochaine fois que je viens au Domaine.
– Ah non… surtout pas ! Ce serait comme si son fantôme m’apparaissait ! Quand elle t’a légué ce monument, elle devait très bien savoir ce qu’elle faisait… Elle a toujours su pourquoi elle faisait les choses. Ce cadeau ne doit pas manquer à la règle ! Il fallait qu’un jour ou l’autre tu découvres ce journal qu’elle avait sciemment caché. Tu l’as déjà lu ?
– Oh non ! Juste quelques lignes au hasard, pour voir de quoi il s’agissait. Mais j’ai tout de suite eu un sentiment de gêne, comme un visiteur qui entre dans la chambre à coucher des maîtres de maison sans y avoir été invité. Je pensais que toi seule avais en premier le droit de lire ce document…
– Tu sais bien que je ne veux plus rien avoir à faire avec ma mère. Si je n’ai pas voulu l’accompagner au cimetière, ce n’est pas pour que son esprit revienne me hanter par l’entremise de ses souvenirs. Ce journal t’était destiné, elle t’adorait. Tu étais son rayon de soleil qu’elle disait ! Fais-en ce que tu veux… Garde-le si ça t’amuse. Lis-le si tu en as la patience, tu y apprendras sûrement que j’ai toujours été la méchante… Mais, en tout cas, tu ne m’en parles jamais plus ! »
Et Julie Bonniot raccrocha.
Delphine soupira : « Elle ne m’a même pas demandé comment j’allais… » Mais la réaction de sa mère ne la surprit pas. Le contraire l’aurait vraiment étonnée bien que déjà trois ans se fussent écoulés depuis le décès de sa grand-mère. Décidément, ces vieilles plaies ne se cicatrisaient pas, pourtant Delphine avait bien cru à une réconciliation entre les deux femmes lors de son mariage avec Éric, vingt ans plus tôt. Cependant, ce ne fut qu’une embellie de quelques mois, un an peut-être. Jusqu’à ce que certaines paroles malheureuses de l’aïeule, à propos d’une quelconque plate-bande dans le jardin de sa fille, rompissent définitivement tous les ponts.
Le téléphone reposé, Delphine resta songeuse dans son fauteuil.
Delphine reconnaissait qu’elle avait eu une enfance, une jeunesse même, pleine de bonheur. Maintenant, considérant son passé du haut de ses quarante-trois ans, elle devait bien admettre en toute honnêteté qu’elle avait vécu dans une famille privilégiée, pas seulement sur le plan matériel, mais surtout par l’harmonie qui les avait entourés, elle et son frère Marc-Édouard. Ils avaient passé toute leur enfance à Thouarcé dans la maison de ses parents. Son père l’avait héritée à la mort de ses grands-parents, Jeanne et Jules Bonniot.
Delphine n’avait pas connu ces aïeux, elle avait à peine un an quand un fatal accident de voiture leur était arrivé. Leur souvenir avait marqué son enfance par l’évocation de la bonne entente et de la complicité de tous les instants qui les unissaient, un exemple que ses parents suivaient en pleine communion. Ces réminiscences mélancoliques n’étaient pour elle que des ouï-dire et elle avait dû se créer les images à partir de vieilles photos et des récits de la famille.
Elle pensait aussi à Simone Haussuard, son autre grand-mère qu’elle avait bien aimée. Elle l’accompagna jusqu’à ses derniers jours, la seule en fait qui s’occupait encore de la vieille dame recluse dans un modeste appartement, entourée de quelques épaves sauvées du naufrage de la maison Haussuard.
Le logement où Simone avait vécu, aussi loin que remontaient les souvenirs de Delphine, se situait dans un immeuble sans âge de la rue du Mail. Plutôt sombre, Simone avait pallié le manque de lumière, tombant chichement des fenêtres étroites, par des murs blancs, des meubles aux couleurs claires et par des quantités de lampes de table qui chassaient les ombres des moindres recoins.
En bonne forme physique en dépit de la rondeur de ses formes et de tous les malheurs qu’elle avait vécus, elle avait gardé jusqu’à la fin un abord avenant, qu’elle soignait en se vêtant de teintes fraîches et préférant même le pantalon. Ne les portait-elle pas dans la vie de tous les jours, laissant robes, jupes et autres tailleurs pour les « sorties » ou les « grandes occasions » ? Elle conservait une certaine jeunesse d’esprit qui rendait sa conversation agréable tant qu’on ne la contredisait pas, car elle avait des idées bien arrêtées sur toutes sortes de sujets. Il ne fallait alors pas lui tenir tête, sous peine d’être ostracisé pour un temps indéfini !
Le sujet qui fâchait le plus était de mettre en doute les valeurs qu’elle professait, en particulier tout ce qui touchait à la transmission du patrimoine familial qui ne devait et pouvait que revenir à un seul, un mâle. Elle aurait toléré une fille, à condition qu’elle fût unique et mariée à un homme capable, selon son propre jugement, d’en assumer la gestion. Pour Simone, la femme n’avait comme seul devoir que d’assurer « l’élevage » des enfants et d’offrir à son mari les conditions lui permettant de remplir son devoir de pérenniser l’héritage des aïeux. Pour elle, Napoléon et son Code civil n’étaient que trahison de la sagesse des peuples qui, par des millénaires d’expérience, avaient compris que la terre ne se divise pas !
Cette conviction avait entraîné la rupture avec Julie, qui remontait à quelques années avant la débâcle Haussuard, plus précisément au règlement de la succession d’Albert Haussuard, le mari de Simone. La mort avait emporté le chef de famille subitement, à l’âge de cinquante-cinq ans en 1956. La dispute impliquait non seulement Julie mais aussi Annette, sa cadette, qui vivait alors aux États-Unis avec son mari ; Julie prenant sur elle la défense des intérêts de sa sœur. Heureusement pour Delphine, sa mère ne voulait pas que cette histoire de gros sous n’affecte la relation de ses enfants avec leur grand-mère et les laissait la rencontrer dans toutes les circonstances où pouvait s’impliquer une aïeule aimante. La seule condition étant que jamais Simone ne devait remettre les pieds au Domaine. Delphine devait reconnaître la loyauté des deux protagonistes et qu’elles n’avaient jamais cherché à monter Marc-Édouard, son frère, ou elle-même, contre l’une ou l’autre. Aussi ne conservait-elle que de bons souvenirs de Simou.
Tout à coup, Delphine réalisa : « Il fait nuit et rien n’est fait ! » Elle considéra les cahiers éparpillés : « D’abord les ranger, je ne vais pas les remettre dans le fond du secrétaire. » Elle avisa un rayon de sa bibliothèque : « Ces romans que je n’ai jamais relus… loin ! Faites place ! » Une décision héroïque de la part de Delphine pour qui chaque livre était un ami et qui avait toujours été incapable de se séparer d’un seul. Dans l’espace ainsi libéré, elle casa les cahiers par ordre de dates. Mais elle n’osa pas en tirer un, pour le lire tranquillement plus tard. Des scrupules la retenaient, une certaine crainte aussi : qu’allait-elle y découvrir ?
En secouant la tête comme pour en chasser ses prémonitions, elle se pencha sur les anciennes compositions d’élèves par lesquelles tout avait commencé.
II
Delphine
1967
Delphine adorait les après-midi passées avec sa grand-mère lorsqu’elle venait la chercher les jeudis à Thouarcé, à la porte du Domaine. Simone l’emmenait dans sa petite voiture jusqu’à son appartement à Angers et la ramenait en fin de journée. Plus tard, lorsqu’elle fut entrée au lycée Joachim-du-Bellay, Delphine vécut chez Simone où elle avait une petite chambre bien à elle. Pendant ces six années, sa grand-mère la conduisait tous les week-ends chez ses parents mais la déposait toujours à l’entrée du Domaine. Delphine savait que des évènements apparemment pénibles avaient suivi la mort de son grand-père, mais elle n’avait que six ans à ce moment-là. Ce ne fut qu’un peu plus tard qu’elle comprit qu’il y avait eu une dispute entre sa mère et sa grand-mère. Elle en prit conscience en recueillant imperceptiblement des informations au gré de bribes de conversation. Ce n’était pas des choses dont on parlait en présence des enfants… Évidemment, elle voyait bien que Simone ne rencontrait jamais sa mère et qu’elle faisait tout pour éviter de la croiser même fortuitement, et réciproquement.
Maintenant qu’elle était adolescente, elle profitait des soirées chez sa grand-mère, pour essayer de lui soutirer des détails, des précisions, des anecdotes peut-être…
« Simou, allez, raconte-moi ton enfance…, sollicitait Delphine, tu as été une petite fille aussi, allez, raconte…
– C’est trop long, Delphine, et c’était il y a tellement longtemps. Les choses ont bien changé depuis ; tout ça n’existe plus…
– Mais non, c’est parce que ça n’existe plus qu’il faut en parler, comme ça, on s’en souvient.
– Mais quand c’est triste, on ne veut pas s’en souvenir, soupira Simone.
– Maman m’avait dit que tu venais de la campagne, où habitais-tu ?
– Oh, dans un tout petit village, à peine plus qu’un hameau, il s’appelait Balanzac, en Saintonge, avec, un peu à l’écart, une église et son curé. Et une école avec un seul instituteur pour tous les degrés. La France profonde… comme disent ceux des villes…
– Et ta famille, Maman m’a dit que tu étais partie toute seule quand tu avais mon âge ?
– Même avant, mais tu vois, ça, ce sont des choses tristes, même pour toi, dont je ne veux pas parler.
– C’est à ce moment-là que tu as rencontré Papidou, insista Delphine.
– Pas du tout, c’est arrivé bien plus tard.
– Je sais que vous vous êtes mariés en cachette et que c’est pour ça que la mère de Papidou n’a jamais voulu te voir. Elle était terrible, n’est-ce pas ?
– Impressionnante, en tout cas. Gabrielle était la reine d’Angers, elle avait une superbe maison sur ce qui est maintenant le boulevard Maréchal-Foch…
– Et roulait en Rolls ! Maman me l’a raconté. On venait la chercher pour goûter ! Je me souviens de Granny mais j’étais encore petite. C’était une très vieille dame.
– Tu avais à peine sept ans quand elle est morte…
– Et elle est morte après Papidou, c’est triste pour une Maman de perdre son fils… Ce n’est pas normal !
– Tu sais, Delphine, ce n’est pas normal non plus de perdre son mari qu’on aime, surtout quand il est encore trop jeune… Et, moi aussi, j’ai perdu un fils…
– Oh, pardon, Simou ! Quelle sotte je suis avec mes bavardages, je te fais de la peine. Ce que tu as dû souffrir ! Surtout qu’ils sont tous morts presqu’en même temps. C’est une malédiction, c’est pourquoi on n’en parle pas…
– Si tu veux, soupira Simone.
– Mais Maman, non plus, ne veut plus te voir… Elle ne veut jamais en parler, mais je sais qu’il y a eu des disputes d’héritage. On me disait que ce n’était pas des histoires pour les enfants, mais maintenant je suis grande et en terminale, nous avons des cours de droit. Les héritages, c’est du droit civil !
– Écoute, Delphine, je me sens un peu fatiguée et c’est l’heure de se coucher. Va au lit et ne lis pas trop tard. »
Àsa toilette, Simone repensait à la conversation de la soirée : « Ce soir, Delphine s’est montrée insistante. Elle veut savoir. Ce n’est pas une curiosité malsaine. Elle ne cherche pas les ragots. Elle aimerait connaître la vérité, car quand on va sur ses 17 ans, on ne vous fait plus avaler n’importe quoi. Mais, pour moi, c’est encore trop pénible. Ça me remue et quand j’y pense, je me dis que ma vie a été vraiment difficile, jusqu’au sacrifice. »
Simone se revit à l’époque où elle vivait encore dans la ferme familiale sur des terres arides qui suffisaient à peine à nourrir la maisonnée. Adolescente, aînée de sept frères et sœurs orphelins d’une mère morte en couches du petit Jean, elle avait dû gérer la vie de la famille jusqu’au moment où l’Assistance publique prit la relève. En effet, le père n’avait pu se remettre du décès de sa femme. Devenu alcoolique et incapable de conduire le train de ferme, il vendait les terres de son domaine déjà bien maigre, pour étancher sa soif. Simone chassa le souvenir horrible de cet homme qui abusait d’elle. Elle ne voulait plus se remémorer les souffrances qu’elle avait finies par surmonter grâce à Albert, son mari adoré que la mort avait enlevé bien trop tôt. Delphine avait ravivé, par ses questions, cette plaie que Simone croyait fermée à jamais.
Comme son esprit ne voulait plus se détacher de cette période lointaine, elle affronta ses souvenirs.
Jusqu’au décès de sa mère, Simone pouvait dire que sa vie avait été heureuse, si elle considérait comme normal un quotidien fait de labeurs incessants, partagés par tous les membres de la famille comme tous les villageois de sa région. Ils étaient tous égaux devant les sécheresses, les tempêtes, les gels. Tous devaient nourrir des ribambelles d’enfants. Les fils, lorsqu’ils avaient survécu aux maladies et aux guerres, reprenaient les domaines de leurs pères et se mariaient aux filles des voisins. Les grandes discussions et les grandes disputes tournaient toujours autour du partage des terres lors des décès ou des mariages. La révolution de 89 avait instauré la dévolution égalitaire entre héritiers et, depuis, les domaines s’étaient morcelés au point qu’ils ne suffisaient plus pour nourrir les familles qui, elles, restaient toujours tout aussi nombreuses. Cette absolue nécessité de conserver la terre comme unique moyen d’assurer la survie de la descendance avait marqué Simone depuis son plus jeune âge. Aussi lorsque son père avait commencé à vendre le patrimoine familial pour assouvir son alcoolisme, Simone avait ressenti un profond sentiment de trahison et d’impuissance. Elle n’avait pas quinze ans et on ne pouvait pas alors s’élever contre les actes d’un père ! À cette évocation, Simone ne put s’empêcher de penser que la pérennité d’un patrimoine réside dans la transmission à un seul bénéficiaire. « Encore faut-il qu’il soit lui-même capable de le maintenir ! » s’exclama-t-elle dans une bouffée de colère rétrospective. Cette réflexion lui rappela Autant en emporte le vent, le roman de Margaret Mitchell. Elle avait retrouvé les valeurs qui étaient les siennes dans la farouche volonté de Scarlett O’Hara de conserver à tout prix Tara, la plantation de son père. Mais elle, Simone, n’avait pas réussi : la maison Haussuard n’était plus. Son fils avait tout gâché… « Autant en emporte le vent ! » se dit-elle avec rage.
Déjà, le désastre vécu dans sa jeunesse l’avait marquée et avait renforcé sa conviction que la préservation de la propriété primait tout. La rude vie de campagne modelait des enfants solides, les garçons plutôt râblés et costauds, endurcis par les travaux des champs plutôt qu’instruits sur les bancs d’école. Les filles, très tôt engagées dans les tâches du ménage, de la basse-cour et des soins aux petits, devenaient des mères dures à la tâche, fidèles à l’église et redoutées de leurs maris. Eux préféraient le réconfort du café du village aux criailleries de la cuisine familiale, souvent la seule pièce à vivre de la maison. Les mariages donnaient lieu à d’âpres tractations entre les pères, avec comme seul but d’éviter la subdivision des domaines quand on ne pouvait pas les fusionner. Parfois, une grossesse imprévue précipitait les négociations et chamboulait les alliances…
Simone avait conservé un solide fond de santé paysanne. Jeune, elle avait été ce que dans les campagnes on appelait « un beau brin de fille » qui n’aurait pas déplu à Aristide Maillol.
Maintenant, à soixante-huit ans, l’embonpoint l’avait gagnée, surtout depuis que, vivant seule, elle se préparait ses repas elle-même. Sa petite-fille appréciait sa cuisine et s’intéressait à ses recettes. Cela ne facilitait pas le maintien de la ligne. Mais Simone s’en fichait, elle n’avait plus personne à qui plaire…
Elle lisait beaucoup, même si elle n’avait fait que l’école primaire, mais avec succès car elle était studieuse et appliquée. Elle avait développé ce goût pendant les années vécues à La Rochelle, stimulée par sa patronne d’alors, qui voyait en elle une employée pleine d’avenir. Pleinement consciente que son mariage l’avait fait entrer dans un milieu plus étoffé intellectuellement, elle s’était efforcée de rattraper le « retard » qu’elle croyait avoir par une lecture assidue, et de la presse et des livres de son mari.
Cependant, une fois dans son lit, Simone ne reprit pas son livre comme tous les soirs. Pourtant, c’était un moment qu’elle savourait particulièrement. D’une part, l’activité du quotidien, toujours la même tout au long de jours tous semblables, était achevée ; l’ombre gagnait le logis ; le bourdonnement de la ville s’estompait. Dans la bulle de lumière douce qui repoussait ses soucis dans l’obscurité, Simone se laissait transporter dans les univers de ses auteurs favoris. Mais, ce soir-là, étendue contre ses oreillers, ses mains inertes reposant sur la couette, elle continuait à songer :
« Quelques années de bonheur certes, le temps de mon mariage avec mon Albert, lorsque nous n’étions vraiment que les deux ensemble avec les enfants. Dès que je mettais le nez dehors, j’étais l’étrangère, la suspecte, la voleuse d’héritage. Quand je pense à tout ce que j’ai fait pour le préserver et qu’il n’en reste rien. Même mon fils a failli. Une fin de race qui n’a pas procréé, car je ne l’ai pas permis. Le moment venu, il faudra que Delphine sache. Je lui léguerai mon secrétaire, l’ultime vestige Haussuard. Elle y trouvera, peut-être mon journal. Alors, elle saura ce que j’aurais voulu qu’elle croie. Mais ce sera trop tard, j’aurai alors emporté la vérité dans ma tombe. »
*
Delphine essaya souvent de revenir à ces sujets. Mais Simone balayait ses questions d’un grand geste et lui répondait chaque fois avec un sourire, un peu triste peut être, que c’était là de l’histoire ancienne, qu’il n’y avait plus à y revenir, que de toute façon cela n’y changerait rien.
III
Julie
1993
Le téléphone raccroché, Julie arpenta à grands pas énervés le couloir qui desservait les pièces principales de la maison. « Je n’en aurai jamais fini avec ces Haussuard ! Disparus, effacés, oubliés, sortis par la grande porte (si l’on peut dire : un suicide…), ne faut-il pas qu’ils reviennent par l’entrée de service : un journal ! Ma mère n’en fera qu’à sa tête jusque dans l’au-delà ! »
« J’en ai marre ! »s’exclama-t-elle en claquant la porte donnant sur le jardin. Elle alla chercher ses gants, un sécateur et commença à nettoyer les rosiers qui bordaient l’allée principale conduisant à la maison. « Les mêmes, songea-t-elle, que ceux en tête de chaque rangée de ceps des vignes du domaine. » Elle travaillait machinalement, ne pouvant effacer le malaise qu’avait provoqué le téléphone de sa fille. « Maintenant ma vie, c’est le Domaine, c’est Martin. Fini, les Haussuard et leurs intrigues. Ils sont bien avancés maintenant, tous tant qu’ils y sont à bouffer les pissenlits par la racine ! Y a plus de Haussuard ! » Et, d’un geste rageur, elle trancha la tête fanée d’une rose. Emportée par son élan, elle se piqua à la tige voisine ; dans son énervement, Julie avait oublié de mettre ses gants qui gisaient sur le gravier à côté d’elle. Elle jura tout bas en les enfilant et continua sa tâche en ressassant ses pensées.
À soixante-neuf ans, Julie se voyait vieille. Elle se sentait fatiguée. Pas physiquement, car pleine d’énergie et sa haute taille svelte la faisait paraître plus jeune qu’elle n’était. Mais moralement. Le monde et son train la lassaient. Cela se voyait sur son visage émacié. Lorsqu’elle ne se sentait pas observée, ses traits étaient sévères, durs. Les commissures de ses lèvres fines s’abaissaient en une moue dédaigneuse. Désormais, elle arborait un port altier, aristocratique, qui détournait les gens qui ne la connaissaient pas de l’approcher. Jamais elle n’était importunée par un quémandeur.
Cela n’avait pas toujours été le cas. Jusqu’à la mort de son père et le cortège de malheurs qui s’est ensuivi, elle était une jeune femme vive et primesautière. Grande, élancée, elle respirait alors la joie de vivre. Son visage, bronzé par le grand air qu’elle affectionnait, reflétait son bonheur. Depuis les drames et, en particulier, la rupture avec sa mère, elle s’était refermée, aigrie. Elle ne trouvait la sérénité que dans son jardin et dans les voyages que Martin acceptait de faire avec elle, maintenant que les soucis de la vigne et du Domaine passaient à ses neveux. Ses enfants étaient adultes et vivaient leur vie depuis longtemps. Certes, elle était grand-mère, mais ses rejetons l’indifféraient plutôt. Elle n’allait pas les voir ; d’ailleurs, elle ne conduisait pas et n’avait jamais plus conduit depuis que son mari, affolé par l’odeur de brûlé qui avait envahi l’habitacle de la voiture, lui avait fait le reproche qu’elle avait oublié de relâcher le frein à main. Si elle était contente de voir progresser ses petits-enfants lorsqu’ils venaient régulièrement leur rendre visite au Domaine, elle les laissait rapidement entre les mains de Martin qui, en grand-père de rêve, savait si bien se mettre à leur niveau. Elle prétextait qu’elle avait trop à faire dans la maison pour se laisser aller à ces enfantillages. Et pourtant, elle avait de l’aide par une femme de ménage qui venait du village quotidiennement pour préparer les repas et faire les nettoyages. Dans le passé, Julie avait eu quelqu’un à demeure mais, depuis que Delphine et Marc-Édouard avaient quitté la maison, elle ne supportait plus une présence étrangère. Certains disaient dans son dos qu’elle n’était qu’une enfant gâtée, et que tout était de la faute de son mari qui se pliait à ses quatre volontés. D’autres voyaient en elle le portrait craché de sa grand-mère Gabrielle…
« Et que l’on ne vienne pas me dire que j’en suis une, de Haussuard, pensait Julie. Ils se sont débarrassés de moi en me mariant à Martin. Mal leur en a pris : parce que je l’ai aimé dès le premier jour, mon Martin. Maintenant je suis une Bonniot et c’est ce qui sera marqué sur ma tombe ! » Elle essuya une larme et se pencha sur ses plates-bandes.
Martin, rentré plus tard dans l’après-midi, la trouva dans la même occupation. Elle lui sauta au cou et lui déclara tout de go : « Martin, je t’aime… je t’aime… je t’aime ! Tu ne peux pas savoir combien ! » Il fut surpris par pareil accueil : « Mais, moi aussi, je t’aime, que se passe-t-il ? »
Julie raconta la découverte du journal de sa mère par Delphine.
« Tu comprends pourquoi je ne veux rien avoir à faire avec ce journal… Après tout ce qui est arrivé ! C’est du passé tout cela. Cette famille Haussuard, c’est eux, la cause de tout ! Et ma mère qui a pris leur parti ! Elle qui avait pourtant été mise au ban du clan par la reine Gabrielle. Maintenant, c’est toi ma famille. Grâce à toi, je suis devenue une Bonniot ! C’est ici que je me sens bien.





























