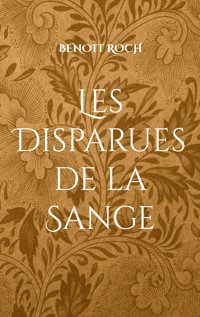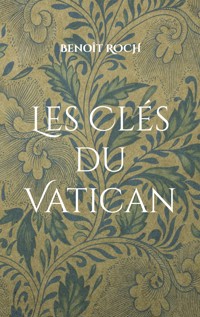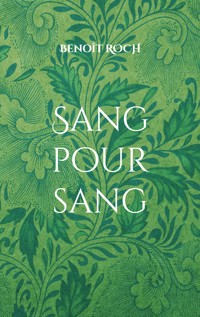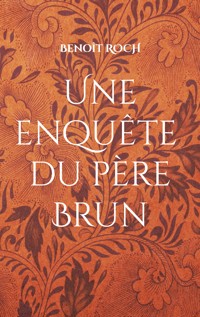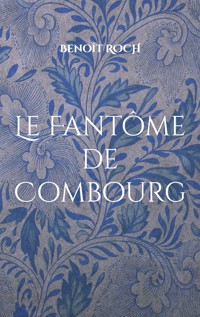
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Serie: Les enquêtes du Père Brun
- Sprache: Französisch
La deuxième enquête du père Brun commence dans le château hanté de Combourg sur les pas de Chateaubriand. Nous retrouvons l'atmosphère du premier volume, avec de nouveaux personnages, dans une quête policière aux accents métaphysiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La vie n’est qu’un fantôme errant, un pauvre comédien qui se pavane et s’agite durant son heure sur la scène et qu’ensuite on n’entend plus ; c’est une histoire dite par un idiot, pleine de bruit et de fureur.
William Shakespeare
(Macbeth)
Avis au lecteur
Cet ouvrage porte le beau nom de roman, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une fiction, benoîtement imaginée par son auteur et qu’en conséquence les personnages, les propos ou les intrigues n’ont aucune réalité dans la vie des autres.
Que si, par inadvertance, et pour le plus grand malheur des bonnes consciences, des fâcheuses ou des orgueilleuses belles personnes se croyant en droit de reconnaître, elles-mêmes, leurs propres actions ou leurs propres paroles, ou les fantômes de leur famille, dans les situations qui peuplent ce récit joyeux, il va sans dire - mais il va mieux en le disant, vous le savez - qu’il ne pourrait s’agir que d’un coup de dés lancé par le destin, la fortune ou le hasard.
Quant à la providence, l’auteur ne cultive pas la vaine insolence des naïfs de la vouloir associer à ces enfantillages.
Sommaire
Avant-propos
Chapitre 1 : Un dîner à Combourg
Chapitre 2 : Le château hanté
Chapitre 3 : Le chat noir
Chapitre 4 : Une nuit agitée
Chapitre 5 : Le coupe-papier
Chapitre 6 : La crèche
Chapitre 7 : Un curieux poème
Chapitre 8 : La loi de Murphy
Chapitre 9 : Une enquête parallèle
Chapitre 10 : Le cabaret du Chat Noir
Chapitre 11 : La danse de Saint Guy
Chapitre 12 : Harald à la dent bleu
Chapitre 13 : L’oncle Pierre
Chapitre 14 : La mère Bodu
Chapitre 15 : Le chat d’argent
Chapitre 16 : La Haute vente
Chapitre 17 : Les rêves d’Amanda
Chapitre 18 : La vieille dame du train
Chapitre 19 : La couleur du glaz
Chapitre 20 : Un complot
Chapitre 21 : La forêt de Brocéliande
Chapitre 22 : La liste de noms
Chapitre 23 : La poule et le cochon
Chapitre 24: Le Brave des braves
Avant-propos
« Le roman policier nous réconcilie avec la métaphysique! ».
Ce n’est pas François-René de Chateaubriand (et pour cause!) mais l’auteur d' « Une enquête du père Brun » qui nous assène cette vérité dans son premier opus paru aux éditions BoD.
Le Nantais Benoit Roch, grand lecteur de Chesterton et de Huysmans, poursuit sa quête policière avec « Le fantôme de Combourg » qui voit pour la première fois son château, aux quatre tours austères, servir de cadre à une aventure que l’Enchanteur eut sans doute apprécié!
L’univers de Combourg se prête en effet merveilleusement à l’esprit d’un roman policier classique avec sa forteresse médiévale, belle maison hantée; son fantôme de haute lignée, son chat noir papal et les légendes et paysages sous un ciel breton.
Une aubaine pour l’auteur qui peut donner ainsi libre cours à son imagination portée par les chevaliers de la Table ronde et leur pèlerinage mystique vers le Graal…
Derrière l’enquête policière, à proprement dite, Benoit Roch poursuit, ici, sa quête métaphysique amorcée dans son premier épisode considérant qu’elle doit autant au génie de Chesterton (Father Brown) qu’à l’esprit de Chateaubriand (Vie de Rancé). Rédigé d’une plume élégante et cultivée, « Le fantôme de Combourg » ne laissera aucun lecteur de Chateaubriand, indifférent.
Bien au contraire, ils y trouveront de quoi fortifier leur insatiable besoin de curiosité et de merveilleux dans le creuset de l’Enchanteur et de ses sylphides admirables qui parcourent toute son œuvre: « C’est ici, dans les bois de Combourg, que je suis devenu ce que je suis! ».
Merci au père Brun d’avoir choisi les longues allées boisées de Combourg pour poursuivre ses enquêtes ponctuées de suspens, d’émotion et de curiosité. Elles enchanteront le lecteur et donneront à ce genre littéraire de nouvelles lettres de noblesse appelées, hic et nunc, à nous faire rêver !
Hervé LOUBOUTIN
Fondateur du prix Combourg
Chapitre 1
Un dîner à Combourg
« C’est dans les bois de Combourg que je suis devenu ce que je suis ». Au moment où il franchissait la grille du parc, le père Brun se remémorait cette phrase, comme si la propre voix de Chateaubriand eût résonné dans son esprit. Le vent soufflait très fort sur les arbres ancestraux, faisant ployer les cimes des vieux hêtres, sous le regard immobile des chênes aux frondaisons nerveuses. Un tilleul, bahuté par les cheveux, comme Dahut par le diable, fit gémir un long craquement, tandis que la voiture du père alla se garer sur l’esplanade balayée par la tempête, comme les terres de Hurlevent, devant la façade féodale qui hantait la nuit.
Il avait gravi les marches en courant, pour s’arrêter sur le palier du grand perron, et tirer la cloche, afin d’annoncer son arrivée. Pendant les quelques secondes interminables de son attente, fouetté par tous les vents de l’enfer, trempé par un invisible crachin, il se retourna vers le parc, si lugubre théâtre d’ombres mouvantes, perdues dans une obscurité suintante, ruisselante, au beau milieu d’une poissée ténébreuse. La porte s’ouvrit sur un homme jeune et élégant :
- Bienvenue à Combourg !
Il suivit son hôte jusqu’à un petit salon, en admirant au passage, sur la droite du grand vestibule d’entrée, le buste de l’Enchanteur, par David d’Angers, dans un marbre magnifique et blanc. Au salon, la mère de son hôte l’accueillit avec soin, en compagnie aimables de quelques amis bienheureux. Une cheminée magistrale charmait les regards par une grande flambée, où craquaient des bûches rougies, éclairant la pièce et réchauffant les cœurs.
- Mon ami Georges !
Les invités buvaient un verre, calés dans les fauteuils profonds, en attendant l’heure du dîner. A côté de la comtesse, un académicien courbé, aussi vieux que les arbres du domaine, bavardait avec le président d’un jury littéraire. Dans un canapé, près de la photo en cadre du célèbre abbé Mugnier, devisaient deux femmes ignées, l’une historienne, l’autre archéologue. Sur le fronton de la cheminée, où crépitait un feu jovial, deux petites tours crénelées, levées sur chaque extrémité, encadraient le linteau. Sur la hotte en biseau, où la hauteur se fondait dans le mur, une hermine bretonne, en bas-relief, était surmontée d’une couronne marquisale, avec ses fleurons séparés par trois perles, et réunies en forme de trèfle, un souvenir des marquis de Coëtquen, lesquels, par lettres royales possédaient la baronnie depuis Henri III, avant de la céder en 1761, par les Durfort, à René-Auguste, père de l’Enchanteur.
L’homme qui avait introduit le père Brun par « Mon ami Georges ! » s’appelait Tugdual de Kerandat, un écrivain qui passait la nuit au château, avant de recevoir le Prix Combourg, décerné au lendemain. Il avait invité son vieil ami d’enfance, moine franciscain, avec quelques membres du jury, en vue de passer toute la nuit dans la demeure de Chateaubriand, et consommer, entre gens de lettres, une soirée mémorable, en dépit de la tempête qui soufflait en faisant grincer les âmes des huisseries et des charpentes séculaires.
- Bienvenue à Combourg ! lui déclara la comtesse qui souriait à la vue du franciscain.
- Merci à vous, Madame la comtesse, et à Monsieur votre fils de me recevoir ici ! C’est une joie pour moi de vous rencontrer ainsi que vos amis, dans ces lieux chargés d’esprit et d’Histoire.
- Chargés d’esprits ! Ah ah, tu n’en manques pas une, Georges ! reprit son ami Tugdual à la volée.
Un murmure de sourires éclaira les lèvres des invités. La soirée s’annonçait bien, égayante et spirituelle. On palabra dans une insouciante bonne humeur, sous les lumières d’ambre et de safran, filtrées par les abat-jours des lampes, face à la chaleur vivace du feu, en dépit de la tempête qui grondait derrière les murs épais de plusieurs pieds, comme si la fin du monde était programmée avec le retour du vieux Noé, afin de célébrer dans les froideurs détrempées de cette nuit diluvienne, l’achèvement des deux Alliances. A l’instant de passer à table, on entendit sonner le dernier invité, qui annonçait son arrivée. Quelques secondes après, émergea un gros monsieur joufflu, aux trois mentons soutenus par un énorme nœud papillon, lequel gros monsieur se présenta, dans une sorte d’hilarité générale :
- Docteur Papillon !
Le dîner était servi dans la grande salle à manger, qui fut la salle de garde, jusqu’à la rénovation, réalisée dans le style troubadour de la fin du XIXème siècle, par Ernest Thrile, élève de Viollet-le-Duc, où trônait, sur un des côtés de la pièce, une sorte de grand buffet en bois sombre, et coiffé d’une couronne comtale, au tout dessus des armes blasonnées de la famille Chateaubriand : De gueules, semé de fleurs-de-lis d’or.
A la bataille de Mansourah, Joinville nous raconte que Chotard de Châteaubriant (qui n’était autre que Geoffroy V du même nom) a sauvé Saint Louis d’un dard, en répandant son sang sur les armes du monarque. Pour le remercier, le saint roi l’autorise à transformer ses armes, et à changer les pommes de pin (ou les plumes de paon) en fleurs-de-lys, afin de les semer sur un blason à fond rouge. Plus tard, la famille, si fière des prouesses de tous ses aïeux, abandonnera son ancienne devise : Je sème l’or, pour en adopter une autre qui claquera aux vents de l’Histoire, comme un étendard de feu : Notre sang teint les bannières de France.
- Croyez-vous aux fantômes, mon père ?
La jeune femme qui interrogeait le moine, pendant la cassolette de Saint-Jacques, portait des lunettes vertes en forme de losange, sous une coiffure en boule, aux reflets gaéliques. Son métier d’archéologue lui coulait dans les veines comme les lois de l’affût dans celles du setter.
- Ah oui, cher Georges, renchérit son ami, que nous dit l’Eglise à ce sujet ?
- Avant de vous relater ce que l’Eglise en dit, répondit le moine, avec aux lèvres le merveilleux sourire de John Wayne, quand il décoche une droite à Lee Marvin, dans la Taverne de l’Irlandais, je vais vous citer un mot du bon vieux Kant : « Les histoires de revenants rencontreront toujours des croyants secrets et seront toujours l’objet, en public, d’une incrédulité de bon ton ».
- Je partage l’avis du philosophe prussien, ajouta le vieil académicien, derrière une paire de lunettes à double foyer, qui datait au moins du siècle où l’on critiquait la Raison pure.
- Depuis les débuts du Moyen âge, l’Eglise a souhaité distinguer deux catégories de fantômes, ou ce qu’il est convenu d’appeler ainsi. Soit un démon prend l’apparence d’un spectre. Soit une âme du Purgatoire vient tout simplement réclamer une délivrance.
- Le Purgatoire ?
- Un état de purification pour les âmes des défunts. Ils ont besoin d’atteindre la perfection pour accéder ensuite à la vision béatifique. Une salle d’attente, en quelque sorte.
- Pure invention de l’Eglise ! fulmina de son côté le Dr Papillon, psychiatre de son état, rouge de colère, que la science indéfinie conduisait à imposer son point de vue à tous, persuadé que chacun demeure la proie inconsciente de sa subconscience, cause efficiente et insondable, éternellement livrée aux ténèbres de l’inconnaissable.
- Pas exactement. Platon en avait eu la géniale intuition, dans le Phédon, son traité sur l’immortalité de l’âme.
- Et dans la République, à la fin du livre X, le mythe d’Er, un revenant qui fait le récit du jugement des âmes, en présentant la rétribution que reçoivent les bons et les méchants, précisa le vieil académicien, d’une voix étonnante et lugubre, comme s’il revenait à l’instant même du séjour des morts.
- Exact, mais le Phédon est plus précis, en installant notre vie entre une région périphérique, presque céleste, celle des récompenses, et une région intérieure, plus centrale, celle des expiations, le fameux royaume d’Hadès, où tous les morts sont jugés mais où seuls restent ceux qui endossent une peine. Il dépeint des âmes portant le poids de leurs péchés, pas assez graves pour être condamnés au Tartare, le plus bas niveau des enfers, pas assez légères pour le paradis des Champs Elysées. Le mythe précise qu’ils sont pris dans des courants, les faisant tourbillonner, jusqu’au moment où ils se trouvent purgés de leurs turpitudes.
- Mais que peut venir réclamer une âme du Purgatoire ? interrogea la deuxième femme, fort grosse, mais plutôt jolie, qui possédait un sourire à faire rougir tout un séminaire, et dans les yeux de laquelle brillait on ne sait quoi de troublant, un petit quelque chose qui faisaient oublier qu’elle était historienne.
- Oh, chère Madame, il y a toutes sortes de raisons. Par exemple, des rituels funéraires mal exécutés, ou bien certaines affaires inachevées. Ces âmes ont besoin que les choses ici-bas soient définitivement réglées ; des suicidés aussi, ou alors des femmes passées en couches, des âmes mortes subitement, sans avoir eu le temps de se confesser pour recevoir l’absolution.
- Mais, dites-nous, mon Père, l’Eglise croit toujours au Purgatoire ? interrogea le président du jury littéraire, un homme d’un certain âge, portant sur ses traits Dieu sait quelle marque de fraîcheur, quelle petite flamme de jeunesse qui pétillait dans ses yeux profonds, illuminant tout son être quand il se livrait dans un sourire.
- Si elle n’y croit pas, d’autres le font pour elle. Avez-vous lu Le XIXème siècle à travers les âges ? Un titre étrange de Philippe Muray. Pour répondre à votre question, il existe un sanctuaire non loin d’ici, dans le Perche, la basilique ND de Montligeon, consacrée à Notre Dame Libératrice des âmes du Purgatoire. Un lieu de pèlerinage, entièrement dédié à la prière pour les défunts.
- Et que dit le livre de Philippe Muray ?
- Il développe une thèse, plutôt curieuse et surprenante pour les incrédules, mais qui ne peut guère étonner un catholique. A travers une étude bien fouillée, documentée, appuyée sur de très nombreuses références, il démontre, preuves à l’appui, que les divers mouvements du XIXème siècle, qui ont mis la société en ébullition, sont tous joints entre eux par un jeu caché de réseaux souterrains.
- Soyez plus précis !
- Janus de la modernité, occultisme et socialisme sont les deux faces d’une seule médaille.
- Quoi ? Que voulez-vous dire ?
- Que le socialisme est pris ici dans un sens très général, incluant les nombreuses doctrines du Progrès qui en découlent. En clair, ce qu’on aime appeler progressisme a été enfanté par l’occultisme. Le Progrès est l’enfant des ténèbres. Ce n’est pas moi qui le dis, mais Philippe Muray, se sentit obligé d’ajouter le père Brun, regard nimbé, comme celui de Carry Grant, dans Arsenic et vieilles dentelles, lorsque ses adorables tantes Adèle et Martha lui avouent, le plus ingénument du monde, qu’elles ont la spécialité de faire disparaître de vieux messieurs seuls au monde, en vue de leur rendre service.
- Mais l’occultisme n’est qu’un jeu, une blague pour amuser les benêts, une plaisanterie digne de Fantômas !
- Non, l’occultisme est la manifestation du pouvoir des forces occultes, répondit le moine avec un air grave. Relisez Là-bas, de Huysmans, pour comprendre que les forces occultes sont celles des esprits démoniaques !
Brusquement, on entendit un coup bref, suivi d’un autre coup, au-dessus du plafond. Tout le monde leva les yeux pour ne rien voir.
- Il est là ! cria le vieil académicien dont le dentier, sous l’effet d’une excitation assez mal contenue, faillit tomber dans l’assiette.
- Ecoutez ! cria sans retenue la grosse historienne sur un ton angoissé.
Un autre coup sourd fut frappé. Cette fois, c’était l’écho d’un choc entre deux pièces de bois qui résonna contre les murs de la pièce.
- Mais ça fout la trouille ! souffla la jeune archéologue, aux cheveux d’automne, qui se cassa un ongle en étranglant sa serviette.
- Allons, allons, s’écria le Dr Papillon, sur un ton encore moins assuré, je vous assure que c’est impossible !
- Malheur à qui trouble la paix des morts ! murmura la comtesse.
- C’est lui ! bredouilla le président du Jury qui ouvrait sa bouche à la cantonade.
- Qui ça, lui ? interrogea le moine.
Alors, le chœur des invités, serré comme des naufragés dans une barque de fortune, abandonnée à la fureur des flots, à la colère du destin, battue par la rage des vents, mordue par la férocité des pluies, les cœurs transis, les visages apeurés, les yeux blafards, répondit dans une seule voix, fiévreuse, caverneuse, et sépulcrale :
- Le fantôme de Combourg !
Chapitre 2
Le château hanté
Sous le portrait de Briant 1er, assis dans le grand salon, le franciscain discutait allégrement de légendes, avec les deux chercheuses universitaires :
- La mythique forêt de Brocéliande, du roi Arthur, de la Fée Viviane, et de Merlin - l’autre Enchanteur - avait exprimé la plus grosse des deux, appuyant sur le dernier mot d’un petit sourire complice, désigne aujourd’hui la forêt de Paimpont.
- Oui mais la forêt médiévale n’a plus rien à voir avec aujourd’hui, embraya l’archéologue sans ménagement. Par exemple, la Forêt du Gâvre, appartenant jadis aux Comtes de Nantes, était un rameau de Brocéliande, où venait chasser le Duc Conan 1er.
- Ce qui veut suggérer que Brocéliande était beaucoup plus vaste, souligna le moine.
- Exact, voulut enchaîner l’historienne, qui se fit pourtant damer le pion par sa collègue.
- On pense que le cœur de Brocéliande se situait dans une zone formant un triangle entre Saint-Malo, Rennes et le Mont-Saint-Michel. Dans ce trigone, on peut tracer un espace circulaire de 40 kms de diamètre environ dont le centre est…
- Combourg ! lança la grosse dame, avec le ton d’un enfant qui veut montrer qu’il connaît les réponses d’un jeu.
- Nous serions donc en plein centre du cycle arthurien ? Fichtre ! Voilà quand même le château de Combourg installé dans une filiation magique, ajouta le père Brun qui se plaisait à la conversation.
Après l’incident du dîner, on était passé au grand salon, et chacun des invités se tenait assis ou debout pour dialoguer, avec une coupe de champagne à la main. Il flottait dans l’air un sentiment de soulagement. On avait retrouvé le calme, sous la fresque de Briant 1er, le premier de la dynastie, qui avait fondé sur les marches de Bretagne, un château et une ville qui portait toujours son nom : Châteaubriant. Un nom digne, allié aux plus grandes familles de Bretagne, du Maine, d’Anjou et du Poitou. Un nom qui avait brillé pour la gloire des armes de France et que François-René avait porté au plus haut sommet des Lettres françaises.
- Regardez ces armoiries, lança d’un coup l’historienne, en désignant un morceau de la fresque.
Le père Brun examina un écu penché sur le côté gauche et surmonté d’un heaume, coiffé d’une couronne comtale. Le blason était strié de trois bandes vermeilles.
- Ce sont les armes des Coëtquen, qui ont possédé le château avant les Chateaubriand. On les décrit de la manière suivante : bandé d’argent et de gueules.
- Vous ignorez sans doute un détail, tenta de préciser l’archéologue qui, cette fois, se fit coiffer au poteau par sa collègue.
- Que ces armoiries sont identiques à celle de Lancelot du Lac. Oui, le fameux héros des Légendes arthuriennes. On les décrit ainsi : d’argent à trois bandes de gueules.
- Vous voulez dire ?
- Lancelot est un des rares chevaliers de la Table Ronde à être né en Brocéliande. Pourquoi les Coëtquen et Lancelot portent les mêmes armoiries ?
- C’est étrange, en effet.
- Plus étrange encore, avait repris la jeune archéologue, bien décidée à reprendre la main, c’est la présence du Lac en bas.
- Oui, coupa vite la grosse dame, qui ne souhaitait pas céder sa place. Ecoutez l’histoire du seigneur Rivallon, baron de Combourg, frère de l’évêque de Dol ! Un jour il se promène sur les rives de l’étang qui débordait, et il aperçoit, tout près de la fontaine de Margatte, un nain retenu par sa barbe blanche, dans un buisson de ronces. Une fois délivré, le petit homme, qui ne mesurait pas plus de quelques dizaines de centimètres, lui explique qu’il a été pris au piège du fourré, parce qu’il a voulu dérober une pierre blanche magique aux vertus merveilleuses. Selon lui, il suffisait de la jeter dans la source de Margatte pour empêcher sa fontaine de déborder. En suite de quoi, Rivallon s’était souvenu de la rencontre, à quelque temps de là, d’une femme âgée qui lui avait refusé le passage. Sa patience s’était échauffée jusqu’à l’injurier. « Puisqu’il en est ainsi, avait braillée la vieille femme, les eaux de Margatte vont couler jusqu’à ce que le village et ton château soient engloutis sous elles ». A peine eût-elle achevé ces mots, que les eaux de Margatte se mirent à sourdre sans s’arrêter, pour commencer à inonder toute la vallée. Se souvenant alors du nain barbichu, Rivallon galopa vers le buisson de ronces où il l’avait délivré, chercha la pierre blanche et se précipita pour la jeter dans la fontaine. L’inondation cessa immédiatement, et le débit se fit menu. De cette inondation, il ne reste aujourd’hui que le Lac tranquille qu’on aperçoit en bas.
La forte dame avait brusquement repris son souffle. Elle semblait narrer les choses sans respirer, comme un enfant qui veut à tout prix raconter une histoire, et qui s’emmêle dans le rythme vif de ses inspirations. La douce peau tendue de son visage empourpré se colora d’un joli rose, tirant entre la bisque et la dragée, signifiant que ses poumons avaient libéré le dioxyde de carbone qui polluait son système sanguin pour y ajouter de l’oxygène tout frais.
- C’est le Lac tranquille, celui de Viviane, la célèbre fée qui sauva Lancelot des flammes du château de ses parents, pour l’élever au bord du lac, au sein de la forêt de Bréchéliant, avait complété l’archéologue, non sans une petite pointe de perfidie à l’encontre de sa collègue.
- Vous voulez-dire, s’exclama le père, que nous sommes ici dans le château de Lancelot ?
Les deux femmes se mirent à sourire, sur un air entendu. Une complicité fictive semblait les unir, une connivence qui les poussait à chercher la renommée au détriment l’une de l’autre, à lutter comme chevaliers dans un tournoi, jusqu’à faire pâlir l’étoile de leur comparse, bataillant pour être le seul et unique objet d’admiration, de désir de tous les autres et, plus que tout, de leur adversaire, illustrant à merveille ces mots de Chrétien de Troyes sur le combat d’Yvain et de Gauvain : « Et bien que Haine ne puisse dire pourquoi l’un devrait haïr l’autre, elle veut les brouiller à tort, pour que chacun haïsse l’autre ».
Le père Brun murmura, la tête encombrée d’admiration pour les légendes arthuriennes :
- Au cœur de Brocéliande ! Quelle joie ! Mais, dites-moi mesdames, d’où vient le nom de cette forêt mythique ?
Pour toute réponse, l’historienne se plongea dans le récit des temps immémoriaux, sur un ton docte et très sérieux, sans même esquisser un seul sourire :
- L’écrivain normand Wace est le premier à évoquer une forêt de Bréchéliant, dans son Roman de Rou, vers 1160-1170, ainsi qu’une fontaine aux caractères merveilleux, qu’il situe à Barenton, au cœur de Paimpont. Mais rien n’interdit de penser que d’autres fontaines merveilleuses se trouvent disséminées sur tout le territoire de Bréchéliant, comme ici, auprès du Lac tranquille, à la fontaine de Margatte.
- Que signifie Bréchéliant ?
- On butte un peu sur l’étymologie, reprit au vol la jeune archéologue, qui avait retiré ses lunettes en losange verts, pour nettoyer les deux verres d’un petit geste énergique. A ce jour, l’origine reste incertaine, entre forme celtique Brec’h (colline) ou bre (motte castrale), mots suivis d’un nom propre, ou bré (la fauche). D’autres encore affirment que le mot indique un point bas marécageux. Par ailleurs, dans la langue des trouvères, le terme Bresilianda pouvait désigner la Bretagne armoricaine dans son entier. Certains traduisent par la Butte à l’anguille, qui a le mérite d’intégrer au nom de la forêt les fables concernant les fées des eaux vives.
- On revient toujours à Viviane, glosa le père Brun, passionné par l’érudition des deux femmes, en dépit du tournoi invisible qu’elles se livraient sous ses yeux.
- Ce qu’on possède de manière certaine, poursuivit la plus imposante des deux, qui cherchait tant bien que mal à placer sa puissance physique au service de son exposé, c’est le nom du premier écrivain des Romans de la Table Ronde : Geoffroy de Monmouth. Il est issu d’une famille d’Armor, originaire de Dol de Bretagne, et s’inspira pour ses fameux récits, de lieux et de familles ayant réellement existé.
- Ce qui pourrait expliquer le blason de Lancelot et celui des Coëtquen.
- Très juste ! ajouta la plus jeune, en se tournant vers sa collègue si puissante, pour la prévenir qu’elle allait lui décocher une pique. Il n’est pas stupide d’affirmer que Combourg est le château où Lancelot a passé son enfance. Tout vient conforter cette idée, les noms des familles nobles du coin. Mes dernières enquêtes ont réussi à établir un rapprochement toponymique et géographique frappant avec les textes légendaires.
- Oui, l’Histoire le justifie aussi, voulut rétorquer la deuxième. Par exemple, une miniature du XVème siècle montre Lancelot chevauchant en deçà des tours d’un grand château qui ressemble trait pour trait à celui de Combourg.
- Tout ça est passionnant ! s’enflammait le moine en admirant la fresque de Briant 1er habillé en chevalier. Ses yeux glissèrent vers les armoiries de Lancelot.
- Et cette famille de Coëtquen, qui a possédé le château, qui est- elle ?
- C’est une grande famille. Elle a pourtant essuyé bien des malheurs. L’un d’eux a failli tuer le duc de Saint-Simon, alors qu’il badinait avec son fusil, croyant l’arme déchargée. Par chance, les balles passèrent au-dessus de sa cible. Le duc de Saint-Simon s’était lié de façon intime au comte de Coëtquen, qui « savait infiniment et agréablement, qui avait beaucoup d’esprit et de douceur ». Mais raconte-t-il, dans ses Mémoires, le pauvre garçon, après sa bévue, ne vécut pas très longtemps. Il s’était fait dire sa bonne aventure par une femme, la du Perchoir, lui ayant annoncé qu’il serait noyé bientôt. Il fut morigéné par le duc à cause de cette curiosité si dangereuse et si folle. Et quelques jours après, marchant avec son régiment jusqu’à l’armée, il voulut faire boire son cheval dans l’Escaut et s’y noya, en présence de tout le régiment, sans avoir pu y être secouru.
- Ah le malheureux !
- Coëtquen est issu de Coat Gwenn, qui signifie Bois Blanc, en breton, précisa la jeune archéologue, après avoir chaussé de nouveau ses instruments d’optique, en vue de jeter un regard plus vert que ses losanges à sa partenaire. C’est la forêt qui a donné son nom à la famille.
- Une famille qui possède son nom d’une forêt, sans aucun doute, on se situe sur une terre arthurienne !
- Raoul de Coëtquen, premier du nom, est mentionné en 1130.
- Un contemporain de Briant 1er ! s’écria le père, faisant lever les yeux de tous vers le portrait du chevalier.
- Mais que regardez-vous là ? demanda le Dr Papillon, nez en l’air, qui s’était approché des trois autres.
- On parlait des Coëtquen, lui répondit le père avec gentillesse.
- Ah ah ! encore attiré par les fantômes ?
- Mais non, pourquoi ?
Tout le monde regarda le père Brun avec un air étonné.
- Ah bon, mais vous ne savez pas ? se piqua la grosse historienne, dont les joues, prestement, s’étaient arrondies sous l’effet d’un sourire rose de satisfaction.
- Mais savoir quoi ?
- Le fantôme de Combourg, souffla à son tour la jeune archéologue, qui ne souriait pas.
- Eh bien ?
- Il s’appelle Malo de Coëtquen ! conclut en étouffant dans sa gorge, un écho de petits rires patelins, d’une façon aussi embarrassante que déplacée, le Dr Papillon qui présentait, sur son gros visage mielleux en peau de chamois, tous les signes indésirables du contentement de soi.
Chapitre 3
Le chat noir
- « Les gens étaient persuadés qu’un certain comte de Combourg, à jambe de bois, mort depuis trois siècles, dit Chateaubriand dans les Mémoires d’Outre-tombe,