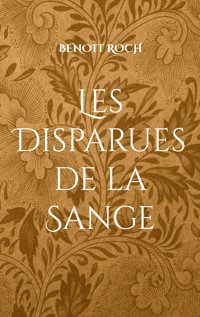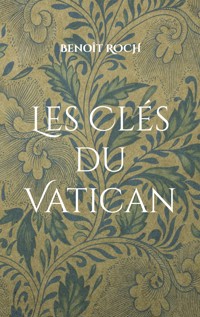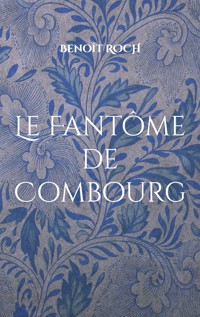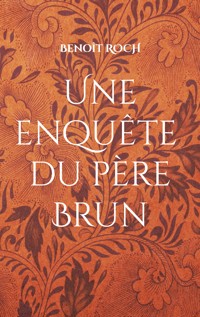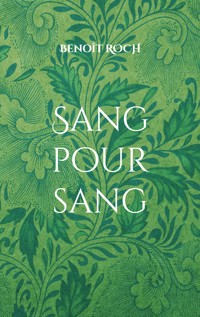
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Serie: Les enquêtes du Père Brun
- Sprache: Französisch
Une nouvelle enquête avec le moine détective, entouré de ses amis. Une inquiétante histoire de disparitions au Pays d'Auge, où Baudelaire sera transformé, lui aussi, en enquêteur. On rit, on pleure, on aime, on vit, on prie et on cherche le coupable !
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pour Valérie S,
qui restera à jamais
la première lectrice du Père Brun.
- Le sang, tout le monde le verse, poursuivitil avec une véhémence croissante. Ce sang il a toujours coulé à flots sur la terre. Les gens qui le répandent comme du champagne montent au Capitole, et sont ensuite traités de bienfaiteurs de l’humanité.
Fédor Dostoïevski
(Crime et châtiment)
Sommaire
Chapitre 1
L’Académie des Durtaliens
Chapitre 2
L’enlèvement
Chapitre 3
La disparition
Chapitre 4
La baie du Mont-Saint-Michel
Chapitre 5
L’inspecteur Baudelaire
Chapitre 6
Un dîner chez le maire
Chapitre 7
Sherlock et le bénédictin
Chapitre 8
Une histoire de cannibalisme
Chapitre 9
Montjoie Saint Denis
Chapitre 10
Le port d’Honfleur
Chapitre 11
L’alchimiste
Chapitre 12
L’eutrapélie
Chapitre 13
Le Festival de Donville
Chapitre 14
La science parle avec les plantes
Chapitre 15
Les Clés du Royaume
Chapitre 16
Le trilemme de Lewis
Chapitre 17
Sur la route
Chapitre 18
Le déjeuner des Durtaliens
Chapitre 19
La philosophie du tube digestif
Chapitre 20
Le transhumanisme
Chapitre 21
Le Detection club
Chapitre 22
L’homme aux oreilles en chou-fleur
Chapitre 23
Le martyr
Chapitre 24
Solve et coagula
Chapitre 1
L’Académie des Durtaliens
- A bon entendeur, le Salut !
Un immense soleil des temps bibliques inondait le jardin du presbytère, tandis que s’élevait, parmi la douce lumière de ce bel été normand, un joyeux tapage de voix, tout aussi volubile que les notes flavescentes d’un chant d’oiseaux multicolores sous la plume enjouée de Clément Janequin.
- Au sein du cosmos, affirmait-elle avec une intuition géniale, bien longtemps avant la théorie de l’effet papillon, toutes choses sont interdépendantes, de telle sorte que le plus petit de nos gestes et faits génère des répercussions jusqu’aux frontières mêmes de l’univers.
- Quelle femme !
- Elle a développé de nombreux talents.
- Une grande figure du Moyen-âge.
- Elle pratiquait à la fois la médecine, la mystique, la poésie, la composition musicale, l’illustration.
- C’était aussi une prédicatrice reconnue !
- En effet. Mais sa première mission était d’honorer son rôle d’abbesse.
- Et que dire de ses visions ?
- Exceptionnelles ! La plus célèbre, celle de l’homme miroir du monde, est vraiment fabuleuse. Son corps est le reflet de l’univers, ils partagent une organisation commune.
- Dans un manuscrit, conservé à Lucques, il est possible d’admirer une miniature, laquelle dessine un homme aux bras étendus dans un cercle, au sein duquel son corps accueille toutes les influences cosmiques.
- Exact ! On raconte même que ce dessin a servi de modèle à Léonard de Vinci pour son Homme de Vitruve.
Les voix ensorcelaient les frondaisons du jardin, baigné par cette splendide lumière d’été, blonde, innocente, de pleine maturité, qui n’appartient qu’aux beaux mois d’été en terre normande. La petite Académie des Durtaliens s’était réunie pour la joie simple, délicieuse, de jaspiner à l’ombre de la collégiale.
- De qui parlez-vous ? demanda une petite fille qui s’appelait Lisa, tandis qu’elle s’amusait à ébrouer le seuil d’un trou de fourmis avec une baguette de noisetier.
Sa mère, qui ressemblait à s’y méprendre au jeune lieutenant Amanda Lemercier, lui articula, dans un grand sourire, que ses amis évoquaient avec elle une figure de femme exceptionnelle, ayant vécu mille ans auparavant, qui s’appelait Hildegarde de Bingen.
- Hildegarde ! Hildegarde ! Hildegarde ! s’était alors amusé à chantonner la petite fille en chatouillant le nuage de fourmis avec sa baguette.
Cette poignée d’âmes, heureuse poignée d’âmes, cette bande de frères et sœurs ressemblait, du moins dans son esprit, à cette autre poignée qui avait porté le fer au jour de la Saint Crépin, lors de la très funeste bataille d’Azincourt, sous la bannière d’Henri V, aux trois lions léopardés rampant sur les trois lys. Outre Amanda, sa petite Lisa, un œil familier pouvait remettre la jeune organiste de la Collégiale, Melle Martin que notre Gargarin, bibliolâtre de son état, surveillait depuis le coin ardent de sa prunelle ursine. On reconnaissait aussi le père Marsac, dominicain, installé dans une chaise longue afin de ne pas perdre une goutte de soleil, ainsi que le maître des lieux, le curé de Donville-sur-mer, notre ami le père Brun, occupé à servir le café.
Un dialogue venait de s’engager entre Amanda et le dominicain, sur les théories médicales de Sainte Hildegarde. La jeune femme assaillait le moine avec joie et curiosité :
- Oui, la doctrine des humeurs, du latin humor qui signifie : liquide.
- Humeur veut dire liquide ?
- A l’origine, oui. Être de bonne humeur voulait dire que la circulation de nos liquides se trouvait excellente.
- Nos liquides ?
- Selon Galien, dont les vues médicales s’appuyaient sur les écrits d’Hippocrate, notre corps se trouve irrigué par quatre liquides, c’est-à-dire quatre humeurs.
- Le sang ?
- Oui. La doctrine des humeurs a perduré pendant des siècles jusqu’à la découverte du système de circulation du sang par Harvey en 1628.
- On ne connaissait pas la circulation du sang avant le XVIIème siècle ?
- La première difficulté est de définir la vision antique et médiévale du sang.
- Ce n’était pas le même sang que dans nos corps ?
- Ah si, bien sûr, mais la polysémie du mot peut nous égarer. Dans la doctrine galénique le sang désigne la masse sanguine, à l’intérieur de laquelle sont amalgamées les quatre humeurs, mais, parfois, le mot peut désigner l’une des quatre humeurs.
- Et quels sont les trois autres liquides ?
- La bile jaune, le flegme et la bile noire.
- D’accord. Alors, si je comprends bien, le sang était soit un mélange des quatre liquides, soit l’un des quatre.
- Exactement !
- Et que pensait Sainte Hildegarde ?
- Dans Les Causes et les Remèdes, elle développe avec brio la théorie des humeurs, en nous exposant que le sang est associé à l’air (chaud et humide), le phlegme à l’eau (froide et humide), la bile jaune au feu (chaud et sec) et la bile noire à la terre (froide et sèche).
- L’air, l’eau, le feu, la terre ? Mais bon sang, ce sont les quatre éléments !
- Bravo !
- C’est incroyable. Et d’où ça vient ?
- C’est très ancien.
- Chez les Grecs ?
- Peut-être avant. Mais le texte fondateur apparaît avec Empédocle : Connais premièrement la quadruple racine !
- Sait-on comment les quatre éléments peuvent agir sur notre corps ?
- On considérait que les quatre humeurs en équilibre formaient le propre d’un tempérament équilibré. Selon Sainte Hildegarde, seuls Adam et Eve (avant la chute) avaient possédé cette harmonie du corps (avec le Christ, et la Vierge, bien sûr). Le péché a provoqué une rupture fatale dans cette heureuse ordonnance (ensuite réparée par la grâce) pour nous répartir en quatre tempéraments déséquilibrés simples, lorsque l’une des humeurs vient à l’emporter très nettement sur les trois autres : sanguin, flegmatique, bilieux ou mélancolique.
- Bilieux ?
- Colérique.
- Pour les déséquilibrés simples. Et pour les autres ?
- Tempéraments déséquilibrés composés, ce qui revient à dire que deux des quatre humeurs prédominent.
- Passionnant ! Cette théorie des humeurs et des tempéraments a disparu dans les temps modernes ?
- En partie seulement. Molière s’en régale encore dans Le Misanthrope. Toute la pièce est portée par cette doctrine des humeurs. Alceste est un atrabilaire, noir comme la mélancolie, Philinte est flegmatique, bleu comme l’eau qui coule, Arsinoé bilieuse, de jaune vêtue, les petits marquis sanguins, rouges et prêts à en découdre pour conquérir Célimène.
- C’est fou ! On ne m’a jamais appris ça à l’école.
A ce moment très précis, la petite voix de Lisa fendit l’air, provoquant un éclat de rire général :
- On n’apprend rien à l’école.
Gargarin, ne lésinant jamais pour une occasion de sourire, vint à relever le trait :
- Cette petite fait preuve d’un humour célinien.
Amanda reprit sa remarque au vol :
- Humour ? Mais ça ressemble à humeur. Est-ce que l’humour est aussi un liquide ?
Le moine en habit blanc, dont les tempes inondées de soleil commençaient à ruisseler, répondit :
- Ah, vous ne croyez pas si bien dire, parce que le mot est emprunté au français, en raison de notre théorie.
- Quoi ? C’est donc vrai ? L’humour vient de la théorie des humeurs ?
- Le mot, oui. Vers le milieu du XVIIIème siècle, les Anglais utilisent et déforment le mot français pour exprimer le sens d’une certaine vitalité, un talent aigu de la transmission rapide des idées, à la façon des humeurs du corps dont la bonne circulation lubrifie la vie.
- La nuit a beau fermer tous les yeux, dit Oswald Spengler, le sang ne dort pas, avait exhalé Gargarin, les yeux mi-clos.
- C’est fou de penser qu’il existe un lien entre sang et humour, souffla d’une seule haleine Amanda, qui semblait soudain happée par le tourbillon de ses pensées.
- Sûrement à cause de la devise des infirmières, blézimarda Gargarin avec une mine de luron préparant une vanne, dans l’espoir visible de mugueter la jeune organiste.
- Et que dit-elle, cette devise ?
- « Je panse, donc j’essuie ».
Il y eut un bref moment de silence, puis la petite assemblée s’esclaffa de bon aloi. On riait, on buvait du café, on prenait le bon soleil d’été, sans se soucier un instant des tracas de la vie. La règle suprême, au sein de cette Académie clandestine, qui imposait d’abandonner ses ennuis à la porte, et de réjouir les esprits par des conversations à la fois joyeuses et savantes, mais jamais pédantes. Ici, pas de compétition, simplement du partage et de l’amitié. On laissait à l’extérieur : jalousie, concurrence, et rivalité. Chacun venait pour adoniser ses connaissances, dans un jeu d’intelligence fraternelle, par l’échange de vues et le bonheur d’être ensemble.
Se tournant vers le père Brun, qui n’avait rien dit jusqu’ici, Amanda lui lança :
- Mais, dites-moi mon père, il n’y a pas de lien entre le sang et l’humour dans la religion ?
Le moine qui sirotait tranquillement son café se mit à sourire, et rétorqua :
- Tout dépend de quel humour il s’agit. Si vous parlez de l’humour du Dieu, je crains que son sens ne nous échappe.
- L’humour de Dieu ? Fichtre !
- Vous ne trouvez pas ça comique, vous, d’avoir créé une créature que se prend pour son Créateur ?
- C’est un point de vue, rétorqua la jeune femme en souriant. Mais je voulais dire que la place du sang est centrale dans votre religion.
- Vous avez raison. Comment ne pas penser au sang du Christ, qui a été versé pour nos péchés ?
- Je dois vous avouer que ce rapport avec le sang m’a toujours intriguée, à la fois effrayée et fascinée.
- C’est un mystère, impossible à comprendre sans l’aide de la grâce. Ruysbroeck nous dit que, par le sang de Notre-Seigneur, l’homme se lie à Dieu et Dieu avec lui. « Et il devient lui-même l’arche et le tabernacle, où Dieu veut habiter ».
Si le père Brun avait eu le temps, il aurait expliqué les théories de René Girard pour témoigner que le mythe du sang est présent depuis les origines dans toutes les religions. « Le sang, c’est la vie » écrivait Bram Stoker dans son célèbre Dracula. Au fil des siècles, ce besoin vital de sang a trouvé des échos imaginaires, pour devenir le breuvage d’une autre vie. Promesse de renaissance, élixir de jouvence, or des dieux, ombre des vampires, lumière du Graal, le mythe du sang s’est répandu comme un fluide sacré. Même La Marseillaise chante la légende du sang impur. Concernant la mythologie des fraternités d’armes, des bands of brothers (comme celle de la Saint Crépin autour d’Henri V) elle repose sur la culture du sang versé. L’Antiquité possédait ses striges, des démons qui suçaient le sang des enfants. Pour sa part, le Moyen-âge se trouvait peuplé de revenants qui affaiblissait le sang, et qu’il fallait à tout prix éliminer en les fixant d’un pieu à leur cercueil. Depuis toujours on a cru aux vampires, c’est une adhésion vraiment solide, attestée par de nombreux auteurs, et même par Jean-Jacques Rousseau : « S’il y eut jamais au monde une histoire garantie et prouvée, c’est celle des vampires ». Bien que la papauté ait condamné cette croyance, la littérature n’a jamais cessé de décrire ces êtres de la nuit, pour s’emparer du vampirisme avec ferveur, que ce soit par La Morte amoureuse de Théophile Gautier, Le Horla de Maupassant, ou le poème de Baudelaire Le Vampire.
Dans de nombreuses civilisations, sang et âme demeurent confondus. Dans le Lévitique, il est écrit en toute lettre « Le sang, c’est l’âme ». Pour les Romains, le sang était le siège de l’âme. Seule la civilisation chinoise a conservé une idée de deux âmes distinctes, à savoir une âme-souffle et une âme-sang. Qu’il soit en relation avec l’âme ou le souffle, le sang délimite la frontière entre les vivants et les morts. Il demeure le premier moyen de cheminer vers le divin. « Les sanctuaires des dieux ruissellent de sang », nous dit Euripide, ce que Baudelaire ne manque pas de chanter dans les Fleurs du Mal, non sans une jolie pointe d’humour noir : « Les sanglots des martyrs et des suppliciés ont une symphonie enivrante sans doute puisque, malgré le sang que leur volupté coûte, les cieux ne s’en sont point encore rassasiés ! » Les sacrifices avaient pour but de convoquer les dieux parmi les hommes. Les dieux ont soif ! Avec le temps, les sacrifices et les mutilations ont laissé place aux symboles, qui furent utilisés en signe de commémoration, et chaque fois que nous cueillons des fleurs rouges ou que nous buvons du vin, nous célébrons, inconsciemment, la mémoire ancestrale des sacrifices humains.
Le sang sur la neige que contemple Perceval est celui d’un souvenir. Pas vraiment une extase, mais un rêve éveillé. C’est avant tout l’éveil des sens, l’image poétique de ce qu’on ne sait pas nommer, la métaphore de ce qui nous anime et qui nous attend, l’aventure du sang est celle de l’amour et de la vie. Le mythe du Graal est une soif de l’âme. Il raconte ce que le cœur humain a de plus merveilleux et de plus secret. Le Graal annonce une éternité resplendissante. Il vient offrir l’illumination humaine. Le sang était la mort. Il est devenu la vie et a donné l’amour. Il devient désormais impératif de trouver la coupe du Sang du Christ. « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme, et ne buvez son sang, vous n’avez point la vie en vous-mêmes ». Sa quête est quête d’éternité, désir d’une vie nouvelle, qui doit étouffer tous les autres désirs. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour ».
- J’ai eu la grâce de suivre la procession du Saint-Sang, faisant revivre le retour de Thierry d’Alsace, depuis la deuxième croisade en 1150, déclara soudain le père Marsac.
- La procession du Saint-Sang ? Qu’est-ce que c’est ?
- Une grande procession religieuse qui date du Moyen-âge. Elle a lieu chaque année le jour de l’Ascension à Bruges.
- En Belgique ?
- Oui, dans la Venise du Nord.
- Et pourquoi du Saint-Sang ?
- Parce que la pièce maîtresse en est un reliquaire qui contient des gouttes de sang coagulé du Christ, imbibant un morceau de terre rapporté de Jérusalem par Thierry d’Alsace.
- Mille ans après la mort du Christ ?
- Oui, ces reliques furent recueillies par Saint Longin, selon la tradition.
- Saint Longin ? Mais qui le connaît ?
- La tradition chrétienne, indiqua en souriant le père Brun. Dans la Basilique Saint-Pierre de Rome, on lui a dressé une immense statue. Un soldat gaulois des Légions romaines. C’est lui qui a percé de sa lance le côté droit du Christ pour s’assurer de sa mort sur la croix. Son nom n’apparaît pas dans les Évangiles, il est attesté par des écrits ultérieurs de la tradition chrétienne.
- Première fois que j’entends parler de lui !
- Selon la tradition, ce soldat s’est converti et il est mort martyr à Césarée de Cappadoce.
- Dans L'Œuvre au noir, ajouta Gargarin, avec un petit temps de retard, dans le but évident d’éclairer les yeux de Melle Martin, Marguerite Yourcenar donne une description de cette procession, au début de la Renaissance.
- Cette procession doit être magnifique, s’enthousiasma la jeune policière.
- Dame, oui !
- Dame ? Pourquoi, il a dit Dame ?
- C’est une façon de dire, Lisa. Mais j’avoue que je ne sais pas pourquoi on dit ça. Mon grand-père le disait souvent.
- Dame, oui ! C’est une interjection lancée pour donner plus de poids, parfois aussi à une négation : dame non !
- C’est curieux de dire Dame. Si Filembourg était là elle nous dirait que c’est une expression sexiste ! marmotta le père Brun entre ses dents, grimaçant avec ironie.
- C’est mieux que dire putain à tout bout de phrase ! se crut autorisé à commenter Gargarin.
- Dame, oui ! répliqua le dominicain. Vous voyez, c’est un bel exemple des évolutions dans notre époque. Dame nous vient tout droit du Moyen-âge. Forme abrégée de Notre-Dame, c’était une invocation à la Vierge Marie qu’on prenait à témoin pour attester de la vérité de ses propos.
Le grand ciel charriait ses petits nuages blancs qui gambadaient comme des moutons chassés par le vent du large. Sous le dais céruléen du cosmos, nos bons amis goûtaient la joie simple d’être vivants, de savourer le festin de l’amitié, pour cueillir cette béatitude rare, lorsque corps et âmes sont en union, comme un lointain reflet de l’harmonie des origines, lorsque le premier des hommes, mélange de glaise et de souffle divin, possédait encore un équilibre parfait entre ses humeurs. Tout apparaissait si doux qu’un pressentiment vint à effleurer l’esprit d’Amanda. Il arrive quelquefois, au moment où tout reste suspendu en apesanteur, où le temps s’est effacé pour nous donner un goût d’éternité, qu’un mauvais souffle nous assaille. On devine alors que la vie ne peut pas se poursuivre en l’état. On sait que quelque chose d’affreux va bientôt se produire. Coleridge développe l’idée que, dans les rêves, nous n’éprouvons pas d’horreur parce qu’un sphinx nous oppresse, mais nous voyons en rêve un sphinx dans le but d’expliquer l’horreur que nous éprouvons. La jeune femme ressassait son rêve de la nuit.
Amanda se retrouve dans une chambre quelconque, sans porte, sans sortie, enfermée. Une issue possible apparaît. La jeune femme réussit à escalader un mur, à passer de l’autre côté, pour se retrouver exactement dans la même pièce qu’auparavant. Le phénomène se reproduit trois ou quatre fois, jusqu’au moment où elle se dit, sans se réveiller : « Voilà, c’est le cauchemar du labyrinthe ». Ensuite, elle sait, dans le rêve, qu’elle peut réussir à toucher les murs de la pièce, de droite à gauche. Alors, elle se réveille, sauf qu’elle ne se réveille pas du tout : elle rêve son rêve. C’est-à-dire, elle rêve se réveiller dans un endroit inconnu, phénomène qui se répète à l’infini. Quand elle finit par ouvrir les yeux, elle comprend qu’on ne se réveille jamais que pour continuer à rêver dans la réalité.
- Maman ! cria une voix de petite fille, qui tira chacun hors de son ataraxie.
Lisa s’était coupé le doigt sur la tranche d’une pierre. Elle brandissait sa petite main en cherchant à retenir ses larmes, tandis que les traits de son visage se brouillaient, l’un après l’autre, comme une eau calme en début d’averse. Une petite goutte, joli rubis aux reflets garance, un liquide mat et visqueux perlait au bord de son index.
- C’est quoi Maman ?
- C’est du sang, ma chérie.
La petite fille sursauta, et recula d’un pas, sous l’effet du mot sacré. Contemplant le bout de sa main, pendant un long soupir, le soleil éclairait son visage, tout entier absorbé par le mystère de cette tâche vermillon. Elle se détendit comme une panthère. D’instinct, elle porta son doigt jusqu’à la bouche et, après avoir goûté le mince filet cramoisi, elle s’exclama, les yeux brillants :
- Humm, c’est bon !
Chapitre 2
L’enlèvement
Amanda s’était heurtée, aussi fort que le battant d’une cloche, à l’inconnu sur le point de sortir. A peine la porte eut-elle grincé que la jeune policière s’était engouffrée, tête baissée, pied en avant, dans la librairie. Cependant, un grand gaillard, mine sévère, cheveux frisés, lunettes carrées, se trouvait au même moment, au même endroit, en sens inverse. Il s’excusa le premier, d’un ton sec, fila sans demander son reste, tandis qu’Amanda tenait la porte en main, comme l’amiral de Villeneuve son gouvernail, après la bataille de Trafalgar.
- Homme, n’as-tu jamais goûté de ton sang, quand par hasard tu t’es coupé le doigt ? Comme il est bon n’est-ce pas ?
- Qu’est-ce que vous dites ? interrogea la jeune femme qui ne comprenait rien aux propos de Gargarin.
- Les chants de Maldoror, Lautréamont.
- Ah d’accord.
- Je pensais à Lisa, et à son petit doigt.
- Ah, je n’y étais pas du tout !
- Comment va-t-elle ?
- Oh, bien, merci ! Ce n’était qu’une toute petite égratignure.
Réalisant qu’elle tenait toujours la porte en sa main, Amanda lâcha le lourd vantail qui vint claquer comme la mâchoire d’un loup, dans le grand poème d’Isidore Ducasse.
- Alors, vous avez fait connaissance avec le Pr Phisbène !
- Pardon ?
- L’homme qui vous a bousculé.
- Ah, fit Amanda, qui décidément avait bien du mal à suivre les idées de Gargarin.
- C’est le directeur de la clinique.
- Quelle clinique ?
- Bah, vous savez, la nouvelle clinique, là-bas, sur les hauteurs.
- Ah oui, je vois.
- Institut Clinique Hospitalier Organique Régional.
- Je ne connaissais pas le nom en entier.
- ICHOR
- Et que font-ils ?
- Si j’ai bien compris, une méthode révolutionnaire pour le traitement des organes lésés. Mais je dois vous avouer que je n’en sais pas plus.
- C’est très spécialisé.
- En tout cas, c’est une clinique pour une clientèle aisée.
- Oh, je vois !
A chaque visite, le bon Gargarin se montrait ravi d’accueillir le lieutenant Lemercier dans sa boutique, non pas que le charme de la jeune femme lui entortillait les sens (car son cœur restait empêtré d’un autre côté) encore que la beauté d’Amanda pouvait parfois le rendre démuni, mais plutôt parce que son être trouvait à se déployer dans son entier par l’exercice de son métier.
Peu de libraires savent donner grâce aux yeux des lecteurs. La plupart vendraient avec la même ardeur : petits pois, dentifrice ou quincaillerie. Ces drôles font profession de marchands, avant même d’être liseurs, encore que certains soient aussi doués pour céder un âne que pour jouer de la mandoline. Les premiers ne connaissent pas un auteur valable, les deuxièmes ne possèdent aucune notion de l’art d’écrire, les troisièmes sont fainéants, les quatrièmes ne lisent rien qui fouette les sangs, les cinquièmes se demandent à quoi bon lire, quant aux derniers, si la liste peut se résumer en si peu de genres, ils n’ont jamais plongé le nez dans un ouvrage qui sache exhaler les arômes de l’esprit.
Gargarin, lui, appartenait à cette espèce rare de libraire qui ne vendait jamais un livre sans l’avoir lu, sans avoir pressé son auteur, ses goûts, ses affinités, sa pensée. Il possédait, par appétit, une solide culture générale, pas moins intellectuelle qu’esthétique, dans un esprit équilibré par les études classiques. Il rangeait les œuvres non pas de façon logique, analytique ou chronologique, mais selon une pensée arborescente, librement inspirée des penseurs médiévaux. Au lieu d’enfermer les livres dans des catégories innombrables, il préférait les répartir, ainsi qu’Humboldt avec les plantes, selon le climat de leurs idées et leur environnement, dans une démarche assez proche de notre conception actuelle des écosystèmes, selon la nouvelle manière des banquiers dessinant des cartes mentales dans les réunions de stratégie.
- Que cherchez-vous aujourd’hui ?
Amanda avait collé ses yeux attentifs sur des rangées de livres. Elle laissait errer son regard sans rechercher quelque chose de précis.
- J’ai bien aimé les derniers livres sur les Vikings.
- Ah j’en suis bien content.
- J’avoue que j’ai appris des tas de choses. Je me suis aperçue qu’on connaît plutôt mal le Moyen-âge.
- « Plutôt mal » est un euphémisme.
- Oui, c’est juste.
- Tenez, vous qui êtes féministe.
- On croirait entendre le père Brun.
- Connaissez-vous Régine Pernoud ?
- Non.
- Une historienne spécialiste de la période médiévale. Après l’École des Chartes, dont elle est sortie avec un diplôme d’archiviste paléographe, elle passe son doctorat à la Sorbonne. Ensuite, elle sera conservatrice de plusieurs musées importants.
- Bravo !
- Tenez, prenez ce livre.
- La femme au temps des cathédrales.
- Oui, un joli titre.
- Ça doit être passionnant. Pour la femme, bien sûr. Le temps des cathédrales, aussi. Une excellente idée de relier les deux !
- Régine Pernoud a réussi à faire changer nos regards sur la période.
- Ah oui ? Et pourquoi ?
- Contrairement aux idées reçues (c’est toute la thèse de cette historienne) les femmes possédaient plus de pouvoir qu’au début des temps modernes.
- Vraiment ?
- Son ouvrage fourmille d’exemples.
- Je vais me régaler. Je prends votre livre.
- Le plus ancien traité d’éducation, affirme-t-elle, est écrit en France par une femme, au XIIIème siècle, à une époque où les filles étaient majeures à douze ans, deux ans avant les garçons.
- Incroyable !
- Ce n’est pas tout. Nombre de femmes exerçaient une activité importante, sachant se débrouiller toutes seules pour l’administration des biens.
- Seulement dans la noblesse ?
- Ah non, dans le commerce aussi ! Et dans plusieurs métiers. La médecine était surtout aux mains des femmes. On trouvait aussi des juges, des dames qui écrivaient, d’autres qui ont animé les cours d’amour, lieux d’inspiration des romans de chevalerie.
- On n’imagine pas.
- Beaucoup de femmes avaient conquis autonomie et libertés avant le déclin. Puis, en 1593, après la Renaissance, au début des temps modernes, un édit du Parlement interdit toute fonction aux femmes dans l’État.
- C’est fou. J’ai hâte de le lire.
- Et ce n’est qu’à partir du XVIIème que la femme a dû prendre obligatoirement le nom de son époux.
- Je l’ignorais.
- D’autres encore, non des moindres, dirigeaient des abbayes prospères. Souvenez-vous de Sainte Hildegarde ! Une autre femme célèbre, Pétronille de Chemillé, a fondé l’ordre de Fontevraud, avec Robert d’Arbrissel ; un ordre où les moines et les moniales étaient tous placés sous l’autorité de l’abbesse.
Amanda examina le livre avec lente attention, sans dissimuler une moue circonspecte, signifiant que ses idées se trouvaient partagées entre la componction et l’admiration.
- C’est un peu sérieux, tout ça, non ?
- Vous avez raison.
- Notre époque est assez sinistre pour ne pas lire que des livres sérieux.
- Un peu de fantaisie ne peut jamais nuire, lança notre libraire, comme s’il récitait la formule d’un exercice de magie. Voyons voir…
Gargarin avait élancé la grande masse de sa silhouette ursine pour s’approcher d’un rayon. Quand il fonçait examiner ses étagères qui regorgeaient de livres, serrés les uns contre les autres, offrant un alignement bigarré, tant par les couleurs que par les titres semés sur les dos de couvertures, on pouvait distinguer un petit nimbe dans ses prunelles. Ses yeux d’orpailleur et son visage étaient pris dans un halo intérieur, car son être était visité par un phénomène d’ordre surnaturel. A cet instant, une caméra thermique aurait détecté, dans sa silhouette, une source de chaleur supérieure à la moyenne d’un corps humain.
- Tenez, dit le libraire, tendant un livre à la policière, je ne vous aurais pas fait naqueter bien longtemps.
- Charles Dickens ?
- Oui.
- Vous m’aviez parlé de fantaisie ?
- Assurément.
- C’est bien lui qui a écrit des romans tristes à pleurer sur la misère, et l’enfance démunie, dans le Londres industriel de l’époque victorienne ?
- C’est lui, assurément, mais on ne peut pas résumer Charles Dickens à Oliver Twist. Il a commencé sa carrière avec un personnage exceptionnel. Un drôle qui l’a rendu célèbre à 26 ans ! On s’arrachait ses aventures.
- Pickwick ? fit Amanda en contemplant la couverture du livre avec une moue dubitative.
- Un ensemble d’histoires publiées en feuilleton, toutes plus hilarantes les unes que les autres. Vous m’en direz des nouvelles.
- Je pensais que Dickens était sinistre.
- Non ! C’est en lisant Pickwick et Don Quichotte que le bon Dostoïevski a eu l’idée de créer le personnage du Prince Mychkine, déplorant que les naïfs, les cœurs purs, les simples d’esprit, dans la littérature, fussent toujours tournés en ridicule. Il voulait donner à son Idiot, des vertus christiques.
- Je ne savais pas.
- François d’Assise aussi se faisait appeler l’Idiot !
A l’évocation du saint d’Assise, Amanda ne put s’empêcher de penser combien il était difficile d’attacher un tel qualificatif au père Brun, sauf peut-être quand il prenait son air de fouine pour plaisanter ou se livrer à des blagues dignes d’un collégien. Elle avait remarqué, depuis leur rencontre, que le moine cultivait une âme d’enfant, malgré un esprit intelligent et scientifique, un cerveau capable de décrypter les secrets les plus obscurs de la physique moléculaire, d’analyser les données artistiques les plus complexes de l’Histoire, ou d’exposer les théories ontologiques les plus ardues. Mais dès qu’il s’agissait de rire, de chahuter, de taquiner, pour semer la joie dans la vie des autres, le grand savant se métamorphosait en enfant de Dieu, créature simplissime, ingénue, candide, innocente de vivre, complètement abandonnée à la Volonté du Père, dans l’instant d’une ivresse angélique et lumineuse.
Qu’est-ce c’est qu’un idiot ? Qu’est-ce qui peut le différencier des autres ? Ne sommes-nous pas tous idiots à notre façon ? En tout cas, à certains moments ? Pour les Grecs et les Latins, le terme signifiait unique ou extraordinaire. Le territoire de l’idiot, s’il en a un, n’est pas celui de la folie ni celui de la bêtise. Il agit plutôt comme une sorte de miroir qui résiste, dont l’opacité le place dans la posture inconfortable d’un être de seuil, d’une âme liminaire, figure d’imaginaire postée comme une vigie sur le limes d’un entre-deux mondes. Avant l’époque moderne, ce mot joyeux désignait quelqu’un d’exagérément optimiste, irréaliste, voire naïf. Dans le fond, un idiot, c’est une âme d’enfant dans un corps d’adulte. C’est Charlot, Bécassine, Bartleby. C’est aussi le merveilleux conte d’Emile Souvestre Perronik l’idiot, paru dans le Foyer Breton, en 1844, qui raconte les aventures d’un de ces pauvres enfants qui ont pour père et mère la charité des chrétiens, en montrant de nombreuses similitudes avec le Conte du Graal, à cette époque bénie où l’innocent était censé attirer la protection divine, pour faire droit aux paroles du Christ : « Je vous le dis en vérité, si vous ne changez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n’entrerez pas aux Royaume des Cieux ».
A peine Amanda eut-elle glissé le nez dans les pages de Pickwick que son téléphone sonna.
- Quoi ? Où ça ? J’arrive !
Son visage était devenu blême.
- Que se passe-t-il ?
- C’est à la Collégiale !
- Quoi, à la Collégiale ?
- Un enlèvement !
- Un enlèvement ?
- Oui, un bébé !
- Un bébé ? Un bébé ? souffla Gargarin qui répétait les mots d’Amanda, comme si son cerveau se retrouvait bloqué à tourner sans fin dans une boucle étrange.
Il tenta d’envisager la situation. Qui pouvait enlever un bébé à la Collégiale ? A qui appartenait ce bébé ? Une série d’images défilait à toute allure, dans un tourbillon de visions mentales : lui-même en bébé, le père Brun en blouse blanche, le maire de Donville en prison, Amanda en treillis de commando, Melle Martin, dans une tenue de bain que la décence nous interdit de décrire. Mais au moment où Gargarin voulut ouvrir la bouche, Amanda avait disparu.
C’était le bébé de Mathilde, la jeune femme qui s’était mariée pendant l’affaire du Manoir du Donville (Une enquête du père Brun). Venue jusqu’à la Collégiale pour se confesser, elle avait confié son enfant à la surveillance de la veuve Leray, une grenouille de bénitier, connue dans tout le village, à la fois pour son dévouement et sa piété, passant le plus clair de son temps à l’église, pour gratter la cire des cierges, pour nettoyer les sols et pour donner un coup de chiffon sur le mobilier. Mais lorsque Mathilde était sortie du confessionnal, elle avait trouvé la veuve assommée derrière un pilier, avec la poussette vide. Choquée, la jeune femme avait hurlé tout l’air de ses poumons, dans un cri que les murs de la Collégiale n’oublieront pas avant mille ans, provoquant l’expulsion du moine depuis l’intérieur de son confessionnal, comme un furieux polichinelle hors de sa boite, regard stupéfié. Vite, il s’était rué dehors, mais n’avait rien vu. Alors, il avait aussitôt appelé Amanda, qui venait de paraître à la Collégiale.
La jeune policière s’essayait à interroger Mme Leray, qui tentait péniblement de recouvrer ses esprits.
- On peut demander à Simone ! mugit Gargarin qui était arrivé entre-temps, avec les livres oubliés par Amanda.
- Qui est Simone ?
- Simone Voyer, l’ancienne buraliste, elle vit à côté sur la place de l’église. Elle a peur de sombrer dans Alzheimer, la Simone, et passe ses journées à la fenêtre pour apprendre par cœur les plaques des voitures qui passent sous son nez.
- Vite, on file chez elle !
Simone avait aperçu une Peugeot de couleur rouge. Quelqu’un était arrivé en courant, avec une sorte de gros sac dans les bras. Puis l’ombre avait démarré en trombe. La vieille dame avait communiqué le numéro d’immatriculation avec ses deux lettres, ses trois chiffres et ses deux autres lettres. Sitôt dit, sitôt fait. Amanda avait transmis le signalement du véhicule par radio à tous les services de police dans un rayon de cinquante kilomètres. Moins d’une heure après, miracle ! Un appel était arrivé de Lisieux : on avait retrouvé la voiture sur la grande place commerçante, tout près de la cathédrale. A l’intérieur, l’enfant se trouvait seul. Pas trace du conducteur. Où était-il passé ? Faisait-il une course ? Comment agir à cause du petit ? Le chef des policiers avait choisi de sauver le bébé en priorité. Une fois extrait sain et sauf de la voiture, les équipes s’étaient mises en embuscade. Après plusieurs heures de guet, il fallut bien se rendre à l’évidence. Le chauffeur s’était volatilisé. La voiture était volée.
- Deo gratias ! Mathilde avait pleuré de joie.
Le plus important était d’avoir sauvé le bébé. Tant pis pour le ravisseur, même s’il présentait un risque. Après tout, sa mésaventure allait peut-être le dissuader de récidiver ? Il serait toujours temps d’aviser si un autre bébé se faisait enlever. Place à la joie, et aux félicitations ! Si Amanda n’avait pas réagi aussi vite, Dieu sait ce qu’il serait advenu du bébé à cette heure.
- C’est quand même étrange d’abandonner le bébé dans une voiture, vous ne trouvez pas ?
- Le plus étrange, corrigea le père Brun, c’est d’enlever un bébé, vous ne trouvez pas ?
- Oui, vous avez raison.
- A partir du moment où il est capable d’une telle folie, on ne peut pas entrer dans le cerveau de ce type d’individu. On peut tout supposer. S’est-il arrêté à la boulangerie pour acheter du pain, ou alors, a-t-il voulu griller une cigarette, ou encore a-t-il souhaité valider un ticket de pari mutuel pour une course de chevaux ? Allez donc savoir ce qui passe dans la tête d’un tel personnage ! C’est comme vouloir comprendre le mystère des postulats de la physique quantique, ou tenter de résoudre les secrets du Masque de fer ou même percer les raisons qui déterminent les Anglais à manger du plum pudding.
Pour la première fois, depuis l’enlèvement, Amanda s’était surprise à sourire. Le moine, encore une fois, lui arrachait une envie de joie, dans un moment de difficulté.
- Tout au long de ma vie d’enquêtrice, je vis des situations invraisemblables. Si un auteur s’amusait à les raconter dans un roman policier, on jugerait tout simplement qu’il exagère et on penserait qu’il a perdu la tête.
- Parce que, nous autres modernes, avons un rapport faussé avec la vérité.
- Que voulez-vous dire ?
- Nous nous limitons à ne croire que le visible.
- C’est difficile de croire à autre chose.
- Chesterton disait que le roman policier avait remplacé le conte de fées.
- La résolution d’un crime n’a rien d’un conte de fées.
- Il voulait dire que nos esprits sont fabriqués pour des réalités qui dépassent le visible.
- Mais encore ?
- A ses yeux, le roman policier exprime le fantastique et le merveilleux, chassés de nos âmes depuis le triomphe de la raison.
- Fantastique et merveilleux ?
- Dans son esprit, la fiction évoque mieux certaines réalités, auxquelles nous sommes devenus étrangers, parce que notre rapport moderne à la vérité a fermé la porte à l’invisible.
- Je n’imaginais pas qu’on pouvait, dans le domaine de la connaissance, concevoir la fiction supérieure à la vérité, encore moins dans la science policière.
- N’oubliez jamais cette phrase de Mark Twain : « La vérité est plus étrange que la fiction, mais c’est parce que la fiction est obligée de rester dans les limites du possible, et pas la vérité ».
Chapitre 3
La disparition
Cette année-là, l’hiver fut long. Pas froid, mais gris, pluvieux, triste. Le ciel était sale, morne, cendré. Une sorte de lumière blafarde, offensive pour les yeux, changeait la terre en un cachot humide. Certains jours, l’espoir, vaincu, pleurait, la pluie étalait ses immenses traînées. La vie était plus lourde dans les jambes, dans les cœurs. Embrassant tout le cercle de l’horizon, le ciel versait des jours noirs plus tristes que les nuits. Parfois, on ne distinguait pas le ciel de la mer. Tout devenait confusion de gris, chaos de brumes, cohue de brouillards. On ne voyait plus que des ombres. Despotique, atroce, l’angoisse plantait son drapeau noir sur les crânes inclinées. Au loin, les cloches sautaient avec furie pour lancer vers le ciel un affreux hurlement. Tout n’était que vent et pluie. Déprime et grisaille. La nuit, des esprits errants et sans patrie se mettaient à geindre opiniâtrement. Les hommes étaient en proie aux longs ennuis, et l’Espérance, comme une chauve-souris, s’en allait battant les murs de son aile timide. Les femmes se terraient sous les toits. Alors, un peuple muet d’infâmes araignées se cognait la tête à des plafonds pourris, pour tendre ses filets au fond des cerveaux tandis que le déluge imitait les barreaux d’une vaste prison. De longs corbillards, sans tambour ni trompettes défilaient dans les âmes. Sur l’esprit gémissant, le ciel bas et lourd pesait comme un couvercle. C’était le moment de relire Baudelaire.
Quand Ulysse débarque au royaume des Phéaciens, qui vivent à l’écart, au milieu d’une mer houleuse, si loin que nul mortel n’a commerce avec eux, on pourrait croire qu’il arrive en Normandie, pendant un hiver gris et pluvieux. Baudelaire aurait-il connu Honfleur sans le mariage de sa mère, avec le sévère général Aupick, qui fit l’acquisition, dès 1855, d’une maison sur le port, admirablement située, jouissant d’une vue sur l’estuaire, posée sur une terrasse en corniche ? Pas question pour lui de s’y rendre avant la mort de son beau-père, auquel il voue toute sa vie une haine effroyable. Désormais veuve, sa mère se retire dans la Maison Joujou, ainsi surnommée par le poète. Dans un premier temps, il semble décidé à s’y installer, mais ses affaires littéraires et sa vie sentimentale le retiennent à Paris. Et, faut-il le rappeler, Baudelaire qui rêvassait d’azur, de vagues, de splendeurs, d’esclaves nus tout imprégnés d’odeurs, Baudelaire qui songeait d’îles paresseuses, d’arbres singuliers, et de fruits savoureux, Baudelaire qui désirait surtout des langoureux vertiges, des valses mélancoliques et des grands reposoirs, Baudelaire, faut-il le rappeler, détestait le climat normand.
Il faut être née ici, se répétait Amanda, pour supporter un tel hiver, sans joie, sans lumière. Elle se rappela les matins de dimanche, sous la couette, alors que la pluie battait les carreaux et que son envie de rester dormir était plus forte que le désir de vivre. Mais la présence de Lisa, petit être de joie et d’amour, lui réchauffait les entrailles et la poussait à se lever pour préparer un bon petit déjeuner, pourvu de lait chocolaté, de confitures, de brioches et de bon beurre frais d’Isigny. Dans le fond, elle aimait cette atmosphère ouatée, derrière les vitres embuées, une fois qu’elle avait passé le cap de se lever, pour quitter la chaleur de son lit, parce qu’elle avait l’impression de vivre, à la façon de ces bêtes à fourrure, dans une tanière de mousse et de coton. Dans ces doux moments de solitudes matutinales, à l’abri des nuages, des torrents de pluies, soustraite aux caprices de la nature, la jeune femme se sentait plus proche de son enfant, qu’elle venait blottir contre son sein pour la réveiller, de sorte que la petite fille parvenait à s’extraire sans tourment du sommeil, happée par la ferveur du corps maternel. Cependant, malgré ce plaisir, ce sentiment de douceur (trop rares dans la vie humaine) malgré ce moment privilégiée avec ce petit cœur, si précieux en raison de sa carrière professionnelle, malgré ce bonheur exigeant d’élever seule un enfant, la jeune femme préférait la saison des bains de soleil et des bains de mer, en dépit de la présence des touristes et de l’agitation des foules, qui occasionnaient pour la police, pendant tout l’été, regain de vigilance et d’activité.
L’affaire avait fait grand bruit. Elle s’appelait Nora. A peine 19 ans, toute la vie devant elle. Depuis six mois, au Grand Hôtel de Cabourg, la jeune fille poursuivait un apprentissage. Elle disparut un mercredi, son jour de repos. Une semaine après l’incident du bébé de Mathilde. Nora était une fille sans histoire qui travaillait bien. Elle nourrissait un désir profond : devenir gouvernante dans l’hôtellerie de luxe, monter en responsabilité, apprendre, voyager et, pourquoi pas, conquérir le monde ? Pour le moment, elle acceptait de commencer en bas de l’échelle, car sa mère, qui l’avait élevée seule, ne possédait pas les moyens de lui payer des études dans une grande école.
- Un caviar d’aubergine.
- Ou une salade de betteraves râpées.
Dans un bureau du commissariat de Deauville, deux mauvaises langues devisaient, dont l’une appartenait à un officier de police et l’autre à un moine franciscain. Ensemble, ils regardaient les informations sur un écran d’ordinateur. Dans la lucarne, s’agitait un gros visage malencontreusement bien connu, couronné d’un palmier mauve : celui de l’avocate Filembourg.
- Cette disparition est évidemment très inquiétante. Je pense qu’il s’agit d’un crime raciste, contre une jeune beurette !
Amanda serrait les dents.
- Mais comment est-elle arrivée là ? s’enquit le père Brun en désignant du menton la petite lucarne où vociférait avec arrogance l’auxiliaire de justice aux cheveux violacés.
- Avec une association locale antiraciste. Je pense qu’elle a embrouillé la mère, lui faisant promesse de remuer ciel et terre, en travaillant gratis.
- Elle se fait payer par l’association ?
- Je ne sais pas, mais elle en est capable.
Un visage de femme, encore jeune, cheveux noirs et bouclés, apparaissait en larmes sur l’écran de l’ordinateur.
- Rendez-moi ma fille ! Je vous en supplie. Ne lui faites aucun mal !
Les supplications avaient privé le bureau d’oxygène.
- Pauvre femme ! marmonna le moine au cœur serré.
- Oui, c’est terrible, mais pas le temps de s’apitoyer ! Il faut aider les recherches. Le procureur a élargi la zone jusqu’à Donville. Si je vous ai fait venir ici, c’est pour nous donner des idées.
- Des idées ?
- Vous êtes un détective sans égal. Donc, si un indice, un signe, ou le moindre détail vous fait tilt, j’aimerais le savoir.
Le père observa Amanda. Il connaissait bien ce petit pli sur le front entre les sourcils. Quand elle était contrariée, son visage ne pouvait dissimuler son état d’irritation. A n’en point douter, la jeune femme appartenait à ces types d’êtres, taillés d’une seule pièce, ainsi que les chefs d’œuvre de Michel-Ange dans un même bloc de roche. La plupart des humains sont façonnés d’un amas d’étoffes, molles, informes. Flexibles, ductiles, leurs âmes sont malléables comme pâte à modeler. L’élasticité de ces êtres flageolants permet de se conformer aux injonctions de la vie sociale, sans jamais se modifier, comme ces jouets en mousse qui, après avoir subi toute sorte de coups, de torsions ou bien de pressions, retrouvent l’aspect de leur forme initiale. Mais il existe une autre catégorie d’êtres, accomplis dans un matériau plus noble, tel que le marbre ou le cristal, qui ne peuvent jamais subir sans cassure. Ils sont parfois brisés par la puissance des orages mais quand ils résistent à la force des tempêtes, leur âme est trempée d’un acier vigoureux, dont on fait les épées les plus tranchantes.
- De mon côté, reprit la policière, je m’engage à fournir tous les éléments de l’enquête.
Puis, après avoir baissé le ton de sa voix, comme si quelqu’un les écoutait et, après avoir fureté du regard dans tous les recoins :
- Bien entendu, cet accord doit rester secret. Vous savez que vous n’avez aucun droit d’accéder aux éléments du dossier de police.