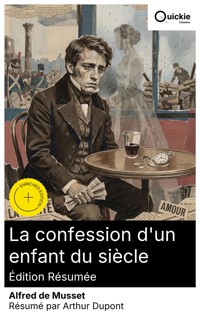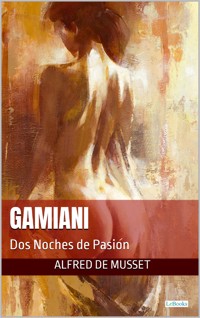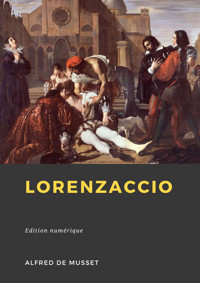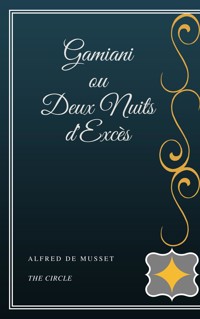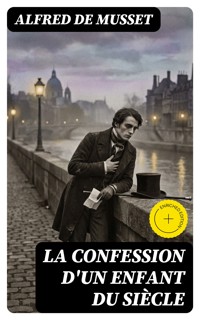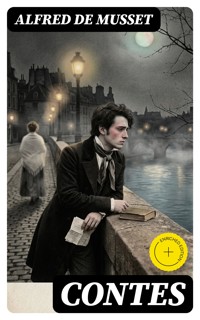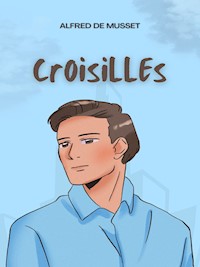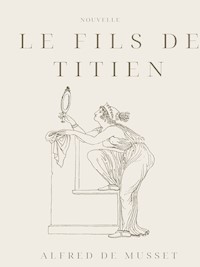
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
A Venise au XVIè siècle, le fils du peintre Titien se perd entre amours sans lendemain, goût du jeu et rêves artistiques. Musset met en scène ses propres dilemmes, et se demande entre autre si l'art vaut la peine qu'on lui sacrifie sa vie ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 74
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Fils de Titien
Le Fils de TitienIIIIIIIVVVIVIIVIIIPage de copyrightLe Fils de Titien
Alfred de Musset
I
Au mois de février 1580, un jeune homme traversait, au point du jour, la Piazetta, à Venise. Ses habits étaient en désordre ; sa toque, sur laquelle flottait une belle plume écarlate, était enfoncée sur ses oreilles. Il marchait à grands pas vers la rive des Esclavons, et son épée et son manteau traînaient derrière lui, tandis que d’un pied assez dédaigneux il enjambait par-dessus les pêcheurs couchés à terre. Arrivé au pont de la Paille, il s’arrêta et regarda autour de lui. La lune se couchait derrière la Giudecca, et l’aurore dorait le palais ducal. De temps en temps une fumée épaisse, une lueur brillante s’échappaient d’un palais voisin. Des poutres, des pierres, d’énormes blocs de marbre, mille débris encombraient le canal des Prisons. Un incendie récent venait de détruire, au milieu des eaux, la demeure d’un patricien. Des gerbes d’étincelles s’élevaient par instants, et à cette clarté sinistre on apercevait un soldat sous les armes veillant au milieu des mines. Cependant notre jeune homme ne semblait frappé ni de ce spectacle de destruction, ni de la beauté du ciel qui se teignait des plus fraîches nuances. Il regarda quelque temps l’horizon, comme pour distraire ses yeux éblouis ; mais la clarté du jour parut produire sur lui un effet désagréable, car il s’enveloppa dans son manteau et poursuivit sa route en courant. Il s’arrêta bientôt de nouveau à la porte d’un palais où il frappa. Un valet, tenant un flambeau à la main, lui ouvrit aussitôt. Au moment d’entrer, il se retourna, et jetant sur le ciel encore un regard :
— Par Bacchus ! s’écria-t-il, mon carnaval me coûte cher.
Ce jeune homme se nommait Pomponio Filippo Vecellio.
C’était le second fils du Titien, enfant plein d’esprit et d’imagination, qui avait fait concevoir à son père les plus heureuses espérances, mais que sa passion pour le jeu entraînait dans un désordre continuel. Il y avait quatre ans seulement que le grand peintre et son fils aîné 0razio étaient morts presque en même temps, et le jeune Pippo, depuis quatre ans, avait déjà dissipé la meilleure part de l’immense fortune que lui avait donnée ce double héritage. Au lieu de cultiver les talents qu’il tenait de la nature et de soutenir la gloire de son nom, il passait ses journées à dormir et ses nuits à jouer chez une certaine comtesse 0rsini, ou du moins soi disant comtesse, qui faisait profession de ruiner la jeunesse vénitienne. Chez elle s’assemblait chaque soir une nombreuse compagnie, composée de nobles et de courtisanes ; là, on soupait et on jouait, et comme on ne payait pas son souper, il va sans dire que les dés se chargeaient d’indemniser la maîtresse du logis. Tandis que les sequins flottaient par monceaux, le vin de Chypre coulait, les œillades allaient grand train, et les victimes, doublement étourdies, y laissaient leur argent et leur raison.
C’est de ce lieu dangereux que nous venons de voir sortir le héros de ce conte, et il avait fait plus d’une perte dans la nuit. Outre qu’il avait vidé ses poches au passedix, le seul tableau qu’il eût jamais terminé, tableau que tous les connaisseurs donnaient pour excellent venait de périr dans l’incendie du palais Dolfino. C’était un sujet d’histoire traité avec une verve et une hardiesse de pinceau presque dignes du Titien lui-même ; vendue à un riche sénateur, cette toile avait eu le même sort qu’un grand nombre d’ouvrages précieux ; l’imprudence d’un valet avait réduit en cendres ces richesses.
Mais c’était là le moindre souci de Pippo ; il ne songeait qu’à la chance fâcheuse qui venait de le poursuivre avec un acharnement inusité, et aux dés qui l’avaient fait perdre.
Il commença, en rentrant chez lui, par soulever le tapis qui couvrait sa table et compter l’argent qui restait dans son tiroir ; puis, comme il était d’un caractère naturellement gai et insouciant, après qu’on l’eut déshabillé, il se mit à sa fenêtre en robe de chambre. Voyant qu’il faisait grand jour, il se demanda s’il fermerait ses volets pour se mettre au lit, ou s’il se réveillerait comme tout le monde ; il y avait longtemps qu’il ne lui était arrivé de voir le soleil du côté où il se lève, et il trouvait le ciel plus joyeux qu’à l’ordinaire. Avant de se décider à veiller ou à dormir, tout en luttant contre le sommeil, il prit son chocolat sur son balcon. Dès que ses yeux se fermaient, il croyait voir une table, des mains agitées, des figures pâles, il entendait résonner les cornets. “Quelle fatale chance ! murmurait-il ; est-ce croyable qu’on perde avec quinze !” Et il voyait son adversaire habituel, le vieux Vespasiano Memmo, amenant dix-huit et s’emparant de l’or entassé sur le tapis. Il rouvrait alors promptement les paupières pour se soustraire à ce mauvais rêve, et regardait les fillettes passer sur le quai ; il lui sembla apercevoir de loin une femme masquée ; il s’en étonna, bien qu’on fût en carnaval, car les pauvres gens ne se masquent pas, et il était étrange, à une pareille heure, qu’une dame vénitienne sortît seule, à pied ; mais il reconnut que ce qu’il avait pris pour un masque était le visage d’une négresse, il la vit bientôt de plus près, et elle lui parut assez bien tournée. Elle marchait fort vite, et un coup de vent, collant sur ses hanches sa robe bigarrée de fleurs, dessina des contours gracieux.
Pippo se pencha sur le balcon et vit, non sans surprise, que la négresse frappait à sa porte.
Le portier tardait à ouvrir.
— Que demandes-tu ? cria le jeune homme ; est-ce à moi que tu as affaire, brunette ? Mon nom est Vecellio, et si l’on te fait attendre, je vais aller t’ouvrir moi-même.
La négresse leva la tête :
— Votre nom est Pomponio Vecellio ?
— Oui, ou Pippo comme tu voudras.
— Vous êtes le fils du Titien ?
— À ton service ; qu’y a-t-il pour te plaire ?
Après avoir jeté sur Pippo un coup d’œil rapide et curieux, la négresse fit quelques pas en arrière, lança adroitement sur le balcon une petite boîte roulée dans du papier, puis s’enfuit promptement, en se retournant de temps en temps. Pippo ramassa la boîte, l’ouvrit et y trouva une jolie bourse enveloppée dans du coton. Il soupçonna avec raison qu’il pouvait y avoir sous le coton un billet qui lui expliquerait cette aventure. Le billet s’y trouvait en effet, mais était aussi mystérieux que le reste, car il ne contenait que ces mots : “Ne dépense pas trop légèrement ce que je renferme ; quand tu sortiras de chez toi, charge-moi d’une pièce d’or, c’est assez pour un jour ; et s’il t’en reste le soir quelque chose, si peu que ce soit, tu trouveras un pauvre qui t’en remerciera.” Lorsque le jeune homme eut retourné la boîte de cent façons, examiné la bourse, regardé de nouveau sur le quai, et qu’il vit enfin clairement qu’il n’en pourrait savoir davantage : “Il faut avouer, pensa-t-il, que ce cadeau est singulier, mais il vient cruellement mal à propos.
Le conseil qu’on me donne est bon ; mais il est trop tard pour dire aux gens qu’ils se noient, quand ils sont au fond de l’Adriatique. Qui diable peut m’envoyer cela ?” Pippo avait aisément reconnu que la négresse était une servante ; il commença à chercher dans sa mémoire quelle était la femme ou l’ami capable de lui adresser cet envoi, et, comme sa modestie ne l’aveuglait pas, il se persuada que ce devait être une femme plutôt qu’un de ses amis. La bourse était en velours brodé d’or ; il lui sembla qu’elle était faite avec une finesse trop exquise pour sortir de la boutique d’un marchand. Il passa donc en revue dans sa tête d’abord les plus belles dames de Venise, ensuite celles qui l’étaient moins ; mais il s’arrêta là, et se demanda comment il s’y prendrait pour découvrir d’où lui venait sa bourse. Il fit là-dessus les rêves les plus hardis et les plus doux ; plus d’une fois il crut avoir deviné ; le cœur lui battait, tandis qu’il s’efforçait de reconnaître l’écriture ; il y avait une princesse bolonaise qui formait ainsi ses lettres majuscules, et une belle dame de Brescia dont c’était à peu près la main.
Rien n’est plus désagréable qu’une idée fâcheuse venant se glisser tout à coup au milieu de semblables rêveries ; c’est à peu près comme si, en se promenant dans une prairie en fleurs, on marchait sur un serpent.
Ce fut aussi ce qu’éprouva Pippo lorsqu’il se souvint tout à coup d’une certaine Monna Bianchina, qui depuis peu le tourmentait singulièrement. Il avait eu avec cette femme une aventure de bal masqué, et elle était assez jolie, mais il n’avait aucun amour pour elle.
Monna Bianchina, au contraire, s’était prise subitement de passion pour lui, et elle s’était même efforcée de voir de l’amour là où il n’y avait que de la politesse ; elle s’attachait à lui, lui écrivait souvent, et l’accablait de tendres reproches ; mais il s’était juré un jour, en sortant de chez elle, de ne jamais y retourner, et il tenait scrupuleusement sa parole.